
Alfred de Bréhat (Alfred Guezenec)
LES AVENTURES DE CHARLOT
Table des matières
CHAPITRE I La famille Morand. – Charlot. – Kéban le bélier................................. 6
CHAPITRE II Fanchette. – Le festin improvisé. – Mésaventure de Charlot........ 15
CHAPITRE III Le matelot. – Les jouets. – Les crêpes. – On va au secours de Charlot. 26
CHAPITRE IV Délivrance de Charlot. – Les exploits de Jobic. – Deux bains dans la mare. 35
CHAPITRE V Les bons cœurs. – Promesses de Jobic. – Le départ pour la pêche. 44
CHAPITRE IX Le trousseau de Charlot. – Les adieux. – Le cœur d’une mère... 86
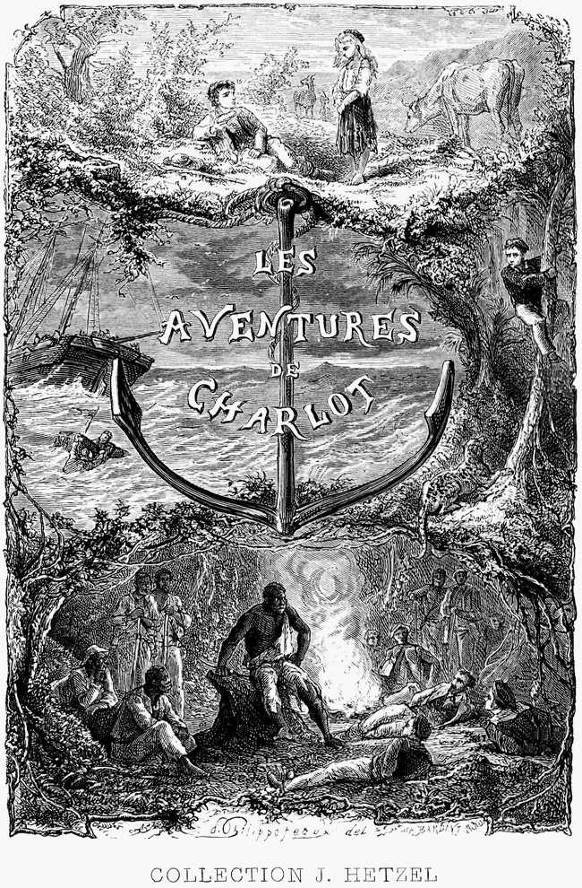

CHAPITRE I – La famille Morand. – Charlot. – Kéban le bélier.
Après avoir fait son temps de service à bord des navires de l’État, Antoine Morand était revenu dans son pays breton, au petit bourg de Lanmodez et à la chère demeure où s’était écoulée son enfance. Lanmodez est situé près de la mer. Une quarantaine de maisons groupées autour de l’église, quelques cabanes de pêcheurs couvertes en chaume, faites en bouzillage (mélange de terre glaise et d’herbe hachée), composent la commune. Dans l’unique chambre de ces cabanes, chaque lit forme un petit appartement. Ils sont en noyer ou en chêne et fermés comme des armoires. Les deux battants sont pourvus d’un volet de bois qui s’ouvre la nuit pour donner de l’air au dormeur. Enfin l’on y parvient en gravissant deux ou trois marches dont chacune renferme un tiroir. Si l’aisance est au logis, ces tiroirs sont remplis de gros linge solide, solidement cousu, d’habits de drap portés aux grandes fêtes depuis trois générations, de coiffes brodées par les arrière-grand’mères.
Chez Antoine, il en était ainsi. De plus, il possédait un petit jardin, une vache et deux chèvres ; sa barque était citée parmi les meilleures ; lui-même était regardé comme un habile pêcheur et un honnête garçon. Quand il eut épousé sa promise Marianne, qui l’attendait depuis huit ans, il se trouva plus heureux qu’un roi.
Bientôt la famille s’augmenta. De petites têtes blondes, des joues rouges comme des pommes d’api apparaissaient dans les grands lits. Ce fut d’abord Charlot, un gros gars qui à trois ans courait tout seul ; vinrent ensuite Denise, puis Rosalie, et dans tous les coins du jardin, de la rue, sur la grève et dans les rochers se traînaient et trottaient les trois marmots. Leurs petites voix emplissaient de bruit la maison. On admirait leur force, et les vieillards avouaient qu’ils n’avaient pas vu souvent de si beaux enfants.
Aussi, lorsqu’après une dure journée de travail, Antoine revenait chez lui le soir, au milieu de la pluie, de la neige ou du vent, il ne sentait point la fatigue ; mais son cœur battait de joie dès qu’il apercevait de loin une petite lumière tremblante qui lui souhaitait la bienvenue. – Arrive, disait-elle, on t’attend. Le fagot est préparé pour être jeté dans le feu et flamber gaiement quand tu entreras. Ta chaise est à sa place. Les petits sont à la fenêtre et te cherchent dans l’obscurité. Ta femme s’inquiète, et le vieux voisin, à demi endormi au coin de l’âtre, lève parfois la tête pour demander si tu es là.
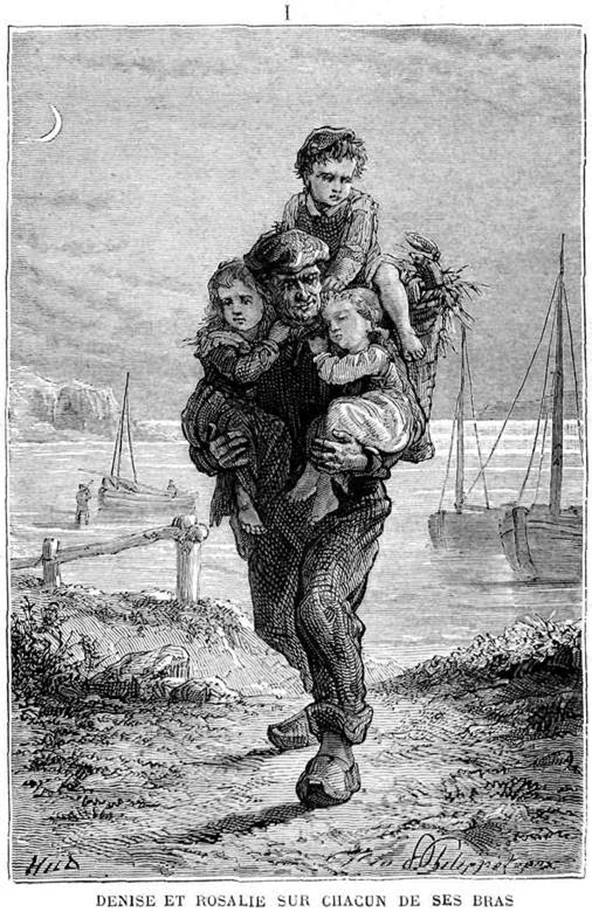
Plus tard, les enfants, devenus grands, s’en allaient ensemble au devant de leur père quand il revenait de la pêche. Denise et Rosalie prenaient place sur chacun de ses bras. Charlot, à cheval sur son cou, au-dessus de la hotte remplie de poisson, babillait avec Denise, en se retournant quelquefois pour surveiller une pince de homard ou une gueule de chien marin dont le voisinage lui semblait inquiétant pour le fond de ses culottes.
Au moment où commence notre histoire, Charlot avait neuf ans. Il était très fort pour son âge, mais, en revanche, si lourd et si pataud, comme disent les paysans, qu’on lui avait donné le sobriquet de l’Endormi. Il mangeait beaucoup, travaillait peu et ne réfléchissait pas du tout. Par ailleurs c’était un bon enfant, aimant ses parents, point menteur, incapable de faire volontairement du mal à quelqu’un. Son rêve était d’être marin. En attendant, il nageait comme un poisson, grimpait comme un écureuil et ne craignait rien, si ce n’est la malice de sa sœur Denise.
Celle-ci était, à sept ans, mignonne, presque délicate pour une enfant bretonne. Mais elle savait déjà coudre et tricoter, elle aidait sa mère dans les soins du ménage, et elle trouvait encore le temps de jouer à son frère aîné cent tours qui lui faisaient voir combien la faiblesse peut l’emporter sur la force. Charlot enrageait et se tourmentait la cervelle pour être habile ; mais jamais il n’obtenait les honneurs de la guerre. D’ailleurs, s’il se fâchait, Rosalie se mettait de la partie. Elle avait quatre ans, elle trottait comme personne et formait une alliée tout à fait redoutable, car, tandis que de ses petits bras elle attaquait vigoureusement son frère, celui-ci s’efforçait de la convaincre par la seule force du raisonnement. Il n’obtenait rien qu’un succès de fou rire ; lui-même s’y laissait gagner ; tout finissait gaiement, mais Charlot comptait chaque fois une défaite de plus.
Comme il grandissait, on l’avait nommé pâtre de la vache, des deux chèvres et d’un bélier, nouveau commensal du logis, et on lui avait adjoint, en qualité d’auxiliaire, un grand chien noir à museau pointu nommé Kidu, mot qui signifie chien noir en breton. À Lanmodez on ne parle que le breton, qui est l’ancienne langue des Celtes, premiers habitants du pays.
Kidu et Charlot étaient grands amis. Tous deux avaient un faible pour le bélier, qui s’appelait Kéban et qui était bien la bête la plus malicieuse et la plus fantasque que l’on pût voir. Mais il avait de l’esprit, il intriguait pour attraper du sel, et sa part était presque toujours plus grosse que celle des autres. Cela n’était pas juste ; aussi Charlot regrettait sa partialité quand il voyait Kéban, plus insoumis que jamais, répondre à ses appels en lui tournant le dos, lui montrer les cornes et se livrer à mille cabrioles ironiques si Kidu allait le relancer. Malheureusement, Kidu et Charlot s’amusaient de ces tours, et le bélier ne s’amendait point.
Un matin, comme Antoine allait partir pour la pêche, il vit au fond du lit de son garçon deux grands yeux tout ouverts et brillants comme des étoiles.
« Déjà éveillé, dit le père.
– Emmène-moi, demanda l’enfant. Je conduirai le bateau avec toi.
– Grand merci ! dans quatre ou cinq ans j’accepterai tes services, mais aujourd’hui je ne puis t’enrôler que pour m’aider à porter mes filets jusqu’à la grève. Si cela te va, lève-toi. »
Charlot fut bientôt prêt. Le père et le fils s’en allèrent ensemble et furent rejoints par deux autres pêcheurs, compagnons accoutumés d’Antoine. Ils trouvèrent la barque ensablée ; on la mit à flot au moyen de roulots passés sous la quille, et elle se balança coquettement tandis qu’on préparait ses voiles.
« Vois-tu bien, dit l’un des pêcheurs à notre ami, les grands bâtiments ont trois mâts : à l’avant celui de misaine[1], à l’arrière celui d’artimon[2], au milieu le grand mât, le seul que nous possédions. Cette barre de bois transversale à laquelle est adaptée la voile nous a servi à la carguer (rouler) ; maintenant elle nous aidera à la hisser. Retiens tout cela, si tu veux être marin.
– Certainement je serai marin, dit Charlot. Je sais déjà bien des choses. Voulez-vous que je vous dise comment on appelle l’avant de la barque ? C’est la proue ; et de l’autre côté c’est la poupe. Voici tribord à droite et bâbord à gauche.
– L’enfant n’est point sot, » dirent les pêcheurs.
Et Antoine sourit avec fierté.
« Emmène-moi, je t’en prie, » continua Charlot s’adressant à son père.
Mais celui-ci lui rappela ses devoirs de pâtre. Que penseraient Kéban, Kidu, la vache noire et les deux chèvres s’ils ne le voyaient pas de la journée ? Et les pêcheurs ne rentreraient que le soir ; encore était-ce par exception, car souvent ils restaient absents deux ou trois jours. Ce n’était pas la petite Rosalie qui mènerait les bêtes au pâturage, elle qui avait si peur du bélier. Denise était occupée à la maison ; chacun avait sa tâche, il fallait que Charlot remplît la sienne. Il se résigna donc en soupirant, et quand l’embarcation se fut éloignée, il reprit le chemin du logis.
Il vit en arrivant Rosalie grimpée sur le banc près de la porte, en train de manger une énorme tartine de lait caillé. Quatre ou cinq poulets piaillaient autour d’elle et réclamaient leur part du régal ; ils poussaient même l’indiscrétion jusqu’à la chercher dans la petite main de l’enfant, quand elle se rencontrait à portée de leur bec. C’est pourquoi elle s’était perchée un peu haut et tenait sa tartine en l’air. Chaque fois qu’elle l’abaissait pour y mordre, elle en détachait cependant quelques miettes et les jetait au peuple vorace.
Notre ami, voyant cette tartine, ce lait et les petites dents blanches de sa sœur qui brillaient au travers, pressa le pas et entra dans la chaumière.
« Je savais bien que Charlot ne manquerait pas l’heure du déjeuner ! s’écria Denise.
– Jamais ! » dit Charlot, qui n’était point honteux de ses opinions.
Il suivit sa mère vers le bahut et la vit couper une superbe tranche de pain de toute la longueur de la miche. Elle étendit là-dessus du lait caillé, tandis que l’Endormi, très éveillé cette fois, ouvrait la bouche à l’avance. Quand la tartine fut entre ses mains, il y mordit si vivement qu’il se barbouilla le nez jusqu’aux sourcils. Sa mère, pour l’embrasser, fut obligée de refaire une place nette sur sa bonne figure.
« Maintenant, dit-elle, va détacher les bêtes ; voilà Kidu qui s’impatiente. »
En effet, le chien sautait autour de son maître, jappait et lui rappelait clairement qu’il était temps de partir. Charlot, que sa bouche pleine empêchait de parler, fit à Denise un signe de tête en guise d’adieu et sortit.
Malheureusement pour lui, il n’était pas le seul qui eût bon appétit ce matin-là. Dans l’étable on mourait de faim. Kéban avait déjà donné dans la porte force coups de cornes. Les chèvres, plus patientes, s’agitaient cependant, et la vache elle-même, si calme d’ordinaire, avait poussé de longs cris d’appel.
Quand l’Endormi, qui ne se pressait jamais, eut ouvert à demi la porte aux prisonniers, Kéban se précipita dehors si impétueusement qu’il l’envoya rouler à quelques pas sur le fumier. La tartine vola d’un autre côté. Charlot se releva furieux et voulut punir le coupable ; mais les poules, bêtes vigilantes, s’étaient aperçues de l’accident et couraient vers la tartine ; il fallait aller au plus pressé. Charlot ressaisit d’abord son déjeuner et se calma un peu en voyant que le lait était resté en dessus. Kidu courut après le bélier et lui mordit les jambes pour lui apprendre la politesse. Kéban n’en trotta que plus vite en faisant sonner sa sonnette. Les chèvres suivirent, et la vache, que tous ces incidents avaient laissée indifférente, continua de marcher d’un pas lourd et cependant rapide, pressée qu’elle était d’arriver au pâturage.
Le petit pâtre, pour ne pas rester seul, dut prendre le même chemin que ses bêtes. Il savait que Kéban courait plus vite que lui, et Kéban le savait aussi. Dans ces conditions, l’indulgence était de rigueur.
Dix minutes plus tard, il était assis sur un tas de pierres, au bord du chemin qui conduisait du village à la grève.
La vache que Marianne avait nommée Bellone, en souvenir de la frégate sur laquelle Morand avait fait son temps de service, s’était installée au beau milieu d’une douve profonde. Elle tondait l’herbe qui en garnissait les bords et guignait de l’œil certaine brèche donnant sur un beau champ de trèfle. Brunette, la chèvre noire, avait grimpé sur le revers du talus, au milieu des épines. Kéban et l’autre chèvre cherchaient aussi leur vie sur le bord du chemin, surveillés par Kidu, qui les empêchait de s’écarter.
CHAPITRE II – Fanchette. – Le festin improvisé. – Mésaventure de Charlot.
On était aux premiers jours du mois de mai. Le soleil s’était levé en laissant à l’horizon de grandes traces rougeâtres. La grive s’éveillait et lançait dans l’air ses premières notes fraîches et un peu perçantes, comme la brise qui les portait. Les fleurs d’or des genêts étaient encore couvertes de rosée. Le bruit lointain des vagues, les clochettes des animaux troublaient seuls le grand silence des champs.
Nonchalamment assis, Charlot, sa tartine à la main, mangeait lentement, se dandinait, presque sommeillant et tout pénétré du plaisir de vivre. Comme il était dans cette heureuse disposition d’esprit, une petite fille de six à sept ans vint à passer. Elle était vêtue d’une robe trouée, ses pieds étaient nus, ses cheveux s’échappaient ébouriffés d’un petit bonnet noir. Elle s’arrêta devant le pâtre, la tête basse, et ses yeux, deux grands yeux noirs attristés, regardaient en dessous la tartine de lait caillé.
« Tu manges, toi ! » murmura-t-elle en essuyant une larme qui roulait sur sa joue pâle.
Nous sommes obligés de convenir que le premier mouvement de Charlot fut de mettre son morceau de pain à l’abri. La petite fille, comprenant ce geste, soupira et fit un mouvement pour s’éloigner.
« Je ne suis pas une voleuse, dit-elle en même temps.
– Écoute ! » lui cria Charlot déjà revenu à sa bonté naturelle.
Elle se retourna.
« Où est-ce que tu vas ? (Il avait ouvert son petit couteau d’un sou et l’agitait avec l’air indécis qui lui était habituel.)
– Je vais au village.
– Faire quoi ?
– Demander la charité.
– Ta mère ne t’a donc rien donné à déjeuner ce matin ?
– Je n’ai ni père, ni mère. »
Et la petite se mit à pleurer.
« Tiens ! » dit Charlot attendri eu coupant la moitié de son pain qu’il tendit à la mendiante. Seulement il garda le morceau où était le lait caillé.
« Comment est-ce que tu t’appelles ? reprit-il, tandis que la petite mangeait.
– Fanchette. Et toi ?
– Charlot. »
Fanchette s’assit à côté de lui.
« Tu es bon, dit-elle, merci.

– Tiens ! » fit encore Charlot, touché de cette parole.
Et par un mouvement majestueux, il mit la moitié de son lait caillé sur le pain de la mendiante.
Cette fois, sa conscience lui disant qu’il avait complètement rempli son devoir, il se sentit le cœur tout joyeux.
« C’est bon, hein ? dit-il à Fanchette.
– Oh ! oui, » répondit-elle.
Mais elle grelottait.
« Est-ce que tu as froid ?
– Un peu.
– C’est drôle. Moi je n’ai pas froid.
– Tu as une grosse veste de drap, et je n’ai qu’une jupe et un casaquin de toile ; encore il est tout percé.
– Si tu veux, nous allons faire un trou dans le talus et nous y allumerons du feu. »
La pauvre Fanchette ne demandait pas mieux.
« Ce sera bien amusant, dit-elle.
– Toi, tu vas chercher du bois ; moi, je ferai le trou.
– Avec quoi ?
– Avec mon couteau donc ! c’est mon père qui me l’a acheté au Pardon (fête patronale) de Pleumeur. »
Ranimée par le repas qu’elle venait de faire, Fanchette ramassa quelques branches mortes. Pendant ce temps, Charlot travaillait à creuser une petite excavation sur le revers du talus, à l’endroit où il n’y avait point d’herbe.
« Oui, mais comment allons-nous allumer notre feu ? demanda la petite.
– Tu vois bien la cheminée qui est là-bas ! Eh bien, c’est la ferme à Yvan Kernosie ; il faut y aller chercher du feu dans ton sabot.
– Je n’ai pas de sabots.
– Pourquoi ça ?
– Dam ! parce que je n’ai pas de quoi en acheter.
– Prends le mien alors, » dit Charlot.
La petite se mit à courir vers la ferme de toute la vitesse de ses jambes affaiblies par de longs jours de jeûne et de misère. Elle revint bientôt, rapportant dans le sabot de Charlot un peu de braise recouverte de cendres.
« Les vilaines gens ! dit-elle en versant la braise dans le trou qu’avait creusé le petit garçon. Ils m’ont reçue quasiment comme un chien. »
Cela étonna un peu notre ami, car il n’y a pas de pays où l’on accueille les pauvres d’une façon plus hospitalière qu’en Bretagne. Il savait d’ailleurs par expérience qu’Yvan Kernosie était un excellent homme.
« C’est drôle, » dit-il en soufflant de toute la force de ses poumons.
Au bout de quelques minutes, les branches s’enflammèrent en lançant de brillantes étincelles.
« Chauffe-toi, dit Charlot en poussant la petite vers le foyer. Hein, comme je fais bien le feu ? C’est Alain, le fils du fermier, qui m’a montré.
– Où demeures-tu ? demanda Fanchette en étendant ses mains devant la flamme.
– Tu vois bien la fumée qui monte-là bas ? eh bien, ma maison est au-dessous. Et toi, où est la tienne ?
– Je n’ai pas de maison.
– Où couches-tu ?
– Dans les champs.
– Et pour dîner ?
– Je mange n’importe où… quand j’ai de quoi manger.
– Oh ! fit Charlot tout songeur.
– À quoi penses-tu ? demanda la petite.
– Écoute : à midi j’irai dîner. Tu viendras avec moi, et ma mère te donnera du pain et du lait… peut-être aussi des coques (sorte de coquillage).
– Elle ne me renverra pas ? murmura Fanchette d’un ton craintif.
– Oh ! non ; jamais on ne renvoie les pauvres chez nous. Un jour Kidu… c’est mon chien… Kidu avait mordu un pauvre, et ma mère l’a battu. Kidu, en se sauvant, a marché sur les petits de notre chatte qui l’a griffé… Kidu faisait une drôle de grimace en se frottant le museau ! »
Charlot se mit à rire en se rappelant la grimace de Kidu. Et le chien, qui avait entendu son nom, s’approcha en frétillant et vint appuyer sa bonne grosse tête sur les genoux du petit garçon.
Tandis que les deux enfants le caressaient en souriant, un fermier du voisinage, qui se rendait au marché, vint à passer près d’eux.
« Qu’est-ce que tu fais là, mon gars ? dit-il à Charlot qu’il connaissait.
– Je chauffe la petite fille que voilà, répondit Charlot.
– C’est bien, mon ami. Tiens, fourre ça dans le feu pour t’amuser, reprit le brave homme en tirant de son panier cinq ou six grosses pommes de terre.
– Merci, merci, Pierre ! » s’écria Charlot, joyeux de cette aubaine inattendue.
Il glissa les pommes de terre dans son petit four et les recouvrit de cendre sur laquelle il entassa de la braise.
Tandis qu’elles cuisaient ainsi, on reprit l’entretien. Charlot, tout entier à la cuisine et à la conversation, oublia de veiller sur ses animaux. Bellone, la belle vache blanche, venait de franchir la brèche qui la séparait du champ voisin, et Brunette, la chèvre noire, forçant le rempart d’ajoncs épineux, était en train de brouter les jeunes pousses d’un arbre. Cependant Kidu, assis près de son maître, et en apparence aussi intéressé que lui par ce qui se disait, ne voyait rien.
Cette négligence pouvait avoir des suites d’autant plus fâcheuses pour les oreilles du jeune Charlot, que la ferme voisine avait changé de maître depuis la veille. Un homme du pays de Langounec, avare et dur, avait remplacé Kernosie de qui Charlot connaissait l’indulgence. Il causait donc toujours et questionnait sa petite compagne avec une hardiesse de curiosité qu’on pardonne à des enfants, mais qu’on blâmerait chez de grandes personnes.
« D’où viens-tu ? demandait-il.
– De Louannec.
– Que faisait ton père ? Le mien va à la pêche.
– Je n’ai connu ni mon père ni ma mère. La vieille Marguerite m’a dit qu’ils étaient morts dans un naufrage.
– Qu’est-ce que c’est que la vieille Marguerite ?
– C’est une pauvre femme de Louannec qui m’a recueillie et qui me donnait à manger.
– Elle n’est pas avec toi ?
– Elle est morte aussi il y a huit jours, murmura Fanchette en essuyant une larme.
– Ah ! fit Charlot. » Puis il ajouta philosophiquement : « Dis donc, il n’y a plus de bois.
– Elle me battait souvent, continua Fanchette tout entière à ses souvenirs, mais c’était quand elle avait bu trop de cidre.
– Alors il ne faut pas la pleurer, dit Charlot, puisqu’elle te battait… Il n’y a plus de bois, dis donc.
– Je l’aimais tout de même, la pauvre Marguerite, car elle n’était pas méchante au fond. Et puis c’est si triste d’être toute seule !
– On s’ennuie, c’est vrai… Il n’y a plus de bois. »
Fanchette se leva et passa dans le champ voisin pour ramasser encore quelques branches mortes.
« Oh ! mon Dieu, dit-elle en revenant tout à coup, ta vache est au milieu du trèfle !
– Et les chèvres ? » s’écria Charlot en regardant avec inquiétude.
Les chèvres avaient aussi pénétré dans le champ. Charlot et Kidu se mirent à courir pour rappeler les vagabonds, et Fanchette les suivit. Malheureusement il était déjà trop tard. Un grand garçon d’une vingtaine d’années, au visage dur et brutal, arrivait, un gros bâton à la main. Il commença par en caresser rudement les côtes de Mme Bellone, dont la gourmandise fut ainsi punie. Puis, apercevant le pauvre Charlot, il courut à lui, le saisit par le collet de sa veste et le battit sans plus de ménagement que s’il avait eu affaire à un garçon de son âge. Il est vrai que Charlot lui avait répondu assez vertement ; mais ce n’était pas un motif pour abuser de sa force contre un enfant. Kéban le jugea sans doute ainsi, car, prenant son élan, il se précipita contre le butor et lui asséna un si violent coup de cornes dans les jambes qu’il le fit tomber sur le nez. Le petit pâtre voulut profiter de l’occasion pour s’enfuir, mais le paysan furieux le rattrapa. Alors Fanchette, faible comme elle était, vint bravement au secours de son nouvel ami. Mal en prit à la pauvre enfant ; elle reçut un coup qui la renversa.
« Ah ! petit drôle, s’écriait le méchant paysan, qui était le fils du fermier, c’est ainsi que tu laisses tes bestiaux s’engraisser à mes dépens. Je t’apprendrai à veiller sur eux !
– Laissez-le, s’écriait Fanchette en pleurant, il ne le fera plus. »
Charlot ne disait rien. Fier déjà comme un petit breton qu’il était, il ne voulait point demander grâce. Cependant il avait grand’peur et tremblait de tous ses membres, quand le paysan, le jetant sous son bras comme un paquet de chanvre, l’emporta vers la ferme.
Sur ces entrefaites, Kidu ayant ramené les chèvres, apparut sur le champ de bataille. Comme le bélier, il s’élança au secours de son maître et mordit si vigoureusement les mollets de l’ennemi que celui-ci poussa un cri de détresse.
Malheureusement pour Charlot, les tentatives de Kéban et de Kidu ne firent qu’augmenter la colère du brutal Mathurin qui frappa de nouveau le pauvre enfant.
« Je vais te renfermer dans le cellier, lui dit-il ; tu y resteras jusqu’à demain matin sans boire ni manger et sans voir clair. Si tu cries, je te fouetterai ; donc, tais-toi ou je tape ! »
Tout en parlant, il s’acheminait vers la ferme, suivi de Fanchette, de Kidu et de Kéban, qui trottinaient par derrière, à distance respectueuse toutefois du bâton de Mathurin.
Au moment d’être enfermé, Charlot fit une tentative désespérée pour se sauver, mais il n’y gagna que des taloches. Le paysan, qui se trouvait seul à la ferme en ce moment, le poussa dans le cellier et ferma la porte à clé. Puis, détachant son chien de garde, il le lança contre le pauvre Kidu.
Bien qu’il fût de moitié moins gros que le dogue de Mathurin, Kidu se défendit avec courage. Il finit cependant par rouler sous son adversaire qui le mordit cruellement, aux grands éclats de rire du paysan. Notre pauvre ami chien se serait fait tuer sur place si Fanchette n’était parvenue à l’emmener.
Se rappelant que la maison de Charlot était au-dessous de la petite colonne de fumée qu’on voyait à peu de distance, elle se mit à courir dans cette direction. Kidu, devinant sa pensée, la suivit. En voyant partir Kidu, qu’ils regardaient comme le lieutenant de leur maître, la vache blanche, les deux chèvres et le bélier se mirent aussi en marche pour retourner au logis.
CHAPITRE III – Le matelot. – Les jouets. – Les crêpes. – On va au secours de Charlot.
Peu de temps après le départ de Charlot pour les champs, un homme à cheval s’était arrêté devant la chaumière des Morand. Sa monture était une de ces bêtes de louage comme on en trouvait partout autrefois en Bretagne, et qui, malgré leur chétive apparence, font quinze à vingt lieues dans la journée et recommencent le lendemain. Un gamin d’une douzaine d’années suivait le cavalier, afin de ramener l’animal à son propriétaire. Que le cheval trotte ou galope, le pauvre diable ne le quitte pas. Je vous laisse à juger du mal et de la fatigue qu’il se donne pour gagner cinq ou six sous, juste de quoi ne pas mourir de faim.
« N’est-ce pas ici que demeure Antoine Morand, ma petite fille ? demanda l’étranger à Denise, qui lavait des coquillages devant la porte.
– Oui, monsieur.
– Est-il là ?
– Non, monsieur.
– Et sa femme ?
– Elle est dans la maison.
– Tu es leur fille, n’est-ce pas ? reprit le voyageur, qui débouclait les courroies d’un sac de marin attaché sur la croupière de la selle en guise de portemanteau.
– Oui, monsieur ; mon père est à la pêche.
– Mon mari reviendra probablement ce soir, dit Marianne, qui était arrivée au bruit.
– Tant mieux ! s’écria joyeusement le nouveau venu. Je suis Jobic Letallec, et j’étais avec lui.
– À bord de la Bellone, interrompit Marianne ; oh ! il nous a parlé de vous bien souvent.
– Vrai ?
– Oui, dit la petite Denise, c’est bien vrai ; l’autre jour encore, il a bu à votre santé.
– Soyez le bienvenu chez nous, » reprit la mère.
Le matelot jeta la bride du cheval au gamin qui l’accompagnait et embrassa cordialement son hôtesse. Pendant ce temps, Denise s’était emparée du sac du marin et cherchait à le soulever.
« C’est trop lourd pour toi, ma petite, dit le matelot en souriant. Comment t’appelles-tu ?
– Denise, monsieur.
– Eh bien, Denise, tu es très gentille, veux-tu m’embrasser ? »
Denise lui tendit ses joues fraîches et rosées.
« Et toi, petite joufflue ? » demanda-t-il en s’avançant vers Rosalie qui, cachée derrière sa mère, dont elle tenait le tablier, regardait curieusement le nouveau venu.
Rosalie était un peu sauvage. Elle se mit à crier. Mais sa sœur l’apaisa en lui parlant tout bas et la poussa doucement vers le matelot.
Jobic saisit à l’improviste la petite effarouchée. Elle poussa un cri de frayeur.
« Oh hisse ! » dit le matelot en l’installant sur son épaule.
En même temps il riait d’un si bon cœur que Rosalie fut promptement rassurée. Cinq minutes après, elle était encore perchée sur l’épaule de son nouvel ami.
Pendant ce temps, Marianne et Denise avaient mis sur la table un pot de cidre, du beurre et une miche de pain bis. Sur l’invitation cordiale de Marianne, le gardien du cheval était aussi entré dans la chaumière. On lui versa deux grandes bolées (chopines) de cidre, et Denise lui coupa un gros morceau de pain. Tandis qu’il beurrait son énorme tartine avec le recueillement que les paysans bretons mettent à cette opération, Jobic Letallec lui paya le prix fixé pour la location du cheval, et lui donna de plus un bon pourboire. Presque tous les marins sont généreux, et malgré son air brusque, sa grosse voix et sa vivacité, Jobic ne faisait pas exception à la règle.
Quand le gamin se remit en route, Marianne lui donna un second morceau de pain, et le pauvre petit s’éloigna tout joyeux en appelant les bénédictions du ciel sur cette maison hospitalière.

« Je croyais que vous aviez trois enfants, dit Letallec à son hôtesse, qui s’occupait déjà des préparatifs du dîner, – car en Bretagne on dîne à midi.
– Mon fils est sorti avec nos bestiaux, répondit Marianne.
– Il reviendra pour dîner ?
– Oh oui ! dit-elle en riant. Il n’oublie jamais ce moment-là, je vous assure.
– C’est qu’en passant par Plendaniel où il y avait une foire, j’ai acheté quelques babioles aux enfants. Je voudrais qu’ils fussent tous là pour faire ma distribution.
– Oh ! fais voir, monsieur ! » s’écria Rosalie en se trémoussant de joie sur l’épaule du matelot.
Et, leste comme un écureuil, la petite curieuse se laissa glisser à terre.
« Il faut attendre Charlot, » dit Marianne.
Les marins ont un grand faible pour les enfants. Le bon Jobic ne put résister aux câlineries de Rosalie, ni à la muette prière des yeux de Denise. Il ouvrit une boîte et en tira divers jouets qu’il distribua aux deux petites filles.
« Merci, merci, monsieur Jobic ! » disait Denise toute radieuse.
Rosalie, une poupée dans les bras, sautait comme une biche, embrassait Letallec, courait à sa mère, embrassait Denise, revenait au marin et ne pouvait tenir en place.
Jobic riait de bon cœur.
« Qu’est-ce que tu regardes ? demanda-t-il à Denise qui jetait un coup d’œil curieux au fond de la boîte.
– Est-ce qu’il y a quelque chose pour Charlot ?
– Qu’est-ce que c’est que Charlot ?
– Mon frère, monsieur Jobic.
– Pourquoi me demandes-tu cela ?
– Pour lui laisser sa part.
– Eh bien, tu as un bon petit cœur, toi, s’écria Jobic ; mais sois tranquille, le gars n’a pas été oublié.
– Demande à maman qu’elle fasse des crêpes, dit mystérieusement à l’oreille du marin Rosalie, qui semblait depuis quelques minutes ruminer un projet dans sa tête.
– Pourquoi ? répondit-il sur le même ton.
– C’est bon ; les sucrées surtout, ça te fera plaisir.
– Et à toi ?
– À moi aussi, tiens ! »
Marianne avait prévenu le désir de sa fille. Seulement, comme les Morand n’étaient pas assez riches pour se permettre des crêpes sucrées aussi fréquemment que l’aurait voulu la généreuse hospitalité de Rosalie, elle se préparait à faire des galettes de blé noir ou sarrazin.
Une brassée d’ajoncs bien secs fut jetée sur l’âtre et flamba joyeusement. Denise prit la galetière, large disque en fer, armé d’un anneau qui sert à le suspendre. Tandis qu’elle en frottait la surface avec un peu de beurre pour empêcher la galette (ou crêpe non sucrée) de s’y attacher, la mère achevait de délayer la pâte dans une vaste terrine.
Quand cette pâte, ou, pour mieux dire, cette bouillie liquide fut à point, Marianne en remplit une petite tasse en fer-blanc destinée à cet usage et la versa sur la galetière. La pâte, étendue par sa main habile, formait un rond presque parfait. Colorée par la chaleur du feu ainsi que par le beurre dont la galetière était enduite, elle prit bientôt la teinte grise et feuille-morte par endroits.
Pendant ce temps, Denise faisait cuire dans l’eau bouillante des coquillages et des crabes qu’on appelle cancres sur les côtes de Bretagne. Jobic avait ôté sa veste et secondait la petite cuisinière avec autant de bonne volonté que d’adresse, car les matelots savent faire un peu de tout.
Rosalie ne quittait pas d’une semelle son nouvel ami. Elle lui expliquait avec une imperturbable assurance tous les préparatifs que faisaient sa mère et sa sœur. Enfin, une demi-douzaine de galettes étaient fabriquées, lorsque le pauvre Kidu, l’oreille en sang, se précipita dans la maison de toute la vitesse des trois pattes dont il pouvait encore disposer. Quant à la quatrième, atteinte d’une rude morsure, il la tenait suspendue en l’air.
« Oh ! mon Dieu ! s’écria Marianne, dont la première pensée fut pour son fils, qu’est-il arrivé à Charlot ?
– Et Kidu ! Vois donc comme il est abîmé ! » dit Denise en caressant le chien qui lui léchait les mains avec reconnaissance.
Marianne s’élança hors de la chaumière et rencontra la petite Fanchette tout essoufflée d’avoir couru.
« C’est ici la maison des parents de Charlot ? demanda la mendiante.
– Oui, mon enfant. Qu’est-il arrivé à mon fils ? »
Fanchette le lui raconta d’une manière un peu décousue, mais avec intelligence. Comme elle parlait sous l’influence de la peur qu’elle-même avait éprouvée, son récit effraya vivement Marianne.
« Ah ! mon Dieu ! s’écria-t-elle, on m’avait bien dit que les nouveaux fermiers étaient de méchantes gens, mais je n’aurais jamais cru des chrétiens capables de frapper ainsi un pauvre enfant. Je cours chez eux.
– Non, dit Jobic en la retenant, j’y vais, moi. »
Marianne insista et, bon gré mal gré, voulut aller retrouver son fils.
« Mais toi reste ici, mon enfant, dit Jobic à la mendiante. Tu es fatiguée, il faut te reposer.
– Non, répondit Fanchette, je vous accompagnerai. Si le vilain homme disait que Charlot n’est pas dans le cellier, je serais là pour soutenir le contraire.
– Et s’il te bat ?
– Tant pis ! ça m’est arrivé tant de fois.
– Ça ne t’arrivera pas avec moi, toujours, ni devant moi ! » s’écria Letallec.
Puis, soulevant la petite, il l’emporta dans ses bras robustes, et se dirigea vers la ferme.
Kidu courait devant eux sur ses trois pattes, et revenait à chaque instant caresser Jobic, comme s’il eût deviné, le bon animal, qu’il amenait du secours à son jeune maître.
CHAPITRE IV – Délivrance de Charlot. – Les exploits de Jobic. – Deux bains dans la mare.
Il n’est jamais agréable pour un enfant de neuf ans de se trouver renfermé dans un endroit obscur, avec la perspective d’y passer vingt-quatre heures sans boire ni manger.
La colère et la frayeur du prisonnier n’empêchaient pas son estomac de lui rappeler qu’il était près de midi, et que le dîner de la maison paternelle chauffait en ce moment. Encore s’il avait eu les pommes de terre si bien arrangées sous la cendre ! Elles devaient maintenant être cuites à point. Le plaisir aurait été grand de les partager avec la petite Fanchette !
Au milieu de ses préoccupations gastronomiques, Charlot en éprouvait d’autres plus sérieuses. Le souvenir de certain gros bâton, qu’il avait vu dans la main du fermier et qu’il avait entendu résonner sur les côtes de la pauvre Bellone, le faisait frémir. Et le gros chien donc, s’il était lancé contre lui !
Cette idée effrayait beaucoup le pauvre enfant. À chaque aboiement du dogue, il tremblait de tous ses membres.
Deux ou trois fois, l’entendant rôder près de la porte de sa prison, il se mit à pousser des cris perçants.
« Veux-tu te taire ! lui criait alors Mathurin qui, assis sur le brancard d’une charrette, emmanchait des fléaux à battre le grain. Si tu cries, je te plonge dans la mare. »
Il y avait en effet, au milieu de la cour, une mare d’eau bourbeuse qui servait de baignoire aux oies et aux canards.
Peu soucieux de partager leurs plaisirs, Charlot prenait le parti de se taire.
Mais bientôt la peur s’empara de lui plus que jamais ; le chien aboyait.
« Qu’est-ce qu’il y a, Corlay ? » dit le paysan à l’animal.
Corlay répondit à sa manière en grondant plus fort.
Ce qui excitait ainsi la mauvaise humeur du chien de garde, c’était l’arrivée de Kidu. Il s’avançait hardiment, précédant Marianne, Jobic et la petite mendiante.
« C’est ici ; et voilà où ce méchant homme a enfermé Charlot, » dit Fanchette en montrant le cellier.
Puis elle ajouta toute tremblante :
« Et le voilà, lui, avec son gros chien et son gros bâton.
– C’est bon, je vais lui parler, murmura Jobic.
– Oh ! non, je vous en prie ! s’écria Marianne, craignant quelque violence du matelot. Laissez-moi d’abord causer avec lui.
– Soit ! »
Malheureusement pour les intentions pacifiques de Marianne, Kidu et Corlay s’étaient précipités l’un sur l’autre. Comme la première fois, le pauvre Kidu eut le dessous, et son féroce adversaire l’aurait étranglé si Jobic n’était intervenu.
« Rappelez donc votre chien ! » cria-t-il au fermier qui riait méchamment.
Au lieu de rappeler Corlay, Mathurin l’excita.
« Kss, kss ! dit-il.
– Oui-da ! » fit Jobic.
Il empoigna un des bâtons de houx destinés à être ajustés aux manches des fléaux et s’en servit si vigoureusement aux dépens de maître Corlay, que celui-ci lâcha le pauvre Kidu et voulut se jeter sur Jobic ; mais le marin maniait son bâton comme sait le faire tout matelot armoricain. En un clin d’œil, Corlay reçut cinq ou six coups qui le mirent en complète déroute.
« Voulez-vous laisser mon chien, vous ! » s’écria Mathurin furieux.
Jobic allait lui répondre sur le même ton ; mais Marianne le retint en lui mettant la main sur le bras.
« Letallec, je vous en prie ! dit-elle.
– J’apprenais à votre chien à connaître son monde, murmura le matelot qui se contenait à peine.
– Monsieur, reprit Marianne, je viens réclamer mon fils que vous avez enfermé.
– Ah ! te voilà, petite coquine ! » interrompit Mathurin en menaçant du poing la pauvre Fanchette, qui se réfugia derrière le marin.
En ce moment Charlot, reconnaissant la voix de sa mère, se mit à pousser des cris de paon.
« Maman ! maman ! À moi ! au secours ! »
La pauvre mère se figura qu’on égorgeait son fils et courut au cellier. Mathurin lui barra le passage et la repoussa brutalement. Comme elle se débattait pour s’échapper, il leva la main sur elle.
Mal lui en prit. Un poignet de fer lui saisit le bras et le rabattit avec tant de force qu’il poussa un cri de douleur.
« Expliquons-nous tranquillement, lui dit Jobic sans le lâcher. Chut ! ne bougeons pas, ou je serre. »
Pendant que Mathurin racontait avec force exagération les ravages commis par les bestiaux de Charlot, Marianne courait ouvrir à son fils. Le pauvre petit se jeta tout en pleurs dans les bras maternels. Il avait le nez en sang et une joue rouge encore du soufflet que lui avait donné son brutal adversaire.
« Comment avez-vous eu le cœur de frapper ainsi cet enfant ? » dit Marianne indignée en montrant au fermier la trace des coups qu’avait reçus maître Charlot.
Comme tous les gens qui n’ont que de mauvaises raisons à donner, Mathurin se répandit en injures et en récriminations.
« Causons tranquillement, interrompit Jobic qui n’était jamais plus en colère que lorsqu’il employait cette formule pacifique. À combien évaluez-vous le dégât dont vous vous plaignez ? »
Mathurin continua de parler à tort et à travers.
« Résumons-nous, reprit le matelot qui le tenait toujours par le bras. À combien estimez-vous le dégât ?
– À plus d’un écu (trois francs), répondit Mathurin, aussi menteur que brutal.
– Un écu ! dit Marianne. Mais, dans toute la journée, la vache et les chèvres ne pourraient pas consommer pour dix sous de trèfle.
– Brisons là, fit le matelot au fermier. Voici vingt sous, mon garçon. Sous le rapport du dommage nous sommes quittes, n’est-ce pas ?
– À peu près, » grommela Mathurin, enchanté de cette aubaine, car les bestiaux n’avaient pas mangé pour la moitié de ce prix, et vingt sous, qui semblent bien peu de chose à des Parisiens, sont une somme pour de pauvres paysans.
« Maintenant, reprit Jobic, il nous reste un autre petit compte à régler, mon gaillard : j’ai à vous rendre les coups que vous avez donnés à l’enfant.
– Il m’avait jeté des pierres ! s’écria Mathurin qui, voyant le marin ôter sa veste, la plier soigneusement et la poser sur une traverse, ne comprenait que trop la signification de cette pantomime.
– Ce n’est pas vrai, dit Charlot.
– Ce n’est pas vrai, » répéta Fanchette.
Emporté par la colère, Mathurin allongea un soufflet à la petite mendiante qu’il renversa du coup. À cette vue, Jobic se dégagea des mains de Marianne et tomba à coups de poing sur le fermier.
Quoique plus jeune que son adversaire, Mathurin avait au moins dix centimètres de plus que lui ; mais Jobic était brave et vigoureux, et le fermier n’était qu’un poltron. Il demanda grâce bien vite.
Au moment où Jobic le lâchait, Mathurin aperçut un des domestiques de la ferme qui arrivait en courant.
« À moi ! cria-t-il. À moi, Fanche ! »
Et se jetant à l’improviste sur Letallec qui ramassait sa veste, il lui porta traîtreusement un grand coup dans le dos.
Jobic se retourna en poussant un rugissement. Il saisit Mathurin à la gorge et le renversa sous lui.
« Prenez garde, Jobic ! » lui cria Marianne en lui montrant le domestique qui n’était plus qu’à deux pas des combattants.
Jobic se redressa, enleva Mathurin de terre et le lança contre le domestique avec tant de force que maître et valet s’en allèrent rouler ensemble dans la mare, au grand effroi des canards et des oies.
Malgré son inquiétude, Marianne ne put s’empêcher de rire en voyant les deux paysans se débattre au milieu de l’eau, se raccrocher l’un à l’autre au sortir de la mare dans un état indescriptible.
Ne désirant point renouveler connaissance avec le matelot qui avait repris son bâton de houx et le faisait tourner d’une façon peu engageante, Mathurin se sauva dans la maison.
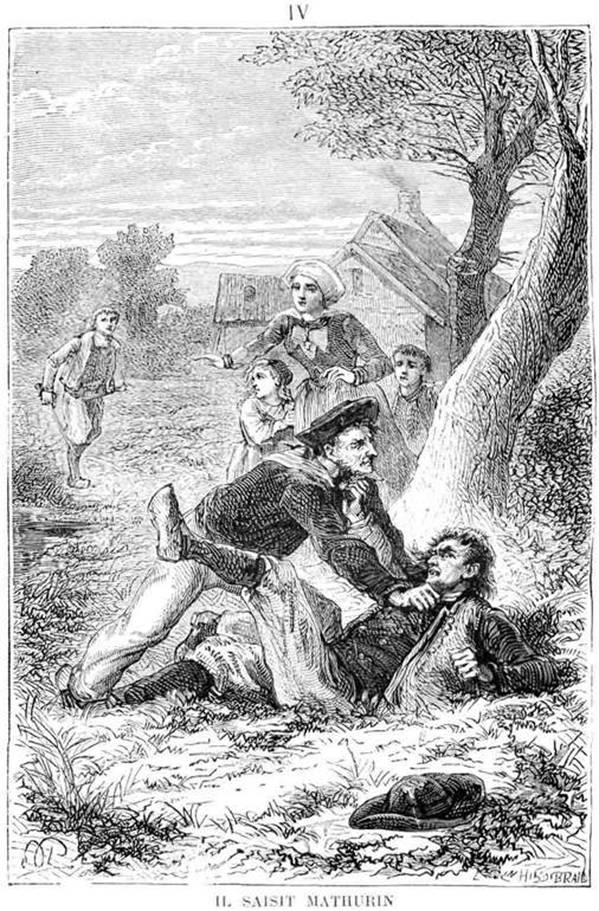
« Causons tranquillement, mon gars, dit Jobic au valet que Marianne connaissait depuis longtemps. Je ne te veux point de mal, et tu serais bien bon de te faire assommer pour un maître aussi poltron que le tien. »
Le domestique avait déjà eu à se plaindre de la brutalité du nouveau fermier ; mais le bain qu’il venait de prendre lui restait sur le cœur.
« Regardez dans quel état votre maître a mis mon fils, dit Marianne en lui montrant la figure enflée de Charlot.
– Ça me fait bien mal, Fanche, ajouta le petit garçon.
– Pauvre gars ! » murmura le paysan, qui avait vu naître Charlot et lui avait fabriqué plus d’un sifflet et plus d’un manche de fouet. »
Pour faire oublier à Fanche son bain imprévu, Marianne l’invita à venir boire un verre de cidre quand il passerait devant la chaumière des Morand.
« Et je vous ferai goûter du rhum que j’ai apporté des Indes, ajouta le matelot. Ça vous séchera si bien que vous ne me garderez pas rancune de votre culbute. »
Le paysan était un brave garçon et ne méprisait ni le cidre ni le rhum ; il se mit à rire et promit d’entrer chez les Morand dans le cours de la journée.
« Mes compliments à votre maître, lui dit Jobic en le quittant. Puisqu’il ne connaît pas encore ses voisins, vous pouvez le prévenir que mon camarade Antoine Morand est plus vigoureux que moi, et que, si jamais on touchait à ses enfants, il pourrait bien assommer le coupable, ou lui fendre la tête d’un coup de bâton. Au revoir et sans rancune. »
CHAPITRE V – Les bons cœurs. – Promesses de Jobic. – Le départ pour la pêche.
Tandis que le domestique rentrait à la ferme pour changer de vêtements, Jobic, Marianne et les deux enfants reprenaient le chemin de la grève.
Charlot, consolé par le plaisir qu’il avait eu à voir son ennemi se débattre dans la mare, cheminait gaiement avec la petite mendiante.
« Et les pommes de terre ! » s’écria celle-ci en passant à côté du champ.
Ils coururent au talus et trouvèrent les pommes de terre un peu carbonisées, mais cependant mangeables. Charlot en devint encore plus joyeux. Fanchette les mit dans son tablier et continua son chemin avec la famille, car Marianne l’avait invitée à dîner. Denise la reçut en l’embrassant et la servit de son mieux.
Quoiqu’on soit fort humain pour les mendiants en Bretagne et qu’on leur parle toujours avec bonté, la pauvre orpheline s’était trouvée rarement à pareille fête. – Jamais, disait-elle, elle n’avait mangé de si bonnes galettes !… Et les coquillages étaient si bien cuits ! Et le lait de la vache blanche avait si bon goût !
Après le dîner, Denise tira sa mère à l’écart.

« Maman, dit-elle, la pauvresse doit avoir bien froid avec son justaucorps en toile.
– Eh bien ? demanda Marianne qui voyait venir sa fille.
– Eh bien, si tu me permettais de lui donner un des miens, puisque j’en ai deux ?
– Alors tu n’en auras plus pour te faire belle le dimanche ?
– Tant pis, murmura Denise avec un soupir. Veux-tu ? » reprit-elle en montrant du doigt l’armoire.
La mère en souriant fit signe que oui.
La petite courut au meuble, grimpa sur une chaise, saisit le justaucorps et l’apporta toute joyeuse à Fanchette.
Celle-ci hésitait à l’accepter et regardait timidement Marianne.
« Prends, mon enfant, » dit la femme du pêcheur.
Fanchette prit le vêtement avec mille remerciements joyeux et confus.
« Écoute, dit Jobic à la gentille Denise, demain nous irons à Lanmodez choisir un justaucorps, et nous achèterons en même temps un tablier et une coiffe pour cette petite. Hein, ça te va-t-il ?
– Oh oui ! » s’écria Denise en frappant des mains.
Rien ne vaut le bon exemple de leurs aînés pour former au bien les jeunes enfants. Témoin de la générosité de sa sœur, Rosalie creusait sa petite cervelle pour trouver un moyen de l’imiter. Après cinq minutes de réflexion, elle alla chercher un de ses bonnets, se hissa sur le banc à côté de Fanchette et se mit en devoir d’ajuster la coiffure sur la tête de la pauvresse. Comme Fanchette avait sept ans, et Rosalie quatre, les dimensions de leurs têtes ne s’accordaient guère, et l’entreprise de l’enfant était difficile à exécuter. La pauvre Fanchette y perdit quelques cheveux et ne se plaignit pas. Enfin Jobic, qui s’était amusé des efforts et de la gravité de Rosalie, promit d’emmener le lendemain tout le monde à Lanmodez.
« Allons-y tout de suite, » dit Rosalie.
Jobic ne demandait pas mieux. Marianne s’y opposa.
« Demain c’est dimanche, dit-elle ; les enfants auront leurs beaux habits ; puis leur père pourra venir avec nous.
– C’est juste, » fit le marin.
Rosalie et Charlot se regardèrent piteusement.
« Et tes bestiaux, Charlot ? reprit la mère ; il est temps de les faire sortir. »
Malheureusement, quand les enfants se sont amusés, il leur paraît ensuite très dur de se remettre à la tâche ordinaire.
Charlot fit la grimace à l’appel de sa mère. Il n’avait pas envie de quitter Jobic. Cependant, comme il n’était point désobéissant, il prit son chapeau de paille, sa gaule, et sortit en soupirant.
« Pauvre petit ! murmura Marianne en le suivant de cet œil attendri des mères, qui sont toujours disposées à compatir aux moindres contrariétés de leurs enfants.
– Maman, dit Denise, si tu veux, j’irai aux champs à la place de Charlot. Je filerai là-bas aussi bien qu’ici.
– Une idée ! dit le matelot, qui ne savait qu’inventer pour faire plaisir à ses jeunes amis. C’est aujourd’hui la grande marée, la mer va se retirer fort loin. C’est le vrai moment pour pêcher au bas de l’eau. »
Nous dirons tout à l’heure ce que l’on appelle ainsi.
Les enfants firent un bond de joie : la pêche au bas de l’eau était un de leurs rêves ; mais leur mère ne voulait pas qu’ils y allassent seuls, et elle avait trop à faire chez elle pour les y accompagner, tandis qu’Antoine trouvait plus de bénéfice à pêcher en bateau.
En voyant la joie de son petit monde, Marianne ne put s’empêcher de sourire.
« Et les bestiaux ? murmura-t-elle avec une inflexion de voix qui révélait qu’elle ne demandait pas mieux que d’être convaincue.
– J’irai à la place de Charlot, s’écria Denise, toujours disposée à se dévouer.
– Si on veut, dit timidement la petite mendiante, moi, je les garderai.
– Cela te privera du plaisir de la pêche, pauvre enfant, fit observer Marianne.
– Oh ! non, madame, je suis si fatiguée que je ne pourrais marcher ; puis j’ai les pieds tout écorchés et l’eau de mer me brûlerait. »
Il y avait du vrai dans ce que disait Fanchette ; mais elle était heureuse surtout de pouvoir faire quelque chose pour ceux qui lui avaient témoigné tant de bonté.
On finit par accepter sa proposition. Charlot, qui était revenu de l’étable, s’empressa de lui confier son sceptre, c’est-à-dire sa gaule d’osier, et lui donna gravement ses instructions. Il fut convenu que Fanchette reviendrait pour souper et qu’elle coucherait chez les Morand.
Mais les bestiaux, quand il voulut les faire sortir, regardaient l’étrangère avec de grands yeux étonnés. Kidu surtout ne pouvait s’expliquer cet arrangement ; il allait de Fanchette à Charlot et de Charlot à Fanchette.
« Qui dois-je suivre ? » demandait-il.
Il penchait cependant pour accompagner Charlot ; mais ce dernier brandit son bâton d’un air terrible, tandis que Fanchette l’appela de sa voix douce en lui montrant du pain. Kidu comprit, et jetant un dernier regard de reproche à son maître, il suivit la mendiante. Il mordit même un peu les jarrets de ce coquin de Kéban qui ne voulait point s’éloigner de son pâtour (pâtre) ordinaire.
Pendant ce temps, Jobic préparait les ustensiles nécessaires à la pêche. Il prit pour lui la hotte, le havenot et la fouine d’Antoine.
Tout le monde sait ce que c’est qu’une hotte, sorte de long panier comme en ont les chiffonniers et que les pêcheurs portent aussi sur leur dos.
Le havenot (havenet, en d’autres pays) est une grande poche en filet fixée sur un cercle en bois et emmanchée au bout d’un long bâton. On la plonge dans l’eau lorsqu’on voit des crevettes ou de petits poissons. Puis on la relève brusquement. L’eau s’écoule à travers les mailles, et les poissons restent au fond de la poche, où les pêcheurs les prennent ensuite avec la main pour les jeter dans la hotte.
La foëne, qu’on appelle fouine sur les côtes de Bretagne, est une sorte de longue fourchette en fer à deux dents ; à trois dents elle porte le nom de trident. Elle est aussi adaptée à un manche de la longueur des cannes que portaient jadis nos grands-pères. Elle sert à piquer les poissons, principalement les poissons plats, tels que les plies et les soles qu’on trouve dans les flaques d’eau.
Outre ces trois ustensiles, Jobic prit encore un levier en fer destiné à soulever les pierres sous lesquelles se cachent les homards et les roussettes ou chiens de mer.
Avec quelques morceaux de vieux filets, que Marianne eut la complaisance de coudre, le marin confectionna tant bien que mal deux havenots pour les petites filles. Rosalie surtout tenait à en avoir un et ne trouvait pas le sien encore assez grand. On lui donna de plus la fourchette de fer qui servait à mettre les ajoncs dans le feu. Denise, plus facile à contenter, prit un simple bâton aiguisé, afin de laisser à Charlot la foëne de Marianne.
Heureuse de la joie de ses enfants, l’excellente mère n’avait qu’un regret, c’était de ne pas être témoin de leurs exploits. Jobic lui proposa de venir ; mais elle avait le ménage à faire, les vêtements et les filets à raccommoder, le souper à préparer ; tout cela ne lui laissait guère le temps de s’amuser.
« Allez sans moi, dit-elle au matelot. Veillez bien sur les enfants, et bonne chance ! Prenez garde à Rosalie surtout, car elle est fort imprudente.
– Soyez tranquille, répondit gaiement Jobic. Adieu vat[3] ! En route, timonier ! »
Il installa Rosalie sur le goëmon qu’il avait mis dans la hotte, prit la main de Denise et partit aussi léger que s’il n’avait rien eu sur le dos.
CHAPITRE VI – La pêche au bas de l’eau. – Le homard de Charlot. Bataille de Rosalie avec une roussette. – Le souper. – Le retour d’Antoine. – Les emplettes de Jobic. – La soirée sur la grève.
À certaines époques de l’année, bien connues des savants et des riverains, la mer se retire plus loin que d’habitude. Elle laisse alors à découvert de vastes espaces qui, en temps ordinaire, restent sous les flots. Les poissons, n’ayant point d’almanach, ne prévoient pas cette circonstance ; un grand nombre, qui n’ont point suivi le courant, se trouvent tout à coup prisonniers dans de petites flaques d’eau ou bien au milieu de bassins formés dans le creux des rochers. Et malheur à eux si quelque pêcheur les découvre avant que la marée suivante les ait remis en liberté.
Dès que la mer commence à descendre, les pêcheurs, et même beaucoup de paysans, qui ne pêchent que ces jours-là, suivent pas à pas la retraite des flots. De temps en temps quelques rigoles leur barrent le passage. Ils les traversent bravement ou les tournent.
Parvenus à une certaine distance, ils commencent leur chasse. L’un pique une petite sole, l’autre attrape avec sa fourchette un congre ou anguille de mer ; celui-ci déniche un homard caché sous une grosse pierre, et le tire à grand’peine de son trou, en évitant l’atteinte des grosses pinces que l’animal met toujours en avant. D’autres plongent leur havenot dans les trous profonds où ils voient nager un bataillon de crevettes, et enlèvent, d’un seul coup, une cinquantaine de soldats à la grise armure. On trouve aussi des huîtres, force crabes et divers coquillages, tels que les bernicles qui ont la forme d’un chapeau chinois, les daïns ou coquilles de Saint-Jacques, pareilles à celles que portaient autrefois les pèlerins, les ormeaux dont j’ignore le nom scientifique, mais qui ont l’air de meringues aplaties et dont la coquille a des reflets nacrés.
Il fallait faire un assez long trajet avant d’arriver à l’endroit où la pêche commençait à devenir fructueuse ; mais Denise et Charlot marchaient vaillamment. Quant à Rosalie, perchée sur la hotte, elle suppléait par le travail de sa langue à l’oisiveté de ses jambes.
Dès qu’on fut en plein territoire de pêche, Jobic mit à terre la petite bavarde. Elle saisit fièrement son havenot et sa fourchette, avec laquelle elle avait failli deux ou trois fois s’éborgner, et trottina sur les talons du marin.
Si Jobic avait voulu faire une pêche sérieuse, il aurait maudit plus d’une fois ses petits acolytes ; mais il tenait surtout à les amuser.
Ceux-ci s’en donnaient à cœur joie.
Chaque fois que l’un d’eux avait pris un poisson gros comme le doigt, il courait le montrer à Jobic qui s’extasiait sur l’habileté du jeune pêcheur. De temps en temps, le matelot jetait furtivement dans le chemin de Rosalie ou de Denise une sole ou une plie déjà piquée par sa foëne.
Quelle joie c’était alors ! Denise aurait pu facilement arriver la première et s’emparer du beau poisson ; mais elle se laissait volontairement dépasser par Rosalie qui faisait trotter ses petites jambes avec une grande agilité.
Une autre fois, Jobic glissait une anguille dans la hotte de la petite fille ou dans celle de Charlot, et sa récompense était dans les cris de joie que leur arrachait cette découverte inexplicable d’un poisson venu de lui-même au-devant de la friture. Charlot travaillait de tout son pouvoir. Comme il se trouve quelquefois dans les trous de rochers des roussettes qui mordent assez dur, et des homards dont la pince pourrait blesser la main délicate d’un enfant, Marianne et Jobic avaient bien recommandé aux petits pêcheurs d’y prendre garde ; mais l’ardeur du butin leur faisait tout oublier.
Tandis que Jobic vidait dans la hotte de Rosalie les crevettes prisonnières au fond du grand havenot, il entendit des cris perçants ; c’était maître Charlot aux prises avec un énorme homard.
« À moi ! Jobic, à moi ! s’écriait Charlot.
– Qu’est-ce que c’est ? demanda le marin en accourant.
– Je tiens un homard.
– Apporte-le.
– Il ne veut pas me lâcher. »
Jobic se mit à rire. Évidemment la blessure de Charlot n’était pas dangereuse. Denise, en revanche, croyait son frère perdu. Elle aurait volontiers pleuré. Rosalie se cachait derrière Jobic.
Le marin s’approcha du petit Morand. Il fourra sa main calleuse dans le trou.
« Aïe ! cria Charlot.

– Voilà le coupable ! » dit Jobic en retirant un homard d’une superbe dimension, dont la pince serrait encore la main de Charlot.
On lui introduisit un petit morceau de bois à la jonction des deux branches qui composaient la pince, afin de l’empêcher de mordre désormais personne. Puis on le jeta dans la hotte d’où l’on avait eu soin d’enlever le varech ou goëmon.
« Hein ! quel beau homard j’ai pris là ! s’écriait fièrement Charlot, tout en frottant sa main qui lui faisait encore un peu mal.
– Comment un garçon de ton âge, un fils de pêcheur surtout, se laisse-t-il attraper ainsi et crie-t-il pour si peu de chose ? dit Jobic au petit garçon.
– Dam ! il pinçait dur, le homard.
– Un homme doit savoir supporter la douleur sans crier.
– Je ne crierai plus, Jobic. Mais tout de même j’appellerai, dis ?
– À la bonne heure ! Tiens, j’aperçois là-bas une roussette qui se sauve. Donne-lui un bon coup de foëne pour l’arrêter.
– Non, c’est à mon tour ! » s’écria la petite Rosalie.
Et brandissant la fourchette aux ajoncs, elle marcha d’un pas délibéré vers la roussette qui cherchait à gagner une flaque d’eau.
Il est bon de dire que ces animaux ont une gueule fort bien garnie de dents, une mâchoire vigoureuse et une peau si rude qu’on s’en sert pour polir le bois. Celle-ci était toute petite ; sans cela Jobic n’eût pas laissé Rosalie l’attaquer seule.
Intrépide comme un petit diable, l’enfant lança sa fourchette, mais elle manqua son gibier et n’atteignit que le sable. La bête, mécontente de se voir ainsi barrer le passage, ouvrit une gueule menaçante. Rosalie, qui avait déjà relevé son arme pour en porter un second coup, fit probablement une réflexion prudente à la vue des dents de la roussette, car, au lieu d’avancer, elle se replia sur le gros de l’armée, aux grands éclats de rire de ses compagnons.
Cet accueil humilia tellement la petite fille, qu’elle chargea de nouveau son adversaire qui, de son côté, avait jugé bon de battre en retraite. Nous devons avouer tout bas, tout bas, que Rosalie la prit par derrière, mais enfin elle atteignit cette fois la roussette.
« Bravo ! bravo ! » lui cria Jobic.
Et, d’un coup de foëne savamment appliqué sur la tête du chien de mer, il l’étourdit complètement.
Rosalie, tout essoufflée, toute palpitante, étendit en guise d’épée sa fourchette sur le corps de son ennemi vaincu. Elle avait l’air d’un triomphateur romain.
« Prends garde ! elle vit peut-être encore ! » lui cria Jobic.
Rosalie ne put se défendre d’un mouvement de panique. Elle fit un bond en arrière qui lui fit perdre un peu de son attitude victorieuse, et ne fut pas très fière quand elle s’aperçut, aux rires de Denise et de Charlot, qu’elle avait été dupe d’une plaisanterie. La roussette fut jetée dans la hotte où elle alla tenir compagnie au homard et à une quarantaine de petits poissons.
Bientôt les enfants commencèrent à traîner la jambe.
« Rentrons, dit Jobic.
– Non, non ! s’écria Charlot. Encore !
– Encore ! » répéta Rosalie.
Le bon Jobic obéit. On continua à suivre la marée qui descendait toujours. À la fin pourtant, Letallec vit qu’il était grand temps de virer de bord. Rosalie dormait à moitié. Denise était à bout de forces, et Charlot s’asseyait sur tous les rochers. Le retour fut pénible. Les enfants avaient marché en avant tant qu’ils avaient pu, sans garder de forces pour le retour.
Maintenant ils n’en trouvaient plus.
Jobic mit du goëmon frais par-dessus les poissons, et Rosalie reprit sa place sur le dos du marin, dont elle tenait la tête en guise de point d’appui.
Quoique Denise ne se plaignît pas, Jobic eut pitié d’elle. Il la prit dans ses bras et la porta jusqu’à la falaise.
« Je vous fatigue, disait la petite qui voulait marcher.
– Non, répondait le bon matelot, cela fait contrepoids à la hotte et à la grosse crevette qui est là-dessus. »
C’était Rosalie qu’il appelait ainsi. Alors Rosalie, pour le punir, lui tirait les cheveux.
Quant à Charlot, il avait voulu s’arrêter trois ou quatre fois ; mais Jobic lui faisait honte de sa paresse, et l’enfant se remettait en marche.
On arriva enfin à la chaumière des Morand. Jobic déposa sur la table sa hotte et les deux petites filles qui se réveillèrent pour l’embrasser et pour assister à l’exhibition du butin.
Pour de vrais pêcheurs, la récolte n’eût pas semblé fort brillante ; mais, pour des enfants de cet âge, c’était superbe. Tous trois se pâmaient d’admiration, et la mère en fit autant pour augmenter leur plaisir.
Il avait été convenu qu’on attendrait le père pour souper ; mais les pauvres petits tombaient de fatigue et de sommeil. Marianne leur fit cuire tout de suite un poisson et leur donna quelques crêpes.
Ils mangèrent, les yeux fermés, et se trouvèrent dans leur lit sans savoir comment. Cinq minutes après, ils dormaient du profond et charmant sommeil de l’enfance.
On prétend même que Charlot, qui avait un peu trop soupé, ronflait ; mais pour mon compte je n’en crois rien.
Fanchette revint à sept heures avec les bestiaux. Elle les mit à l’étable et s’acquitta à merveille de ses fonctions de bergère. Elle entra ensuite dans la maison et s’occupa silencieusement à seconder Marianne qui préparait le souper. C’était le premier ménage un peu convenable qu’elle eût vu ; tout était nouveau, tout était surprise pour elle, tout lui paraissait merveilleux. Marianne était ravie du naïf hommage rendu à l’ordonnance de sa maison.
On voyait que la pauvre enfant ne savait pas faire grand’chose ; mais elle regardait si attentivement et devinait si bien ce qu’elle ignorait, qu’elle parvenait toujours à se rendre utile.
La bonne Marianne la prit tout de suite en affection ; Jobic en fit autant, quoique le petit lutin de Rosalie restât toujours sa favorite.
Avec la marée montante apparut la barque d’Antoine. Jobic alla sur la grève attendre son camarade afin de lui donner un coup de main pour débarquer le poisson.
La joie des deux amis fut grande de se retrouver. Ils s’embrassèrent avec effusion. On porta sur le rivage les paniers contenant la pêche qui avait été bonne, ainsi qu’il arrive généralement par les grandes marées.
Aussi le souper fut-il gai.
« Quelle est cette enfant ? » demanda Antoine en regardant avec surprise la petite Fanchette qui trottinait dans la cuisine, attisant le feu, apportant les plats et lavant les assiettes comme si elle était de la maison.
Marianne le lui raconta tout bas en faisant l’éloge de Fanchette, éloge que Jobic appuya de tout son pouvoir. Le brave pêcheur passa doucement sa main brunie sur la tête de la petite et lui dit quelques mots bienveillants. On fit dans la cuisine un lit pour Fanchette avec du varech desséché, de la paille et une grosse couverture. Jobic, qui aurait au besoin dormi sur des planches, s’en alla coucher dans une sorte de petit grenier où l’on renfermait la paille.
Sur ce lit primitif, le digne marin dormit si bien, qu’Antoine fut obligé de le secouer vigoureusement le lendemain matin pour le réveiller.
Les trois petits Morand étaient déjà sur pied depuis deux heures au moins. Ils regardaient, toutes les cinq minutes, le cadran du coucou qui ornait un des coins de la chaumière, afin de voir s’il était temps de partir pour Lanmodez. Marianne, heureuse de leur joie, se hâta de leur mettre leurs habits du dimanche. Denise et sa mère pillèrent ensuite leur modeste garde-robe pour habiller Fanchette un peu plus décemment.
La pauvre petite ne s’était jamais vue si belle ; elle se contemplait avec admiration dans le miroir de Denise, et remerciait chaleureusement ses bienfaitrices.
Neuf heures sonnèrent enfin, et l’on partit pour le village afin d’assister d’abord à la grand’messe. En sortant de l’office, Jobic prit Rosalie dans ses bras. Denise et Charlot empoignèrent chacun un pan de sa ceinture et le suivirent de boutique en boutique.
Le digne marin était si heureux du plaisir que ses cadeaux causaient à ses petits amis, qu’il aurait dépensé tout son argent en futilités si Marianne et son mari ne l’avaient emmené, pour ainsi dire de force.
On revint donc à la chaumière, en ramenant bien entendu la petite Fanchette, que Jobic n’avait eu garde d’oublier dans ses générosités.
Après le dîner, on alla se promener sur la grève. Les enfants étrennèrent leurs nouveaux jouets. Pendant ce temps, Antoine et Jobic causaient ensemble et rappelaient les souvenirs de leurs voyages.
CHAPITRE VII – Départ pour la pêche en mer. – La tempête. – Malheur affreux. – Dévouement de Jobic.
Le soir, tout en fumant, Antoine demanda à son ami ce qu’il comptait faire et quels étaient ses projets de voyage.
« Je pars sur le Marignan pour Bombay, dit Jobic.
– Quand appareille-t-il ?
– Dans un mois.
– Bon !
– Mais il faut que je sois à mon poste dans huit jours.
– Pourquoi ?
– Pour le chargement, donc !
– Eh bien, en attendant, tu vas rester ici.
– Si je ne te gêne pas ?
– Tu vois bien que non. Tout le monde t’aime déjà comme si tu étais de la famille.
– C’est vrai, dit Marianne en souriant.
– Oh oui ! s’écrièrent les enfants ; il ne faut jamais partir, monsieur Jobic.
– Jamais ! jamais ! répéta Rosalie.
– Tu veux que je reste ici, petit chiffon ?
– Oui.
– C’est dit alors. »
Les enfants battirent joyeusement des mains.
« Et Fanchette restera aussi, dit Charlot.
– Oh ! oui, maman ! » murmura Denise en regardant sa mère d’un air suppliant.
La pauvre Marianne n’aurait pas mieux demandé, car la situation de la petite mendiante l’intéressait vivement : mais trois enfants à nourrir sont déjà une lourde charge.
« Nous tâcherons de lui trouver une occupation dans les environs, chez de braves gens qui seront bons pour elle, dit-elle en embrassant Fanchette ; elle viendra nous voir tous les jours et passera chez nous ses dimanches. Je m’en occuperai dès demain. En attendant, Antoine permettra qu’elle demeure avec nous.
– Tant que tu voudras ! s’écria Antoine, qui avait aussi bon cœur que sa femme.
– Que Dieu vous récompense ! » murmura Fanchette.
Puis, cédant à son émotion, la pauvre petite cacha sa tête dans son tablier et sanglota dans un coin, à la grande stupéfaction de Rosalie qui ne savait pas encore qu’on pût pleurer de joie.
Tout étant ainsi arrangé à la satisfaction générale, les enfants allèrent docilement se coucher. Leurs parents ne tardèrent pas à faire comme eux, car Antoine et son ami Jobic devaient partir pour la pêche le lendemain de grand matin.
Charlot, qui s’était endormi avec le secret espoir qu’on l’emmènerait, se réveilla au point du jour. Il s’élança bien vite de son lit.
Hélas ! les deux marins avaient déjà quitté la maison. Prenant à peine le temps de s’habiller, le gamin courut sur la grève. La barque d’Antoine était à dix ou douze encâblures du rivage et filait rapidement vers la pleine mer.
Charlot se donna deux ou trois grands coups de poing dans la tête, puis, calmé par ce remède original, il reprit le chemin de la maison, déjeuna de bon appétit et partit avec ses bestiaux.
Dans le courant de la journée, le ciel se couvrit de nuages sombres et menaçants. Les vagues commençaient à moutonner, c’est-à-dire à se couvrir d’écume dans le lointain. Sur le rivage, les flots déferlaient avec une fureur croissante. Les oiseaux de mer voltigeaient de tous côtés en poussant des cris aigus. Bientôt les femmes des pêcheurs se groupèrent sur la grève. L’inquiétude était peinte sur leurs visages. Quelques-unes montaient sur les points les plus élevés de la falaise, pour tâcher de découvrir à l’horizon les bateaux de leurs maris ou de leurs frères.
Deux ou trois canots, trop petits pour se risquer loin des côtes, pêchaient à peu de distance ; ils se hâtèrent de regagner le rivage.
« Il va y avoir une tempête, disaient les marins en se signant. Que sainte Anne protège les camarades qui sont au large ! »
Bientôt l’orage éclata. Le tonnerre gronda dans le lointain. De sinistres éclairs déchirèrent les nuages noirs et épais qui déroulaient au ciel leurs sombres plis. Les vagues grandissaient toujours. Leurs montagnes écumantes se brisaient les unes contre les autres avec un épouvantable fracas ; les plus rapprochées du rivage se précipitaient contre les rochers, et toute la falaise tremblait de leur choc. De temps en temps, une voile paraissait au milieu des flots irrités. L’œil exercé des marins la reconnaissait bien vite.
« C’est le bateau d’un tel, » disait-on.
Puis chacun suivait avec une profonde anxiété les mouvements du frêle esquif qui bondissait sur les vagues et semblait fuir devant elles. Trois barques regagnèrent ainsi le port. Avec celles qui étaient rentrées aux premiers moments de la tempête, cela faisait sept. Il en restait encore trois ; celle d’Antoine était du nombre. Vers la fin du jour, une d’elles parut enfin. Son mât était brisé ; des trois marins qui la montaient ils n’en revenait que deux : le patron et son matelot. Le mousse avait été emporté par une lame. Les deux marins avaient fait tout ce qui était humainement possible pour le sauver, mais ils avaient failli périr eux-mêmes dans cette tentative. De grosses larmes roulaient sur leurs joues hâlées quand ils firent ce triste récit à la pauvre mère du mousse qui attendait sur la grève le retour de son fils.
La malheureuse femme se laissa tomber à terre, mit son tablier sur sa tête et demeura immobile comme privée de sentiment. Quelques voisines l’emmenèrent chez elle.
« Antoine est-il de retour ? demanda l’un des marins qui venait d’arriver.
– Non ! Pourquoi ?
– Il était à deux milles au moins plus loin que nous.
– Sa barque est solide, dit un autre.
– Oui, murmura un vieux pêcheur, mais il lui aura fallu doubler la Roche Bleue.
– Silence, dit un troisième, Marianne est là et nous écoute. »
Hélas ! la pauvre Marianne avait tout entendu. Pâle, haletante, les yeux fixes, elle interrogeait l’horizon.
« Une voile par le travers de l’île Modez ! » cria un marin qui avait une longue-vue.
Marianne s’élança vers lui.
« Laissez-moi voir, » dit-elle.
Et collant son œil humide contre le verre, elle regarda avec une fiévreuse curiosité.
« C’est la barque d’Antoine ! s’écria-t-elle.
– Pourvu qu’elle puisse aborder, dit tout bas le vieux marin.
– Je veux voir aussi, reprit une autre femme dont le mari montait la troisième barque, celle dont on n’avait point encore de nouvelles.
– C’est bien la barque d’Antoine, poursuivit le marin qui avait aussi regardé dans l’intervalle.
– Sainte Vierge ! protégez mon mari ! » murmura Marianne.
En dépit du mauvais temps, la barque approchait rapidement. Bientôt on put distinguer les hommes qui la montaient. Il y en avait trois. À son départ, Antoine avait avec lui son matelot habituel, un mousse et Jobic. Qui donc manquait ? L’œil collé à l’objectif de la longue-vue, Marianne cherchait à reconnaître qui se trouvait dans le bateau ; mais déjà, auprès d’elle, la vue perçante de quelques marins expérimentés avait découvert qu’Antoine n’était pas avec ses camarades. Son matelot aussi était absent. Il n’y avait à bord que le mousse, Jobic et un des matelots qui montaient l’autre barque attendue.
Folle d’inquiétude, Marianne interrogeait du regard les figures de ses voisins. Leurs physionomies compatissantes lui révélèrent la cruelle vérité. Elle voulait encore douter cependant. De sa main tremblante, elle reprit la longue-vue.
Vingt fois la barque faillit sombrer sous le choc des vagues, ou se briser contre les rochers. Assis à l’arrière, Jobic tenait la barre. Un mouchoir entourait son front. Son bras gauche immobile paraissait attaché à sa vareuse. L’autre matelot veillait aux voiles. Le petit mousse, qui avait douze ans à peine, le secondait de son mieux et vidait avec une écuelle de bois l’eau qui remplissait le fond du canot.
Enfin l’embarcation atteignit le rivage. Chacun s’élança vers les marins.
« Mon mari ! s’écria Marianne en se précipitant vers Jobic.

– Dieu nous l’a repris, » murmura le matelot qui pleurait comme un enfant.
La pauvre femme sanglota avec un accent déchirant.
« Il est mort comme un brave et digne marin qu’il était, reprit Jobic avec énergie. Il a voulu aller au secours de ses camarades dont la barque avait sombré. En se penchant pour tendre la gaffe à un malheureux qui se noyait, il est tombé à l’eau. Je me suis jeté après, mais je n’ai pu le retrouver, le flot m’a lancé contre les rochers ; puis, en se retirant, il m’a ramené vers la barque, et ce brave garçon m’a sauvé, » ajouta-t-il en montrant le matelot de l’autre embarcation.
Cet homme parlait en ce moment à la veuve du marin qu’Antoine avait inutilement essayé d’arracher à la mort.
Le mousse était le fils de ce dernier ; il avait passé les deux bras au cou de sa mère et cherchait à la consoler.
Jobic et quelques voisines emmenèrent Marianne chez elle. En entrant dans la chaumière où jamais ne devait revenir Antoine, la malheureuse femme eut un accès de désespoir effrayant.
Les naïves caresses de ses enfants, que Jobic avait poussés dans ses bras, firent enfin couler les pleurs qui l’étouffaient. Elle réunit les trois têtes chéries et les pressa sur son cœur en les couvrant de larmes et de baisers.
Les pauvres petits ne pouvaient croire à leur malheur.
« Papa reviendra, disait Charlot.
– Oh oui ! » affirmait Rosalie.
Denise pleurait silencieusement ; Fanchette, consternée, aurait voulu être morte à la place du bon Antoine.
Le matin suivant, Marianne exigea que Jobic lui racontât tous les détails de la catastrophe qui l’avait rendue veuve.
« Antoine est au ciel avec les martyrs et les saints, reprit-elle ensuite ; je l’y retrouverai quand ceux-là – elle montrait les enfants – pourront se passer de moi.
– Oui, Marianne, répondait Jobic ; mais c’est égal, il aurait mieux valu que Dieu me prît à la place de notre pauvre Antoine. »
Marianne était une femme courageuse ; sa piété et son amour pour ses enfants lui donnèrent la force de dompter sa douleur. En cette occasion, Denise et la petite mendiante furent bonnes et dévouées. Elles s’occupèrent du ménage, firent la cuisine, soignèrent les autres enfants et montrèrent enfin, pour remplacer la pauvre mère, une intelligence et des attentions qui touchèrent profondément Jobic et Marianne. Charlot aussi faisait de son mieux ; mais les petits garçons n’ont pas généralement l’intelligence aussi développée que les petites filles. La mort de son père l’avait d’ailleurs plongé dans une sorte de stupeur. Il passait des journées entières avec Kidu sur le bord de la mer, redemandant l’absent aux flots qui l’avaient englouti, et interrogeant du regard tous les points de l’espace. Fanchette allait le chercher aux heures des repas. Il se laissait ramener ; mais, dès que la surveillance cessait, il retournait à son poste. Un seul mot sortait de sa bouche : « Papa ! »
Pauvre Charlot ! Il comprenait déjà toute l’étendue de la perte qu’il venait de faire. Quoique plus jeune, Denise la sentait mieux encore ; femme déjà par le cœur, elle trouvait, pour consoler sa mère, des paroles et des caresses au-dessus de son âge.
Dès le lendemain, Jobic s’était mis à la besogne pour réparer les avaries qu’avait reçues la barque d’Antoine. Le bon matelot était cependant bien avarié lui-même. Il avait un grand trou à la tête, et son bras gauche était tout couvert de meurtrissures ; mais son courage lui donnait des forces. Il ne voulait pas abandonner la famille de son ami.
Au bout de trois jours, la barque fut remise à flot. Jobic partit pour la pêche avec un matelot qu’il avait enrôlé et le petit mousse qui accompagnait d’habitude le malheureux Antoine, et qui avait failli périr avec lui. Hélas ! il fallait gagner de quoi vivre, et le mousse repartait bravement parce que c’était son devoir de le faire.
Il y a bien des choses tristes dans ce monde ; mais aussi que de dévouements, que de nobles actions qui restent ignorés ! combien de vies consacrées par le courage et l’abnégation, qui devraient nous servir d’exemple !
Il va sans dire que le produit de la pêche de Jobic appartenait tout entier à la famille Morand. Cette famille était devenue la sienne. Il acceptait la mission sacrée de veiller sur les orphelins, comme si leur père avait eu le temps de la lui confier.
Pour être plus libre, Jobic s’était installé dans une cabane voisine. Il prenait ses repas chez les Morand ; mais il était plus souvent en mer qu’à terre. Comme c’était un de ces habiles et vaillants matelots qu’un capitaine tient à se conserver, il avait obtenu du commandant de l’Argonaute la permission de rester à Lanmodez jusqu’au départ du navire.
Pendant le temps qu’il ne consacrait pas à la pêche, il s’occupait des orphelins et de leur mère.
Au bout d’un mois, lorsqu’il fallut enfin songer au départ, Jobic demanda un soir à Marianne ce qu’elle comptait faire quand il ne serait plus là pour manœuvrer le bateau de pêche.
« Je vous l’ai dit, répondit-elle, je tâcherai de louer ma barque à notre matelot qui est un bon homme. Il pêchera et me donnera la moitié du poisson.
– En effet, dit Jobic, c’est le meilleur parti à prendre. Et votre fils ?
– Charlot ?
– Oui, Charlot. Vous ne voulez pas me comprendre, ma pauvre Marianne. Charlot aura dix ans le mois prochain. Il est grand et fort pour son âge ; il peut déjà commencer à naviguer.
– Il est si jeune !
– J’étais mousse à son âge.
– Ne me l’emmenez pas encore, Jobic. Je suis si malheureuse en ce moment ! Laissez-le-moi deux ou trois ans. Et puis, j’ai peur de la mer.
– Ce n’est pas raisonnable, Marianne ; vous savez bien qu’Antoine voulait en faire un marin.
– Hélas ! murmura la pauvre mère.
– Charlot est un bon petit garçon, reprit Jobic, mais il a de la tendance à devenir fainéant.
– C’est de ma faute.
– Je ne dis pas non ; cependant, cela tient aussi à son caractère. Manger un peu de vache enragée lui ferait du bien. Enfin, pour aujourd’hui, n’en parlons plus. Nous verrons cela l’année prochaine.
– Oui, l’année prochaine ! Vous reviendrez, n’est-ce pas ?
– Sans doute ; mais, croyez-moi, habituez l’enfant petit à petit à la rude existence qu’il doit mener. Plus tard, il aurait trop à en souffrir. Quand il fera beau, envoyez-le à la pêche avec le bateau de quelque voisin. À bord d’un grand navire, on ne prendrait pas un mousse aussi étranger que lui à la manœuvre. Instruisez-le par ailleurs aussi ; l’instruction sert à tout et ne nuit à rien. Voyons, Marianne, soyons raisonnable et ne pleurez pas comme cela.
– C’est plus fort que moi, Jobic. Quand je pense à ce que la mer m’a déjà coûté !… »
Jobic consola de son mieux la pauvre femme. Pendant les deux ou trois jours qui lui restaient, il remit la barque à neuf, répara les ustensiles de pêche et conclut, avec l’ancien matelot d’Antoine, l’arrangement dont nous avons parlé tout à l’heure et qui est assez fréquent parmi les pêcheurs. Ce matelot, qui s’appelait Clément, s’engagea à entretenir le bateau en bon état ainsi que les filets et à partager le produit de la pêche avec la famille Morand.
Des camarades d’Antoine promirent à Jobic de veiller sur les orphelins et d’emmener le petit Charlot pour en faire un marin.
Enfin Jobic dut partir. Il embrassa une dernière fois les enfants qui ne voulaient plus le quitter, et serra contre son cœur la pauvre veuve qui le remerciait avec effusion de tout ce qu’il avait fait pour eux. Puis, honteux des larmes qui mouillaient ses paupières, il quitta la cabane où il avait passé de si joyeux instants auprès de son ami. Il partit à pied pour Paimpol, et de là s’embarqua sur un caboteur qui allait au Havre.
Le lendemain du départ de Jobic, Marianne, en cherchant du linge dans l’armoire, trouva une petite bourse de cuir qui contenait soixante francs. C’était la bourse du matelot. Il avait laissé à la famille de son ami tout ce qui lui restait d’argent.
CHAPITRE VIII – La gêne. – Courage de Marianne. – Retour de Jobic. – On décide le départ de Charlot. – Le capitaine Tanguy.
Plusieurs mois s’écoulèrent.
Fanchette tint fidèle compagnie à la pauvre veuve, durant les premières semaines qui suivirent la mort d’Antoine. Elle était bonne, affectueuse, et les petits Morand l’aimaient comme une sœur. Marianne aussi éprouvait une vive affection pour cette enfant qui lui donnait toutes les preuves d’une profonde reconnaissance. Cependant, comme Fanchette devait pourvoir elle-même à sa vie, elle entra au service d’un fermier du voisinage. On la traitait bien. Quand elle avait un moment de liberté, elle venait voir ses amis et s’ingéniait à leur être utile. Son courage et son gentil caractère intéressèrent en sa faveur le vieux curé du village qui était l’oncle de son maître. Chaque fois que le digne prêtre venait à la ferme, il causait un peu avec Fanchette, lui faisait dire ce qu’elle souhaitait et ses espérances.
Fanchette ne désirait rien tant que de savoir lire, pour suivre la messe le dimanche, disait-elle, et pouvoir chercher dans l’almanach le temps des semailles et la façon de bien soigner les bêtes.
« Ma petite, dit un jour le curé, puisque tu as si bonne envie d’être savante, viens me voir tous les soirs quand ta besogne est faite : mon neveu te le permettra ; je t’apprendrai à lire et à écrire. »

Grande fut la joie de l’enfant, et grande son ardeur au travail. Comme elle ne voulait pas que le fermier pût se plaindre de la voir occupée d’autre chose que de sa tâche quotidienne, elle prenait sur le temps de son sommeil pour étudier les mystères de l’alphabet et faire des pages de grands O. Bientôt elle fut en état de lire ses prières couramment.
Alors, comme sa première pensée était toujours de chercher en quoi elle pouvait être utile à la famille Morand, Fanchette proposa à Charlot de lui donner à son tour des leçons, les dimanches après vêpres.
« Quand on sait lire, vois-tu, lui dit-elle, on peut arriver à tout. »
Charlot se prêta volontiers à cet arrangement. Pendant deux ou trois dimanches, au sortir de l’église, les deux enfants allèrent s’asseoir sous un arbre, et Fanchette s’efforçait de faire entrer dans la cervelle de son ami tout ce qu’elle-même venait d’apprendre.
Mais nous devons avouer que le résultat de ces études n’était point brillant. La petite fille y gagnait seulement de comprendre que l’enseignement est difficile ; qu’autre chose est de savoir, et de partager son savoir. Quant à Charlot, il restait aussi ignorant que devant et l’esprit un peu plus troublé.
Un jour, l’instituteur les surprit dans un moment de découragement complet. Charlot s’était renversé en arrière, résolu à ne plus jeter les yeux sur les mystérieux petits signes noirs dont il ne pouvait se rappeler ni la forme ni la valeur. Le livre était tombé, et Fanchette, attristée, ne songeait pas à le ramasser.
« Cela ne va pas, mes enfants ? dit l’instituteur qui était un brave homme.
– Oh ! pas du tout, soupira Charlot.
– Et si je te donnais des leçons, moi, serais-tu bien attentif, bien appliqué ?
– Certainement je ferais de mon mieux, monsieur Nicolas.
– Eh bien, mon garçon, nous arrangerons cela. J’en parlerai à ta mère. »
Tout le monde s’intéressait à la pauvre Marianne qui, dans son malheur, montrait un courage et une résignation héroïques. M. Nicolas, heureux de lui rendre service, lui annonça qu’il se chargeait d’apprendre à son fils la lecture, l’écriture et un peu d’arithmétique. Charlot, d’ordinaire indolent, fut si désireux de reconnaître les soins de l’instituteur, qu’il travailla courageusement et s’aperçut, à sa grande surprise, que le travail lui-même, la peine et la fatigue qu’il donne ont un charme dont on ne peut plus se passer après qu’on l’a goûté. En trois mois, il sut lire aussi bien que Fanchette.
Alors son maître lui donna l’histoire de France, une petite géographie et un atlas sur lequel il put retrouver les chemins qu’avait parcourus son père. Il étudiait aussi les quatre règles d’arithmétique ; le temps ne lui manquait pas pour le faire, tandis qu’il gardait ses bêtes ; et les garder formait toujours la seule tâche que lui imposait sa mère.
Malgré la promesse qu’elle avait faite à Jobic, Marianne n’avait pas le courage de former Charlot au rude métier qu’il devait embrasser. Elle ne pouvait se décider à l’envoyer sur mer.
« Demain, disait-elle, demain. »
Et demain n’arrivait jamais.
La gêne cependant commençait à menacer la chaumière. Quoique bon marin, Clément était loin d’égaler le pauvre Antoine. Il s’enivrait quelquefois et perdait alors plus d’une bonne journée. Puis, au lieu de recevoir comme jadis le produit de la pêche, les Morand n’avaient plus droit qu’à la moitié, et leur budget s’en ressentait.
Un jour, Clément tomba malade et passa près d’une semaine au lit. Pour de pauvres gens qui vivent au jour le jour, un chômage est terrible, car il oblige à faire des dettes qu’on est souvent plusieurs mois sans pouvoir payer.
Marianne le savait et faisait des prodiges de travail et d’économie pour nouer les deux bouts.
Aussi dure pour elle-même qu’elle était faible pour ses enfants, elle allait sur la grève recueillir des coquillages. Une partie servait au repas de la famille. La courageuse veuve portait le reste à Lanmodez pour les vendre. Denise la secondait de tout son pouvoir, mais la pauvre petite n’était pas encore bien forte.
Quoiqu’il s’appliquât si bien à l’étude, Charlot, pour tout autre chose, manquait d’initiative. Lorsque sa mère lui disait : « Fais ceci, » il le faisait ; mais l’idée ne lui venait pas de le faire de lui-même.
Habitué à trouver son déjeuner et son dîner servis, son lit préparé et ses habits cousus sans avoir besoin de gagner personnellement de quoi payer tout cela, il ne se rendait pas suffisamment compte de toute la peine qu’il faut prendre pour subvenir soi-même à ses besoins. Cependant, il ne manquait ni d’adresse ni de bonne volonté. Des matelots du voisinage l’ayant quelquefois emmené à la pêche, il mérita leurs éloges, et on lui prédit qu’il ferait un jour un bon marin s’il voulait prendre la besogne à cœur.
Il atteignit ainsi sa onzième année.
Un matin, un an environ après le départ de Jobic, Charlot gardait les bestiaux non loin de la falaise. Il s’endormit sur un tas de petits cailloux destinés à l’empierrement du chemin. Comme circonstance atténuante, nous devons dire qu’il avait passé en mer la journée de la veille et même une partie de la nuit.
Au beau milieu de son sommeil, il fut brusquement réveillé par la chute, ou pour mieux dire par l’écroulement du lit peu moelleux qu’il s’était choisi.
La première personne qu’aperçurent les yeux effarés du petit garçon fut Jobic Letallec.
« Jobic ! » s’écria Charlot en se précipitant dans les bras du matelot.
C’était Letallec, en effet, qui venait de réveiller si brusquement le petit pâtre. Il embrassa l’enfant.
« Qu’est-ce que tu faisais là ? lui demanda-t-il.
– Je gardais mes bestiaux.
– Oui-da !… Où sont-ils ?
– Bellone est… »
Charlot s’interrompit.
Bellone, fidèle aux habitudes de maraude qu’elle devait à la négligence de son gardien, avait passé dans une sapinière voisine.
« Et Kéban ? » demanda le matelot.
Maître Kéban manquait aussi à l’appel.
« Commence par rassembler tes bestiaux, lui dit Jobic. Nous aurons ensuite à causer. »
Un peu ému du ton sérieux avec lequel lui parlait le marin, Charlot se hâta de rappeler les maraudeurs. Grâce à Kidu, l’opération fut bientôt terminée.
« Maintenant, dit Jobic, assieds-toi là et écoute-moi bien.
– Oui, monsieur Jobic, murmura Charlot.
– Tu vas sur douze ans, mon gars. Dans la position de ta famille, tu es d’âge à te rendre utile, et tu ne le comprends pas assez. Je ne te parle pas seulement du présent, mais aussi de l’avenir. Qu’est-ce que tu veux être ?
– Marin donc.
– Tu es bien décidé ?
– Oui.
– Tu n’aimerais pas mieux devenir valet de ferme ?
– Oh ! non. D’abord j’aime mieux naviguer… Et puis…
– Et puis ?… Voyons.
– Et puis vous m’avez dit l’année dernière qu’en naviguant j’aurais plus de chance de gagner de l’argent pour donner à maman.
– Bravo ! s’écria joyeusement Jobic. Tu es bien le fils d’Antoine et tu feras un brave marin comme lui. Puisque tu as si bon courage, il faut partir tout de suite.
– Tout de suite ?
– Dans quelques jours enfin. Tu es logé, nourri, vêtu, mon garçon, et tout cela coûte de l’argent. Afin d’en gagner, ta pauvre mère se tue de travail.
– Est-ce que les mousses sont bien payés, Jobic ?
– Dame ! répondit le matelot en souriant, la première année il ne faut pas trop compter sur ta solde pour soutenir ta famille. Mais, à mesure que tu deviendras utile, tu seras payé davantage. D’ici là, sois tranquille ; je connais quelqu’un qui ne laissera pas dans le besoin la femme et les enfants de son vieux camarade.
– Merci, Jobic.
– Est-ce dit ? Veux-tu t’embarquer avec moi ?
– Oh ! Jobic, c’est avec vous surtout que je veux m’embarquer.
– Alors il faut que tu le dises de toi-même et sérieusement à ta mère. La pauvre femme t’aime tant qu’elle voudra te garder encore auprès d’elle ; au lieu de lui être bon à quelque chose, tu augmenterais les charges qu’elle a déjà sur le corps. Rosalie est maintenant assez grande pour garder les bestiaux à ta place.
– Oh oui ! ils lui obéissent aussi bien qu’à moi… excepté Kéban qui lui donne toujours des coups de tête, mais parce qu’elle se sauve, voyez-vous.
– Allons, c’est entendu, et je suis satisfait. Je vais préparer ta mère à la nouvelle de ton départ. À bientôt, mon garçon. »
En arrivant à la chaumière, Charlot trouva Marianne tout en larmes. La pauvre femme sentait bien que Jobic et son fils avaient raison, mais son cœur n’en souffrait pas moins.
Puis l’absence de Charlot devait être longue. Jobic, qui l’emmenait naturellement avec lui, s’était engagé à bord du trois-mâts le Jean-Bart, appartenant à la grande compagnie dite Compagnie Nationale. Les administrateurs de cette Compagnie s’occupaient en ce moment d’établir des correspondants et des consignataires dans tous les ports de commerce importants de l’étranger, et de faire explorer les ressources des diverses contrées avec lesquelles on était déjà en relation, ou qui offraient assez d’avantages pour qu’on y envoyât des navires.
Deux employés supérieurs de la Compagnie devaient, par conséquent, prendre passage à bord du Jean-Bart, et le capitaine avait ordre de se conformer à leurs instructions. Comme ils comptaient s’arrêter assez longtemps dans certains pays, leur voyage n’avait pas de limite fixe. On supposait pourtant qu’il durerait deux ou trois ans au moins ; mais Jobic n’eut garde de l’avouer tout de suite à la pauvre Marianne.
Vu l’importance de la mission confiée à ces deux inspecteurs, on leur avait donné le meilleur marcheur de tous les navires, le capitaine le plus capable et un équipage d’élite. Aussi n’était-ce qu’à grand’peine que Jobic avait obtenu du capitaine Tanguy, avec lequel il naviguait depuis six ans et qui appréciait beaucoup le brave matelot, la promesse d’engager comme mousse le petit Charlot. M. Tanguy avait même répondu d’abord par un refus.
« Capitaine, avait dit enfin Jobic, c’est le fils de ce pauvre Antoine Morand que vous avez connu à bord de la Suzanne ; vous savez bien, un timonier qui n’avait pas son pareil. Il s’est noyé l’année dernière en voulant sauver un ami ; sa veuve et ses enfants n’ont rien pour vivre. Le petit est encore un peu jeune, c’est vrai, mais je me charge de son éducation. D’ailleurs il est très grand et très fort pour son âge.
– Eh bien, amène-le, dit le capitaine.
– Merci, capitaine.
– Bien entendu je ne le prendrai définitivement qu’après l’avoir vu.
– Sans doute. Adieu, capitaine. »
Et déjà Jobic s’en allait, quand la voix du capitaine le rappela.
« Tu dis que ses parents sont pauvres ?
– Oui.
– Eh bien, si ce petit avait besoin de quelque chose pour son équipement, tu sais : du linge, des souliers, un tas de bêtises enfin… avance l’argent et je te le rendrai. Si tu n’en avais pas, écris-moi… tu entends ?
– Merci, capitaine, mais je suis là. Je me suis juré de veiller sur les enfants de mon pauvre Antoine, et le petit ne manquera de rien, allez.
– C’est bon, c’est bon… Va te promener alors, et laisse-moi faire mes connaissements. Attends donc. Jean, du rhum. »
Le domestique, qui remplissait une malle dans un coin de la chambre, apporta ce que demandait le capitaine. Jobic avala lestement ses deux verres de rhum comme si c’eût été de l’eau sucrée, et partit en remerciant le digne capitaine.
« Ah ! si j’avais seulement une douzaine de lurons et de braves comme celui-là ! » murmura M. Tanguy en suivant des yeux le matelot.
Il est bon de dire ici que M. Tanguy était Bas-Breton, et, par conséquent, fort disposé à bien accueillir ses compatriotes.
C’est à la suite de cette conversation que Jobic était parti pour Lanmodez avec l’intention de ramener Charlot au Havre avec lui.
CHAPITRE IX – Le trousseau de Charlot. – Les adieux. – Le cœur d’une mère.
Le Jean-Bart devant mettre à la voile à la fin du mois, il n’y avait pas de temps à perdre pour préparer le petit trousseau de Charlot. Sa mère se mit aussitôt à la besogne. Obligeantes comme on l’est presque toujours chez les pauvres gens, quelques voisines lui offrirent leurs services ; mais elle voulut tout faire par elle-même. Elle trouvait quelque consolation à s’occuper des vêtements que devait porter son fils bien-aimé.
Denise seule avait la permission de seconder sa mère ; elle y travaillait de tout son pouvoir. Souvent on voyait de grosses larmes couler sur les joues de Marianne et tomber sur l’ouvrage qu’elle tenait à la main. Alors Denise s’approchait tout doucement et embrassait sa mère, qui pleurait ensuite avec moins d’amertume.
Rosalie aussi voulut mettre la main au trousseau de son frère. On fut obligé de refaire secrètement tout ce qu’elle avait cousu, car ses points offraient les variations les plus imprévues : il y en avait de grands, de petits, de longs, de courts, de toute espèce enfin, excepté de solides, et cette qualité surtout est importante pour des vêtements qu’on emporte à bord. Il n’y avait pas là de blanchisseuse ; chaque matelot devait laver son propre linge, et le plus souvent à l’eau de mer, dont l’action est pernicieuse pour les tissus.
Quant à Fanchette, à qui Marianne avait appris à coudre, elle travaillait du matin au soir, même en mangeant le morceau de pain qu’elle emportait aux champs.
Il fallait la voir arriver toute rayonnante chez Marianne et lui remettre le mouchoir ou la chemise qu’elle venait d’ourler. Touchée du zèle que mettait cette enfant à la servir, la veuve la prenait dans ses bras et l’embrassait avec effusion.
« Il reviendra bientôt, allez, madame Marianne, disait Fanchette, et il vous apportera de l’argent. Il deviendra fort et bon comme Jobic ; ce sera un brave marin qui fera honneur à sa famille.
– Il sera capitaine ! s’écriait Rosalie.
– Capitaine des mousses, » répondait Jobic en riant.
Si le matelot avait laissé faire Marianne, celle-ci, malgré sa pauvreté, aurait trouvé moyen de remplir des caisses d’objets destinés à son fils.
« Vous vous figurez donc qu’on va lui donner une cabine ? disait Jobic. Il aura de la place pour son sac de marin, et tout juste encore. Ce qui ne pourra pas tenir dans le sac, voyez-vous, ça restera au Havre. Ce n’est donc pas la peine de dépenser votre argent et de vous exterminer de travail pour des choses inutiles.
– Mais, Jobic, il y a encore de la place, disait la pauvre mère en tendant de toutes ses forces le sac en grosse toile à voiles que devait emporter Charlot.
– Vous oubliez, Marianne, qu’il faut laisser de la place pour la chemise de laine et le béret que nous achèterons en arrivant au Havre.
– Le pauvre petit aura froid.
– Ta, ta, ta ! il a déjà plus d’affaires que les trois quarts de ses camarades. Il est fort et bien portant, ce garçon ; il n’a pas besoin d’emporter un chargement avec lui. »
Enfin tout se trouva terminé. Il fallut songer au départ. Marianne aurait bien voulu gagner encore quelques jours, mais Jobic y mit de la fermeté. Trouvant Charlot moins actif et moins futé que la plupart des petits mousses de son âge, il tenait à ce que l’enfant se dégourdît un peu avant le départ, en travaillant au chargement.
Il expliqua tout cela à sa mère, et elle fut bien obligée de reconnaître qu’il avait raison.
Un beau matin, la charrette d’un fermier voisin s’arrêta de bonne heure devant la porte des Morand. Marianne et Denise devaient accompagner Charlot jusqu’au village qu’il fallait traverser pour aller à Lézardrieux.
Charlot embrassa Rosalie qui pleurait et voulait partir avec lui. Puis il alla dire adieu aux animaux que chaque jour il menait au pâturage.
« Adieu, Bellone, dit-il à la vache blanche qui le regardait de son grand œil doux et mélancolique. Adieu, Kéban ; adieu, Brunette. »
Ni Bellone, ni Kéban, ni Brunette ne comprenaient les paroles de Charlot ; mais, voyant sa figure attristée, ils frottaient leurs bonnes têtes contre la poitrine de l’enfant pour le consoler et lui témoigner leur affection.
Quant à Kidu, il ne quittait pas son petit maître d’une semelle.
Sur la route, on rencontra Fanchette qui se tenait aux aguets pour dire adieu à son ancien camarade. Elle l’embrassa, lui glissa dans la main une petite médaille en plomb de saint Mathurin et une pièce de vingt sous, tout son trésor. Puis elle vint prendre la main de Marianne et la porta à ses lèvres avec un mouvement rempli d’effusion, exprimant par cette muette caresse la part qu’elle prenait à son chagrin. Charlot avait l’air très sérieux.
En arrivant, à Lanmodez, le fermier qui avait la complaisance de le conduire, ainsi que Jobic, jusqu’à Lézardrieux, fit une halte de cinq minutes pour prendre quelques commissions. Il était convenu que là se ferait l’adieu définitif du futur mousse et de sa famille.
Émerveillé de son voyage en charrette, étourdi à la pensée des belles choses qu’il allait voir, Charlot, qui n’avait pas encore atteint d’ailleurs l’âge où l’on comprend toute la douleur d’une séparation, avait naturellement bien du chagrin de quitter sa mère et ses sœurs ; mais c’était surtout de les voir pleurer qu’il pleurait lui-même.
La pauvre Marianne le tint longtemps pressé sur son cœur en appelant sur lui toutes les bénédictions du ciel.
Jobic fit un signe au fermier.
« Il est temps de partir, dit le paysan.
– Adieu, maman ! cria Charlot.
– Adieu, mon fils ! répondit Marianne. Sois bon et brave comme ton père, et que Dieu veille sur toi ! »
Les chevaux se mirent en mouvement, et les voyageurs s’éloignèrent.
Kidu avait vu son maître monter en voiture. Il le suivit en aboyant. On avait beau le renvoyer, il revenait toujours. Jobic le ramena à Marianne, qui fut obligée de l’attacher avec son mouchoir. Alors le pauvre chien, les yeux fixés sur la charrette qui emportait Charlot, se mit à pousser des hurlements plaintifs qui navraient le cœur de Marianne.
Elle et Denise restèrent sur la route tant qu’on put distinguer les voyageurs. Bientôt un tournant les déroba à leurs yeux.
Toutes deux entrèrent alors dans l’église, où Marianne s’agenouilla devant l’autel et pria longtemps.
Enfin Denise et Fanchette parvinrent à l’emmener en lui rappelant que Rosalie était seule à la maison.
Une fois de retour dans la chaumière, Marianne reprit ses occupations accoutumées ; mais on ne la vit plus sourire comme du temps où elle avait auprès d’elle son mari et son fils.
Chaque fois qu’il s’élevait une tempête, elle devenait sombre et inquiète. Ce n’était pas raisonnable, car Charlot étant déjà bien loin de France, l’orage qui régnait sur les côtes de Bretagne n’avait aucune influence sur le sort du Jean-Bart. Mais le cœur d’une mère s’alarme de tout.
Alors Denise et Rosalie redoublaient envers elle de soins et de prévenances. Toutes trois priaient ensemble, et le calme rentrait peu à peu dans l’âme de la pauvre Marianne.

CHAPITRE X – Arrivée au Havre. – Cadillac et Dur-à-cuire. – Entrevue avec le capitaine. – Le bâtiment met à la voile.
Nous n’essayerons pas de décrire les étonnements et les admirations de Charlot dorant son voyage et au moment de son arrivée au Havre.
Tout était nouveau, tout était magnifique pour un enfant qui n’avait jamais poussé ses excursions plus loin que Pleumeur, c’est-à-dire à trois lieues environ de Lanmodez.
« Ah ! mon Dieu ! s’écria-t-il en apercevant le port. Ah ! mon Dieu ! c’est comme une forêt sur l’eau ! »
Les étonnements de Charlot amusaient beaucoup son ami Jobic, qui lui donnait d’interminables explications avec une patience fort méritoire chez lui. Le matelot attendit deux ou trois jours avant de conduire son protégé chez le capitaine. Il craignait que l’air ahuri de Charlot ne produisît une mauvaise impression sur M. Tanguy.
Parmi les matelots déjà engagés sur le Jean-Bart, se trouvaient deux hommes qui avaient connu Antoine. Jobic leur présenta Charlot.
Avec des gens de cœur, cela suffisait ; Charlot pouvait désormais compter sur deux protecteurs de plus.
L’un d’eux était un vieux loup de mer, à la voix rude, à l’air grognon, qui semblait toujours prêt à dévorer les gens avec lesquels il causait. Il disait bonjour à son meilleur camarade du ton dont un autre aurait abordé son ennemi déclaré. Pierre Norzec était Breton comme Jobic et Charlot : car, en vrai Breton qu’il était, le capitaine Tanguy avait pris le plus possible de ses compatriotes.
Excellent homme au fond, Pierre avait des dehors si maussades qu’ils lui avaient valu le sobriquet de Dur-à-cuire.
L’autre ami de Charlot formait avec Norzec un contraste des plus piquants. Il se nommait Lazare Cadillac ; mais, grâce aux histoires peu vraisemblables qu’il avait coutume de raconter avec un aplomb magnifique, on l’appelait le plus souvent Cadicrac.
Par une bizarrerie fort commune, ces deux hommes de caractère si opposé étaient les meilleurs amis du monde. Du matin au soir, Cadillac taquinait son camarade, et le père Dur-à-cuire, que la moindre plaisanterie de la part d’un autre mettait en fureur, ne faisait que menacer Lazare de l’écorcher vif, ce qu’il n’avait jamais essayé de faire, on le pense bien.
Les mauvaises langues du bord prétendaient que leur attachement tenait surtout à ce que l’un était aussi bavard que l’autre était taciturne. Lazare parlait ; Pierre écoutait, et tout allait pour le mieux.
L’accueil fait à Charlot par ces deux matelots fut caractéristique.
« Ton nom ? demanda brusquement Norzec.
– Charlot.
– Âge ?
– Douze ans bientôt.
– Un franc marin, ton père. Travaille bien, sinon gare dessous ; je cogne. Faut pas faire honte à ton père. Veux-tu un verre de cognac, moussaillon ?
– Non, dit Cadillac, c’est trop fort pour ce petit ; donne-lui du cassis.
– Pouah ! fit dédaigneusement Norzec, des douceurs !
– Il ne prendra rien du tout, cela vaudra mieux, répondit Jobic qui était le plus raisonnable. Laissez-lui le temps de s’habituer.
– Accoste ici, moussaillon, dit Cadillac en empoignant Charlot qu’il mit entre ses jambes ; sais-tu la manière dont les singes mangent le sucre au Bengale ?
– Non, monsieur.
– Apporte du sucre, garçon. Hé, là-bas ! »
Le garçon de café accourut. Les matelots payent bien, mais il ne faut pas les faire attendre.
« Voilà, monsieur. »
Le garçon apporta cinq ou six morceaux de sucre, comme pour une tasse de café.
« Mets-en dans ta bouche, » dit Lazare au petit Morand.
L’enfant obéit, ne sachant trop s’il devait rire ou trembler.
« Croque. »
Charlot croqua. Comme il aimait le sucre, la démonstration lui plaisait assez jusque-là.
« Eh bien, lui dit gravement Lazare en le mettant devant une glace, pour manger le sucre les singes font exactement comme toi ; ils le croquent. »
L’enfant ne comprit d’abord rien à cette plaisanterie de matelot ; mais, au second morceau de sucre, il vit bien qu’elle n’avait d’autre but que de lui donner une friandise et de l’enhardir un peu en le faisant rire.
« Un mousse qui mange du sucre ! grommelait pendant ce temps le vieux Norzec. Pourquoi pas demander du chocolat et des glaces pour ce petit brigand ? Tiens, moussaillon, voilà dix sous pour toi ; mais si tu achètes des bonbons avec, je te hache en morceaux. Allons, file ton nœud ! »
Charlot profita de la permission pour s’établir sur le seuil de la porte entr’ouverte, et pour regarder de tous ses yeux un joueur d’orgue de Barbarie qui faisait danser deux petits chiens au son de cet instrument.
Quelques minutes après, Jobic vint le chercher. Ils sortaient ensemble, quand ils se trouvèrent nez à nez avec le capitaine Tanguy, qui passait par hasard dans la rue.
« C’est là ton protégé ? dit-il à Jobic en fronçant le sourcil.
– Oui, capitaine.
– Depuis quand êtes-vous au Havre ?

– Depuis huit jours, capitaine.
– Pourquoi ne me l’as-tu pas amené tout de suite ? »
Jobic ne savait pas mentir ; il balbutia quelques mots inintelligibles.
« Tu voulais le former auparavant, n’est-ce-pas ? C’est pour cela sans doute que tu le mènes déjà au cabaret, afin qu’il devienne un chenapan comme le petit Bernard, que vous avez perdu en le faisant boire et fumer.
– Capitaine, reprit Jobic tout honteux, c’était pour faire voir l’enfant à Norzec et à Cadillac, tous deux amis de son père, que je l’ai amené là.
– C’est différent. Mais il ne faut plus l’y conduire. À son âge, on place mal son amour-propre ; on veut être un homme en imitant les défauts des hommes qu’on voit autour de soi et qui frappent plus que leurs bonnes qualités. »
Tout en parlant, M. Tanguy écartait de la main les longs cheveux blonds qui couvraient le front du petit Morand.
« Tu as une honnête figure, mon garçon, lui dit-il, et tu ressembles à ton père. Tâche de lui ressembler en tout, car c’était un brave marin. »
Il fit causer Charlot. Quoique fort intimidé, notre ami ne répondit pas trop mal. Le capitaine l’eut bien vite jugé.
« Nous en ferons quelque chose, dit-il au matelot. L’écorce est épaisse, mais le cœur est bon. Sais-tu lire, Charlot ?
– Oui, capitaine.
– Écrire ?
– Oui, capitaine.
– Et calculer ?
– Un peu.
– Allons, à partir d’aujourd’hui, tu peux te regarder comme faisant partie de l’équipage du Jean-Bart. Écris-le à ta mère, et dis-lui que ton capitaine a connu ton père et aura soin de toi. »
Dès le lendemain, Jobic conduisit Charlot à bord du Jean-Bart, qui était amarré contre le quai et dont on complétait le chargement. L’enfant se mit immédiatement à la besogne. Il s’amusa beaucoup le premier jour ; le second, la tâche lui sembla un peu rude. Grâce à Jobic et à ses deux amis, on le ménageait beaucoup cependant ; mais, pour comprendre ce qu’est véritablement le travail, il faut avoir travaillé ailleurs que chez soi. Les enfants se figurent toujours qu’en dehors de la famille, ils trouveront plus d’indulgence et de liberté, et c’est justement le contraire qui arrive.
Quelques jours avant son départ du Havre, Charlot écrivit à sa mère la lettre suivante, qui lui coûta bien des heures de travail et force cheveux : car, lorsque les phrases ne lui venaient pas, il se grattait la tête avec une telle animation, qu’une grande correspondance n’eût pas tardé à le rendre chauve.
« Ma chère maman, écrivait-il, je me porte bien, et je désire que la présente vous trouve de même en bonne santé, et Denise et Rosalie et Fanchette aussi. Nous partons dans huit jours. C’est moi qui travaille dur, ma chère maman ! Ça m’ennuie bien quelquefois, va ; mais, quand je boude à l’ouvrage, Jobic me dit : Pense à ta mère qui a travaillé toute sa vie pour vous nourrir. Alors ça me donne du courage et je recommence.
« Le capitaine est content de moi, à preuve que, l’autre jour, il m’a donné, en passant, une tape sur la joue et que Bernard, au contraire, a reçu une calotte parce qu’il frottait le dos du chien d’un passager avec du tripoli, au lieu de frotter le cuivre de l’habitacle, et le chien n’était pas content. C’est Kidu qui aurait bien mordu, si on l’avait frotté comme ça. Mais Bernard est si drôle qu’il me fait rire tout de même. Il est toujours à me taquiner et à me conter un tas de choses extraordinaires. Je ne sais jamais quand il dit vrai ou quand il ne dit pas vrai. Des fois ça me vexe quand je le vois me rire au nez, et je lui flanque des coups, et il me les rend, car il a trois ans de plus que moi ; mais après je n’y pense plus, et je l’aime assez tout de même, parce qu’il est bien amusant.
« Figure-toi qu’il fume comme un vieux matelot, et qu’il boit de grands verres de cognac. Moi, un jour, j’ai voulu essayer ; mais ça m’a rendu malade, et Jobic m’a fichu des claques. Alors je n’ai pas eu envie de recommencer, je t’assure bien, d’autant plus qu’il m’a dit que ça te ferait du chagrin, et ça suffit pour que je ne le fasse plus jamais.
« Parce que, vois-tu, maintenant que me voilà quasiment un homme et que je vois comme c’est dur de gagner de l’argent, je comprends combien papa et toi vous avez été courageux et bons pour nous, et je veux devenir riche pour que tu ne travailles plus du tout, ni mes sœurs non plus, et que tu manges des crêpes et du lard tant que tu voudras, et que tu boives du cidre. Tu auras aussi une jolie petite maison blanche comme j’en vois ici, et de si beaux dindons avec des canards blancs et un petit bateau pour nous promener. Et puis Denise et Rosalie seront bien habillées, et la petite Fanchette demeurera chez nous, parce que je l’aime bien aussi. J’ai toujours ses vingt sous dans ma bourse et quarante-huit sous qu’on m’a donnés, pour des commissions que j’avais faites. Moi, je voulais te les envoyer, mais Jobic a dit qu’il fallait attendre à mon retour.
« Il est bien bon pour moi, Jobic, et le père Dur-à-cuire et Cadillac aussi. C’est celui-là qui te ferait rire avec ses histoires.
« Nous sommes bien nourris, je t’assure, et souvent je voudrais pouvoir mettre ma part dans ma poche pour l’apporter à mes petites sœurs. Dis à Denise de m’écrire une grande, grande lettre, si tu n’as pas le temps, toi, et qu’elle me raconte tout plein de choses. Et Rosalie, est-ce qu’elle commence à se faire obéir de Kéban ? Il ne faut pas surtout qu’elle lui jette des pierres, car il croit que c’est pour jouer ; il viendrait lui donner des coups de tête, et Rosalie tomberait par terre, puisque, moi qui suis fort, je tombais quelquefois. Il y a dans ce pays-ci de grosses, grosses vaches qui ont quasiment l’air de bœufs ; mais elles n’ont pas de bon lait comme Bellone. Est-ce que Brunette grimpe toujours sur les talus ? Bernard dit qu’il y a des pays où les chèvres paissent sur les grands arbres, mais je ne crois pas cela, n’est-ce-pas ?
« Dis à Rosalie d’embrasser bien mon pauvre Kidu pour moi… J’ai toujours envie de pleurer, quand je pense à vous ; mais Norzec et Jobic disent que c’est honteux pour un mousse d’avoir la larme à l’œil. Quand ça m’étouffe trop, je vais me cacher dans la hune, et là je pleure à mon aise. Mais ne dis cela à personne, car on se moquerait de moi.
« Je t’embrasse, ma bonne chère mère, comme je t’aime et mes sœurs aussi. Dis à Fanchette que je pense bien souvent à elle et que je l’aime parce qu’elle a été bonne pour toi.
« Et puis, comme je n’ai plus rien à te dire, je ferme ma lettre. Voilà trois jours que j’y travaille ; même j’en suis tout en nage, tant ça me donne chaud de tant écrire.
« Je t’embrasse de tout mon cœur, maman, et mes sœurs et Fanchette et tout le monde.
« Ton fils Charlot Morand, mousse à bord du Jean-Bart.
« Ce 28 mai 1840. »
Huit jours après l’envoi de cette longue missive, le Jean-Bart mettait à la voile et cinglait vers le Brésil.
CHAPITRE XI – Le Jean-Bart. – Vie de bord. – L’intérieur d’un navire. – Débuts de Charlot. – Mauvais tours de Bernard.
Coucher dans un hamac, morceau de toile à voile suspendu par des cordes, peut être favorable au sommeil des gens qui en ont l’habitude. Mais la première nuit que Charlot passa dans ce nouveau lit fut agitée ; chaque mouvement du vaisseau, en le secouant, disloquait ses membres. Il se leva moulu comme s’il avait reçu des coups de bâton.
« Mon gars, lui dit Jobic, dans soixante ans d’ici, tu ne voudras pas dormir ailleurs que là-dedans. Sais-tu, continua-t-il, que tu as de la chance de naviguer pour ton coup d’essai sur le Jean-Bart, un trois-mâts de huit cents tonneaux. »
Charlot regarda son ami et parut calculer en lui-même la place que tiendraient huit cents barriques de vin arrimées (rangées) à fond de cale.
Jobic lui expliqua que le tonneau est une mesure de poids, qui équivaut à 1 000 kilogrammes. Le Jean-Bart était capable de jauger (porter) 800 fois 1 000 kilogrammes. Il parut au petit mousse qu’un bâtiment semblable ne devait jamais éprouver de naufrage.

Cependant on s’occupait sur le pont de déterminer la vitesse de la marche du bâtiment. Un morceau de bois à peu près triangulaire, nommé loch, avait été jeté à l’eau et restait stationnaire, tandis que la corde qu’on y avait adaptée se déroulait rapidement. Au bout d’une minute, la quantité de corde ainsi dévidée indique la longueur de distance parcourue.
« Tout cela est si important, dit Jobic à Charlot, que chaque jour on consigne sur un livre spécial, nommé livre de loch, du nom de ce morceau de bois, quelle a été la marche du navire, quelle route il a tenue, les coups de vent, les avaries, les rencontres, etc. C’est la tâche de l’officier de quart, ainsi nommé parce que le temps de son service dure quatre heures. Les matelots se relaient aussi dans le même temps. Sur les navires de commerce, ils se divisent en deux bandes, deux bordées, et on les désigne sous le nom de tribordais ou bâbordais, selon qu’ils se trouvent à bâbord ou à tribord.
– Pourquoi, demanda Charlot, qui suivait toujours de l’œil le loch et sa longue corde, pourquoi y a-t-il des nœuds à cette corde ?
– Bon ! as-tu aussi remarqué que ces nœuds étaient faits à intervalles réguliers ? Celui qui tient la corde les compte quand ils lui passent sous le doigt. L’on sait alors que le vaisseau file six nœuds ou dix nœuds à l’heure, et c’est un autre moyen de connaître avec quelle rapidité l’on marche. »
Charlot vit encore avec plaisir qu’il voyagerait en compagnie de quelques moutons, d’une vache et d’une chèvre qu’on avait installés dans la chaloupe. Il se promit de chercher par là des amis.
Enfin, ne voulant pas négliger la pratique pour la théorie, Jobic commanda à son protégé de grimper au grand mât. Pour cela, des cordages nommés haubans sont disposés comme les montants d’une échelle double. Ils partent des flancs du navire et rejoignent le sommet de chaque mât. Les échelons sont en corde plus mince et plus tendue ; ils prennent le nom d’enfléchure. Mais un mât n’est point fait d’une seule pièce ; il se compose en réalité de trois mâts emboîtés les uns dans les autres. Au sommet de chacun, se trouve une espèce de plate-forme à jour, nommée hune. Au-dessus du grand mât s’élève le mât de hune, dont la voile prend la désignation de grand hunier ; puis vient le mât de perroquet, surmonté de celui de catacois ou plutôt cacatois, ainsi que le nomment tous les marins.
Malheureusement pour Charlot, maître Bernard, son collègue, lui avait raconté très sérieusement que le trou du chat, échancrure pratiquée dans la hune et par laquelle on passe pour aller plus haut, devait son nom à un chat énorme qui s’y tenait jour et nuit.
« Il ne dit rien aux anciens matelots, prétendait Bernard, mais il griffe et mord cruellement ceux qu’il ne connaît pas. »
Un novice (aspirant matelot) et deux autres marins avaient confirmé ce récit. Charlot commença donc à trembler quand Letallec lui ordonna de monter au grand mât, puis d’aller jusqu’aux barres de perroquet. Il gravissait lentement les enfléchures.
« Plus vite, lambin ! » lui cria Jobic.
À mesure qu’il approchait de la hune, Charlot ralentissait encore son ascension.
« Veux-tu monter ! » lui disait le matelot, mécontent de sa nonchalance.
Quant à Bernard et au novice, ils riaient à se tenir les côtes.
Jobic saisit un bout de corde et fit mine de s’élancer dans la mâture pour activer le mousse.
« Serais-tu poltron, mon gars ? » cria d’en bas le capitaine qui venait d’arriver.
À ces mots, la fierté du petit Breton domina tout autre sentiment. Il prit son élan, traversa le trou du chat, et grimpa d’un trait jusqu’aux barres de perroquet.
« L’enfant a du cœur, il ira bien, » murmura le capitaine en continuant son chemin.
Au bout de cinq ou six minutes, un bruit particulier le fit se retourner.
C’était maître Charlot qui, revenu de son expédition, tombait à coups de poing sur Bernard.
« La paix ! » dit le capitaine.
Les combattants se séparèrent. M. Tanguy eut bientôt appris la cause du combat.
« Mon enfant, dit-il à Charlot, qui roulait son béret d’un air confus, je ne veux point de bataille à mon bord. On ne se fâche pas ainsi pour une bagatelle. Quand on doit rester longtemps ensemble, il faut que chacun y mette du sien et qu’on se montre réciproquement indulgent.
– Oui, capitaine, soupira Charlot.
– Quant à toi, Bernard, il ne faut pas non plus que tes plaisanteries aillent trop loin ; autrement, c’est le martinet du contre-maître qui se chargerait du payement. »
Cette mercuriale n’empêcha point maître Bernard de mystifier bien d’autres fois son petit camarade ; mais peu à peu celui-ci devint plus avisé.
Un jour pourtant, il fut la dupe d’une autre aventure. Un passager avait recueilli un poisson volant. Ce poisson est à peu près de la dimension d’un petit hareng ; il a de grandes nageoires au moyen desquelles il s’enlève sur l’eau et peut se soutenir une ou deux minutes en l’air, jusqu’à ce qu’il retombe dans les flots, ou sur le pont de quelque navire. C’est le plus souvent pour se dérober à la voracité des dorades et des thons, qui leur font une guerre acharnée, que ces pauvres animaux se livrent à la gymnastique aérienne qui leur a mérité leur nom.
Charlot n’avait point vu le poisson, mais il avait entendu parler de la trouvaille faite par le passager. Après avoir préparé la chose longtemps à l’avance par ses récits, Bernard vint informer son camarade que le chirurgien du bord l’envoyait dire au coq de mettre à la broche les deux ailes du poisson volant.
Charlot, devant lequel on parlait depuis une heure de cet animal comme d’une sorte de poulet ou de pigeon aquatique, accomplit naïvement la prétendue commission du chirurgien.
Par malheur, le coq avait encouru la veille de sévères reproches au sujet d’une fricassée de poulets, qui ne contenait que quatre ailes pour trois têtes et six cuisses. Le capitaine n’ayant jamais voulu consentir à attribuer ce déficit à une mauvaise conformation de ses poulets, le coq avait été mis à la demi-ration de vin pendant trois jours.
Déjà de mauvaise humeur, il prit pour une raillerie le message du pauvre Charlot et l’en récompensa immédiatement par un rude soufflet. Éclairé sur la mystification dont il venait d’être victime, Charlot s’en retourna, l’oreille basse, vers les matelots qui riaient de bon cœur.
« Eh bien, Charlot, qu’a répondu le coq ? demanda Bernard d’un ton gouailleur.
– Voilà sa réponse, » repartit le petit Breton en rendant généreusement à Bernard le soufflet qu’il avait reçu.
Peu soucieux de ce présent, Bernard riposta. Par malheur pour lui, vint à passer le second, c’est-à-dire l’officier placé immédiatement après le capitaine et dont l’autorité prime celle du lieutenant, qui n’est que le troisième officier du bord. Pour s’être servi indûment du nom du chirurgien, Bernard fut condamné à douze coups de martinet qui lui furent appliqués immédiatement, au grand désespoir de Charlot qui criait :
« Donnez-m’en la moitié. J’en mérite bien six pour avoir été si bête ! »
Bernard, au milieu de son supplice, essayait de le consoler.
« On n’en meurt pas, lui disait-il, et dans un sens ça fait du bien, car on s’en veut tout de même d’être si taquin. Mais que veux-tu, Charlot, c’est plus fort que moi ; dès qu’une malice me passe par la tête, je la mets à l’air. Et voilà les suites, » ajouta l’étourdi, en montrant ses épaules meurtries à Charlot.
CHAPITRE XII – Charlot fait connaissance avec un passager. – Le passage de la ligne. – Le Père Tropique et son cortège. – Le baptême. – Tempête à l’horizon.
Au moment de quitter son fils, Marianne lui avait fait promettre qu’il travaillerait l’écriture et l’arithmétique chaque fois qu’il en trouverait l’occasion ; Jobic avait donné sa parole qu’il y veillerait. Il est bon de dire ici que, de tout temps, Charlot avait eu de grandes dispositions pour le calcul.
Un jour qu’assis à l’écart, il se livrait à une division compliquée, il s’aperçut, en relevant la tête, qu’un passager le regardait travailler. Charlot connaissait déjà de vue M. Lambert Villiers, l’inspecteur chargé par la Compagnie de l’importante mission à laquelle on avait affecté le Jean-Bart.
M. Villiers devait avoir une quarantaine d’années. Il était petit, brun, et déjà presque chauve. Sa physionomie un peu triste révélait une grande intelligence, et ses yeux annonçaient un caractère actif et résolu.
« Que fais-tu là, mon enfant ? demanda-t-il.
– Une division, monsieur.
– Voyons cela. »
Rouge jusqu’aux oreilles, Charlot montra son papier.

« Et tu as le courage de travailler ainsi sans maître ?
– Je l’avais promis à maman.
– C’est bien, mon ami, très bien. Tu dois aimer la lecture ?
– Je crois que oui, monsieur.
– Tu crois ?
– Autrefois je ne l’aimais pas beaucoup ; mais maintenant il me semble que je l’aimerais.
– Je n’ai malheureusement que des livres trop sérieux pour toi, reprit l’ingénieur, après un instant de silence. N’importe, viens dans ma cabine quand tu ne seras pas de quart, nous verrons à te trouver quelque chose. »
Malgré la bienveillance que lui avait témoignée M. Villiers, le pauvre Charlot n’osait aller le trouver. Il est défendu aux gens de l’équipage de passer sur l’arrière, à moins que ce ne soit pour les besoins du service, et l’enfant avait peur d’enfreindre la consigne.
Au risque de se faire punir, Jobic prit le mousse par la main et le conduisit chez M. Villiers. Il y gagna un verre de rhum et un cigare, et il se retira, laissant Charlot en train de causer avec l’inspecteur, que le babil du mousse amusait. De tout temps Charlot avait été bon et serviable ; mais son indolence l’avait souvent empêché de montrer ses bonnes qualités. Maintenant qu’il avait gagné de l’activité et perdu son air endormi, il commençait à paraître ce qu’il était réellement, un bon garçon intelligent, honnête et le cœur sur la main.
Sa franchise et sa modestie plurent à M. Villiers. Il parla de Charlot au capitaine, et celui-ci le confirma dans la bonne opinion qu’il avait conçue de notre ami.
Appelé de temps en temps chez l’inspecteur, Charlot fut chargé de divers petits arrangements à faire dans sa cabine. Son empressement le rendit d’abord assez maladroit ; mais, avec l’habitude, il reprit du sang-froid et finit par se rendre véritablement utile à son protecteur, qui s’intéressait à lui toujours davantage. Lui trouvant des dispositions pour les mathématiques, M. Villiers lui en donna quelques leçons. Charlot fit des progrès rapides. Il comprenait tout et n’oubliait pas le lendemain ce qu’il avait appris la veille. Bientôt la reconnaissance et l’affection qu’il éprouvait pour M. Villiers augmentèrent encore son ardeur au travail. De son côté, l’inspecteur le prit tout à fait en amitié.
Cependant, on approchait de l’équateur, ligne imaginaire qui sépare le globe en deux parties à égales distances des pôles. L’usage existe, sur les vaisseaux, de célébrer le passage de cette ligne par une cérémonie qu’on appelle le Baptême du Père Tropique.
Le capitaine, très exigeant sous le rapport du travail et de la discipline, était en revanche disposé à laisser jouir son équipage de toutes les distractions qui ne nuisaient pas à la régularité du service. Il autorisa donc les matelots à célébrer le Baptême du Père Tropique.
Sur le rang d’avant (gaillard d’avant), on s’occupait activement des préparatifs de cette solennité.
Quand vint le grand jour, une grêle de fèves et de haricots, tombant du haut de la mâture, annonça qu’un grave événement se préparait dans les régions célestes.
Bientôt parut un postillon, coiffé d’un chapeau ciré, tout couvert de rubans et chaussé de longues bottes comme en portent les pêcheurs de Terre-Neuve ; à ces bottes s’adaptaient de gigantesques éperons mexicains dont les molettes avaient au moins sept à huit centimètres de diamètre. Il s’approcha du capitaine, qui se promenait les mains derrière le dos sur la dunette, et lui fit un petit discours.
Le but de cette harangue était de lui annoncer la visite du Père Tropique, souverain des contrées que traversait le Jean-Bart.
« Très bien, répondit le capitaine, tu peux dire à Sa Majesté que nous la recevrons avec les égards qui lui sont dus.
– Et son épouse ?
– Et son épouse aussi. »
Le postillon s’inclina, fit tourner bride au long bâton sur lequel il était à cheval, et se dirigea vers l’avant. En descendant de la dunette, il embarrassa ses éperons l’un dans l’autre et fit la plus belle culbute du monde.
On se mit à rire, le postillon se releva, fouetta vigoureusement son coursier en bois qu’il accusa de l’avoir désarçonné par une ruade, et alla rejoindre son souverain.
Pendant ce temps, les passagers et les officiers se rassemblaient pour attendre la visite du Père Tropique. Le capitaine se tenait un peu en avant.
Un vacarme infernal, produit par une clarinette, un violon, un flageolet, deux couvercles de casseroles et un petit baril vide sur lequel on frappait comme sur une grosse caisse, servit d’ouverture à la cérémonie.
Deux matelots, affublés de longues barbes d’étoupe, coiffés de bonnets de carton, vêtus de manteaux romains représentés par des couvertures et portant chacun une hache d’abordage, se présentèrent d’abord comme les sapeurs d’un régiment.
Deux petits anges couverts de plumes, que le goudron collait sur leur corps, servaient de pages au souverain. Ces anges étaient les deux mousses Bernard et René. Charlot, devant subir le baptême, ne figurait pas dans le cortège.
Enfin parut le Père Tropique, qui n’était autre que Lazare Cadillac. Une barbe immense, faite avec des copeaux de menuisier, assortie à sa longue chevelure, lui descendait jusqu’aux jambes. Il portait une armure de carton doré, un manteau royal qui avait été et qui devait redevenir une courtepointe en indienne à franges ; des bottes de Terre-Neuve et trois petites casseroles en guise de montre et de breloques, complétaient son costume.
Sa tendre épouse l’accompagnait. Le novice qui jouait ce rôle, et qui n’était point laid, s’était badigeonné le visage avec de la farine et prenait des airs timides et modestes tout à fait convenables à son emploi. Comme ensemble, sa toilette laissait un peu à désirer. Sa robe ne dépassait guère le genou, et ses gros souliers juraient avec ses bas de soie confectionnés au moyen d’un vieux foulard blanc. Quant à trouver un bonnet pareil au sien, je défierais toutes les modistes parisiennes d’y parvenir. Fleurs fanées, dentelles en papier, franges en étoupe, plumes d’oies et de canards en guise de marabouts, ce prodigieux bonnet réunissait tout ce qu’on peut désirer. Aussi avait-il la hauteur d’un bonnet à poil.
Sa Majesté féminine tenait dans ses bras un poupon composé d’un sac bourré de copeaux, et elle lui prodiguait les plus tendres caresses.
Derrière ces nobles personnages, gambadaient les courtisans les plus étranges que puisse rêver l’imagination d’un peintre fantaisiste. Et quels cris, quelles contorsions, quels éclats de rire !
Les matelots ne s’amusent pas souvent et ne rient guère ; mais, quand ils s’y mettent, c’est de tout leur cœur.
Arrivé devant le capitaine, le Père Tropique brandit son sceptre.
« Silence ! dit-il.
– Silence ! » répétèrent les courtisans.
Un silence profond régna aussitôt. Le Père Tropique commença une longue harangue, dont les termes sont consacrés par l’usage et que nous ne répéterons pas ici.
Le capitaine lui répondit en quelques mots et lui accorda la permission de baptiser les nouveaux venus.
Le royal cortège fit volte-face et se retira, tandis que les haricots pleuvaient comme de plus belle.
Un grand baquet rempli d’eau fut placé sur l’avant et recouvert d’une planche mobile. De chaque côté se tenaient les courriers et les licteurs de Sa Majesté.
Les nouveaux passagers furent conduits devant le Père Tropique. Selon la générosité de leur offrande, on se contentait de leur jeter un peu d’eau de Cologne dans la manche, ou bien on les inondait d’eau de mer.
Charlot, passant la ligne pour la première fois, devait subir le baptême dans toute sa rigueur.
Comme Jobic savait qu’il ne supportait pas très bien les plaisanteries, il lui avait recommandé de ne point se fâcher, quelque mauvais tour qu’on pût lui jouer.
Charlot l’avait promis un peu à contre-cœur, et non sans une certaine appréhension des épreuves mystérieuses qu’il allait avoir à subir.
À l’appel de son nom, les deux satellites le conduisirent aux pieds de Sa Majesté.
« Quel est ton nom ? demanda le Père Tropique.
– Charlot Morand.
– Tu es le fils d’un brave marin qui nous a souvent présenté ses hommages. Assieds-toi là. »
On fit asseoir Charlot tout ému sur la planche qui recouvrait une cuve remplie d’eau. Le Père Tropique fit un petit discours sur les devoirs d’un bon mousse. Charlot dut embrasser une sorte de grande férule blanchie d’un côté avec de la farine, et noircie de l’autre avec du noir de fumée. À la suite de ces baisers, il fut, à son insu, badigeonné de noir et de blanc.
Pendant qu’il récitait la formule du serment que lui dictait un matelot costumé en sauvage, on retira brusquement la planche et Charlot tomba dans l’eau… pas la tête la première… au contraire. En même temps un seau d’eau, qu’on tenait suspendu au-dessus de lui, compléta sa douche.
« Pouah ! Pouah ! » fit le pauvre garçon, qui se crut noyé.
Il sortit enfin de sa baignoire dans un état facile à comprendre, et se sauva à toutes jambes au milieu des éclats de rire des matelots. Bernard surtout le retenait pour s’amuser de sa colère ; mal lui en prit. Fidèle à sa promesse, Charlot ne lui administra pas le moindre coup de poing ; il le saisit au contraire dans ses bras et l’embrassa si affectueusement que le pauvre ange se trouva bientôt aussi mouillé que Charlot.
Cet épisode fit rire tout le monde, et notre héros encore plus que personne.
Tandis que les matelots se poursuivaient jusque dans la mâture avec des seaux d’eau et se servaient même des pompes à incendie du navire pour s’arroser réciproquement, le capitaine interrogeait l’horizon d’un regard attentif. Des signes imperceptibles pour tout autre qu’un marin expérimenté lui faisaient redouter un ouragan soudain, comme il en arrive quelquefois dans ces parages.
Bientôt son parti fut pris. Il donna quelques ordres. Le Père Tropique, sa famille et ses courtisans, tous furent en cinq minutes parés (prêts) pour la manœuvre. Les matelots s’étaient débarrassés en un clin d’œil de leurs costumes fantastiques ; mais les pauvres anges, qui ne pouvaient enlever leur goudron et leurs plumes qu’à grand renfort d’huile, de graisse ou de beurre, durent manœuvrer toute la journée sous ce costume peu commode.
CHAPITRE XIII – La tempête. – Un homme à la mer. – Courage de Charlot. – Arrivée à Rio-Janeiro. – M. Villiers.
La tempête éclata bientôt dans toute sa fureur. Le navire bondissait sur les vagues. Son beaupré, à chaque coup de tangage, disparaissait dans les flots.
Tout autre que des marins exercés demeurait dans sa cabine. Cependant M. Villiers avait voulu rester sur la dunette. C’est une sorte de maison en bois, s’élevant au-dessus du pont et surmontée d’un autre pont qui lui sert de couverture et de terrasse. Sur ce second pont est placé le gouvernail.
Au moment où le navire se câbrait, pour ainsi dire, afin de franchir la cime d’une vague énorme, une autre vague arriva et balaya tout ce qui se trouvait sur la dunette, sauf le timonier, qui se cramponnait à la roue. Quant au capitaine, il était alors sur son banc de quart.
Entraîné par la vague furieuse, M. Villiers disparut.
« Un homme à la mer ! dit le timonier. – Deux hommes à la mer ! » ajouta-t-il aussitôt.
Le second homme, c’était notre ami Charlot. À l’instant où M. Villiers était enlevé de dessus le bord, le mousse apportait en courant un cordage que le timonier avait demandé pour l’aider à maintenir la roue du gouvernail.
Avec une présence d’esprit qu’on n’aurait jamais attendue d’un enfant de cet âge, Charlot remit une des extrémités de la corde au timonier ; puis, conservant l’autre à la main, il se jeta résolument à l’eau avant que le marin pût le retenir.
Quoique Charlot, élevé sur les bords de la mer, nageât comme un petit poisson, sa tentative n’en était pas moins dangereuse. Mais le brave enfant n’avait consulté que son cœur et sa reconnaissance pour M. Villiers.
Dieu voulut sans doute l’en récompenser. Par un hasard miraculeux, il se trouva tout près de celui qu’il cherchait à sauver. Malgré cela, il avait peine à le rejoindre ; les vagues le lui cachaient de temps en temps et les éloignaient l’un de l’autre. Enfin, un moment rapprochés, ils saisirent ensemble une des bouées de sauvetage qu’on leur jetait du navire. Tous deux s’y cramponnèrent, et, grâce à la corde que le mousse n’avait pas lâchée, on les hala jusque sous la poupe, et on leur lança d’autres cordages. Tous leurs efforts n’empêchèrent point qu’une vague ne les emportât encore à quelque distance. Mais on les ramena de nouveau, et on parvint enfin à les hisser sur la dunette. Charlot avait perdu connaissance. Par un mouvement instinctif, il tenait son cordage avec tant de force qu’on eut mille peines à le retirer de ses doigts crispés.
Quand il revint à lui, il reçut les compliments de tout le monde. Jobic et Lazare l’embrassèrent. Le père Dur-à-cuire murmura en levant les épaules :
« Eh bien, mon garçon, à te voir manger ton sucre, là-bas au Havre, je ne t’aurais pas cru si brave. »
Le digne matelot n’avait jamais pu digérer ce sucre-là.
L’héroïque conduite de Charlot fut consignée sur le livre de bord, et le capitaine le félicita chaleureusement. Quant à M. Villiers, qui avait montré pendant l’accident un sang-froid extraordinaire, il ne le perdit qu’en serrant dans ses bras le brave petit garçon auquel il devait la vie.
Comme la tempête n’était pas encore à sa fin, Charlot se déroba aux remerciements de M. Villiers pour retourner à son poste. En le voyant arriver sur le gaillard d’avant, les matelots l’applaudirent.
« Charlot, mon garçon, dit Cadillac, qui aurait plaisanté sur un gril brûlant, je te nomme colonel de mon régiment, le 1er plongeur à cheval, et je te décore de la médaille de sauvetage. »
Il fit mine en même temps de lui accrocher sur la poitrine un couvercle de casserole. Mais, tout en plaisantant ainsi, il serra cordialement la main du petit mousse.
Une manœuvre dispersa tout le monde.
Au bout de quelques heures, la tempête se calma enfin. On put reprendre la route directe au lieu de continuer à fuir devant le vent, ou vent arrière, c’est-à-dire dans le même sens que le vent.
Pendant la soirée, M. Villiers se promena longtemps sur le pont en compagnie du capitaine Tanguy. Ils causaient avec une certaine animation. Le timonier, qui entendait quelques mots de leur conversation chaque fois qu’ils arrivaient près de lui, raconta qu’ils avaient prononcé plus d’une fois le nom de Charlot.
D’après le peu qu’il avait saisi, il lui semblait que M. Villiers émettait quelque projet à l’égard du petit mousse, et que le capitaine l’engageait à en différer l’accomplissement.
« Laissez-le se former auparavant, répondait M. Tanguy ; plus tard, il vous remerciera d’avoir attendu. »
De quoi s’agissait-il ? Voilà ce que le matelot ne put dire à Jobic.
Malgré ses bonnes qualités, l’enfant n’était point parfait. Bien d’autres que lui d’ailleurs se fussent laissé enivrer par les éloges qu’il recevait. Il se crut tout de suite un grand personnage, et, suivant l’expression populaire, il posa un peu.
Les actes de courage et de dévouement sont chose trop commune parmi les marins pour qu’on en parle bien longtemps. Au bout de quelques jours, quoi qu’on n’eût pas oublié le courage de Charlot, et qu’on le traitât moins brusquement que ses camarades, on ne lui parlait plus de ses exploits. Alors Charlot en parla de lui-même. Les deux premières fois, cela passa sans observation. Mais un jour, Dur-à-cuire lui dit de son air bourru :
« Laisse-nous tranquilles avec ton histoire, moussaillon. On ne se vante pas ainsi, que diable ! Au large ! »
Voyant que Charlot se retirait tout piteux, Cadillac l’empoigna par le bras :
« Je vais t’expliquer ce que Dur-à-cuire vient de te narrer si gracieusement, dit-il en saluant ironiquement le vieux matelot. Ce que tu as fait l’autre jour est bien, assurément, surtout pour un enfant comme toi, mais tu gâtes ton affaire en en causant à perpétuité. Parmi les hommes qui t’entourent, il n’en est guère qui n’auraient quelques traits de même genre à citer. Vois un peu s’ils en jacassent comme toi à tout propos. Les éloges, faut les attendre et ne jamais aller les chercher.
– Quand on est brave, faut pas être vaniteux, comprends-tu ? ajouta Jobic.
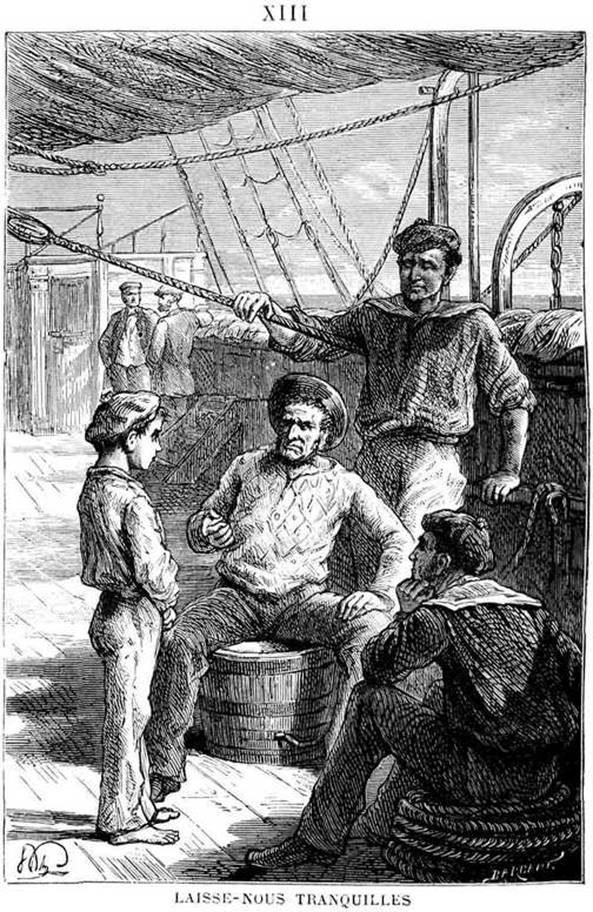
– Oui, Jobic, murmura Charlot honteux.
– Tiens, moi, par exemple, reprit Lazare, un jour qu’il faisait nuit, j’ai sauvé une diligence à douze places et cinq chevaux, qui était entrée au grand trot dans le ventre d’une baleine avec les vingt-trois voyageurs qu’elle contenait, et trois chats dont deux chiens. Eh bien, tu vois que je n’en parle jamais.
– Et comment as-tu fait pour sauver ta diligence ? demanda Jobic.
– J’ai frappé (attaché) une amarre sur le timon de la voiture, j’ai roulé l’autre extrémité autour d’un boulet, avec lequel j’ai chargé un canon, puis j’ai mis le feu à la pièce. En sautant, le boulet a entraîné la voiture, les douze chevaux, les quarante voyageurs et les trois éléphants.
– Tu disais trois chats.
– Oui, mais ils avaient trouvé tant de souris dans le ventre de la baleine qu’ils étaient devenus gros comme des éléphants. »
Comme maître Cadillac débitait ces folies d’un air impassible et du ton le plus grave, tout le monde se mit à rire, et Charlot fit chorus.
Il profita néanmoins de l’avis du matelot, et sa modestie acheva de lui concilier l’affection de l’équipage.
Quant à M. Villiers, il redoubla de sollicitude envers son nouveau protégé. Il avait obtenu du capitaine que le mousse aurait chaque soir quelque liberté pour lire et travailler. Il lui demandait compte de ses lectures, causait avec lui de façon à développer son esprit, et le poussait vivement en mathématiques.
Après une traversée de deux mois, le Jean-Bart arriva en vue de Rio-Janeiro.
Rio-Janeiro, capitale du Brésil, est une ville de 200 000 âmes. La population se compose de blancs, de métis, de mulâtres, de nègres et d’Indiens. Ceux-ci, maintenant peu nombreux et dans une misérable condition, descendent des premiers habitants du pays. On évalue à deux ou trois millions le nombre des nègres esclaves.
La traite (commerce des nègres) est à présent interdite par les lois, mais, au moment dont nous parlons, elle avait lieu encore clandestinement, à la honte de l’humanité.
La langue du pays est le portugais. La plupart des blancs savent aussi l’anglais ou le français. Presque tous sont catholiques.
Située à l’entrée d’une baie magnifique et encadrée de pittoresques montagnes, Rio-Janeiro se compose de maisons à un seul étage construites à l’européenne et n’offrant rien de pittoresque. Le port est un des plus beaux du monde. La ville est excessivement sale. Comme il n’y a pas d’égouts, chaque ondée de pluie transforme les rues en rivières qui emprisonnent les gens dans leurs maisons.
M. Villiers avait à faire diverses études sur les ressources et les relations commerciales de Rio-Janeiro ; il loua une maison dans la rue principale, qu’on appelle Rua Dircita. Les matelots étant peu occupés, il obtint du capitaine la permission d’emmener Charlot, sous prétexte de l’employer à faire des commissions.
Le premier soin de notre ami, en débarquant, fut de porter lui-même à la poste une lettre pour sa mère. Cette lettre était un petit volume auquel, depuis longtemps, il employait les soirées. Il contait sa vie à bord, ses études, les bontés de M. Villiers ; il disait surtout le grand désir qu’il avait de revoir sa famille.
Dans la chaumière, Charlot était, comme on le pense bien, le sujet toujours renaissant des causeries, l’objet de tous les rêves, l’inquiétude et l’espoir de sa mère et de ses sœurs. Aucun petit événement n’avait lieu qui ne rappelât son souvenir et le regret de son absence. Quand Rosalie eut des souliers neufs, elle eût bien voulu faire admirer à Charlot son petit pied chaussé de bleu. Denise parlait de lui, même à Kéban. Chaque soir les deux enfants et leur mère répétaient ensemble la prière des marins : « Mon Dieu, épargnez au vaisseau qui le porte le vent et la fureur des flots. Préservez-le lui-même de tout mal ; faites que nous le revoyions heureux. Mais si vous en ordonnez autrement, donnez à lui et à nous force et courage. »
Fanchette prenait sa part de tous ces vœux, de toutes ces pensées ; bonne, active, intelligente, elle avait gagné l’affection de ses maîtres, qui la traitaient mieux qu’une servante ordinaire. Le curé continuait de lui donner des leçons ; elle savait l’histoire sainte, le catéchisme, elle apprenait l’arithmétique, et, dans les longues soirées d’hiver, c’était elle qui lisait à haute voix, autour du foyer qui réunissait la famille, des livres choisis par le digne prêtre.
Par elle, celui-ci connut bientôt davantage Marianne, Charlot, Denise et Rosalie. Il accompagna Fanchette quand elle allait voir ses amis, et ses visites laissaient toujours les pauvres gens plus heureux et en meilleur espoir. Il pourvoyait aussi à ce que Marianne, dont le chagrin avait altéré la santé, eût de temps en temps du bouillon et un peu de bon vin. Enfin il s’occupait des enfants, contait des histoires à Rosalie, encourageait Denise à profiter de ses rares instants de loisir pour se perfectionner dans la lecture.
La petite avait appris, comme son frère, avec l’instituteur ; mais elle n’avait pas le temps de continuer ses leçons ; seulement M. Nicolas la prenait avec soi pendant deux heures pour lui faire lire quelque livre utile.
M. Nicolas aussi était un des bons amis de la famille ; il aimait à parler de son petit élève absent.
« Vous verrez, Mme Marianne, que ce garçon-là fera son chemin. Il a de l’intelligence et du cœur.
– Pour du cœur, monsieur, bien sûr il en a, disait Marianne. C’est un brave enfant ; que Dieu le bénisse ! »
Aussi nous avons vu que Dieu bénissait Charlot.
CHAPITRE XIV – Les nègres. – Le masque de fer-blanc. – La grâce de Morabé. – Voyage dans l’intérieur. – Expédition de Charlot. – Culbute. – Le manioc. – Un vilain camarade de lit. – Un rôti de serpent.
Pendant quelques jours, Charlot parcourut la ville avec M. Villiers. L’inspecteur rencontrait à chaque instant l’occasion d’apprendre quelque chose à son petit protégé.
Celui-ci, encouragé, ne tarissait pas en questions, et ce désir de savoir faisait qu’on s’intéressait à lui davantage encore.
De proche en proche, tous les sujets furent abordés. Charlot apprit l’histoire de la découverte de l’Amérique. Il sut que le premier Européen qui mit le pied au Brésil, en 1500, fut un Portugais nommé Janez Pinzon. Il sut que Rio-Janeiro, fondée par les Portugais, en 1556, cédée aux Hollandais en 1640, et par ceux-ci à la maison de Bragance, fut prise par Duguay-Trouin en 1711.
Quand le petit mousse entendait dire la belle conduite et les exploits d’un grand capitaine, son cœur se gonflait d’admiration ; il éprouvait à la fois le désir de se distinguer un jour, et la tristesse d’en être peut-être incapable.
« Mon cher enfant, lui répétait alors M. Villiers, songe uniquement à la tâche quotidienne. Chaque fois qu’il faut agir, agis pour le mieux en suivant l’inspiration de ta conscience. Duguay-Trouin et les honnêtes gens de tout temps et de tous pays n’ont pas fait autre chose. »
Parmi les objets nouveaux qui surprenaient Charlot, la vue des nègres esclaves fut ce qui lui causa la plus vive impression.
Ces malheureux à demi nus, vêtus de haillons, circulaient dans les rues courbés sous le poids de lourds fardeaux et traités comme des animaux. Le cœur de l’enfant saignait devant cette dégradation.
Un jour M. Villiers reçut d’un de ses correspondants, le señor Paraõ, divers objets qui lui furent apportés par un nègre dont le visage était couvert d’un masque de fer-blanc retenu derrière la tête au moyen d’un cadenas. C’est un procédé qu’on emploie souvent pour empêcher les nègres de manger de la terre. Quelques-uns, en effet, sont affectés d’une maladie d’estomac qui les porte à dévorer de la terre et du charbon, et lorsqu’on les laisse satisfaire ce goût dépravé, ils ne tardent pas à succomber.
On se sert aussi du masque comme instrument de punition, mais cela arrive rarement. Tel était cependant le cas pour le nègre dont nous parlons. Il appartenait à un ancien négrier enrichi par la traite, qui avait la réputation trop méritée d’être excessivement dur pour ses esclaves.
Un jour qu’il frappait à coups de pied le fils de ce nègre, un petit garçon de huit à dix ans, le pauvre père céda au cri de son cœur et voulut défendre son fils. Convaincu d’avoir levé la main sur son maître, il fut saisi, garrotté et roué de coups.
Le señor Paraõ pouvait le faire condamner à mort ; mais il ne se souciait pas de perdre un esclave aussi robuste et aussi intelligent que Morabé. Il lui fit grâce de la vie, non par humanité, mais par calcul ; seulement il se vengea plus cruellement encore peut-être en lui faisant infliger à diverses reprises autant de coups de fouet que le malheureux pouvait en supporter sans mourir, et surtout en le condamnant au terrible supplice du masque.
Tandis que M. Villiers examinait les objets qu’on lui apportait, le nègre raconta son histoire au petit mousse dont l’âge lui rappelait celui de son fils.
Quand Morabé fut parti, Charlot commença à rôder autour de l’inspecteur comme un enfant qui a quelque chose à demander et qui n’ose.
« Qu’as-tu donc ? » demanda M. Villiers.
Charlot raconta l’histoire de Morabé.
« Eh bien ? dit M. Villiers, qui voyait déjà venir maître Charlot.
– Eh bien, monsieur, le señor Paraõ répète sans cesse que toute sa maison est à votre disposition…
– Après ?
– Si vous lui demandiez la grâce de Morabé, il vous l’accorderait…
– Petit intrigant ! » répondit M. Villiers en passant sa main sur la tête de l’enfant.
Celui-ci comprit que sa cause était gagnée, et ses yeux brillèrent de joie.
Le lendemain, en effet, M. Villiers l’envoya chez le señor Paraõ, et la première personne qu’il rencontra dans la cour fut le pauvre Morabé délivré de son masque.
L’esclave courut à Charlot et le remercia chaleureusement. « Si jamais le petit blanc a besoin de moi, dit-il, je lui appartiens. »
Charlot fut très heureux de voir le pauvre homme libre de respirer, mais il ne songea pas que Morabé pût jamais lui rendre aucun service.
Cependant l’inspecteur devait aller en excursion dans l’intérieur du pays. Comme une partie du trajet se faisait par eau, le capitaine lui offrit la chaloupe du bâtiment et lui donna pour équipage l’élite des matelots du Jean-Bart ; Jobic, Pierre Norzec et Cadillac en firent naturellement partie. Charlot obtint aussi de suivre M. Villiers qui avait hésité à l’emmener, car il craignait pour lui les fièvres si communes dans ce pays.
La chaloupe fut placée sous le commandement de M. Noël Ganflé, le plus positif, le plus exact et le plus taciturne officier que M. Villiers eût jamais rencontré dans ses nombreux voyages. Marcel Gautier, le chirurgien du Jean-Bart, obtint l’autorisation de faire partie de l’expédition.
Le trajet eut lieu sans incident remarquable. On débarqua le soir auprès de la petite ville de San-Juan, située à 40 leguas environ de Rio-de-Janeiro. La legua brésilienne équivaut à peu près à 1600 mètres.
M. Villiers, le lieutenant et le chirurgien couchèrent dans un hôtel, si toutefois l’on peut donner ce nom à une affreuse maison où l’on ne trouve ni à boire ni à manger et où la vermine seule abonde.

On avait affirmé à l’inspecteur que la route était sûre ; mais, comme les nègres marrons (évadés) s’étaient réfugiés de ce côté, M. Villiers avait pris la précaution de se faire accompagner d’une partie de son monde.
Le soir même de l’arrivée à San-Juan, il ordonna qu’on lui amenât des mulets pour le lendemain. À la pointe du jour on se mit en marche.
L’escorte se composait de Jobic, du père Dur-à-cuire et de son inséparable Cadillac, d’un novice, de Charlot et de Bernard Louviers. Nous avons oublié de dire que ce dernier faisait partie de l’équipage de la chaloupe. Ce n’était pas grâce à sa bonne conduite qu’il avait obtenu cette faveur, car le capitaine était toujours plus mécontent de lui ; mais M. Tanguy voulait soustraire Bernard à l’influence de quelques mauvais sujets dont celui-ci avait déjà fait la connaissance à Rio.
Afin de n’être pas retardé par les piétons, redoutant d’ailleurs l’effet terrible de la chaleur sur ses hommes, M. Villiers avait fait venir des mules et des chevaux pour tout le monde. Les marins ne sont pas généralement d’habiles cavaliers, et le départ fut difficile.
Cependant Cadillac avait déclaré qu’il montait mieux que Léotard. On lui avait destiné une grande bête dépourvue de queue, mais dont les os apparaissaient dans toute leur symétrie. L’animal avait aussi une paire d’oreilles inquiètes qui se tenaient toujours en arrière en signe de méfiance et de mauvaise humeur. Mais Cadillac ne s’inquiétait guère de pareils symptômes. Il voulut se mettre en selle ; le cheval hennit et recula.
« Pourquoi le prends-tu à gauche ? cria Dur-à-cuire.
– C’est ma méthode… répondit Cadillac. Je l’ai inventée. »
Mais le cheval, qui ne connaissait pas la méthode, y vit une insulte personnelle. Il commença à tourner rapidement pour éviter son cavalier, levant en même temps la tête et la secouant avec un air de résolution indomptable.
« Je te monterai dessus, animal ! criait Cadillac, quand je devrais sauter par-dessus ta tête. »
En effet, par une manœuvre habile, il surprit son adversaire, s’élança et se trouva placé en travers de lui, à peu près comme un sac de blé. Aussitôt le cheval partit d’un air délibéré, secouant ses jambes à chaque pas, comme s’il avait voulu les rejeter loin de lui et pour tout à fait. Cette allure ne rendait pas facile au matelot l’opération de se mettre en selle. Il parvint cependant à s’asseoir, mais ne put jamais attraper les étriers, trop longs pour lui. Si bien qu’il dut chevaucher à la façon des singes, les coudes et les genoux tout près du corps.
Tandis qu’emporté malgré lui il jurait contre sa bête, des événements également fâcheux se passaient derrière lui.
Bernard avait déniché, on ne sait où, un énorme éperon aussi long que son pied, et l’avait solidement accroché à son soulier. Le guide l’ayant engagé à l’ôter, il ne répondit que par de mauvaises plaisanteries et conserva son éperon.
Soit que le mulet n’aimât point à être piqué, soit qu’il trouvât mauvais de n’être piqué que d’un seul côté, toujours est-il qu’il se mit à ruer. Intrépide et souple, Bernard tint bon d’abord, mais, dans ses efforts pour rester en selle, il n’était pas maître des mouvements de ses jambes. Plus le mulet se débattait, plus l’éperon s’enfonçait dans sa chair ; c’était un mauvais moyen de calmer l’animal. Il partit enfin au grand galop, emportant Bernard qui tirait vainement sur la bride comme sur un cordage.
Le pauvre Norzec, fort innocent pourtant des méfaits de ce coquin d’éperon, en fut aussi la victime. Compagnon habituel de la monture de Bernard, le mulet du père Dur-à-cuire partit à fond de train sur les traces de son ami. Nous devons ajouter, pour sauver l’honneur du matelot, qu’il tira si vigoureusement sur les rênes que le morceau lui en resta dans la main. N’ayant plus alors aucun moyen de gouverner sa monture, il se cramponna d’une main à l’arçon de la selle, de l’autre à la croupière, et ce fut dans cette position qu’il disparut aux yeux des autres voyageurs.
Au bout d’une heure, ceux-ci retrouvèrent les trois fugitifs réunis dans la même infortune. Cadillac était assis et se frottait les genoux. Bernard, que le mulet avait déposé peu mollement sur un buisson, avait la figure tout écorchée. Quant au père Dur-à-cuire, il était tombé pile, dit-il, c’est-à-dire sur le dos, et n’avait pas grand mal. Tout en parlant cependant, il se tâtait, se palpait, et il est permis de croire que lui non plus n’était pas sans avarie.
« Tu es bien heureux, disait-il à Bernard, de t’être tant abîmé.
– Merci ! murmura Bernard.
– Sans cela je t’aurais assommé.
– Pour me donner une partie de plaisir complète, n’est-ce pas ? » répondit le mousse en évitant lestement la main robuste qui se dirigeait vers ses oreilles avec des intentions hostiles.
Peu flatté par les charmes de l’équitation, le père Dur-à-cuire ne resta désormais sur son mulet qu’à son corps défendant. La plupart du temps il cheminait à pied, tirant derrière lui sa monture, qui se laissait traîner avec l’obstination particulière à sa race. De temps en temps le matelot, exaspéré, se retournait vers l’animal et lui disait gravement :
« Ce n’est donc pas assez de te remorquer, feignant, faudra-t-il encore que je te porte ?
– Comment veux-tu qu’il te réponde, disait alors Cadillac, il ne sait pas le français ? Parle-lui portugais. »
Lui, cependant, avait pris le parti de s’abandonner complètement au bon plaisir de son cheval, et tous deux cheminaient depuis lors paisiblement.
Quant à notre ami Charlot, ainsi que la plupart des paysans de la Basse-Bretagne, il savait un peu monter à cheval. Il regarda comment s’y prenait M. Gautier, le chirurgien, qui était très bon cavalier, et il s’efforça de l’imiter. Celui-ci vit les efforts du petit mousse. Comme Charlot, poussé par son obligeance habituelle, avait trouvé moyen de lui rendre divers petits services, le chirurgien l’avait pris en affection. Il l’appela et lui montra comment il devait se placer sur la selle et diriger sa monture.
Au bout de quelques heures, nos voyageurs arrivèrent à une fazenda (habitation agricole) de laquelle dépendait une grande plantation de manioc.
Le manioc est un arbuste dont la racine remplace le blé au Brésil. Sa culture a une certaine importance. Il porte, vers la fin de juillet, des fleurs rouges ; son fruit contient des graines d’un blanc tirant sur le gris.
La racine ressemble par sa forme à une grosse carotte, mais sa couleur est celle de la pomme de terre. Son poids moyen est d’environ un kilogramme.
On commence par la ratisser soigneusement ; puis on la râpe, à la main dans les maisons particulières, au moyen d’une grande meule dans les fabriques. Une fois qu’elle a été ainsi réduite en poudre, on l’entasse dans des paniers qu’on laisse séjourner assez longtemps dans l’eau. On la soumet ensuite au pressoir qui en fait sortir le jus, puis on l’étend sur de grandes plaques en fer qu’on expose au feu.
La consommation de cette racine est considérable ; on la mange surtout en bouillie, on en fait des galettes, ou bien on la sert sur la table en farine, et chacun en prend ce qu’il lui plaît pour consommer avec la viande ou le poisson.
Le manioc et la carna secca (viande séchée), qui vient principalement de Buenos-Ayres, forment le fond de la nourriture des nègres.
Le fazendero (propriétaire agriculteur) invita les voyageurs à dîner. M. Villiers aurait désiré que Charlot pût manger à la même table que lui ; mais cela eût été contraire à la discipline du bord, et le capitaine lui avait fait comprendre, avant le départ, tous les inconvénients que cela pourrait offrir. Ne pouvant davantage, M. Villiers recommanda son protégé au fazendero.
Les campagnards brésiliens sont très hospitaliers, et les voyageurs furent traités avec une abondance qui prouvait au moins la bonne volonté de leur hôte. Le dessert surtout était splendide. Il s’y trouvait une quantité de fruits que Charlot ne connaissait ni de vue ni de nom. Il aurait fait volontiers connaissance avec la plupart d’entre eux, tant ils avaient de belles couleurs, mais le chirurgien l’engagea à s’observer sous ce rapport.
Le pauvre Cadillac et Jobic lui-même négligèrent de suivre le sage conseil du docteur, et mal leur en prit. Pendant deux jours, ils furent obligés de se livrer à une gymnastique fort ennuyeuse, car à peine grimpés sur leurs mulets il fallait en descendre, et cela se répétait vingt fois par jour.
Heureusement pour eux, la petite caravane rencontra sur la route une truppa qui revenait justement de la plantation de café que l’inspecteur allait visiter. Un vieux mulâtre, le chef de cette truppa (convoi d’une dizaine de mulets), indiqua aux deux matelots un remède dont l’usage les mit bientôt à même de rester tranquillement sur leur selle.
Comme M. Villiers parlait à cet homme du projet de pousser son excursion jusqu’à Buena-Vista, c’est-à-dire à une dizaine de leguas de la plantation du señor Corvisto, celui-ci parut inquiet.
« Qu’avez-vous donc ? » lui demanda l’inspecteur.
Le vieux mulâtre hésita et jeta un regard furtif autour de lui.
« Il y a beaucoup de nègres marrons de ce côté, dit-il.
– Sont-ils dangereux ?
– Pas d’habitude. Ils se tiennent dans le bois et n’en sortent guère.
– Eh bien, alors ?
– Eh bien, señor, il en est arrivé dernièrement de nouveaux qui sont très méchants, et… enfin je crois que la route est dangereuse. »
Comme deux nègres s’approchaient, l’esclave s’éloigna précipitamment.
M. Villiers consulta le guide, auquel il fit part des inquiétudes que lui suggéraient les récits du mulâtre. Le guide se mit à rire.
« C’est un vieux coquin qui a voulu obtenir une gratification de Votre Excellence, dit-il ; il est extrêmement rare de voir des nègres marrons attaquer un blanc, même isolé. Les pauvres diables ont trop peur de se montrer pour risquer rien de pareil. »
Quelque diligence qu’eussent faite les voyageurs, ils ne purent gagner avant le soir l’habitation du señor Corvisto. Il leur fallut coucher sous une sorte de hangar dont la toiture laissait fort à désirer.
Au milieu de la nuit, Charlot poussa un cri de détresse. Brusquement réveillé par une sensation de froid à la jambe, il y avait porté la main et avait rencontré un corps visqueux et glacé. C’était un serpent qui s’était glissé tout doucement sous la couverture du petit mousse.
Charlot bondit bien loin de sa couche. On accourut.
Jobic souleva bravement la couverture. On aperçut alors le serpent qui dormait du sommeil de l’innocence, blotti sous le tissu de laine.
Jobic et Cadillac levaient déjà leurs bâtons pour l’assommer, quand les deux nègres qui voyageaient avec les matelots retinrent leurs bras. L’un d’eux empoigna le serpent par le cou, tandis que l’autre, armé d’une pierre, en assénait un bon coup sur la tête du reptile.
« Li mort ; nous manger li ! dit le nègre en riant de façon à montrer les dents jusqu’aux oreilles.
– Vous mangerez le serpent ! s’écria Charlot ébahi.
– Oui, li bon ; puis, nous donner la peau au señor, » ajouta le nègre en désignant M. Villiers.
Ainsi qu’on l’apprit plus tard, leur cadeau n’avait pas une grande valeur ; mais ils comptaient sur une gratification du généreux étranger, et leur attente ne fut pas trompée. Quant au serpent, il était d’une espèce fort commune et sa morsure n’était pas venimeuse.
« Encore s’il était truffé ! » murmurait Cadillac en voyant les nègres préparer leur cuisine.
CHAPITRE XV – Santa-Esperanza. – Un fazendero. – Récolte du café. – Un coup de tête de Bernard. – Angoisses. – Les Indiens Pouris. – Arrivée à Buena-Vista. – Explorations dans les bois. – Disparition mystérieuse du guide.
On arriva le lendemain à Santa-Esperanza, l’habitation du señor Corvisto.
Ce personnage passait pour être fort riche. On disait qu’il possédait au moins 600 nègres, ce qui est une manière d’évaluer la fortune dans ce pays. La valeur moyenne d’un esclave est de 12 à 1500 francs. Cela a beaucoup augmenté. Il est vrai que les femmes et les enfants valent moins cher.
Le pauvre Charlot était tout ahuri d’entendre ainsi parler de la vente des créatures humaines, exactement comme s’il s’était agi d’un bœuf ou d’un cheval. Il s’étonnait aussi de l’insouciance des esclaves qui chantent, qui rient, et n’ont vraiment pas l’air aussi malheureux qu’on le supposerait en Europe. L’intérêt de leur maître étant de les conserver en bonne santé, ils sont assez bien nourris. Ils ont aussi, durant leurs maladies, des soins qui manquent quelquefois aux pauvres gens de nos pays.
L’habitation du señor Corvisto ne répondait pas à sa fortune. Elle était grande, il est vrai, et entourée de vastes jardins, mais ces jardins étaient mal tenus. La maison n’était pas en meilleur état. Quatre ou cinq croisées seulement avaient des vitres. Les autres n’étaient que des ouvertures dénuées de tout châssis.
Le mobilier était aussi des plus simples, sauf quelques meubles d’une grande valeur qu’on avait fait venir évidemment de Rio-Janeiro et qui contrastaient singulièrement avec les autres. Autour de l’habitation ondulaient des collines dont les pentes peu rapides étaient couvertes de caféiers.
La hauteur moyenne du caféier, quand il a atteint toute sa croissance, est d’environ deux mètres. Ses fleurs blanches ressemblent un peu pour la forme à celles des jasmins d’Espagne. Le pistil de cette fleur devient un fruit oblong et pointu, d’abord vert, puis rouge, puis rouge brun, qui se compose de deux loges contenant chacune un grain qui n’est autre que le café.
Suivant la nature du terrain et la manière de procéder des fazenderos, la cueillette du café se fait tous les deux ou tous les trois ans. Comme le même arbrisseau porte à la fois des fleurs et des fruits, la récolte du café est pour ainsi dire continue.
Quoique rien n’annonçât chez lui une vigueur exceptionnelle, M. Villiers était une de ces natures énergiques qui résistent parfaitement à la fatigue. Dès le lendemain de son arrivée à la plantation de Santa-Esperanza, il se leva à la pointe du jour pour assister aux travaux des esclaves. Charlot, Bernard et maître Cadillac l’accompagnèrent.
Ils assistèrent au départ des noirs, que le surveillant compta un par un avant de les envoyer au travail.
La récolte du café n’est pas du reste une besogne très pénible : on le cueille comme on cueille les pois en Europe, puis on le transporte, pour le faire sécher au soleil, sur de grandes aires pareilles à celles qui servent chez nous au battage du blé. Elles sont entourées de petits murs d’un demi-mètre de haut, percés à leur partie inférieure d’échancrures destinées à laisser écouler l’eau de pluie.
Une fois que les coques sont sèches, on les verse dans des mortiers, où des pilons en bois, mus par un cours d’eau, les frappent de coups multipliés et les écossent en peu de temps.
Des mortiers, les grains de café passent à travers une sorte de crible, et de là sur une vaste surface plane en forme de table, autour de laquelle les nègres sont rangés. Ils achèvent alors de séparer les grains de la balle. Ce travail se fait avec une dextérité fort amusante à voir.
Une fois épluché, le grain est soumis à une chaleur modérée dans de grands chaudrons en cuivre ou sur des disques de même métal ayant de tout petits rebords.
C’est là qu’il prend la livrée grisâtre sous laquelle il nous arrive.
Malgré l’ardeur du soleil, les nègres travaillaient assez gaiement.
Tandis que M. Villiers examinait le tableau animé qu’il avait sous les yeux et prenait quelques notes, Bernard et Charlot s’amusaient à seconder les nègres et à cueillir les coques contenant le café. Bernard aperçut dans un coin un endroit où les caféiers étaient chargés de fruits, et qu’on semblait avoir oublié. Quand les noirs le virent se diriger de ce côté, ils lui firent signe de revenir sur ses pas. Le surveillant, qui était à l’autre extrémité du champ, le rappela aussi. Mais, suivant son habitude, Bernard n’en tint compte. On le perdit bientôt de vue. Un instant après, il poussa des cris de détresse. Charlot s’élançait bravement à son secours, lorsque le surveillant, qui venait d’arriver au galop de son cheval, le prit par le bras et le retint vigoureusement. Cet homme, qui était un mulâtre, abandonna sa monture et pénétra au milieu des caféiers.
Pendant ce temps, des esclaves racontaient à Charlot que, dans les plantations où y il avait beaucoup de serpents (et il en était ainsi pour Santa-Esperanza), on leur abandonnait un petit coin du champ. Comme les reptiles fuient généralement devant l’homme, ils finissaient par se retirer presque tous vers cet endroit à mesure que les travailleurs envahissaient le reste. À la fin de la cueillette, on réduisait de plus en plus leur retraite et l’on finissait par y mettre le feu.
Cela n’avait lieu, du reste, qu’en peu d’endroits, car sur la plupart des plantations, cette précaution n’était pas nécessaire.
Le mulâtre reparut bientôt, soutenant Bernard d’une main et portant de l’autre un serpent vert-bouteille dont la vue fit pousser de grands cris aux esclaves. Il appartenait, paraît-il, à une espèce très dangereuse.
Le reptile avait mordu Bernard à la cuisse. Le mousse l’avait assommé avec son bâton ferré, et le mulâtre l’avait achevé, car ces animaux ont la vie extrêmement dure.
Quoiqu’il ne fût point poltron, le pauvre Bernard éprouvait de cruelles angoisses.
« Croyez-vous que j’en mourrai, monsieur ? demandait-il au surveillant.
– J’espère que non, répondit gravement le mulâtre ; par bonheur pour vous, une partie du venin est restée sur votre pantalon. En cautérisant immédiatement, nous arrêterons probablement l’action de ce qui aura pénétré dans la plaie. »
Les consolations du mulâtre n’étaient pas, comme on voit, des plus rassurantes. Tout en parlant, néanmoins il agissait. Comme Bernard avait déjà ôté son pantalon pour qu’on pût visiter la blessure, le mulâtre tira un couteau affilé de sa poche et fit une incision en croix sur l’endroit mordu par le serpent. Il enleva même le morceau de chair que les dents de l’animal avaient touché. Il fit saigner la blessure en pressant les bords de la plaie et la cautérisa avec de l’acide nitrique dont M. Villiers avait toujours un flacon dans son portefeuille. Puis il mâcha quelques herbes qu’un vieux nègre s’était hâté de cueillir, et en fit une sorte de cataplasme qu’il mit sur la plaie et qu’il assujettit avec un mouchoir.
Effrayé du danger que courait son camarade, Charlot regardait d’un œil inquiet cette opération que Bernard supporta du reste avec beaucoup de courage.
« Voilà ce qu’on gagne à vouloir faire toujours à sa tête et à n’écouter les avis de personne, dit M. Villiers.
– Pauvre garçon ! murmura Charlot, s’il allait mourir.
– Tranquillise-toi, reprit l’inspecteur ; le mulâtre vient de me dire que la cautérisation ayant été faite immédiatement, Bernard ne courait aucun danger. »
Dès que le soleil disparut à l’horizon, les nègres suspendirent leurs travaux. Ils vinrent se mettre en rang devant l’habitation. On les compta comme le matin. Puis on dit à haute voix une prière après laquelle ils allèrent souper.
M. Villiers avait le projet de visiter aussi un établissement formé par un Allemand, M. Hofen, au milieu d’une épaisse forêt, pour l’exploitation de divers arbres précieux servant à la teinture et à l’ébénisterie. Cette propriété, nommée Buena-Vista, était située près d’une petite rivière, ce qui permettait d’envoyer les bois jusqu’à la mer sans trop de frais.
M. Corvisto conseilla à M. Villiers de prendre pour guides des Indiens qui venaient de passer la nuit sous un des hangars de la plantation.
Ces Indiens, dits Pouris, étaient à la recherche de deux nègres évadés. Ils les suivaient à la piste depuis trois jours, comme de véritables chiens de chasse, et prétendaient être certains de les retrouver.
Le teint des Pouris est cuivré ; leurs cheveux noirs et très épais ne sont pas crépus, mais ils ont, comme les nègres, le nez épaté, les lèvres épaisses et l’air abruti. Ils vivent dans la plus affreuse misère, ce qui tient surtout à leur indolence, car ils ne travaillent guère que pour ne pas mourir de faim.
M. Corvisto ayant garanti leur fidélité à l’inspecteur français, ce dernier se mit en route dès le lendemain matin en emmenant toute son escorte, sauf Bernard, pour la blessure duquel il redoutait la fatigue du voyage.
À quelque distance de Santa-Esperanza, les Pouris se séparèrent. Deux seulement restèrent avec M. Villiers ; les quatre autres s’enfoncèrent dans les bois pour suivre la piste des nègres fugitifs. Un mulâtre et un Brésilien les accompagnaient.
Les deux guides de M. Villiers s’acquittèrent fidèlement de leur mission et le conduisirent à bon port à la maison de M. Hofen.
Ce dernier se trouvait absent. Il était parti avec la moitié de ses hommes pour donner la chasse à une bande de nègres marrons qui lui avaient volé des bestiaux et des grains.
En l’attendant, M. Villiers commença ses explorations. Il emmena seulement avec lui son ami Charlot et maître Cadillac. Le chirurgien étudiait une autre partie de la forêt en compagnie de Norzec. Quant au lieutenant, il avait préféré rester à l’habitation.
Dès que M. Villiers avait trouvé quelque arbre précieux de teinture et d’ébénisterie, des arbustes, des plantes fournissant des épices ou des gommes, il en prenait des échantillons que Cadillac était chargé de porter sur ses robustes épaules.
Un des nègres de M. Hofen servait de guide à l’inspecteur.
Un jour que M. Villiers s’était enfoncé plus avant que d’habitude dans la forêt, le guide s’éloigna pour cueillir des fruits.
Quelques minutes après, un bruit de branches froissées ou brisées attira l’attention de Charlot. Il lui sembla aussi entendre un cri, mais il lui aurait été impossible de dire si c’était le cri d’un homme ou bien celui d’un animal.
Il s’avança vers l’endroit d’où venait ce bruit, mais rien ne se fit plus entendre.
Il revint auprès de M. Villiers.
Au bout de quelques minutes, l’inspecteur appela le guide. Personne ne répondit.
« Attendons, » dit M. Villiers.
Ils attendirent quelque temps, mais Sérouma (l’Indien) ne parut point.
M. Villiers et Charlot le hélèrent de nouveau, de toute la force de leurs poumons, puis ils se mirent à sa recherche.
Arrivés à deux ou trois cents pas, ils remarquèrent un endroit où des branches cassées et des feuilles éparses semblaient révéler une lutte.
« Venez voir, monsieur ! s’écria tout à coup le petit mousse.
– Qu’y a-t-il ? demanda M. Villiers.
– Du sang ! répondit Charlot en montrant des feuilles marquées de taches rouges.
– Et là encore, ajouta Cadillac un instant après.
– Il est arrivé quelque malheur à ce pauvre Sérouma, » dit M. Villiers avec anxiété.
Ils cherchèrent si les taches du sang allaient plus loin, mais ils n’en trouvèrent plus. De temps en temps ils élevaient la voix pour appeler le guide. Nul ne répondit à leurs cris. Le soleil s’inclinait déjà à l’horizon, et dans ces climats la nuit vient vite.
« Il faut retourner à Buena-Vista, dit M. Villiers. Pourvu que nous retrouvions notre chemin, » pensait-il en même temps.

CHAPITRE XVI – Une nuit dans les bois. – Les nègres marrons. – Prisonniers. – Le camp des nègres. – Le grand Malgache. – Position critique.
Ils revinrent sur leurs pas ; malheureusement, comptant sur leur guide, ils avaient négligé d’observer le chemin déjà parcouru. Il faut d’ailleurs avoir vécu longtemps dans les bois pour être capable de se retrouver au milieu de ces épaisses forêts, où il n’existe d’autres routes que les pistes formées par le passage des bêtes fauves, et où l’œil du nègre est le seul qui puisse découvrir un point de repère.
M. Villiers et Charlot se trouvèrent bientôt complètement perdus. La nuit arrivait. Les voix des animaux sauvages commençaient à se faire entendre dans le lointain.
Pour ne pas alarmer son petit compagnon, M. Villiers dissimula ses inquiétudes.
« Il faut renoncer à gagner Buena-Vista ce soir, dit-il ; nous allons coucher ici.
– Brrr ! fit Charlot, peu flatté de cette perspective.
– As-tu peur ? lui demanda Cadillac.
– Non, mais…
– Mais ?
– Mais si nous allions être mangés par les lions ?…
– Avant tout, interrompit l’inspecteur, il faudrait nous occuper de faire du feu. C’est le meilleur moyen d’éloigner les animaux féroces.
– Et de cuire son dîner, quand on a de quoi dîner, murmura Cadillac.
– As-tu faim, Charlot ? » demanda M. Villiers.
Quelque mésaventure qui pût arriver à notre ami Charlot, cela ne lui enlevait jamais l’appétit.
Il répondit à la question de l’inspecteur par un gros soupir.
Cadillac portait la cantine sur son dos, mais, comme on avait déjà livré le matin un rude assaut aux provisions qu’elle contenait, ce qui restait était fort insuffisant pour le dîner de trois personnes. Il fallait d’ailleurs songer au déjeuner du lendemain.
Tandis que M. Villiers partageait en trois portions égales le biscuit de bord et le petit morceau de viande froide qui avait échappé à leur premier appétit, Cadillac ramassait du bois mort pour faire le feu.
Charlot, de son côté, cueillait quelques fruits ; mais, comme on lui avait recommandé de ne pas s’éloigner, sa récolte ne fut pas abondante.
« Que pensez-vous de la disparition de notre guide, Cadillac ? demanda M. Villiers, en jetant un regard autour de lui pour s’assurer qu’il ne serait pas entendu de Charlot qu’il craignait d’alarmer.
– Je pense, monsieur, que le pauvre Sérouma aura été dévoré par quelque bête féroce.
– Non, nous aurions trouvé des lambeaux de vêtements et des traces plus visibles d’une lutte.
– Alors il aurait été tué par des bandits ou des sauvages ?
– Par des nègres marrons, plutôt. Silence, voici le mousse. »
Malgré de cruelles inquiétudes, les trois Européens commencèrent bientôt à sentir leurs yeux se fermer sous le poids du sommeil. Il fut convenu que Cadillac et M. Villiers veilleraient à tour de rôle au salut commun.
Toujours prêt à donner l’exemple, l’inspecteur se chargea du premier quart. Cadillac et Charlot se couchèrent auprès du brasier. M. Villiers s’assit à côté d’eux, sur un tronc d’arbre, la main sur ses pistolets et l’oreille attentive au moindre bruit. Deux mortelles heures s’écoulèrent ainsi.
Ses inquiétudes auraient été bien plus vives encore s’il avait pu distinguer ce qui se passait autour de lui dans l’épaisseur du fourré.
À cinquante pas à peine, plusieurs corps noirs et complètement nus se tenaient couchés sur le sol. On ne voyait d’eux que leurs yeux, qui scintillaient dans l’obscurité comme des vers luisants.
Ils formaient, en rampant autour des Européens, un cercle qui allait toujours en se resserrant. Bientôt les plus avancés arrivèrent tout près du brasier. Un cri aigu retentit soudain. À ce signal, les nègres se redressèrent d’un bond et s’élancèrent sur les blancs.
Pris à l’improviste, et d’ailleurs accablés par le nombre, ceux-ci ne purent se défendre.
Cadillac blessa pourtant l’un des assaillants. Quant à M. Villiers, qui montra dans cette occasion son sang-froid habituel, il comprit tout de suite l’inutilité d’une résistance, et il arrêta la main de Charlot qui se disposait à jouer vaillamment de son petit couteau de chasse.
En un clin d’œil, les Européens furent ficelés comme des ballots de marchandises et emportés par des nègres, qui cheminaient dans l’obscurité aussi facilement que s’ils avaient eu des yeux de chat. Les broussailles déchiraient au passage les mains et les visages des prisonniers ; mais, dans leur anxiété, eux-mêmes n’y prenaient pas garde.
Après quelques heures d’un pénible voyage, on atteignit une clairière au milieu de laquelle flambait un grand feu.
Là, des noirs dormaient couchés sur le sol, ou causaient en fumant et en buvant de l’arak et du tafia.
Les trois blancs furent jetés à terre assez rudement.
« Hé, là-bas ! cria Cadillac, faites donc attention à l’arrimage ! Ne voyez-vous donc pas qu’il y a écrit : fragile, sur mon dos. »
Un coup de poing administré par un grand coquin de nègre borgne lui coupa la parole.
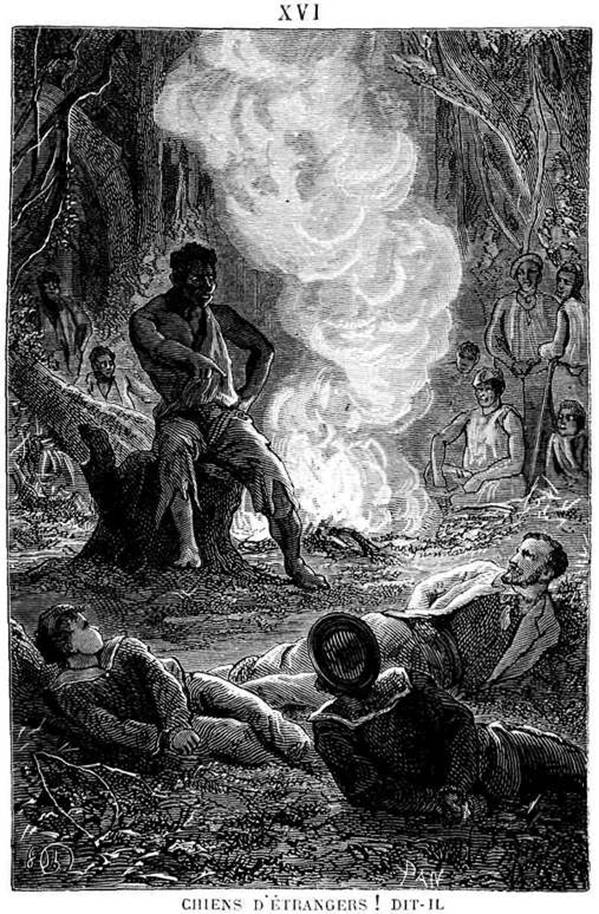
En ce moment, un Malgache à figure sinistre, dont le corps à demi nu annonçait une vigueur extraordinaire, et qui avait des bras d’une longueur disproportionnée, sortit de la foule et s’assit sur un gros billot, à quelque distance du brasier.
« Chiens d’étrangers, dit-il en portugais, vous appartenez à une race maudite qui vit de notre sang et de nos sueurs. Hier encore des blancs se sont emparés de huit de nos compagnons et les ont emmenés. Le destin qu’ils subiront décidera du vôtre. Tout à l’heure un de ces hommes partira pour Buena-Vista. Le señor Hofen doit y être rendu maintenant avec ses prisonniers. Mon messager lui proposera un échange entre nos frères et vous. Si le señor Hofen accepte, vous aurez la vie sauve ; mais, s’il a exécuté sa menace de pendre mes compatriotes aux arbres de sa cour, je vous ferai couper en morceaux et rôtir sur le brasier que vous voyez. »
En parlant ainsi, le Malgache tourmentait le manche de son couteau. On voyait qu’il lui en coûtait de ne pas déchirer immédiatement le corps de ses ennemis.
Quand le soleil vint dissiper l’obscurité, M. Villiers s’aperçut que les nègres avaient entouré leur retraite d’une sorte de palissade formée d’arbustes épineux. Paresseux comme ils le sont presque tous, ils restaient couchés sur le sol et ne se levaient que pour manger ou pour jouer à divers jeux avec une animation extraordinaire.
La plupart avaient de mauvaises figures. Comme nous l’avons dit, les esclaves sont généralement bien traités au Brésil, et les fugitifs sont presque tous des fainéants ; quant à ceux dont le but est d’échapper à de mauvais traitements, on comprend qu’ils soient exaspérés contre la race blanche. Tous étaient maigres et décharnés. Leur contenance indiquait assez qu’ils vivaient au milieu d’inquiétudes continuelles.
Au moment d’envoyer un messager à Buena-Vista, le Malgache ordonna à M. Villiers d’écrire lui-même quelques mots à M. Hofen. L’inspecteur obéit.
Dès qu’il eut achevé un billet au crayon sur une feuille déchirée de son calepin, le noir appela un de ses compagnons qui en fit la lecture à haute voix :
« Nous sommes prisonniers des nègres marrons, et notre sort dépend de celui que subiront les noirs que vous avez capturés. »
M. Villiers avait ajouté en allemand, à la suite de son nom et comme si cela faisait partie de la signature : folgen fluss (suivre rivière). Il avait distingué en effet, à peu de distance, le murmure d’un grand cours d’eau, et il avait vu quelques nègres rentrer de la pêche avec des poissons encore vivants, ce qui indiquait une grande proximité de l’eau, car dans ce pays tout se corrompt en quelques heures.
Les deux mots allemands, placés comme ils l’étaient, n’attirèrent point l’attention. Un messager partit aussitôt avec la lettre. Cet homme avait parmi ses camarades la réputation d’un rapide marcheur, et, malgré la distance, on espérait le revoir le soir même. Il revint en effet vers sept heures.
Les nègres s’assemblèrent autour de lui.
Il paraît que les noirs prisonniers avaient été cruellement traités, car des cris de colère et de vengeance s’élevèrent dès qu’il eut parlé.
Les pauvres Européens s’attendaient à être massacrés ; mais on se contenta de les menacer de resserrer leurs liens.
« Quelles nouvelles a donc apporté le messager ? » demanda M. Villiers.
On ne lui répondit que par des injures.
CHAPITRE XVII – Un cœur reconnaissant. – Fuite de Charlot. – L’iguane. – L’once. – Des amis et des vivres.
Vers une heure du matin, Charlot, qui était couché le dos appuyé contre un tronc d’arbre renversé, sentit tout à coup une main qui le touchait légèrement. Il poussa un cri étouffé.
« Silence ! lui dit-on à voix basse, je viens vous sauver. Restez immobile et ne tournez même pas la tête de mon côté. »
Malheureusement pour Charlot, son cri avait éveillé l’attention d’un gardien qui s’approcha de lui.
« Pourquoi as-tu crié ? lui demanda le noir.
– Un serpent a passé là, tout près de moi, balbutia Charlot.
– Eh bien, puisse-t-il t’avoir mordu, chien ! » s’écria l’autre en retournant prendre sa place près du brasier.
Au bout de quelques minutes, Charlot entendit un imperceptible bruissement auprès de lui. C’était l’inconnu qui revenait.
« Écoutez-moi, reprit-il à l’oreille du petit mousse ; je suis Morabé, le nègre qui portait un masque à Rio-Janeiro et dont vous avez obtenu la grâce. Je viens d’entendre la réponse apportée par le messager.
– A-t-il remis la lettre ?
– Oui, mais il était trop tard. En arrivant auprès de Buena-Vista, les nègres prisonniers avaient tenté de s’enfuir ; trois seulement ont réussi ; les autres sont morts ou couverts de blessures.
– Que veut-on faire de nous ? demanda Charlot.
– On attend le jour pour ordonner votre supplice.
– Pauvre maman ! murmura Charlot qui, un instant, se retrouva par la pensée en Bretagne et dans sa petite chaumière.
– Morabé se souvient du bien et du mal, reprit le noir. Je vais couper vos liens ; reculez peu à peu vers le bois et sauvez-vous dans le fourré.
– Où irai-je ? murmura le pauvre enfant.
– Marchez dans la direction de cet arbre, reprit le noir en lui montrant du doigt un grand arbre éclairé par les lueurs vacillantes du brasier. Continuez tout droit. Vous arriverez à la rivière. Suivez-en le cours, il vous conduira tout près de l’établissement des blancs. Attendez, ne bougez pas ! »
Il coupait en même temps les liens du petit mousse.
« Restez encore immobile pendant quelque temps, dit-il, de peur qu’on ne vous regarde.
– Et M. Villiers, et Cadillac ?
– Je ne puis les sauver.
– Je ne partirai pas sans eux.
– Voyez comme ils sont entourés.
– C’est M. Villiers qui a obtenu votre grâce.
– Hélas ! je ne puis rien pour lui. »
M. Villiers et Cadillac étaient en effet couchés au milieu du cercle lumineux formé par la lueur du brasier. De chaque côté des Européens se trouvaient deux nègres armés de sabres et de couteaux.
Charlot se mit à pleurer.
« Je resterai avec eux, dit-il.
– Vous vous perdrez sans les sauver. Tapaï est si cruel !
– Qui est Tapaï ?
– Le Malgache qui nous commande. S’il savait ce que je viens de faire, il me tuerait sans pitié… Je vous en prie, sauvez-vous ! »
La vie aventureuse que Charlot menait depuis quelque temps avait développé son intelligence. Il réfléchit que s’il parvenait à gagner Buena-Vista, il pourrait peut-être amener du secours à ses amis, et que ceux-ci n’avaient pas d’autre chance de salut.
« Eh bien ? lui dit Morabé, que son silence inquiétait.
– Je vais partir, répondit l’enfant. Que le bon Dieu te récompense. »
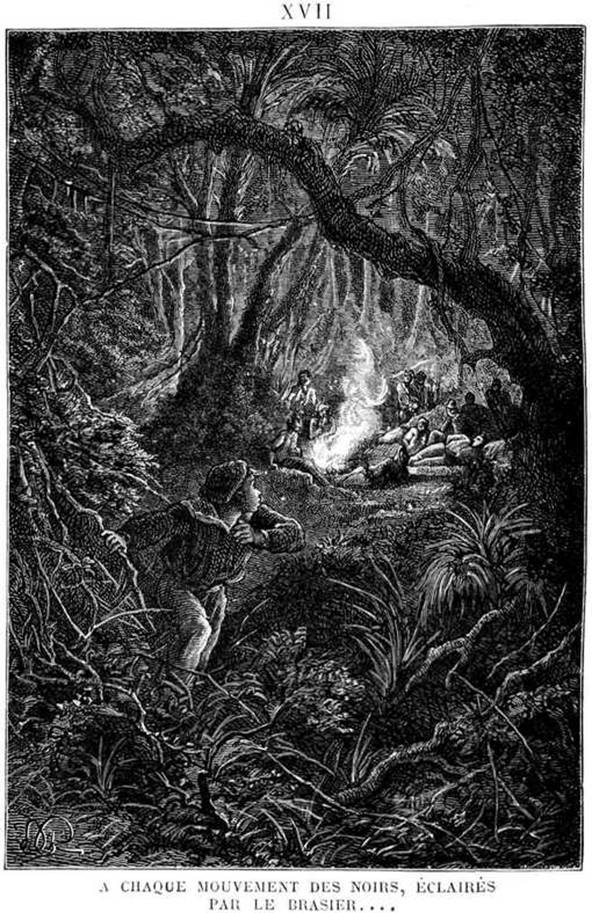
Au moment où Charlot commençait à reculer, aidé par Morabé, qui le tirait en arrière, un des nègres jeta plusieurs brasses dans le feu. La flamme qui jaillit éclaira l’endroit où était le petit mousse.
« Il faut attendre, lui dit tout bas son sauveur ; on verrait vos mouvements. »
Charlot demeura immobile. Un des gardiens se leva et regarda de son côté. Ne voyant rien de nature à l’inquiéter, il se rassit à côté du feu.
Le cœur du mousse battait avec violence. Maintenant qu’il avait pris la résolution de fuir, chaque minute lui semblait un siècle. Il tremblait non pour lui, le brave enfant, mais pour ses amis.
Morabé lui donna quelques instructions sur la route qu’il devait suivre et sur les principales difficultés qu’il avait à surmonter.
« Venez avec moi, lui dit Charlot.
– Tapaï verrait bien que c’est moi qui vous ai délivré, et il me tuerait.
– Vous resterez à l’habitation.
– On me livrerait à mon maître, qui me ferait mourir sous les coups.
– Pourquoi vous êtes-vous sauvé ?
– Le señor a presque tué mon fils. Cette fois je l’ai frappé de mon couteau. Il ne pardonnera jamais. Tenez ! voici la flamme qui diminue ; il faut profiter du moment. Partez. »
Charlot saisit la main que le pauvre nègre n’aurait pas eu la pensée de lui tendre et la serra de toute la force de ses petites mains.
Nul ne pourrait dire les angoisses qu’éprouva le pauvre enfant durant les quelques minutes qu’il mit à gagner le fourré. À chaque mouvement des noirs, éclairés par le brasier, il se figurait qu’ils allaient se lever et le poursuivre. À l’instant même où il atteignait la lisière du bois, un des nègres se redressa tout à coup et se dirigea vers lui.
Le sang de Charlot se glaça dans ses veines. Il se crut perdu.
« Mon Dieu, protégez-moi ! » murmura-t-il.
Le nègre changea tout à coup de direction. Charlot le vit demander du tabac à un de ses compagnons.
Une minute après, le fugitif était entré dans le fourré et s’éloignait en rampant avec des précautions infinies. Chaque frôlement de feuilles le faisait tressaillir, mais il n’en continuait pas moins son chemin avec courage. Bientôt il put se lever et marcher.
Mais il n’était pas facile d’avancer au milieu de cet épais fourré hérissé d’arbustes épineux et de plantes grimpantes. Le mousse eut bientôt les pieds, les mains et le visage tout en sang. Il rencontra enfin une coulée ou petit passage formé par les animaux qui allaient boire à la rivière. Il la suivit, à quatre pattes comme un singe. Enfin, au bout d’une heure environ, il arriva à la rivière. Alors, tombant à genoux, Charlot remercia Dieu de l’avoir sauvé. Puis il se mit à suivre le cours de l’eau de toute la vitesse de ses jambes, car il craignait encore d’être rattrapé par les noirs.
C’était une rude entreprise pour un enfant de cet âge, de franchir ainsi une distance de plusieurs lieues au milieu de difficultés et de périls de tout genre. Il n’avait d’ailleurs ni armes, ni provisions. Le pays lui était inconnu, et il se voyait continuellement arrêté par des halliers épineux, ou par des marais qu’il lui fallait tourner.
Mourant de faim et déjà fatigué par la marche de la veille, Charlot cheminait péniblement. Vingt fois il fut sur le point de se coucher par terre et d’y rester pour mourir, tant il se sentait épuisé et découragé ; mais, en songeant à sa mère et à ses amis prisonniers des nègres, il retrouvait des forces. Il se levait en soupirant, étirait ses pauvres membres brisés et recommençait à marcher. Heureusement pour lui la lune se leva et vint éclairer la forêt.
Un peu avant le jour, Charlot aperçut un grand lézard qui dormait à demi caché sous un monceau de feuilles mortes. Il se rappela que les nègres mangeaient de ces animaux et que la chair n’en paraissait pas trop répugnante. Il aurait certainement mieux aimé un beefsteack ou un poulet rôti, mais il n’avait pas le choix.
Le difficile était de s’emparer du lézard. L’animal avait au moins deux pieds de long, et ne devait pas être fort disposé à se laisser mettre à la broche.
Pour toute arme, Charlot avait son bâton et son couteau.
Il mit le couteau tout ouvert entre ses dents, prit son bâton de la main droite et commença à ramper tout doucement pour s’approcher de son futur rôti.
Heureusement l’iguane (grand lézard) dormait tranquillement.
À force de précautions, Charlot finit par arriver à deux ou trois pas de la bête. Il leva son bâton et lui en asséna un grand coup sur la tête.
Réveillé en sursaut par cette attaque inattendue, l’iguane prit la fuite en passant entre les jambes de Charlot qu’il renversa.
Charlot se releva lestement et courut après son dîner qui s’en allait bon train vers les halliers. Il parvint à le rejoindre et tomba sur lui à coups de bâton. Le petit garçon y allait de bon cœur et tournait adroitement autour du lézard pour éviter ses dents.
Étourdi par la grêle de coups qu’il avait reçus, celui-ci se traînait péniblement. Charlot allait l’achever, lorsqu’il entendit du bruit derrière lui. Il se retourna brusquement.
Au même instant un animal sortit du bois par un bond énorme et vint retomber à cinq ou six pas devant le mousse. C’était un once, sorte de petit léopard que le pauvre garçon prit pour un tigre à cause de sa forme et de son pelage.
Tandis que, fort effrayé, il regardait le nouveau venu d’un œil hagard, l’once s’allongea à terre comme un chat et sembla l’examiner à son tour. On eût dit qu’il se demandait par quel endroit il fallait entamer cette proie.
Sans quitter des yeux son ennemi, Charlot reculait peu à peu vers un arbre. L’once restait toujours immobile. Dès que Charlot sentit qu’il touchait l’arbre, il se retourna vivement et se mit à grimper avec une agilité sans pareille. En un clin d’œil il fut au sommet des branches.
Il se serait cru dès lors parfaitement en sûreté, s’il n’avait entendu dire que certains animaux de l’espèce féline grimpaient aussi aux arbres. L’once, en effet, se rapprocha du tronc et se mit à tourner tout autour comme un général qui prend ses mesures.
« Mon Dieu ! ayez pitié de moi ! » murmura le pauvre Charlot.
Au moment où il se penchait pour regarder ce qu’était devenu l’animal, un coup de feu retentit. L’once fit un bond. Une seconde balle l’atteignit et le fit rouler sur le sol. Six hommes sortirent au même instant du fourré.
C’était Marcel Gautier, le chirurgien du Jean-Bart, Norzec, un mulâtre et trois nègres de l’habitation.
Charlot dégringola de son perchoir et courut se jeter dans les bras de ses amis. Le pauvre petit avait l’air si épuisé que les larmes en vinrent aux yeux du chirurgien.
« Es-tu blessé, coquin de moussaillon ? demanda Dur-à-cuire de sa plus grosse voix, après avoir commencé par embrasser l’enfant comme s’il eût voulu l’étouffer.
– Non, M. Norzec, mais je suis si fatigué et j’ai si faim !…
– Voici de quoi manger, mon pauvre Charlot, » répondit le chirurgien en lui tendant un morceau de galette de manioc et une tranche de venaison.
Charlot ne put répondre ; il avait déjà dans la bouche un morceau de galette qui la remplissait tout entière.
« Doucement donc ! lui dit M. Gautier, tu vas t’étouffer. »
Charlot fit signe que non.
Tout à coup le petit garçon s’arrêta.
« Eh bien, tu ne manges plus, fainéant ! dit le père Dur-à-cuire.
– M. Villiers et Cadillac ont été pris par les esclaves marrons, dit Charlot ; on doit les faire mourir ce matin ; prisonnier comme eux, j’ai pu me sauver, grâce à un bon nègre qui m’y a aidé ; et si j’ai consenti à m’enfuir, c’était dans l’espoir de leur ramener du secours.
– Tonnerre ! » s’écria le matelot.
Charlot raconta alors tout ce qui s’était passé depuis la disparition du guide.
« C’est sans doute le cadavre de ce malheureux que nous avons trouvé dans la forêt, dit M. Gautier. Tu as bien agi, Charlot, reprends des forces, continue ton déjeuner, tandis que Norzec et moi nous allons voir ce qu’il y a de mieux à faire pour sauver nos amis. »
Tout en déjeunant, Charlot s’applaudissait d’avoir échappé à la nécessité de manger du grand lézard. Le chirurgien et son compagnon lui apprirent comment ils étaient arrivés si à propos à son secours.
CHAPITRE XVIII – On marche au secours des prisonniers. – La fête du supplice. – L’attaque. – La déroute. – Vaillance de Charlot. – Les prisonniers nègres. – Éclaircissements. – Charlot paye sa dette à Morabé.
L’envoyé de Tapaï avait délivré à M. Hofen le message du Malgache et la lettre de M. Villiers. On s’était mis aussitôt en devoir de voler au secours des Européens prisonniers. M. Gautier avait d’abord eu la pensée de faire suivre le messager ; mais celui-ci s’était enfui, et M. Hofen savait qu’il serait inutile de chercher à le rejoindre. La seule indication de nature à guider les recherches était les deux mots suivre rivière, ajoutés en allemand au bas de la lettre de l’inspecteur. Malheureusement, il y avait un endroit où la rivière se divisait en deux branches. M. Hofen se dit que les nègres marrons devaient être campés non loin du point de jonction ; il était cependant prudent d’explorer les deux branches. M. Gautier et Norzec partirent d’un côté, guidés par un nègre ; M. Hofen, M. Gauflé et Jobic prirent l’autre direction.
Entre les deux branches, et coupant en ligne droite l’angle qu’elles formaient, une troisième bande, composée de quatorze esclaves fidèles et bien armés, sous la conduite de deux blancs, s’avançait vers la retraite présumée des bandits.
Chacun de ces petits détachements était accompagné de nègres habitués à sonder la profondeur des bois. L’un ou l’autre devait tomber sur la piste des marrons. Il avait alors pour consigne d’envoyer prévenir les autres bandes, qui, aussitôt, se réuniraient toutes trois pour occuper le campement.
Mais les nègres marrons se tenaient toujours sur leurs gardes, et plaçaient des éclaireurs de tous côtés ; l’entreprise était donc fort hasardeuse.
La route que venait de parcourir Charlot étant la plus directe, il fut convenu qu’on la suivrait. On envoya deux noirs aux deux autres corps, et on attendit d’être tous réunis avant de pousser en avant.
Tout brisé de fatigue qu’il était, le pauvre Charlot ne tenait pas d’impatience.
« Le Malgache a dit qu’il les ferait mourir au lever du soleil, » répétait-il à chaque instant.
La même inquiétude dévorait le chirurgien et le matelot. À la fin, ils ne purent y résister. Ils laissèrent trois nègres pour guider les autres bandes quand elles arriveraient, et se dirigèrent vers le camp des marrons sous la conduite de Charlot.
« Monte sur mon dos, petit marsouin, dit le père Dur-à-cuire à l’enfant, qui traînait péniblement ses jambes fatiguées.
– Merci, Norzec, répondit le mousse, je vous fatiguerais trop.
– Veux-tu bien monter, moussaillon de malheur ! s’écria Norzec ; monte, ou je t’assomme. »
Peu effrayé de cette menace dont il connaissait la valeur, Charlot céda pourtant au digne marin et s’installa sur ses robustes épaules.
Norzec marchait si vite, malgré son fardeau, que M. Gautier pouvait à peine le suivre.
Au bout de quelque temps, on parvint à l’endroit où Charlot avait dans la nuit rejoint la rivière. Un arbre de forme bizarre, qui avait poussé isolément sur la berge, fit reconnaître la place au petit mousse.
Ici commençait la partie la plus périlleuse de l’expédition. Il fallait s’enfoncer dans le bois, et l’on s’exposait à être découvert par les éclaireurs ennemis.
La coulée qui avait conduit Charlot à la rivière se trouvait presque en face de l’arbre, et les rameaux brisés marquaient encore son passage. L’enfant entra le premier dans cette coulée, où M. Gautier le suivit. Norzec fermait la marche.
Au bout d’une heure environ, ils entendirent divers bruits dont ils ne purent s’expliquer la nature, mais qui partaient du même point de la forêt. Ils se dirigèrent de ce côté.
À mesure qu’ils approchaient, ils distinguaient des éclats de voix, des cris, et le bruit sec de morceaux de bois qu’on frappait l’un contre l’autre.
M. Gautier trembla pour les prisonniers.
« On célèbre sans doute la fête de leur supplice, » pensa-t-il.
Un instant plus tard, en effet, il put se convaincre que cette supposition était juste.
Arrivés à un endroit où le fourré disparaissait pour faire place à une vaste clairière, les Français aperçurent de loin les nègres qui dansaient avec des cris et des contorsions frénétiques autour de leurs prisonniers. Ceux-ci étaient complètement nus ; des liens d’écorce les attachaient à un poteau.
M. Villiers était fort pâle, mais il conservait sa figure impassible. Quant à Cadillac, il souriait d’un air de défi et semblait narguer ses bourreaux.
À un signal donné par Tapaï, le grand Malgache, la danse infernale s’arrêta. Les nègres s’armèrent de bâtons de bois flexibles et se groupèrent autour des prisonniers. Tapaï s’était sans doute réservé l’honneur de frapper le premier coup. Écartant de la main ses compagnons, il s’avança vers M. Villiers.
« Aujourd’hui ce sont les nègres qui frappent les blancs et qui les font mourir, dit-il à l’inspecteur. Mort aux blancs ! »
En parlant ainsi, il leva le bras ; au même instant un coup de feu retentit. Le Malgache poussa un cri de rage en portant la main à son épaule.
C’était M. Gautier qui venait de lui envoyer une première balle. Deux autres suivirent presque instantanément qui renversèrent deux autres nègres, les plus rapprochés de M. Villiers. Le chirurgien et le matelot se précipitèrent alors, le pistolet au poing, au milieu des noirs qui, à l’intrépidité de leur attaque, les prirent pour l’avant-garde d’un corps nombreux. La plupart se sauvèrent. Quelques-uns pourtant tinrent tête aux assaillants.
Mais Tapaï ne voulait point perdre sa vengeance ; il tira, malgré sa blessure, son couteau et s’élança de nouveau vers les prisonniers. Il allait saisir M. Villiers par les cheveux, lorsque quelque chose lui passa entre les jambes et le renversa. Ce quelque chose était notre ami Charlot.
Entraîné par la chute de son adversaire, l’enfant roula sur le sol avec le grand Malgache ; mais il ne lâcha point ses jambes. Heureusement pour le brave petit mousse, Tapaï, blessé, ne pouvait se servir de son bras droit. Norzec, accourant à la rescousse, asséna sur la tête du colosse un tel coup de crosse qu’il lui fendit le crâne.
Sans se préoccuper des meurtrissures qu’il avait reçues, Charlot courut à M. Villiers dont il coupa précipitamment les liens. Il en fit autant pour Cadillac.
« Ouf ! » s’écria celui-ci en s’étirant les bras.
Puis, saisissant son bâton, il s’en servit si bien qu’en moins d’une minute deux de ses ennemis gisaient sur le sol à demi morts.
M. Villiers, de son côté, ne restait pas oisif et se battait vaillamment.
Malheureusement pour les Européens, les noirs s’aperçurent bientôt qu’ils étaient en petit nombre. Ils se consultèrent, rappelèrent les fuyards et revinrent tous ensemble à l’attaque.
Serrés l’un contre l’autre, adossés au large tronc d’un arbre énorme, et protégeant de leurs corps le mousse placé derrière eux, M. Villiers, le chirurgien et les deux matelots, le couteau aux dents, avaient en outre rechargé leurs armes et promettaient de vendre chèrement leur vie.
Tout à coup, deux ou trois marrons, accourant des profondeurs du bois, se précipitèrent sur la clairière.
« Les blancs ! crièrent-ils, les blancs arrivent ! Sauvons-nous ! »
Cette fois tous prirent la fuite. Plusieurs coups de feu partirent du fourré.
Les blancs, qui venaient d’arriver avec une douzaine de nègres fidèles commandés par M. Hofen en personne, s’élancèrent après les fugitifs.
« Charlot ! mon pauvre Charlot ! criait Jobic en cherchant de tous côtés son petit protégé, où est Charlot ?
– Me voici, Jobic, » répondit l’enfant en venant se jeter dans les bras du matelot.
Jobic l’enleva de terre et l’embrassa à le faire crier.
« Pas si fort, disait l’enfant, tu me serres trop, Jobic.
– Tâche de ne pas me le casser ! s’écria Cadillac. C’est à ce mousse-là que je dois d’être encore de ce monde, et je ne veux pas qu’on me l’abîme.
– C’est lui qui nous a guidés jusqu’ici, ajouta le chirurgien. Si nous sommes arrivés à temps pour sauver M. Villiers et Cadillac, c’est au courage de maître Charlot que nous le devons. »
Mais Charlot ne pouvait répondre à tous ces compliments. Le pauvre enfant, brisé, meurtri, tombait de fatigue, de sommeil et de faim.
Les yeux à moitié fermés déjà, il avala quelques morceaux de galette et un verre d’eau mêlée de rhum que lui présenta Jobic. Puis, étendant ses bras, il laissa retomber sa tête sur le sol et s’endormit au milieu des conversations et du bruit.
Pendant ce temps, les soldats de M. Hofen poursuivaient les nègres marrons. Ils en firent sept prisonniers.
Parmi ceux-ci se trouvait Morabé. On les enchaîna solidement et, après une halte de quelques heures nécessaire pour reposer les hommes, on se mit en devoir de regagner Buena-Vista.
Norzec, Jobic et Cadillac se disputèrent à qui porterait Charlot, toujours endormi.
« J’ai entendu dire à des cavaliers qu’on était plus fatigué quand on changeait de cheval, dit Norzec ; ainsi, filez votre nœud. Charlot est habitué à mon trot, et c’est moi qui le porterai… Ho, hisse ! »
Le mousse endormi se trouva de nouveau à califourchon sur le cou du matelot.
Grâce aux nègres qui accompagnaient M. Hofen, on revint à Buena-Vista sans faire le détour auquel l’obligation de suivre la rivière avait contraint notre ami. Chemin faisant, M. Hofen raconta aux étrangers qu’aussitôt la réception du renseignement que lui avaient envoyé M. Gautier et Charlot, il avait deviné quelle devait être la position des nègres marrons. Son intention était de les cerner ; mais, comme il était arrivé juste au moment où les blancs allaient être écrasés par le nombre, il n’avait eu que le temps de s’élancer sur les bandits.
Charlot n’entendit pas un mot de tout cela. En arrivant à l’habitation, on le jeta sur un lit. Il ne fit qu’un somme jusqu’au matin.
En se levant, il s’aperçut que tout le monde était rassemblé dans la cour. Il courut voir ce qui se passait.
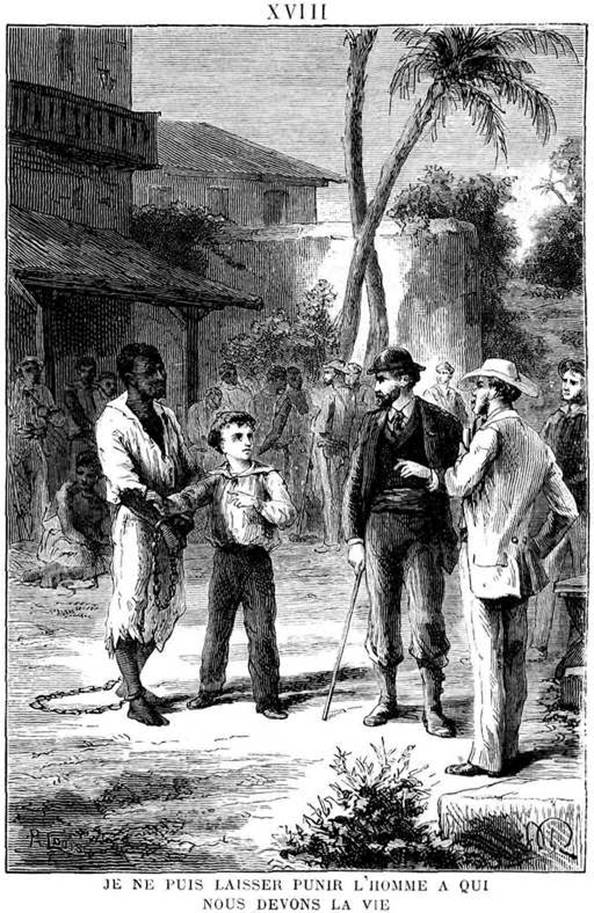
Des esclaves, armés jusqu’aux dents et commandés par un blanc et un mulâtre, se disposaient à conduire à la ville la plus prochaine les révoltés pris les armes à la main.
« Pauvres gens ! » murmura Charlot.
Il allait s’éloigner le cœur gros, lorsqu’il remarqua qu’un des nègres l’appelait en lui faisant autant de signes que le permettaient les chaînes dont le malheureux était chargé. Charlot s’approcha et reconnut Morabé.
Le petit mousse n’en fit ni une ni deux, comme on dit ; il se jeta au cou de l’esclave.
Une explication s’ensuivit. On relâcha les liens de Morabé.
« Je ne puis laisser punir l’homme à qui nous devons la vie, dit M. Villiers. Comment faire pour le sauver, monsieur Hofen ? »
Ce dernier le tira un peu à l’écart.
« Il n’y a qu’un seul moyen, dit-il, c’est d’acheter Morabé à son maître.
– Oh oui ! s’écria Charlot.
– Malheureusement il est à craindre que le señor Paraõ ne consente pas à vendre cet esclave.
– En offrant le double de ce qu’il vaut ?
– Le señor Paraõ est vindicatif ; il aimera mieux se venger.
– Nous verrons, reprit M. Villiers. Pour le moment, obtenez seulement qu’on laisse cet homme sous votre garde. Je me charge de le ramener à Rio-Janeiro. Une fois là, nous trouverons moyen de le sauver. »
Grâce à quelques milreïs[4] distribués aux chefs de l’escorte, l’affaire s’arrangea.
On enferma Morabé dans une chambre où il fut bien traité et bien nourri. Puis, il partit à son tour avec ses protecteurs pour Rio-Janeiro, où nos voyageurs arrivèrent à bon port, mais singulièrement amaigris et noircis par le soleil de feu du Brésil.
Telle était l’humeur vindicative du señor Paraõ qu’il ne voulait à aucun prix vendre son esclave. Il tenait absolument à le faire mourir.
Heureusement pour le nègre, la Providence se chargea le même jour de punir le Brésilien de sa cruauté. Son cheval, qu’il surmenait et rouait de coups, prit le mors aux dents et l’écrasa contre un arbre.
Alors les héritiers acceptèrent en échange de Morabé et de sa famille le prix élevé qu’en offrait M. Villiers.
Jamais Charlot n’avait été aussi content que le jour où le nègre, libre désormais, vint remercier son petit protecteur et M. Villiers.
« Que Dieu bénisse la mère qui vous a mis au monde ! » s’écriait le pauvre homme les larmes aux yeux.
Pour s’associer à la bonne œuvre de l’inspecteur, l’équipage du Jean-Bart fit une collecte, afin de laisser à la famille du noir les moyens d’acheter une petite hutte et de vivre quelque temps. Comme les marins sont généreux, cette collecte produisit 70 milreïs, c’est-à-dire environ 168 francs. M. Villiers y ajouta 200 francs.
Morabé, industrieux et actif plus que ses compatriotes, monta un petit commerce de fruits. On sut plus tard qu’il avait prospéré et qu’il vivait heureux avec sa femme et ses enfants.
CHAPITRE XIX – Le cap Horn. – Valparaiso. – La famille Morand. – La fièvre typhoïde. – Dévouement de Fanchette. – La lettre.
Peu de temps après le retour de M. Villiers et de ses compagnons à Rio-Janeiro, le Jean-Bart mit à la voile pour continuer son voyage. Nous ne nous arrêterons pas avec lui à chacune des escales (relâches) qu’il fit sur les côtes du Brésil. Il s’agissait d’affaires commerciales dont le détail serait trop long et n’offrirait aucun intérêt à nos jeunes lecteurs. Disons seulement que, trois mois plus tard, le Jean-Bart, en route pour Valparaiso, se disposait à la périlleuse entreprise de doubler le cap Horn.
Ce cap, qui forme la pointe la plus méridionale de l’Amérique, doit son nom à Guillaume Schouten, qui le découvrit en 1816 et lui donna le nom de sa ville natale.
La mer est toujours extrêmement houleuse dans ces parages, et des tempêtes fréquentes menacent les navigateurs.
À la sortie du détroit Le Maire, qui sépare la Terre de Feu des îles Staatenland, le Jean-Bart essuya un orage terrible. Il fallut prendre des ris, c’est-à-dire diminuer la surface des voiles au moyen de ficelles attachées à la toile et nouées ensemble. Une des vergues fut brisée par un coup de vent, et les éclats blessèrent deux matelots assez grièvement. Des montagnes d’eau se précipitaient en écumant sur le navire qu’elles semblaient à chaque instant devoir engloutir. À peine, dans le tumulte de la tempête, pouvait-on entendre les ordres du capitaine.
Enfin, après quelques heures, le vent diminua de violence et l’on put hisser des voiles. Mais la mer, bouleversée, restait toujours houleuse, et le navire fatiguait beaucoup, comme on dit à bord. Harassés et sans cesse appelés à la manœuvre, les matelots avaient à peine le temps de manger. Quant au repos, il ne fallait y penser ni pour le jour ni pour la nuit.
En dépit des coups de vent qui se renouvelèrent plusieurs fois en quelques jours, le Jean-Bart parvint à doubler le cap Horn, dont la pointe nue et désolée s’élève à près de 200 mètres au-dessus des flots.
À partir de ce moment, nos voyageurs quittaient l’océan Atlantique et entraient dans l’océan Pacifique. Ce dernier ne mérite son nom qu’à une certaine distance de son terrible voisin, dont les tempêtes réagissent sur lui.
Charlot se comporta fort bravement dans les jours de péril. Il montra surtout un sang-froid extraordinaire chez un enfant de cet âge. Quoiqu’il ne fît aucun étalage de zèle et de bravoure, le capitaine remarqua sa conduite avant même que M. Villiers ne la lui eût signalée.
« C’est un marin de la bonne roche, dit-il à l’inspecteur. Beaucoup de besogne et peu de bruit. Si ce garçon-là pouvait rester un ou deux ans à terre pour travailler les mathématiques, il y a chez lui l’étoffe d’un capitaine au cabotage et peut-être au long cours.
– Bernard aussi s’est bien montré, dit M. Villiers.
– Certainement ; ce n’est ni le courage ni l’intelligence qui lui manquent ; malheureusement, cela ne suffit pas. Il est menteur, indiscipliné et paresseux. Ces défauts lui font perdre le fruit de toutes ses bonnes qualités. Avec plus de vivacité et d’intelligence que Charlot, vous verrez qu’il réussira moins bien dans la vie que ce dernier. »
Une vigie, c’est-à-dire un matelot qui était de faction dans la hune pour voir de plus loin, interrompit le capitaine en annonçant qu’on apercevait Valparaiso.
Rien de plus triste que l’aspect de cette ville peuplée cependant de 40 000 âmes. Elle dépend du Chili, dont Santiago est la capitale. Les maisons, construites à l’italienne, sont fort richement décorées dans l’intérieur ; mais les tourbillons de sable, qui s’élèvent sur la route au moindre souffle du vent, abîment tout et exercent une influence fâcheuse sur la santé des habitants.
Comme tous les peuples de l’Amérique du Sud, les Chiliens sont d’intrépides cavaliers. Le costume national est le puncho, sorte de pièce d’étoffe au milieu de laquelle on pratique un trou pour passer la tête.
Le commerce de cette ville se fait principalement avec Lima et consiste en métaux précieux, tels que l’or, l’argent et le platine. Le Chili exporte aussi des bœufs, des moutons et des grains.
Aucun incident n’ayant marqué le séjour du Jean-Bart dans le port de Valparaiso, nous ne nous y arrêterons pas.
Laissons le capitaine Tanguy et son équipage visiter les principales villes de la côte occidentale de l’Amérique du Sud, et revenons à la famille de Charlot, que nous avons perdue de vue depuis longtemps.
Marianne avait continué sa vie laborieuse et dévouée. La pauvre femme ne pouvait cependant reprendre complètement ses forces. Le chagrin de la perte de son mari était chez elle aussi vif que le premier jour. Elle ne trouvait de charme à rien ; son unique plaisir désormais était d’embrasser ses deux filles et de recevoir des nouvelles du cher petit absent. Elle s’était procuré une mappemonde, sur laquelle Denise et elle suivaient les relâches de maître Charlot.
Chaque soir on voyageait avec lui, et ses lettres apportaient une semaine tout entière de joie et d’animation dans la pauvre demeure.
Un jour, en arrivant chez ses amies, Fanchette les trouva désolées ; Marianne venait de tomber tout à fait malade. Les voisines disaient tout bas qu’elle avait la fièvre typhoïde. Cette maladie était alors à l’état d’épidémie sur la côte. Denise aussi se plaignait de douleurs de tête et pouvait à peine se remuer.
L’argent est si difficile à gagner pour les pauvres gens, qu’ils hésitent longtemps avant de faire venir un docteur. Puis le médecin le moins éloigné demeurait à Lezardrieux, c’est-à-dire à trois lieues de là environ.
Enfin, un fermier qui se rendait de ce côté se chargea de le prévenir.
Au premier coup d’œil, le médecin reconnut la terrible maladie.
« Est-ce qu’il y a du danger, monsieur Traneau ? demanda tout bas Fanchette.
– Pas encore, mon enfant, mais cela peut venir. Et il est indispensable que les deux malades soient veillées avec le plus grand soin. »
Il écrivit quelques prescriptions et sortit.
Mais il ne suffisait pas d’avoir les ordonnances du médecin, il fallait encore les porter au pharmacien de Lézardrieux ou de Tréguier, et il fallait aussi de l’argent pour payer les médicaments.
Fanchette obtint du facteur qu’il ferait ses commissions au bourg voisin. Puis, ayant réuni le peu d’argent qu’elle avait amassé, elle demanda un congé à son maître et vint s’installer au chevet de ses amies. Marianne avait déjà perdu le sentiment de ce qui se passait autour d’elle. Denise parlait incessamment sans qu’on pût la comprendre.
La petite Rosalie allait en pleurant d’un lit à l’autre et venait cacher sa figure éplorée contre l’épaule de Fanchette, qui la consolait de son mieux.
La tâche de celle-ci était difficile. Les deux malades réclamaient des soins constants. Il fallait être sur pied toute la nuit pour leur donner à boire, car une soif inextinguible les dévorait. Il fallait aussi préparer les repas de Rosalie, l’aider à faire sortir les bestiaux et à les renfermer, traire la vache et la chèvre, aller chercher de l’eau à la fontaine, laver le linge, que sais-je enfin ? Une femme dans la force de l’âge serait difficilement venue à bout de tant de soins. Comment Fanchette, frêle et chétive, parvint-elle à s’en acquitter ? Dieu seul pourrait le dire. La courageuse enfant travaillait sans cesse et ne dormait que deux ou trois heures par jour.
L’instituteur et le curé venaient souvent et gardaient les malades tandis qu’elle était occupée ailleurs. Le curé ne manquait jamais d’apporter du vin, un morceau de viande, ou un peu d’argent ; mais lui-même était pauvre, et sa cure ne l’enrichissait pas. L’instituteur et quelques voisines donnaient des coquillages, des pommes de terre. Du reste, le médecin avait ordonné que très peu de personnes restassent dans la chambre, dont l’air devait être conservé aussi pur que possible.
Comme on l’a dit souvent, un malheur n’arrive jamais seul. Le matelot qui manœuvrait la barque des Morand, paya aussi son tribut à l’épidémie de fièvre typhoïde.
La pauvre famille se trouva dès lors complètement sans ressources.
Un jour, le facteur apporta une lettre pour Mme Marianne Morand.
« C’est vingt-huit sous, dit-il.
– Je n’ai pas tant d’argent que cela, » répondit Fanchette qui avait envie de pleurer.
Le facteur fit un geste de regret et remit la lettre dans sa boîte.
« Vous la reprenez !
– Dame ! puisqu’elle n’est pas payée. »
Fanchette poussa un gros soupir. À cet instant le curé parut sur le seuil.
« Qu’y a-t-il donc ? » demanda-t-il en voyant l’air malheureux de Fanchette.
On le lui expliqua. Il prit la lettre et paya le port.
« Marianne est hors d’état d’entendre la lecture de ceci, reprit-il en regardant la malade.
– S’il y avait des choses pressées dedans, cependant, remarqua Fanchette.
– On dirait qu’elle contient quelque papier d’un autre format, dit encore le curé qui palpait la lettre, peut-être un mandat. »
Il regarda le timbre, l’écriture.
« Valparaiso ! Ce doit être de son fils.
– De Charlot. Ah ! quel bonheur !
– Que faire ? se demandait le digne prêtre. Si cette lettre contient réellement de l’argent, il faut l’ouvrir. D’un autre côté, décacheter une lettre qui ne m’est pas adressée… Bah ! Dieu lit dans mon cœur, il voit ce qui me fait agir. »
Il fit sauter le cachet et trouva un mandat de cent quarante francs, un petit billet du capitaine Tanguy et une lettre de Charlot.
« Madame, écrivait le capitaine, j’ai tenu à vous écrire pour vous témoigner ma satisfaction de la conduite de votre fils. C’est un excellent enfant qui sera digne de son père et deviendra comme lui un brave et loyal marin. Il peut compter dès à présent sur l’amitié de votre tout dévoué.
« Tanguy,
« Capitaine au long cours. »
« Ma chère maman, écrivait Charlot de son côté, tu sais qu’en arrivant à Rio-Janeiro, M. Villiers m’avait donné cent francs. Avec cela, sur le conseil de Norzec, j’ai acheté une petite pacotille. M. Villiers s’est chargé de me la vendre à Valparaiso, et j’ai déjà soixante-deux francs de bénéfice. Avec ce que m’ont donné le second et le chirurgien pour qui j’avais fait des commissions, ça me fait cent quatre-vingts francs.
« Jamais je ne m’étais vu tant d’argent. J’avais si peur de le perdre que je n’en dormais pas.
« Qu’est-ce que tu comptes faire de ce trésor ? m’a demandé un jour le capitaine.
« J’ai dit que je le gardais pour toi et que je voudrais bien pouvoir te le donner tout de suite.
« Alors il l’a pris et l’a porté chez un banquier, et le banquier lui a remis en échange un papier que je t’envoie. Il est adressé à un monsieur Rothschild. Il paraît que ce monsieur est bien connu, car le capitaine m’a dit que tu pouvais présenter ce papier à n’importe quel banquier de Tréguier ou de Lannion et qu’on te donnerait l’argent tout de suite.
« Il faudra acheter une mante pour toi, car la tienne était tout usée et tu avais froid les jours de gros temps. Et puis des souliers et du bon cidre pour te donner des forces. Je voudrais bien aussi que Denise et Rosalie aient chacune une veste neuve. Rosalie avait tant d’envie d’en porter une verte comme celle de la petite Binie. Et puis je voudrais bien aussi que tu donnes quelque chose à Fanchette, tu l’embrasseras de ma part. Enfin tu sais mieux que moi ce qu’il faut faire de l’argent, et tu achèteras ce que tu voudras.
« Si tu savais combien je désire être riche pour t’envoyer beaucoup d’argent. Tu aurais une jolie maison blanche, comme il y en a au Havre, et puis un bon dîner. Enfin tout ce qu’il y a de meilleur serait pour toi et pour mes sœurs. Fanchette aussi en aurait sa part. Sans compter que je n’oublierais ni Jobic, ni Cadillac, ni le père Dur-à-cuire, qui sont tous bons pour moi.
« Tu sais bien M. Villiers, de qui je te parle toujours ? Eh bien, il me donne des leçons de mathématiques. Je lui en suis si reconnaissant ! Quelquefois il s’impatiente, parce que je ne comprends pas très vite ; alors je deviens rouge et je ne sais plus ce que je dis. Mais il hausse les épaules en riant et il me tire l’oreille, une manière d’amitié, en me disant de n’avoir point peur. Il dit qu’il faut que je travaille pour devenir un jour capitaine. Moi, je voudrais bien, mais c’est si beau que je n’ose l’espérer.
« Quand tu m’écriras, donne-moi des nouvelles de tout le monde, de Denise, de Rosalie, de Fanchette et de tous nos bestiaux et du vieux sacristain, de Jérôme, de notre matelot, du petit Mathurin, et enfin de tous les voisins.
« Je vais faire mon possible pour gagner encore d’autre argent afin de te l’envoyer. Ainsi ne ménage pas celui-ci, emploie-le à bien te soigner ainsi que mes sœurs et la petite Fanchette.
« Adieu, ma chère maman, je prie le bon Dieu qu’il vous conserve tous en bonne santé, et je me dis pour la vie ton fils obéissant,
« Charlot Morand. »
Un paraphe formidable accompagnait la signature de Charlot.
« Brave petit cœur, va, » murmura le bon curé.
Malgré l’état d’assoupissement dans lequel Marianne était constamment plongée, son cœur de mère avait entendu le nom de Charlot. Elle souleva péniblement sa tête et montra la lettre du doigt.
« Charlot, murmura-t-elle en essayant de rassembler le fil emmêlé de ses idées.
– Il se porte bien et il vous envoie cent quarante francs, dit le curé. Le capitaine vous écrit aussi et vous fait les plus grands éloges de votre fils. »
Un éclair de joie illumina le visage amaigri de la pauvre mère.
« Mon cher enfant ! » dit-elle.
Il fallut lui mettre la lettre devant les yeux et la poser un instant sur ses lèvres. Puis son regard s’éteignit, sa tête retomba sur l’oreiller. Cinq minutes après, elle ne voyait plus rien de ce qui se passait autour d’elle.
« Écoute, dit le curé à Fanchette, en attendant que Marianne soit assez bien pour signer le mandat, je vais lui faire l’avance d’une partie de cette somme. Envoie prendre chez moi soixante-dix francs, cela te permettra d’avoir les objets les plus nécessaires. »
Fanchette courut chez les voisins. Avec l’obligeance des pauvres gens, chacun se mit à l’œuvre. L’un alla chez le curé ; l’autre courut jusqu’à Lézardrieux chez le pharmacien ; un troisième acheta un peu de menu bois dans une ferme voisine. Chacun enfin fit de son mieux.

Soit que la maladie de Marianne fût arrivée à la période décroissante, soit que l’émotion produite par les nouvelles de son fils eût amené une crise salutaire, à partir de ce jour il y eut amélioration dans son état. Bientôt le médecin déclara qu’elle était hors de danger ainsi que Denise. Mais il eut bien soin d’ajouter que leur état réclamait encore longtemps des soins assidus.
La grande distraction de la veuve fut alors de se faire lire la lettre de Charlot et celle du capitaine Tanguy. Elle était si fière des éloges qu’on donnait à son enfant !
« Il ne t’a pas oubliée non plus, toi, disait-elle en montrant à Fanchette les passages où Charlot parlait amicalement de sa petite camarade.
– Bon Charlot !
– Comme il te remerciera quand il saura tout ce que tu as fait pour nous ! Tu as été notre bon ange, ma petite Fanchette.
– Ah ! madame Marianne, ne dites pas cela.
– Si, mon enfant. Le docteur et le curé m’ont raconté que sans tes soins Denise et moi ne serions plus de ce monde.
– Oh ! s’écria Fanchette, j’aurais voulu pouvoir faire davantage ! Je n’oublierai jamais combien vous avez été bonne pour la pauvre mendiante. Si vous saviez comme je suis heureuse chaque fois que j’entre dans votre maison ! Tout le monde me reçoit ici comme si j’étais de la famille, et on m’embrasse, on me dit de bonnes paroles ! Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer cela, madame Marianne, mais voyez-vous, il me semble que mon cœur s’ouvre quand je viens ici… et… et… enfin je vous aime tous de tout mon cœur, et je vous suis bien reconnaissante de votre amitié. »
Elle se jeta dans les bras de la veuve qui la serra sur son cœur avec effusion.
« Eh bien, et moi ? dit Rosalie en glissant sa tête mutine près de celle de sa mère.
– Et moi ? murmura Denise qui avait passé son bras bien faible encore autour du cou de Fanchette.
– Mes enfants, dit Marianne, remercions Dieu du secours qu’il vient de nous envoyer. Remercions-le surtout de m’avoir donné des enfants si dévoués, si affectueux. Puisse sa bonté nous protéger encore, protéger surtout mon petit Charlot et le ramener auprès de nous ! »
Marianne et les trois enfants se mirent à genoux et firent ensemble une fervente prière.
CHAPITRE XX – San-Francisco. – La fièvre d’or. – Désertion de Bernard et de Jérôme. Explorations. – Découverte de l’or. – Travail aux mines.
Retournons maintenant à notre ami Charlot, dont le navire est en vue de San-Francisco. Cette ville, que la découverte des mines d’or a rendue célèbre, était jadis une petite bourgade peu importante. Elle dépendait de la Nouvelle-Californie, qui fut découverte en 1542 par Cabrillo et que le célèbre navigateur Drake explora trente-six ans plus tard. L’Espagne s’en empara au dix-huitième siècle. Après avoir fait longtemps partie du Mexique, elle fut conquise par les États-Unis et comprise dès lors dans leur Confédération. La population de la Californie, qui n’était alors que de 160 000 âmes tout au plus, dépasse maintenant 500 000 âmes.
Monterez, autrefois capitale du pays, a dû céder son titre à San-Francisco.
Cette ville, située à l’entrée du fleuve du même nom, ne comptait en 1847 que 4 ou 5 000 habitants. Aujourd’hui la population monte à plus de 100 000 personnes appartenant à toutes les nations.
La baie de San-Francisco, une des plus belles du monde, a vingt-cinq lieues de long et se compose de plusieurs autres baies, entre autres de celles de Santa-Clara et de San-Pablo. Elle renferme aussi plusieurs îles, telles que l’île de Los Angelos et l’île Molatte.
La ville est située au sud de l’entrée de la baie. On la voit à droite en traversant le goulet ou détroit connu sous le nom de Porte-d’Or.
Au moment où nos voyageurs arrivèrent à San-Francisco, le pays était en proie à la fièvre de l’or. Les mines venaient d’être découvertes, et les travailleurs comme les aventuriers accouraient de toutes les parties du monde. Pleins d’illusions, ils se figuraient faire fortune en quelques jours sans peine ni travail. On parlait beaucoup de ceux qui revenaient des mines avec des sacs de poudre d’or et de pepites (morceaux d’or) ; mais on oubliait les malheureux, bien plus nombreux encore, qui n’avaient trouvé dans leurs recherches que la misère, la fièvre et souvent la mort.
Plusieurs navires à l’ancre dans la baie ne pouvaient repartir faute d’équipage ; les matelots s’étaient sauvés pour aller aux mines. Aussi, le capitaine Tanguy jugea-t-il à propos de faire ce petit discours à son monde :
« Mes enfants, si en arrivant à Rio-Janeiro ou à Panama, je vous avais dit que je trouvais des matelots à moitié prix et que, par conséquent, j’allais vous débarquer pour leur faire place, vous m’auriez accusé de mauvaise foi, et vous m’auriez représenté avec raison que je n’avais pas le droit de manquer aux conditions de l’engagement que nous avons pris au Havre. Eh bien, si l’un de vous me quittait pour aller aux mines, il manquerait à sa parole et serait méprisé de ses camarades. Je sais que vous êtes tous de braves garçons, de vrais marins, et j’ai confiance en vous. Ici comme ailleurs, je vous laisserai aller à terre, et je compte sur l’honneur pour vous empêcher de déserter votre navire. »
Les hommes jurèrent de revenir fidèlement à bord.
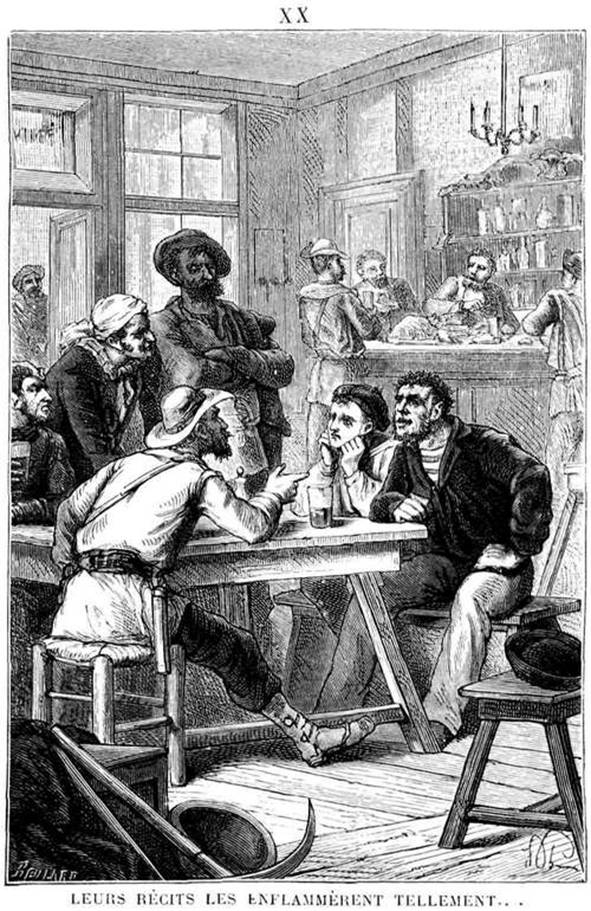
Ils tinrent leur parole, en effet, sauf Bernard et un autre marin, d’esprit assez borné, qui s’appelait Jérôme Sornin. Ces deux derniers eurent le malheur de se trouver dans un cabaret avec une bande de mineurs qui arrivaient des placers (endroits où l’on recueille l’or) et qui avaient fait une brillante campagne.
Leurs récits enflammèrent tellement l’imagination de Bernard et de Jérôme, qu’ils résolurent de partir aussi pour les mines.
Ils voulurent entraîner Charlot avec eux, mais le mousse refusa bravement.
« Nigaud, lui dit Bernard, songe donc que tu rapporteras de l’or plein tes poches pour envoyer à ta mère et à tes sœurs.
– C’est vrai, soupira Charlot, mais rappelle-toi ce que le capitaine nous a dit hier.
– Bah ! des bêtises. Vois donc les matelots des autres navires… Allons, viens avec nous.
– Non, répondit Charlot avec fermeté ; mon devoir est de rester ici, et je resterai.
– Ne va pas nous trahir au moins, dit Jérôme.
– Il n’y a rien à craindre, » reprit Bernard.
Ils s’éloignèrent aussitôt, et ils partirent furtivement le lendemain matin.
« Ce garçon prend un mauvais chemin, murmura le capitaine quand il constata l’absence de Bernard. Si son pauvre père vivait encore, quelle honte pour lui ! »
Ainsi que nous l’avons dit, M. Villiers était chargé des intérêts d’une puissante Compagnie commerciale, et la Californie lui offrait un vaste champ d’études.
« Croyez-vous que nous puissions passer quinze jours ici sans que vos matelots désertent ? dit-il au capitaine Tanguy.
– Oui, répondit le capitaine, maintenant je réponds d’eux. Seulement, comme la fidélité de ces braves gens mérite une récompense, je vais les autoriser à travailler pour leur compte dans la ville ; ils iront à tour de rôle. »
Il est bon de dire qu’à cette époque la main-d’œuvre était hors de prix à San-Francisco. On payait des garçons de café jusqu’à 80 francs par jour. Des charpentiers et des manœuvres se faisaient des journées de 120 francs.
Comme portefaix, un homme vigoureux pouvait aisément gagner une soixantaine de francs.
Il est vrai que les vivres et les logements étaient à des prix proportionnés ; le bénéfice était en réalité bien moins considérable qu’on ne l’eût supposé.
L’esprit de conduite et l’honnêteté sont toujours appréciés partout, et les matelots du Jean-Bart trouvèrent promptement à s’employer à de bonnes conditions.
Jobic entra chez un charpentier qui lui donnait 60 fr. par jour. Norzec s’établit portefaix. Cadillac, qui était adroit comme un singe, devint barbier ambulant ; il y eut des journées où il gagna jusqu’à 200 francs.
Quant à Charlot, qui avait l’air de deux ans au moins plus âgé qu’il ne l’était réellement, il se fit commissionnaire. Le menuisier du bord lui fabriqua une paire de crochets à sa taille ; et le mousse, actif, probe et intelligent, eut bientôt une petite clientèle.
Un jour qu’il était assis à sa place accoutumée sur les wharfs, ou quais, un individu, habillé comme les gens qui arrivent des mines et chargé autant qu’une bête de somme, s’arrêta devant lui.
Bien qu’il fût à moitié gris, cet homme n’avait pas mauvaise figure. On l’aurait pris pour un ancien marin. Son gros rire, un peu bête, était cependant bon et confiant.
« Mon garçon, dit-il à Charlot, connais-tu un endroit où un homme, qui a de l’or plein son sac, puisse se faire beau et se payer tout ce qu’il y a de plus huppé en fait d’habillement ?
– Oui, monsieur, répondit Charlot. Il y a le grand bazar de Melwil et Ce, où vous trouverez tout ce que vous voudrez.
– Bon, bon ! Alors tu vas m’y conduire.
– Oui, monsieur. »
Chemin faisant, le mineur raconta qu’il arrivait des placers, et qu’en six mois, il avait récolté pour 48 000 fr. d’or.
« Maintenant, dit-il, il n’y a rien de trop bon pour moi, et je veux vivre comme un capitaine de vaisseau.
– Vous êtes bien heureux, soupira Charlot.
– Tu voudrais aussi gagner de l’argent, mon petit homme ?
– Dame, oui !
– Et qu’en ferais-tu ?
– Je l’enverrais à ma mère et à mes sœurs. »
Le mineur s’arrêta.
« Tiens, tu vaux mieux que moi. J’ai aussi une pauvre vieille mère qui m’attend là-bas, et je ne pensais pas à elle.
– Maintenant que vous êtes riche, il faut aller la voir, dit le mousse.
– Je veux faire encore une expédition aux placers auparavant. Je connais un endroit où je suis sûr de ramasser plus de cinquante livres d’or.
– Oui, monsieur, mais votre mère, pendant ce temps-là, qu’est-ce qu’elle deviendra ? »
Le mineur s’arrêta encore.
« Le petit a raison, murmura-t-il, je suis un sans cœur. Je ne vaux pas le diable. Attends, petit. »
Il défit une large ceinture qu’il portait roulée autour de la taille, dessous sa vareuse, et en tira un sac noir et sali, plein de poudre d’or.
« Il y en a là pour 12 000 fr., dit-il. Garde-moi ça, c’est pour envoyer à ma vieille mère.
– Tout de suite ?
– Oh ! non, tu m’ennuies ; j’ai trop soif, puis je veux me requinquer ; nous arrangerons le reste après que j’aurai fait mes emplettes. Tiens, voilà une once pour toi (environ 80 fr.) ; tu la donneras à ta mère. Et maintenant, marchons. »
En route, le mineur, qui s’appelait Letoureux, s’arrêta encore dans deux ou trois bar-room, sorte de comptoirs où l’on vend des boissons et des liqueurs fortes.
Quand il entra dans le bazar, il se tenait à peine debout. Heureusement pour lui, les marchands servaient chaque jour des clients de ce genre et savaient comment s’y prendre avec eux.
On l’équipa à neuf des pieds à la tête pour la modeste somme de 380 dollars (1900 fr.). Les commis auraient assez volontiers gardé la ceinture avec les vieux habits du chaland, mais ce dernier, malgré son ivresse, ne perdait pas de vue son or.
En sortant, Charlot remarqua deux individus plantés à la porte du bazar comme attendant quelqu’un. Il se rappela avoir déjà vu ces deux figures derrière eux, et quand il les vit de nouveau emboîter le pas à leur suite, quelques soupçons traversèrent son esprit.
« Monsieur, dit-il à son compagnon, il faut nous hâter de gagner l’hôtel. Voilà deux hommes qui nous suivent et qui n’ont pas l’air d’avoir de bons desseins.
– Eux, répondit le mineur que l’ivresse disposait à tout voir en beau, c’est des amis. Tu vas voir plutôt. »
Il s’approcha des inconnus et les engagea à entrer avec lui au premier bar-room qu’ils rencontreraient.
La proposition fut acceptée avec empressement. On s’installa, et les hommes insistèrent beaucoup pour faire boire Charlot ; mais celui-ci refusa obstinément.
La nuit approchait cependant, et l’on sait avec quelle rapidité elle tombe dans cette partie du globe. Quand les convives sortirent du bar-room, l’obscurité était complète. L’un des individus prit le bras droit de Letoureux, l’autre s’empara du bras gauche, et tous trois s’en allèrent en chantant, Letoureux en français et ses compagnons en anglais. Charlot trottait par derrière, soucieux et inquiet, car il devinait que les prétendus amis du pauvre mineur se proposaient de le dévaliser.
« Tu peux t’en aller, mon garçon, lui dirent-ils deux ou trois fois, nous n’avons plus besoin de toi. »
L’enfant ne répondait rien, mais, quoique très fatigué, il suivait toujours les trois hommes.
Malgré son ivresse, Letoureux avait conservé le souvenir confus de l’or qu’il avait remis au mousse.
De temps en temps il se tournait vers lui et murmurait confusément quelques mots relatifs à son sac.
« Que veut-il dire ? demanda l’un des Américains.
– Dame, répondit Charlot auquel vint une idée, il parle d’un grand sac de poudre d’or qu’il a confié à un portefaix avant d’aller au bazar, et qu’il voudrait sans doute aller reprendre.
– Il était bien grand, ce sac ?
– Oh ! oui, monsieur, fit Charlot ; grand comme ça. »
Et il indiquait les dimensions d’un sac propre à contenir au moins 40 à 50 livres d’or, c’est-à-dire près de 80 000 francs.
Les Américains se regardèrent.
« Qui a remis ce sac au portefaix ? demandèrent-ils.
– Moi, fit Charlot.
– Et où perche ce portefaix ?
– Au coin du quai, à côté des maisons neuves.
– Peux-tu nous y conduire ?
– Oui, monsieur.
– Écoute, mon garçon, tu as l’air intelligent : si tu veux gagner 500 dollars, conduis-nous chez cet homme, et tu lui demanderas le sac en disant que nous sommes des amis de celui-ci – en désignant Letoureux.
– Oui, monsieur.
– Seulement, ajouta l’autre, prends garde à toi ; si tu nous trahis, je t’enfonce mon couteau dans le ventre.
– Tais-toi donc, imbécile, murmura le premier, il fallait le surveiller sans rien dire et ne pas l’alarmer inutilement. »
Le portefaix auquel Charlot conduisait les trois hommes n’était autre que Norzec. Quoique épuisé de fatigue, l’enfant courait de toutes ses forces, car il craignait de ne plus trouver le marin à son poste.
Enfin ils arrivèrent au coin où se trouvait Dur-à-cuire.
« Eh bien ? demanda un des Américains.
– C’est ici, répondit Charlot en cherchant du regard son ami.
– Et l’homme qui a reçu le sac ?
– Le voilà ! »
Charlot venait en effet d’apercevoir Norzec qui, sa journée terminée, s’en allait bras dessus bras dessous avec un confrère, un matelot anglais, près duquel lui-même, tout robuste qu’il était, avait l’air d’un gringalet.
« Alors, viens lui demander le sac d’or, dit l’Américain, et songe à ce que je t’ai dit ; si tu nous trahis, je t’étrangle. »
Il posa la main sur le cou du mousse comme pour jouer, et se dirigea avec lui vers les deux marins.
« Qu’est-ce que tu veux, mon garçon ? demanda Norzec en reconnaissant Charlot.
– Nous venons réclamer le sac d’or qui vous a été confié ce matin par notre ami, dit le voleur en montrant Letoureux.
– Un sac d’or ! fit Norzec stupéfait, qu’est-ce que cela veut dire ?
– Ça veut dire, s’écria Charlot, que ces deux hommes-là veulent voler celui-ci.
– Comment, petit drôle ! » s’écria l’Américain en assénant à l’enfant un coup de poing qui l’aurait assommé si l’Anglais n’avait paré le coup avec l’adresse d’un boxeur émérite.
Voyant que les choses tournaient mal pour eux, les voleurs voulurent fuir ; mais ils avaient affaire à des gaillards vigoureux et résolus qui les empoignèrent à la gorge.
Norzec reçut un coup de bowie-knife qu’il para adroitement. L’autre compagnon, pour se venger, tira sur Charlot un coup de revolver qui ne fit que lui effleurer l’épaule.
Au bruit de la détonation, plusieurs personnes accoururent. Norzec et le matelot anglais, qui avaient ficelé leurs prisonniers comme des saucissons, racontèrent ce qui s’était passé.
Il paraît que les deux Américains n’en étaient pas à leur coup d’essai, car on les reconnut pour avoir déjà été condamnés et s’être enfuis de prison.
À cette époque, il n’y avait pas en Californie de police régulièrement constituée, et les habitants de San-Francisco se faisaient eux-mêmes justice. On empoigna les coupables, et ils furent reconduits sous les verrous.
Nous n’avons pas besoin de dire les compliments qu’on fit à Charlot sur son courage et sa présence d’esprit. Norzec ne se sentait pas de joie en les entendant.
Quant à Letoureux, qu’on parvint à dégriser en lui faisant boire de l’ammoniaque, il ne pouvait se lasser de remercier le petit garçon auquel il devait sa vie et sa fortune.
Rendu plus sage par son aventure, il résolut de retourner immédiatement dans son pays. Mais auparavant il voulut récompenser généreusement son sauveur : il lui laissa une somme de six mille francs.
« Écoutez donc, disait-il à ceux qui lui représentaient que c’était beaucoup, si le petit avait été moins brave et moins honnête, il m’aurait laissé égorger par les deux brigands. Puis il aurait gardé les 12 ou 15 000 francs de poudre d’or que je lui avais confiés et que personne ne serait venu lui réclamer. Je lui dois la vie enfin, et ma carcasse vaut bien encore 6 000 francs, pour moi du moins. »
Le pauvre Charlot faillit devenir fou de joie lorsqu’il apprit son aubaine.
« J’achèterai une maison pour maman, s’écria-t-il, et des robes de soie pour mes sœurs et pour Fanchette.
– En attendant, dit M. Villiers, veux-tu envoyer tout de suite de l’argent chez toi ?
– Oh ! oui, monsieur, tout.
– Non, il faut garder quelque chose pour t’acheter une pacotille. Envoie 2 000 francs. »
Il le conduisit chez un banquier qui leur remit une traite de 2 000 francs payable au Havre. Charlot l’adressa à sa mère avec une longue lettre, et le tout partit dans le sac aux dépêches d’un navire qui mettait à la voile pour Bordeaux.
Le lendemain, M. Villiers invita Charlot à déjeuner, et, comme avant de quitter San-Francisco il désirait en voir un peu les environs, il fit louer trois chevaux et partit avec le mousse et Cadillac.
Arrivés à quatre lieues environ de la ville et sur le point de tourner bride, nos promeneurs entendirent tout à coup une voix lamentable s’élever d’un marécage voisin.
« Au secours ! criait-on en français, au secours ! Ayez pitié de moi !
– C’est singulier, dit Cadillac, il me semble que je connais cette voix. »
Il mit pied à terre ainsi que Charlot et courut à l’endroit d’où partaient les cris.
Mais avant d’aller plus loin, il faut que nous racontions au lecteur ce qu’il était advenu de Jérôme et de Bernard, les deux déserteurs du Jean-Bart.
CHAPITRE XXI – Les deux aventuriers. – Tribulations de Bernard et de son compagnon. – Les bushrangers. – Mort de Jérôme. – Dangers de Bernard.
Maître Bernard, étant dépensier, trouva sa bourse plate quand, au moment de partir, il voulut faire quelques emplettes nécessaires à leur expédition. Au contraire, Jérôme Sornin, qui était avare, se trouvait bien en fonds ; mais il ne se décida point à dégarnir ses poches.
Tous deux s’en allèrent donc avec leurs bâtons et leurs couteaux, une chemise, un mouchoir, un pantalon de rechange, une gourde remplie de rhum et quelques livres de pain.
Pour arriver plus vite sur les terrains aurifères, ils prirent le bateau à vapeur de Sacramento, ce qui réduisit à un demi-dollar (2 fr. 50 c.) les ressources du mousse. Jérôme possédait encore 62 francs, mais la fourmi de la fable était une dissipatrice auprès de Sornin. Jamais il n’aurait prêté 5 francs à un ami, fût-ce pour le sauver de la mort.
Après plusieurs journées d’un pénible voyage, ils arrivèrent à la mine de San-Juan.
« Je crois que nous devrions commencer à travailler ici, dit Bernard.
– Il y a bien du monde.
– Oui, mais il faut absolument que je gagne quelque chose, moi. Au prix où sont les vivres, je n’ai même plus de quoi dîner. »
Jérôme ne répondit rien. Comme il avait faim, lui aussi, il s’approcha d’une sorte de boutique tenue par un homme de mauvaise mine qui gardait un poignard et un revolver auprès de ses balances à poudre d’or.
Pour un morceau de pain et une tranche de salaison, l’honnête marchand demanda deux dollars.
« Deux dollars ! s’écria Jérôme ; jamais ! »
Il s’éloigna.
Mais la faim le rappela bientôt. Il débattit inutilement le prix du marchand et finit par donner les deux dollars. Bernard était menteur, fainéant, étourdi ; mais il n’était pas avare, et jamais il n’eût hésité à partager son dîner avec un ami moins fortuné. Aussi, jugeant d’après lui-même, il regardait Jérôme et attendait.
Enfin il parla.
« Dis donc, et moi ? Comment vais-je faire ?
– Pour quoi ?
– Pour dîner.
– Achète du pain et du salé.
– Avec quoi ?
– Fallait apporter de l’argent.
– Puisque je n’en avais pas.
– C’est pas ma faute, tiens !
– C’est vrai, mais tu peux bien me prêter quelques dollars.
– Merci ! les camarades sont libres de jeter leur argent par la fenêtre. Moi, je n’aime pas cela.
– À ton aise. »
Bernard s’éloigna. Le pauvre garçon avait grand’faim. L’air vif de la Californie creuse l’estomac, et la route qu’il venait de faire avait encore développé son appétit. Mais il n’y avait rien chez le marchand qui ne coûtât qu’un demi-dollar. À la fin, il songea à sa chemise de rechange et offrit à l’homme de la lui vendre. Celui-ci la retourna en tous sens en la regardant d’un œil de mépris.
« Deux dollars, dit-il.
– Quatre.
– Deux ou rien, » fit le marchand en coupant du savon pour un client qui le paya en poudre d’or.
L’estomac de Bernard lui dit d’accepter le marché. Il accepta. Les deux dollars passèrent naturellement à acheter du pain et de la salaison.
Leur repas achevé, nos aventuriers redescendirent la rivière où l’on recueillait l’or mêlé à la terre qui formait le lit du cours d’eau. Malheureusement, ils n’avaient aucun instrument pour tirer de la terre et laver l’or qu’elle contenait.
Tandis que Jérôme se consultait pour savoir s’il devait en acheter, Bernard furetait au milieu des travailleurs sans se préoccuper des rebuffades qu’il essuyait ni des regards soupçonneux qu’on lui jetait.
À la fin, il avisa un mineur assis sur un monceau de pierres et qui jurait depuis cinq minutes comme un charretier embourbé.
« Qu’avez-vous donc ? lui demanda Bernard.
– Allez au diable ! répondit le mineur.
– J’ai le temps. Pourquoi ne travaillez-vous pas ?
– Que vous importe ? »
Et il se remit à jurer.
« Faut-il vous aider ? demanda de nouveau Bernard.
– À quoi, animal ?
– À laver l’or, donc.
– Tu vois bien que je ne puis bouger le bras, imbécile, reprit l’autre en lui montrant ses deux poignets horriblement gonflés. Un quartier de rocher que je soulevais m’est retombé sur les mains. Me voilà hors d’état de travailler d’ici longtemps.
– Si vous voulez, je travaillerai pour vous avec vos outils, et nous partagerons le profit. »
Le marché finit par se conclure. Bernard se mit à la besogne.
Une pelle, une pioche et une batea composaient tout l’attirail du mineur.
La batea est une grande sébile en bois dans laquelle on met de la terre aurifère. On plonge à demi cette batea dans l’eau courante, qui délaie et emporte la terre pour ne laisser au fond du récipient que l’or mélangé de gros sable noir.
Maître Jérôme s’approcha bien vite, quand il vit la fortune de son camarade. Il voulut s’y associer, mais ce fut à son tour d’embourser un refus.
Alors, le matelot fit sournoisement remarquer au mineur que lui, Jérôme, était plus vigoureux et plus âgé que Bernard et qu’il pourrait recueillir bien plus d’or dans le même espace de temps.
« Laissons-le faire aujourd’hui, répondit l’homme. Demain, vous le remplacerez. »
Quand Bernard vit que son camarade le supplantait ainsi, il devint furieux et tomba sur lui à coups de poing. Naturellement il eut le dessous et ne fut pas ménagé.
Mais leur querelle attira l’attention. On vint leur demander s’ils avaient acquitté la redevance que, depuis quelques mois, chaque travailleur devait payer au gouvernement pour son droit d’exploitation.
Sur la réponse négative de nos aventuriers, on les envoya chercher fortune ailleurs.
Ils partirent l’oreille basse. Afin d’emporter quelques provisions, Bernard vendit son pantalon de rechange. Désormais il ne lui restait plus que les vêtements qu’il avait sur le corps.
On comprend que les deux déserteurs ne devaient pas trouver dans la conversation une grande diversion à leurs ennuis. Chacun en voulait à son compagnon et sentait qu’il ne pouvait compter sur lui en cas de danger.
On arriva à un autre placer ; Bernard vendit son chapeau et son mouchoir afin d’avoir de quoi déjeuner. Malgré son intelligence et ses recherches il ne put trouver aucun arrangement à faire. Les mineurs sont soupçonneux, et nos deux pèlerins n’inspiraient pas la confiance. Aussi le pauvre mousse se coucha-t-il sans dîner.
Le lendemain, voyant que l’heure du déjeuner se passait de même, il alla trouver une escouade de quatre hommes qui manœuvraient un craddle, et leur offrit de faire la cuisine, de laver le linge, de couper le bois, etc., pour sa nourriture et une petite part dans le bénéfice. On accepta.
Il entra immédiatement en fonctions.
Quant à Jérôme, il acheta enfin une pelle cassée et une vieille casserole qui servait de batea à un pauvre Irlandais. Avec cela il se mit à la besogne.
La chance le favorisant, il tomba du premier coup sur un bon endroit de la rivière et recueillit pour 420 francs de poudre dans sa journée. Aussi travailla-t-il si bien qu’il avait le corps tout courbaturé. Cela ne l’empêcha point de recommencer le lendemain avec diverses alternatives de succès. Au bout de trois jours, il avait ramassé 750 francs et payé la taxe.
Quant à Bernard, il menait une rude existence et se lamentait chaque soir d’un état de choses si peu conforme à ses illusions. Du reste, tous les mineurs voyaient diminuer leurs recettes, et l’on désertait peu à peu ce placer pour celui de Gold Fountain. La chance de Jérôme n’ayant duré que trois jours, il eut envie de visiter ce nouvel endroit. Bernard et lui se remirent en route. L’un emportait sa batea et 920 francs, l’autre 5 dollars.
Ils s’en allèrent ainsi cheminant côte à côte sans confiance et sans amitié, se détestant au fond et enchaînés cependant par leur faute commune.
On les avait prévenus que des bushrangers (voleurs de grand chemin) rôdaient dans les environs. Jérôme en avait conçu quelque inquiétude.
« Si les voleurs nous attaquaient ! disait-il.
– Ça m’est bien égal, répondait Bernard, qu’est-ce qu’ils auraient à me prendre ?
– Oui, mais à moi ?
– Ça ne me regarde pas.
– On dit qu’ils ne se gênent guère pour tuer un homme. Tu me défendrais bien sans doute ?
– Pourquoi ?
– Entre amis…
– Est-ce que je profite de ton or, moi ?
– Dame ! chacun son bien.
– Et chacun sa peau. Je n’irai pas risquer la mienne pour défendre ton or, dont il ne m’est jamais revenu aucun profit. »
En ceci Bernard se faisait pire qu’il n’était réellement, mais l’égoïsme de Jérôme excusait sa réponse.
Le pauvre homme devait d’ailleurs être puni de sa cupidité d’une façon plus terrible. Comme pour justifier ses craintes, ils rencontrèrent un jour une bande de mineurs à figures barbues et sinistres, armés jusqu’aux dents, mais dépourvus de bagages.
En dépit de leurs physionomies, c’étaient de joyeux compères, chantant, plaisantant, vociférant, échangeant des interpellations et des quolibets en français, en allemand, en espagnol et surtout en anglais.
Bernard, qui aimait la compagnie et que toute conversation bruyante séduisait, trouva bientôt moyen de se faufiler parmi eux. Les voyageurs le regardaient pourtant avec un air de méfiance singulier.
« Serait-ce un espion ? dit l’un d’eux à l’oreille d’un autre.
– Allons donc, un enfant !
– Il y en a de si rusés ! Et son camarade ?
– Un crétin. Seulement il garde la main sur sa ceinture avec tant de soin qu’il pourrait bien se trouver là quelques dollars.
– Il faudra vérifier.
– Parbleu ! »
Les haltes dans ce pays sont généralement marquées par les sources qu’on rencontre. Aussi les voyageurs dont nous parlons s’arrêtèrent-ils le soir près d’un cours d’eau. Chacun jeta son fardeau sur le sol, déplia sa couverture et se mit en devoir de vaquer à l’importante affaire du dîner.
Tandis que Jérôme cherchait avec quelque convive une association peu coûteuse, Bernard était invité par un autre, que son babil amusait, à s’asseoir près de lui.
Il accepta d’autant plus volontiers que le garde-manger de la bande paraissait bien garni, à en juger par le nombre d’outres pleines que l’on voyait étalées sur le gazon.
« Est-ce que je ne pourrais pas dîner aussi en payant ma part ? demanda gauchement Jérôme à celui qui paraissait diriger les autres.
– Combien as-tu ?
– De quoi ?
– D’or, parbleu.
– Pas grand’chose.
– Enfin.
– Environ 40 dollars.
– Tu mens.
– Non, monsieur, je vous jure.
– Au reste, peu importe ; ce que tu as nous suffira.
– 40 dollars pour un dîner !
– L’honneur de dîner avec nous vaut bien cela.
– J’aime mieux dîner tout seul.
– Assez de plaisanteries. Ton or ? »
Et l’homme se jeta sur lui.
Jérôme était brave ; l’avarice surexcitait encore ses forces. Il défendit vaillamment son petit avoir. Oubliant ses justes griefs, Bernard se précipita généreusement au secours de son compagnon. Mais ils étaient seuls contre dix, et ils avaient affaire à des hommes qui ne connaissaient aucune crainte, aucun motif d’humanité. Dans la lutte, Jérôme reçut un coup de couteau dans le cœur ; il mourut sans pousser un cri. Bernard, à sa première blessure, eut la présence d’esprit de tomber et de faire le mort. On le retourna, on le secoua ; il ne souffla pas. Alors on le jeta dans la rivière avec le malheureux Jérôme. Il se laissa entraîner quelque temps par le courant ; puis, dès qu’il fut hors de vue, il nagea vers la rive et se blottit au plus épais des roseaux.
Pendant toute la soirée et toute la nuit, il resta dans cette affreuse situation, n’osant faire un mouvement, de peur d’attirer l’attention des bushrangers. Chaque frémissement du feuillage le faisait tressaillir. Glacé de froid et mourant de faim, le pauvre enfant expiait cruellement sa désertion. Quand enfin les voleurs furent partis, il se mit en roule dans la direction de San-Francisco.
Heureusement pour le pauvre garçon, des mineurs, qui voyageaient sur un petit char à bœufs, eurent la charité de le faire monter près d’eux et de lui donner à manger. Cela dura quatre jours. Ensuite il dut continuer sa route à pied. On lui avait laissé des provisions. Il rencontra aussi d’autres personnes qui lui firent partager leur repas. Il parvint de cette façon jusqu’à cinq lieues de San-Francisco. Mais ses forces étaient à leur terme. Il se laissa tomber au pied de quelques arbres qui bordaient la route et demeura sans mouvement.
Quelques minutes plus tard, comme nous l’avons dit, M. Villiers et ses deux compagnons vinrent à passer. Les cris de Bernard ayant attiré leur attention, ils le découvrirent et furent saisis de pitié en le voyant hâve, défait, presque mourant. Le malheureux se couvrait la figure de ses deux mains et pleurait amèrement de honte et de chagrin. Cadillac et Charlot le consolèrent de leur mieux ; il leur conta son histoire.
« Il faut ramener promptement ce jeune homme à San-Francisco et lui faire donner des soins, dit M. Villiers. Prenez-le en croupe, Cadillac. »
Cadillac s’empressa d’obéir, et la petite caravane se dirigea vers San-Francisco.
En arrivant, M. Villiers fit transporter Bernard chez lui. L’enfant, bien soigné, ne tarda pas à revenir à la santé, et l’inspecteur se chargea de faire sa paix avec le capitaine Tanguy. Il y parvint, mais non sans peine.
Bernard cependant mit tant de franchise dans ses aveux et protesta si bien qu’il était corrigé désormais, que M. Tanguy se laissa attendrir.
« Ne parlons plus du passé, dit-il ; seulement, mon garçon, rappelle-toi qu’on ne gagne jamais rien en manquant à son devoir. Te voilà à peine sorti de maladie et sans le sou, tandis que tes camarades restés fidèles sont bien portants, heureux, et leur bourse même ne s’en trouve pas plus mal. »
Quelques jours plus tard, l’équipage du Jean-Bart ralliait le bord, et le navire cinglait vers la Chine. Il devait ensuite faire escale à Calcutta, puis enfin revenir en France.
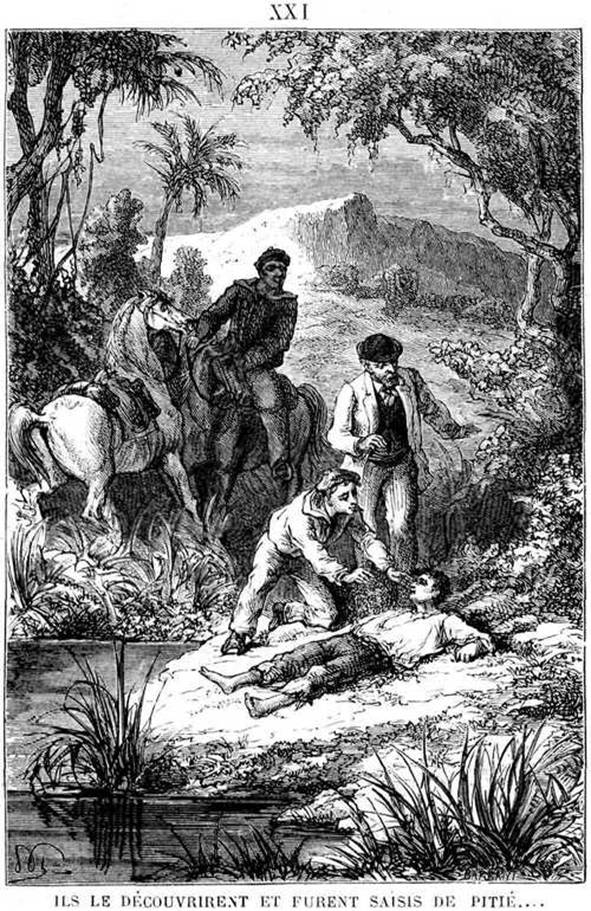
« Quand reverrai-je ma mère et mes sœurs et Fanchette ? pensait Charlot. Me reconnaîtra-t-on chez moi seulement ? Il me semble que je suis déjà tellement changé ! Pour moi, je les reconnaîtrai toutes, et même la petite Rosalie, quand elle serait devenue aussi grande que maman et un peu raisonnable. »
Mais le voyage n’était pas encore à sa fin. De longs mois devaient s’écouler avant que le mousse revît les côtes de France. Pendant ce temps, il vécut presque toujours à bord, car le navire ne fit plus que de courtes relâches. M. Villiers, dont l’intérêt pour son petit ami ne se démentit point, lui continua ses leçons et ses conseils. Il ne négligeait point non plus ses intérêts matériels. Charlot apprit que du blé, des épices, de la soie, de l’ivoire, achetés bon marché à Pékin, se revendaient un bon prix à Calcutta. Sa bourse s’arrondit, et il s’en réjouit en pensant au bien qu’il pourrait faire à ceux qu’il aimait.
CHAPITRE XXII – Le retour. – Les amis de Charlot. – Projets. – Mariage de Chariot. – Jours heureux.
Trois ans s’étaient écoulés depuis le départ de Charlot. Grâce à l’argent qu’il avait envoyé chez lui à chaque relâche du navire, l’aisance avait reparu dans le ménage.
Fanchette avait quitté son maître, qui était resté son ami, et elle demeurait maintenant chez les Morand. Le vieux curé lui avait donné l’idée et les moyens d’entreprendre, pour le compte de Marianne, un petit commerce qui réussissait parfaitement. Des propriétaires des environs, dont les jardins produisaient plus de fruits qu’ils n’en pouvaient consommer, lui cédaient ces fruits pour un prix très modique. Fanchette allait ensuite, avec une petite charrette, les revendre en détail à Lézardrieux ou à Tréguier. La bonne conduite et l’intelligence de la jeune fille excitaient un vif intérêt. On lui achetait de préférence à toute autre.
Voyant le succès de ses opérations, elle les étendit un peu et vendit divers articles de mercerie. Plus tard, elle eut des mouchoirs de couleur, des broderies, des dentelles communes pour les coiffes des paysannes. Active, avenante, polie avec tout le monde, elle se formait peu à peu une bonne clientèle.
Son aide de camp habituel était Rosalie, qui commençait à devenir grande fille, et qui se pâmait d’aise lorsque Fanchette lui permettait de porter son éventaire ou de mesurer du lacet pour les pratiques.
Denise déchargeait sa mère des soins du ménage. Si Marianne avait écouté ses trois filles, comme elle les appelait, elle se serait croisé les bras du matin au soir ; mais elle était trop laborieuse pour cela.
Fanchette et Rosalie avaient beau lui cacher sa quenouille ou ses aiguilles, elle savait les retrouver, ou bien elle dénichait quelque autre travail en dépit des réclamations des enfants qui la grondaient en riant.
Marianne les chérissait toutes trois. Elle eût été parfaitement heureuse sans l’absence de Charlot. Mais elle pensait à lui jour et nuit. Pour le revoir un seul moment, elle eût consenti de bon cœur à faire vingt lieues, pieds nus sur les rochers.
Dieu sait tous les projets qu’on formait dans la chaumière relativement au retour du petit mousse.
Cette phrase : « Quand Charlot sera ici, » était répétée au moins vingt fois par jour. « Il ne peut tarder maintenant, ajoutait-on ; sa dernière lettre nous disait qu’il cinglait vers la France. »
Enfin, un matin, vers la fin du mois de juin, une voiture s’arrêta à quelques portées de fusil de la chaumière des Morand. Quatre marins en descendirent. Trois d’entre eux s’assirent sur le gazon à l’ombre des arbres. Le quatrième se dirigea vers la maison de Marianne.
« Entrez, fit la veuve en entendant loqueter à la porte.
– Bonjour à la compagnie ! dit la voix joyeuse de notre ami Jobic.
– Jobic ! s’écria Marianne en courant à lui. Et mon fils ?…
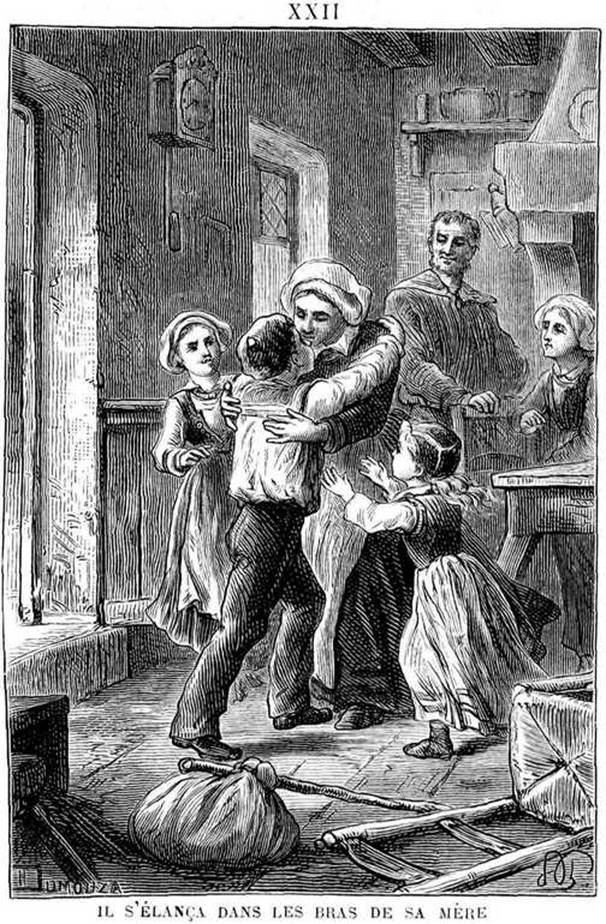
– Il va bien, répondit le matelot. Calmez-vous, Marianne, vous le verrez bientôt.
– Pourquoi n’est-il pas là… puisque vous-même…
– Ah ! dame, vous savez, les affaires de l’armement… »
Mais Jobic, qui n’était point un habile menteur, ne pouvait s’empêcher de rire et de cligner de l’œil.
« Il est là, j’en suis sûre ! s’écria la pauvre mère. Au nom du ciel, Jobic, ne me faites pas attendre davantage ! »
Elle ouvrit la porte de la chaumière.
« Charlot ! » cria-t-elle.
Et Rosalie de répéter avec Denise :
« Charlot ! Charlot ! »
Charlot arriva en courant et s’élança dans les bras de sa mère.
« Mon fils ! murmurait Marianne, comme tu es grandi, comme tu es fort !
– Embrasse-moi donc ! criait Denise.
– Et moi ! disait Rosalie, grimpée sur la chaise de sa mère.
– Prenez donc des précautions avec des enragées comme ça, » grommela Jobic d’un air grognon.
Mais le digne matelot eut son tour.
Charlot étant accaparé par ses sœurs, Marianne vint lui prendre la main et le remercia avec effusion des soins qu’il avait pris pour son enfant.
« Ne parlons pas de ça, disait Jobic, ne parlons pas de ça. C’est un plaisir de veiller sur un garçon comme celui-là. Il fait honneur à sa famille et à ses amis. »
Jobic racontait à Marianne les prouesses du jeune marin, tandis que ce dernier embrassait Fanchette. Le premier mouvement de la jeune fille avait été de se jeter dans les bras de son ancien camarade ; mais, en voyant un grand garçon à la mine hardie, elle était restée tout interdite. De son côté, Charlot était surpris de retrouver une jeune fille avenante et gracieuse au lieu de la pauvresse hâve, maigre et mal habillée qu’il avait laissée en Bretagne.
Tous deux se regardèrent un instant en silence d’un air surpris. Rosalie, qui ne comprenait rien à cette hésitation, les poussa l’un vers l’autre. Denise et elle commencèrent en même temps un panégyrique de Fanchette, que celle-ci ne parvint pas à interrompre.
Marianne, entendant cela, prit part à la conversation et joignit ses éloges à ceux de ses filles.
Ces témoignages de reconnaissance, ces affectueuses paroles émurent tellement la pauvre Fanchette qu’elle se mit à pleurer.
« Qu’as-tu donc ? s’écria Rosalie.
– Je suis trop heureuse, murmura l’orpheline en cachant sa tête dans les bras de Marianne. Vous êtes tous si bons pour moi, que je bénis Dieu chaque jour de m’avoir conduite auprès de vous.
– Mère, dit Charlot au bout de quelques minutes, tu sais bien Cadillac et le père Dur-à-cuire dont je te parlais souvent dans mes lettres ?
– Les deux amis de ton père, ceux qui ont eu tant de bontés pour toi.
– Oui, maman. Eh bien, ils ont voulu me conduire jusqu’ici. Ils sont à deux pas.
– Et tu les laisses dehors ?
– Dame, maman, c’est Norzec qui l’a voulu. Il prétend que ça l’ennuie de voir pleurer les femmes et qu’il veut laisser passer l’orage avant de venir te souhaiter le bonjour.
– Ah ! c’est un drôle de particulier, dit Jobic, mais un cœur d’or, voyez-vous, Marianne.
– Cours chercher tes amis, mon enfant, » reprit la veuve qui, prenant au sérieux les boutades de Norzec, se bassinait précipitamment les yeux avec de l’eau fraîche.
Un instant après, Charlot revint dans la chaumière, en poussant devant lui Cadillac et Norzec qui reculait comme un cheval rétif.
« Celui-ci est Cadillac, fit Charlot, et voilà M. Norzec, le père Dur-à-cuire, comme nous l’appelons à bord. »
Au milieu de tant d’émotions, la pauvre Marianne ne savait plus où elle en était. Faute de meilleure expression pour témoigner sa reconnaissance aux deux matelots, elle les embrassa et les remercia d’avoir veillé sur Charlot.
« Ah ben oui ! veiller sur un petit marsouin comme ça, grommela Norzec, d’autant plus bourru qu’il avait la larme à l’œil. Dès qu’il y avait des coups à recevoir, il fallait qu’il y courût. Vous avez là un fameux garnement de fils, allez. N’est-ce pas, moussaillon de malheur ? »
Et il empoigna Charlot par la tête, à la grande terreur de Rosalie, qui ne fut rassurée que par les éclats de rire du mousse, que le matelot secouait de manière à faire croire qu’il voulait lui démantibuler les os.
Quelques heures s’écoulèrent comme un songe, au milieu d’une conversation à bâtons rompus où quelques larmes et les éclats de rire se succédaient.
Charlot raconta à sa mère une partie de ses voyages. De San-Francisco, le Jean-Bart était allé en Chine. Là, sur le conseil de M. Villiers, le mousse avait employé la plus grande partie de son argent à faire une pacotille qu’il avait ensuite vendue avec un assez joli bénéfice en arrivant à Calcutta. Dans cette dernière ville, chef-lieu des Indes Orientales, il avait acheté du salpêtre, des nattes, des marabouts. M. Villiers s’était chargé de lui vendre tout cela au Havre. Le résultat de ces opérations commerciales était une somme de 9 000 francs qu’il jeta tout joyeux sur les genoux de sa mère.
Tandis que notre héros racontait à ses sœurs émerveillées quelques épisodes de son voyage, Jobic tira Marianne un peu à l’écart.
« Vous avez reçu, lui dit-il, une lettre de M. Villiers, n’est-ce pas ?
– Oui, Jobic, une lettre qui m’a rendue bien heureuse. Il fait l’éloge de mon fils et il me promet de veiller toujours sur lui.
– Vous pouvez compter là-dessus, reprit Jobic. Il m’a chargé de vous le répéter de sa part. Il porte une grande amitié à Charlot et tient à ce qu’il devienne un jour capitaine au long cours. Comme il faudra, pour cela, que le petit passe deux ou trois ans à terre pour préparer ses examens, M. Villiers m’a dit qu’il se chargerait de la dépense. Seulement, il ne veut pas en parler à Charlot, parce qu’il trouve qu’un homme ne doit compter que sur lui-même.
« Dès que le mousse aura passé ses examens, M. Villiers se charge de lui faire donner un bon commandement. Et comme on ne peut être reçu capitaine avant vingt-cinq ans, nous avons encore du temps devant nous. »
Dans la journée, Charlot alla visiter les voisins et remercier tous ceux qui avaient rendu quelque service à sa mère. Il avait apporté avec lui une foule de petits objets qu’il offrit en cadeau.
Cette attention, plus encore que la valeur des objets, fit grand plaisir à tout le monde. Cela n’empêcha point qu’on fut étonné de voir un mousse dont le gousset était si bien garni. On n’avait jamais entendu parler de chose pareille.
Le soir, le curé et l’instituteur vinrent dîner dans la chaumière. Le curé s’était fait accompagner d’un énorme pâté fabriqué avec grand soin par sa gouvernante. Jamais repas ne fut plus gai. Au dessert, Rosalie, qui s’était installée sur les genoux du père Dur-à-cuire, causa gravement avec lui. Le matelot se prit d’une si belle amitié pour la petite fille que, pendant le séjour qu’il fit à Lanmodez, il ne sortait jamais sans l’emmener avec lui.
Jobic et ses deux camarades passèrent huit jours au village. Puis ils repartirent pour le Havre, afin de travailler au chargement de leur navire.
Charlot ne tarda pas à les rejoindre ; mais cette fois la séparation fut moins douloureuse, car son voyage ne devait durer qu’un an. D’ailleurs le mousse avait monté en grade, et c’était maintenant en qualité de pilotin qu’il partait.
Il continua à se rendre digne de la bienveillance de ses chefs et devint bientôt un excellent marin. Économe et laborieux, il savait aussi employer son argent de manière à réaliser des bénéfices qu’il envoyait à sa mère régulièrement. Et jamais il ne lui écrivait sans joindre à sa lettre un mot pour Fanchette.
Celle-ci était souvent chargée de lui répondre. Elle le tenait au courant de tout ce qui se passait à Lanmodez.
Grâce à l’argent qu’envoyait Charlot et à celui que Fanchette gagnait par son commerce, la famille Morand vivait dans l’aisance.
Marianne acheta une jolie petite maison qui contenait plusieurs chambres. Au rez-de-chaussée se trouvait la cuisine et une petite boutique, où Fanchette et Denise vendaient de la mercerie et divers objets de toilette à l’usage des femmes de la campagne. La famille prospérait.
Quand Charlot eut atteint ses dix-neuf ans, M. Villiers le fit entrer dans une école spéciale afin qu’il préparât ses examens. Il passait le temps des vacances chez sa mère. Fanchette avait alors dix-sept ans. Elle était jolie autant que bonne et dévouée.
Un jour le jeune marin confia à sa mère qu’il serait bien heureux d’avoir une femme douce, économe et laborieuse comme Fanchette. Cet aveu fit grand plaisir à Marianne, qui depuis longtemps rêvait ce mariage. Quant à Rosalie, ayant saisi quelques mots de la conversation, elle perdit la tête de joie et courut dans le magasin. Là, comme une folle, elle se jeta dans les bras de Fanchette en l’appelant Mme Charlot Morand.
La pauvre fille fut tellement troublée qu’elle faillit s’évanouir. Marianne arriva là-dessus, lui dit de bonnes paroles. Fanchette, qui admirait la bonne conduite et l’intelligence de Charlot, ne se fit pas prier pour devenir sa femme. Le mariage fut remis au temps où le jeune homme aurait passé ses examens. Quand vint cette époque, Denise était aussi fiancée à un instituteur de Paimpol ; le vieux curé bénit en même temps les deux unions.
Charlot fut capitaine au long cours aussitôt que son âge le lui permit. M. Villiers, qui n’avait jamais cessé de veiller sur son petit compagnon de voyage, obtint pour lui le commandement d’un beau navire.
Il va sans dire que Jobic, Norzec et Cadillac firent partie de l’équipage du jeune capitaine. Il n’avait jamais oublié les premiers protecteurs de son enfance ; aussi saisit-il avec empressement l’occasion de leur témoigner sa reconnaissance des bontés qu’ils avaient eues pour lui autrefois.
Chaque fois qu’il revient au Havre et peut disposer de quelques jours, il emmène à Lanmodez les trois matelots, que Marianne, Fanchette et Rosalie accueillent comme faisant partie de la famille. Ces jours-là, Denise et quelquefois son mari viennent prendre leur part de la fête. Dans une de ces visites, Charlot amena son second, qui lui avait rendu pendant la traversée de grands services. Le jeune homme était orphelin ; en voyant le bonheur qui régnait dans cette famille, il ne put s’empêcher de sentir plus vivement le vide qui l’entourait. Rosalie, dont le cœur était bon, se chargea de le consoler en devenant sa femme.
Il y a maintenant six petits enfants autour de la table de famille. C’est encore l’instituteur qui leur apprend à lire. Le vieux curé espère vivre assez pour leur faire faire leur première communion.
Quand Charlot se trouve entre sa mère, sa femme, ses sœurs, ses enfants et ses fidèles amis, il remercie Dieu qui a si généreusement récompensé le travail et le courage du petit mousse du Jean-Bart.

À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse
du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Janvier 2010
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : PatriceC, Jean-Marc, MauriceC, Coolmicro et Fred.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.