
Arthur Conan Doyle
LA COMPAGNIE BLANCHE
(1891)
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
Table des matières
CHAPITRE PREMIER Comment le mouton noir s’échappa de la bergerie
CHAPITRE II Comment Alleyne Edricson s’en alla dans le monde
CHAPITRE III Comment Hordle John dupa le fouleur de Lymington
CHAPITRE IV Comment le bailli de Southampton extermina deux voleurs
CHAPITRE V Comment une étrange compagnie se trouva rassemblée à « L’Émerillon bigarré »
CHAPITRE VI Comment Samkin Aylward paria son lit de plumes
CHAPITRE VII Comment les trois compagnons voyagèrent à travers bois
CHAPITRE IX Étranges incidents dans le bois de Minstead
CHAPITRE X Comment Hordle John trouva un homme qu’il pouvait suivre
CHAPITRE XI Comment un jeune berger se vit confier un troupeau dangereux
CHAPITRE XII Comment Alleyne apprit plus qu’il n’enseigna
CHAPITRE XIII Comment la Compagnie Blanche partit pour la guerre
CHAPITRE XIV Comment, sur sa route, Sir Nigel chercha l’aventure
CHAPITRE XV Comment la cogghe jaune quitta le port de Lepe
CHAPITRE XVI Comment la cogghe jaune se battit contre les deux bateaux-pirates
CHAPITRE XVII Comment la cogghe jaune franchit la barre de la Gironde
CHAPITRE XVIII Comment Sir Nigel Loring posa une mouche sur son œil
CHAPITRE XIX Agitation à l’abbaye de Saint-André
CHAPITRE XX Comment Alleyne conquit sa place dans une honorable guilde
CHAPITRE XXI Comment Agostino Pisano risqua sa tête
CHAPITRE XXII Une soirée avec les archers à la « Rose de Guyenne »
CHAPITRE XXIII Comment se comporta l’Angleterre sur la lice de Bordeaux
CHAPITRE XXIV Comment un champion surgit de l’est
CHAPITRE XXV Comment Sir Nigel écrivit au château de Twynham
CHAPITRE XXVI Comment les trois camarades se procurèrent un grand trésor
CHAPITRE XXVII Comment Roger Pied-bot fut dépêché au Paradis
CHAPITRE XXVIII Comment les camarades passèrent dans les marches de France
CHAPITRE XXIX Comment dame Tiphaine eut son heure bénie de voyance
CHAPITRE XXX Comment les hommes des sous-bois se rendirent au château de Villefranche
CHAPITRE XXXI Comment cinq hommes tinrent le donjon de Villefranche
CHAPITRE XXXII Comment la Compagnie tint conseil autour de l’arbre déraciné
CHAPITRE XXXIII Comment l’armée passa le col de Roncevaux
CHAPITRE XXXIV Comment la Compagnie fit du sport dans le val de Pampelune
CHAPITRE XXXV Comment Sir Nigel prit un faucon pour un aigle
CHAPITRE XXXVI Comment Sir Nigel retira la mouche de son œil
CHAPITRE XXXVII Comment la Compagnie Blanche reçut son licenciement
CHAPITRE XXXVIII Retour dans le Hampshire
À propos de cette édition électronique
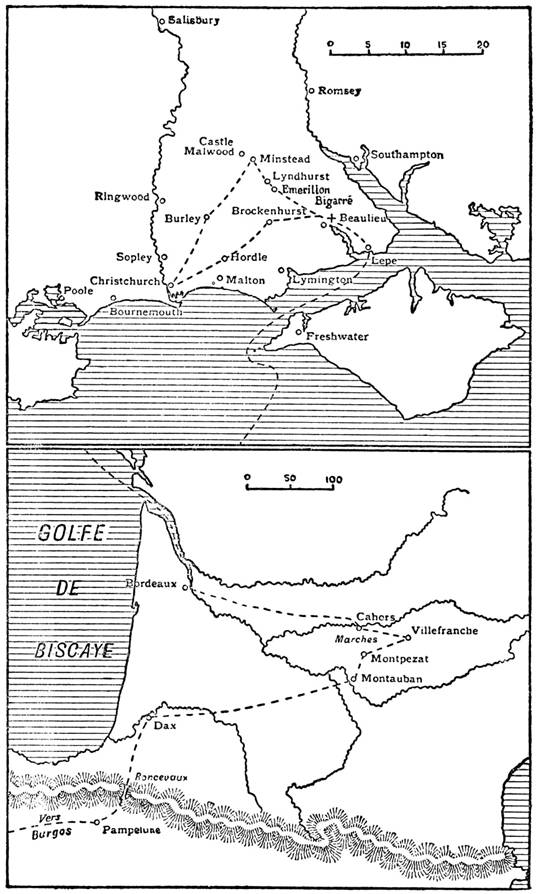
CHAPITRE PREMIER
Comment le mouton noir s’échappa de la bergerie
La grosse cloche de Beaulieu sonnait à toute volée ; elle brassait l’air lourd de l’été, elle poussait ses crescendos et ses diminuendos jusqu’au cœur de la forêt. Rien de plus banal, pour les pêcheurs sur l’Exe ou pour les tourbiers du Blackdown, que ses grands battements rythmés qui leur étaient aussi familiers que le caquetage des geais ou le grondement des butors. Cette fois-ci pourtant ils levèrent la tête, intrigués : l’angélus avait déjà été sonné, et ce n’était pas encore l’heure des vêpres ; pourquoi s’agitait donc la grosse cloche de Beaulieu alors que l’ombre n’était ni courte ni longue ?
Tout autour de l’abbaye les moines se hâtaient ; leurs robes blanches affluèrent dans les grandes allées de chênes noueux et de hêtres moussus. Dès le premier coup de cloche tous s’étaient mis en route ; ils avaient quitté les vignes ou le pressoir, les étables ou les prés, les marnières ou les salines, et même les lointaines forges de Sowley ou le manoir écarté de Saint-Léonard. Cet appel ne les avait pas surpris. La veille au soir un messager avait fait le tour des dépendances de l’abbaye, et il avait averti chaque moine d’avoir à être rentré dans le couvent pour trois heures de l’après-midi. Le vieux frère convers Athanasius, qui était préposé au heurtoir depuis l’année de la bataille de Bannockburn, ne se rappelait pas qu’une convocation aussi pressante eût jamais réuni la communauté.
Un étranger qui n’aurait rien su de l’abbaye et de ses immenses ressources, mais qui aurait assisté au défilé des frères, aurait à peu près deviné les diverses tâches dont l’accomplissement faisait vivre le vieux monastère. Rares étaient en effet les religieux qui, tandis qu’ils avançaient gravement par deux ou par trois, tête basse et la prière aux lèvres, n’arboraient pas les signes extérieurs de leurs occupations quotidiennes. Ces deux-là, par exemple, avaient les poignets et les manches tachés du jus des raisins noirs ; cet autre à la barbe fleurie rapportait sa hache et avait juché sur ses épaules un gros fagot de bois ; à côté de lui marchait un moine qui portait sous le bras des cisailles pour la tonte, et sa robe blanche était parsemée des flocons d’une laine plus blanche encore ; une longue cohorte était pacifiquement armée de bêches et de pioches ; enfin les deux derniers transportaient un énorme panier débordant de carpes fraîchement pêchées, car le lendemain était un vendredi et il y aurait cinquante écuelles à remplir pour un nombre égal de gros mangeurs. Tous paraissaient las. Il est vrai que l’abbé Berghersh était aussi dur pour eux que pour lui-même.
Pendant que s’opérait le rassemblement, l’Abbé arpentait avec impatience la grande salle haute réservée aux événements d’importance. Il avait joint ses mains, qu’il avait blanches et nerveuses. Ses traits fins tirés par la méditation, son visage hâve attestaient qu’il avait terrassé l’ennemi intérieur, mais que ce combat l’avait grandement meurtri. On oubliait sa débilité apparente dès qu’un éclair d’énergie farouche jaillissait sous ses sourcils retombants : cette lueur fulgurante (et fréquente) rappelait qu’il appartenait à une famille de soldats : son frère jumeau Sir Bartholomew Berghersh n’avait-il pas été au nombre de ces héros qui avaient planté la croix de saint Georges devant les portes de Paris ?… Lèvres serrées, front plissé, l’Abbé foulait de long en large le plancher de chêne, pendant que la grosse cloche sonnait au-dessus de sa tête. Il ressemblait à une incarnation de l’ascétisme.
Trois notes étouffées annoncèrent la fin du branle. Avant même que leur écho se fût tu, l’Abbé frappa sur un petit gong ; un frère lai se présenta aussitôt.
– Les frères sont-ils rentrés ? demanda-t-il dans le dialecte franco-anglais en usage dans les couvents.
– Ils sont ici, répondit l’interpellé qui avait les yeux baissés et les mains croisées sur la poitrine.
– Tous ?
– Trente-deux anciens et quinze novices, Révérend Père. Le Frère Marc, qui a la fièvre, n’a pu venir. Il a dit que…
– Peu importe ce qu’il a dit. Avec fièvre ou sans fièvre il aurait dû se rendre à ma convocation. Son esprit aura à s’assagir, comme celui de beaucoup dans cette abbaye. Vous-même, Frère Francis, vous avez par deux fois élevé la voix, assez fort pour qu’elle parvînt à mes oreilles, pendant qu’au réfectoire le lecteur évoquait la vie des saints bénis de Dieu. Qu’avez-vous à répondre ?
Le frère lai demeura humblement immobile et silencieux.
– Mille ave et autant de credo, récités debout avec les bras ouverts devant l’autel de la Vierge, vous aideront peut-être à vous rappeler que le Créateur nous a donné deux oreilles mais une seule bouche, en signe que l’ouïe doit travailler deux fois plus que la parole. Où est le maître des novices ?
– Il est dehors, Révérend Père.
– Introduisez-le.
Les sandales claquèrent sur le plancher, la porte cloutée de fer grinça sur ses gonds ; quelques instants plus tard elle se rouvrit pour laisser pénétrer un moine trapu au visage épais et à l’allure autoritaire.
– Vous m’avez demandé, Révérend Père ?
– Oui, Frère Jérôme. Je désire que cette affaire soit réglée avec le minimum de scandale ; et pourtant il est nécessaire que l’exemple soit public.
L’Abbé s’était exprimé en latin. Le latin, par son caractère antique et solennel, convenait mieux pour traduire les pensées de deux hauts dignitaires de l’ordre.
– Peut-être vaudrait-il mieux que les novices ne soient pas présents ? suggéra le maître. La mention d’une femme risque de les détourner des pieuses méditations vers des pensées profanes et impies.
– Une femme ! Une femme ! gémit l’Abbé. Saint Chrysostome a eu bien raison de qualifier la femme de radix malorum ! Depuis Ève, quel bien est venu de l’une d’elles ? Qui porte plainte ?
– Le Frère Ambrose.
– Un saint et brave jeune homme.
– Une lumière, un modèle pour tous les novices.
– Finissons-en donc, selon notre vénérable règle monastique. Commandez au procureur et au procureur adjoint d’introduire ici les frères par rang d’âge, en même temps que Frère John l’accusé et frère Ambrose l’accusateur.
– Et les novices ?
– Qu’ils attendent dans l’allée nord du cloître ! Un moment ! Dites au procureur adjoint de leur envoyer Thomas le lecteur afin qu’il leur lise des extraits des Gesta beati Benedicti. Peut-être ce texte les préservera-t-il contre les babillages puérils et pernicieux.
Une fois de plus l’Abbé demeura seul. Il pencha sa maigre figure grisonnante au-dessus de son bréviaire enluminé et ne leva pas les yeux quand les moines pénétrèrent dans la salle ; à pas lents, mesurés, ils allèrent s’asseoir sur les bancs de bois qui de chaque côté étaient parallèles au mur. À l’autre extrémité, sur deux sièges élevés aussi imposants que celui de l’Abbé, mais sculptés avec un peu moins de recherche, s’assirent le maître des novices et le procureur. Ce dernier était un gros moine majestueux, dont les yeux noirs pétillaient ; sa tonsure était entourée d’une masse abondante de cheveux frisés, très bruns. Entre eux se tenait un frère pâle et efflanqué qui semblait peu à son aise : il se balançait nerveusement et se grattait le menton avec le rouleau de parchemin qu’il serrait dans sa main. L’Abbé, du haut de sa position, considéra les deux rangs de visages placides et hâlés, leurs grands yeux bovins, leurs expressions simplistes. Puis il tourna son regard inquisiteur dans la direction du moine pâle qui lui faisait face.
– Cette plainte émane de vous, Frère Ambrose, dit-il. Puisse saint Benoît, patron de cette maison, se trouver avec nous aujourd’hui et nous aider dans nos conclusions ! Combien de chefs d’accusation y figurent ?
– Trois, Révérend Père, répondit le frère d’une voix mal assurée.
– Les avez-vous établis selon la règle ?
– Les voici, Révérend Père, inscrits sur ce parchemin.
– Que ce parchemin soit remis au procureur. Faites entrer le Frère John afin qu’il entende les accusations portées contre lui.
À ce commandement un frère lai ouvrit la porte ; deux autres frères lais entrèrent alors, encadrant un jeune novice de l’ordre. Il avait la taille d’un colosse, les yeux noirs, les cheveux roux, de gros traits, et, répandu sur toute sa personne, un air mi-provocant, mi-amusé. Il avait rejeté le capuchon sur ses épaules. Sa robe, dégrafée en haut, laissait apparaître un cou puissant, rougeaud, côtelé comme l’écorce du sapin. Des bras très musclés, couverts d’un duvet roux, émergeaient des larges manches de son habit dont le pan retroussé sur un côté permettait d’apercevoir une jambe formidable toute égratignée par les ronces. Sur une révérence à l’Abbé (révérence qui était peut-être plus ironique que respectueuse) le novice se dirigea vers le prie-Dieu sculpté qui avait été préparé pour lui, puis il demeura silencieux et tout droit, la main sur la clochette d’or qui était utilisée pour les oraisons spéciales de la maison de l’Abbé. Ses yeux noirs parcoururent l’assemblée avant de se poser, menaçants et farouches, sur le visage de son accusateur.
Le procureur se leva. Il déroula avec lenteur le parchemin et en commença la lecture d’une voix emphatique. Le frémissement qui agita les frères révéla l’intérêt qu’ils portaient au débat.
– Accusations portées le deuxième jeudi après la fête de l’Assomption, l’an 1366 de Notre Seigneur, contre le Frère John, précédemment connu sous le nom de Hordle John, ou John de Hordle, mais à présent novice dans le saint ordre monastique des Cisterciens. Lecture faite le même jour à l’abbaye de Beaulieu en présence du Révérend Père Abbé Berghersh et de tout l’ordre assemblé.
« Les accusations contre ledit Frère John sont les suivantes, à savoir :
« Premièrement, que le jour susmentionné de la fête de l’Assomption, de la bière légère ayant été servie aux novices dans la proportion d’un quart pour quatre, ledit Frère John vida le pot d’un trait au grand dam du Frère Paul, du Frère Porphyre et du Frère Ambrose, qui purent à peine avaler leur morue salée en raison de la sécheresse de leur gosier…
Devant cette accusation solennelle, le novice leva une main et mordit ses lèvres, tandis que les frères (même les plus dévôts) échangeaient des regards amusés et toussotaient pour dissimuler leur envie de rire. Seul l’Abbé demeura imperturbable.
– … De plus, que le maître des novices l’ayant informé que pendant deux jours il aurait pour toute nourriture un pain de son de trois livres et des haricots afin d’honorer et de glorifier plus hautement sainte Monique, mère de saint Augustin, il fut surpris par le Frère Ambrose et par d’autres frères à dire qu’il vouait à vingt mille diables ladite Monique, mère de saint Augustin, ou n’importe quelle sainte qui s’interposerait entre un homme et sa nourriture. De plus, que le Frère Ambrose lui ayant reproché ce souhait blasphématoire, il se saisit dudit frère et lui plongea la tête dans le piscatorium ou vivier, pendant un laps de temps au cours duquel ledit frère put répéter un pater et quatre ave pour fortifier son âme contre une mort imminente…
Cette grave accusation souleva un bourdonnement et des murmures dans les rangs des frères en robe blanche ; mais l’Abbé étendit sa longue main nerveuse.
– Quoi encore ? demanda-t-il.
– … De plus, qu’entre none et les vêpres le jour de la fête de Jacques le Mineur, ledit Frère John fut aperçu sur la route de Brockenhurst, près de l’endroit appelé l’étang de la Cognée, en conversation avec une personne de l’autre sexe, jeune fille nommée Mary Sowley, fille du verdier du Roi. De plus, qu’après diverses plaisanteries et farces, ledit Frère John souleva ladite Mary Sowley et la prit, la porta et la reposa de l’autre côté du ruisseau, pour l’infinie satisfaction du diable et au profond détriment de son âme, dont la scandaleuse défaillance et vilenie est attestée par trois membres de l’ordre.
Un silence de mort plana dans la salle ; des hochements de tête, des yeux levés vers le ciel révélaient la pieuse horreur qui s’était emparée de la communauté. L’Abbé arqua ses sourcils gris.
– Qui peut se porter garant de ces derniers faits ? interrogea-t-il.
– Je le puis, répondit l’accusateur. Et le peuvent également Frère Porphyre, qui était avec moi, et Frère Marc, lequel a été si bouleversé et si troublé intérieurement par ce spectacle qu’il est alité avec de la fièvre.
– Et la femme ? demanda l’Abbé. Ne s’est-elle pas répandue en lamentations et en larmes devant la dégradation du Frère ?
– Non. Elle lui a souri gentiment et l’a remercié. Je l’affirme, et le Frère Porphyre peut l’affirmer aussi.
– Vous le pouvez ? tonna l’Abbé. Vous le pouvez tous les deux ? Avez-vous oublié que la trente-cinquième règle de l’ordre ordonne qu’en présence d’une femme le visage doit se détourner et les yeux se river au sol ? Vous l’avez oubliée, cette règle ! Si vos yeux avaient été braqués sur vos sandales, comment auriez-vous pu voir le sourire dont vous faites état ? Huit jours de cellule, faux Frères, huit jours de pain de seigle et de lentilles, avec doubles Laudes et doubles Matines, vous aideront à vous rappeler les règles sous lesquelles vous vivez.
Accablés par ce subit accès de colère, les deux témoins enfouirent leurs figures dans le creux de leurs poitrines, et se laissèrent tomber sur leurs sièges. L’Abbé les foudroya d’un ultime regard, puis reporta ses yeux sur l’accusé qui soutint le choc avec un visage ferme et tranquille.
– Qu’avez-vous à dire, Frère John, sur les lourdes charges qui sont alléguées contre vous ?
– Assez peu, bon Père, assez peu ! dit le novice en anglais avec le débit traînant des Saxons de l’Ouest.
Les frères, qui étaient tous de bons Anglais, dressèrent l’oreille au son de ces accents familiers dont ils avaient perdu l’usage. Mais l’Abbé devint rouge de colère et il frappa d’une main l’accoudoir de son fauteuil.
– Quel est ce langage ? s’écria-t-il. Est-ce là une langue à employer entre les murs d’un ancien monastère de bonne réputation ? Il est vrai que la grâce et la science vont toujours de pair ; quand l’une est perdue, point n’est besoin de chercher l’autre !
– Cela, je ne le sais pas, répondit Frère John. Je sais seulement que les mots me sont venus naturellement aux lèvres, car c’est ainsi que s’exprimaient mes pères. Avec votre permission je parlerai ma langue ; sinon je garderai le silence.
L’Abbé tapota du pied sur le plancher et acquiesça de la tête, comme quelqu’un qui passe sur un détail mais qui ne l’oubliera pas.
– Pour l’affaire de la bière, reprit Frère John, j’étais rentré des champs en nage, et j’avais à peine eu le goût dans la bouche que déjà le pot était vide. Il se peut également que j’aie parlé un peu brusquement à propos du pain de son et des haricots, mais pour un homme de ma taille une telle nourriture est insuffisante. Il est vrai aussi que j’ai empoigné ce maître idiot de Frère Ambrose, quoique je ne lui aie fait aucun mal, ainsi que vous pouvez le constater. Pour ce qui est de la jeune fille, il est vrai que je l’ai portée de l’autre côté du ruisseau car elle avait sa robe et ses souliers, et moi j’étais pieds nus dans des sandales de bois qui ne risquaient pas d’être abîmées par l’eau. J’aurais été honteux en tant qu’homme et en tant que moine si je ne l’avais pas aidée.
Il regarda autour de lui ; il avait dans les yeux la même lueur amusée.
– Cela suffit, prononça l’Abbé. Il a tout confessé. Il ne me reste plus qu’à déterminer le châtiment que mérite sa mauvaise conduite…
Il se leva ; les deux rangées de religieux l’imitèrent ; les frères jetèrent des coups d’œil obliques vers le prélat en colère.
– … John de Hordle ! éclata-t-il. Pendant vos deux mois de noviciat vous vous êtes montré un moine infidèle, indigne de porter la robe blanche qui est le symbole extérieur d’un esprit sans tache. Cette robe vous sera donc retirée, et vous serez rejeté dans le monde extérieur sans le bénéfice de la cléricature, et sans la moindre participation aux grâces et aux bénédictions de ceux qui vivent sous la protection du bienheureux Benoît. Vous ne reviendrez jamais à Beaulieu ni dans l’une des dépendances de Beaulieu, et votre nom sera rayé des rôles de l’ordre.
La sentence parut terrible aux moines âgés, qui avaient si bien pris l’habitude de la vie paisible et régulière de l’abbaye qu’ils auraient été des enfants perdus dans le monde extérieur : de leur oasis de paix et de piété, ils considéraient le désert de la vie comme un lieu plein de tempêtes et de luttes, très inconfortable, dominé par le mal. Le jeune novice quant à lui ne devait pas partager cette opinion, car ses yeux étincelèrent et son sourire s’accentua. Il n’en fallut pas davantage pour enflammer l’humeur de l’Abbé.
– Voilà pour le châtiment spirituel ! poursuivit-il. Mais c’est à vos sentiments plus grossiers que nous allons maintenant nous intéresser. Comme vous n’êtes plus protégé par le bouclier de la sainte Église, la difficulté ne sera pas grande. Holà ! Frères lais ! Francis, Naomi, Joseph ! Saisissez-vous de lui et liez-lui les bras ! Traînez-le par ici, et que les forestiers et les portiers le chassent à coups de fouet hors de l’enceinte !
Quand les trois frères susnommés s’avancèrent pour exécuter l’ordre de l’Abbé, le sourire disparut du visage du novice. Il regarda à droite, à gauche, avec des yeux sombres farouches, comme un taureau harcelé par des chiens. Puis, poussant un cri jailli du plus profond de sa poitrine, il s’empara du lourd prie-Dieu de chêne et il le balança ; il était prêt à frapper. Il recula de deux pas afin de n’être pas assailli par surprise.
– Par la croix noire de Waltham ! rugit-il. Si l’un de vous, coquins, touche du bout des doigts le bord de ma robe, je lui écrase le crâne comme une aveline !
Ses gros bras musclés, sa voix tonnante, ses cheveux roux en bataille impressionnèrent les trois frères qui s’immobilisèrent, cloués sur place. Les deux rangs de moines blancs oscillaient comme des peupliers sous la tempête. L’Abbé seul bondit en avant ; mais le procureur et le maître des novices le retinrent chacun par un bras afin qu’il ne s’exposât point au danger.
– Il est possédé d’un démon ! crièrent-ils. Courez, Frère Ambrose, Frère Joachim ! Appelez Hugh du moulin, et Wat le bûcheron, et Raoul avec son arbalète et ses carreaux ! Dites-leur que nous craignons pour notre vie ! Courez ! Courez, pour l’amour de la Vierge !
Mais le novice était stratège autant qu’homme d’action. Il s’élança, précipita à la tête de Frère Ambrose son arme lourde et, pendant que le moine et le prie-Dieu roulaient ensemble sur le plancher, il se rua par la porte ouverte, pour dégringoler l’escalier en colimaçon. Le vieux Frère Athanasius, de sa cellule, eut la vision de deux pieds ailés et d’une robe retroussée ; mais avant qu’il eût eu le temps de se frotter les yeux, le moine infidèle se trouvait dehors et fonçait sur la route de Lyndhurst aussi vite que le lui permettaient ses sandales.
CHAPITRE II
Comment Alleyne Edricson s’en alla dans le monde
Jamais la paisible atmosphère de la vieille maison cistercienne n’avait été pareillement troublée. Jamais n’avait éclaté une révolte aussi soudaine, aussi brève, aussi réussie. Mais l’abbé Berghersh devait veiller à ce que cette rébellion unique en son genre ne mît point en péril l’ordre établi. En quelques phrases acides et brûlantes, il compara la sortie du faux Frère à l’expulsion de nos premiers parents du paradis terrestre, et il affirma que s’ils ne se réformaient pas, d’autres membres de la communauté pourraient se trouver dans le même mauvais cas. Ayant ainsi ramené la docilité au sein de son troupeau, il renvoya les moines à leurs travaux et se retira dans son appartement privé pour chercher les secours spirituels nécessaires à l’accomplissement de sa haute mission.
L’Abbé était encore agenouillé quand quelques coups légers frappés à sa porte interrompirent ses oraisons. Il se releva et commanda d’entrer. Mais l’humeur causée par cette interruption s’adoucit quand il reconnut le visiteur, et sa physionomie s’éclaira d’un sourire paternel.
C’était un jeune homme mince d’une taille légèrement au-dessus de la moyenne, il avait des cheveux blonds et des traits enfantins ; il était bien bâti et d’un extérieur avenant. Des yeux gris clairs et pensifs, ainsi qu’une délicate vivacité d’expression, indiquaient une nature qui s’était développée loin des joies et des tristesses bruyantes du monde. Le dessin de la bouche et un menton volontaire interdisaient de lui attribuer de la mollesse de caractère. Il pouvait être impulsif, enthousiaste, sensible, souple, et cherchant à plaire ; mais un observateur attentif aurait juré que ses manières douces de jeune moine masquaient une fermeté et une résolution naturelles.
Il n’était pas revêtu de la robe monastique ; il avait un costume de laïque ; cependant son justaucorps, son manteau et ses chausses étaient d’une couleur sombre, décente pour quelqu’un ayant vécu à l’intérieur d’une enceinte sacrée. Il portait en bandoulière une besace de voyage. D’une main il serrait un gros bâton pointu et ferré ; de l’autre il tenait son bonnet qu’ornait sur le devant une grande médaille d’étain frappée à l’image de Notre-Dame de Rocamadour.
– Êtes-vous prêt, beau fils ? dit l’Abbé. Ce jour est décidément celui des départs. En douze heures l’abbaye a dû arracher son herbe la plus nocive, et se séparer de sa fleur préférée.
– Vous êtes trop bon, mon Père ! répondit le jeune homme. Si je pouvais disposer de moi à mon gré, je ne partirais jamais et je terminerais mes jours ici à Beaulieu. L’abbaye a été ma demeure depuis que je suis en âge de me souvenir, et j’ai chagrin à la quitter.
– La vie apporte beaucoup de croix, dit doucement l’Abbé. Qui n’en a pas ? Votre départ nous afflige autant que vous. Mais rien ne peut l’empêcher. J’ai donné ma parole à votre père Edric que lorsque vous auriez vingt ans vous iriez dans le monde afin d’en goûter les saveurs par vous-même. Asseyez-vous sur ce siège, Alleyne, car il se peut que vous ne vous reposiez pas avant longtemps.
Le jeune homme obéit, mais avec une répugnance et un manque d’assurance visibles. L’Abbé se tenait près de la fenêtre étroite ; sa longue ombre noire tombait obliquement sur le plancher.
– Il y a vingt ans, reprit-il, votre père, le seigneur de Minstead, est mort en laissant à l’abbaye de riches terres et aussi son enfant, à condition que nous l’élevions jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge d’homme. Il l’a fait en partie parce que votre mère était morte, et en partie parce que votre frère aîné, l’actuel seigneur de Minstead, avait déjà manifesté une nature grossière et farouche et qu’il n’aurait pas été pour vous un compagnon convenable. Il manifesta toutefois sa volonté que vous ne resteriez pas au couvent et que, parvenu à maturité, vous retourneriez dans le monde.
– Mais, mon Père, interrompit le jeune homme, n’ai-je pas déjà franchi quelques degrés dans la cléricature ?
– Si, beau fils, mais pas assez pour vous empêcher de porter le costume laïque ni pour vous interdire le genre d’existence que vous allez mener. Vous avez été portier ?
– Oui, mon Père.
– Exorciste ?
– Oui, mon Père.
– Lecteur ?
– Oui, mon Père.
– Acolyte ?
– Oui, mon Père.
– Mais vous n’avez pas prononcé de vœux de fidélité et de chasteté ?
– Non, mon Père.
– Vous êtes donc libre de vivre dans le siècle. Mais avant que vous partiez, faites-moi savoir quels talents vous emportez de Beaulieu. J’en connais quelques-uns. Vous savez jouer de la citole et du rebec. Sans vous notre chœur sera muet. Vous sculptez aussi, je crois ?
La pâle figure du jeune homme s’enflamma d’une fierté d’artiste.
– Oui, Révérend Père ! Grâce au bon Frère Bartholomew, je sculpte le bois et l’ivoire, et je puis également travailler l’argent et le bronze. Du Frère Francis j’ai appris à peindre sur parchemin, sur verre et sur métal, et je connais les colorants et les essences qui préservent la couleur de l’humidité ou d’un air trop vif. Le Frère Luc m’a initié au damasquinage et à l’émaillage des châsses, des tabernacles, des diptyques et des triptyques. Pour le reste je sais un peu faire de la tapisserie, tailler des pierres précieuses et fabriquer des outils.
– Une belle liste, en vérité ! s’exclama le Supérieur en souriant. Quel clerc de Cambridge ou d’Oxenford pourrait se prévaloir d’autant ? Mais pour la lecture ? Je crains que vous ne soyez moins disert.
– En effet, mon Père ; mon bagage est léger. Pourtant, grâce à notre bon procureur, je ne suis pas totalement illettré. J’ai lu Ockham, Bradwardine et d’autres de l’École, ainsi que le savant Duns Scott et la Somme du saint d’Aquin.
– Mais qu’avez-vous retenu de vos lectures sur les choses de ce monde ? De cette haute fenêtre vous pouvez apercevoir la pointe boisée et la fumée de Bucklershard, l’embouchure de l’Exe et le scintillement de la mer. Je vous demande maintenant, Alleyne, où arriverait un homme qui embarquerait et traverserait cette mer.
Le jeune homme réfléchit et dessina un plan avec son bâton sur les nattes de jonc qui recouvraient une partie du plancher.
– Révérend Père, dit-il, il arriverait dans ces régions de la France qui sont tenues par sa Majesté Royale. Mais s’il tendait vers le sud il pourrait atteindre l’Espagne et les États barbaresques. Vers le nord il gagnerait les Flandres, et les pays des Orientaux et des Moscovites.
– Exact ! Et si, après avoir atteint les possessions du Roi, il prolongeait son voyage vers l’est ?
– Dans ce cas il arriverait dans cette partie de la France qui est encore en litige, et il pourrait espérer atteindre la célèbre cité d’Avignon où s’est établi notre Père bénit, le pilier de la Chrétienté.
– Et ensuite ?
– Ensuite il traverserait le pays des Alemans et le grand Empire romain, et puis il irait vers le pays des Huns et des païens de Lithuanie, au-delà duquel est située la grande ville de Constantin et s’étend le royaume des impurs sectateurs de Mahomet.
– Et ensuite, beau fils ?
– Au-delà il y a Jérusalem et la Terre Sainte, ainsi que le grand fleuve qui a sa source dans le jardin de l’Éden.
– Et ensuite ?
– Non, Révérend Père, je n’en sais pas davantage. À mon avis le bout du monde n’est pas loin.
– Alors nous pouvons encore trouver quelque chose à vous apprendre, Alleyne ! fit l’Abbé avec complaisance. Sachez que beaucoup de peuples étranges s’interposent avant le bout du monde. Il y a le pays des Amazones et le pays des nains, et le pays des femmes jolies mais mauvaises qui tuent d’un regard comme le basilic. Plus loin il y a le royaume de Prester John et du Grand Khan. Tout cela je le sais de source sûre, puisque je le tiens du pieux et vaillant chevalier du Christ, Sir John de Mandeville, qui s’arrêta deux fois à Beaulieu en allant à Southampton et en revenant : du pupitre du réfectoire, il nous fit un discours sur ce qu’il avait vu, et il se trouva plus d’un bon Frère pour s’arrêter de boire et de manger tant ces étranges contes étaient saisissants.
– Je voudrais bien savoir, mon Père, ce qui peut exister à l’extrémité du monde.
– L’approfondissement de certains sujets, répondit l’Abbé avec gravité, ne nous a jamais été recommandé. Mais vous avez une longue route devant vous. Où irez-vous d’abord ?
– Chez mon frère à Minstead. Puisqu’il est vraiment impie et violent, il faut que je le voie et que je cherche à le ramener dans la bonne voie.
L’Abbé hocha la tête.
– Le seigneur de Minstead s’est taillé une fâcheuse réputation, fit-il. Si vous vous rendez chez lui, veillez au moins à ce qu’il ne vous détourne pas de la route étroite où vous avez appris à marcher. Mais vous êtes sous la garde de Dieu, et Dieu vous protégera toujours dans le péril ou les soucis. Par-dessus tout, évitez les pièges des femmes ; elles en tendent constamment pour y prendre de jeunes aveugles. À genoux, mon enfant, et recevez la bénédiction d’un vieil homme.
Alleyne Edricson baissa la tête pendant que dans son cœur l’Abbé suppliait le Ciel de protéger cette âme innocente qui s’engageait dans les ténèbres et les dangers du siècle. Ce n’était une formule vide ni pour l’un ni pour l’autre. Tous deux considéraient la vie extérieure comme une source de violence et de péché, environnée de dangers physiques et surtout spirituels.
À cette époque le ciel était proche des hommes. Les interventions directes de Dieu se manifestaient dans le tonnerre et l’arc-en-ciel, la tempête et les éclairs. Pour le croyant, des nuées d’anges et de confesseurs ou de martyrs, des armées de saints et de sauvés se penchaient toujours vers leurs frères de l’Église militante : ils les relevaient, les encourageaient, les aidaient. Ce fut donc d’un cœur raffermi que le jeune homme quitta la chambre de l’Abbé. Celui-ci l’accompagna jusqu’en haut de l’escalier et le recommanda à la protection de saint Julien, patron des voyageurs.
En bas, sous le porche de l’abbaye, les moines s’étaient rassemblés pour un dernier adieu. Beaucoup avaient apporté un petit cadeau afin qu’il se souvînt d’eux. Le Frère Bartholomew était là avec un crucifix d’ivoire sculpté, et aussi le Frère Luc avec un psautier dont le dos blanc était décoré d’abeilles d’or, et encore le Frère Francis qui lui offrit « Le massacre des Innocents » admirablement dessiné sur parchemin. Tous ces objets furent soigneusement glissés au fond de la besace du voyageur, et recouverts par les soins du Frère Athanasius d’un paquet de pain et de fromage et d’un petit flacon du célèbre vin cacheté de bleu de l’abbaye. Voilà comment, s’arrachant aux mains qui se tendaient vers lui, parmi des éclats de rire et des bénédictions, Alleyne Edricson quitta Beaulieu.
Au tournant de la route il s’arrêta pour regarder derrière lui. L’immense bâtiment qu’il connaissait si bien s’étendait baigné du miel du soleil couchant : il contempla la maison de l’Abbé, l’église allongée, le cloître ogival. Et puis il y avait aussi le large ruban de l’Exe, le vieux puits de pierre, le petit autel de la Vierge dans une niche et, surtout, le groupe des robes blanches avec ces mains qui s’agitaient dans sa direction. Un brouillard embua les yeux du jeune homme, qui se mit en route, la gorge serrée et le cœur lourd.
CHAPITRE III
Comment Hordle John dupa le fouleur de Lymington
Mais il ne serait pas conforme à l’ordre naturel qu’un ardent garçon de vingt ans ayant le vaste monde devant lui passât ses premières heures de liberté à se lamenter sur ce qu’il venait de quitter. Bien avant que le son des cloches de Beaulieu eût cessé de parvenir à ses oreilles, Alleyne avait repris une démarche assurée, faisait des moulinets avec son bâton ferré et sifflait comme un merle. Il est vrai que la soirée était digne de raffermir le moral d’un homme. Les rayons obliques du soleil filtraient à travers les arbres, dessinaient sur la route des barres dorées entre des nervures délicates. Au loin, devant et derrière lui, les rameaux verts qui commençaient à prendre une teinte cuivrée s’élançaient pour former de larges arceaux. L’air calme de l’été s’alourdissait des senteurs résineuses de la grande forêt. Ici et là un ruisseau aux eaux roussâtres babillait en s’échappant des sous-bois et courait se perdre parmi les fougères et les ronces. Édifiée sur le bourdonnement des insectes et le bruissement des feuilles, la paix de la nature régnait partout.
La vie pourtant ne manquait pas : tous les grands bois en étaient riches. Tantôt une hermine d’été, souple et furtive, traversait la route pour assouvir sa cruelle passion de la chasse ; tantôt un chat sauvage perché sur une branche de chêne observait le voyageur d’un œil jaune et méfiant. Ou encore une laie suivie de deux petits marcassins surgissait des broussailles, à moins qu’un cerf majestueux n’avançât parmi les troncs d’arbres et ne regardât autour de lui avec l’assurance d’un sujet du Roi. Quand il en aperçut un, Alleyne le menaça gaiement de son gourdin et le cerf, pensant sans doute que le Roi était trop loin pour le protéger, s’enfuit en bondissant.
À présent le jeune homme se trouvait loin de l’abbaye. Il fut d’autant plus surpris d’apercevoir, au bout d’un virage, un homme revêtu de la robe blanche de l’ordre et assis sur un talus de bruyère. Alleyne connaissait bien tous les frères, sauf celui-ci. Il secouait sa tête rougeaude et bouffie avec un air de grande perplexité : il joignait les mains et les agitait furieusement ; enfin il se leva et descendit la route en courant. Mais quand il s’était mis debout, Alleyne avait remarqué que sa robe était beaucoup trop longue pour sa taille, qu’elle traînait par terre et tirebouchonnait sur ses chevilles de telle manière que même en la retroussant il était incapable de marcher vite. Néanmoins il se mit à courir ; ses pieds s’embarrassèrent dans sa robe ; il dut ralentir ; il faillit tomber ; il préféra se laisser choir sur la bruyère. Quand Alleyne parvint à sa hauteur, il l’interpella.
– Jeune ami, lui dit-il, d’après votre costume laïque je gage que vous ne savez pas grand-chose sur l’abbaye de Beaulieu.
– Vous êtes dans l’erreur, répondit le clerc. J’ai passé toute ma vie entre ses murs.
– Serait-ce vrai ? s’écria-t-il. Alors pourrez-vous me dire le nom d’un grand lourdaud de frère immonde qui a un visage taché de son et des mains comme des pelles ? Ses yeux sont noirs, sa tignasse rouge, et il beugle comme le taureau de la paroisse. Je ne crois pas qu’il y en ait deux de semblables dans un même couvent.
– Il s’agit sûrement du Frère John. J’espère qu’il ne vous a pas fait de mal, bien que vous soyez en colère contre lui ?
– Du mal ? s’exclama l’autre en sursautant sur sa bruyère. Du mal ! Il m’a volé tous mes vêtements ; est-ce un mal ? Et il m’a laissé ici dans ce triste costume blanc, si bien que j’ai honte de me représenter devant ma femme : elle pensera que j’ai pris sa vieille chemise pour m’habiller. C’est une misère que je l’aie rencontré !
– Mais que s’est-il passé ? demanda le clerc qui avait du mal à réprimer un fou rire devant le spectacle de ce petit homme courroucé, tout noiraud dans sa robe blanche.
– Voici. Je suivais cette route et j’espérais atteindre Lymington avant la nuit, quand j’ai rencontré ce fripon de rouquin assis exactement en ce même endroit. Je me suis découvert en passant devant lui ; après tout ce pouvait être un saint homme en train de faire oraison ! Mais il m’a interpellé pour me demander si j’avais entendu parler de la nouvelle indulgence accordée aux Cisterciens. Je lui ai répondu que non. « Alors, tant pis pour ton âme ! » s’est-il écrié. Et il s’est lancé dans une longue histoire : tenant compte des vertus de l’abbé Berghersh, le Pape avait décrété que quiconque endosserait l’habit d’un moine de Beaulieu, le temps de dire les sept psaumes de David, aurait sa place assurée au royaume de Dieu. Quand j’ai appris cela, je me suis jeté à genoux et je l’ai supplié de me prêter sa robe pour que je la passe ; il a cédé à mes nombreuses adjurations, surtout après que je lui aie remis trois marcs pour redorer la statue de Laurent le martyr. J’ai donc revêtu sa robe. Je ne pouvais pas faire autrement que de lui permettre de porter mon bon justaucorps de cuir et mes chausses, car, disait-il, il commençait à faire froid et il n’aurait pas été décent qu’il demeurât demi-nu pendant que je me livrerais à mes oraisons. Une fois qu’il a été habillé, et il ne l’a pas été sans peine car nous ne sommes pas de la même taille, je n’en étais arrivé qu’à la fin du deuxième psaume ; là-dessus il m’a ordonné de faire honneur à mon nouvel habit, et il s’est enfui à toutes jambes. J’aurais bien voulu courir moi aussi, mais j’avais l’impression d’avoir été cousu dans un sac. Aussi me suis-je assis ici, je n’en bougerai pas avant d’avoir retrouvé mes affaires.
– Non, non, ami ! Ne prenez pas les choses si lugubrement ! dit Alleyne en posant une main sur l’épaule de l’affligé. Il vous reste toujours la ressource de troquer à l’abbaye cette robe contre un justaucorps. Mais peut-être avez-vous un ami dans les environs ?
– Oui, j’en ai un, répondit-il. Et juste à côté. Mais je ne me soucie guère d’aller le trouver, car sa femme a une langue de diablesse, et elle raconterait mon aventure dans tout le pays : je ne pourrais plus me montrer dans aucun marché, de Fordingbridge à Southampton. Mais si vous, beau messire, vous aviez la bonté de faire un crochet de deux portées de flèche, vous me rendriez un service sans égal.
– De tout mon cœur ! fit Alleyne.
– Alors prenez ce sentier sur la gauche, je vous prie, puis la piste de chevreuils qui débouche sur la droite. Vous verrez sous un grand hêtre la hutte d’un charbonnier. Dites-lui mon nom, mon bon seigneur, le nom de Peter le fouleur, de Lymington, et demandez-lui des vêtements de rechange afin que je puisse me remettre en route sans délai. Pour certaines raisons il ne me refusera pas ce service.
Alleyne partit par le sentier indiqué et découvrit bientôt la hutte du charbonnier. Celui-ci était sorti pour couper du bois dans la forêt ; mais sa femme, grosse matrone affairée, trouva les vêtements qui convenaient et en fit un ballot. Pendant qu’elle s’empressait, Alleyne Edricson se tenait devant la porte ouverte, et il la regardait avec autant d’intérêt que de méfiance car il n’avait jamais vu une femme d’aussi près. Elle avait des bras rouges, une robe en lainage sombre et une broche en cuivre grosse comme une tartelette.
– Peter le fouleur ! ne cessait-elle de répéter. Par la sainte Vierge, si j’étais la femme de Peter le fouleur, je lui aurais appris à ne pas donner ses vêtements au premier coquin venu ! Mais il a toujours été stupidement crédule, Peter, bien que nous lui soyons redevable de nous avoir aidés pour l’enterrement de notre second fils, Wat, qui était apprenti chez lui à Lymington l’année de la Peste Noire. Mais qui êtes-vous, jeune seigneur ?
– Un clerc qui va de Beaulieu à Minstead.
– Tiens, vraiment ? Vous avez été élevé à l’abbaye, alors ? Je pourrais le deviner rien qu’à vos joues rougissantes et à vos yeux baissés. Vous avez appris chez les moines, je suppose, à redouter les femmes. Ils déshonorent leurs propres mères, avec cet enseignement-là ! Le monde serait joli, ma foi, s’il n’y avait plus de femmes !
– Que le ciel nous préserve d’une telle éventualité ! dit Alleyne.
– Amen et amen ! Mais vous êtes joli garçon, d’autant plus mignon que vous avez des manières modestes. Il est facile de voir à votre figure que vous n’avez point passé vos journées sous la pluie, dans la chaleur et le vent, comme mon pauvre Wat a été forcé de le faire.
– J’ai encore vu bien peu de choses de la vie, bonne dame !
– Vous n’y trouverez rien qui vous dédommagera de la perte de votre fraîcheur. Voilà les habits. Peter n’aura qu’à les rapporter la prochaine fois qu’il passera par ici. Sainte Vierge ! Regardez cette poussière sur votre doublet ! On voit bien que vous n’avez pas de femme pour veiller sur vous. Là ! C’est mieux. Maintenant fais-moi la bise, mon petit.
Alleyne se pencha pour déposer un baiser sur son visage. Le baiser était en effet la manière ordinaire de se saluer à l’époque et, comme Érasme le remarqua bien plus tard, davantage en Angleterre que partout ailleurs. Celui-là fit battre furieusement le sang aux tempes d’Alleyne qui se demanda, en partant, comment l’abbé Berghersh aurait réagi devant une invitation aussi franche. Il en avait encore des fourmillements dans la peau quand il rejoignit la route, mais ce qu’il vit alors lui changea les idées.
Un peu plus bas, l’infortuné Peter tapait du pied et tempêtait dix fois plus fort qu’auparavant. Au lieu de la grande robe blanche, il n’avait plus de vêtements du tout, sauf une courte chemise de flanelle et une paire de chaussons de cuir. Loin sur la route courait un homme très grand, qui avait un ballot sous un bras et l’autre main au côté, comme quelqu’un qui rit jusqu’à en avoir mal.
– Regardez-le ! cria Peter. Regardez-le ! Vous me servirez de témoin. Il fera connaissance avec la prison de Winchester ! Voyez comme il s’enfuit avec mon habit !
– Qui est-ce ?
– Qui, sinon ce maudit Frère John ? Il m’a laissé moins de vêtements que n’en a un galérien. Ce double fripon m’a volé ma robe.
– Du calme, mon ami ! C’était sa robe, objecta Alleyne.
– Il a tous mes habits : la robe, le justaucorps, les hauts-de-chausses, tout ! Je lui suis bien reconnaissant de m’avoir laissé ma chemise et mes chaussons ! Cela ne m’étonnerait pas qu’il revienne bientôt les chercher.
– Mais comment est-ce arrivé ? demanda Alleyne éberlué.
– Sont-ce là les vêtements ? Par pitié, donnez-les moi ! Le Pape lui-même ne me les reprendrait pas, même s’il m’envoyait tout le sacré collège des cardinaux pour me les réclamer. Comment est-ce arrivé ? Hé bien, vous veniez de me quitter quand ce maudit John est revenu au pas de course ; quand j’ai ouvert la bouche pour l’accabler de reproches, il m’a demandé s’il était vraisemblable qu’un homme de prières abandonnât son habit de religieux pour s’emparer du justaucorps d’un laïque. Il n’avait fait qu’un petit tour, m’a-t-il dit, pour que je fusse plus libre dans mes dévotions. Sur ce j’ai retiré ma robe, et lui, simulant beaucoup de hâte, a commencé à dégrafer le justaucorps. Mais quand j’ai posé ma robe sur le sol, il l’a ramassée et il a pris ses jambes à son cou, en me laissant dans cette triste situation. Il riait tellement, comme une grosse grenouille coassante, que j’aurais pu le rattraper si je n’avais pas le souffle aussi court que ses jambes sont longues.
Le jeune homme écouta cette histoire avec tout le sérieux dont il fut capable, mais quand il vit son interlocuteur bedonnant se mettre debout en exhibant toute sa dignité offensée, un gros rire l’assaillit si brusquement qu’il dut s’appuyer contre un arbre. Le fouleur le considéra d’abord avec une gravité chagrine. Mais comme le rire paraissait devoir s’éterniser, il s’inclina avec une politesse forcée et s’éloigna dans ses habits empruntés. Quand il ne fut plus qu’un point noir sur la route, Alleyne s’essuya les yeux et se remit joyeusement en marche.
CHAPITRE IV
Comment le bailli de Southampton extermina deux voleurs
Si la route qu’il avait prise n’était guère plus fréquentée que la plupart des routes du royaume, elle l’était beaucoup moins que celles qui reliaient les grandes villes entre elles. Cependant Alleyne croisa d’autres voyageurs, et à plusieurs reprises il fut doublé par des processions de mulets de bât et de cavaliers qui allaient dans la même direction. Une fois un moine mendiant s’avança vers lui en boitillant et lui demanda l’aumône d’une voix dolente : pour acheter un pain qui, dit-il, le sauverait d’une mort imminente. Mais Alleyne accéléra l’allure, car les moines lui avaient appris à se méfier des religieux errants, et, d’autre part, un grand os de gigot à demi raclé dépassait de sa poche. Pour aussi vite qu’il se défila, il ne put éviter la malédiction des quatre saints évangélistes que lui lança le mendiant, accompagnée d’injures si horribles qu’effrayé il se boucha les oreilles avec ses doigts et courut un bon moment à perdre haleine.
Plus loin, à la lisière d’un bois, il tomba sur un colporteur et sa femme qui étaient assis sur un arbre déraciné. Le colporteur avait posé par terre son ballot qui servait de table ; tous deux dévoraient un grand pâté et l’arrosaient d’une boisson tirée d’une jarre de pierre. Le colporteur lui adressa au passage une grossière plaisanterie, mais sa femme appela Alleyne d’une voix aiguë et l’invita à venir se joindre à eux. Là-dessus l’homme passa de la gaieté à la colère et il se mit à la rouer de coups. Alleyne pressa le pas de peur qu’il ne lui fît plus de mal, mais son cœur pesait comme une masse de plomb. Partout où il portait les yeux, il ne voyait que violence et injustice, et la dureté de l’homme pour l’homme.
Pendant qu’il ruminait ces tristes pensées et languissait après la paix de l’abbaye, il parvint à un endroit découvert parsemé de buissons de houx, où l’attendait le spectacle le plus étrange qu’il eût jamais vu. Le chemin était bordé d’un long rideau de feuillage, derrière lequel se dressaient toutes droites quatre jambes d’hommes recouvertes de chausses bariolées jaunes et noires. À sa stupéfaction une musique gaie s’éleva dans l’air et les quatre jambes gigotèrent au rythme de la musique. Alleyne fit sur la pointe des pieds le tour des buissons et s’arrêta interdit : deux hommes se déplaçaient sur la tête et ils jouaient, l’un d’une viole, l’autre d’un pipeau, aussi allégrement et aussi juste que s’ils étaient assis dans un orchestre. Alleyne se signa devant ce spectacle surnaturel, et il eut du mal à conserver son sang-froid quand les deux danseurs, l’apercevant, se dirigèrent vers lui en bondissant sur la tête. À une longueur de lance ils exécutèrent chacun un saut périlleux et retombèrent sur leurs pieds, souriants et la main sur le cœur.
– Une récompense ! Une récompense, beau chevalier aux yeux écarquillés ! cria l’un.
– Un présent, mon prince ! susurra l’autre. N’importe quelle bagatelle nous sera utile : une bourse pleine d’or, ou même un gobelet ciselé !
Alleyne se souvint de ce qu’il avait lu sur la possession démoniaque : les sauts, les contorsions, les exclamations brusques. Il allait répéter les exorcismes propres à le défendre contre de telles attaques quand les deux inconnus éclatèrent de rire et, retombant à nouveau pieds en l’air, firent claquer leurs talons en se moquant de lui.
– Jamais vu d’acrobates auparavant ? demanda le plus âgé.
C’était un gaillard bronzé, noir de cheveux, aussi brun et souple qu’une baguette de noisetier. Il poursuivit :
– Pourquoi reculez-vous, comme si nous étions les rejetons du diable ?
– Pourquoi reculez-vous, oiseau couleur de miel ?
– Pourquoi avez-vous peur, ma douceur cannellisée ? s’écria l’autre qui était un grand garçon efflanqué avec des yeux coquins.
– C’est, messires, que le spectacle est nouveau pour moi, répondit le clerc. Quand j’ai vu vos quatre jambes par-dessus les buissons, j’en ai à peine cru mes yeux. Pourquoi faites-vous cela ?
– Question bien sèche pour y répondre ! cria le plus jeune en se remettant debout. Question qui donne soif, mon bel oiseau ! Mais que vois-je ? Un flacon, un flacon ! C’est merveilleux…
Tout en parlant il avait allongé le bras et retiré le flacon de la besace d’Alleyne. Adroitement il lui cassa le col et s’en versa la moitié dans le gosier. Il tendit le reste à son camarade qui but le vin et qui, à la stupéfaction grandissante du clerc, fit semblant d’avaler le flacon : il s’y prit si bien qu’Alleyne crut le voir disparaître dans sa gorge. Mais une seconde plus tard il le balança par-dessus sa tête et le rattrapa en équilibre sur le mollet de sa jambe.
– Nous vous remercions pour le vin, mon bon seigneur, dit-il, et pour la courtoisie spontanée avec laquelle vous nous l’avez offert. Pour en terminer avec votre question, apprenez que nous sommes bateleurs ; nous nous sommes exhibés avec un énorme succès à la foire de Winchester et nous nous rendons à Ringwood pour le grand marché de la Saint-Michel. Mais comme notre art est très subtil et très précis, nous ne pouvons pas laisser passer un jour sans nous entraîner ; dans ce but nous choisissons un endroit tranquille où nous faisons halte. Or vous nous avez découverts ici. Et nous ne pouvons guère être surpris de votre étonnement, puisque vous n’aviez jamais vu d’acrobates et que beaucoup de barons, comtes, maréchaux et chevaliers qui sont allés jusqu’en Terre Sainte sont unanimes à déclarer qu’ils n’ont jamais vu un numéro aussi parfait et aussi gracieux. Si vous voulez bien vous asseoir sur ce petit tertre, nous allons recommencer nos exercices.
Alleyne s’assit avec plaisir entre les deux gros ballots qui contenaient les costumes des bateleurs : doublets de soie couleur de feu et ceintures de cuir pailletées de cuivre et de fer blanc. Les acrobates se remirent sur la tête : ils se déplaçaient par petits bonds en observant une totale rigidité du cou et en jouant de leurs instruments sans la moindre fausse note. Le hasard voulut qu’Alleyne aperçut, dépassant l’un des ballots, le bout d’une cithare ; il la prit, l’accorda et gratta sur les cordes un accompagnement de l’air entraînant que jouaient les danseurs. Quand ils l’entendirent, ils posèrent leurs propres instruments et, mains au sol, se mirent à sautiller de plus en plus vite ; ils criaient à Alleyne d’accélérer le rythme ; ils ne s’arrêtèrent que lorsque la fatigue les accabla tous les trois.
– Bien joué, ma douce colombe ! s’exclama le plus jeune. Pour les cordes, vous êtes un artiste !
– Comment connaissiez-vous l’air ? demanda l’autre.
– Je ne le connaissais pas. Je n’ai fait que suivre les notes que j’entendais.
Ce fut à leur tour d’ouvrir de grands yeux : ils contemplèrent Alleyne avec autant d’émerveillement qu’il en avait mis à les regarder.
– Vous avez une drôle d’oreille ! fit le plus âgé. Il y a longtemps que nous cherchons un musicien de votre qualité. Voulez-vous vous joindre à nous et pousser jusqu’à Ringwood ? Vous n’aurez pas grand-chose à faire et vous recevrez deux pence par jour, plus le souper tous les soirs.
– Arrosé d’autant de bière que vous pourrez en ingurgiter, ajouta le plus jeune. Et un flacon de vin de Gascogne le dimanche.
– Non, impossible ! répondit Alleyne. Un autre travail m’attend, et je me suis déjà attardé trop longtemps avec vous.
Il reprit résolument la route ; les deux bateleurs coururent derrière lui, lui offrirent quatre pence, puis six pence par jour ; mais il se contenta de sourire et de secouer la tête ; finalement ils renoncèrent à le séduire. Plus loin il se retourna et aperçut le plus petit grimpé sur les épaules du plus jeune ; de cet échafaudage quatre mains s’agitaient pour lui dire adieu ; il leur répondit par de grands signes, puis se hâta d’avancer ; cette rencontre le ragaillardit.
Alleyne n’avait pas franchi une grande distance en raison des aventures mineures qui lui étaient arrivées. Mineures, et cependant passionnantes. Jusqu’ici il avait mené une existence si paisible qu’un mauvais brassage de la bière ou une modification à une antienne avaient pris figure d’événements. Mais voici qu’il assistait maintenant au jeu vif et changeant des lumières et des ombres de la vie. Un abîme semblait se creuser entre cette nouvelle existence pleine d’imprévus et d’incertitudes et le cycle régulier des travaux et des prières d’antan. Les quelques heures qui s’étaient écoulées depuis son départ de l’abbaye effaçaient de sa mémoire tous les ans qu’il y avait passés. Il prit le pain que les frères avaient placé dans sa besace : quand il le porta à sa bouche il lui parut étrange qu’il eût gardé la chaleur des fours de Beaulieu.
Au-delà de Penerley, qui comptait trois chaumières et une grange, il quitta le pays boisé : la grande lande dénudée de Blackdown s’étirait devant lui ; elle était rose de bruyères et bronzée par des fougères en train de se flétrir. À gauche les bois étaient encore épais, mais la route s’en éloignait et serpentait à découvert. Le soleil reposait bas vers l’ouest sur un nuage de pourpre, d’où il projetait une douce lumière sur la lande sauvage et la lisière des forêts ; il transformait les feuilles desséchées en flocons d’or d’autant plus brillants que s’assombrissaient les profondeurs sylvestres. Pour le contemplatif le déclin est aussi beau que l’épanouissement, la mort aussi belle que la vie. Cette pensée se glissa dans le cœur d’Alleyne quand il contempla avec ravissement la beauté poignante du paysage automnal. Mais il ne s’y arrêta guère, car il lui restait dix bons kilomètres de marche avant de parvenir à l’auberge la plus proche. Il mangea hâtivement du pain et du fromage, après quoi il trouva que sa besace pesait moins lourd.
Sur cette route à découvert les voyageurs étaient moins rares que dans la forêt. Il croisa d’abord deux Dominicains à longues robes noires qui passèrent près de lui en remuant les lèvres et en ne lui accordant aucune attention. Puis il vit un religieux d’un ordre mineur, à cheveux gris et à forte bedaine, qui marchait à pas lents et qui regardait autour de lui avec l’air d’un homme en paix avec lui-même comme avec son prochain ; il arrêta Alleyne pour lui demander s’il n’y avait pas dans les environs un hôtel spécialement réputé pour sa matelote d’anguilles ; le clerc lui ayant répondu qu’il avait entendu vanter les anguilles de Sowley, le digne religieux passa sa langue sur ses lèvres avant de repartir d’un pas plus rapide. Presque sur ses talons arrivèrent trois cultivateurs, avec la pelle ou la pioche sur l’épaule ; ils chantaient d’une voix juste, mais leur anglais était si grossier et si rude qu’il sonnait aux oreilles d’un homme élevé au couvent comme une langue étrangère, barbare. L’un d’eux portait un jeune butor qu’ils avaient attrapé sur la lande ; ils le proposèrent à Alleyne contre une pièce d’argent. Il fut content quand il se fut débarrassé d’eux, car leurs barbes hérissées et leurs regards farouches ne l’incitèrent guère à prolonger une discussion d’affaires.
Mais ce ne sont pas toujours les individus d’aspect peu engageant qui sont le plus à craindre. Un infirme à la jambe de bois s’approcha en boitillant ; il semblait si vieux et si faible qu’un enfant n’en aurait pas eu peur ; quand Alleyne l’eut dépassé, il lui lança tout à coup, par pure méchanceté, une malédiction brutale, en même temps qu’une pierre qui siffla à ses oreilles. Cette agression sans motif épouvanta si fort Alleyne qu’il prit ses jambes à son cou et ne s’arrêta de courir que lorsqu’il fut hors de portée des jurons et des pierres que l’infirme continuait à lui expédier. Il eut l’impression que dans cette Angleterre il n’existait pas d’autre protection pour l’homme que la force de son bras et la rapidité de sa course. Au couvent il avait vaguement entendu parler de la loi, d’une loi toute-puissante, devant laquelle s’inclinaient prélats et barons, mais il n’en décelait pas le moindre signe. À quoi servait une loi inscrite sur parchemin, se demandait-il, si personne n’en assurait le respect ? Mais avant que le soleil fût couché, il allait connaître tout le poids de cette loi anglaise quand elle pouvait s’abattre sur un contrevenant.
Après deux kilomètres de lande, la route descendait assez brusquement dans un creux où coulait un rapide ruisseau couleur de tourbe. À droite s’élevait, et s’élève encore aujourd’hui, un ancien tumulus recouvert de bruyères et de ronces. Alleyne descendait allégrement la pente qui menait au ruisseau quand de l’autre côté il aperçut une vieille dame qui boitait de fatigue et s’appuyait lourdement sur un bâton. Lorsqu’elle parvint au bord du ruisseau, elle s’arrêta et chercha un gué. En face du chemin, une grosse pierre avait été posée en plein milieu de l’eau, mais trop loin de la terre ferme pour une femme âgée. Deux fois elle essaya de placer un pied dessus, deux fois elle dut reculer. Alors elle s’assit, hochant désespérément la tête et se tordant les mains. Sur ces entrefaites Alleyne arriva de l’autre côté du ruisseau.
– Venez, bonne mère ! lui dit-il. Ce n’est pas un passage bien dangereux.
– Hélas, brave jeune homme ! J’ai les yeux brouillés. Je vois bien qu’il y a une pierre, mais je ne sais pas où exactement.
– Cela peut facilement s’arranger.
Il la souleva : elle était légère car l’âge l’avait beaucoup usée ; il la fit traverser ; mais lorsqu’il la posa de l’autre côté, elle faillit tomber ; elle était à peine capable de tenir debout en s’appuyant sur son bâton.
– Vous êtes faible, bonne mère. Vous venez de loin, n’est-ce pas ?
– Du Wiltshire, ami ! soupira-t-elle. Voilà trois jours que je vais par les routes. Je vais chez mon fils qui est garde du Roi à Brockenhurst. Il a toujours dit qu’il prendrait soin de moi quand je serais vieille.
– Et il le fera, bonne mère, puisque vous avez pris soin de lui quand il était jeune. Mais depuis quand n’avez-vous pas mangé ?
– J’ai mangé à Lyndenhurst ; mais ma bourse était vide et je n’ai pu avoir qu’une assiette de porridge chez les religieuses. J’espère pourtant que je pourrai arriver ce soir à Brockenhurst : là on me donnera tout ce que je pourrai désirer. Oui, messire, mon fils est un cœur d’or ; d’ailleurs la pensée qu’il est un serviteur du Roi et qu’il porte un doublet vert sur le dos me soutient autant que la nourriture.
– Tout de même, la route est longue jusqu’à Brockenhurst ! dit Alleyne. Voici le pain et le fromage qui me restent ; et voici un penny qui vous aidera à souper. Que Dieu soit avec vous !
– Dieu soit avec toi aussi, brave homme ! cria-t-elle. Puisse-t-il te donner autant de joies que tu m’en donnes !
Elle se remit en route en continuant de marmonner des bénédictions ; pendant quelque temps Alleyne suivit du regard sa petite silhouette et son ombre longue qui gravissaient la côte.
Il était déjà reparti quand un étrange spectacle le fit frissonner. D’entre les fourrés qui recouvraient le tumulus sur sa droite, deux hommes le surveillaient. Le soleil couchant éclairait bien leurs visages ; il y en avait un qui paraissait assez âgé et qui était pourvu d’une barbiche, d’un nez crochu, et d’une grosse tache rouge de naissance sur la tempe ; l’autre était un nègre ; on rencontrait fort peu de nègres en Angleterre à cette époque, et encore moins dans les régions tranquilles du sud. Alleyne avait lu des récits sur les nègres, mais il n’en avait jamais vu un, et ses yeux s’arrêtèrent sur les grosses lèvres et les dents luisantes de celui-là. Pendant qu’il les observait les deux hommes sortirent de leur abri et descendirent sur le chemin d’un pas si furtif, si inquiétant, que le clerc accéléra l’allure.
Il avait atteint le haut de la côte, quand il entendit le bruit d’une bagarre, ainsi qu’une faible voix qui bêlait pour appeler au secours. Il se retourna : la vieille dame était étalée de son long sur la route ; sa guimpe rouge voletait au vent ; les deux bandits étaient penchés sur elle et voulaient lui arracher son penny. Quand il vit les membres menus de la vieille dame se débattre contre ses agresseurs, la fureur tourbillonna dans sa tête. Il laissa tomber sa besace, repassa le ruisseau d’un bond et se rua sur les deux coquins en faisant tournoyer son bâton ferré ; ses yeux gris étincelaient de colère.
Les voleurs, cependant, n’étaient pas disposés à abandonner leur victime avant de l’avoir complètement dévalisée. Le nègre avait noué autour de son front le fichu écarlate de la vieille dame et il se porta au-devant d’Alleyne ; il était armé d’un long couteau, tandis que l’autre agitait un gourdin et défiait Alleyne en l’accablant de malédictions. Mais Alleyne n’avait nul besoin d’un défi pour agir. Il se jeta sur le nègre et le frappa avec tant de vigueur que le couteau tomba sur la route et que son propriétaire s’enfuit en hurlant. Le deuxième bandit, moins facile à épouvanter, sauta sur le clerc et l’étreignit par la taille ; il avait la force d’un ours ; il cria à son camarade de revenir et de le poignarder dans le dos. Le nègre ramassa son couteau et se rapprocha ; il avait le meurtre dans les yeux. Alleyne et l’autre étaient toujours aux prises ; ils se colletaient en oscillant et en titubant sur la route. Juste au moment où Alleyne sentit le froid de la lame entre ses deux épaules, un galop de chevaux troua l’air du crépuscule ; le nègre poussa un cri de terreur et s’enfuit à travers la bruyère. Son acolyte essaya de se libérer ; il claquait des dents ; Alleyne sentit qu’il s’amollissait. Le clerc comprit que de l’aide lui arrivait, et il serra plus fort son adversaire jusqu’à ce qu’il pût le jeter à terre et regarder derrière lui.
Il vit un gros cavalier solidement bâti, vêtu d’une tunique de velours rouge, qui dévalait la côte en poussant son grand cheval noir au maximum de sa vitesse. Il était couché sur l’encolure de la bête, et à chaque bond ses épaules se soulevaient comme si c’était lui qui enlevait sa monture. Alleyne remarqua aussi qu’il avait des gants blancs en daim, une plume bouclée blanche sur son chapeau de velours et un baudrier large et doré en travers de sa poitrine. Derrière lui galopaient six autres cavaliers, deux par deux, habillés de sobres justaucorps bruns dont les pans rayés de jaune volaient derrière leurs épaules. Ils furent bientôt sur les lieux de la bagarre.
– En voici un ! cria le chef qui sauta à bas de son cheval écumant et qui saisit le vieux bandit par le bord de son justaucorps. C’est l’un des deux. Je le reconnais à cette marque du diable sur son front. Où sont tes cordes, Peterkins ? Là ! Lie-lui les mains et les pieds. Sa dernière heure a sonné. Et vous, jeune homme, qui êtes-vous ?
– Je suis un clerc, messire ; je viens de Beaulieu.
– Un clerc ! s’exclama l’officier. Venez-vous d’Oxenford ou de Cambridge ? Avez-vous une lettre du procureur de votre collège vous autorisant à mendier ? Montrez-moi votre lettre.
Il avait une tête carrée, des favoris épais et un regard inquisiteur.
– Je viens de l’abbaye de Beaulieu, et je n’ai pas besoin de mendier, répondit Alleyne qui céda à un tremblement irrépressible à présent que la bagarre était terminée.
– Cela vaut mieux pour vous, répondit l’officier. Savez-vous qui je suis ?
– Non, messire, je l’ignore.
– Je suis la loi ! déclara l’autre solennellement. Je suis la loi d’Angleterre, le représentant de Sa Très Gracieuse et Royale Majesté Édouard III.
Alleyne s’inclina très bas devant le représentant du Roi.
– En vérité vous êtes arrivé à temps, très honoré seigneur ! Un moment plus tard, ils m’auraient assassiné.
– Mais il devrait y en avoir un autre ! s’écria l’officier. Où est le nègre ? Nous sommes à la recherche de deux hommes : un marin atteint du feu de saint Antoine, et un nègre qui avait servi à son bord comme cuisinier.
– Le nègre s’est enfui par là ! dit Alleyne en désignant le tumulus.
– Il ne doit pas être loin, seigneur bailli ! s’écria un archer en décrochant son arc. Il se cache quelque part car il se doute bien, tout païen qu’il soit, que les quatre pattes de nos chevaux courent plus vite que les deux siennes.
– Sus à lui donc ! cria l’officier. Il ne sera pas dit, tant que je serai bailli de Southampton, qu’un voleur, un vide-gousset, un tire-laine ou un assassin a échappé à ma police. Laissons par terre ce coquin. Maintenant mettez-vous en ligne, joyeux compères, la flèche sur la corde ; un bon sport vous attend, comme seul le Roi en procure. Toi sur la gauche, Howett, et Thomas de Redbridge sur la droite. Comme cela ! Battez toute la bruyère. Un pot de vin au meilleur tireur.
Les archers n’eurent pas longtemps à chercher. Le nègre s’était enfoui dans sa cachette sous le tumulus ; il aurait pu passer inaperçu s’il n’avait pas eu le fichu rouge autour du front. Il leva la tête pour surveiller ses ennemis. Il n’en fallut pas plus aux yeux vifs du bailli qui éperonna son cheval et tira son épée. Se voyant découvert, le nègre se rua hors de sa cachette et fonça à toutes jambes devant les archers en ligne. Les deux soldats qui entouraient Alleyne bandèrent leurs arcs avec autant de placidité que s’ils s’amusaient à un concours de village.
– Correction du vent : sept mètres, Hal ! dit l’un des deux qui avaient les cheveux grisonnants.
– Cinq, répliqua l’autre qui lâcha la corde.
Alleyne poussa un petit cri ; un éclair jaune avait paru passer à travers l’homme ; mais celui-ci continua à courir.
– Sept, maître fou ! grommela celui qui avait parlé le premier.
Son arc vibra comme la corde d’une harpe. Le nègre sauta très haut dans l’air, lança en avant ses bras et ses jambes et s’écrasa sur la bruyère.
– Juste sous l’omoplate, commenta l’archer qui s’en alla rechercher sa flèche.
– Le vieux limier est en fin de compte le meilleur, déclara le bailli de Southampton en regagnant la route. Ce qui signifie pour ce soir même, Matthew Atwood, un quart du meilleur malvoisie de tout Southampton. Es-tu sûr qu’il est bien mort ?
– Aussi mort que Ponce Pilate, digne seigneur.
– Bien. Maintenant, passons à l’autre bandit. Les arbres ne manquent pas là-bas, mais nous n’avons pas le temps de nous promener. Tire ton épée, Thomas de Redbridge, et décolle-moi cette tête de ses épaules !’
– Une faveur, gracieux seigneur ! Une faveur ! cria le condamné.
– Laquelle ? interrogea le bailli.
– Je vais avouer mon crime. C’est bien moi et le cuisinier nègre, tous deux du bateau La Rose de Gloire de Southampton, qui avons attaqué le marchand des Flandres et l’avons dévalisé de ses épices et de ses dentelles : vol pour lequel, nous le savons, vous détenez un mandat contre nous.
– Cette confession ne te rapportera pas grand-chose, répondit le bailli. Tu as commis un crime dans mon bailliage, tu dois mourir !
– Mais, seigneur, plaida Alleyne qui était blanc comme un linge, il n’est pas encore passé en jugement !
– Jeune clerc, dit le bailli, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Il est vrai qu’il n’a pas été conduit devant le tribunal, mais c’est le tribunal qui est venu à lui. Il a violé la loi et il s’est mis au ban de la société. Ne vous occupez pas de ce qui ne vous regarde pas. Mais quelle est cette faveur, bandit, que tu sollicites ?
– J’ai dans mon soulier, très honoré seigneur, un morceau de bois qui appartenait jadis à la barque dans laquelle saint Paul fut jeté contre l’île de Melita. Je l’ai acheté pour deux nobles à la rose à un marin qui venait du Levant. La faveur que je sollicite est que vous le placiez dans mes mains pour que je puisse mourir en le serrant. De cette manière mon salut éternel sera garanti, et le vôtre également car je ne cesserai d’intercéder pour vous.
Sur l’ordre du bailli, le bandit fut déchaussé : en effet, sur le côté de la cambrure, enveloppé dans un morceau de belle soie, se trouvait un éclat allongé de bois sombre. Les archers se découvrirent, et le bailli se signa dévotement avant de le remettre au voleur.
– S’il est vrai, dit-il, que, par les mérites extraordinaires de saint Paul, ton âme souillée de péchés parvienne au paradis, j’espère que tu n’oublieras pas cette intercession que tu m’as promise. Rappelle-toi donc que c’est pour Herward le bailli que tu devras prier, et non pour Herward le shérif qui est le fils de mon oncle. Maintenant, Thomas, je te prie de te hâter, car nous avons une longue route devant nous et le soleil est déjà couché.
Alleyne contempla la scène : le fonctionnaire majestueux vêtu de velours, le groupe des archers au visage dur qui tenaient leurs chevaux par la bride, le voleur avec ses bras liés derrière le dos et son doublet dégrafé pour découvrir ses épaules. Sur un côté de la route la vieille dame s’était relevée et rajustait sa guimpe rouge. L’un des archers dégaina et s’avança vers le voleur. Horrifié le clerc s’enfuit ; mais à peine avait-il commencé à courir qu’il entendit un coup mat qui s’acheva sur une sorte de sifflement. Une minute plus tard le bailli et quatre de ses hommes le dépassèrent pour regagner Southampton ; les deux autres avaient été désignés comme fossoyeurs. Quand ils arrivèrent à sa hauteur, Alleyne vit un archer essuyer la lame de son épée sur la crinière de sa monture. Un malaise affreux s’empara de lui ; il se laissa tomber sur un talus et éclata en sanglots. C’était, pensait-il, un monde terrible ; et il était difficile de savoir qui était le plus redoutable, des bandits ou des serviteurs de la loi.
CHAPITRE V
Comment une étrange compagnie se trouva
rassemblée à « L’Émerillon bigarré »
La nuit était tombée, la lune brillait entre des lambeaux de nuages déchiquetés. Fatigué par tant d’événements exceptionnels, les pieds endoloris, Alleyne Edricson arriva enfin devant l’auberge de la forêt qui était située aux environs de Lyndhurst. La maison était rectangulaire, basse, légèrement en retrait ; de chaque côté de la porte deux torches brûlaient comme pour souhaiter la bienvenue au voyageur. D’une fenêtre se projetait une longue perche au bout de laquelle était attaché un bouquet de feuillage : on vendait donc des liqueurs à l’intérieur. En approchant Alleyne constata que l’auberge avait été grossièrement construite avec des poutres mal jointes et que la lumière de la salle filtrait par les interstices. Le toit était en chaume et minable ; mais par un contraste curieux, toute une rangée d’écussons de bois magnifiquement peints de chevrons, de bandes, de sautoirs et d’autres emblèmes héraldiques s’étirait sous ses avancées. Près de la porte un cheval était attaché ; les lueurs rougeâtres qui s’échappaient de l’intérieur éclairaient sa tête brune et ses yeux patients, mais tout son corps était plongé dans l’ombre.
Alleyne hésita. Il savait que Minstead, où habitait son frère, n’était plus qu’à quelques kilomètres. D’autre part il n’avait pas revu ce frère depuis son enfance, et les renseignements qu’il avait recueillis sur son compte le dépeignaient comme un homme dur et âpre. Peut-être l’heure était-elle mal choisie pour chercher refuge sous son toit : il était tard ! N’aurait-il pas avantage à dormir dans cette auberge, puis à pousser dans la matinée jusqu’à Minstead ? Si son frère l’accueillait bien, il demeurerait quelque temps chez lui et verrait comment lui être utile. Si, au contraire, il avait le cœur endurci, Alleyne pourrait se mettre en route et gagner sa vie comme artisan ou scribe. Au bout d’une année, selon le vœu de son père, il serait libre de retourner chez les religieux : une éducation monastique, puis une année dans le siècle, et ensuite le libre choix. C’était une curieuse décision, mais il était contraint de l’exécuter. D’autre part s’il voulait commencer par gagner l’amitié de son frère, il ferait mieux d’attendre le lendemain matin pour frapper à son huis.
La porte en planches était entrebâillée. Alleyne entendit un tel vacarme de rires gras et de propos rudes qu’il s’arrêta irrésolu sur le seuil. Mais réfléchissant que c’était un lieu public où il avait autant de droits que n’importe qui, il poussa la porte et pénétra dans la salle commune.
Bien que la soirée fût loin d’être fraîche, un feu de bois pétillait dans un grand âtre ; une partie de la fumée grimpait par une cheminée de fortune, mais dans l’ensemble elle roulait plutôt ses nuages dans la pièce ; l’atmosphère en était si lourde qu’un nouvel arrivant commençait par être pris de suffocation. Sur le feu un grand chaudron mijotait et exhalait des odeurs pleines de promesses. Une douzaine de personnes de tous âges et de toutes conditions étaient assises autour ; lorsque Alleyne entra, l’assistance poussa un tel cri qu’il s’arrêta net ; il regarda à travers la fumée en se demandant ce que signifiait un accueil aussi bruyant.
– Une tournée ! Une tournée ! cria un rude gaillard dont le justaucorps était en loques. Une tournée d’hydromel ou de bière sur le compte du dernier arrivant !
– C’est la loi de « L’Émerillon bigarré » ! dit un autre. Holà, dame Eliza ! Voici un nouveau client, et nous n’avons plus rien à boire.
– Je viens aux ordres, messeigneurs ! Bien entendu je prends votre commande, répondit la tenancière qui se précipita avec les mains pleines de gobelets de cuir. Que voulez-vous boire ? De la bière pour ceux de la forêt, de l’hydromel pour le ménestrel, une liqueur pour le chaudronnier, et du vin pour le reste de la compagnie. C’est une vieille coutume de la maison, jeune seigneur. Depuis de nombreuses années à « L’Émerillon bigarré » l’usage veut que la compagnie boive à la santé du dernier arrivant. Vous plaît-il de vous prêter à cette fantaisie ?
– Ma foi, bonne dame, répondit Alleyne, je ne voudrais pas manquer aux usages de votre maison, mais c’est peu de dire que ma bourse est mince. Toutefois jusqu’à concurrence de deux pence, je serai ravi de payer mon écot.
– Franchement parlé et bien dit, mon petit moine ! rugit une grosse voix.
Une lourde main s’appesantit sur l’épaule d’Alleyne. Levant les yeux il reconnut à côté de lui son ancien compagnon du couvent, l’ex-moine Hordle John.
– Par l’épine de Glastonbury, s’exclama-t-il, Beaulieu traverse une mauvaise passe ! En un jour les moines perdent les deux seuls hommes qu’abritaient leurs murs. Car je t’ai observé, jeunot, et je sais que malgré ce masque de bébé il y a en toi l’étoffe d’un homme. Il y a l’Abbé, aussi. Je ne suis pas de ses amis, ni lui des miens ; mais dans ses veines coule un sang chaud. C’est le seul homme qui reste là-bas. Les autres, que sont-ils ?
– De saints hommes ! répondit Alleyne gravement.
– De saints hommes ? Dis plutôt de saints choux ! Ou de saintes cosses ! Que font-ils d’autre que vivre et manger et s’engraisser ? Si c’est cela, la sainteté, je te montrerai des porcs dans la forêt qui seraient dignes de figurer en tête du calendrier. Crois-tu que c’était pour mener une existence pareille que ce bon bras a été ajusté à mon épaule, ou que ta tête a été placée sur ton cou ? Il y a des tas de choses à faire dans le monde, ami, et ce n’est pas en nous cachant derrière des murs de pierre que nous les ferons.
– Alors pourquoi es-tu allé chez les frères ? s’enquit Alleyne.
– À question raisonnable, réponse raisonnable. Je suis allé chez les frères parce que Margery Alspaye, de Bolder, a épousé Crooked Thomas, de Ringwood, et a laissé tomber un certain John de Hordle sous le prétexte qu’elle ne pouvait pas se marier avec le luron, l’énergumène et le vagabond que, paraît-il, je suis. Voilà pourquoi, moi, naïf et impulsif, j’avais quitté le monde ; et voilà pourquoi, ayant eu le temps de réfléchir, je suis rudement content de m’y retrouver à nouveau. Jour de malheur, celui où j’ai troqué mon justaucorps de petit propriétaire pour une robe blanche !
Pendant qu’il parlait, l’aubergiste était rentrée en portant un grand plateau de gobelets et de flacons pleins de bière brune ou de vin rouge. Derrière elle suivait une servante encombrée d’une pile d’assiettes en bois et d’une gerbe de cuillers, qu’elle distribua à la ronde. Deux forestiers, reconnaissables à leur doublet vert taché par les intempéries, retirèrent le grand chaudron du feu ; un troisième, armé d’une énorme louche d’étain, servit à chacun une part de viandes fumantes. Alleyne transporta sa portion et sa bière sur un tréteau dans un coin retiré ; de là il pouvait manger tranquillement et contempler cet étrange tableau qui différait des repas silencieux et bien ordonnancés auxquels il avait été habitué.
La salle ressemblait vaguement à une écurie, le plafond bas, noirci par la fumée, crasseux, était percé de plusieurs trappes auxquelles on accédait par des échelles. Les murs de planches n’étaient pas peints ; çà et là étaient fixées de grandes chevilles de bois d’où pendaient des manteaux, des bissacs, des fouets, des brides et des selles. Au-dessus de la cheminée six ou sept écus de bois, barbouillés d’armoiries, inégalement enfumés et sales, attestaient qu’ils avaient été accrochés à des époques différentes. Il n’y avait pas de meubles, en dehors d’un long dressoir supportant de vieilles poteries et de plusieurs bancs et tréteaux dont les pieds s’enfonçaient dans la molle argile du sol. Pour toutes lumières, celle du feu, plus trois torches enfoncées dans des godets fixés au mur ; elles vacillaient, elles crépitaient en dégageant une forte odeur de résine. Tout cela était neuf pour le jeune clerc. Mais le plus intéressant était le cercle des dîneurs autour du feu : tous des voyageurs modestes, tels qu’on aurait pu en trouver cette nuit-là dans toutes les auberges de l’Angleterre ; mais aux yeux d’Alleyne ils représentaient le monde inconnu contre lequel il avait été si fréquemment et si gravement mis en garde. Or, d’après ce qu’il voyait, ce monde-là ne ressemblait nullement à un lieu de perdition.
Trois ou quatre étaient certainement des gardes-chasses et des verdiers de la forêt ; ils étaient hâlés par le soleil, ils portaient la barbe, ils avaient l’œil vif et le geste prompt des cerfs en compagnie desquels ils vivaient. Dans l’angle de la cheminée se trouvait un ménestrel d’une quarantaine d’années, vêtu d’un costume défraîchi en drap de Norwich ; sa tunique était devenue si étroite qu’elle n’était attachée qu’au cou et à la taille ; il avait le visage rude et morne ; ses yeux jaunes, saillants, révélaient qu’il ne s’éloignait jamais longtemps d’un pot de vin ; sous un bras il maintenait une harpe dorée et tachée à laquelle il manquait deux cordes ; son autre main plongeait avidement dans son assiette. À côté de lui étaient assis deux hommes du même âge ; l’un avait une fourrure à son habit, qui lui conférait une dignité qui lui était plus chère que son confort, puisqu’il la gardait serrée en dépit de la chaleur du feu de bois ; l’autre, vêtu d’un costume roux souillé et d’un long pourpoint à basques, avait un visage de renard, des yeux perçants et une barbe maigrichonne. Son voisin était Hordle John. Puis venaient trois rudes gaillards malpropres avec des cheveux et des barbes hirsutes : c’étaient des travailleurs libres qui venaient des fermes voisines. (De petites propriétés foncières libres se disséminaient encore au cœur du domaine royal.) La compagnie était complétée par un paysan en peau de mouton et par un jeune homme habillé de clair : il portait une cape aux bords découpés, des chausses bariolées ; il regardait autour de lui avec dédain ; tandis qu’il maniait activement la cuiller, il tenait près de son nez un flacon de sels. Dans l’angle un obèse était étalé sur une botte de foin ; il ronflait comme un sonneur ; visiblement il était ivre mort.
– Voici Wat ! annonça la tenancière qui vint s’asseoir auprès d’Alleyne et qui désigna de sa louche le dormeur. C’est lui qui peint les emblèmes par ici. Hélas ! jamais je n’aurais dû être assez folle pour lui faire confiance ! Maintenant, jeune homme, quelle sorte d’oiseau pensez-vous qu’est l’émerillon bigarré qui est l’enseigne de mon auberge ?
– Un émerillon, dit Alleyne, c’est un oiseau qui ressemble à un aigle ou à un faucon. Je me rappelle que le Frère Bartholomew, initié à tous les secrets de la nature, m’en a montré un quand nous cheminions ensemble près de Vinney Ridge.
– Un faucon ou un aigle, vous dites ? Et bigarré, cela veut dire de plusieurs couleurs. N’importe qui affirmerait la même chose, sauf ce tonneau de mensonges. Il est arrivé ici, voyez-vous, et il m’a dit que si je voulais lui donner un gallon de bière, ce qui le fortifierait pendant son travail, et aussi des couleurs et une planche, il peindrait pour moi un bel émerillon bigarré que je pourrais accrocher en enseigne au-dessus de ma porte. Moi, pauvre crédule, je lui ai donné de la bière et tout ce qu’il a voulu ; et je l’ai laissé seul, parce qu’il m’a dit que lorsqu’un homme avait un chef-d’œuvre à exécuter il ne fallait pas lui distraire l’esprit. Quand je suis revenue, le gallon était vide et il était couché comme vous le voyez ; la planche était barbouillée de peinture. Regardez !…
Elle leva un panneau de bois qui était posé contre le mur, et exhiba l’image fort primaire d’une volaille anguleuse et décharnée, munie de pattes interminables et d’un corps tacheté.
– … Est-ce que ça ressemble à l’oiseau que vous avez vu ?
Alleyne secoua la tête ; il ne put s’empêcher de sourire.
– … Bien sûr que non ! reprit l’aubergiste. Ça ne ressemble à aucun oiseau qui ait jamais agité des plumes. On dirait plutôt un poulet plumé qui serait mort de méningite. Et de la scarlatine, par surcroît ! Que penseraient les gens comme il faut, Sir Nicholas Bornhunte, ou Sir Bernard Brocas de Rochecourt, s’ils voyaient une enseigne pareille ? Et le Roi ! Car le Roi passe souvent par ici, et il aime ses faucons comme il aime ses fils. Ce serait la ruine de mon établissement !
– L’affaire peut encore s’arranger, dit Alleyne. Je vous prierais, bonne dame, de me donner les pots de peinture et le pinceau, et je vais essayer de retoucher ce chef-d’œuvre.
Dame Eliza le considéra avec scepticisme, comme si elle redoutait une nouvelle ruse, mais elle réfléchit qu’il n’avait pas réclamé de bière ; aussi apporta-t-elle les peintures, et elle le surveilla pendant qu’il travaillait, tout en lui parlant des gens assis autour du feu.
– Les quatre garçons de la forêt, dit-elle, vont partir bientôt. Ils habitent à Emery Down, à deux kilomètres d’ici. Ils s’occupent des daguets de la chasse du Roi. Le ménestrel s’appelle Floyting Will. Il vient du nord, mais depuis plusieurs années il fait le tour de la forêt de Southampton à Christchurch. Il boit beaucoup et paie rarement ; mais il vous ferait mal aux côtes si vous l’entendiez chanter « La farce de Hendy Tobias ». Peut-être qu’il chantera quand la bière l’aura échauffé.
– Qui sont ses voisins ? demanda Alleyne très intéressé. Celui qui a un habit fourré possède une figure intelligente.
– Il vend des pilules et des baumes ; il est très instruit pour tout ce qui est humeurs, rhumatismes, flux et autres maladies. Vous voyez qu’il porte sur sa manche l’image de saint Luc, le premier médecin. Je prie le bon saint Thomas de Kent que je n’aie pas besoin de lui de sitôt ! Il s’est arrêté ici ce soir parce qu’il fait sa cueillette d’herbes dans les environs. À côté de lui c’est un arracheur de dents ; le sac qu’il porte à sa ceinture est rempli des dents qu’il a extraites à la foire de Winchester. Je jurerais bien qu’il y en a davantage de saines que de gâtées, car il travaille vite mais sa vue baisse. Quant à son voisin à cheveux roux, je ne le connais pas. Les quatre de ce côté sont des cultivateurs : trois sont au service du bailli de Sir Baldwin Redvers ; l’autre, à ce qu’on m’a dit, celui qui a la peau de mouton, est un serf des Midlands qui s’est enfui de chez son maître.
– Et l’autre ? chuchota Alleyne. Ce doit être un homme d’importance, pour regarder avec tant de dédain ses voisins.
L’aubergiste le contempla d’un œil paternel et secoua la tête.
– Vous n’avez guère l’habitude du monde, dit-elle. Autrement vous vous seriez aperçu que ce sont les petits hommes et non les grands qui pointent le nez en l’air avec cette insolence. Vous voyez ces écus sur le mur et vous avez vu ceux qui sont sous l’avancée du toit ? Chacun est l’emblème d’un noble seigneur ou d’un galant chevalier qui a dormi sous mon toit. Et bien, je n’ai jamais rencontré d’hommes plus doux ni plus faciles à servir : ils mangeaient mon bacon, ils buvaient mon vin avec le visage joyeux, et en réglant leur note ils me disaient une parole courtoise ou une plaisanterie qui m’était plus agréable que mon bénéfice. Voilà de vrais gens comme il faut ! Mais un colporteur ou un montreur d’ours jurera qu’il y a de la vase dans le vin et de l’eau dans la bière, et il décampera sur un juron. Ce jeune homme est un élève de Cambridge, là où les garçons se laissent tourner la tête par un peu de science et où ils perdent l’usage de leurs mains à force d’étudier les lois des Romains. Mais je dois à présent dresser les lits. Que les saints vous aident dans votre tâche !
Alleyne tira sa planche vers un endroit éclairé par l’une des torches, et il travailla avec l’ardeur et le plaisir de l’artiste, tout en prêtant l’oreille aux propos qui s’échangeaient autour du feu. Le paysan en peau de mouton, qui n’avait pas ouvert la bouche de toute la soirée, avait été si échauffé par la bière qu’il parlait maintenant d’une voix forte et coléreuse ; ses yeux lançaient des éclairs, il serrait les poings.
– Sir Humphrey Tennant d’Ashby peut bien labourer ses propres champs à ma place ! cria-t-il. Il y a trop longtemps que le château a étendu son ombre sur la chaumière. Depuis trois cents ans ma famille a sué de la sueur et des larmes, jour après jour, pour que du vin soit toujours servi sur la table du seigneur et qu’il ait un équipement sur le dos. Qu’il se débarrasse de sa vaisselle d’or et qu’il fouille le sol, puisqu’il faut fouiller le sol !
– Bien parlé, mon beau fils ! approuva l’un des cultivateurs indépendants. Si tous les hommes parlaient comme ça…
– Il voulait me vendre avec sa terre, poursuivit l’autre avec passion. Savez-vous ce qu’a dit le bailli ? « L’homme, la femme et leur fumier ! » Voilà ce qu’il a dit, ce gâteux. Jamais un bouvillon n’a été vendu sur la ferme avec tant de légèreté. Ah ! Peut-être s’éveillera-t-il quelque nuit avec des flammes qui lui lécheront les oreilles, car le feu est l’ami du pauvre, et j’ai vu un tas de cendres fumantes là où la veille encore se dressait un château aussi important que celui d’Ashby !
– Voici un enfant de métal ! cria un autre cultivateur. Il ose dire tout haut ce que tout le monde pense. Ne sommes-nous pas tous des descendants d’Adam, tous avec de la chair et du sang, tous avec la même bouche qui a besoin de manger et de boire ? Où est donc la différence entre la cape d’hermine et la tunique de cuir, puisqu’au-dessous le corps est le même ?
– Attention, Jenkin ! dit un autre. Notre ennemi se dissimule aussi bien sous une robe que sous le haubert. Nous avons à redouter autant de la tonsure que du casque. Frappe sur le noble et le prêtre hurle. Frappe sur le prêtre et le noble met la main à son épée. Ce sont deux voleurs jumeaux qui vivent sur notre travail.
– Il serait diablement malin, l’homme qui vivrait sur ton travail, Hugh ! observa l’un des gardes-chasses. Tu passes la moitié de ton temps à ingurgiter de l’hydromel à « L’Émerillon bigarré » !
– Cela vaut mieux que de voler des cerfs qui sont placés sous sa protection, comme certains que je connais bien.
– Si tu oses ouvrir contre moi ta bouche porcine, s’écria le garde, je te couperai les oreilles avant que le bourreau ait eu le temps de le faire, espèce d’écervelé !
– Allons, messires ! s’exclama dame Eliza d’une voix chantante et douce qui montrait que de telles discussions étaient monnaie courante parmi ses clients du soir. Pas de querelles, messires ! Veillez à la bonne réputation de la maison !
– D’ailleurs, si l’on en venait à se couper les oreilles, dit le troisième cultivateur, d’autres auraient leur mot à dire. Nous sommes tous des hommes libres, et je pense que le gourdin d’un petit fermier vaut largement le couteau d’un garde-chasse. Par saint Anselme ! Ce serait un jour de malheur si nous devions nous abaisser devant les serviteurs de nos maîtres comme devant nos maîtres !
– Personne n’est mon maître, sauf le Roi ! répondit le garde-chasse. Qui donc ici refuserait de servir le Roi d’Angleterre, sinon un traître ?
– Je ne connais pas le Roi d’Angleterre, déclara Jenkin. Quelle sorte de Roi d’Angleterre est-ce là, qui ne sait pas dire un mot d’anglais ? Vous vous rappelez qu’il descendit l’an dernier à Malwood, avec son sénéchal, son maréchal, son chancelier et ses vingt-quatre gardes. Vers midi je me trouvais près de la grille de Franklin Swinton quand il arriva au galop avec un grand chien de garde aux trousses. « Ouvre ! m’a-t-il crié en français. Ouvre ! » Et il m’a fait un signe pour que j’ouvre la grille. Et puis : « Merci ! », comme s’il avait peur de moi. Et vous parlez d’un Roi d’Angleterre !
– Je n’en suis pas surpris, s’écria l’élève de Cambridge de la voix aiguë et nasillarde qui était à la mode chez les étudiants. L’anglais n’est pas une langue pour les hommes bien nés et d’une éducation raffinée. C’est une stupide manière de parler ; on dirait qu’on renifle ou qu’on grogne. Pour ma part, je jure par le savant Polycarpe que je me sens plus à l’aise avec l’hébreu et aussi avec l’arabe.
– Je ne veux pas entendre un mot contre le vieux Roi Ned ! tonna Hordle John. Que m’importe qu’il aime un œil vif et un minois fripon ? Je connais l’un de ses sujets qui pourrait là-dessus rivaliser avec lui. S’il ne peut pas parler comme un Anglais, je dis qu’au moins il peut se battre comme un Anglais : il frappait aux portes de Paris pendant que des piliers de cabaret ronchonnaient et rotaient ici entre deux pots de bière.
Ces fortes paroles, prononcées par un homme d’aspect aussi formidable, domptèrent le camp des déloyaux qui firent soudainement silence. Du coup, Alleyne put suivre la conversation qui réunissait dans l’autre coin le médecin, l’arracheur de dents et le ménestrel.
– Un rat cru ! disait le spécialiste des baumes et onguents. Voilà ce que j’ai toujours recommandé contre la peste. Un rat cru avec sa panse ouverte.
– Ne pourrait-il pas être grillé, mon maître ? demanda l’arracheur de dents. Un rat cru, cela fait un plat triste !
– Mais un rat cru, pas pour être mangé ! cria le médecin du haut de son mépris. Pourquoi manger un rat cru ?
– Oui, au fait, pourquoi manger un rat cru ? s’enquit le ménestrel en vidant son gobelet d’un trait.
– Le rat cru doit être placé sur le mal ou la plaie. Car le rat, remarquez-le, est un animal immonde : il a donc une affinité certaine pour toutes les choses immondes, et toutes les humeurs vicieuses passent de l’homme dans cette bête.
– Est-ce que ce remède guérirait de la Peste Noire, mon maître ? interrogea Jenkin.
– Oui, bien sûr, mon beau fils !
– Alors je suis bien content que personne ne le sache ! La Peste Noire est la meilleure amie du pauvre peuple d’Angleterre.
– Comment cela ? questionna Hordle John.
– Voyons, ami ! Il est bien facile de voir que tu n’as pas travaillé de tes mains ; autrement tu ne m’aurais pas posé de question. Quand la moitié du peuple anglais est passée de vie à trépas, c’est alors que l’autre moitié a pu choisir son métier préféré et réclamer de bons gages. Voilà pourquoi je dis que la Peste Noire a été la meilleure amie des pauvres gens dans ce pays.
– C’est vrai, Jenkin ! dit un autre cultivateur. Mais tous les effets n’ont pas été aussi bons. Nous savons bien qu’à cause de la Peste Noire, des terres à blé ont été transformées en pâturages, si bien que là où travaillaient cent hommes qui gagnaient leur vie il n’y a plus qu’un simple berger qui fait paître ses moutons.
– Le mal n’est pas grand, observa l’arracheur de dents. Car les moutons font vivre beaucoup de gens. Il n’y a pas que le berger : il y a le tondeur, le marqueur au fer chaud, et puis l’apprêteur, le saleur, le teinturier, le fouleur, le tisserand, le marchand et bien d’autres !
– Et puisque nous en sommes là, dit l’un des gardes, leur mauvaise viande déchausse les dents et voilà un bénéfice pour celui qui peut les arracher.
Cette saillie dirigée contre le dentiste souleva un éclat de rire général. Le ménestrel en profita pour disposer sa harpe sur son genou et il attaqua une mélodie sur les cordes effilochées.
– Place pour Floyting Will ! crièrent les forestiers. Gratte-nous un air joyeux.
– Oui ! Les « Filles de Lancastre », suggéra un autre.
– Ou « Saint Siméon et le Diable » !
– Non ! La « Farce de Hendy Tobias » !
À toutes ces invitations le ménestrel ne répondit rien. Il fixa le plafond de ses yeux rêveurs, comme s’il cherchait à se rappeler des paroles. Puis, sur un geste large au-dessus des cordes, il entama une chanson si grossière et si stupide qu’avant la fin du premier couplet, notre jeune clerc bondit, le feu aux joues.
– Comment osez-vous chanter de pareilles choses ? s’écria-t-il. Vous, un homme âgé, qui devriez être un exemple pour les autres !
Ahuris, les voyageurs se tournèrent tous vers l’interrupteur.
– Par la Vierge de Hampole ! Notre clerc a retrouvé sa langue, déclara l’un des gardes. Qu’est-ce qui ne te plaît pas dans cette chanson ? Par quoi tes oreilles de bébé ont-elles été offensées ?
– Jamais on n’a chanté ici chanson plus pure et de meilleur goût ! cria un autre. Sommes-nous dans une auberge publique, oui ou non ?
– Vous faudra-t-il une litanie, mon saint clerc ? ironisa un troisième. Ou un hymne sera-t-il assez bon pour vous servir ?
Le ménestrel, fort en colère, avait reposé sa harpe.
– Un enfant va-t-il me faire la morale ? s’écria-t-il en fixant Alleyne d’un regard furieux. Un enfant qui n’a pas de poil au menton va-t-il me tenir tête, alors que j’ai chanté dans toutes les foires, de la Tweed à la Trent, et que j’ai été deux fois récompensé par la Haute Cour des Ménestrels à Beverley ? Je ne chanterai plus ce soir.
– Si, tu chanteras ! fit l’un des cultivateurs. Ho, dame Eliza ! Apportez à Will un pichet de votre meilleur[1] pour lui rafraîchir le gosier. Et reprends ta chanson, maintenant. Si notre clerc à tête de fille ne l’aime pas, il n’a qu’à filer et retourner d’où il vient.
– Pas si vite ! intervint Hordle John. Deux choses sont à considérer dans cette affaire. Il se peut que mon petit camarade ait eu le reproche un peu trop prompt, parce qu’il s’est trouvé de bonne heure au couvent et qu’il connaît peu les rudes manières et paroles de ce monde. Cependant il y a quelque chose de vrai dans ce qu’il a dit car, vous le savez bien, cette chanson n’est pas des plus honnêtes. Je le soutiendrai donc, et il ne s’en ira pas, mais ses oreilles ne seront pas offensées davantage.
– Vraiment, votre Haute et Puissante Grâce ? se moqua l’un des cultivateurs. Seriez-vous aussi ordonné ?
– Par la Vierge ! fit un second. Je crois que vous avez tous les deux une bonne chance de vous retrouver sur la route avant longtemps !
– Et suffisamment abîmés pour que vous soyez à peine capables de ramper dessus ! hurla un troisième.
– Non, je pars ! Je m’en vais ! dit précipitamment Alleyne à Hordle John quand il vit celui-ci relever ses manches et arborer des bras gros comme des gigots. Je ne veux pas que tu te querelles à cause de moi.
– Silence, mon garçon ! murmura Hordle John. Je me soucie d’eux comme d’une mouche. Ils risquent de s’apercevoir qu’ils ont plus de filasse sur leur quenouille qu’ils ne savent comment l’enrouler. Tiens-toi à l’écart, et laisse-moi le champ libre !
Les forestiers et les cultivateurs s’étaient levés. Dame Eliza et le médecin aux herbes s’étaient interposés entre les deux camps et multipliaient les mots apaisants, les gestes de conciliation. Mais la porte de « L’Émerillon bigarré » s’ouvrit brutalement, et l’attention de la compagnie se détourna de la querelle pour se fixer sur le nouveau venu qui s’annonçait aussi peu cérémonieusement.
CHAPITRE VI
Comment Samkin Aylward paria son lit de plumes
Il n’était ni grand ni petit ; mais sa charpente était massive, très robuste ; il avait le torse cambré et des épaules extraordinairement larges. Son visage rasé était aussi brun qu’une noisette ; le grand air l’avait tanné, séché ; ses traits durs ne tiraient nul adoucissement d’une longue cicatrice blanche qui s’étirait depuis le coin de la narine gauche jusqu’au bas de la mâchoire. Dans son regard clair et inquisiteur s’allumait une lueur à la fois autoritaire et menaçante. Le dessin de sa bouche était ferme comme il convenait à un volontaire du danger. Il portait une épée droite au côté, et un arc de guerre qui dépassait son épaule. Mais sa brigandine rapiécée et son casque bosselé attestaient qu’il n’était pas un soldat pour rire et qu’il venait de quitter les champs de bataille. Sa forte poitrine était couverte d’un surcot blanc au centre duquel s’étalait en rouge le lion de saint Georges. Un frais rameau de genêt sur un côté de son casque apportait une note de gaieté à son équipement menaçant.
– Ah, ah ! cria-t-il en clignant des yeux comme une chouette surprise par la lumière. Bonsoir à vous, camarades ! Holà ! Une femme, par mon âme ?…
En un instant il avait saisi dame Eliza par la taille et l’embrassait goulûment. Toutefois ayant aperçu la servante il abandonna sur-le-champ la patronne et enlaça la fille qui, toute confuse, grimpa par une échelle et rabattit la lourde trappe sur son poursuivant. Alors il retourna vers l’aubergiste et la salua encore une fois avec autant de soulagement que de satisfaction.
– … La petite a peur ! dit-il. Ah, c’est l’amour, l’amour ! Allons bon ! Je parle encore français : j’ai le français collé au gosier. Il faut que je le lave avec de la bonne bière anglaise. Par mon épée, camarades, je n’ai pas une goutte de sang français dans les veines, et je suis un loyal archer anglais. Je m’appelle Samkin Aylward, et je suis de Crooksbury. Je vous le dis, mes amis : je suis heureux de me sentir à nouveau sur le sol de la chère vieille patrie ! Quand j’ai débarqué tout à l’heure à Hythe, je me suis cassé en deux et j’ai baisé la bonne terre brune, aussi vrai que je vous embrasse maintenant, ma belle, car il y avait huit longues années que je ne l’avais vue. Son parfum m’aurait ressuscité, si ç’avait été nécessaire. Mais où sont mes six coquins ? Holà ! En avant !
Obéissant à l’ordre, six hommes, vêtus comme des débardeurs ordinaires, firent une entrée solennelle dans la salle. Chacun portait sur sa tête un gros ballot. Ils s’alignèrent militairement, tandis que le soldat se tenait face à eux pour vérifier leurs paquets d’un œil qui ne badinait pas.
– Numéro un ! Un lit de plumes français avec les deux courtepointes de cendal blanc.
– Ici, digne seigneur ! répondit l’un des porteurs en posant un grand paquet dans un coin.
– Numéro deux ! Sept aunes de drap rouge de Turquie et neuf aunes de drap d’or. Range-les près de l’autre. Bonne dame, je vous prie de servir à chacun de ces hommes un verre de vin ou un pot de bière. Là ! Une pièce entière de velours blanc de Gênes avec douze aunes de soie pourpre. Coquin ! Il y a de la saleté sur les bords. Tu as essuyé un mur, faquin !
– Pas moi, très digne seigneur ! protesta le porteur en reculant devant les yeux féroces de l’archer.
– Je te dis que si, chien ! Par les trois rois, j’ai vu des hommes mourir pour moins que cela ! Si tu avais traversé les épreuves que j’ai endurées pour acquérir ces objets, tu les traiterais avec plus de précaution. Je jure par les os de mes dix doigts qu’il n’y en pas un qui ne pèse son poids de sang français ! Numéro quatre ! Une navette, une aiguière d’argent, une boucle en or, et une chape bordée de perles. Je les ai trouvées, camarades, pendant le sac de Narbonne, dans l’église Saint-Denis, et je les ai emportées de peur qu’elles ne tombent entre des mains impies. Numéro cinq ! une cape de fourrure, un gobelet d’or avec un dessous et un couvercle, et une boîte de sucre rose. Pose le tout. Numéro six ! Trois livres d’orfèvrerie de Limoges, une paire de souliers ferrés en argent, et, enfin, toute une quantité de toile grattée. Voilà, le contrôle est terminé ! Voici une belle pièce. Vous pouvez disposer.
– Et aller où ? demanda l’un des porteurs.
– Où ? Au diable, si tu veux. Qu’est-ce que ça peut me faire ! Maintenant, ma belle, à souper. J’ai des couronnes dans ma bourse, ma douce, et j’entends les dépenser. Apportez du vin pendant que l’on me prépare un repas. Buvons, braves enfants ! Vous viderez bien un pot avec moi ?
C’était une invitation que refusaient rarement les clients d’une auberge anglaise. Les flacons furent rassemblés et remplis de nouveau jusqu’au col. Deux des forestiers et trois cultivateurs vidèrent d’un trait leur gobelet et partirent ensemble car il était tard et ils habitaient loin. Les autres se rapprochèrent en laissant la place d’honneur, à la droite du ménestrel au nouvel arrivant. Il avait retiré son casque et sa brigandine, et il les avait posés ainsi que son épée, son carquois et son grand arc peint, sur le butin qui avait été entassé dans un coin. À présent il étendait devant le feu ses jambes solides et légèrement arquées ; il dégrafait son justaucorps vert ; tenant un grand pot de vin dans sa main, il était la vivante image du bon et gai compagnon. Sa physionomie s’était détendue. Les boucles brunes qu’avait dissimulées son casque descendaient sur sa nuque de taureau. Il pouvait avoir quarante ans, mais son genre de vie avait sévèrement marqué son visage. Alleyne s’était arrêté de peindre son émerillon bigarré et, le pinceau à la main, il dévorait du regard cet homme qui ne ressemblait en rien à ceux qu’il avait connus. Il avait appris que les hommes étaient ou bons ou mauvais ; or il en voyait un qui était féroce un moment, et doux la seconde d’après, qui avait le juron sur les lèvres et un sourire dans le regard. C’était déconcertant !
Le soldat surprit l’examen du jeune clerc. Il leva son pot et but à sa santé en découvrant ses dents blanches.
– À toi, mon garçon ! s’écria-t-il. Tu n’as sans doute jamais vu un homme d’armes pour que tu me contemples ainsi ?
– Non, répondit Alleyne avec franchise. Mais j’ai souvent entendu parler de leurs faits et gestes.
– Par ma garde ! s’écria l’autre. Si tu traversais la mer, tu en verrais des quantités ! Tu ne pourrais pas décharger ton carquois dans n’importe quelle rue de Bordeaux sans épingler un archer, un écuyer ou un chevalier. On y compte plus de cuirasses que de robes, je t’assure !
– Et où as-tu fait cette belle récolte ? s’enquit Hordle John en désignant le butin entassé dans le coin.
– Là où le premier brave venu n’a qu’à se baisser pour ramasser. Là où un homme de valeur peut toujours gagner un bon salaire. Là où il n’a pas besoin d’un trésorier : il allonge le bras et se sert lui-même. Oui, c’est une bonne vie correcte ! Allons, je lève mon pot à la santé de mes vieux camarades. Que les saints soient avec eux ! Buvons tous ensemble, mes enfants, sous peine de mon déplaisir, à Sir Claude Latour et à la Compagnie Blanche !
– À Sir Claude Latour et à la Compagnie Blanche ! crièrent les voyageurs en vidant leurs gobelets.
– Bien lampé, mes braves ! Il m’appartient donc de remplir à nouveau vos gobelets puisque vous les avez vidés en l’honneur de mes chers enfants au justaucorps blanc. Holà, mon ange ! Du vin et de la bière ! Que dit le vieux refrain ?
« Nous boirons tous ensemble
À la plume de l’oie grise
Et au pays des oies grises. »
Il avait rugi plutôt que chanté, et il s’interrompit en éclatant de rire.
– Je crois que je suis meilleur archer que ménestrel ! fit-il.
– Il me semble que j’ai quelque souvenir de l’air, intervint le ménestrel en faisant courir ses doigts sur la harpe. Avec l’espoir que je ne vous offenserai pas, très saint seigneur…
Il lança un coup d’œil venimeux à Alleyne.
– … Et avec la permission de la société, je vais me hasarder.
Plus tard Alleyne Edricson devait se rappeler souvent cette scène, bien que d’autres, plus étranges et plus agitées, dussent se succéder dans sa vie. Le gros ménestrel, le groupe d’auditeurs, l’archer qui battait du doigt la mesure, l’énorme silhouette de Hordle John, tous éclairés par les lueurs rougeâtres du feu au milieu d’eux… Depuis il y songea fréquemment avec amour.
Pour l’instant il admirait l’habileté avec laquelle le jongleur éludait la difficulté de deux cordes manquantes, et la chaleur de sa voix quand il entonna la petite ballade des archers anglais sur le continent.
« Que dire de l’arc ?
L’arc vient d’Angleterre :
En bois loyal, en bois d’if,
Le bois des arcs anglais ;
C’est pourquoi les hommes libres
Aiment le vieil if
Et la terre où pousse l’if.
Que dire de la corde ?
La corde vient d’Angleterre :
Une corde dure, une corde solide,
Une corde qu’aiment les archers ;
C’est pourquoi nous viderons nos gobelets
En l’honneur du lin anglais
Et du pays où la corde a été tressée.
Que dire de la flèche ?
La flèche a été taillée en Angleterre :
Une longue flèche, une flèche solide,
Barbelée, équilibrée, précise ;
C’est pourquoi nous boirons tous ensemble
À la plume de l’oie grise,
Et au pays des oies grises.
Que dire des hommes ?
Les hommes sont nés en Angleterre :
Les archers, les cavaliers,
Les gars des vallons et des crêtes.
À votre santé ! À la vôtre !
Buvons aux cœurs loyaux
Et au pays des cœurs loyaux ! »
– Bien chanté, par ma garde ! cria l’archer ravi. Cette chanson-là, je l’ai entendue plus d’un soir, aussi bien en temps de guerre qu’après les combats, avec la Compagnie Blanche, lorsque Black Simon entonnait les couplets et que quatre cents des meilleurs archers qui aient jamais tendu une corde l’accompagnaient en chœur. J’ai vu le vieux John Hawkwood, celui qui a conduit la moitié de la Compagnie en Italie, rire dans sa barbe quand il l’entendait et rire, mes enfants, jusqu’à en faire cliqueter ses plates. Mais pour en apprécier toute la saveur, il faut être archer anglais et servir au loin sur une terre étrangère.
Pendant que le ménestrel avait chanté, dame Eliza et la servante avaient installé une planche entre deux tréteaux ; dessus elles avaient posé le couteau, la cuiller, le sel, le pain et enfin l’assiette fumante. L’archer s’installa avec l’air d’un homme qui savait ce que c’était de ne pas trouver toujours de la nourriture en abondance. Mais sa langue ne s’en arrêta pas pour autant.
– Ce qui me dépasse, dit-il, c’est que vous tous, qui êtes des gaillards robustes, vous puissiez rester chez vous à vous gratter le dos alors qu’il se passe tellement de choses outre-mer. Voyez : moi, qu’ai-je à faire ? Uniquement l’œil sur la corde, la corde à la flèche, et la flèche dans la cible. Un point, c’est tout. Exactement ce que vous faites vous-mêmes par plaisir le dimanche soir sur le champ de tir de la commune.
– Et la paye ? s’enquit un cultivateur.
– Voici ce que me rapporte la paye, répondit-il. Je mange le meilleur, et je bois sec. J’invite mon ami et je ne demande à personne de m’inviter. Je passe une robe de soie sur le corps de qui me plaît. Jamais femme de chevalier ne sera mieux parée. Tout ça vaut combien, mon garçon ? Et combien, le tas de bagatelles qui se trouvent dans ce coin ? Toutes ces babioles viennent du Midi de la France, toutes, où j’ai fait la guerre. Par mon épée ! Je crois, camarades, que mon butin peut parler à ma place.
– On dirait en effet un bon métier ! fit l’arracheur de dents.
– Tête bleue ! Oui, vraiment. Et puis il y a la chance d’une rançon. Tenez, dans l’affaire de Brignais, qui remonte à quatre ans, lorsque nous avons tué Jacques de Bourbon et passé son armée au fil de l’épée, bien rares étaient parmi nous ceux qui n’avaient pas un comte, un baron ou un chevalier. Peter Karsdale, qui n’était qu’un rustre ordinaire, et qui venait d’arriver chez nous (il avait encore des puces anglaises sous son doublet) a posé sa grosse patte de paysan sur le Sieur Amaury de Chatonville qui possède la moitié de la Picardie : il en a tiré cinq mille couronnes, plus le cheval et l’équipement. Il est vrai qu’une Française a tout repris à Peter, aussi vite qu’il avait été payé ; mais quoi ? Nom d’une corde d’arbalète, quel malheur si l’argent n’était pas fait pour être dépensé ! Et comment mieux le dépenser que pour une femme ? N’est-ce pas, ma belle ?
– Ce serait en vérité un grand malheur si nous n’avions pas nos braves archers pour rapporter au pays de l’argent et des mœurs aimables ! approuva dame Eliza.
Les franches manières du soldat avaient produit sur elle une forte impression.
– À toi, ma chérie ! dit-il en plaçant une main sur son cœur. Holà ! La petite me surveille derrière la porte. À toi aussi, ma petite ! Mon Dieu ! Mais elle a un teint frais…
– Il y a un point, digne seigneur, intervint l’élève de Cambridge de sa voix pointue, que je serais heureux que vous m’expliquiez. D’après ce que je sais, une paix a été conclue à Brétigny il y a six ans entre notre très gracieux souverain et le Roi de France. Cela étant, il me paraît extraordinaire que vous parliez si fort de guerre et de compagnies alors que nous sommes en paix avec les Français.
– Autrement dit, je suis un menteur ! dit l’archer en posant son couteau.
– Le ciel m’est témoin que je n’ai jamais voulu dire une chose pareille ! s’écria l’étudiant. Magna est veritas sed rara, ce qui signifie en latin que les archers sont tous des hommes honorables. Je vous ai interrogé parce que je cherche à savoir, et parce que ma profession est d’apprendre.
– Je crains que dans ta profession tu ne sois encore qu’un apprenti, répliqua le soldat. De l’autre côté de l’eau n’importe quel enfant pourrait en effet te répondre. Apprends donc que, bien qu’il puisse y avoir la paix entre nos provinces et les Français, la guerre sévit toujours dans les marches de France, car c’est un pays très divisé contre lui-même, qui est harcelé par des bandes d’écorcheurs, de pillards, de Brabançons, de tard venus, etc. Quand chacun essaie d’égorger son voisin, quand tous les barons à cinq sous la pièce marchent au roulement du tambour pour combattre n’importe qui, ce serait bien étrange si cinq cents braves garçons d’Angleterre ne pouvaient pas se débrouiller pour vivre. À présent que Sir John Hawkwood s’en est allé avec les Anglais de l’est et les bûcherons de Nottingham au service du marquis de Montferrat pour se battre contre le Sire de Milan, nous ne sommes plus que deux cents. Mais j’espère que je ramènerai avec moi de quoi combler les vides dans les rangs de la Compagnie Blanche. Par la dent de Pierre, ce serait bien dommage si je ne savais pas rassembler des hommes du Hamptonshire prêts à se battre sous le drapeau rouge de saint Georges, surtout si mon ancien maître Sir Nigel Loring, de Christchurch, coiffait à nouveau le haubert et prenait notre tête.
– Ah, vous auriez de la chance dans ce cas ! fit un forestier. Car on dit que, le Prince mis à part et peut-être aussi le bon vieux Sir John Chandos, personne dans l’armée ne rivalise avec lui en courage.
– Tu dis vrai, répondit l’archer. Avec ces deux yeux je l’ai vu sur de maudits champs de bataille, et jamais homme ne s’y est mieux conduit. Mon Dieu ! Oui, vous auriez tort de vous fier à sa taille, ou de vous laisser endormir par sa voix douce, car depuis près de vingt ans il n’y a pas eu d’escarmouche, d’assaut, de sortie, d’embuscade, d’escalade ni de bataille rangée sans que Sir Nigel n’y soit trouvé en plein cœur. Je me rends maintenant à Christchurch, avec une lettre de Sir Claude Latour qui lui demande s’il consentirait à prendre la place de Sir John Hawkwood ; et il acceptera d’autant plus facilement si je me fais escorter de deux ou trois hommes valables. Qu’en dis-tu, garde forestier ? Délaisseras-tu les chevreuils pour lâcher une flèche sur une plus noble cible ?
Le garde secoua la tête.
– J’ai femme et enfants à Emery Down, expliqua-t-il. Je ne les quitterais pas pour une pareille aventure.
– Et toi, jeune homme ? interrogea l’archer.
– Non, je suis un homme de paix ! répondit Alleyne Edricson. En outre, une autre tâche m’attend.
– Peste ! grogna le soldat en tapant sur le tréteau. Qu’est devenu, au nom du diable, le peuple ? Pourquoi restez-vous assis à mourir d’ennui au coin du feu, comme des corbeaux autour d’un cheval mort, alors que du travail d’homme vous attend à quelques lieues d’ici ? Dites plutôt que vous êtes tous des bons à rien, des fainéants ! Par ma garde ! Je crois que tous les hommes d’Angleterre sont déjà en France et que ceux qui restent ne sont que des femmes qui portent chausses !
– Archer, dit Hordle John, tu as menti plus d’une fois, et plutôt trois fois que deux. Voilà pourquoi, et aussi parce que certaines choses en toi me déplaisent, je suis diablement tenté de te faire toucher les deux épaules.
– Par mon épée ! Enfin je trouve un homme ! cria l’archer. Et, devant Dieu, je dis que tu seras encore meilleur que je ne le suppose si tu peux me faire toucher les deux épaules, mon garçon ! Depuis sept ans je n’ai trouvé personne à la Compagnie qui ait été capable de salir mon justaucorps.
– Assez de vantardises ! fit Hordle John en se levant et en se débarrassant de son doublet. Je vais te montrer qu’il reste en Angleterre de meilleurs hommes que ceux qui s’en sont allés en France voler et piller.
– Pasques Dieu ! cria l’archer en dégrafant son justaucorps et en toisant son adversaire avec le regard aigu de quelqu’un qui s’y connaît en hommes. Je n’avais vu jusqu’ici qu’une fois un corps pareil Avec ta permission, rouquin mon ami, je serais désolé d’échanger des coups de poing avec toi ; et je soutiens que personne à la Compagnie ne te défierait pour tirer sur la corde. Que cela soit un baume pour ton orgueil ! D’autre part, j’ai l’impression que tu as mené une vie tranquille ces derniers mois et que mes muscles sont plus durs que les tiens. Je suis prêt à parier sur ma chance contre toi, si tu n’as pas peur.
– Peur ? grogna le gros John. Je ne sais pas comment est fait le visage d’un homme dont j’aurais peur. Allons ! Nous verrons bientôt qui est le plus fort de nous deux.
– Mais l’enjeu ?
– Je n’ai rien à parier. Allons-y ! Pour l’amour et le plaisir du sport !
– Rien à parier ? s’exclama l’homme d’armes. Comment, mais tu possèdes ce que je convoite par-dessus tout ! C’est ton grand corps costaud que je veux… Écoute-moi, mon garçon : j’ai ici un lit de plumes français, que j’ai eu bien du mal à ramener. Je l’ai conquis pendant le sac d’Issoudun, et le Roi lui-même n’en a pas de semblable. Si tu me terrasses, il est à toi. Mais si je te terrasse, alors tu me jures de venir avec moi en France où tu serviras dans la Compagnie Blanche aussi longtemps que nous serons mobilisés.
– Un bel enjeu ! s’écrièrent les voyageurs qui reculèrent les bancs pour laisser du champ aux lutteurs.
– Alors, tu peux dire adieu à ton lit, soldat ! dit Hordle John.
– Non. Je garderai le lit et je t’emmènerai en France malgré ta grosse voix, et tu passeras ta vie à m’en remercier. À quoi allons-nous jouer, mon enfant ? Au col et au coude, à la clef serrée, au catch ?
– Va au diable avec tes ruses ! répondit John en ouvrant et refermant ses grosses mains rouges. Avance, et à qui fera tomber l’autre.
– Alors apprête-toi à manger de la poussière ! L’archer s’avança dans l’espace dégagé sans perdre de vue son adversaire. Il avait retiré son justaucorps vert, et son torse n’était couvert que d’un gilet de soie rose décolleté et sans manches. Hordle John était nu jusqu’à la ceinture ; ses gros muscles saillaient comme les racines d’un chêne : il dominait l’archer en hauteur. Mais celui-ci, bien que plus petit de trente centimètres, était très fort, rapide sur ses jambes et adroit ; à voir son port de tête et la lueur dans son regard, il était évident qu’il croyait en sa victoire. Il aurait été difficile cette nuit-là, n’importe où en Angleterre, de trouver deux adversaires plus dignes l’un de l’autre.
Le gros John attendait au milieu ; il avait l’œil mauvais, menaçant ; ses cheveux roux étaient en bataille. L’archer s’avança d’un pas vif et léger d’abord vers la droite, puis vers la gauche, en ployant les genoux et les mains en avant. Soudain, dans un élan si prompt et si hardi que les spectateurs eurent du mal à le suivre, il vola sur son rival et passa une jambe autour de lui. Entre deux hommes d’égale force, une telle prise aurait entraîné la chute ; mais Hordle John se débarrassa de lui comme d’un rat et le projeta à travers la salle ; la tête de l’archer alla rebondir contre le mur.
– Ma foi ! cria-t-il en passant un doigt dans ses boucles de cheveux. Tu n’as pas été loin du lit de plumes, mon gars ! Bientôt cette bonne hôtellerie aura une fenêtre de plus.
Nullement dompté, il s’approcha encore une fois de son adversaire, mais avec plus de précautions. Il feinta court, surprit la garde de l’autre, et bondit : il lança en avant ses jambes autour de la taille de HardIe John et ses bras autour du cou de taureau, avec l’espoir de le faire tomber sous la violence du choc. Le gros John, soufflant de rage, le saisit entre ses bras énormes, le leva en l’air et le rejeta vers le plancher avec une force qui aurait pu lui fendre les os si l’archer, plein de sang-froid, ne s’était pas suspendu à ses avant-bras pour ne pas tomber ; il se laissa choir sur ses pieds et se maintint en équilibre au prix d’un effort qui fit craquer toutes ses jointures. Il recula d’un bond, mais son redoutable adversaire, échauffé par le combat, s’élança à son tour et par cette imprudence fournit au lutteur entraîné l’occasion attendue. Quand le gros John se jeta sur lui, l’archer plongea sous les grosses mains rouges qui s’avançaient pour le saisir et, attrapant son homme par les cuisses, le fit basculer par-dessus son épaule. Alleyne eut l’impression que John volait avec des ailes. Pendant qu’il fendait l’air de ses membres géants, le clerc eut très peur : jamais certainement un homme ne pourrait se tirer indemne d’une chute pareille ! En vérité, tout aussi robuste que fût John, il se serait rompu le cou s’il n’avait atterri la tête la première dans le creux de l’estomac de l’ivrogne qui sommeillait paisiblement dans son coin sans se douter le moins du monde des incidents extraordinaires qui se déroulaient près de lui. L’infortuné artiste, brusquement tiré de ses rêves, se redressa en poussant un cri perçant. Hordle John, lui, avait bondi au milieu de la salle, presque aussi rapidement qu’il en avait été éjecté.
– Encore une reprise, par tous les saints ! s’écria-t-il en tendant les bras.
– Pas moi dit l’archer en se rhabillant. Je me suis tiré d’affaire. Je préférerais lutter contre le grand ours de Navarre !
– C’était une ruse ! protesta John.
– C’était une ruse, oui. Par les os de mes dix doigts, une ruse qui rapporte à la Compagnie un homme tout à fait convenable.
– Oh, pour cela, je m’en soucie comme d’une guigne ! Il y a une bonne heure que je m’étais juré de t’accompagner, puisque tu me proposais une existence agréable. Mais j’aurais bien voulu avoir le lit de plumes !
– Je n’en doute pas, mon ami ! répondit l’archer en retournant à son gobelet. À ta santé, mon garçon, et puissions-nous être bons camarades ! Mais holà, qu’est-ce qui tourmente notre ami à la triste figure ?
Le malheureux artiste s’était assis, s’était frotté le corps d’un air morose et avait promené sur l’assistance un regard vide ; visiblement il ne savait ni où il était ni ce qui lui était arrivé. Tout à coup un éclair d’intelligence était passé sur ses traits empâtés, et il s’était levé. À présent il se dirigeait en titubant vers la porte.
– Attention à la bière ! dit-il en brandissant un doigt pour avertir la société. Ô sainte Vierge, méfiez-vous de la bière !
Il se frotta encore l’estomac et s’éclipsa dans l’obscurité sous les rires, auxquels se joignit le vaincu autant que son vainqueur. Le garde-forestier et les deux cultivateurs ne tardèrent pas à reprendre la route ; les voyageurs se partagèrent les couvertures que dame Eliza et sa servante avaient disposées sur le plancher. Alleyne, épuisé par toutes les émotions de sa journée, s’endormit aussitôt et son profond sommeil ne fut troublé que par des visions de jambes en l’air, de mendiants avec l’injure à la bouche, de bandits nègres, et des curieux visages qu’il avait vus à « L’Émerillon bigarré ».
CHAPITRE VII
Comment les trois compagnons voyagèrent à travers bois
Dès l’aube l’auberge avait ressuscité à la vie. En ce temps-là où l’éclairage coûtait cher, il était rare qu’une heure de lumière du jour fût gaspillée. Mais même quand dame Eliza commença à s’agiter, certains de ses hôtes avaient été encore plus matinaux : en effet la porte était entrouverte et le distingué élève de Cambridge avait pris la poudre d’escampette, trop absorbé sans doute par les problèmes élevés de l’antiquité pour s’abaisser à réfléchir aux quatre pence qu’il devait pour son lit et sa nourriture. Les cris aigus que poussa l’aubergiste quand elle découvrit sa perte et le caquetage des poules qui s’étaient introduites par la porte entrebâillée tirèrent les dormeurs de leur sommeil.
Une fois levée, la société ne tarda pas à se disperser. Une mule luisante de santé, harnachée de rouge, fut menée d’une écurie voisine pour le médecin qui partit à l’amble avec une grande dignité sur la route de Southampton. L’arracheur de dents et le ménestrel se firent servir un gobelet de bière avant de se diriger ensemble vers la foire de Ringwood ; le vieux jongleur avait l’œil jaune et les traits tirés à la suite de ses libations nocturnes. Par contre l’archer, qui avait bu davantage que les autres, était gai comme un pinson ; après avoir embrassé dame Eliza et pourchassé la servante qui dut grimper une nouvelle fois à l’échelle pour lui échapper, il alla se laver dans le ruisseau et revint avec de l’eau qui dégouttait encore de son visage et de ses cheveux.
– Holà, homme de paix ! cria-t-il à Alleyne. De quel côté diriges-tu tes pas, ce matin ?
– Je m’en vais à Minstead, répondit le clerc. Mon frère Simon Edricson y habite et je compte séjourner chez lui quelque temps. Je vous prie, ma bonne dame, de me préparer mon compte.
– Votre compte ! s’exclama-t-elle en contemplant le tableau qu’avait peint Alleyne la veille au soir. Dites plutôt que c’est moi qui suis en compte avec vous, bon jeune homme ! Voilà enfin un émerillon bigarré, qui tient un levraut entre ses serres, aussi vrai que je suis une femme et que je vis ! Par la croix de Waltham, comme la peinture est adroite, et délicate !
– Regardez son œil rouge ! renchérit la servante.
– Oui, et le bec entrouvert !
– Et l’aile aux plumes hérissées, ajouta Hordle John.
– Par mon épée ! cria l’archer. C’est l’oiseau tout vivant.
Le jeune clerc rougit de plaisir sous cette avalanche de compliments, peut-être sommaires et manquant de discernement, mais bien plus chaleureux et spontanés que ceux qu’avaient pu lui adresser le Frère Jérôme qui critiquait toujours et l’Abbé aux phrases brèves. Il lui apparut que dans ce monde la bonté ne le cédait en rien à la méchanceté. Son hôtesse ne voulut rien accepter ni pour le lit ni pour la nourriture. L’archer et Hordle John s’emparèrent chacun d’un bras d’Alleyne et le conduisirent devant le comptoir où un peu de poisson fumé, un plat d’épinards et une jarre de lait allaient constituer leur petit déjeuner.
– Je ne serais pas surpris d’apprendre, camarade, lui dit le soldat tout en posant sur le tranchoir d’Alleyne un morceau de poisson, que tu es capable de lire des choses écrites, puisque tu es si adroit à manier le pinceau et les couleurs.
– Ce serait une honte pour les bons frères de Beaulieu si j’en étais incapable, répondit-il, puisque j’ai été leur clerc pendant ces dix dernières années.
L’archer le considéra avec un grand respect.
– Voyez cela ! fit-il. Et tu n’as pas de poil au menton et tu as une peau de fille… Moi, avec le petit joujou que j’ai là, je peux toucher une cible à trois cent cinquante pas, et avec le grand arc de guerre à quatre cent vingt pas. Et cependant je ne sais pas peindre, et je ne pourrais pas lire mon propre nom si tu écrivais « Sam Aylward » sous mon nez. Dans toute la Compagnie, il n’y avait qu’un seul homme qui sût lire, et il s’est fait tuer à la prise de Ventadour : ce qui prouve que l’instruction, si utile à un clerc, est bien inutile à un militaire.
– J’ai quelques notions, dit le gros John. Mais je suis trop peu resté chez les moines pour tout connaître.
– Voici quelque chose qui va te mettre à l’épreuve, sourit l’archer qui tira de l’intérieur de sa tunique un carré de parchemin.
Une large bande de soie pourpre en faisait le tour, et elle était scellée aux deux extrémités par un grand cachet rouge. John se pencha avec gravité sur l’inscription qui était portée au dos ; pendant longtemps il demeura avec ses sourcils froncés et le front soucieux comme quelqu’un qui se livre à un gros effort intellectuel.
– Je n’ai rien lu récemment, avoua-t-il et je ne puis pas dire ce que cela signifie. Il me semble qu’il y a plusieurs interprétations, tout comme un archer préfère l’if et un autre archer le frêne. D’après son aspect et sa longueur, je déduis qu’il s’agit d’un verset d’un psaume.
L’archer secoua la tête.
– C’est peu vraisemblable, dit-il. Je ne crois pas que Sir Claude Latour me fasse faire tant de chemin pour un verset de psaume. Tu es passé cette fois à côté de la cible, camarade ! Donne-le à cet enfant. Je parie mon lit de plumes qu’il va nous l’expliquer.
– C’est écrit en français, dit Alleyne. Et d’une belle écriture moulée. Voici ce que je lis : « Au moult puissant et moult honorable chevalier, Sir Nigel Loring de Chrischurch, de son très fidèle ami Sir Claude Latour, capitaine de la Compagnie Blanche, châtelain de Biscar, grand seigneur de Montchâteau, vavasseur du renommé Gaston, comte de Foix, tenant les droits de la haute justice, de la moyenne et de la basse ».
Il la traduisit en anglais ; l’archer poussa un cri de joie.
– Voilà ! s’exclama-t-il. C’est exactement ce qu’il aurait dit !
– Oui, dit Hordle John en examinant une nouvelle fois le parchemin, c’est exactement cela. Mais je ne comprends pas cette haute justice, cette moyenne et cette basse.
– Par ma garde, tu la comprendrais si tu étais Jacques Bonhomme ! La basse justice signifie que tu peux le dépouiller, la moyenne que tu peux le torturer, la haute que tu peux le tuer. Rien de plus vrai ! Mais c’est cette lettre que je dois porter à destination. Puisque nous n’avons plus rien à manger ni à boire, il est temps que nous nous mettions en route. Mon gros John, tu m’accompagnes. Et toi, jeune enfant, où m’as-tu dit que tu allais ?
– À Minstead.
– Ah oui ! Je connais ce pays de forêts, bien que je sois né près du village de Midhurst. Je n’ai rien à dire contre les hommes du Hampton, car il n’y a pas de meilleurs compagnons ni de plus solides archers dans toute la Compagnie que certains qui ont appris à détendre la corde dans cette région. Nous irons ensemble jusqu’à Minstead, car c’est presque sur notre chemin.
– Je suis prêt ! acquiesça Alleyne tout content de la perspective d’une telle compagnie.
– Mais moi je ne le suis pas. Je vais laisser mon butin à cette auberge, puisque l’hôtesse est une honnête femme. Holà, ma chérie ! Je désire vous confier mon orfèvrerie, mon velours, ma soie, mon lit de plumes, ma navette, mon aiguière, mon tissu et le reste. Je ne prends avec moi que l’argent dans ce sac et la boîte de sucre rose, qui est un présent de mon capitaine pour Lady Loring. Puis-je vous demander de veiller sur mes trésors ?
– Je vais les ranger dans ma soupente la plus sûre, brave archer. Revenez quand vous le voudrez, vous trouverez tout à votre disposition.
– Voilà une bonne amie ! s’écria l’archer en lui prenant la main. La terre anglaise avec les femmes d’Angleterre, je dis, et le vin de France avec le butin français. Je reviendrai bientôt, mon ange. Je suis célibataire, ma douceur, et quand la guerre sera finie, je devrai m’établir quelque part. Peut-être vous et moi… Ah, méchante ! La petite nous surveille derrière la porte. Maintenant, John, le soleil est au-dessus des arbres. Il faudra que tu sois un peu plus prompt quand le bugle sonnera « Archer, lève-toi… »
– Il y a une heure que je t’attends ! répliqua Hordle John d’un ton bourru.
– Alors, partons ! Adieu, ma vie. Ces deux livres solderont l’addition et paieront en sus quelques rubans à la prochaine kermesse. N’oubliez pas Sam Aylward, car son cœur vous appartient pour toujours… Et à toi aussi, petite ! Allons, en marche ! Et que saint Julien nous procure partout un aussi bon cantonnement !
Le soleil avait grimpé au-dessus des bois d’Ashurst et de Denny ; il brillait clair, mais le vent d’est secouait les feuilles sur les arbres. Dans la grand-rue de Lyndhurst nos voyageurs durent se frayer le passage, car la petite ville était pleine de gardes, de grooms et de piqueurs attachés à la chasse du Roi. Le Roi en personne était descendu au château de Malwood, mais une partie de sa suite avait été contrainte de chercher un billet de logement dans les chaumières ou dans les petites maisons en torchis du village. Ici et là un écusson affiché devant une fenêtre sans vitres indiquait qu’un chevalier ou un baron s’était installé pour la nuit. Ces armoiries pouvaient être déchiffrées mieux qu’un parchemin, et l’archer comme la plupart des hommes de son époque connaissait à fond les symboles héraldiques.
– Voici la tête de Maure de Sir Bernard Brocas, commentait-il. Je l’ai vu il y a une dizaine d’années à la bataille de Poitiers ; il se comporta comme un homme. Il est le chef de la cavalerie du Roi et à l’occasion il est capable d’entonner un refrain jovial ; pourtant il ne pourrait rivaliser avec Sir John Chandos qui est le premier à table ou en selle. Trois merlettes sur champ d’azur : ce doit être l’un des Luttrell. Étant donné le croissant qui y figure, il devrait s’agir du deuxième fils du vieux Sir Hugh qui attrapa une flèche dans la cheville à la prise de Romorantin : trop pressé de se ruer dans la bagarre, il n’attendit pas que son écuyer eût agrafé ses jambières. Voilà la plume qui est l’antique emblème des de Bray. J’ai servi sous Sir Thomas de Bray qui était gras comme un pâté et qui mania admirablement l’épée jusqu’à ce qu’il devînt obèse.
L’archer bavardait sur ce thème pendant que les trois compagnons se faufilaient parmi des chevaux qui piaffaient, des valets qui couraient, et des groupes de pages et d’écuyers qui discutaient avec passion des mérites respectifs des écuries et des chenils de leurs maîtres. Lorsqu’ils passèrent devant la vieille église qui se dressait à main gauche dans le village, ils virent le portail ouvert : un flot de dévots s’écoulait sur le chemin en pente ; ils venaient d’entendre la messe et ils jacassaient comme une compagnie de geais. Alleyne ploya le genou et se découvrit ; mais avant qu’il eût terminé un ave, ses camarades avaient disparu derrière un tournant, et il dut courir pour les rattraper.
– Comment ! s’étonna-t-il. Pas un mot de prière devant la maison de Dieu ? Comment pouvez-vous escompter sa bénédiction pour la journée ?
– Mon ami, répondit Hordle John, j’ai tant prié pendant ces deux derniers mois, et non seulement pendant le jour, mais aussi à matines, à laudes, etc., alors que je pouvais à peine remuer la tête, que je me sens comme si j’avais quelque peu abusé des prières.
– Comment peut-on avoir trop de religion ? s’écria Alleyne sur un ton passionné. C’est la seule chose qui compte. Un homme n’est qu’une bête féroce, s’il vit au jour le jour pour manger et pour boire, pour respirer et pour dormir. C’est seulement quand il s’élève et quand il prend conscience de l’esprit immortel qui est en lui qu’il devient un vrai homme. Considérez comme il serait affligeant que le sang du Rédempteur eût été versé en vain !
– Béni soit l’enfant ! cria l’archer. Il rougit comme une fille et il prêche comme tout un Sacré Collège !
– Pour dire vrai, je rougis de ce que quelqu’un d’aussi faible et indigne que moi essaie d’enseigner à autrui une voie qu’il a lui-même bien du mal à suivre.
– Gentiment dit, mon garçon ! En ce qui concerne la mise à mort du Rédempteur, ç’a été une vilaine affaire. Un bon Père nous a lu en France un parchemin authentique sur cette histoire. Les soldats se sont emparés de Lui dans le jardin. En vérité Ses apôtres étaient peut-être de saints hommes, mais ils ne valaient pas grand-chose en tant qu’hommes d’armes. Tout de même il y en a eu un, le sieur Pierre, qui a dégainé ; mais, à moins qu’il n’ait été calomnié, il n’a fait que couper l’oreille d’un valet, ce qui n’était guère chevaleresque. Par les os de mes dix doigts ! Si j’avais été là, avec Black Simon de Norwich et une vingtaine d’hommes choisis de la Compagnie, nous les aurions tenus en respect. Et même si nous n’avions pas pu faire davantage, nous aurions décoché à ce chevalier déloyal, le sieur Judas, tant de flèches anglaises qu’il aurait à jamais maudit le jour où il exécuta une telle mission.
Le jeune clerc sourit.
– S’Il avait voulu de l’aide, dit-il, Il aurait eu à sa disposition des légions d’archanges venues du ciel ; mais quel besoin aurait-Il eu de vos pauvres arcs et de vos pauvres flèches ? D’ailleurs souviens-toi de Ses paroles : « Celui qui vivra par l’épée périra par l’épée ».
– Et quelle mort pourrait être plus belle ? demanda l’archer. Si je souhaite quelque chose, c’est de mourir ainsi. Non pas, comprends bien, dans une petite embuscade tendue à la Compagnie, mais sur le champ de bataille, avec la grande bannière du lion déployée au-dessus de nos têtes et l’étendard rouge en avant, au milieu des cris de mes amis et de la vibration des cordes. Mais il faudrait que ce soit une épée, une lance ou une flèche qui me fasse mordre la poussière. Car je serais honteux d’être tué par un boulet de fer projeté par une pétoire à feu ou par une bombarde ou par n’importe quelle arme aussi peu digne d’un soldat, et tout juste bonne à effrayer les bébés par le bruit et la fumée.
– Même dans mon couvent, dit Alleyne, j’ai beaucoup entendu parler de ces terribles machines nouvelles. On m’a affirmé, mais je le crois difficilement, qu’elles peuvent expédier un boulet deux fois plus loin qu’un archer sa flèche, et avec une telle force qu’il peut pénétrer à travers l’armure d’un soldat.
– C’est vrai, mon enfant. Mais pendant que l’armurier prend son boulet du diable, l’enfourne et allume sa mèche, je peux facilement lui décocher six flèches, peut-être huit, si bien qu’en fin de compte son avantage n’est pas grand. Pourtant je ne nie pas que pour la prise d’une ville il est préférable d’avoir des bombardes. Il paraît qu’à Calais elles ont fait dans les murailles des trous assez grands pour qu’un homme y puisse passer la tête. Mais dites-moi, camarades, nous avons été précédés par quelqu’un qui a été grièvement blessé !
En effet, une véritable piste de sang s’allongeait : c’était tantôt de simples gouttes, tantôt de larges caillots rougeâtres. Les feuilles mortes et les silex blancs en étaient tout éclaboussés.
– Un chevreuil blessé ? suggéra John.
– Non. Je suis suffisamment homme des bois pour voir qu’aucun chevreuil n’est passé par là ce matin. Et le sang est frais. Mais écoutez !
Ils penchèrent la tête tous les trois. Du silence de la forêt jaillit une sorte de crissement, de sifflement auquel se mêlaient des gémissements plaintifs, et la voix d’un être humain s’éleva dans une mélopée frémissante. Ils se précipitèrent ; ils escaladèrent une petite hauteur et aperçurent sur l’autre versant l’origine de ces bruits étranges.
Un homme de grande taille, mais voûté, marchait lentement, la tête basse et les mains jointes au milieu du sentier. Il était habillé des pieds à la tête d’une longue pièce de drap blanc, et coiffé d’un grand capuchon orné d’une croix rouge. Sa robe était rabattue sur ses épaules, et sa chair avait de quoi donner le frisson car elle était réduite en pulpe ; le sang coulait dans sa robe et s’égouttait sur le sol. Derrière lui avançait un homme plus petit, grisonnant, et vêtu de la même tenue blanche. Il chantait en français de longues lamentations en vers et, à la fin de chaque vers, il levait une grosse corde munie de grains de plomb pour frapper son compagnon entre les deux épaules jusqu’à ce que le sang jaillît de nouveau. Tandis que nos trois voyageurs écarquillaient les yeux à ce spectacle, un changement s’opéra tout à coup : le petit homme ayant fini sa mélopée défit sa robe et tendit la discipline à l’autre, lequel entonna le même chant plaintif et se mit à flageller son compagnon de toute la vigueur de son bras. Ainsi, alternativement fouettant et fouettés, ils poursuivirent leur route douloureuse à travers les bois magnifiques, sous les voûtes de hêtres, dans un décor où la force et la majesté sereine de la nature devaient être choquées par une énergie virile aussi mal employée.
Hordle John et Alleyne Edricson n’avaient jamais rien vu de pareil.
– Ce sont les moines que l’on appelle les Flagellants, expliqua l’archer. Je suis surpris que vous n’en ayez pas déjà rencontré, car de l’autre côté de l’eau les Flagellants sont aussi nombreux que les frères mendiants. On m’a dit qu’il n’y avait pas d’Anglais dans leur ordre, mais qu’ils étaient tous originaires de France, d’Italie et de Bohème. En avant, camarades ! Rejoignons-les afin de bavarder avec eux.
Quand ils s’approchèrent, Alleyne entendit la complainte que chantait le flagellant en abattant son fouet à la fin de chaque vers, et que rythmaient les gémissements du flagellé. C’était du vieux français ; à peu près ceci :
« Or avant, entre nous tous frères
Battons nos charognes bien fort
En remembrant la grand misère
De Dieu et sa piteuse mort,
Qui fut pris en la gent amère
Et vendu et trais à tort
Et bastu sa chair, vierge et dère.
Au nom de ce battons plus fort. »
À cet endroit le fouet changeait de main.
– En vérité, Révérends Pères, dit l’archer en français, vous vous êtes assez flagellés pour aujourd’hui ! La route est ensanglantée comme un abattoir pour la saint Martin. Pourquoi vous maltraitez-vous de la sorte ?
– Pour vos péchés, pour vos péchés ! débitèrent-ils d’une même voix traînante.
Ils regardèrent les voyageurs avec des yeux éteints et tristes, puis ils se remirent à leur épuisante besogne sans écouter davantage les prières et adjurations qui leur étaient adressées. Devant l’inutilité de leurs remontrances, les trois camarades reprirent leur route et abandonnèrent ces étranges pénitents à leur manie.
– Mort Dieu ! cria l’archer. J’ai bien répandu un bon gobelet de mon sang en France, mais ç’a toujours été en combat, et j’y réfléchirais à deux fois avant de le faire couler goutte à goutte comme ces religieux. Par ma garde, notre enfant est aussi blanc qu’un fromage de Picardie ! Qu’est-ce qui ne va pas, mon cher ?
– Ce n’est rien, répondit Alleyne. J’ai mené une existence trop tranquille. Je ne suis pas accoutumé à de tels spectacles.
– Ma foi, s’écria le soldat, je n’ai encore jamais vu quelqu’un qui soit si fort en paroles et si faible de cœur !
– Tu te trompes, ami ! intervint le gros John. Il ne s’agit pas de faiblesse de cœur, car je le connais bien. Son cœur est aussi courageux que le tien ou le mien, mais il possède plus de choses dans sa caboche que tu n’en acquerras jamais sous ta boîte en fer blanc ; aussi peut-il plonger plus profond dans la vie, et elle pèse davantage sur lui que sur nous.
– C’est assurément un triste spectacle, dit Alleyne, que de voir ces saints hommes, qui ne sont pas pécheurs eux-mêmes, souffrir pour les péchés d’autrui. Ce sont des saints, en admettant qu’à cette époque un homme puisse mériter cette épithète.
– Je les considère comme moins que rien ! s’écria Hordle John. Car qui est meilleur après tous ces coups de fouet et ces miaulements de chat écorché ? Ils sont comme les autres moines, je parie, quand ils ont fini de se flageller. Qu’ils laissent donc leurs dos, et qu’ils chassent l’orgueil de leur cœur !
– Par les trois rois, il y a du vrai dans ce que tu dis ! fit l’archer. En outre, si j’étais le bon Dieu, cela ne me ferait guère plaisir de voir un pauvre diable s’arracher la chair des os ; et je penserais qu’il n’aurait qu’une bien médiocre opinion de moi en espérant me plaire par ce travail de grand prévôt. Non, par mon épée ! Je regarderais plutôt avec amour un brave archer qui n’a jamais fait de mal à un ennemi vaincu et qui ne reculerait devant aucun adversaire.
– Tu ne parles sans doute pas ainsi par goût du péché, soupira Alleyne. Si tes mots sont des mots de sauvage, ce n’est pas à moi de les juger. Ne peux-tu donc pas comprendre qu’il y a en ce monde d’autres ennemis que les Français, et autant de gloire à les vaincre ? Un écuyer ou un chevalier ne serait-il pas bien fier s’il terrassait sept adversaires en champ clos ? Or nous sommes dans le champ clos de la vie, et voilà sept champions noirs qui nous assaillent. Ce sont messire Orgueil, messire Désir cupide, dame Luxure, dame Colère, dame Gloutonnerie, dame Envie, et dame Paresse. Qu’un homme terrasse ces sept-là, et il aura le prix du jour, des mains de la plus belle des reines de beauté, de la Vierge-Mère elle-même. Voilà pourquoi ces religieux mortifient leur chair et nous donnent un exemple, à nous qui avons tendance à choyer trop la nôtre. Je dis donc qu’ils sont les saints de Dieu et je m’incline devant eux.
– Incline-toi, mon petit ! répliqua l’archer. Je n’ai jamais entendu parler aussi bien depuis la mort du vieux Dom Bertrand, qui fut quelque temps le chapelain de la Compagnie Blanche. Il était très bon soldat ; mais à la bataille de Brignais il fut transpercé par la lance d’un cavalier du Hainaut. Cela nous valut une excommunication de son meurtrier quand nous revîmes notre Saint Père à Avignon ; mais comme nous ne connaissions pas son nom, et comme nous ne savions rien de lui sinon qu’il montait un roussin gris pommelé, je me suis souvent demandé comment l’excommunication pouvait avoir effet.
– Ta Compagnie s’est donc agenouillée devant notre Saint Père le Pape Urbain, pivot et centre de la chrétienté ? interrogea Alleyne fort intéressé. Tu as peut-être eu la chance de voir son auguste visage ?
– Deux fois je l’ai vu, répondit l’archer. C’est un petit bonhomme à face de rat, et le menton plein de croûtes. La première fois nous avons tiré de lui cinq mille couronnes, et il en fit grand tapage. La deuxième fois nous lui en avons demandé dix mille, mais il fallut trois jours avant qu’il vînt à composition ; à mon avis nous aurions obtenu davantage en pillant son palais. Son chambellan et ses cardinaux sont sortis pour nous demander, si je me souviens bien, ce que nous préférions : ou accepter sept mille couronnes avec sa bénédiction et une absolution plénière, ou recevoir dix mille avec un interdit solennel par les cloches, le parchemin et les cierges. D’une seule voix nous nous sommes prononcés pour les dix mille couronnes avec l’anathème. Mais je ne sais comment les émissaires du Pape influencèrent Sir John ; bref, nous fûmes bénis et absous contre notre gré. Cela valait peut-être mieux, car la Compagnie en avait bien besoin à ce moment-là !
Le pieux Alleyne fut grandement choqué par ce récit. Involontairement il regarda autour de lui, attendant ces éclairs et ces coups de tonnerre qui, dans les Acta Sanctorum, coupaient net la parole au railleur. Mais le soleil d’automne continua de répandre sa chaleur paisible, et le tranquille sentier rouge poursuivait ses méandres à travers la forêt touffue. La nature semblait trop occupée d’elle-même pour venger la dignité d’un pontife outragé. Pourtant il éprouva au fond de son cœur le poids d’un reproche, comme s’il avait péché en prêtant l’oreille à de tels propos. L’éducation de vingt années se révolta. Il s’écarta un instant dans un sentier de traverse et se jeta à genoux ; là il pria de toute son âme pour l’archer et pour lui-même, et se releva rasséréné.
CHAPITRE VIII
Les trois amis
Pendant qu’il se livrait à ses oraisons, ses compagnons avaient continué leur marche. Son jeune sang et l’air frais du matin l’incitèrent à une course folle. Bâton dans une main et besace dans l’autre, cheveux bouclés au vent, il s’élança d’un pas élastique sur le sentier de la forêt, agile et gracieux comme un daim. À un détour du chemin, dans une chaumière entourée d’une haie, le gros John et Aylward l’archer s’étaient arrêtés pour regarder quelque chose. Alleyne les rejoignit et vit deux enfants (le plus jeune pouvait avoir neuf ans et l’aîné guère davantage) sur le petit bout de terrain qui séparait la haie de la chaumière ; ils tenaient dans leur main gauche une baguette recourbée, à bout de bras ; on aurait dit deux petites statues tant ils étaient silencieux et rigides. Ils avaient des yeux bleus, des cheveux blonds ; ils étaient robustes et bien bâtis ; ils vivaient au grand air, à en juger par le hâle de leur peau.
– Jeunes pousses d’un vieux bois d’arc ! s’écria le soldat tout joyeux. Voilà comment on doit élever des enfants. Par ma garde ! Je ne les aurais pas mieux exercés si je m’en étais occupé moi-même.
– Que font-ils ? demanda Hordle John. Ils se tiennent tout raides ; j’espère qu’ils n’ont pas été changés en statues…
– Non. Ils entraînent leur bras gauche, afin de tenir l’arc sans trembler. C’est ainsi que mon propre père m’a exercé : six jours par semaine j’élevais son gourdin à bout de bras et je le maintenais en l’air jusqu’à ce que ledit bras fût aussi lourd que du plomb. Holà, mes enfants, combien de temps resterez-vous le bras tendu ?
– Jusqu’à ce que le soleil soit au-dessus du grand tilleul, bon maître ! répondit l’aîné.
– Que voulez-vous être plus tard ? Bûcherons ? Verdiers ?
– Non, soldats ! crièrent-ils ensemble.
– Par la barbe de mon père, voilà de la bonne race ! Mais pourquoi tenez-vous tant à être soldats ?
– Pour nous battre contre les Écossais. Papa nous enverra combattre les Écossais !
– Et pourquoi les Écossais, mes mignons ? Nous avons vu des galères françaises et espagnoles du côté de Southampton mais je crois que les Écossais n’arriveront pas ici de sitôt !
– Nous n’en voulons qu’aux Écossais, reprit l’aîné, car ce sont les Écossais qui ont arraché à papa ses pouces et ses doigts pour la corde.
– Exactement, les enfants ! fit une voix grave derrière Alleyne.
Les voyageurs se retournèrent. Un homme maigre aux os saillants, aux joues creuses et au teint brouillé s’était approché sans qu’ils l’eussent entendu. Il ouvrit ses deux mains : le pouce, l’index et le médium de chaque main avaient été arrachés.
– Par ma foi, camarade, qui t’a gratifié d’un traitement aussi honteux ? s’écria l’archer.
– On voit bien, ami, que tu es né loin des marches d’Écosse ! répondit l’inconnu avec un sourire amer. Au nord de la Humber, personne n’ignore à quel travail se livre Douglas le Diable, le sinistre Lord James.
– Et comment es-tu tombé entre ses mains ? demanda John.
– Je suis un homme du nord, de Beverley, expliqua-t-il. À une certaine époque il n’y avait pas de meilleur tireur à l’arc que Robin Heathcot entre la Trent et le Tweed. Mais voilà comment il m’a laissé, comme il a laissé d’ailleurs beaucoup d’autres pauvres archers de la frontière : sans prise pour l’arc ni la corde ! Le Roi m’a accordé une chaumière et un travail ici dans le sud. S’il plaît à Dieu, ces deux enfants paieront une dette qui court depuis longtemps. Combien valent les pouces de papa, garçons ?
– Vingt vies écossaises ! répondirent-ils d’une même voix.
– Et combien les doigts ?
– Dix.
– Quand ils pourront courber mon arc de guerre, et descendre un écureuil à cent pas, je les enverrai prendre du service chez Johnny Corpeland, seigneur des Marches et gouverneur de Carlisle. Sur mon âme, je donnerais le reste de mes doigts pour voir ce Douglas à portée de leurs flèches !
– Puisses-tu vivre assez pour le voir ! approuva l’archer. Et maintenant, enfants, prenez l’avis d’un vieux soldat. Accoutumez-vous à tirer une flèche plongeante. Évidemment un archer peut être obligé de tirer droit et vite, mais il lui arrive très souvent d’avoir affaire avec un guetteur derrière une muraille ou avec un arbalétrier qui aurait relevé son mantelet ; vous ne pouvez espérer l’atteindre que si votre flèche tombe des nuages. Je n’ai pas tiré depuis deux semaines, mais je crois être capable de vous montrer comment il faut vous y prendre.
Il prit son arc long, amena son carquois devant lui et chercha une cible. À quelque distance il y avait une souche jaune et desséchée, qu’on apercevait sous les branches tombantes d’un chêne majestueux. L’archer calcula du regard la distance. Il prit trois flèches et les tira avec une telle rapidité qu’avant que la première eût atteint la cible, la dernière était déjà sur la corde. Les flèches passèrent nettement au-dessus du chêne. Sur les trois, deux s’enfoncèrent dans la souche ; la troisième déroutée par un caprice du vent tomba à cinquante centimètres du but.
– Bravo ! cria le paysan du nord. Écoutez-le, mes enfants ! C’est un maître archer. Votre père dit amen à chacune de ses paroles.
– Par ma garde ! fit Aylward. Si je me mets à prêcher sur le tir à l’arc, je n’aurai pas trop de toute la journée pour mon sermon. À la Compagnie nous avons des archers qui sont capables de planter une flèche dans n’importe quelle fissure ou jointure de l’équipement d’un homme d’armes, depuis la fermeture du bassinet jusqu’à la charnière des jambières. Mais avec ta permission, l’ami, je vais récupérer mes flèches, car chacune vaut un penny et un homme pauvre ne peut s’offrir le luxe d’en abandonner trois dans une souche au bord de la route. D’ailleurs il nous faut repartir. De tout mon cœur j’espère que tu pourras entraîner ces deux jeunes autours pour qu’ils puissent abattre le gibier dont tu nous as parlé.
Les voyageurs quittèrent le mutilé et sa progéniture, longèrent les cabanes éparpillées d’Emery Down et parvinrent sur la lande immense, ondulée, couverte de fougères et de bruyères où des cochons à demi sauvages fouillaient avec leur groin la terre des petites collines avoisinantes. La route grimpait en tournant sans cesse ; le vent soufflait allégrement sur les hauteurs. Des fourrés épais étaient rayés d’or et de pourpre ; ils se détachaient nettement sur le sol noir des tourbières ; une daine royale paissait ; elle tourna vers les intrus son front blanc et ses grands yeux inquiets. Alleyne admira la beauté souple de l’animal, mais les doigts de l’archer frémirent sur son carquois, et ses yeux s’allumèrent sous la poussée de l’instinct qui fait de l’homme un meurtrier.
– Tête Dieu ! grommela-t-il. Si nous étions en France, ou même en Guyenne, nous aurions de la viande fraîche pour notre déjeuner. Que ce soit la loi ou pas la loi, j’ai grande envie de lui décocher un trait.
– Auparavant j’aurai brisé ton arc sur mon genou ! cria John en posant sa grosse patte sur la manche d’Aylward. Écoute-moi bien, l’ami : je suis né dans la forêt et je sais ce qui s’y passe. Dans notre bonne ville de Hordle, deux garçons ont perdu leurs yeux et un troisième sa peau pour avoir fait ce que tu veux faire. À vrai dire, tu ne m’avais pas beaucoup plu au premier abord ; mais depuis j’ai conçu suffisamment d’estime pour toi pour souhaiter que l’écorcheur du verdier ne s’occupe pas de ta peau !
– C’est mon métier de risquer ma peau, grogna l’archer.
Néanmoins il rejeta son carquois sur sa hanche et il tourna la tête vers l’ouest.
Ils continuaient à grimper. Le sentier quitta la bruyère pour passer à travers des buissons de houx et des bois d’ifs, puis à nouveau ce fut la lande. Rien de plus gai que les merles siffleurs quand ils surgissaient d’un bouquet de verdure pour se poser dans un autre. Parfois les voyageurs devaient sauter par-dessus dans un torrent couleur d’ambre, bordé de fougères monstrueuses ; le martin-pêcheur bleu s’affairait ; mais le héron gorgé de truites et de dignité, gris et pensif, se reposait sur une patte parmi les joncs. Des geais jacassaient. Des ramiers voletaient en rangs serrés au-dessus de leurs têtes. Sans arrêt le charpentier de la nature, le grand pivert, tapait du bec sur les troncs d’arbres. De chaque côté, au fur et à mesure que nos trois camarades prenaient de l’altitude, le paysage s’élargissait, se développait ; vers le sud il descendait en pentes à travers la forêt dorée et la lande brune vers les lointaines fumées de Lymington et la mer embrumée qui se fondait dans l’horizon ; vers le nord les bois moutonnaient indéfiniment, les bocages couronnant d’autres bocages, jusqu’à la flèche blanche de Salisbury qui, très loin, se dessinait dure et claire contre le ciel sans nuages. Pour Alleyne qui avait passé ses jours dans une région au niveau de la mer, l’air vif des hauteurs et l’immense campagne transformaient son appréciation de l’existence ; la joie de vivre faisait battre ses artères. Le gros John lui-même n’était pas insensible à la beauté paisible qui les environnait. Quant à l’archer, il sifflotait allégrement ou chantait des bribes de chansons d’amour françaises d’une voix qui aurait attendri le cœur féminin le plus dur.
– J’ai beaucoup aimé cet homme du nord, déclara-t-il bientôt. Il sait haïr. Rien qu’à ses yeux et à ses joues, on voit qu’il est aussi aigre qu’un verjus. Un homme qui a du fiel dans le foie m’intéresse.
– Hélas ! soupira Alleyne. Ne serait-il pas préférable qu’il eût de l’amour dans le cœur ?
– Je ne dis pas non. Par mon épée, nul ne peut dire que je suis traître au petit roi. Tant mieux si les hommes aiment l’autre sexe. Pasques Dieu ! Les femmes sont faites pour être aimées, ces petites, depuis la guimpe jusqu’au lacet du soulier ! Je suis heureux, mon garçon, de constater que les bons moines t’ont si bien éduqué.
– Non. Je ne parlais pas de l’amour du monde. Je parlais du sentiment au nom duquel l’homme n’éprouve pas de ressentiment envers ceux qui lui ont fait du tort.
L’archer hocha la tête.
– Un homme devrait aimer les hommes de son sang, dit-il. Mais il n’est pas dans la nature des choses qu’un homme né en Angleterre aime un Écossais ou un Français. Ma foi ! Tu n’as pas vu une charge des pillards de Nithsdale sur leurs petits chevaux de Galloway ; si oui, tu ne parlerais pas de les aimer ! Autant embrasser Belzébuth. Je crains, mon gars, qu’on ne t’ait mal dressé à Beaulieu. Sûrement un évêque en sait plus qu’un abbé sur le bien ou le mal, et moi avec ces yeux-là j’ai vu l’évêque de Lincoln fracasser le crâne d’un Écossais d’un coup de hache, ce qui était une étrange façon de lui prouver son amour.
Alleyne se demanda s’il avait le droit de s’insurger contre une opinion aussi définitive, émise par un dignitaire de l’Église.
– Tu as donc porté les armes contre les Écossais ? fit·il.
– Oui. Plusieurs fois. Ce sont de rudes soldats. Une bonne école pour celui qui veut apprendre le courage et la science militaire.
– Je me suis laissé dire, intervint Hordle John, qu’ils sont de bons hommes de guerre.
– Pour la masse d’armes et la lance ils n’ont pas leurs pareils, répondit l’archer. Ils peuvent se déplacer loin, aussi, avec des sacs de viande et des grils suspendus à leur ceinturon ; si bien que ce serait de la folie que de vouloir les poursuivre. Près de la frontière les champs sont rares et les bœufs également : la moisson s’y fait avec une faux d’une main et une hallebarde dans l’autre. Par contre les archers d’Écosse sont les plus lamentables que j’aie jamais vus ; ils sont incapables de tirer juste avec une arbalète ; et ne parlons pas de l’arc de guerre !… La plupart sont pauvres, y compris les nobles ; un très petit nombre peut s’acheter une brigandine comme celle que je porte ; aussi leur est-il difficile de résister à nos chevaliers, dont chacun porte sur la tête et les épaules le revenu de cinq fermes d’Écosse. Homme contre homme, à armes égales, ils valent les plus braves de toute la Chrétienté.
– Et les Français ? interrogea Alleyne.
– Les Français sont aussi très courageux. Nous avons remporté de grands succès en France ; ce qui a provoqué de nombreuses vantardises et des excès de langage autour des feux de camp. Mais j’ai remarqué que ceux qui connaissaient le mieux la musique ne participaient pas à ce concert d’absurdités. J’ai vu des Français combattre sur des champs de bataille, dans des attaques et dans des sièges, dans des escalades, des raids de nuit, des embuscades, des sorties, des assauts en champ clos. Leurs chevaliers et leurs écuyers, mon enfant, sont à tous égards aussi bons que les nôtres, et je pourrais t’en citer une vingtaine qui derrière Du Guesclin tiendraient la lice contre les meilleurs d’Angleterre. D’un autre côté le peuple est si tourmenté par la gabelle, la capitation et toutes sortes de maudites tailles qu’il a perdu tout courage. Il est fou de demander à quelqu’un d’être en temps de paix un roquet misérable et en temps de guerre un lion. Tonds-les comme des moutons, ils resteront moutons. Si les nobles n’avaient pas écrasé le peuple, il est vraisemblable que nous n’aurions pas écrasé les nobles.
– Mais ils doivent être très malheureux, s’ils s’inclinent ainsi devant les riches ! réfléchit John. Je ne suis moi-même qu’un pauvre gars du peuple, et pourtant je sais qu’il existe des chartes, des franchises, des usages, des coutumes, et ainsi de suite. Et je sais aussi que si on les supprimait, il ne nous resterait plus qu’à acheter des fers de flèche.
– Oui, mais en France les hommes de loi sont aussi forts que les hommes de guerre. Par mon épée, j’affirme que là-bas un homme a plus à redouter de l’encrier d’un juriste que du fer d’un seigneur ! On déniche toujours dans les coffres-forts quelque maudit parchemin pour prouver que le riche doit être encore plus riche et le pauvre encore plus pauvre. En Angleterre personne ne le supporterait ; mais de l’autre côté de l’eau le peuple est calme.
– Et quelles autres nations as-tu vues dans tes voyages, beau sire ? demanda Alleyne Edricson.
Son esprit jeune était affamé de faits après tant de spéculations et de mysticisme.
– J’ai vu le paysan des Pays-Bas et je n’ai rien à dire contre lui. Par nature il est lourd et lent ; et il ne prendrait assurément pas les armes pour les beaux yeux d’une dame ni sous l’effet d’une corde bien grattée, comme les impulsifs à sang chaud du midi. Mais, ma foi, si tu étends ta main sur ses balles de laine, ou si tu le plaisantes sur le velours de Bruges, alors tous les bourgeois bourdonnent comme une ruche, et se précipitent, prêts à frapper de bon cœur. Par Notre-Dame ! À Courtrai et ailleurs ils ont montré aux Français qu’ils étaient aussi adroits à manier l’épée qu’à la bien tremper.
– Et les Espagnols ?
– Eux aussi sont très courageux ; d’autant plus que depuis plusieurs siècles ils ont dû combattre avec acharnement les maudits sectateurs du noir Mahomet, qui les avaient attaqués par le sud et qui, je crois, occupent encore la plus belle moitié du pays. J’ai eu mon tour avec eux en mer quand ils sont venus vers Winchelsea ; la bonne reine et ses dames d’honneur étaient assises sur la falaise et suivaient la bataille comme s’il s’était agi d’une joute ou d’un tournoi. Par ma garde, c’était un spectacle qui valait la peine d’être vu, car tout ce qui comptait en Angleterre était sur l’eau ce jour-là ! Nous sommes partis sur de petits bateaux et nous sommes revenus sur de grandes galères : sur cinquante gros vaisseaux espagnols, plus de quarante arborèrent la Croix de saint Georges avant le coucher du soleil. Mais à présent, jeune homme, je t’ai répondu avec franchise, et je crois que c’est à toi de me répondre à présent. Il faut qu’entre nous les choses soient claires et nettes. J’ai pour habitude de viser droit au but. Tu as vu les objets que j’avais avec moi et que j’ai laissés à l’hôtellerie. Dis-moi quel est celui que tu désirerais, sauf seulement la boîte de sucre rose que j’apporte à Lady Loring, et il sera à toi si tu me suis en France.
– Non, répondit Alleyne. Je serais heureux de te suivre en France ou n’importe où, ne serait-ce que pour t’écouter, et aussi parce que vous êtes les deux seuls amis que je possède dans le monde hors du couvent. Mais en vérité cela m’est impossible car j’ai des devoirs à remplir envers mon frère, puisque nos père et mère sont morts et qu’il est mon aîné. En outre, je ne conçois pas de quelle utilité je te serais en France : ni par tempérament ni par entraînement je ne suis homme de guerre, et il me semble que dans ce pays on ne fait que s’y battre.
– Cela vient de la stupidité de mes propos ! s’écria l’archer. Comme je ne suis pas instruit, ma langue ne parle que d’épées et de cibles, parce que ma main ne s’occupe guère que de cela. Apprends donc que pour un manuscrit en Angleterre il y en a vingt en France. Pour ce qui est des statues, des pierres taillées, des châsses, des grilles ciselées, ou de tout ce qui enchanterait l’œil d’un clerc instruit, la proportion est de un contre cent. Pendant le sac de Carcassonne j’ai vu des salles remplies de parchemins, mais personne dans notre Compagnie n’était capable de les lire. À Arles et à Nîmes aussi et dans d’autres villes que je pourrais citer, les grandes arcades et les formidables remparts qu’ont autrefois construits des géants venus du sud tiennent encore debout. Tiens, tes yeux brillent ? Bien sûr, tu aimerais voir tout cela ! Accompagne-moi donc, et je te jure par les dix doigts de mes mains que je te montrerai ces merveilles !
– Oui, je serais vraiment content de les voir, répondit Alleyne ; mais j’ai quitté Beaulieu dans un but bien précis et je dois accomplir mon devoir, tout comme tu accomplis le tien.
– Réfléchis encore, mon ami, insista Aylward, à tout le bien que tu pourrais faire là-bas. La Compagnie est forte de trois cents hommes, et personne ne prie pour eux ; pourtant la Vierge sait s’il n’a jamais existé un groupe d’hommes qui ait davantage besoin de prières ! Ce devoir-ci peut contrebalancer l’autre. Ton frère s’est débrouillé sans toi pendant de nombreuses années. D’après ce que j’ai compris il ne s’est jamais dérangé pour aller te voir à Beaulieu ; il n’a donc pas si grand besoin de tes services !
– De plus, dit John, tout le monde dans la forêt le connaît. De Bramshaw Hill à Holmesley Walk il n’y a pas plus ivrogne, braillard, dangereux que lui. Tu t’en apercevras à tes dépens.
– Raison de plus pour que j’essaye de l’amender, répliqua Alleyne. N’insistez pas, mes amis, car tous mes désirs m’attirent vers la France, et ce serait une vraie joie si je pouvais vous suivre. Mais vraiment c’est impossible. Et ici même je vais prendre congé de vous, car je vois parmi les arbres une tour carrée qui doit être celle de l’église de Minstead. Je suivrai ce sentier à travers bois pour arriver plus tôt.
– Hé bien, que Dieu soit avec toi, mon enfant ! s’écria l’archer en pressant Alleyne contre son cœur. Je suis prompt à aimer, prompt à haïr. Dieu m’est témoin que je suis désolé de te quitter.
– Ne pourrions-nous, proposa le gros John, attendre ici pour savoir quel accueil te réserve ton frère ? Il se peut que tu sois aussi mal reçu qu’un fournisseur par la châtelaine du village.
– Non ! répondit Alleyne. Ne m’attendez pas. Je resterai à Minstead.
– À tout hasard je vais t’indiquer notre itinéraire, déclara l’archer. Nous allons voyager vers le sud à travers les bois jusqu’à ce que nous arrivions à la route de Christchurch. Là nous irons tout droit, avec l’espoir d’atteindre ce soir le château de Sir William Montacute, comte de Salisbury, de qui Sir Nigel Loring est connétable. Nous habiterons là, et tu pourras nous y rejoindre, car il nous faudra bien un bon mois avant que nous soyons prêts à partir pour la France.
Ces deux amis de fraîche date, mais si braves de cœur, Alleyne les quitta avec un vif chagrin ; le combat entre sa conscience et son inclination fut si violent qu’il n’osa pas se retourner tout de suite, de peur que sa résolution ne mollît. Il attendit de s’être profondément engagé dans les bois pour jeter un coup d’œil derrière lui. À travers les branchages, il les aperçut tous deux sur la route. L’archer se tenait droit, les bras croisés, et son arc dépassait la ligne de ses épaules ; le soleil faisait briller son casque et les maillons de sa brigandine. À côté de lui se dressait sa gigantesque recrue dans les habits du fouleur de Lymington ; ses bras et ses jambes émergeaient du vêtement trop court et trop étriqué. Pendant qu’Alleyne les regardait, ils se remirent en marche.
CHAPITRE IX
Étranges incidents dans le bois de Minstead
Le chemin que devait suivre le clerc passait à travers une forêt magnifique. Les troncs géants des chênes et des hêtres formaient dans chaque direction de larges avenues, projetaient en l’air leurs grosses branches pour édifier les arceaux majestueux de la cathédrale de la nature. Le sol était tapissé d’une mousse douce autant que verte, tachetée de feuilles mortes, qui fléchissait agréablement sous les pas du voyageur. Le chemin était si peu fréquenté que par endroits il disparaissait complètement sous le gazon pour reparaître un peu plus loin comme un ruban de couleur rouille entre les troncs. Tout était calme et paisible. Le bruissement des branchages et le roucoulement des ramiers rompaient seuls le silence. Une fois, Alleyne entendit au loin la joyeuse sonnerie d’un bugle de chasse et les aboiements perçants d’une meute.
Ce n’était pas sans émotion qu’il regardait autour de lui car, en dépit de sa vie retirée, il avait appris suffisamment de choses sur l’ancienne grandeur de sa famille pour ne pas ignorer qu’à une certaine époque elle avait étendu sa domination incontestée sur toutes ces terres. Son père aurait pu retracer son pur lignage saxon jusqu’à ce Godfrey Malf qui possédait les manoirs de Bisterne et de Minstead lorsque les premiers Normands débarquèrent sur le sol anglais. Le boisement du district, toutefois, ainsi que sa conversion en domaine royal, avaient amputé sa propriété, tandis que d’autres parcelles lui avaient été confisquées pour le punir d’une complicité imaginaire dans un soulèvement saxon qui avait échoué. Le destin de l’ancêtre avait préfiguré celui de ses descendants. Pendant trois cents années leur domaine s’était progressivement amenuisé, tantôt par suite d’une usurpation royale ou féodale, tantôt par des dons à l’Église comme celui qu’avait fait le père d’Alleyne pour ouvrir à son fils cadet les portes de l’abbaye de Beaulieu. L’importance de la famille avait donc diminué, mais le vieux manoir saxon lui appartenait encore, ainsi que deux fermes et un bois assez grand pour nourrir une centaine de porcs (sylva de centum porcis, lisait-on sur un vieux parchemin de famille). Et surtout, le propriétaire pouvait garder la tête haute puisqu’il était le véritable seigneur de Minstead : il avait la tenure de la terre en socage libre ; il n’avait pas de supérieur féodal ; il n’était responsable que devant le Roi. Comme il connaissait cette histoire, Alleyne sentit s’allumer en lui une petite flamme de vanité mondaine quand il vit pour la première fois la terre qui avait appartenu à de nombreuses générations de ses aïeux. Il força l’allure en faisant voltiger gaiement son bâton et en cherchant à chaque détour du chemin à apercevoir la vieille résidence saxonne. Tout à coup cependant il s’arrêta : devant lui venait de surgir un homme d’aspect farouche qui tenait à la main une massue et qui, dissimulé derrière un arbre, lui barrait maintenant le passage. C’était un paysan robuste, rude, avec une tunique et un bonnet en peaux de mouton non tannées, des chausses de cuir et des lanières autour des jambes et des pieds.
– Halte ! cria-t-il en levant sa massue. Qui es-tu pour te promener si librement dans ce bois ? Où vas-tu, et quel est ton but ?
– Pourquoi te répondrais-je, mon ami ? demanda Alleyne en se mettant sur ses gardes.
– Parce que ta langue peut te sauver la tête. Mais où ai-je déjà vu ton visage ?
– Pas plus tard que la nuit dernière à « L’Émerillon bigarré », répondit le clerc qui avait reconnu le serf évadé.
– Oui, par la Vierge ! Tu es le petit clerc qui restait si tranquille dans ton coin et qui a crié haro sur le ménestrel. Qu’as-tu dans ta besace ?
– Aucun objet de valeur.
– Comment puis-je en être sûr, clerc ? Montre-moi ta besace.
– Non.
– Imbécile ! Je pourrais t’arracher les membres comme à un poulet. Qu’as-tu dans ta besace ? As-tu oublié que nous sommes seuls, qu’il n’y a âme qui vive dans les environs ? Veux-tu perdre la vie, en sus de ta besace ?
– Je ne m’en séparerai pas sans combattre.
– Tu veux te battre ? Un combat entre un vieux coq et un poussin qui sort de l’œuf ! Voudrais-tu te battre pour la première et dernière fois de ta vie ?
– Si tu m’avais demandé de te faire la charité, répondit Alleyne, je t’aurais donné de bon cœur. Mais après ce que tu m’as dit, tu n’auras pas de moi un seul farthing, et quand je verrai mon frère, le seigneur de Minstead, il se mettra en quête de toi, t’appréhendera comme le vilain que tu es et te traitera selon tes mérites.
Le hors-la-loi abaissa sa massue.
– Le frère du seigneur ? s’exclama-t-il. Par les clefs de saint Pierre, je préférerais avoir ma main desséchée et ma langue paralysée plutôt que de vous frapper ou de vous maltraiter ! Si vous êtes le frère du seigneur de Minstead, vous êtes du bon côté malgré votre défroque de clerc.
– Je suis son frère, dit Alleyne. Mais même si je ne l’étais pas, pourquoi me molester sur les terres du Roi ?
– Je me soucie du Roi et de ses nobles comme d’un pépin de pomme ! s’écria le serf avec passion. Je n’ai reçu d’eux que des mauvais traitements, que je leur rendrai. Je suis un bon ami pour mes amis, et, par la Vierge, un méchant ennemi pour mes ennemis !
– Donc le pire des ennemis pour toi-même ! répliqua Alleyne. Mais puisque tu connais mon frère, je te serais obligé de m’indiquer le plus court chemin qui conduit à sa demeure.
Le serf allait répondre, mais la sonnerie d’un bugle retentit tout près d’eux dans le bois. Alleyne entrevit le flanc brun foncé et la gorge blanche d’un cerf altier entre des troncs d’arbres. Une minute plus tard déferlèrent douze ou quatorze limiers bondissant sur une piste chaude, le nez au sol et la queue en l’air. Du coup la forêt silencieuse se mit à vivre bruyamment : des sabots au galop, des broussailles qui craquaient, des cris aigus de chasseurs précédèrent l’arrivée juste derrière la meute de deux piqueurs harcelant les traînards et encourageant les limiers de tête dans ce jargon mi-français mi-anglais qui était le langage de la vénerie et de la chasse à courre. Alleyne, bouche bée, les regarda passer et écouta les puissants « Allez, Bayard ! Allez, Pommers ! Allez, Lebryt ! » qui s’adressaient à leurs chiens favoris. Puis un groupe de cavaliers jaillit littéralement du sous-bois.
L’homme qui chevauchait en tête avait entre cinquante et soixante ans ; sous son haut front pensif ses yeux clairs brillaient ; sa barbe grise pointait toute hérissée et révélait un tempérament passionné ; la longue figure mince et la bouche ferme étaient celles d’un conducteur d’hommes. Il se tenait droit comme un militaire et il montait son cheval avec la grâce insouciante de quelqu’un qui a passé sa vie en selle. S’il avait été vêtu sans apparat, sa physionomie dominatrice et la flamme de son regard auraient suffi à indiquer qu’il était né pour commander. Mais comme il portait une tunique de soie saupoudrée de fleurs de lis d’or, une cape de velours bordée de pourpre royale et les lions d’Angleterre incrustés en argent sur son harnachement, personne ne pouvait manquer de reconnaître le noble Édouard, le plus martial et le plus puissant de toute la longue lignée de rois-soldats qui avaient gouverné la race anglo-normande. Alleyne se découvrit et s’inclina quand il le vit, mais le serf croisa les bras en s’appuyant sur sa massue, considérant avec peu de tendresse l’escorte de nobles et de chevaliers de service.
– Ah ! s’écria Édouard en tirant sur les rênes de son beau destrier noir. Le cerf est-il passé ? Non ? Ici, Brocas ! Tu parles anglais.
– Le cerf, drôles ? demanda un homme au teint hâlé et aux traits farouches qui monta à hauteur du Roi. Si vous lui avez fait faire demi-tour, gare à vos oreilles !
– Il est passé là, près du hêtre pourri, dit Alleyne. Et les chiens le serraient de près.
– Très bien ! cria Édouard toujours en français (car il avait beau comprendre l’anglais, il n’avait jamais appris à s’exprimer dans cette langue barbare et disgracieuse). Par ma foi, messires, poursuivit-il en se tournant sur sa selle pour s’adresser à son escorte, à moins que ma science de la chasse à courre ne soit en défaut, c’est un cerf de six cors, une bête magnifique, que nous avons levé aujourd’hui. Un saint Hubert d’or à celui qui sonnera l’hallali le premier !
Il secoua la bride et s’éloigna dans un bruit de tonnerre. Courbés sur leurs chevaux les chevaliers partirent à leur tour au galop, dans l’espoir de gagner la récompense promise par le Roi. Un seul demeura en arrière :
Brocas, qui amena son cheval auprès du serf et lui cingla la figure d’un coup de fouet.
– Découvre-toi, chien, découvre-toi quand un monarque daigne abaisser son regard jusqu’à toi !
Il siffla plutôt qu’il n’articula ces paroles, puis éperonna son cheval et disparut.
Le serf accepta le coup sans sourciller ni crier. C’était évidemment un homme à qui revenaient de naissance et en héritage les coups de fouet et les zébrures sur la peau. Toutefois ses yeux lancèrent des éclairs, et il menaça du poing la silhouette du cavalier qui s’éloignait.
– Chien noir de Gascogne ! murmura-t-il. Maudit soit le jour où toi et tes pareils ont mis le pied sur la libre Angleterre ! Je connais ton chenil de Rochecourt. Une nuit viendra où je pourrai te faire, à toi et aux tiens, ce que toi et les tiens m’ont fait à moi et aux miens. Que Dieu me frappe si je manque à te frapper, voleur français, toi, ta femme, ton enfant, tous ceux qui habitent sous ton toit !
– Non, non ! s’écria Alleyne. Ne mêle pas le nom de Dieu à ces menaces impies ! Et cependant c’était un coup lâche, le coup qui irrite le sang et délie la langue du plus pacifique… Attends ! Je vais trouver quelques herbes calmantes et je les poserai sur ta joue pour apaiser ta souffrance.
– Non. Une seule chose peut apaiser ma souffrance et l’avenir me la procurera. Mais, clerc, si vous voulez voir votre frère, il faut que vous partiez, car il tient un rassemblement aujourd’hui, et ses fidèles arriveront avant que l’ombre s’infléchisse de l’ouest vers l’est. Je vous prie de ne pas le retenir, car ce serait un malheur si tous ces solides garçons étaient présents et que leur chef ne fût pas là. Je vous accompagnerais volontiers mais, pour tout vous dire, je suis de faction ici et je n’ai pas le droit de bouger. Le sentier que voilà, entre les chênes et les ronces, aboutit à ses champs du bas.
Alleyne ne perdit pas de temps pour suivre la direction que venait de lui indiquer le hors-la-loi ; il le quitta aussitôt. Mais cette rencontre l’avait assombri. Non pas seulement parce que la colère et l’aigreur étaient insupportables à la douceur de son caractère, mais aussi parce qu’il avait été contrarié d’entendre parler de son frère comme d’un chef de hors-la-loi ou d’un groupe de factieux. Décidément, de tout ce qu’il avait vu du monde, rien ne le surprenait davantage que la haine que les diverses classes se vouaient mutuellement. Les propos tenus à l’auberge par le cultivateur, le garde forestier et le serf appelaient ouvertement à la révolte. Or le nom de son frère se trouvait à présent prononcé comme s’il était au centre même du mécontentement général. Pour dire la vérité, le peuple d’Angleterre était las de ce beau jeu de chevalerie qui se jouait depuis si longtemps à ses frais. Tant que les chevaliers et les barons avaient constitué une puissance et la seule garde du royaume, le peuple les avait tolérés ; mais maintenant, tout le monde savait que les grandes batailles de France avaient été gagnées par des petits propriétaires, des paysans et des mineurs ; de surcroît le cavalier à lourde armure semblait ne plus aspirer à cette réputation militaire à laquelle sa classe avait toujours prétendu. Les tournois et les assauts sur la lice avaient jadis beaucoup impressionné le peuple, mais le champion panaché à la démarche lourde et gauche n’était plus un objet de crainte et de respect pour les hommes dont les pères ou les frères avaient tiré à l’arc à Crécy ou à Poitiers où la fleur de la chevalerie mondiale s’était montrée incapable de résister aux armes de paysans disciplinés. Le pouvoir avait changé de mains. Le protecteur était devenu un protégé, et toute l’organisation du système féodal oscillait sur ses bases. D’où le sourd murmure des classes inférieures ; d’où le mécontentement latent qui explosait dans des orages locaux et qui atteignit son point culminant quelques années plus tard dans le grand soulèvement qui eut Tyler à sa tête. Dans le Hampshire, ce qui étonna Alleyne aurait été observé par n’importe quel voyageur entre la Manche et les marches d’Écosse.
Il suivait la route indiquée, mais ses pressentiments augmentaient au fur et à mesure que ses pas le rapprochaient d’une demeure qu’il ne connaissait pas. Tout à coup le rideau des arbres s’amincit, le gazon s’élargit en un vaste pré ; sur l’herbe verte cinq vaches étaient couchées au soleil, et une multitude de porcs noirs paressaient sans être gardés. Un ruisseau brun qui venait de la forêt traversait le pré ; un pont grossier l’enjambait ; de l’autre côté un deuxième champ grimpait jusqu’à une maison en bois longue et basse, avec un toit de chaume et des ouvertures carrées en guise de fenêtres. Les yeux brillants, les joues en feu, Alleyne contempla cette demeure de ses pères. Un ruban de fumée bleue s’échappait par un trou dans le chaume : c’était le seul signe de vie visible, en plus d’un gros chien noir qui dormait enchaîné au poteau de la porte. Dans l’éclat du soleil d’automne la maison était sise aussi calme, aussi paisible qu’il se l’était représentée dans ses rêves.
Il fut tiré de son agréable rêverie par un bruit de voix. Deux personnes émergèrent de la forêt à quelque distance sur sa droite et s’engagèrent dans le champ en direction du pont. L’une était un homme qui avait une longue barbe blonde ; des cheveux de la même couleur retombaient sur ses épaules ; son costume en bon drap de Norwich et son maintien assuré indiquaient un homme de condition ; la teinte sombre de son vêtement et l’absence de toute parure contrastaient avec l’éclat de la tenue royale qu’Alleyne avait admirée un peu plus tôt. À son côté marchait une femme, grande, mince, brune, dont la silhouette était pleine de grâce et le visage charmant. Ses cheveux couleur de jais étaient tirés sur la nuque sous une coiffe rose ; elle avait un fier port de tête et le pas allongé, souple, de certains animaux infatigables des bois. Elle tendait devant elle sa main gauche gantée de velours rouge ; sur le poignet était posé un petit faucon brun, duveteux et crotté, qu’elle cajolait tout en marchant. Quand elle parvint sous le soleil, Alleyne remarqua que sa robe légère à rayures roses était toute tachée de terre et de mousse d’un côté. Il demeura à l’ombre d’un chêne et la contempla avec des yeux admiratifs, car cette femme lui parut être la plus belle et la plus gracieuse créature qu’on puisse concevoir. C’était ainsi qu’il avait imaginé les anges, qu’il avait essayé de les peindre dans les missels de Beaulieu ; mais ici apparaissait une touche d’humanité sensible qui chatouilla ses nerfs d’un frémissement qu’aucun pur esprit n’aurait provoqué.
Tous deux avançaient rapidement à travers le champ vers le pont étroit ; lui marchait en tête, elle le suivait à quelques pas. Devant le pont ils s’arrêtèrent et demeurèrent quelques instants face à face en se parlant avec animation. Alleyne avait lu des histoires d’amour et d’amoureux. Ce couple était sans doute un couple d’amoureux. Sinon pourquoi se seraient-ils promenés dans les bois ? Et pourquoi s’abandonneraient-ils à la douceur d’un entretien auprès du ruisseau qui courait à travers champs ? Et pourtant, pendant qu’il les observait et qu’il hésitait sur ce qu’il devait faire, il en vint bientôt à douter de l’exactitude de l’hypothèse qu’il s’était formulée. L’homme à la barbe blonde, grand et carré, bloquait l’entrée du pont et agitait ses mains tout en parlant. Le son de ses paroles s’éleva, dominé par des accents de menace et de colère. Impavide auprès de lui, elle caressait toujours son faucon. Mais à deux reprises elle lança par-dessus son épaule un vif regard comme si elle quêtait du secours. Le jeune clerc s’émut si fort de ces appels muets qu’il quitta sa cachette et s’engagea dans le champ. Il était incapable de ne pas voler au secours de quelqu’un qui pouvait avoir besoin de sa présence. Ils étaient si absorbés l’un par l’autre qu’ils ne le virent pas s’approcher. Mais quand il ne fut plus qu’à quelques pas, l’homme passa rudement un bras autour de la taille de la jeune femme et voulut l’attirer contre lui. Elle se débattit farouchement et tenta de lui échapper, tandis que le faucon tout ébouriffé battait des ailes et donnait des coups de bec pour défendre sa maîtresse. L’oiseau et la demoiselle, toutefois, n’avaient que fort peu de chances contre leur agresseur qui, riant lourdement, s’empara du poignet de la jeune femme.
– Ce sont toujours les plus belles roses qui possèdent les plus longues épines ! dit-il. Du calme, petite fille, ou vous pourriez vous faire du mal. Il faut acquitter le droit de péage saxon sur une terre saxonne, fière Maude, en dépit de tous vos airs et de vos gracieusetés.
– Goujat ! siffla-t-elle entre ses dents. Bas lourdaud ! Rustre mal né ! Est-ce là votre hospitalité ? Je préférerais épouser un serf marqué au fer des champs de mon père. Laissez-moi aller, vous dis-je !… Ah, bon jeune homme, c’est le Ciel qui vous envoie ! Obligez-le à me lâcher ! Par l’honneur de votre mère, je vous prie de ne pas me quitter et d’obliger ce faquin à me lâcher !
– Ne pas vous quitter ? Avec joie ! fit Alleyne. Certainement, messire, vous auriez honte de retenir cette demoiselle contre sa volonté ?
L’homme tourna vers lui un visage de lion en fureur. Avec sa masse de cheveux dorés, ses yeux bleus brillants, ses traits bien accentués, il était extrêmement avenant. Cependant son expression contenait quelque chose de si féroce et de si cruel qu’un enfant ou une bête fauve se serait enfui à sa vue. Son front était plissé, ses sourcils froncés, ses joues colorées, son regard allumé d’une lueur sauvage.
– Jeune fou ! s’écria-t-il en retenant la jeune femme dont le visage n’exprimait plus qu’une violente répulsion. Laisse ta cuiller dans ta soupe ! Passe ton chemin si tu veux échapper au pire. Cette petite jeune fille est venue avec moi ; avec moi elle restera.
– Menteur ! cria-t-elle.
Elle baissa la tête et mordit d’un coup de dents la large main brune qui la retenait. Il poussa un juron ; elle se libéra et se glissa derrière Alleyne ; on aurait dit le levraut qui tremble en voyant l’oiseau de proie dessiner des cercles au-dessus de lui.
– Hors de mes terres ! articula l’homme sans se soucier du sang qui coulait de sa main. Que viens-tu faire ici ? D’après ton habit, tu dois être l’un de ces maudits clercs qui courent le pays comme des rats et qui se mêlent toujours de ce qui ne les regarde pas. Trop lâches pour se battre, trop fainéants pour travailler. Par la croix ! Si je pouvais disposer de toi, je te clouerais sur une porte de l’abbaye comme on pend les bêtes puantes devant leurs trous. Tu n’es ni un homme ni une femme, jeune tonsuré. Retourne vers tes frères avant que je t’empoigne ! Car tu es sur mes terres, et je peux te tuer comme un vulgaire cambrioleur.
– Ce sont donc vos terres ? balbutia Alleyne.
– Voudrais-tu me les disputer, chien ? Voudrais-tu par ruse ou malice me frustrer de mes derniers acres ? Apprends, coquin, que tu as osé aujourd’hui te mettre en travers de la route d’un homme dont la race a abondé en conseillers du Roi et en chefs d’armée jusqu’à ce que cette équipe de voleurs normands s’établisse dans le pays et que des chiens impurs dans ton genre prêchent partout que le voleur doit garder son butin et que l’honnête homme pêche s’il veut reprendre son bien.
– Vous êtes le seigneur de Minstead !
– Oui. Et je suis le fils d’Edric, du pur sang de Godfrey le comte, par la fille unique de la maison d’Aluric dont les ancêtres ont tenu la bannière au cheval blanc pendant le combat fatal où notre écu s’est brisé et notre épée ébréchée. Je te le dis, clerc : ma famille possédait cette terre de Bramshaw Wood à Ringwood Road. Et par l’âme de mon père, je serais curieux de voir qu’on veuille m’arracher le peu qui me resta ! Va-t’en, te dis-je ! Et ne te mêle pas de mes affaires.
– Si vous me lâchez maintenant, murmura la jeune fille, honte pour toujours à votre virilité !
– Voyons, messire, fit Alleyne de la voix la plus douce et la plus persuasive qu’il put prendre, si votre naissance est noble, il n’y a aucune raison pour que vos manières ne le soient pas. Je suis tout à fait persuadé que vous n’avez fait que plaisanter avec cette demoiselle et que vous lui permettrez à présent de quitter votre propriété, soit seule soit en ma compagnie si elle en a besoin à travers bois. Quant à la naissance, je n’ai nullement l’intention de me vanter, et il y a du vrai dans ce que vous avez dit sur l’incapacité des clercs, mais néanmoins ma naissance vaut la vôtre !
– Chien ! cria le seigneur de Minstead. Personne dans le sud ne peut en dire autant.
– Et pourtant je le puis ! fit Alleyne en souriant. Car moi aussi je suis fils d’Edric, du pur sang de Godfrey le comte par la fille unique d’Aluric de Brockenhurst. Certainement, mon cher frère, continua-t-il en lui tendant la main, vous me réserverez un accueil plus affectueux que celui-là. Nous sommes les deux seuls rameaux restants sur ce vieux tronc saxon.
En jurant son frère aîné repoussa la main tendue, et une expression de haine maligne passa sur sa physionomie bouleversée.
– Tu es donc le jeune renardeau de Beaulieu ? fit-il. J’aurais dû le deviner à ta figure sans poils, à ton parler onctueux, à tes manières serviles : tu es si bien marqué par les frères, tu es si poltron que tu ne réponds même pas à une parole rude par une autre parole rude. Ton père, jeune tonsuré, avec tous ses défauts, avait au moins du courage : peu d’hommes osaient l’affronter quand il était en colère. Mais toi ! Regarde, vil rat, regarde ces prés où paissent les vaches, et ce champ plus loin, et le verger tout près de l’église. Sais-tu que toutes ces terres ont été arrachées à notre père mourant par des prêtres avides afin de pourvoir aux besoins de ton éducation au couvent ? Moi, seigneur de Minstead, j’ai été dépouillé pour que tu puisses bredouiller du latin et manger du pain que tu n’as pas encore gagné à la sueur de ton front. Tu commences par me voler, et maintenant tu viens prêchant et pleurnichant, en quête sans doute d’un nouveau champ ou d’un nouveau pré pour tes amis moines. Coquin ! Je lâcherai mes chiens contre toi. En attendant, ôte-toi de mon chemin, et si tu interviens prends garde à ta vie !
Il s’élança, poussa le clerc d’un coup d’épaule et abattit sa main sur le poignet de la jeune fille. Toutefois Alleyne, aussi agile qu’un lévrier, sauta vers la demoiselle, s’empara de son autre poignet et brandit son bâton ferré.
– Vous pouvez me dire à moi ce qu’il vous plaît, déclara-t-il en serrant les dents ; il est possible que je ne mérite pas mieux. Mais, que je sois votre frère ou non, je jure sur mon salut éternel que je vous casserai le bras si vous ne lâchez pas cette jeune fille.
L’accent de sa voix, la lueur qui étincela dans son regard promettaient que le coup allait suivre la menace. Pendant un moment le bouillant héritage d’une longue lignée de comtes l’emporta sur la doctrine de la douceur et de la pitié. Alors subitement Alleyne prit conscience d’une sorte d’excitation sauvage de toutes ses fibres, d’un élan de folle allégresse parce que sa véritable personnalité se libérait des liens de l’habitude et de l’enseignement qui l’avaient contenue si longtemps. Le seigneur de Minstead lâcha prise, bondit en arrière, chercha autour de lui un bâton ou une pierre, mais comme il n’en aperçut pas il fit demi-tour et se précipita vers sa maison en lançant plusieurs coups de sifflet.
– Venez ! haleta la jeune fille. Fuyons, ami, avant qu’il revienne.
– Non pas ! Qu’il revienne ! s’écria Alleyne. Je ne bougerai pas d’un pouce devant lui ou devant ses chiens !
– Venez, venez donc ! répéta-t-elle en le tirant par le bras. Je le connais : il vous tuera ! Venez, pour l’amour de la Vierge ! Pour moi aussi, car je ne pourrais pas m’enfuir et vous laisser ici !
– Fuyons, alors ! dit-il.
Ils coururent tous deux vers les bois. Quand ils parvinrent à la lisière des fourrés, Alleyne regarda derrière eux : son frère était ressorti de la maison ; le soleil brillait dans ses cheveux et dans sa barbe. Il tenait quelque chose qui miroitait dans sa main droite ; il se baissa pour détacher le gros chien noir.
– Par ici ! chuchota la jeune fille. À travers les broussailles jusqu’à ce frêne fourchu. Ne vous occupez pas de moi Je peux courir aussi vite que vous, j’en suis sûre. Maintenant, dans le ruisseau ! Oui, dedans ! Plus haut que les chevilles, pour que le chien perde nos traces bien qu’il ne soit sans doute qu’un roquet comme son maître.
Déjà elle avait sauté dans le ruisseau ; il était peu profond ; elle courut rapidement en plein milieu ; l’eau brune glougloutait sous ses pieds ; d’une main elle écartait les branchages et les ronces. Alleyne la suivait de près ; un tourbillon de pensées l’assaillait : cet accueil démolissait ses plans, ruinait ses espoirs. Mais les pieds luisants de son guide chassèrent ses préoccupations ; il voyait la petite silhouette féminine se courber, se redresser, sauter de pierre en pierre ; et elle y mettait tant de légèreté qu’il avait du mal à ne pas perdre de terrain. Enfin, alors qu’il était à bout de souffle, elle sortit de l’eau et grimpa sur la rive moussue ; entre deux buissons de houx, elle s’arrêta pour considérer tristement ses pieds trempés et sa robe déchirée.
– Sainte Marie ! fit-elle. Que faire ? Ma mère va me consigner dans ma chambre pendant un mois, et elle me fera travailler à la tapisserie des neuf vaillants chevaliers. Elle me l’avait promis la semaine dernière, quand je suis tombée dans le marécage de Wilverley ; et pourtant elle sait bien que je suis incapable de m’intéresser à des travaux d’aiguille.
Alleyne était demeuré dans le ruisseau ; il contempla la gracieuse harmonie en blanc et rose, l’arc de la chevelure noire et le fier visage sensible qui se releva vers le sien avec franchise et confiance.
– Nous ferions mieux de nous remettre en marche, dit-il. Il peut encore nous rattraper.
– Non. Nous sommes maintenant assez loin de ses terres, et il ne sait pas dans quel bois nous avons cherché refuge. Mais vous… Vous l’aviez à votre merci. Pourquoi ne l’avez-vous pas tué ?
– Le tuer ! Tuer mon frère ?
– Et pourquoi pas ?…
Elle découvrit ses dents blanches.
– … Lui vous aurait tué. Je le connais. Je l’ai lu dans ses yeux. Si j’avais eu votre gros bâton j’aurais essayé et… Hé oui, je l’aurais tué !
Elle agita sa petite main crispée et ses lèvres se contractèrent de haine.
– Je suis déjà affligé jusqu’au fond de l’âme de ce que j’ai fait, répondit-il en s’asseyant sur la berge et en plongeant sa tête entre ses mains. Que Dieu m’aide ! Tout le mauvais de moi semblait me dominer, me commander. Une seconde de plus et je le frappais ! Lui, le fils de ma propre mère, l’homme que je désirais tant serrer dans mes bras. Hélas, que j’ai été faible !
– Faible ? s’écria-t-elle en haussant ses sourcils noirs. Mon père lui-même, qui juge sévèrement les hommes, ne dirait pas que vous avez été faible. Mais c’est pour moi, messire, une chose bien amusante que de vous entendre vous lamenter sur votre conduite ! Je ne puis vous proposer qu’une chose : rebroussons chemin, et faites votre paix avec le seigneur de Minstead en lui restituant sa prisonnière. Il serait fort triste qu’un objet aussi insignifiant qu’une femme s’interposât entre deux êtres du même sang !
Le naïf Alleyne écarquilla les yeux.
– Non, madame, ce serait pire que tout ! dit-il. Quel homme serait assez pleutre et assez vil pour se dérober à votre appel ? Je me suis brouillé avec mon frère et maintenant, par malheur, voici que je vous ai offensée par ma langue malhabile ! En vérité, madame, je suis déchiré des deux côtés et j’ai du mal à bien comprendre ce qui s’est passé.
Elle émit un petit rire en cascade.
– Je ne saurais m’en étonner ! fit-elle. Vous êtes arrivé comme le chevalier des romans qui bondit entre le dragon et la demoiselle, sans avoir beaucoup de temps pour poser des questions. Venez ! reprit-elle en se levant et en tentant de défroisser sa robe. Marchons ensemble dans le silence des halliers. Peut-être rencontrerons-nous Bertrand avec les chevaux. Si mon pauvre Troubadour n’avait pas perdu un fer, nous n’aurions pas été exposés à cet ennui. Attendez : il faut que je vous prenne le bras ; j’ai beau parler sur un ton léger, j’ai aussi peur, maintenant que tout s’est bien terminé, que mon brave Roland. Voyez comme son cœur bat ! Et il a ses chères plumes hérissées, mon petit chevalier qui ne veut pas voir sa maîtresse maltraitée !
Elle caressa son faucon. Alleyne marchait à côté d’elle et de temps à autre il lançait un coup d’œil à cette jeune fille qui avait le maintien d’une reine. En silence ils avancèrent sur le velours d’un gazon tacheté de lumière et d’ombres.
– Vous n’avez donc pas envie d’entendre mon histoire ? demanda-t-elle enfin.
– S’il vous plaît de me la dire, oui ! répondit-il.
– Oh ! s’exclama-t-elle en hochant la tête. Puisqu’elle présente si peu d’intérêt pour vous, n’en parlons plus !
– Non ! fit-il avec une sorte de passion. Je voudrais l’entendre.
– Vous avez le droit de l’entendre, puisque c’est à cause d’elle que vous avez perdu l’amitié d’un frère. Et pourtant… Oh, après tout, vous êtes clerc, d’après ce que j’ai compris ! Donc vous vous orientez vers les ordres ? Je vous prends comme directeur de conscience. Sachez que cet homme m’a courtisée, moins je pense pour mes qualités personnelles que par ambition : il avait dû se mettre dans la tête qu’il agrandirait son domaine en puisant dans le coffre-fort de mon père. Hélas, la Vierge le sait : il n’aurait pas trouvé grand-chose à l’intérieur ! Mais mon père, qui est fier, vaillant chevalier et soldat éprouvé, est d’un sang fort ancien, et la naissance grossière comme la basse ascendance du seigneur de… Oh, jour de malheur ! J’oubliais que votre origine est la même que la sienne.
– Ne vous souciez pas de cela, répondit Alleyne. Nous descendons tous de notre bonne mère Ève.
– D’une même source s’écoulent plusieurs rivières, dit-elle rapidement. Certaines sont tranquilles et douces, d’autres sont sauvages. Mais, en résumé, mon père ne voulait pas de lui comme futur gendre, et moi, à vrai dire, je ne voulais pas de lui comme mari. Quand il l’apprit il se déclara contre nous et jura de se venger. Comme il passe pour un homme dangereux, qu’épaulent de nombreux hors-la-loi et rebelles, mon père m’interdit de chasser au faucon ou au chien courant dans les bois situés au nord de la route de Christchurch. Malheureusement, ce matin je lâchai mon petit Roland que voilà sur un héron aux ailes puissantes ; Bertrand le page et moi nous nous lançâmes à sa poursuite, sans autre idée que de faire du bon sport, et nous arrivâmes dans les bois de Minstead. Jusque-là, le mal n’était pas grand ; mais mon cheval Troubadour mit sa patte déferrée sur un bâton pointu : il se cabra et me jeta par terre. Regardez ma robe : c’est la troisième que j’ai salie en une semaine. Quand Agatha, la demoiselle d’atour, la verra dans cet état, je sais ce qui m’attend.
– Et ensuite, madame ?
– Eh bien ! Troubadour partit au galop ; sans doute en tombant lui avais-je donné un coup d’éperon ; Bertrand se lança à sa poursuite. Quand je me relevai, le seigneur de Minstead en personne apparut ; il m’apprit que je me trouvais sur ses terres, mais il entoura cette nouvelle de termes si courtois et de gestes si prévenants que j’eus l’idée d’accepter son toit pour m’y réfugier en attendant le retour de mon page. Par la grâce de la Vierge et l’aide de ma patronne sainte Madeleine je me suis arrêtée avant d’arriver chez lui. Alors, comme vous l’avez vu, il a essayé de m’y traîner de force. Et puis… Ah !
Elle frissonna et vacilla comme sous le coup d’un accès de fièvre.
– Qu’y a-t-il ? s’écria Alleyne en regardant autour de lui.
– Rien, mon ami ! Je pensais à la façon dont je lui ai mordu la main. J’aurais préféré mordre dans un crapaud vivant ou dans un serpent venimeux. Oh, je maudis mes lèvres ! Mais vous… Comme vous avez été brave, et vif ! Comme vous êtes doux, et pourtant comme vous pouvez être hardi devant un inconnu ! Si j’étais un homme, j’aurais voulu faire ce que vous avez fait !
– C’est une bien petite chose ! répondit-il tout satisfait de ces louanges. Mais vous… Qu’allez-vous faire ?
– Prés d’ici il y a un grand chêne. Je pense que Bertrand y aura mené les chevaux car c’est un vieux rendez-vous de chasse pour nous. Puis tout droit à la maison, et plus de fauconnerie pour aujourd’hui ! Un galop de dix-huit kilomètres séchera mes pieds et ma robe.
– Mais votre père ?
– Oh, je ne lui dirai rien ! Vous ne le connaissez pas, mais je vous assure qu’il n’est pas homme à qui désobéir comme je l’ai fait. Il me vengerait, c’est vrai, mais ce n’est pas de lui que j’attends ma vengeance. Quelque jour, peut-être dans une joute ou dans un tournoi, un chevalier voudra porter mes couleurs ; je lui dirai alors que s’il veut vraiment mériter mes bonnes grâces il doit d’abord redresser un tort, et que l’auteur de ce tort est le seigneur de Minstead. Et mon chevalier se lancera dans une aventure comme les aiment les hardis chevaliers, et ma dette sera éteinte, et mon père n’en saura rien, et il y aura un bandit de moins sur la terre. Dites, n’est-ce pas un bon plan ?
– Non, madame. C’est un plan indigne de vous. Comment pouvez-vous parler de violence et de vengeance ? N’existe-t-il donc personne qui soit doux et aimable, pitoyable et prêt à pardonner ? Hélas ! Le monde est dur, cruel ; je voudrais n’avoir jamais quitté la cellule de mon abbaye ! Entendre de votre bouche de telles paroles, c’est comme si j’entendais un ange de grâce prêcher le credo du diable !
Elle sursauta. Elle tressaillit comme le jeune poulain qui sent le mors pour la première fois.
– Grand merci pour votre sermon, jeune seigneur ! fit-elle avec une petite révérence. Si je vous ai bien compris, vous êtes désolé de m’avoir rencontrée et vous me considérez comme un démon ? Eh bien ! mon père qui n’est pas tendre quand il est en colère ne m’a jamais appelée de ce nom. Et il en aurait le droit, et ce pourrait être son devoir, mais assurément vous n’en avez ni l’un ni l’autre. Aussi vaudrait-il mieux, puisque vous avez une si basse opinion de moi, que vous preniez ce sentier sur la gauche. Moi je continuerai par celui-ci. Je ne suis évidemment pas digne de vous accompagner plus longtemps !
Sur ces mots, elle partit droit devant elle avec une dignité que démentait à peine sa robe déchirée. Alleyne demeura cloué sur place. Il attendit en vain qu’elle se retournât ou qu’elle ralentît son pas ; au contraire elle s’éloigna d’une allure égale jusqu’à ce qu’elle ne fût plus qu’une tache indistincte parmi les feuilles. Alors il baissa la tête et, le cœur lourd, il prit l’autre chemin tout en se reprochant la maladresse de langage qui avait offensé celle qu’il n’aurait jamais voulu fâcher.
Il avait déjà parcouru une centaine de mètres quand il entendit soudain un léger craquement de feuilles mortes derrière lui ; il se retourna ; la jeune fille l’avait rattrapé ; elle se tenait sur son ombre ; elle était une vivante image de l’humilité et du repentir.
– Je ne vous chagrinerai plus, dit-elle. Et même je ne parlerai plus. Mais je préférerais rester auprès de vous tant que nous sommes dans les bois.
– Non, vous ne pourrez pas me chagriner ! répondit-il tout heureux. Ce sont mes paroles rudes qui vous ont fait de la peine. Mais toute ma vie je suis demeuré parmi des hommes et, avec la meilleure volonté, je sais mal tempérer mes propos pour l’oreille d’une jeune fille.
– Alors, s’écria-t-elle, dites-moi que j’ai raison de vouloir me venger du seigneur de Minstead !
– Non, répondit-il gravement. Cela je ne peux pas vous le dire.
– Alors, lequel maintenant est méchant et désagréable ? lança-t-elle triomphante. Comme vous êtes ferme et froid malgré votre âge ! Sûrement vous n’êtes pas un simple clerc, mais évêque ou cardinal ? Vous devriez avoir une crosse au lieu d’un gourdin et une mitre à la place d’un bonnet ! Bon, pour vous faire plaisir, je pardonnerai au seigneur de Minstead et je ne me vengerai de personne, sinon de moi qui éprouve toujours le besoin de m’exposer au danger. Serez-vous satisfait, messire ?
– C’est votre véritable personnalité qui vient de s’exprimer ! s’écria-t-il. Et vous trouverez plus de plaisir à pardonner qu’en n’importe quelle vengeance.
Elle secoua la tête, comme si elle en doutait, et puis elle poussa un cri de surprise plus que de joie.
– Voici Bertrand avec les chevaux !
Dans la clairière s’avançait un petit page habillé de vert ; il avait les yeux rieurs et de longues boucles qui flottaient derrière son cou. Il s’était hissé sur un haut cheval bai et tenait par la bride un palefroi noir ardent ; les flancs des deux montures luisaient de sueur.
– Je vous ai cherché partout, chère damoiselle Maude ! dit-il en sautant à bas du cheval pour présenter l’étrier. Troubadour a galopé jusqu’à Holmhill avant que je puisse le rattraper. J’espère que vous n’avez pas eu de mal ni de soucis ?
Il lança un regard inquisiteur vers Alleyne.
– Non, Bertrand, grâce à ce chevaleresque étranger. Et maintenant, messire, reprit-elle en se mettant en selle, il ne convient pas que je vous quitte sans vous dire un mot de plus. Clerc ou pas clerc, vous avez agi ce jour comme un véritable chevalier. Le Roi Arthur et toute sa table n’auraient pu mieux faire. Il se peut qu’en retour, mon père ou son entourage ait la faculté d’aider vos intérêts. Il n’est pas riche, mais il est estimé et il possède des amis puissants. Dites-moi ce que vous comptez faire, et voyons s’il peut vous être utile.
– Hélas, madame ! Je ne sais plus que faire. J’ai deux amis qui sont allés à Christchurch ; vraisemblablement je vais aller les rejoindre.
– Et où cela dans Christchurch ?
– Au château du vaillant chevalier Sir Nigel Loring, connétable du comte de Salisbury.
À son vif étonnement elle éclata de rire, éperonna son palefroi et s’enfonça dans les bois, suivie de son page. Elle n’ajouta pas un mot, mais avant de disparaître parmi les arbres elle se retourna pour lui adresser un dernier geste d’adieu. Il demeura là un long moment, avec l’espoir qu’elle reviendrait ; mais le bruit des sabots s’éloigna et mourut au loin ; les bois ne furent plus troublés que par le murmure des feuilles. Il se décida alors à partir et il regagna la route, mais il n’était plus l’enfant gai qui l’avait quittée trois heures auparavant pour prendre un raccourci.
CHAPITRE X
Comment Hordle John trouva un homme qu’il pouvait suivre
Puisqu’il ne pouvait pas revenir à Beaulieu avant une année et puisque son frère lâcherait ses chiens sur lui s’il reparaissait sur les terres de Minstead, il se sentit vraiment à la dérive dans le monde. Nord, est, sud, ouest, il pouvait prendre l’une ou l’autre de ces directions : toutes lui semblaient pareillement tristes et sans joie. L’Abbé avait roulé dix couronnes d’argent dans une feuille de laitue et les avait cachées au fond de sa besace, mais elles ne lui suffiraient pas pour douze longs mois. Au sein de ces ténèbres ne brillait qu’une tache claire : les deux camarades qu’il avait quittés le matin. S’il parvenait à les retrouver, tout irait bien. L’après-midi n’était guère avancé, en dépit de toutes ses aventures. En marchant vite, peut-être les rattraperait-il avant leur arrivée à Christchurch ? Il avança donc à grands pas. Tout en marchant il dévora un morceau de pain qui lui restait de Beaulieu, et il l’arrosa d’une eau fraîche qui coulait à travers bois.
Ce n’était ni facile ni plaisant de voyager ainsi au sein de cette immense forêt qui mesurait près de trente kilomètres d’est en ouest et une bonne vingtaine de Bramshaw Wood au nord, à Lymington au sud. Alleyne toutefois eut la chance de rencontrer un bûcheron qui, sa hache sur l’épaule, cheminait seul dans la même direction et lui servit de guide. Il dépassa la lisière de Bolderwood Walk, célèbre pour ses vieux frênes et ses ifs, il traversa Mark Ash et ses grands hêtres, il poussa au-delà des bosquets de Knightwood où le chêne géant n’était qu’un grand arbre parmi beaucoup d’autres d’une taille considérable. Le bûcheron et Alleyne avançaient sans se parler beaucoup car leurs pensées étaient aussi éloignées que les pôles. Le paysan avait essayé de mettre la conversation sur la chasse, les fougères, les milans à tête grise qui hantaient Wood Fidley, et la formidable pêche au hareng réussie par les bateaux de Pitt’s Deep. Mais le clerc réfléchissait à son avenir, pensait à son frère et surtout à cette étrange jeune fille, belle, farouche, attendrissante qui avait surgi si brusquement dans sa vie pour s’en retirer aussi vite. Il était si distrait et si avare de réponses que le bûcheron préféra siffloter. Bientôt il bifurqua vers Burley, et laissa Alleyne sur la route de Christchurch.
Le jeune homme força l’allure. À chaque tournant ou à chaque côte il espérait apercevoir ses compagnons de la matinée. De Vinney Ridge à Rhinefield Walk la route était bordée de bois touffus et denses ; mais ensuite la campagne se transforma ; une vaste lande brune apparut avec des bouquets d’arbres ; elle se prolongeait par de molles ondulations jusqu’au rideau sombre des forêts lointaines. Des nuées d’insectes dansaient dans la lumière dorée de l’automne, et le pépiement des oiseaux emplissait l’air tiède. De longues libellules chatoyantes s’élançaient en travers du chemin ou restaient suspendues, immobiles et frémissantes, avec leurs ailes transparentes et leurs corps lumineux. Une fois une orfraie au col blanc plana haut au-dessus de la tête du voyageur ; puis une troupe d’outardes brunes émergea d’un buisson de fougères arborescentes et disparut en poussant des cris stridents et en battant des ailes.
La route était aussi fréquentée par des êtres humains : des mendiants, des courriers, des colporteurs et des chaudronniers ambulants ; joyeux lurons pour la plupart, ils se saluaient ou saluaient Alleyne d’un mot leste. Près de Shotwood il rencontra cinq marins qui venaient de Poole et se rendaient à Southampton : c’étaient des hommes au visage rouge et rude qui l’interpellèrent dans un jargon incompréhensible et lui présentèrent un grand pot où ils venaient de boire ; ils ne voulurent pas le laisser passer avant qu’il eût trempé dedans son gobelet ; il avala une lampée, toussa et s’étrangla au point que des larmes jaillirent à ses yeux. Plus loin il tomba sur un robuste cavalier à barbe noire qui tenait un rosaire dans sa main droite ; une longue épée à double poignée cliquetait contre l’étrier. À sa robe noire et à la croix à huit branches peinte sur sa manche, Alleyne reconnut l’un des Chevaliers Hospitaliers de saint Jean de Jérusalem, dont le presbytère était situé à Baddesley. Il leva deux doigts quand il passa près du clerc, avec un « Benedic, fili mi ! » auquel Alleyne répondit en se découvrant et en s’agenouillant, plein de respect pour cet homme qui avait voué sa vie à la défaite des Infidèles. Pauvre naïf ! Il n’avait pas encore appris à distinguer entre ce que sont les hommes et ce qu’ils font profession d’être. Il ne savait pas que les chevaliers de saint Jean, enrichis des dépouilles des Templiers, ne songeaient nullement à troquer leur palais pour une tente, ni les caves d’Angleterre pour les déserts arides de Syrie. Il arrive pourtant que l’ignorance soit plus précieuse que la sagesse : Alleyne en reprenant sa route se fortifia en vue d’une vie plus haute, à l’image du chevalier et en pensant à son sacrifice (ce qu’il n’aurait sans doute pas fait s’il avait su que les Hospitaliers s’intéressaient plus aux malvoisies qu’aux Mameluks et à la venaison qu’à des victoires).
La plaine, dans la région de Wilverley Walk, aboutit une fois de plus à des bois, et un nuage du sud monta à l’assaut du ciel. Quelques grosses gouttes s’écrasèrent sur le sol, précédant une forte averse qui résonna sur les feuilles. Alleyne chercha autour de lui un abri et aperçut un gros buisson de houx, si bien creusé par-dessous qu’aucune maison n’aurait été plus sèche. Sous ce dais, deux hommes étaient déjà accroupis, et par de grands signes ils invitèrent Alleyne à les rejoindre. Quand il approcha il vit qu’ils avaient disposé devant eux cinq harengs séchés, une grande miche de pain et une gourde en cuir pleine de lait. Mais au lieu de manger ils avaient l’air de se disputer. D’après leur costume et leurs manières, c’était sûrement deux de ces étudiants errants dont le nombre était alors considérable dans tous les pays d’Europe. L’un, long et mince, avait une tête mélancolique ; l’autre était gras et parlait fort, du ton de quelqu’un qui ne souffre pas d’être contredit.
– Venez ici, bon jeune homme ! cria-t-il. Venez ici ! Vultus ingenui puer. Ne faites pas attention au visage de mon brave ami. Fœnum habet in cornu, comme l’a dit Horace ; mais je ne lui en veux pas de mal pour cela.
– Faites fonctionner un peu moins fort votre soufflet ! s’écria l’autre. Puisque vous avez cité Horace, je me rappelle un vers : Loquaces si sapiat… Quelle est la suite ? Bref, cela veut dire en clair qu’un homme sensé doit toujours éviter un grand bavard. Si tous les hommes étaient sensés, vous vous sentiriez bien seul, l’ami !
– Hélas ! Dicon, je crains que votre logique ne soit aussi mauvaise que votre philosophie ou que votre théologie. Et Dieu sait si celles-ci sont mauvaises ! Écoutez-moi : en supposant, propter argumentum, que je sois un grand bavard, le véritable raisonnement est donc celui-ci : que puisque tous les hommes sensés devraient me fuir et que vous ne m’avez pas fui, mais que vous êtes pour l’instant en train de manger des harengs avec moi sous un buisson de houx, ergo vous n’êtes pas un homme sensé, ce que je susurre à vos longues oreilles depuis le premier jour où j’ai jeté les yeux sur vos côtelettes tombantes.
– Tut, tut ! cria l’autre. Votre langue ressemble au traquet d’un moulin. Asseyez-vous ici, mon ami, et goûtez à ces harengs. Mais comprenez d’abord que cette dégustation s’accompagne de certaines conditions.
– J’avais espéré, dit Alleyne en s’associant à l’humour des deux étudiants, que les harengs pourraient s’accompagner d’une tranche de pain et d’une gorgée de lait.
– Écoutez-le ! s’exclama le petit gros. C’est toujours ainsi, Dicon. L’esprit, mon enfant, est une chose qui s’attrape, comme la gale ou la fièvre. Je sue l’esprit par tous mes pores : c’est une aura qui m’environne. Je vous le dis, ami : aucun homme ne peut s’approcher de moi à moins de six mètres sans attraper une étincelle. Réfléchissez à votre propre cas. Jamais esprit plus terne ne m’a approché ; et pourtant cette semaine vous avez dit trois choses passables, plus une, le jour où nous avons quitté Fordingbridge, dont je n’aurais pas eu honte moi-même.
– Assez, crécelle ! fit l’autre. Le lait, vous l’aurez et du pain aussi, ami, avec le hareng, mais il vous faudra nous départager.
– Dites-nous, brave jeune homme, intervint le petit gros, si vous êtes un clerc instruit et si vous avez étudié à Oxenford ou à Paris.
– J’ai une certaine instruction, répondit Alleyne en s’emparant d’un hareng, mais je ne suis allé ni à Oxenford ni à Paris. J’ai été élevé par des moines cisterciens à l’abbaye de Beaulieu.
– Peuh ! crièrent-ils ensemble. Quelle sorte d’éducation est-ce là !
– Non cuivis contingit adire Corinthum, cita Alleyne.
– Allons, Stephen, il a une petite teinture ! fit le grand mélancolique d’une voix pleine d’espoir. Il peut être le meilleur juge puisqu’il ne nous connaît ni l’un ni l’autre. Donc, attention, ami ! Que vos oreilles travaillent comme votre mâchoire inférieure ! Jurex damnatur… Vous n’ignorez pas le vieil adage. Me voici donc soutenant la bonne réputation de Duns Scot contre les babillages et les raisonnements stupides de Willie Ockham.
– Tandis que moi, cria l’autre, je soutiens le bon sens et la sagesse extraordinaire du très érudit William contre les fantaisies du cerveau fêlé et fangeux de cet Écossais, qui a caché le petit peu d’esprit qu’il possède sous un fatras de mots : une goutte de vin de Gascogne dans un tonnelet d’eau stagnante. Toute la sagesse de Salomon serait insuffisante à démêler ce que veut dire ce coquin.
– Certes, Stephen Hapgood, sa sagesse ne saurait suffire. C’est comme si une taupe s’emportait contre l’étoile du matin parce qu’elle ne peut pas l’apercevoir. Mais notre débat, ami, porte sur la nature de cette essence subtile que nous appelons la pensée. Je maintiens avec Scot que la pensée est en vérité une chose, qu’elle soit vapeur ou exhalaison ou toute substance invisible à nos yeux imparfaits. Car, voyez-vous, ce qui produit une chose doit être soi-même une chose, et si la pensée d’un homme peut produire un livre écrit, alors la pensée doit être elle-même une chose matérielle, comme le livre qui l’a exprimée. Me suis-je fait comprendre ?
– Tandis que moi, cria l’autre, je soutiens avec mon maître respecté, doctor præclarus et excellentissimus, que toutes les choses ne sont que pensée : car quand la pensée s’en va, dites-moi, je vous prie, où sont les chose ? Voici des arbres autour de nous ; je les vois parce que je pense que je les vois ; mais si je suis évanoui, ou endormi, ou ivre de vin, ma pensée s’en va de moi, et les arbres s’en vont aussi. Alors, Dicon, ne vous ai-je pas touché au vif ?
Alleyne, assis entre eux, mastiquait son pain pendant qu’ils se disputaient par-dessus ses genoux, têtes en avant et mains brandies, bouillants de chaleur argumentielle. Jamais il n’avait entendu un tel jargon de scolastique. Il ignorait tout de ces distinctions subtiles, de ce feu croisé de propositions majeures et mineures, des syllogismes, des postulats et des réfutations. Les questions et les réponses cliquetaient comme des épées. Ils se lançaient à la tête les anciens, les Pères de l’Église, les modernes, les Écritures, les Arabes, tandis que la pluie continuait à s’égoutter des branches et qu’une odeur de terre mouillée se levait du sol. Finalement le petit gros sembla se lasser, car il se mit à attaquer son repas, pendant que son adversaire, aussi fier qu’un coq invaincu, se lançait dans un long monologue entrecoupé de citations. Tout à coup, cependant, ses yeux tombèrent sur les provisions et il poussa un cri d’effroi.
– Voleur ! Deux fois voleur ! s’exclama-t-il. Vous avez mangé mes harengs, et je n’ai rien pris depuis ce matin !
– Cela, fit l’autre avec suffisance, était mon argument final, mon ultime effort ou peroratio, comme disent les orateurs. Car, mon ami, puisque toutes les pensées sont des choses, vous n’avez qu’à penser à une paire de harengs et à imaginer un pot de lait pour les arroser.
– Joli raisonnement ! cria l’autre. Auquel je ne vois qu’une réponse…
Sur ce, il se pencha en avant et frappa rudement son camarade sur la joue.
– … Non, ne le prenez pas mal ! fit-il. Puisque toutes les choses ne sont que pensées, cela aussi n’est qu’une pensée, et peut être dédaignée.
Ce dernier argument ne fit pas néanmoins grande impression sur le disciple d’Ockham qui ramassa un grand bâton et exprima son désaccord en cognant dur sur la caboche du réaliste. Par une heureuse coïncidence le bois était si léger et si pourri qu’il se brisa en mille morceaux. Mais Alleyne jugea plus sage de laisser les deux étudiants régler leur différend entre eux seuls, d’autant plus que le soleil avait fait sa réapparition. Une fois revenu sur la route détrempée, il se retourna et aperçut les philosophes se menaçant du geste et de la parole, mais leurs cris s’affaiblirent au fur et à mesure qu’il prit ses distances ; un tournant les cacha à sa vue.
Après Holmesley Walk et Wooton Heath, la forêt commença enfin à se clairsemer ; des champs de blé et des pâturages se glissèrent entre les arbres. Par endroits se dressaient de petites agglomérations de cabanes en torchis, auprès desquelles flânaient des cultivateurs à tignasse ébouriffée ; des petits enfants jouaient au milieu de la route. Derrière des bosquets il distingua des pignons et des toits de chaume qui appartenaient à des maisons cossues : les hommes trouvaient de l’embauche aux champs ; souvent une épaisse colonne de fumée noire révélait l’abondance. À ces signes Alleyne comprit qu’il se trouvait à la lisière de la forêt et près de Christchurch. Le soleil était bas vers l’ouest ; ses rayons s’allongeaient sur un riche pays vert, faisaient miroiter le blanc des moutons et projetaient d’immenses ombres sur les vaches rouges amoureuses du trèfle. Le voyageur fut bien content d’apercevoir la haute tour du prieuré de Christchurch éclairée par la douce lumière du soir, mais encore plus content quand, au bout d’un virage, il vit ses deux camarades assis à califourchon sur une branche tombée. Ils disposaient d’un espace plat devant eux, et ils y jetaient l’un après l’autre des petits carrés d’os ; ils étaient tellement absorbés par leur occupation qu’ils ne levèrent même pas les yeux. Alleyne constata avec étonnement que l’arc du soldat était sur le dos de John, que l’épée du soldat était accrochée au côté de John, et que le casque d’acier était posé sur le tronc d’arbre entre eux deux.
– Mort de ma vie ! criait Aylward. A-t-on jamais vu plus de malchance ? Depuis que j’ai quitté la Navarre je n’ai pas eu un jeu. Un et trois ! En avant, camarade !
– Quatre et trois ! s’écria Hordle John en comptant sur ses doigts. Cela fait sept. Holà, archer, ton casque est à moi ! Maintenant, attention à ton justaucorps !
– Mon Dieu ! gémit l’archer. Je vais arriver à Christchurch en chemise…
Puis tout à coup il tourna la tête.
– … Holà ! Par la splendeur du ciel, voici notre cher petit ! Par les os de mes dix doigts, quelle heureuse vision !
Il se leva d’un bond et passa ses bras autour du cou d’Alleyne. John, non moins satisfait mais plus réservé et très Saxon de manières, demeura immobile, souriant de toutes ses dents, coiffé du casque qu’il avait posé à l’envers sur ses cheveux roux.
– Tu t’arrêtes ? demanda l’archer. Si tu t’arrêtes, je te préviens que tu ne nous quitteras plus !
– Je ne souhaite rien de mieux, répondit Alleyne tout ému par la cordialité de l’accueil.
– Bien parlé, enfant ! cria le gros John. Nous irons à la guerre tous les trois, et que le diable emporte l’Abbé de Beaulieu ! Mais tu as les pieds et les chausses tout salis. Tu t’es promené dans l’eau, ou je me trompe fort !
– Tu ne te trompes pas, dit Alleyne.
Pendant qu’ils se remettaient en route il leur raconta ses aventures : sa rencontre du serf évadé, l’apparition du Roi, son arrivée sur les terres de son frère, l’histoire de la belle damoiselle et du méchant seigneur de Minstead… L’encadrant, ils buvaient ses paroles ; mais avant qu’il eût terminé, l’archer vira sur ses talons et partit au petit trot sur la route qu’ils venaient de parcourir ; il soufflait par les narines comme un cheval de course. Alleyne le rattrapa par la manche.
– Qu’est-ce qui te prend ? demanda-t-il.
– Je retourne à Minstead.
– Et pourquoi faire ?
– Pour enfoncer quelques pouces d’acier dans la peau de ce seigneur de Minstead. Comment ! Entraîner une damoiselle contre sa volonté, puis lâcher ses chiens contre son propre frère ? Laisse-moi y aller !
– Que nenni ! s’écria Alleyne en riant. Il ne nous a fait aucun mal. Reviens, ami !
Moitié en le tirant, moitié en le suppliant, il lui fit reprendre la direction de Christchurch. Mais l’archer avança en gardant le menton bas ; ce ne fut que lorsqu’il aperçut une servante auprès d’un puits qu’il retrouva son sourire.
– Mais vous ? s’enquit Alleyne. Il y a eu du changement pour vous aussi. Pourquoi l’ouvrier ne porte-t-il pas lui-même ses outils ? Où sont l’arc, l’épée et le casque ? Et pourquoi John a-t-il une allure si belliqueuse ?
– À cause d’un jeu que l’ami Aylward m’a enseigné.
– J’ai trouvé un élève un peu trop doué, grogna l’archer. Il m’a dépouillé comme si j’étais tombé entre les mains d’une douzaine de brigands. Mais par ma garde, il faut que tu me les rendes, camarade ! Sinon je serais discrédité pour remplir ma mission. Je t’en achèterai chez un armurier.
– Reprends-les, et ne te soucie pas de m’en payer d’autres, répondit John. Je ne voulais qu’apprendre ce que je ressentirais en portant l’équipement qui sans doute sera le mien pendant quelques années.
– Ma foi, il était né pour être un compagnon franc ! s’exclama Aylward. Il en a la manière de parler et la tournure d’esprit. Je les reprends donc ; d’ailleurs j’étais gêné de ne pas sentir mon arc en bois d’if taper contre l’os de ma jambe. Regardez, mes garçons ; de ce côté de l’église se profile la tour carrée du château du comte de Salisbury. D’ici il me semble que je vois sur la bannière le chevreuil rouge des Montacute.
– Rouge sur fond blanc, confirma Alleyne en s’abritant les yeux. Mais pour le chevreuil, je n’en saurais rien dire. Comme cette grande tour est noire, et comme resplendit sur la muraille l’éclat de l’écu ! Sous l’étendard, quelque chose scintille comme une étoile.
– Oui, c’est le casque du guetteur, expliqua l’archer. Mais il nous faut pousser de l’avant, si nous voulons arriver avant que se relève le pont-levis au bugle des vêpres. Sir Nigel, si réputé comme soldat, veille certainement sur la discipline à l’intérieur du château et personne ne peut entrer après le coucher du soleil !
Par hasard, ce soir-là, Sir Nigel Loring avait soupé avant le coucher du soleil ; après avoir vérifié si Pommers et Cadsand (ses deux destriers), ses treize chevaux de selle, ses cinq ganets, les trois palefrois de Lady Loring, et le grand roussin gris pommelé avaient été bien soignés, il avait sorti ses chiens pour prendre l’air. Il en avait soixante ou soixante-dix, des grands et des petits, des chiens à poils doux et des chiens à poils durs : limiers, chiens courants, vautres, chiens-loups, dogues, chiens de berger, fox-terriers, épagneuls, etc. Ils descendirent derrière lui, aboyant, geignant, appelant, soufflant et barrant de leur meute le chemin étroit qui menait des chenils de Twynham aux bords de l’Avon ; ils avaient la langue pendante et la queue bien droite ; deux valets en livrée roussâtre criaient et brandissaient des fouets au milieu de ce flot canin pour tenter de le canaliser. Derrière venait Sir Nigel qui donnait le bras à Lady Loring ; tous deux marchaient lentement, paisiblement, comme il convenait à leur âge et à leur qualité ; ils surveillaient en souriant l’armée en désordre qui les précédait. Ils s’arrêtèrent devant le pont, s’accoudèrent sur le parapet et regardèrent le reflet de leurs visages dans l’eau où sautaient des truites saumonées.
Sir Nigel était frêle et de petite taille ; il zézayait en parlant et il avait des gestes doux. Sa femme, qui n’était pas une géante, le dominait de la largeur de trois doigts. Il avait eu la vue affaiblie de bonne heure par un sac de chaux qui avait été vidé sur sa tête quand il conduisait la colonne d’assaut du comte de Derby à l’attaque de la brèche de Bergerac ; il avait contracté là une légère voussure du dos, ainsi qu’un clignotement des yeux. Il avait quarante-six ans, mais une constante pratique des armes et une existence saine lui avaient conservé une activité et une endurance extraordinaires ; de loin il paraissait avoir les membres grêles et la fragilité d’un enfant ; cependant sa figure était jaunâtre, tannée comme du cuir ; il avait à coup sûr durement vécu au grand air ; la petite barbe en pointe qu’il portait pour se conformer à la mode était parsemée de fils gris. Il avait des traits fins, délicats, réguliers, un nez busqué, des yeux proéminents. Son costume était simple mais soigné. Sur le chapeau flandrien (qu’il portait rabattu sur le côté gauche afin de cacher l’oreille qui avait été en partie déchirée par un Flamand au siège de Tournai), l’image de Notre Dame d’Embrun était accrochée au ruban. Sa tunique et son haut-de-chausses étaient de couleur pourpre ; de longs crêpes pendaient de ses manches jusqu’à ses genoux. Il avait des chaussures en cuir rouge, pointues, qui toutefois n’atteignaient pas cette longueur extravagante que le prochain règne allait mettre à l’honneur. Il était ceint d’un baudrier brodé d’or, et ses armes (cinq roses rouges sur champ d’argent) étaient adroitement ciselées sur l’agrafe. Tel était Sir Nigel Loring, tandis qu’il bavardait avec Lady Loring sur le pont.
Certes si un étranger avait vu les deux visages seulement et s’il lui avait été demandé lequel appartenait au hardi guerrier dont le nom était aimé par les plus rudes soldats de l’Europe, il aurait désigné celui de Lady Loring. Elle avait la figure carrée, des sourcils épais et les yeux de quelqu’un habitué à commander. Elle était plus grande et plus grosse que son mari ; une robe de soie à traîne et une écharpe bordée de fourrure ne parvenaient pas à dissimuler l’épaisseur de sa silhouette. C’était l’époque des femmes martiales. Les exploits de la brune Agnès de Dunbar, de Lady Salisbury et de la comtesse de Montfort étaient encore frais dans la mémoire du public. Avec de tels exemples, les épouses des capitaines anglais avaient pris l’allure guerrière de leurs maris, et en l’absence de ceux-ci elles régissaient leurs châteaux avec la prudence et la discipline de vieux sénéchaux. Les Montacute n’avaient aucune inquiétude pour leur château de Twynham : il ne risquait pas grand-chose d’une galère pirate ou d’une escadre française tant que Lady Mary Loring en assumait la charge. Certains assuraient que de toutes les actions d’éclat où Sir Nigel Loring avait prouvé son courage, la moindre n’était pas d’avoir courtisé la main d’une dame de cette trempe.
– Je vous assure, cher seigneur, disait-elle, que ces distractions ne conviennent pas à une damoiselle : faucons et chiens courants, violes et citoles, chanter un rondeau français, lire les Gestes de Doon de Mayence… Je l’ai trouvée hier soir faisant semblant de dormir, la rusée, avec le coin du rouleau débordant de l’oreiller ! Il lui a été prêté par le Père Christopher du prieuré, c’est son éternelle réponse. Comment tout cela l’aidera-t-il quand elle aura un château à diriger, avec cent bouches ouvertes pour réclamer du bœuf et de la bière ?
– C’est vrai, ma douce oiselle, très vrai ! répondit le chevalier en prenant un bonbon dans une boite en or. Cette jeune fille ressemble à une jeune pouliche qui s’ébroue et se jette dans les plaisirs de la vie. Donnez-lui du temps, madame, laissez passer sa jeunesse !
– Je sais bien ce que mon père m’aurait donné : pas du temps, mais de la baguette de noisetier sur les épaules. Ma foi ! Je ne sais plus où va le monde, quand les jeunes filles font fi de l’autorité de leurs aînées. Je suis surprise que vous ne la corrigiez pas, mon cher seigneur !
– Non, douceur de mon cœur ! Je n’ai jamais levé la main sur une femme, et il serait en vérité curieux que je commence sur le fruit de ma chair et de mon sang. C’est une femme qui m’a jeté de la chaux dans les yeux ; quoique je l’eusse vue qui se penchait et que j’eusse pu arrêter sa main à temps, j’ai estimé qu’un chevalier n’avait pas à contrarier ni à gêner une personne du sexe.
– La coquine ! s’écria Lady Loring en serrant ses grosses mains. Si je m’étais trouvée à côté d’elle !…
– Je l’aurais bien voulu, ma chère, puisque vous auriez été ainsi tout près de moi ! Mais je crois que vous avez raison, et que les ailes de Maude ont besoin d’être rognées. Je vous en laisserai le soin quand je serai parti, car, à vrai dire, cette existence tranquille n’est pas pour moi ; sans votre amour attentif et vos gracieuses bontés je serais incapable de végéter ici plus d’une semaine. J’ai entendu dire qu’on préparait un nouveau rassemblement à Bordeaux et, par saint Paul, ce serait bien la première fois si les lions d’Angleterre et la pile rouge de Chandos paraissaient sur un champ de bataille sans que les roses de Loring flottassent à côté !
– Voilà bien le malheur que je redoutais ! s’écria-t-elle toute pâle. J’avais remarqué vos distractions, votre regard attendri, vos rafistolages d’équipements. Considérez, mon doux seigneur, que vous avez déjà acquis beaucoup d’honneurs, que nous nous sommes bien peu vus l’un et l’autre, que vous portez sur votre corps les cicatrices de vingt blessures reçues dans je ne sais combien de combats sanglants. N’avez-vous donc pas assez fait pour l’honneur et le bien public ?
– Madame, quand notre suzerain le Roi, qui a près de soixante ans, et Lord Chandos, qui en a soixante-dix, sont joyeusement prêts à mettre la lance en arrêt pour la cause de l’Angleterre, je serais malvenu de me vanter des services que j’ai rendus. Il est exact que j’ai reçu vingt-sept blessures. Raison de plus pour que je rende grâces d’être encore solide et résistant. J’ai vu aussi quelques querelles et quelques échauffourées. Je compte six grandes batailles sur terre, plus quatre en mer, et cinquante-sept assauts, escarmouches et embuscades. J’ai été assiégé vingt-deux fois, et j’ai participé à la prise de trente et une villes. De toute évidence il serait très honteux de ma part, et aussi de la vôtre puisque vous portez mon nom, que je me dérobe devant un travail viril. En outre, réfléchissez à la minceur de notre bourse. Si nous n’avions pas eu le gouvernement de ce château que nous a confié le comte de Salisbury, nous pourrions à peine tenir notre rang. En conséquence, ma douceur, il est extrêmement nécessaire que je me rende là où il y a un bon salaire à gagner et de belles rançons à conquérir.
– Ah, mon cher seigneur ! fit-elle d’un visage triste et las. Je croyais qu’enfin je vous avais à moi seule, puisque vous aviez passé au loin une si grande partie de votre jeunesse. Et pourtant il faut que ma voix, je ne le sais que trop, vous pousse vers la gloire et la renommée et ne vous retienne pas lorsqu’il y a de l’honneur à glaner. Que pourrais-je vous dire ? Tout le monde est persuadé que votre valeur a davantage besoin d’un mors que d’un éperon. J’ai mal quand je pense que vous êtes obligé de partir à présent comme un simple bachelier empirant à la chevalerie, alors que dans tout le pays aucun noble n’a meilleur droit que vous au pennon carré, mais nous n’avons pas assez d’argent pour l’arborer.
– Et si nous n’avons pas assez d’argent, à qui la faute, ma douce amie ?
– Il ne s’agit pas de faute, mon beau seigneur, mais de vertu. Car combien de rançons n’avez-vous pas gagnés ? Mais vous semiez les couronnes parmi les pages, les archers, les valets, et une semaine plus tard il vous restait à peine de quoi acheter des vivres et du fourrage. Ce sont là largesses très chevaleresques ; pourtant sans argent, comment peut-on s’élever ?
– L’argent, l’argent souille ! s’écria-t-il. Qu’importe de s’élever ou de choir, du moment que le devoir est accompli et que l’honneur est sauf ! Chevalier banneret ou aspirant, pennon carré ou pointu, je ne donnerais pas un denier pour la différence ! Songez à Sir John Chandos : fleur élue de la chevalerie anglaise, n’est-il pas simple chevalier ? Cependant ne vous irritez pas, colombe de mon cœur, car il se pourrait qu’il n’y eût plus de guerres. Il faut attendre des nouvelles. Mais voici trois étrangers dont l’un, si je ne m’abuse, est un soldat frais émoulu du service. Sans doute nous apprendra-t-il ce qui se trame de l’autre côté de l’eau.
Lady Loring leva les yeux. Elle vit dans la lumière du crépuscule trois hommes qui cheminaient côte à côte sur la route ; ils étaient gris de poussière mais ils bavardaient gaiement entre eux. Celui du milieu était jeune et avenant, avec un visage bien franc et des yeux gris clairs qui regardaient à droite et à gauche comme s’ils trouvaient le monde neuf et plaisant. À sa droite marchait un colosse roux qui affichait un large sourire et dont le vêtement donnait l’impression qu’il allait éclater et se fendre sur les coutures. De l’autre côté un archer trapu et robuste avait posé sa main noueuse sur l’épaule du jeune garçon ; il était armé d’une épée et d’un long arc jaune ; son teint hâlé, son visage dur, son casque bosselé, sa brigandine usée, le lion de saint Georges qui se dressait sur un tissu décoloré, tout indiquait qu’il rentrait de l’un des théâtres de la guerre. Il regarda avidement Sir Nigel quand il approcha, puis, enfouissant une main sous son plastron, il s’avança vers lui non sans s’être gauchement incliné devant Lady Loring.
– Je vous demande pardon, noble seigneur, dit-il, mais je crains que vous n’ayez oublié quelqu’un qui fut jadis votre humble ami et camarade.
– Non, tu es Samkin Aylward ! s’écria le chevalier. Et bien souvent j’ai pensé à toi ! Il y a de nombreuses années que je ne t’ai vu.
– Hé oui, mon maître ! Bien des jours se sont écoulés depuis qu’ensemble nous avons quitté Tilford pour faire la guerre.
– C’est une grande joie de te revoir ! Repose-toi d’abord, puis tu viendras nous dire ce qui se passe en France. On m’a affirmé que nos pennons pourraient bien flotter d’ici un an au sud des grands monts d’Espagne.
– On en parlait à Bordeaux, répondit l’archer. Et j’ai constaté moi-même que les armuriers et les forgerons étaient aussi occupés que des rats dans une cale de blé. Mais je vous apporte cette lettre du vaillant chevalier gascon Sir Claude Latour. Et à vous, Madame, j’apporte de sa part une boîte de sucre rouge de Narbonne, accompagnée de tous les vœux chevaleresques et courtois qu’un galant gentilhomme peut adresser à une belle et noble dame.
Ce petit discours avait coûté à l’archer beaucoup de peine et de préparatifs. Mais il aurait pu se les épargner, car la dame se montra aussi intéressée par la lettre que son seigneur ; ils la tenaient chacun par un coin et ils la déchiffraient très lentement, épelant chaque mot d’une bouche incertaine en fronçant les sourcils. Pendant qu’ils la lisaient, Alleyne, qui était demeuré avec Hordle John à quelques pas derrière leur camarade, vit Lady Loring retenir sa respiration ; mais le chevalier, lui, se mit à rire doucement.
– Vous voyez, cher cœur ! fit-il. On ne laisse pas le vieux chien au chenil quand une chasse se prépare. Dis-moi. Aylward, quelle est cette Compagnie Blanche ?
– Ah, mon bon seigneur, vous parliez de chiens ? Imaginez une meute de limiers avides de n’importe quel gibier pourvu qu’ils aient un bon piqueur pour les faire courir. Messire, nous avons été ensemble dans beaucoup de guerres, et j’ai vu beaucoup de braves, mais jamais une telle compagnie de vaillants. Il ne manque que vous à leur tête ; personne ne pourrait leur barrer le passage.
– Pardieu ! dit Sir Nigel. S’ils sont tous comme leurs ambassadeurs, voilà des hommes dont un chef s’enorgueillirait à bon droit ! Comment s’appelle ce géant derrière toi ?
– C’est le gros John de Hordle, un forestier qui vient de s’engager dans la Compagnie.
– Tout à fait la silhouette d’un homme d’armes ! commenta le petit chevalier. Tu n’es pas une mauviette, Samkin Aylward, mais je crois qu’il est plus fort que toi. Voyez-vous cette grosse pierre du couronnement du mur qui est tombée sur le pont ? Quatre de mes fainéants de valets ont essayé aujourd’hui de la bouger. Je voudrais que pour leur faire honte vous deux la fassiez basculer dans l’eau. Je crains pourtant que la tâche ne soit trop rude pour vous, car la pierre est terriblement lourde.
Il désigna un gros bloc de rocher sur le caniveau ; son poids l’avait enfoncée dans le sol rougeâtre. L’archer s’en approcha et releva les manches de son justaucorps ; il n’avait pas l’air trop sûr de lui car vraiment il s’agissait d’un lourd morceau de roc. Mais John l’écarta de sa main gauche, se pencha sur la pierre et, à lui seul, la souleva du trou qu’elle avait creusé ; d’une poussée il la jeta dans l’Avon. La pierre tomba parmi de grandes éclaboussures ; un angle pointu dépassait la surface de l’eau : un remous se dessina tout autour.
– Bien joué ! cria Sir Nigel.
Et Lady Loring en écho répéta :
– Bien joué !
John, hilare, secoua la poussière de ses doigts.
– J’ai éprouvé la force de ses bras autour de mes côtes, dit l’archer. Rien que d’y penser, elles craquent encore. Mon autre camarade est un clerc instruit, malgré sa jeunesse ; il s’appelle Alleyne et il est fils d’Edric et frère du seigneur de Minstead.
– Jeune homme, déclara Sir Nigel avec une grande fermeté, si tu as les mêmes idées que ton frère, tu ne franchiras pas ma herse.
– Non, mon bon seigneur ! s’écria Aylward. Je suis là pour témoigner qu’ils n’ont rien de commun ; aujourd’hui même son frère a lâché ses chiens contre lui et l’a chassé de ses terres.
– Appartiens-tu aussi à la Compagnie Blanche ? s’enquit Sir Nigel. Tu n’as eu qu’une petite expérience de la guerre, à en juger par ta contenance et ta physionomie.
– Je voudrais aller en France avec mes amis que voici, répondit Alleyne. Mais je suis un homme de paix : lecteur, exorciste, acolyte, et clerc.
– Ce n’est pas un obstacle, dit Sir Nigel.
– Non, mon bon seigneur ! s’écria joyeusement l’archer. Après tout, j’ai moi-même servi deux trimestres avec Arnold de Cervolles, celui que l’on appelait l’archiprêtre. Par ma garde ! Je le revois encore avec sa robe de moine retroussée jusqu’aux genoux et marchant avec du sang par-dessus les sandales au premier rang de la bataille. Il se mettait à quatre pattes auprès des blessés et, avant qu’ils eussent rendu le dernier souffle, il les confessait et leur donnait l’absolution ; il allait aussi vite qu’à écosser des pois. Ma foi ! J’en connais qui auraient préféré le voir s’occuper un peu moins des âmes et un plus des corps !
– Il est bon d’avoir un clerc instruit dans chaque unité, fit observer Sir Nigel. Par saint Paul, il existe des hommes assez misérables pour mettre plus haut que le sourire de leur dame la plume d’un scribe, ils font leur devoir en espérant qu’ils seront peut-être cités dans une chronique ou dans la ballade d’un jongleur. Je me rappelle qu’au siège de Retters il y avait un petit clerc gras, luisant qui s’appelait Chaucer ; il versifiait si facilement que personne n’osait reculer d’un pas devant les murs, tant on redoutait d’avoir son nom dans un couplet et d’être chanté par tous les valets du camp. Mais, oiselle de mon âme, vous m’entendez discourir comme si tout était décidé, alors que je n’ai pris conseil ni de vous ni de madame ma mère. Rentrons dans nos appartements, tandis que ces étrangers trouveront dans le cellier et à l’office tout ce dont ils auront besoin.
– L’air fraîchit, murmura Lady Loring qui reprit la route une main posée sur le bras de son seigneur.
Les trois camarades suivirent. Aylward était tout heureux d’avoir rempli sa mission ; Alleyne s’émerveillait des humbles manières d’un capitaine si célèbre ; John reniflait, ricanait pour exprimer sa déception et son mépris.
– Qu’est-ce qui ne va pas ? interrogea Aylward surpris.
– J’ai été trompé et filouté, répondit-il d’un ton bourru.
– Par qui, messire Samson le fort ?
– Par toi, messire Balaam le faux prophète.
– Je ne suis pas Balaam, s’exclama l’archer. Bien que je converse présentement avec l’animal qui lui parla. Qu’est-ce qui ne va pas ? Et comment t’ai-je dupé ?
– N’as-tu pas déclaré, et Alleyne était témoin, que si je t’accompagnais à la guerre tu me placerais sous les ordres d’un chef qui en Angleterre ne le cédait à personne pour la valeur ? Or tu me présentes un lambeau d’homme hâve et mal poussé, avec des yeux comme ceux d’un hibou qui mue, un avorton qui, de surcroît, demande à sa mère la permission de ceindre l’épée ?
– Est-ce là où le bât te blesse ? fit l’archer en riant. Dans trois mois d’ici je te demanderai ce que tu penses de lui, si nous sommes encore en vie. Car il est certain que…
La phrase d’Aylward fut interrompue par un vacarme extraordinaire qui éclata en bas de la rue dans la direction du prieuré. Des hommes criaient, des femmes hurlaient, des roquets aboyaient ; mais le bruit dominant était un grondement de tonnerre, menaçant et terrible. De la rue étroite déferlèrent deux chiens geignants qui avaient la queue piteusement repliée sous leurs pattes, puis un bourgeois blême, à la barbe hérissée, qui tendait les bras en avant avec les doigts écartés, et qui jetait des coups d’œil par-dessus ses épaules comme s’il était poursuivi par quelque chose de terrible.
– Fuyez, madame, fuyez ! cria-t-il en passant près de nous avec la vitesse d’une flèche.
Le serrant de près en effet apparut un ours noir énorme. Sa langue rouge pendait de sa gueule béante. Une chaîne brisée cliquetait derrière lui. À droite et à gauche tout le monde se réfugia sous une voûte ou dans une porte. Hordle John souleva Lady Nigel comme si elle avait été une plume et s’élança avec elle derrière un portail ouvert. Aylward, tout en dévidant un beau chapelet de jurons français, plongea une main dans son carquois et entreprit de décrocher son arc. Alleyne, tout excité par un spectacle aussi imprévu, se colla contre un mur. La bête avançait en bondissant lourdement ; dans la lumière incertaine elle paraissait encore plus grosse ; du sang et de la bave dégouttaient de son museau. Seul Sir Nigel, indifférent à la panique générale, continua à marcher au milieu de la route, un mouchoir de soie dans une main et sa bonbonnière d’or dans l’autre. Alleyne sentit son sang se glacer dans ses veines quand il se rendit compte qu’une rencontre entre l’homme et l’ours était inévitable. L’ours se dressa sur ses deux pattes de derrière ; ses yeux brillaient de peur et de haine ; il agita ses pattes antérieures par-dessus le chevalier comme pour le terrasser. Lui toutefois cligna ses yeux plissés, leva son mouchoir et l’abattit doucement par deux fois sur le museau.
– Impertinent ! Fripon ! fit-il gentiment.
Déconcerté, l’ours abaissa ses deux pattes de devant, recula, et il fut aussitôt maîtrisé par les cordes du montreur et d’une foule de paysans qui l’avaient rattrapé.
Le plus épouvanté était le montreur d’ours. Pour boire une pinte de bière à l’auberge il avait attaché la bête à un pieu ; mais l’ours avait été agacé par des roquets du village ; il était devenu fou de rage parce qu’ils l’avaient mordillé ; alors il avait brisé sa chaîne et s’était échappé en mordant ou frappant tout ce qui se trouvait sur son chemin. Mais le montreur avait été complètement affolé quand il s’était aperçu que son animal avait failli faire du mal au seigneur et à la dame du château, lesquels avaient le pouvoir de le jeter dans les oubliettes ou de le faire fouetter jusqu’à ce qu’il n’eût plus de peau sur les épaules. Pourtant, quand il vint quémander son pardon, il reçut quelques piécettes d’argent de Sir Nigel. Lady Loring par contre était moins disposée à la charité, car elle avait été grandement froissée dans sa dignité par la manière dont elle avait été bousculée et écartée de son époux. Quand ils franchirent la grille du château, John tira Aylward par la manche et tous deux s’arrêtèrent.
– Je te fais mes excuses, camarade ! murmura John. J’ai été stupide de ne pas avoir deviné qu’un petit coq pouvait être le plus courageux. Je crois vraiment que cet homme est un chef que nous pouvons suivre.
CHAPITRE XI
Comment un jeune berger se vit confier un troupeau dangereux
L’entrée du château de Twynham était sombre, malgré les deux torches qui brûlaient de l’autre côté du portail. Les voyageurs purent néanmoins distinguer au-dessus de la grille l’écu des Montacute, gueules de chevreuil sur champ d’argent, flanqué à droite et à gauche d’armoiries plus petites où l’on reconnaissait les roses rouges du connétable. Quand ils passèrent sur le pont-levis, Alleyne vit briller des armes. À peine avaient-ils posé le pied dans le baile extérieur qu’une sonnerie de bugle retentit : dans un grand bruit de charnières grinçantes et de chaînes qui cliquetaient, le pont se releva, halé par des mains invisibles. Au même instant la grande herse descendit et intercepta les dernières lueurs du jour. Sir Nigel et son épouse rentrèrent au château. Un sous-intendant prit en charge les trois camarades et les mena à l’office où il y avait toujours du pain, du bœuf et de la bière réservés aux voyageurs. Après un repas cordial et quelques ablutions dans un baquet, ils flânèrent dans le baile ; là, l’archer scruta l’obscurité pour s’intéresser aux murailles et au donjon, avec l’œil critique du soldat qui a vu quelques sièges et qui est difficile à satisfaire ; Alleyne et John trouvaient que le château était une forteresse formidable.
Construit par les soins de Sir Baldwin de Redvers au début du XIIe siècle, à une époque où les hommes songeaient plus à la guerre qu’au confort, le château de Twynham avait été conçu pour servir uniquement de place forte. Il ne ressemblait donc nullement aux palais magnifiques qui combinèrent plus tard la robustesse avec la somptuosité. Au temps des Édouard, des châteaux comme ceux de Conway et de Caernarvon (pour ne rien dire de celui de Windsor) administrèrent la preuve qu’il était possible de s’assurer le luxe pendant la paix aussi bien que la sécurité dans les périodes troublées. Twynham, qui avait été commis à la garde de Sir Nigel, dominait les eaux claires de l’Avon de sa masse imposante et sombre, comme l’avaient voulu les premiers Anglo-Normands. Il y avait deux bailes (extérieur et intérieur) non pavés et ensemencés d’herbe pour les moutons et le bétail qui en cas de danger devaient être ramenés dans l’enceinte. Tout autour se dressaient de hauts murs à tourelles ; dans l’angle un donjon carré, farouche et sans fenêtres, s’élevait au-dessus d’un monticule qui le rendait pratiquement inaccessible pour un assaillant. Adossées en ligne le long des murs des bailes, des maisons de bois et des écuries abritaient les archers et les hommes d’armes de la garnison. La plupart des portes de ces humbles demeures étaient ouvertes ; la faible lumière qui régnait à l’intérieur permit à Alleyne d’apercevoir des hommes barbus en train de fourbir leur équipement, tandis que les femmes bavardaient sur le pas des portes, un travail d’aiguille à la main. L’air était plein de leur caquet ainsi que du babil joyeux des enfants : contraste bizarre avec le miroitement des armes et le belliqueux défi des murailles.
– M’est avis qu’une compagnie d’écoliers pourrait tenir cette place contre une armée ! fit John.
– Je pense comme toi, dit Alleyne.
– Hé bien, vous vous trompez ! déclara l’archer. Par ma garde ! J’ai vu une forteresse plus redoutable enlevée en une soirée d’été. Je m’en souviens d’une en Picardie, qui avait un nom aussi long qu’un pedigree de Gascon. C’était quand je servais sous Sir Robert Knolles, avant l’époque de la Compagnie. Nous en avons fait le sac et ramassé un gros butin. Moi-même j’ai gagné un grand hanap en argent, deux gobelets, et une cuirasse en acier d’Espagne. Pasques Dieu ! Les jolies femmes ne manquent pas par ici ! Mort de ma vie ! Vous voyez celle qui se tient sur le seuil ? Je vais lui dire deux mots. Mais que nous veut celui-ci ?
– Y a-t-il parmi vous un archer du nom de Sam Aylward ? demanda un homme d’armes grand et maigre, qui avait traversé la cour pour aller vers eux.
– C’est mon nom, répondit l’archer.
– Alors, je n’ai nul besoin de te dire le mien, fit l’inconnu.
– Par la sainte croix ! Mais c’est Black Simon de Norwich ! s’exclama Aylward. Sur mon cœur, camarade ! Viens sur mon cœur ! Ah, que je suis content de te revoir !
Tous deux tombèrent dans les bras l’un de l’autre et s’étreignirent comme des ours.
– Et d’où viens-tu, vieux paquet de sang et d’os ? s’enquit l’archer.
– Je me suis engagé ici. Dis-moi, camarade, est-il exact que nous allions en découdre encore une fois avec ces Français ? On le dit dans la salle des gardes, et on ajoute que Sir Nigel va repartir.
– C’est assez vraisemblable, mon gars, au train où vont les choses.
– Alors, que Dieu soit loué ! cria l’autre. Cette nuit même je vais mettre de côté un calice en or pour l’offrir à l’autel de mon saint patron. Je me suis langui de toi, Aylward, comme une jeune fille se languit de son amoureux.
– L’envie de piller t’aurait donc repris ? Ta bourse est-elle si légère qu’il n’y en a pas assez pour une tournée ? J’ai un sac à ma ceinture, l’ami, et tu n’as qu’à y plonger ta main et prendre ce que tu veux. Entre nous, le partage a toujours été de règle.
– Non, camarade. Ce n’est pas de l’or français qu’il me faut, mais du sang français. Je m’agiterais dans mon tombeau, cousin, si je mourais avant de disputer un autre tournoi avec eux. Car en France nous avons toujours fait la guerre loyalement et proprement : pour l’homme le poing fermé, mais le genou ployé devant la femme, n’est-ce pas ? Or que s’est-il passé à Winchelsea quand leurs galères ont débarqué il y a quelques années ? J’avais là ma vieille mère, qui était descendue des Midlands pour se rapprocher de son fils. On l’a trouvée plus tard près de son âtre, transpercée par la hallebarde d’un Français. Ma sœur cadette, la femme de mon frère et ses deux enfants n’étaient plus que des tas de cendres dans les ruines fumantes de leur maison. Je ne dirai pas que nous avons tout respecté en France ; mais au moins nous avons épargné les femmes et les enfants ! Voilà pourquoi, vieil ami, j’ai le sang en ébullition, pourquoi il me tarde d’entendre le vieux cri de guerre. Par la vérité de Dieu, si Sir Nigel déploie son pennon, j’en connais un qui sera heureux de sentir des battants de selle entre ses jambes.
– Nous avons fait ensemble du bon ouvrage, vieux chien de guerre ! dit Aylward. Par ma garde, nous pouvons espérer en faire encore un peu plus avant de mourir ! Mais c’est plutôt la bécasse espagnole que le héron français que nous chasserons. Il est vrai que Du Guesclin et les meilleures lances de France se sont mis, paraît-il, au service des lions et des tours de Castille. Mais, dis-moi, camarade, j’ai dans l’idée qu’une petite affaire entre nous deux n’a jamais été réglée.
– Pardieu, tu dis vrai ! s’écria l’autre. Je l’avais oublié. Le grand prévôt et ses hommes nous avaient séparés à notre dernière rencontre.
– Sur quoi, mon ami, nous avions fait vœu de vider notre querelle à la première occasion. Je vois que tu as ton épée ; la lune brille suffisamment pour deux oiseaux de nuit comme nous. En garde, mon gars ! Il y a un bon mois que je n’ai pas entendu le cliquetis de l’acier.
– Sortons de l’ombre, acquiesça l’autre en dégainant. Un vœu est un vœu ; on ne s’en délie pas à la légère.
– Un vœu à des saints, intervint Alleyne à voix haute, doit être respecté ; mais celui-ci est un vœu au diable et, tout clerc que je sois, je suis l’interprète de la sainte Église quand je vous déclare que c’est un péché mortel de régler ainsi un différend. Quoi ! Deux hommes mûrs se garderont-ils rancune pendant des années et se sauteront-ils à la gorge comme deux roquets ?
– Pas de rancune, jeune clerc ! Pas la moindre ! s’écria Black Simon. Je n’ai pas une goutte d’amertume dans le cœur contre mon vieux camarade ; mais la querelle, comme il l’a dit, n’est pas vidée. En garde, Aylward !
– Pas tant que je pourrai m’interposer entre vous deux ! cria Alleyne en bondissant devant l’archer. C’est une honte, c’est un péché de voir deux chrétiens d’Angleterre dégainer pour se battre l’un contre l’autre comme deux païens assoiffés de sang.
– Et j’ajoute, déclara Hordle John qui apparut soudain sur la porte de l’office en tenant un gros rouleau à pâtisserie, que si l’un de vous deux lève son épée, je l’aplatis comme une pâte molle. Par la croix noire ! Je taperais dessus comme sur un clou dans une porte, mais je ne vous laisserai pas vous couper la gorge.
– Pardieu, voilà une étrange manière de prêcher la paix ! s’emporta Black Simon. Tu pourrais bien te faire égorger toi-même, mon gros, si tu t’approches de moi avec ta massue. Mieux vaudrait que le pont-levis du château retombe sur ma tête !
Alleyne étendit les bras pour séparer les deux antagonistes et se tourna vers l’archer.
– Dis-moi, Aylward, quelle est la cause de cette querelle afin que nous examinions si un règlement honorable ne peut pas intervenir.
L’archer considéra d’abord ses pieds, puis la lune.
– Parbleu ! s’écria-t-il. La cause de notre querelle ? Eh bien ! mon petit, elle remonte à plusieurs années. Nous étions dans le Limousin. Comment veux-tu que je me la rappelle exactement ? Simon l’a sûrement sur le bout de la langue.
– Ma foi non ! répliqua l’autre. J’ai eu depuis d’autres choses en tête. Nous nous étions disputés à propos de dés, ou de vin, ou peut-être d’une femme, hé ?
– Tu as mis le doigt dessus ! dit Aylward. C’était bien à propos d’une femme. Et nous allons vider notre querelle car je n’ai pas changé d’avis.
– Mais quelle femme ? demanda Black Simon. Que la peste m’étouffe si je me rappelle quoi que ce soit à son sujet !
– C’était Blanche-Rose, la servante des « Trois Corbeaux » à Limoges. Que son joli cœur soit béni ! Eh bien, mon gars, je l’aimais !
– Tu n’étais pas le seul, dit Simon. Je m’en souviens maintenant. Le jour même où nous nous battîmes pour cette petite friponne, elle partit avec Evan ap Price, ce Gallois aux longues jambes. Ils sont à présent propriétaires d’une hôtellerie quelque part sur les bords de la Garonne, et le Gallois boit tellement de liqueurs qu’il en reste peu pour la clientèle.
– Alors n’en parlons plus, fit Aylward en remettant son épée au fourreau. Un Gallois ! Quel mauvais goût, camarade ! D’autant plus mauvais qu’elle pouvait choisir entre un bel archer et un grand homme d’armes !
– Tu as raison, vieil ami ! D’ailleurs il vaut mieux que nous ayons réglé pacifiquement notre différend, car Sir Nigel serait sorti au premier cliquetis d’épées, et il a juré que s’il éclatait une querelle dans la garnison il trancherait la main droite des adversaires. Tu le connais, et tu sais qu’il tient parole !
– Mort-Dieu oui ! Mais il y a de la bière, de l’hydromel et du vin à l’office, et l’intendant est un joyeux coquin qui ne fera pas de difficultés pour un verre ou deux. Buvons, mon gars, car ce n’est pas tous les jours que deux vieux amis se retrouvent.
Les soldats et Hordle John se dirigèrent vers l’office. Alleyne allait les suivre quand il sentit une main sur son épaule : un jeune page se tenait près de lui.
– Le seigneur Loring commande, dit l’enfant, que vous me suiviez dans la grande salle et que vous l’attendiez là.
– Et mes camarades ?
– Son ordre ne concernait que vous.
Alleyne accompagna donc le messager ; à l’extrémité est de la cour, de larges marches conduisaient à l’entrée du grand château dont le mur extérieur était baigné par l’Avon. Les plans primitifs n’avaient rien prévu pour le logement du seigneur et de sa famille en dehors du sous-sol sombre et sinistre du donjon. Mais une génération plus civilisée (ou plus efféminée) avait refusé de se laisser parquer dans une cave, et elle avait édifié au flanc du donjon le château avec ses salles qui se faisaient suite, pour lui servir de demeure décente. En haut des marches Alleyne fut introduit dans la grande salle. Il regarda autour de lui ; comme il ne vit personne, il resta debout, son bonnet à la main, et il examina les lieux. Les temps n’étaient plus où la grande salle d’un seigneur ressemblait, avec de la paille par terre, à une grange où flânaient et mangeaient tous les habitants du château. Les Croisés avaient rapporté l’expérience du luxe domestique, le souvenir des tapis de Damas et des nattes d’Alep ; ils n’avaient pu supporter plus longtemps l’odieux inconfort et l’absence de toute vie privée qu’ils retrouvèrent en rentrant dans les places fortes de leurs aïeux. Plus importante encore fut l’influence des grandes guerres contre la France : les deux nations pouvaient en effet rivaliser d’égal à égal dans les exercices militaires, mais nos voisins nous étaient incontestablement supérieurs dans les arts de la paix. Un flot de chevaliers regagnant leur pays, de soldats blessés, se déversait depuis un quart de siècle en Angleterre ; il s’ensuivit un plus grand raffinement dans la mode anglaise. D’autre part des bateaux chargés de marchandises françaises pillées à Calais, à Rouen et dans d’autres villes mises à sac avaient fourni à nos artisans des modèles sur lesquels ils pouvaient épanouir leurs talents. Voilà pourquoi dans de nombreux châteaux anglais, et au château de Twynham en particulier, on pouvait trouver des salles qui ne manquaient ni de grandeur ni de confort.
Dans la vaste cheminée de pierre, un feu de bois crépitait ; des lueurs rougeâtres dansaient autour de la pièce. Une lanterne était allumée dans chaque angle, la salle était donc claire et gaie. Au-dessus de la cheminée s’étalaient des guirlandes de blasons qui remontaient jusqu’aux corniches du plafond en chêne sculpté ; de chaque côté du feu, deux grands fauteuils surmontés d’un dais étaient destinés au maître de maison et à son hôte d’honneur. Devant les murs pendaient des tapisseries compliquées et richement colorées qui représentaient les exploits de Sir Bevis de Hampton ; des bancs et les tréteaux des banquets se dissimulaient derrière cet écran de luxe. Le plancher était un carrelage verni ; un tapis flamand carré rouge et noir s’étalait au centre ; de nombreux canapés, des coussins, des chaises pliantes, des banquettes sculptées meublaient encore la salle. Tout au bout un long buffet noir était couvert de coupes en or, de plateaux d’argent et d’autres pièces de valeur. Mais ce qui intéressa le plus Alleyne fut une petite table en bois d’ébène tout près de lui ; à côté d’un échiquier dont les pièces étaient encore posées, un manuscrit était ouvert ; l’écriture était parfaitement moulée ; dans la marge de gracieuses enjolivures étaient dessinées. Vainement Alleyne tenta-t-il de se rappeler le lieu où il se trouvait, ainsi que les règles de la bonne éducation qui auraient dû le retenir : ces lettrines coloriées et les lignes noires si bien tracées l’attirèrent comme la pierre d’aimant attire l’aiguille. Presque sans s’en rendre compte il se déplaça et approcha du roman de Garin de Montglane ; alors il s’absorba si profondément dans sa lecture qu’il oublia où il se trouvait et pourquoi il était venu.
Il fut rappelé aux réalités, cependant, par un petit rire féminin. Consterné il laissa tomber le manuscrit sur l’échiquier et se retourna. La salle était vide et silencieuse. Il allongea le bras pour reprendre le Roman ; mais derechef le petit rire joyeux se fit entendre. Il regarda le plafond, la porte fermée, les plis rigides de la tapisserie immobile, puis il aperçut une sorte de reflet derrière l’angle d’une banquette à haut dossier qui lui faisait face ; il fit un pas sur le côté : une mince main blanche tenait un miroir d’argent de telle manière que l’observateur pouvait voir sans être vu. Il s’arrêta, se demanda s’il allait avancer ou s’il ferait semblant de n’avoir rien remarqué. Mais pendant qu’il hésitait, le miroir disparut et une jeune femme, grande et gracieuse, se leva derrière le paravent de chêne ; ses yeux pétillaient de malice. Alleyne tressaillit en reconnaissant la damoiselle qu’il avait arrachée aux violences de son frère. Elle ne portait plus sa charmante tenue d’écuyère, mais une longue robe en velours noir de Bruges qu’ornaient de fines dentelles blanches au col et aux poignets. Elle lui avait déjà paru bien belle, mais à présent le charme qui émanait de sa silhouette délicate et de son fier maintien se trouvait rehaussé par la riche simplicité de ses atours.
– Ah, vous sursautez ! fit-elle gaiement. Je ne saurais m’en étonner. Vous ne pensiez pas revoir jamais la damoiselle en détresse ? Oh, si j’étais ménestrel, que j’aimerais mettre tout ce roman en vers et en musique ! La jeune étourdie, le méchant seigneur, et le clerc vertueux… Ainsi notre renommée s’établirait dans l’histoire, et vous seriez cité avec Sir Percival ou Sir Galahad et tous les autres libérateurs de dames opprimées.
– Ce que j’ai fait, déclara Alleyne, est une trop petite chose pour mériter des remerciements ; et cependant, si je puis le dire sans vous offenser, l’affaire me semble trop sérieuse, elle était trop pressante pour devenir un sujet de gaieté et de raillerie. J’avais compté sur l’affection de mon frère, mais Dieu a voulu qu’il en ait été autrement. C’est une joie de vous revoir, madame, et de savoir que vous êtes rentrée chez vous sans incidents, si toutefois ce château est bien votre demeure.
– Oui, le château de Twynham est ma demeure, et Sir Nigel Loring est mon père. J’aurais dû vous le dire ce matin, mais quand j’ai appris que vous alliez vous rendre ici, j’ai aussitôt pensé vous faire la surprise. Oh, mon Dieu, comme c’était amusant de vous observer !…
Elle éclata de rire une fois encore, une main sur le côté, et ses yeux mi-clos brillant de plaisir.
– … Vous avez reculé, puis vous êtes revenu, attiré par mon livre, comme la souris qui sent le fromage mais qui a peur du piège.
– Je suis honteux, répondit Alleyne, de l’avoir touché.
– Non, cela m’a fait chaud au cœur de vous voir faire. J’ai été si heureuse que j’ai ri de plaisir. Mon beau prêcheur peut donc être tenté ? me suis-je dit. Il n’est pas d’une autre argile que la nôtre.
– Que Dieu m’aide ! Je suis le plus faible des faibles ! gémit Alleyne. Je prie pour avoir plus de force.
– Et pourquoi faire ? interrogea-t-elle âprement. Si vous devez, comme je le suppose, vous enfermer pour toujours dans une cellule entre les quatre murs d’une abbaye, à quoi servirait que votre prière soit exaucée ?
– À mon salut.
Elle se détourna et haussa légèrement les épaules.
– Est-ce tout ? dit-elle. Alors vous n’êtes pas meilleur que le Père Christopher et tous les autres. Votre salut ! Vous ! Toujours vous ! Mon père est le sujet du Roi ; quand il chevauche au plus fort de la mêlée il ne pense pas à sauver son propre corps ; il se soucie peu de le laisser sur le champ de bataille ! Pourquoi dès lors vous, qui êtes soldats de l’esprit, vous ennuieriez-vous et vivriez-vous sempiternellement dans une cellule ou dans une caverne, avec la tête pleine de vos soucis égoïstes, tandis que le monde, que vous devriez guérir, va son chemin sans vous voir ni vous entendre ? Si vous tous vous vous préoccupiez aussi peu de votre âme que le soldat de son corps, les âmes des autres s’en porteraient sans doute mieux.
– Il y a du vrai dans ce que vous dites, madame ! répondit Alleyne. Et cependant je discerne mal ce que vous voudriez voir faire par le clergé et l’Église.
– Je voudrais les voir vivre comme les autres, faire dans le monde des travaux d’hommes, prêcher en actes et non pas en paroles. Je voudrais les voir sortir de leurs lieux de retraite, se mêler à la foule, éprouver les peines et les plaisirs, les soucis et les récompenses, les tentations et les émotions des gens ordinaires. Qu’ils travaillent ! Qu’ils peinent, qu’ils labourent le sol ! Qu’ils prennent femme…
– Hélas ! cria Alleyne épouvanté. Vous avez sûrement goûté au poison de ce Wicliffe, dont j’ai entendu dire tant de mal !
– Non, je ne le connais pas. Ce que je viens de vous dire, je l’ai appris toute seule en regardant par la fenêtre de ma chambre et en observant ces pauvres moines du prieuré, en assistant à leur vie assommante, à leur train-train d’inutilités. Je me suis demandé si ce qu’on pouvait faire de mieux avec la vertu consistait à l’enfermer entre des hauts murs comme une bête sauvage. Si les bons se cloîtrent et si les méchants se promènent en liberté, alors tant pis pour le monde !
Alleyne la contempla avec stupéfaction : ses joues avaient rosi, elle avait les yeux brillants, et toute son attitude exprimait une conviction éloquente. Mais aussitôt elle reprit sa première expression malicieuse.
– Feriez-vous ce que je vous demanderais ? interrogea-t-elle.
– Que me demandez-vous, madame ?
– Oh, clerc peu galant ! Un vrai chevalier n’aurait jamais posé votre question, mais il aurait juré tout de suite. Il s’agit de confirmer ce que je dirai à mon père.
– Confirmer quoi ?
– Confirmer, s’il le demande, que c’est au sud de la route de Christchurch que je vous ai rencontré. Sinon je serai enfermée avec les demoiselles d’atour, et j’aurai huit jours de travaux d’aiguille, alors que je préférerais faire galoper Troubadour jusqu’à Wilverley Walk, ou lâcher mon petit Roland sur les hérons de Vinney Ridge.
– S’il me pose la question, je ne répondrai pas.
– Vous ne répondrez pas ? Mais il voudra que vous lui répondiez ! Il ne faut pas que vous me trahissiez ; autrement cela ira mal pour moi.
– Mais madame, s’écria le pauvre Alleyne désespéré, comment pourrais-je dire que nous nous sommes rencontrés au sud de la route alors que je sais parfaitement que c’était à six kilomètres au nord ?
– Vous ne voulez pas le dire ?
– Mais vous ne le diriez pas, vous non plus, puisque vous savez que ce n’est pas vrai.
– Oh, je suis lasse de vos prêches ! s’écria-t-elle.
Et elle sortit de la salle en secouant sa jolie tête. Alleyne demeura seul, aussi abattu et honteux que s’il avait lui-même proposé quelque chose d’infâme. Mais elle revint au bout d’une minute, d’une humeur différente.
– Écoutez, mon ami ! dit-elle. Si vous aviez été enfermé aujourd’hui dans une abbaye ou dans une cellule, vous n’auriez pas pu apprendre à une jeune fille fantasque de respecter la vérité, n’est-ce pas ? Que vaut le berger qui abandonne ses moutons ?
– C’est un triste berger ! fit humblement Alleyne. Mais voici votre noble père.
– Vous allez voir quelle bonne élève je suis… Père, je suis grandement redevable à ce jeune clerc, qui m’a rendu service et m’a secourue ce matin dans les bois de Minstead, à six kilomètres au nord de Christchurch, où je n’aurais pas dû être puisque vous m’aviez ordonné de ne pas aller par là.
Elle avait débité cette longue phrase d’une voix forte, puis elle lança à la dérobée un regard interrogateur à Alleyne pour quêter son approbation.
Sir Nigel, qui était entré dans la salle et qui prêtait l’appui de son bras à une vieille dame aux cheveux argentés, parut stupéfait de cette soudaine explosion de franchise.
– Maude, Maude ! fit-il en hochant la tête. Il m’est plus malaisé de me faire obéir de vous que des deux cents archers pris de vin qui me suivirent en Guyenne. Cependant, n’en parlons plus ! Votre noble mère, ma petite, va venir ici d’un moment à l’autre, et il n’est pas indispensable qu’elle soit au courant. Ce soir, nous ne vous remettrons pas entre les mains du grand prévôt. Regagnez votre chambre, ma douce, et réjouissez-vous, car celle qui avoue est pardonnée. Et maintenant, bonne Dame, poursuivit-il quand sa fille se fut retirée, asseyez-vous auprès du feu ; votre sang est moins vif qu’autrefois. Alleyne Edricson, je voulais te dire un mot, car je désirerais t’avoir à mon service. Et voici qu’arrive juste à temps ma chère épouse, dont l’opinion m’est si précieuse que je ne décide jamais d’une chose importante sans son conseil. Mais en vérité c’est elle qui a eu l’idée que je t’emmène.
– Parce que vous m’avez fait une bonne impression et que je crois qu’on peut avoir confiance en vous, expliqua Lady Loring. Or mon cher seigneur a besoin d’une personne de confiance qui ne le quitte pas, car il se soucie si peu de sa personne qu’il lui faut constamment quelqu’un qui pourvoie à ses besoins. Vous avez vu un couvent. Il serait bon que vous voyiez le monde aussi, avant de choisir entre les deux.
– C’est justement la raison pour laquelle mon père voulait qu’à ma vingtième année je sortisse dans le monde, répondit Alleyne.
– Votre père était un sage, dit-elle. Vous ne pourriez mieux accomplir sa volonté qu’en suivant la voie où vous aurez pour compagnons tout ce qui est noble et brave en Angleterre.
– Sais-tu monter à cheval ? interrogea Sir Nigel en examinant le jeune homme de ses yeux clignotants.
– Oui, je suis beaucoup monté à l’abbaye.
– Encore y a-t-il une différence entre la rosse d’un moine et le destrier d’un guerrier. Sais-tu chanter et jouer d’un instrument de musique ?
– Je connais la citole, la flûte et le rebec.
– Bien ! Peux-tu déchiffrer les blasons ?
– N’importe lesquels.
Sir Nigel lui désigna un des écus du mur ; Alleyne le lut sans faire de faute.
– Pas mal pour un jeune homme élevé par les religieux. J’espère que tu es modeste et serviable ?
– J’ai toujours servi, messire.
– Sais-tu sculpter, graver, ciseler ?
– Je le faisais deux jours par semaine pour les frères.
– Un modèle, en vérité ! Tu seras un écuyer parfait. Mais dis-moi, je te prie, si tu sais friser les cheveux ?
– Non, noble seigneur, mais je pourrai apprendre.
– C’est important, fit-il. Car j’aime garder mes cheveux bien en ordre : le poids du casque depuis trente ans a légèrement dégarni mon crâne…
Il retira sa toque de velours et exhiba un crâne aussi chauve qu’un œuf, qui luisait sous la lumière du feu. Il pivota et montra une petite bande où des cheveux clairsemés, semblables à des derniers survivants sur un champ de bataille, tentaient d’échapper au destin de leurs camarades.
– … Vois-tu, reprit-il, ces boucles ont besoin d’être un peu graissées et frisées. Je crois que si tu regardes avec attention, là où la lumière éclaire bien ma tête, tu t’apercevras qu’il y a des endroits où le cheveu se fait rare.
– Et ce sera à vous aussi de porter la bourse, dit Lady Loring. Car mon doux seigneur est d’un tempérament si généreux qu’il la donnerait gaiement au premier qui lui demanderait l’aumône. Toutes ces choses, jointes à quelques connaissances en vénerie, en chasse à courre ou au faucon, en équitation, ainsi qu’à la grâce, à l’intrépidité et à la courtoisie qui conviennent à votre âge, feront de vous un parfait écuyer pour Sir Nigel Loring.
– Hélas, madame ! répliqua Alleyne. Je mesure bien le grand honneur que vous m’avez fait en m’estimant digne de servir un chevalier si réputé ; mais je suis tellement conscient de ma propre faiblesse que j’ose à peine accepter des devoirs que je pourrais être bien maladroit à remplir.
– La modestie et l’humilité d’esprit, fit-elle, sont les premières et les plus rares qualités d’un page ou d’un écuyer. Vos paroles prouvent que vous les possédez ; tout le reste viendra en son temps. Mais il n’y a nulle nécessité de se hâter. Réfléchissez bien cette nuit, et demandez en prières à être guidé. Nous connaissons votre père et nous ne demandons pas mieux que d’aider son fils, bien que nous n’ayons guère de motifs pour aimer votre frère qui est le plus grand faiseur d’histoires du pays.
– Nous pouvons difficilement espérer, dit Nigel, être prêts avant la fête de saint Luc, car il reste beaucoup de choses à faire. Tu auras donc des loisirs s’il te plaît d’entrer à mon service, et tu pourras t’initier aux devoirs qui t’incombent. Bertrand, le page de ma fille, souhaite passionnément me suivre ; mais pour dire vrai il est bien jeune pour le rude travail qui nous attend sans doute.
– Et j’ai une faveur, moi, à vous demander, ajouta Lady Loring au moment où Alleyne allait se retirer. Vous avez, je crois, reçu une solide instruction à Beaulieu ?
– Je sais bien peu de choses, madame, par comparaison avec ceux qui furent mes maîtres.
– Suffisamment pour ce que je désire, j’en suis sûre. Je voudrais que vous consacriez une heure ou deux pendant votre séjour au château à causer avec ma fille Maude ; car elle est un peu en retard, je le crains, et elle n’a aucun goût pour les belles lettres, sauf pour ces pauvres romans qui ne font que remplir sa tête vide de rêveries à propos de damoiselles ravies et de chevaliers errants. Le Père Christopher vient du prieuré après none, mais il est accablé d’ans, il parle lentement, et elle ne tire qu’un maigre profit de son enseignement. Je voudrais que vous fassiez ce que vous pourrez avec elle, ainsi qu’avec Agatha, ma jeune demoiselle d’atour, et avec Dorothy Pierpoint.
Voici comment Alleyne se trouva choisi pour servir, non seulement d’écuyer à un chevalier, mais aussi d’écuyer à trois demoiselles ; rôle qu’il n’avait guère songé à jouer sur la scène du monde. Comme il ne pouvait pas refuser de faire ce qu’il pourrait, il sortit de la salle du château la tête en feu, assailli par un tourbillon de pensées qui lui représentaient les chemins aussi étranges que périlleux sur lesquels il était destiné à aller de l’avant.
CHAPITRE XII
Comment Alleyne apprit plus qu’il n’enseigna
Dans tous les comtés du sud, on commença à s’agiter, à fourbir des armes, à façonner des équipements. De château en château la nouvelle s’était rapidement répandue : le vieux jeu allait recommencer, les lions et les fleurs de lis s’affronteraient au début du printemps. Quelle nouvelle pour ce cher pays belliqueux, qui depuis une génération avait choisi le métier de la guerre, qui avait exporté des archers et importé des prisonniers ! Pendant six années ses fils avaient impatiemment attendu la fin d’une paix inaccoutumée ; maintenant ils se ruaient sur leurs armes comme sur leur droit d’aînesse. Les vieux soldats de Crécy, de Nogent et de Poitiers se réjouissaient parce qu’ils allaient entendre encore une fois les trompettes guerrières ; mais les plus heureux étaient les jeunes qui avaient les oreilles rebattues des récits glorieux de leurs aînés. Franchir les grands monts du sud, affronter les hommes qui avaient dompté les Maures, suivre le plus grand capitaine de l’époque, voir des champs de blé et des vignobles ensoleillés alors que les marches de Picardie et de Normandie étaient aussi nues et mornes que les forêts de Jedburgh, quelles perspectives pour une race de soldats ! D’une mer à l’autre on bandait des arcs dans les chaumières, et l’acier résonnait dans les châteaux.
Il ne fallut pas longtemps à chaque place forte pour mettre sa cavalerie en route, et à chaque hameau pour fournir l’infanterie. À la fin de l’automne et au début de l’hiver routes et chemins retentissaient d’appels de bugles et de trompettes, de hennissements, du pas des détachements en marche. Du Wrekin dans les marches galloises aux Costwoods dans l’ouest, ou au Butser dans le midi, tous les sommets de colline devinrent des observatoires d’où les paysans voyaient miroiter les armes, flotter les étendards et les panaches. Empruntant des sentiers écartés, des clairières ou des chemins de lande, ces petits ruisselets d’acier se réunissaient sur les grand-routes pour former un fleuve qui prenait de plus en plus d’ampleur en se rapprochant d’un port de mer, où toute la journée, et jour après jour, on s’affairait, on travaillait, on se rassemblait ; les grands vaisseaux étaient chargés ; les uns après les autres ils déployaient leurs ailes blanches et gagnaient la haute mer parmi l’entrechoquement des cymbales, les roulements de tambour, les cris joyeux de ceux qui partaient et de ceux qui attendaient leur tour. D’Orwell à la Dart, il n’y avait pas de port qui ne fît partir sa petite flotte égayée par des flots d’étamine comme pour un joyeux festival. Ainsi, pendant la saison où les jours diminuaient, la puissance de l’Angleterre prenait le large.
L’ancien et populeux comté du Hampshire ne manquait ni de chefs ni de soldats pour une mobilisation qui promettait de l’honneur et du profit. Au nord la tête de Maure des Brocas et les mascles rouges des De Roches flottaient au-dessus d’une forte troupe d’archers venus des forêts de Hall, de Woolmer, et de Harewood. De Borhunte se préparait dans l’est, et Sir John de Montague dans l’ouest. Sir Luke de Ponynges, Sir Thomas West, Sir Maurice de Bruin, Sir Arthur Lipscombe, Sir Walter Ramsey et le robuste Sir Oliver Buttesthorn marchaient tous vers le sud avec des recrues d’Andover, d’Alresford, d’Odiham et de Winchester, pendant que venaient du Sussex Sir John Clinton, Sir Thomas Cheyne et Sir John Fallislee avec une troupe d’hommes d’armes sélectionnés ; ils se dirigeaient vers Southampton. Le plus grand des rassemblements, toutefois, eut lieu au château de Twynham, car le nom et la renommée de Sir Nigel Loring attiraient les tempéraments les plus hardis : tous désiraient servir sous un chef si formidable, sous la bannière des cinq roses rouges.
Et si Sir Nigel avait pu montrer les bachelles qu’exigeaient les lois du sang, il aurait pu couper son pennon pointu pour en faire une bannière carrée, et emmener sur le champ de bataille l’escorte digne d’un chevalier banneret. Mais la pauvreté pesait lourdement sur lui, ses terres étaient peu abondantes, ses coffres vides, et le château où il habitait ne lui appartenait pas. Il eut le cœur gros quand il vit de bons archers et des lanciers expérimentés se détourner de sa porte parce qu’il n’avait pas d’argent pour les équiper et les payer. Cependant la lettre que lui avait apportée Aylward lui accorda des possibilités qu’il ne tarda pas à utiliser. Sir Claude Latour, lieutenant gascon de la Compagnie Blanche, l’assurait en effet qu’il lui restait assez pour équiper une centaine d’archers et vingt hommes d’armes, ce qui, ajouté aux trois cents vétérans qui se trouvaient déjà en France, constituerait une force militaire que n’importe quel chef serait fier de commander. Avec une sagesse précautionneuse, le chevalier choisit ses hommes parmi les volontaires qui affluaient. Il tint de nombreuses conférences avec Black Simon, Sam Aylward et quelques-uns de ses subordonnés les plus avisés pour arrêter les élus. Aux environs de la Toussaint, les feuilles n’étaient pas toutes tombées des arbres, mais Sir Nigel avait dressé sa liste et réuni sous son pennon la plus formidable troupe de forestiers du Hampshire qui aient jamais bandé un arc de guerre. Vingt hommes d’armes, bien montés et équipés, formaient la cavalerie du détachement. Les jeunes Peter Terlake de Fareham et Walter Ford de Botley, vaillants fils de vaillants seigneurs, vinrent à leurs frais se mettre au service de Sir Nigel et partager avec Alleyne Edricson les devoirs de la charge d’écuyer.
L’enrôlement était terminé, mais il restait encore à faire. Pour les armures, les épées et les lances, point n’était besoin de s’en préoccuper car elles seraient meilleures et moins chères à Bordeaux qu’en Angleterre. Par contre, pour ce qui était des arcs, l’Espagne ne manquait pas d’ifs, mais il valait mieux emporter suffisamment de bois anglais et garder en réserve le bois espagnol. De plus il fallait trois cordes de rechange par arc, ainsi qu’une grande provision de fers de flèche, sans compter les brigandines à mailles serrées, les casques capitonnés, les brassards ou garde-bras, qui étaient l’équipement normal d’un archer. Sur des kilomètres à la ronde les femmes travaillèrent dur ; elles taillaient les surcots blancs qui étaient la tenue de la Compagnie, et elles les décoraient du lion rouge de saint Georges au milieu de la poitrine. Quand enfin le rassemblement s’opéra dans la cour du château, un vétéran des guerres de France aurait confessé qu’il n’avait jamais vu d’unité plus martiale et mieux équipée, depuis le vieux chevalier caracolant sur son grand destrier noir jusqu’à Hordle John, recrue géante, qui s’appuyait négligemment sur un immense arc noir. Sur ces cent vingt hommes, plus de la moitié avaient déjà des campagnes à leur actif ; quelques-uns même avaient passé leur vie à faire la guerre et participé aux batailles qui avaient établi pour l’émerveillement du monde la valeur et la réputation de l’infanterie insulaire.
Tous ces préparatifs requirent six longues semaines ; la saint Martin approchait quand ils furent achevés. Depuis près de deux mois Alleyne Edricson se trouvait au château de Twynham ; cette période se révéla décisive : elle changea tout le cours de son existence ; elle l’écarta du but qu’il s’était primitivement assigné ; elle l’entraîna vers des voies plus libres, plus lumineuses. Déjà Alleyne bénissait son père d’avoir décidé qu’il devait connaître le monde avant d’y renoncer.
Car le monde ne ressemblait guère aux descriptions qu’il en avait entendues, notamment quand le maître des novices évoquait les loups dévorants qui les guettaient au-delà des paisibles enclos de Beaulieu. Le monde certes n’était pas dépourvu de cruauté, ni de luxure, de péché ou de tristesse ; mais une compensation existait dans les nombreuses qualités, dans les vertus robustes et positives qui résistaient aux tentations et aux violentes secousses de la vie quotidienne. Comme par contraste paraissaient ternes l’absence de péché due à l’incapacité de pécher, les victoires obtenues dans la fuite devant l’ennemi ! Bien qu’élevé au monastère, Alleyne possédait une finesse naturelle et une intelligence assez souple pour formuler des conclusions nouvelles. Il était obligé de constater que les hommes avec lesquels il était maintenant en contact avaient beau être farouches, querelleurs, grossiers parfois : ils n’en possédaient pas moins une nature plus riche et ils étaient plus utiles au monde que les frères au regard bovin qui se levaient, mangeaient et dormaient d’un bout de l’année à l’autre dans le cercle étroit d’une existence stagnante. L’abbé Berghersh avait de la valeur, mais était-il supérieur à ce gentil chevalier qui menait une vie simple, soutenue et rehaussée par l’idéal inflexible du devoir, et qui accomplissait d’un cœur impavide tout ce qu’il avait à faire ? En passant du service de l’un au service de l’autre, Alleyne n’avait nullement l’impression de déroger. Par tempérament il n’aimait pas la guerre, mais à cette époque d’ordres guerriers et de fraternités militantes, la frontière n’était pas très bien tracée entre le prêtre et le soldat. Sans causer de scandale l’homme de Dieu et l’homme d’épée pouvaient se réconcilier dans le même individu. Dès lors pourquoi lui, simple clerc, s’éternisait-il dans des scrupules alors que s’offrait une chance d’obéir à l’esprit comme à la lettre des dispositions de son père ? Certes il lui en coûta bien des conflits intérieurs, bien des réflexions angoissées, bien des prières diurnes et nocturnes, bien des doutes et des craintes ! Trois jours après son arrivée au château de Twynham il accepta de Sir Nigel un cheval et un équipement dont les frais seraient prélevés sur sa part de bénéfices dans l’expédition. Sept heures chaque jour il s’exerçait dans la lice du château pour devenir le digne écuyer d’un chevalier aussi célèbre. Il était jeune, agile ; il avait en réserve toute l’énergie requise pendant des années de vie saine : il ne mit pas longtemps à apprendre le maniement de son cheval et de ses armes et à s’en servir assez bien pour mériter un signe de tête approbateur de la part des hommes d’armes, ou pour tenir la dragée haute à Terlake et à Ford, ses camarades écuyers.
Mais d’autres considérations ne l’influencèrent-elles pas ? L’esprit humain est si complexe qu’il peut à peine discerner les profonds ressorts qui le font agir. Alleyne vit se déployer un aspect de la vie devant lequel il était aussi innocent qu’un enfant, mais dont l’importance pesa assurément sur sa décision. Selon les préceptes du couvent, une femme était l’incarnation, la synthèse de tout ce qui était dangereux et mauvais ; la présence d’une femme était si pernicieuse qu’un vrai Cistercien ne pouvait pas lever les yeux ou toucher le bout de ses doigts sans être mis au ban de la communauté et commettre un péché mortel. Or voici que chaque jour, pendant une heure après none et une heure avant les vêpres, il se trouvait en rapports étroits avec trois femmes également jeunes, également jolies, donc doublement dangereuses du point de vue monastique. Et pourtant leur présence lui inspirait un vif plaisir, une paix agréable ; elle faisait écho à tout ce qui était bon et doux en lui-même ; elle lui emplissait l’âme d’une félicité inconnue.
Cependant la damoiselle Maude Loring n’était pas une élève facile. Un homme plus âgé, un meilleur psychologue aurait été déconcerté par ses sautes d’humeur, ses préventions soudaines, sa répulsion à l’égard de toute contrainte ou d’une autorité s’exerçant sur elle. Si un sujet l’intéressait, s’il y avait place pour du romanesque ou pour l’imagination, alors son esprit subtil s’en emparait et elle laissait peiner loin derrière elle ses deux compagnes d’études et même son professeur. Au contraire s’il lui fallait faire montre de patience, de régularité et de mémoire, elle était incapable de fixer son attention. Alleyne pouvait lui raconter les histoires des vieux dieux et des héros, lui parler d’exploits courageux ou de buts élevés, lui décrire les mystères du ciel et captiver sa fantaisie avec la lune et les étoiles, il avait en face de lui une auditrice fervente qui, joues en feu et yeux brillants, pouvait répéter derrière lui les mots qu’il avait prononcés. Mais quand il en venait à l’astrolabe, aux chiffres et au calcul des épicycles, les pensées de la jeune fille se détournaient vers son cheval et son faucon ; un regard vide et une figure inexpressive avertissaient le professeur qu’il avait perdu le contrôle de son élève ; il ne lui restait plus qu’à reprendre le vieux roman pour retrouver l’oreille de Maude.
Certains jours, quand elle était de détestable humeur, elle opposait de l’impertinence, voire une rébellion ouverte à la douce fermeté d’Alleyne. Dans ce cas il faisait semblant de ne rien remarquer, il poursuivait la leçon jusqu’à ce que sa patience l’eût reconquise et qu’elle éclatât contre elle-même en reproches cent fois trop violents par rapport à la nature de sa faute. Mais un curieux incident se produisit un matin. Elle était arrivée de fort méchante humeur, et Agatha, la jeune demoiselle d’atour, pensant plaire à sa maîtresse, se mit également à secouer la tête et à répliquer aigrement aux questions d’Alleyne. Aussitôt Maude tourna vers elle une paire d’yeux étincelants dans un visage blanc de rage.
– Tu oses ! s’exclama-t-elle. Tu oses ?
Épouvantée, Agatha tenta de s’excuser.
– Mais noble damoiselle, lui dit-elle, qu’ai-je fait ? Je n’en ai pas dit plus que je n’ai entendu.
– Tu oses ! répéta la damoiselle d’une voix frémissante. Toi, effrontée malgracieuse, stupide écervelée qui ne penses à rien d’autre qu’à des ourlets de chemise ! Et lui qui est si gentil, si aimable, si patient ! Tu… Ah, tu as raison de filer d’ici !
Tout en croisant et en décroisant ses longs doigts blancs, elle avait parlé sur un tel ton qu’avant la fin de son petit discours Agatha s’était précipitée vers la porte, derrière laquelle elle avait éclaté en sanglots.
Alleyne demeura abasourdi devant cette tigresse qui avait si soudainement volé à son secours.
– Cette colère était inutile, dit-il doucement. Les paroles de cette jeune fille ne m’ont nullement affecté. C’est vous qui aviez commencé.
– Je le sais ! cria-t-elle. Je suis très méchante. Mais c’est assez d’une méchante pour vous maltraiter. Ma foi ! je ne veux pas qu’il y en ait une autre.
– Mais non, personne ne me maltraite ! répondit-il. Le péché est dans les mots que vous avez prononcés. Vous l’avez appelée effrontée, écervelée, et je ne sais quoi…
– Et vous êtes celui qui m’avez appris à dire la vérité ! Voilà que je dis la vérité, et vous n’êtes pas content ! Écervelée elle est : je l’appellerai écervelée !
C’est par de semblables disputes qu’était troublée la paix de la petite classe. Au fur et à mesure que s’écoulaient les semaines, néanmoins, elles devinrent moins fréquentes et moins violentes tant l’égalité d’humeur et la fermeté d’Alleyne influençaient Maude. À vrai dire, en certaines occasions il en vint à se demander si ce n’était pas la damoiselle qui l’influençait. Si elle changeait, il changeait aussi. En la tirant au-dessus du monde, il descendait progressivement, lui, au niveau du monde. En vain lutta-t-il ; en vain essaya-t-il de se persuader de la folie qu’il y avait à trop penser à la fille de Sir Nigel. Qui était-il donc pour oser lever les yeux sur la plus jolie damoiselle du Hampshire ? Un cadet de famille, un clerc impécunieux, un écuyer incapable de payer son propre équipement… Oui, c’était la voix de la raison ; mais la raison avait beau dire, la voix de la jeune fille résonnait plus fort à ses oreilles, et son image échauffait son cœur toujours davantage. Plus éloquent que la raison, plus irrésistible que les leçons du couvent, plus puissant que n’importe quel frein, surgissait le vieux tyran qui ne supportait aucun rival dans le royaume de la jeunesse.
Et pourtant il fut surpris et bouleversé lorsqu’il découvrit comme elle était profondément entrée dans sa vie, et combien les ambitions et désirs qui avaient nourri sa nature spirituelle se centraient à présent sur cet objet de la terre. Jusque-là il avait à peine osé réfléchir au changement qui s’était opéré en lui : quelques phrases inattendues suffirent à le lui révéler dans toute son ampleur ; ce fut l’éclair dans les ténèbres.
Un jour de novembre il était parti à cheval vers Poole en compagnie de son camarade écuyer Peter Terlake, pour aller chercher certains bois d’arc chez Wat Swathling, armurier du Dorsetshire. Le jour du grand départ n’était pas éloigné. Les deux jeunes gens rentraient au galop car la nuit était déjà tombée et il y avait encore beaucoup à faire. Peter était un garçon élevé à la campagne, sec, dur, bronzé ; il attendait la guerre comme l’écolier attend les vacances. Toute la journée cependant il s’était montré sombre et taciturne.
– Dis-moi, Alleyne Edricson, fit-il tout à coup pendant qu’ils franchissaient les collines de Bournemouth, ne t’a-t-il pas semblé que ces temps-ci la damoiselle Maude est plus pâle et plus silencieuse que d’habitude ?
– C’est possible, répondit l’autre brièvement.
– Et qu’elle demeure plus souvent rêveuse à sa fenêtre qu’elle ne chevauche gaiement pour chasser. À mon avis, Alleyne, c’est ton enseignement qui lui retire tout goût pour la vie. Il est trop lourd pour elle, comme le serait une lance pesante pour un cavalier léger.
– Sa mère l’a voulu ainsi.
– Par Notre Dame, et sauf respect, s’écria Terlake, je crois que madame sa mère serait plus apte à commander une compagnie d’assaut qu’à élever sa tendre fille qui a la blancheur du lait. Écoute bien, Alleyne, ce que je n’ai jamais dit encore à âme qui vive : j’aime la belle damoiselle Maude, et pour la servir je verserais mon sang jusqu’à sa dernière goutte.
Il avait parlé d’une voix frémissante. Alleyne ne dit rien, mais il sentit un bloc de glace immobiliser son cœur.
– Mon père possède beaucoup d’acres, poursuivit l’autre, entre Fareham Creek et la côte de Portsdown Hill. Il y a dessus assez de granges à remplir, de bois à scier, de grain à moudre et de moutons à garder pour satisfaire n’importe quel exigeant, et je suis fils unique. Je suis sûr que Sir Nigel serait heureux d’une telle union.
– Mais la damoiselle ? demanda Alleyne les lèvres sèches.
– Ah, camarade, voilà la cause de mes soucis ! Si je dis un mot de ce que je pense, c’est un hochement de tête, un regard d’une froideur… Autant soupirer après la statue de neige que nous avons édifiée l’hiver dernier dans la cour de notre château ! Je n’ai fait que lui demander hier soir son voile vert afin que je puisse l’arborer sur mon heaume. Elle m’a lancé à la figure qu’elle le gardait pour un meilleur homme que moi, et puis du même souffle elle m’a demandé pardon pour m’avoir répondu si rudement. Mais elle n’a pas retiré ses mots et elle a refusé de me donner son voile. T’est-il apparu, Alleyne, qu’elle aime quelqu’un ?
– Non, je ne saurais le dire ! fit Alleyne qui tressaillit d’une nouvelle espérance.
– J’ai pensé à cela, mais je ne vois pas qui elle pourrait aimer. En vérité, en dehors de moi-même, de Walter Ford et de toi qui es clerc à demi, et du Père Christopher du prieuré, et de Bertrand le page, qui voit-elle ?
– Je n’en sais rien…
Les deux écuyers remirent leurs montures au galop et s’absorbèrent dans leurs pensées respectives.
Le lendemain matin le professeur constata que son élève était réellement pâle et fatiguée ; elle avait les yeux cernés, distraits. Ce changement lui fit de la peine.
– Je crains que ta maîtresse ne soit malade, Agatha, dit-il à la demoiselle d’atour quand Maude eut regagné sa chambre.
La servante lui décocha un regard oblique et rieur.
– Ce n’est pas une maladie mortelle ! fit-elle.
– Plaise à Dieu que non ! s’écria-t-il. Mais dis-moi, Agatha, de quel mal elle souffre.
– Je crois qu’en allongeant le bras je pourrais toucher une autre personne atteinte du même mal, répondit-elle avec le même coup d’œil de biais. Vous ne pouvez pas donner un nom à ce mal, vous qui êtes si savant ?
– Non. Simplement elle semble toute triste.
– Eh bien ! c’est que dans trois jours vous serez tous partis, et que le château de Twynham sera aussi lugubre que le prieuré. N’est-ce pas là assez pour assombrir une damoiselle ?
– C’est vrai. J’avais oublié qu’elle allait perdre son père…
– Son père ! s’exclama la demoiselle d’atour en éclatant d’un petit rire aigu. Oh, triple niais !
Et elle fila dans le couloir comme une flèche ; Alleyne demeura perplexe, partagé entre l’espoir et le doute, hésitant à ajouter foi au sens qui perçait sous les paroles d’Agatha.
CHAPITRE XIII
Comment la Compagnie Blanche partit pour la guerre
La fête de saint Luc était passée ; mais à la saint Martin, lorsque les bœufs sont conduits à l’abattoir, la Compagnie Blanche fut prête à se mettre en route. Les bugles d’airain sonnèrent du donjon et du portail. Les tambours de guerre battirent allégrement. Les hommes se rassemblèrent dans le baile extérieur ; ils étaient munis de torches car le jour n’était pas encore levé. De la fenêtre de l’armurerie, Alleyne contemplait les cercles de lumière jaune, les visages graves et barbus, le miroitement des armes, les têtes fines des chevaux. En tête se tenaient les archers, sur dix rangs, encadrés par des sous-officiers qui d’un mot bref réglaient les distances et l’alignement. Derrière étaient groupés les cavaliers vêtus d’acier ; les longues flammes de leurs lances droites retombaient devant les hampes de chêne ; ils étaient immobiles et silencieux ; on aurait dit des statues de métal, si par intermittence leurs montures n’avaient pas piaffé d’impatience. Ils étaient précédés par Black Simon, le guerrier de Norwich, dont la silhouette dégingandée était recouverte d’une armure imposante ; il portait sur son épaule droite le guidon de soie avec les cinq roses rouges. Tout autour des cercles de lumière, il y avait les serviteurs du château, les soldats de la garnison et quelques groupes de femmes sanglotant dans leurs tabliers et invoquant tous les saints du paradis pour que soient protégés Wat, Will ou Peterkin qui s’en allaient à la guerre.
Le jeune écuyer s’était penché en avant pour ne rien perdre d’un spectacle si nouveau pour lui. Il sentit une main se poser sur son épaule. Il se retourna : la damoiselle Maude était là, appuyée contre le mur, une main sur le cœur, mince et blanche comme un lis à demi épanoui. Elle cachait son visage, mais à son souffle entrecoupé il devina qu’elle pleurait de tout son cœur.
– Mon Dieu ! s’exclama-t-il bouleversé. D’où vient que vous êtes si triste, madame ?
– C’est de voir partir tous ces hommes braves, répondit-elle, et de penser au petit nombre de ceux qui reviendront. Beaucoup s’en vont, mais… Je me rappelle avoir déjà assisté à un départ, quand j’étais une petite fille, l’année de la grande bataille du Prince. Je me souviens du rassemblement dans le baile, pareil à celui d’aujourd’hui. Ma mère m’avait prise dans ses bras pour que je puisse regarder par cette même fenêtre.
– S’il plaît à Dieu, vous les verrez tous de retour avant la fin d’une année.
Elle secoua la tête et le regarda ; ses joues avaient rosi et ses yeux étincelaient.
– Oh, je me hais d’être femme ! cria-t-elle en tapant du pied. Que puis-je faire de bon ? Il faut que je reste ici, à parler, à coudre, à filer, et puis à filer, à coudre et à parler. Toujours tourner en rond, avec rien au bout. Et maintenant vous partez, vous aussi ! Qui me transportera en pensée hors de ces murailles grises ? Qui haussera mon esprit au-dessus de la tapisserie et de la quenouille ? Que puis-je faire ? Je ne suis pas plus utile, je ne vaux pas davantage qu’un arc brisé.
– Pour moi vous valez tant, s’écria-t-il dans un tourbillon de mots passionnés, que tout le reste ne compte plus ! Vous êtes mon cœur, ma vie, ma seule et unique pensée. Oh, Maude, je ne peux pas vivre sans vous, je ne puis pas vous quitter sans un mot d’amour ! Tout s’est transformé depuis que je vous connais. Je suis pauvre, d’humble naissance, très indigne de vous ; mais si un grand amour peut compenser de tels défauts, alors le mien en est capable. Donnez-moi un mot d’espoir, rien qu’une parole que je puisse emporter à la guerre ! Un mot seulement… Ah, vous vous dérobez, vous frémissez ! Je vous ai effrayée.
Deux fois elle remua les lèvres ; deux fois aucun son ne sortit de sa bouche. Enfin elle parla de la voix dure et mesurée de quelqu’un qui n’ose pas se fier à un langage trop franc.
– C’est trop soudain, dit-elle. Il n’y a pas longtemps, le monde ne comptait pas pour vous. Vous avez changé une fois. Qui m’assure que vous ne changerez pas encore ?
– Cruelle ! cria-t-il. Qui m’a changé ?
– Et puis, votre frère ! poursuivit-elle avec un petit rire en dédaignant de répondre à sa question. Je pense que c’est une coutume familiale chez les Edricson… Non, pardonnez-moi : je ne voulais pas railler. Mais en vérité, Alleyne, ceci est si brusque que je ne sais quoi dire.
– Dites-moi un mot d’espoir, même d’espoir lointain, un mot que je puisse chérir dans mon cœur !
– Non, Alleyne, cette bonté-là serait cruelle ; vous avez été pour moi un ami trop généreux et trop loyal pour que je veuille vous leurrer. Un lien plus étroit ne peut pas exister entre nous. Ce serait folie d’y penser. En admettant qu’il n’y ait pas d’autres raisons, il suffit de savoir que mon père et votre frère s’y opposeraient tous deux.
– Mon frère ! Qu’a-t-il à voir là ? Quant à votre père…
– Allons, Alleyne ! N’était-ce pas vous qui vouliez que j’agisse loyalement envers tous et, bien entendu, envers mon père en particulier ?
– C’est vrai ! cria-t-il. Mais vous ne me rejetez pas, Maude ? Vous me donnez bien un rayon d’espérance ? Je ne réclame ni gage ni promesse. Dites seulement que vous ne me haïssez pas, qu’en un jour plus heureux j’entendrai peut-être de votre bouche des paroles plus douces !
Elle porta sur lui un regard presque tendre, et une aimable réponse allait sans doute s’échapper de ses lèvres quand un cri rude, suivi d’un cliquetis d’armes et du piétinement des chevaux, retentit dans le baile. En l’entendant son visage se durcit, ses yeux brillèrent ; elle se redressa et rejeta la tête en arrière : une âme de feu dans un corps de femme.
– Mon père est en bas, dit-elle. Votre place est à son côté. Non, ne me regardez pas, Alleyne ! L’heure n’est plus aux badinages. Gagnez l’affection de mon père, et tout peut suivre. C’est après avoir fait son devoir qu’un brave espère une récompense. Allez, et que Dieu soit avec vous !
Elle tendit sa longue main blanche, mais quand il voulut poser ses lèvres sur le poignet, elle s’échappa en lui abandonnant le voile vert qu’avait vainement sollicité le pauvre Peter Terlake. Des acclamations jaillirent du baile. Il entendit aussi le bruit de la herse qu’on relevait. Il enfouit son visage dans le voile, le cacha sous sa tunique, et se précipita pour rejoindre son maître.
La lumière du jour avait percé les ténèbres ; on servit à la ronde de la bière épicée pendant que s’échangeaient les derniers adieux. Un vent froid soufflait de la mer. Des nuages bas, déchiquetés, couraient à travers le ciel. Les gens de Christchurch s’étaient réunis par petits paquets près du pont de l’Avon ; les femmes s’enveloppaient dans leurs châles. L’avant-garde de la petite armée descendit du château ; les pas résonnaient sur le sol gelé. Black Simon avec le pennon défila en tête sur un destrier aussi maigre et puissant que son cavalier. Derrière lui, sur trois de front, venaient neuf hommes d’armes : c’étaient des soldats d’élite qui avaient déjà guerroyé en France et qui connaissaient les marches de Picardie aussi bien que les dunes de leur Hampshire natal ; ils étaient armés jusqu’aux dents : lance, épée, masse d’armes, avec des boucliers carrés pourvus à l’angle droit supérieur d’une encoche destinée à soutenir la lance à l’horizontale ; pour la protection individuelle, chacun portait une cotte de courroies de cuir entrecroisées renforcée à l’épaule, au coude et sur l’avant-bras par des bandes d’acier ; les jambières et les genouillères étaient aussi en cuir renforcé d’acier ; gantelets et souliers étaient constitués par des plaques de fer adroitement jointes ; ainsi franchirent-ils, dans le fracas des armures et des sabots, le pont de l’Avon sous les ovations des bourgeois qui saluaient les cinq roses et leur garde d’honneur.
Immédiatement après les chevaux, marchaient quarante robustes archers barbus, un petit bouclier rond sur le dos et le long arc jaune (l’arme la plus meurtrière à cette époque) dépassant la ligne des épaules ; à la ceinture pendait une hache ou une épée selon le goût de chacun ; sur la hanche droite le carquois de cuir projetait sa bosse garnie de plumes d’oie, de pigeon ou de paon. Derrière les archers deux tambours battaient, et deux trompettes bariolés soufflaient dans leurs instruments. Leur succédèrent vingt-sept chevaux de bât qui portaient des piquets de tente, des armes de rechange, des éperons, des coins, des marmites, des fers pour les chevaux, des sacs de clous et cent autres objets dont l’expérience avait prouvé qu’ils étaient utiles dans un pays dévasté et hostile. Un mulet blanc avec un caparaçon rouge était conduit par un valet : il était chargé du linge et des accessoires de table de Sir Nigel. Suivaient quarante archers, dix hommes d’armes et enfin une arrière-garde de vingt archers avec le gros John plastronnant au premier rang à côté du vétéran Aylward dont l’équipement bosselé et le surcot décoloré contrastaient singulièrement avec la tenue neuve de ses compagnons. Un feu croisé de compliments, de vœux et de questions (sans oublier les grosses plaisanteries saxonnes) mit aux prises les archers en marche et la foule des badauds.
– Holà, vieil Higginson ! cria Aylward en apercevant la silhouette imposante de l’aubergiste du village. Finie la bière brune, mon gars ! Nous t’abandonnons ton poison.
– Par saint Paul, non ! répliqua l’autre. Tu l’emportes avec toi. Il n’en reste plus une goutte dans le grand tonneau. Il était temps que tu partes !
– Si ton tonneau est léger, je gage que ta bourse est lourde, mon bonhomme ! lança Hordle John. Veille à ce que ta cave soit pleine pour notre retour.
– Veille, toi, à garder ta gorge pour la boire ! cria un autre sous les rires de la foule.
– Si tu garantis la bière, moi je garantis la gorge ! fit John sans sourciller.
– Serrez les rangs ! commanda Aylward. En avant, mes enfants ! Ah, par les os de mes dix doigts, voici la douce Mary du moulin ! Mais elle est ravissante ! Adieu, Mary, ma chérie ! Mon cœur est toujours à toi. Remonte ta ceinture, Watkin, et balance tes épaules comme un vrai compagnon franc. Par ma garde ! Vos justaucorps seront aussi sales que le mien quand vous reverrez Hengistbury Head.
La Compagnie était arrivée au tournant de la route quand Sir Nigel Loring franchit le portail. Il montait Pommers, son grand destrier noir, dont le pas majestueux sur le bois du pont-levis répercuta des échos bruyants sous la voûte sombre qui l’enjambait. Sir Nigel était encore vêtu de son costume de temps de paix, avec une toque plate de velours et une plume d’autruche maintenue par une broche en or. (Pour ses trois écuyers qui chevauchaient derrière lui, c’était comme s’il portait l’œuf de l’oiseau en même temps que sa plume, car sa nuque chauve luisait comme un globe d’ivoire.) Il avait pour seule arme l’épée longue et lourde qui était accrochée à sa selle ; mais Terlake portait devant lui le haut bassinet, Ford la lourde lance de frêne avec le pennon à pointe, Alleyne le bouclier armorié. Lady Loring sur son palefroi s’était placée à côté de son seigneur, car elle voulait l’accompagner jusqu’à la lisière de la forêt ; elle tournait fréquemment vers lui son visage aux traits tirés, et elle inspectait du regard son équipement.
– J’espère n’avoir rien oublié, dit-elle à Alleyne qu’elle invita à chevaucher à sa hauteur. Je vous le confie, Edricson. Les chausses, les chemises, le linge sont dans le panier brun sur le flanc gauche du mulet. Son vin, il le prend chaud quand les nuits sont froides, avec une quantité d’épices qui recouvrirait l’ongle du pouce. Veillez à ce qu’il se change s’il revient en sueur d’une joute. Là, il y a de la graisse d’oie dans une boîte, pour le cas où ses vieilles cicatrices se réveilleraient à un changement de temps. Il faut que ses couvertures soient sèches, et…
– Allons, cœur de ma vie ! interrompit le petit chevalier. Ne vous souciez pas de cela pour l’instant. Pourquoi es-tu si pâlot, Edricson ? N’y a-t-il pas de quoi faire danser de joie un cœur viril ? Regarde cette Compagnie, ses vaillants cavaliers, ses archers solides. Par saint Paul, je serais bien à plaindre si je n’étais pas satisfait d’une pareille escorte pour les roses rouges !
– Je vous ai déjà remis la bourse, Edricson, poursuivit Lady Loring. Il y a dedans vingt-trois marcs, un noble, trois shillings et quatre pence : un véritable trésor. Et je vous prie de vous rappeler, Edricson, qu’il a deux paires de souliers : l’une en cuir rouge pour l’ordinaire, l’autre avec des chaînettes d’or pour le cas où il boirait du vin en compagnie du Prince ou de Chandos.
– Douce oiselle, intervint Sir Nigel, je suis bien triste de me séparer de vous, mais nous sommes maintenant au bord de la forêt, et il ne serait pas séant que je retienne la châtelaine trop loin de ce qui lui est confié.
– Mon cher seigneur, s’écria-t-elle en mordant sa lèvre, laissez-moi vous accompagner encore pendant un furlong ou deux. Vous allez voyager seul pendant tant de lieues !
– Venez donc, ma consolation ! répondit-il. Mais je désire un gage de vous. J’ai pour coutume, ma chère, et cela depuis que je vous connais, de faire proclamation par héraut dans tous les camps, places fortes ou villes où je séjourne, que ma dame étant sans rivale pour la beauté et la tendresse dans toute la Chrétienté, je serais très honoré si un gentilhomme courait trois fois contre moi à la lance pour le cas où il voudrait soutenir les droits de la sienne. Je vous prie donc, ma belle colombe, de me confier l’un de ces gants de daim afin que je puisse le porter en gage de celle dont je serai toujours le serviteur.
– Hélas pour la beauté et la tendresse ! cria-t-elle. Belle et tendre je le serais volontiers pour vous, mon seigneur, mais je suis vieille et laide, et les chevaliers riraient si vous mettiez votre lance en arrêt pour une telle cause !
– Edricson, dit Sir Nigel, tu as des yeux jeunes ; les miens sont un peu obscurcis. Si par hasard tu vois un chevalier rire, ou sourire, ou même arquer le sourcil ou se mordre les lèvres ou manifester une surprise quelconque quand je me ferai le champion de Lady Mary, tu prendras note de son nom, de sa cotte d’armes et de son logement. Votre gant, désir de ma vie !
Lady Mary Loring retira son gant de daim qu’il éleva avec respect et fixa sur le devant de sa toque de velours.
– Je le place avec mes autres anges gardiens, dit-il en désignant les médailles de saints qui étaient accrochées à côté du gant. Et maintenant, ma très chérie, vous êtes venue suffisamment loin. Puisse la Vierge vous garder et vous favoriser ! Un baiser !
Il se pencha de sa selle, puis enfonçant ses éperons dans les flancs de son cheval, il partit au triple galop vers ses hommes ; ses trois écuyers le suivirent. Un kilomètre plus loin, quand la route escalada une colline, ils se retournèrent : Lady Mary sur son palefroi blanc était demeurée à l’endroit où ils l’avaient laissée. Quand ils redescendirent la côte, elle avait disparu.
CHAPITRE XIV
Comment, sur sa route, Sir Nigel chercha l’aventure
Pendant quelque temps Sir Nigel parut très triste et abattu ; il gardait les yeux fixés sur le pommeau de sa selle. Edricson et Terlake chevauchaient à sa suite sans plus de gaieté, tandis que Ford, jeune étourneau insouciant, adressait des sourires à ses compagnons mélancoliques et faisait des moulinets avec la lourde lance de son maître ; il poussait une pointe à gauche, une autre pointe à droite, comme s’il luttait contre une armée d’assaillants. Une fois Sir Nigel se retourna sur sa selle ; instantanément Ford redevint aussi rigide que s’il avait été frappé de paralysie. Les archers se trouvaient derrière un virage ; tous quatre avançaient dans la solitude.
– Venez à ma hauteur, amis, je vous en prie ! commanda le chevalier en tirant sur ses rênes. Puisqu’il vous a plu de me suivre à la guerre, il serait bon que vous sachiez comment me servir le mieux. Je suis sûr, Terlake, que tu te montreras le digne fils d’un vaillant père, et que toi aussi, Ford, tu seras digne du tien. Quant à toi. Edricson, je pense que tu te souviens de cette vieille famille dont tu es issu. En premier lieu je voudrais que vous vous mettiez bien dans la tête que nous ne partons absolument pas pour amasser du butin ou pour exiger des rançons, quoique cette éventualité ne soit pas à écarter. Nous nous rendons en France et de là, je crois, en Espagne, pour quêter humblement des occasions de gagner de l’honneur et peut-être partager un peu de gloire. Je vous avertis donc que ma volonté est de courir toute chance de cet ordre. Je désire que vous ne l’oubliiez jamais et que vous me teniez au courant de tous cartels ou défis, des torts, des tyrannies, des infamies et nuisances dont des damoiselles seraient victimes. Aucune occasion n’est à dédaigner : j’ai vu des bagatelles comme faire tomber un gant ou donner une chiquenaude à une miette de pain qui, convenablement poussées, aboutissaient à une très noble joute à la lance. Mais, Edricson, n’aperçois-je pas là-bas un gentilhomme qui traverse les taillis ? Il conviendrait que tu lui présentes mes compliments et, s’il est de sang noble, peut-être consentira-t-il à échanger avec moi quelques coups de pointe.
– Ma foi, messire, dit Ford en se dressant sur ses étriers et en abritant ses yeux, c’est le vieux Hob Davidson, le gros meunier de Milton !
– Ah, c’est lui ? fit Sir Nigel en plissant les joues. Mais il ne faut pas mépriser les aventures de route. Je n’ai jamais vu de plus belles passes d’armes que dans ces rencontres de hasard, quand des gentilshommes veulent se distinguer. Je me rappelle qu’à deux lieues de la ville de Reims j’ai croisé un gentilhomme français, très brave et très courtois ; j’ai eu avec lui une fort honorable contestation pendant plus d’une heure ; j’ai toujours regretté de n’avoir pas su son nom, car il m’a frappé d’une masse d’armes et a continué son chemin avant que je fusse en état de lui répliquer ; mais je me rappelle son écu : un alérion sur fasce d’azur. J’ai été aussi transpercé à l’épaule en une occasion similaire par Lyon de Montcourt, que j’avais rencontré sur la grand-route entre Libourne et Bordeaux. Je ne l’ai vu qu’une fois, mais je lui porte la plus profonde estime et affection. La même chose m’est également arrivée avec l’écuyer Le Bourg Capillet, qui aurait été un très vaillant capitaine s’il avait survécu.
– Il est donc mort ? demanda Alleyne.
– Hélas ! Mon mauvais destin a voulu que je le tue au cours d’une dispute qui a éclaté dans un champ près de Tarbes. Je ne me souviens pas de la cause de notre querelle, car elle a eu lieu l’année de la grande chevauchée du Prince à travers le Languedoc, et il y a eu quantité d’escarmouches pendant notre progression. Par saint Paul ! Je ne crois pas qu’un honorable gentilhomme ait jamais eu plus de chances de se distinguer qu’en galopant en tête de l’armée et en arrivant aux portes de Narbonne, ou de Bergerac, ou du mont Giscar ; il y avait toujours un seigneur courtois qui l’attendait et se mettait à sa disposition pour lui permettre d’accomplir son vœu. J’en ai rencontré un à Ventadour ; il a couru trois fois contre moi entre l’aube et le lever du soleil pour l’exaltation de sa dame.
– Et vous l’avez tué aussi, messire ? interrogea Ford avec respect.
– Je ne l’ai jamais su. Il a été transporté à l’intérieur des murs et, comme j’avais eu la malchance de me briser l’os d’une jambe, j’éprouvais de graves difficultés à me tenir à cheval ou même debout. Pourtant grâce à la bonté du ciel et à la pieuse intercession du vaillant saint Georges, j’ai pu m’asseoir sur mon destrier le jour de la grande bataille qui se déroula peu après. Mais que vois-je là ? Une très belle et très imposante jeune fille, si je ne me trompe ?
C’était en effet une grande et forte fille de la campagne, un panier d’épinards sur la tête et un copieux morceau de lard sous son bras. Elle esquissa une révérence épouvantée quand Sir Nigel se découvrit et ralentit son cheval.
– Dieu soit avec toi, belle jeune fille ! dit-il.
– Dieu vous garde, noble seigneur ! répondit-elle en se balançant, incertaine, d’une jambe sur l’autre.
– Ne crains rien, jolie demoiselle ! fit Sir Nigel. Mais dis-moi si par hasard un pauvre et très indigne chevalier peut te rendre service. Pour le cas où tu aurais été maltraitée, je pourrais te faire rendre justice.
– Oh non, mon bon seigneur ! répondit-elle en serrant contre elle son morceau de lard comme si cette offre chevaleresque masquait un noir dessein. Je trais les vaches chez le fermier Arnold, et c’est un maître qui a le meilleur cœur du monde.
– Très bien ! fit-il en secouant sa bride. Je désire que vous ayez toujours en tête, poursuivit-il en s’adressant à ses écuyers, que la courtoisie et la gentillesse ne s’adressent pas seulement, comme le font bassement tant de faux chevaliers, à des jeunes filles d’une haute naissance : il n’y a pas de femme si humble qu’un vrai chevalier ne doive aider quand du tort lui a été fait. Mais voici un cavalier qui a l’air pressé. Il serait bon de lui demander où il se dirige, car peut-être souhaite-t-il se distinguer en chevalerie.
La route morne, balayée par le vent, s’enfonçait devant eux dans une petite vallée, puis, remontant la pente de la lande de l’autre côté, se perdait ensuite parmi les pins. Au loin, à travers des rangées de troncs maigres, le scintillement de l’acier indiquait la position de la Compagnie. Vers le nord le paysage boisé étendait sa monotonie ; mais vers le sud, entre deux dunes, la mer grise apparaissait ; à l’horizon se dessinait la voile blanche d’une galère. Juste en face des voyageurs un cavalier pressait sa monture pour gravir la côte ; il la cravachait et l’éperonnait comme s’il se hâtait vers une destination précise. Alleyne observa bientôt que le cheval rouan était gris de poussière, couvert d’écume ; il avait dû galoper pendant plusieurs lieues. Le cavalier avait une figure énergique, la bouche dure, l’œil perçant ; une lourde épée cliquetait à son côté ; un paquet blanc et rigide enveloppé de drap se balançait en travers du pommeau de sa selle.
– Messager du Roi ! hurla-t-il en arrivant sur eux. Dégagez la chaussée pour le serviteur du Roi !
– Pas si fort, l’ami ! dit le petit chevalier en faisant pivoter son cheval pour barrer la route. J’ai moi-même été le serviteur du Roi pendant trente années, mais je n’ai jamais vociféré ainsi sur une route paisible.
– Je galope pour son service, cria l’autre. Et je porte cela qui lui appartient. Vous me barrez le chemin à vos risques et périls.
– J’ai déjà vu des ennemis du Roi proclamer qu’ils galopaient pour son service, répondit Sir Nigel. Le démon des ténèbres peut se cacher sous un habit de lumière. Il faut nous montrer un signe ou un ordre de mission.
– Alors je vais me frayer le passage ! cria l’inconnu en posant une main sur la garde de son épée. Je ne me laisserai pas arrêter, moi au service du Roi, par le premier passant venu.
– Si vous êtes gentilhomme à quartiers et à cotte d’armes, zézaya Sir Nigel, je serai ravi d’approfondir ce débat. Sinon, j’ai trois écuyers fort dignes ; n’importe lequel prendra l’affaire à son compte et la débattra avec vous très honorablement.
L’homme dévisagea les quatre cavaliers, et sa main lâcha la garde de son épée.
– Vous me demandez un signe, dit-il. Je vais vous en montrer un, puisque vous y tenez.
À ces mots il découvrit l’objet qui était couché en travers de sa selle ; à leur profonde horreur ils reconnurent une jambe d’homme fraîchement sciée.
– … Par la dent de Dieu ! poursuivit-il avec un rire bestial. Vous me demandez si je suis homme à quartiers ? C’est exact ; je suis officier au tribunal des verdiers de Lyndhurst. Cette jambe de voleur sera pendue à Milton ; l’autre est déjà en place à Brockenhurst ; tout le monde saura ce qu’il en coûte de trop aimer le pâté de venaison.
– Pouah ! cria Sir Nigel. Passe sur l’autre bord de la route, mon garçon, et détale pour que nous ne te voyions plus ! Quant à nous, amis, mettons nos chevaux au trot pour traverser cette jolie vallée car, par Notre Dame, un souffle de l’air pur de Dieu sera le bienvenu après un tel spectacle…
Il reprit bientôt :
– … Nous espérions attraper un faucon, mais c’était un charognard. Ma foi, il existe des hommes dont le cœur est plus dur que du cuir d’ours ! En ce qui me concerne, j’ai pratiqué le vieux jeu de la guerre depuis que j’ai du poil au menton, et j’ai vu en une seule journée dix mille visages de braves tournés vers le ciel, mais je jure par mon Créateur que je ne peux pas supporter l’ouvrage du boucher.
– Et cependant, noble seigneur, dit Edricson, cet ouvrage-là n’était pas rare, paraît-il, en France !
– Il y en a eu trop, beaucoup trop ! répondit-il. Mais j’ai toujours remarqué que les meilleurs sur le champ de bataille étaient ceux qui se refusaient à maltraiter un prisonnier. Par saint Paul, ce ne sont pas ceux qui ouvrent la brèche qui pillent une ville, mais les immondes coquins qui surviennent quand la voie est dégagée pour eux ! Qu’est ceci parmi les arbres ?
– Une chapelle de Notre Dame, expliqua Terlake, et un mendiant aveugle qui vit des aumônes des fidèles.
– Une chapelle ! s’écria le chevalier. Alors disons une oraison…
Il se découvrit et, joignant les mains, il psalmodia d’une voix aiguë :
– … Benedictus dominus Deus meus, qui docet manus meas ad prœlium, et digitos meos ad bellum…
À ses· trois écuyers il offrait vraiment un spectacle étrange : perché sur son grand cheval, yeux levés vers le ciel, crâne nu luisant sous le soleil d’hiver.
– … C’est une noble prière, dit-il en se recouvrant. Elle m’a été enseignée par le seigneur Chandos en personne. Mais comment te portes-tu, père ? Je n’éprouve que de la compassion pour toi, puisque je suis moi-même comme quelqu’un qui regarderait par une fenêtre embuée tandis que mes voisins voient à travers du pur cristal. Cependant, par saint Paul, il y a une grande différence entre l’homme qui a une vue brouillée et celui qui ne voit rien du tout.
– Hélas, beau sire ! s’exclama l’aveugle. Je n’ai pas vu le bleu béni du ciel depuis quarante ans.
– Tu as été aveugle à beaucoup de choses bonnes et belles, dit Sir Nigel. Mais tu as évité beaucoup de laideurs et beaucoup de mal. Nos yeux viennent justement d’être impressionnés par un objet qui t’aurait laissé insensible. Par saint Paul, il faut que nous partions ; sinon, notre Compagnie croirait avoir perdu son capitaine au début de son aventure ! Jette ma bourse à cet homme, Edricson, et allons-nous-en.
Alleyne, qui flânait derrière, se souvint de la recommandation de Lady Loring ; il réduisit le généreux présent du chevalier à un penny que le mendiant enfouit dans sa besace en marmonnant force bénédictions. Puis le jeune écuyer éperonna sa monture et rattrapa ses compagnons à l’endroit où la lande succédait aux arbres et où le hameau de Hordle dispersait ses maisons des deux côtés de la route. La Compagnie avait déjà fait son entrée dans le village. Quand le chevalier et ses écuyers se rapprochèrent, ils entendirent une voix stridente, à laquelle répondait un grand rire dans les rangs des archers. Une minute plus tard ils avaient rejoint l’arrière-garde : les hommes avançaient la barbe sur l’épaule et la figure hilare. Sur le flanc de la colonne marchait un archer gigantesque aux cheveux roux, qui agitait les bras et discourait ferme, tandis qu’une petite femme ridée l’accablait d’injures agrémentées de coups de bâton. Elle aurait pu frapper aussi bien un arbre de la forêt, à en juger par l’effet produit.
– J’espère, Aylward, dit gravement Sir Nigel, que ceci ne signifie pas que cette femme a été rudoyée. Si jamais violence était commise à l’égard d’une femme, je déclare que le responsable sera pendu, même s’il était le meilleur archer de la terre !
– Non, mon noble seigneur, répondit Aylward avec un large sourire. C’est un homme qui subit en ce moment des violences. Il est natif de Hordle, et cette femme est sa mère ; voilà comment elle l’accueille.
– Lourdaud, bon à rien ! criait-elle en tapant sur John de toutes ses forces. Je vais t’apprendre, moi ! Je vais te bâtonner ! Oui, par ma foi !
– Allons, mère ! répondait John. Je vais en France comme archer pour donner des coups et en recevoir.
– En France, tu dis ? Reste plutôt ici avec moi, et je te promets plus de coups que tu n’en recevras jamais en France. Si tu cours après les coups, inutile d’aller plus loin !
– Par ma garde, la bonne dame dit vrai ! fil Aylward. C’est le paradis des coups, par ici !
– De quoi te mêles-tu, galérien ? cria la farouche vieille dame en prenant l’archer à parti. Ne puis-je pas causer avec mon fils sans entendre le claquet de ta langue ? Un soldat sans un poil de barbe ! J’ai vu de meilleurs soldats que toi : ils tétaient encore leur mère et pour tout équipement ils avaient des langes !
– Prends cela pour toi, Aylward ! crièrent les archers dans un grand éclat de rire.
– Ne la contrarie pas, camarade ! dit le gros John. Elle a bon cœur, mais elle ne souffre pas d’être contredite. Il m’est bon et agréable d’entendre sa voix et de sentir qu’elle est derrière moi. Mais il faut que je vous quitte maintenant, mère, car la route est trop mauvaise pour vos pieds. Je vous rapporterai une robe de soie, si j’en trouve une en France ou en Espagne, et j’apporterai à Jinny un penny en argent. Bonsoir, mère, et que Dieu vous garde !
Il enlaça la petite vieille, la souleva légèrement pour l’embrasser, puis alla reprendre sa place dans les rangs.
– Il a toujours été comme ça ! cria-t-elle en prenant à témoin Sir Nigel qui avait arrêté son cheval et l’écoutait avec la plus exquise politesse. Il en a toujours fait à sa tête, en dépit de tout ce que j’ai pu lui dire. D’abord il devait se faire moine, à cause d’une fille qui a été assez sage pour lui tourner le dos. Puis le voilà qui s’engage dans une troupe de bandits, et il s’en va à la guerre ; mais moi je n’aurai personne pour entretenir le feu si je sors, ou soigner la vache si je reste à la maison. Cependant j’ai été une bonne mère pour lui ! Trois volées de coudrier par jour, je lui administrais sur les épaules ! Il s’en souciait aussi peu qu’aujourd’hui.
– Soyez sûre qu’il vous reviendra sain, sauf et prospère, bonne dame, répondit Sir Nigel. En attendant je regrette d’avoir déjà remis ma bourse à un mendiant sur la route, et je…
– Non, messire, interrompit Alleyne. Il me reste quelques pièces de monnaie.
– Alors je vous prie de les remettre à cette très digne, femme.
Il s’éloigna au petit trot. Alleyne déboursa encore deux pence et il laissa la vieille dame au bout du hameau ; sa voix perçante ne maudissait plus ; elle multipliait à présent les bénédictions.
Il y avait deux carrefours avant le gué de Lymington ; au premier et au second Sir Nigel arrêta son cheval et guetta en se tordant le cou une aventure possible. Les carrefours, expliqua-t-il, étaient des endroits rêvés pour des joutes à la lance entre chevaliers ; dans sa jeunesse il avait vu parfois des gentilshommes attendre là pendant des semaines, et soutenir des controverses courtoises avec les premiers venus en vue de se distinguer personnellement et pour le plus grand honneur de leur dame. Toutefois les temps avaient évolué ; les pistes à travers la forêt étaient désertes et silencieuses ; aucun martèlement de sabots, aucun cliquetis d’armures ne signalait l’approche d’un adversaire éventuel. Sir Nigel poursuivit donc son chemin fort déçu. Arrivés devant la rivière de Lymington, les hommes s’ébrouèrent au passage du gué, puis firent halte sur l’autre rive afin de manger le pain et la viande salée que portaient les chevaux de bât. Avant que le soleil fût parvenu à son zénith, ils s’étaient remis en route et leurs deux cents pieds marchaient comme deux.
Un troisième carrefour était situé à l’endroit où la piste de Boldre descendait vers le village de pêcheurs qui s’appelle Pitt’s Deep. Quand la troupe s’engagea dans la descente, elle croisa deux hommes qui avançaient l’un derrière l’autre. Les cavaliers ne purent s’empêcher de ralentir leurs montures car cette paire de voyageurs n’était pas ordinaire. Le premier était difforme, sale ; il avait des yeux rusés, cruels, et une tignasse rousse ; il tenait à la main une petite croix en bois blanc qu’il élevait si haut que tous les soldats l’aperçurent ; il semblait être parvenu à la dernière extrémité de l’épouvante, car son visage était couleur de terre et il tremblait de tous ses membres. Derrière lui marchait un homme à barbe noire ; son regard était implacable, et il avait la bouche crispée. Il portait sur l’épaule un grand bâton noueux muni de trois clous à la pointe. De temps à autre il le balançait en l’air comme s’il avait du mal à se retenir de l’abattre sur le crâne de son compagnon. Ainsi déambulaient-ils en silence sous les branches qui bordaient le sentier herbeux de Boldre.
– Par saint Paul ! s’écria le chevalier. Voici un curieux spectacle. Il se peut qu’une aventure aussi dangereuse qu’honorable nous soit offerte. Je te prie, Edricson, d’aller au-devant d’eux et de t’enquérir du motif de ce manège.
Il n’eut pas besoin de bouger, car les deux hommes approchèrent jusqu’à ce qu’ils ne fussent plus qu’à une longueur de lance. Celui qui portait la croix s’assit lamentablement sur un tertre moussu, tandis que l’autre demeura debout derrière lui avec son gourdin en l’air ; il était si absorbé et il regardait si férocement son compagnon qu’il ne leva pas les yeux vers le chevalier et ses trois écuyers.
– Je te prie, ami, dit Sir Nigel, de nous renseigner sur ton nom, et sur la raison qui te fait poursuivre cet homme d’une telle inimitié.
– Tant que je me maintiendrai dans les limites de la loi du Roi, répondit l’inconnu, je ne vois pas pourquoi je te rendrais des comptes.
– Tu n’es pas un raisonneur très logique, fit le chevalier. Car s’il est légal que tu le menaces de ton gourdin, il n’est pas moins légal que je te menace de mon épée.
L’homme qui portait la croix tomba sur les genoux, leva les mains et son visage s’illumina d’espoir.
– Pour l’amour du Christ, noble seigneur, s’écria-t-il, j’ai à ma ceinture un sac qui contient cent nobles ; je vous le remettrai volontiers si vous passez votre épée dans le corps de cet homme.
– Comment, coquin ? s’exclama Sir Nigel. Penses-tu que le bras d’un chevalier s’achète comme une marchandise de colporteur ? Par saint Paul ! La haine de cet homme ne doit pas être sans fondements !
– En vérité, messire, vous avez raison ! déclara l’homme au gourdin pendant que l’autre se rasseyait sur le bord de la route. Car cet individu est Peter Peterson, vide-gousset et meurtrier célèbre, qui a causé beaucoup de dégâts dans les environs de Winchester. Juste avant-hier, pour la fête des saints Simon et Jude, il a tué mon jeune frère William dans la forêt de Bere. Rien que pour cela j’irais à l’autre bout de la terre pour avoir le sang de son cœur.
– Mais si c’est exact, s’étonna Sir Nigel, pourquoi marches-tu derrière lui à travers la forêt ?
– Parce que je suis un honnête Anglais et que je ne prends que ce que m’accorde la loi. Une fois le crime commis, ce monstre s’est enfui au sanctuaire de la Sainte-Croix ; je l’y ai suivi. Le prieur, toutefois, a ordonné que tant qu’il tiendrait la croix personne ne pourrait lui mettre la main au collet sous peine d’excommunication, ce dont me protège le ciel ! Mais s’il pose la croix un instant, s’il ne se rend pas à Pitt’s Deep où il doit s’embarquer pour l’étranger, s’il ne prend pas le premier bateau en partance, si jusqu’à ce que le bateau soit prêt il ne se baigne pas chaque jour dans la mer à hauteur des reins, alors il devient un hors-la-loi, et je peux lui fracasser la cervelle.
Sur quoi l’homme à terre gronda ; on aurait dit un rat ; l’autre serra les dents, secoua son gourdin et le considéra avec des yeux meurtriers. Le chevalier et ses écuyers regardèrent le bandit puis le vengeur, mais comme il s’agissait d’une affaire qu’ils étaient incapables de régler, ils ne s’attardèrent pas plus longtemps et reprirent leur route. Alleyne, s’étant retourné, vit que l’assassin avait tiré de sa besace du pain et du fromage et qu’il mangeait en silence avec la croix protectrice posée sur sa poitrine, tandis que l’autre, sombre et menaçant, debout sur le chemin ensoleillé, l’écrasait de son ombre noire.
CHAPITRE XV
Comment la cogghe jaune quitta le port de Lepe
Cette nuit-là la Compagnie dormit à St. Léonard, dans les grandes granges du couvent. Alleyne et John s’y retrouvèrent en pays de connaissance, car l’abbaye de Beaulieu était toute proche. Le jeune écuyer éprouva un sentiment bizarre quand il revit les robes blanches et quand il entendit le battement régulier de la cloche qui conviait aux vêpres. De bonne heure le matin ils prirent la direction de Lepe. En haut d’une colline parsemée de bruyère, ils découvrirent tout à coup le vieux port, ses maisons bien groupées, une traînée de fumée bleue et une forêt de mâts. À gauche et à droite la longue boucle bleue de la Solent léchait la plage jaune. À quelque distance de la ville, une ligne de petites embarcations se balançait paresseusement sur une houle légère. Plus loin un grand navire marchand était à l’ancre, haut de mâts, large d’embelle, peint en jaune canari, dominant les barques de pêche comme un cygne parmi les canards.
– Par saint Paul ! s’écria le chevalier. Notre brave marchand de Southampton ne nous a point dupés, car je crois bien que voilà notre bateau. Il m’avait dit qu’il serait de grande taille et peint en jaune.
– Oui, par ma garde ! murmura Aylward. Il est jaune comme la griffe d’un milan, et il pourrait transporter autant d’hommes qu’il y a de pépins dans un grenadier.
– Tant mieux, fit Terlake. Car à mon avis, messire, nous ne sommes pas les seuls à attendre un passage pour la Gascogne. J’aperçois par-ci par-là du côté de ces maisons un miroitement qui ne provient sûrement pas de la veste d’un marin ou du pourpoint d’un bourgeois.
– Je le vois aussi, dit Alleyne en abritant ses yeux. Et je distingue en outre des hommes d’armes dans les bateaux qui font la navette entre le vaisseau jaune et le rivage. Mais voici déjà des gens qui viennent nous souhaiter la bienvenue.
Une foule de pêcheurs, de bourgeois et de femmes s’échappait en effet de la porte du nord ; tous agitaient les bras, dansaient de joie, comme s’ils venaient d’être délivrés d’une grande frayeur. À leur tête chevauchait un homme très imposant et très solennel qui avait un menton allongé et les paupières tombantes. Il portait autour de son cou une écharpe de fourrure et une lourde chaîne dorée terminée par un médaillon qui dansait sur sa poitrine.
– Soyez le bienvenu, puissant et noble seigneur ! s’écria-t-il en se découvrant devant Black Simon. J’ai entendu parler des vaillants exploits de votre seigneurie, et, à vrai dire, ils sont dignes de votre visage et de votre maintien. Puis-je faire quelque chose pour vous ?
– Puisque vous me le demandez, répondit l’homme d’armes, je serais heureux que vous me remettiez un ou deux anneaux de la chaîne que vous portez autour de votre cou.
– Comment ! La chaîne de la Corporation ? s’exclama l’autre, horrifié. L’ancienne chaîne de la commune de Lepe ? C’est une mauvaise plaisanterie, Sir Nigel !
– Alors pourquoi diable me demandiez·vous si vous pouviez faire quelque chose pour moi ? dit Simon. Mais puisque c’est à Sir Nigel que vous désirez parler, le voici sur le cheval noir.
Le maire de Lepe contempla avec stupéfaction le doux regard et la fragile constitution du célèbre guerrier.
– Je vous demande pardon, très gracieux seigneur ! fit-il. Vous avez devant vous le maire et le premier magistrat de la vénérable et puissante ville de Lepe. Je vous souhaite de tout cœur la bienvenue, d’autant plus que vous arrivez à un moment où nous sommes bien en peine pour nous défendre.
– Ah ! s’écria Sir Nigel en dressant l’oreille.
– Oui, messire. La ville est fort ancienne, les murs aussi vieux que la ville. Mais il y a certain pirate normand, un scélérat assoiffé de sang qui s’appelle Tête-Noire et qui, avec un Gênois du nom de Tito Caracci, couramment surnommé Barbe-en-Pointe, est un véritable fléau sur la côte. En vérité, messire, il s’agit d’individus très cruels, sans foi ni loi, implacables et impitoyables ; s’ils débarquaient dans la vénérable et puissante cité de Lepe, alors…
– Alors, adieu à la vénérable et puissante cité de Lepe ! ajouta Ford dont la langue trop vive l’emportait parfois sur le respect qu’il devait à Sir Nigel.
Mais le chevalier était trop intéressé par cette affaire nouvelle pour prendre garde au bavardage de son écuyer.
– Avez-vous motif de penser, demanda-t-il, que ces pirates sont sur le point de se hasarder dans une expédition contre vous ?
– Ils sont à bord de deux grandes galères, répondit le maire, pourvues de deux rangs d’avirons de chaque côté, et d’une grande quantité de machines de guerre et d’hommes d’armes. À Weymouth et à Portland ils ont commis des crimes et des rapts. Hier matin ils étaient à Cowes ; nous avons aperçu la fumée des maisons incendiées. Aujourd’hui ils ont mouillé près de Freshwater, et nous craignons fort qu’ils ne viennent par ici et qu’ils ne causent des dommages terribles.
– Il nous est impossible de nous attarder, dit Sir Nigel en dirigeant son cheval vers la ville tandis que le maire le suivait sur sa gauche. Le Prince nous attend à Bordeaux, et nous ne pouvons pas manquer le rassemblement général. Néanmoins je vous promets que sur notre route nous trouverons le temps de passer du côté de Freshwater et de faire en sorte que ces coquins vous laissent en paix.
– Nous vous sommes bien obligés ! s’écria le maire. Mais je ne vois pas, messire, comment sans navire de guerre vous pourrez les affronter. Avec vos archers au contraire vous pourriez fort bien tenir la ville et leur faire grand mal s’ils tentaient de débarquer.
– Il y a là-bas une cogghe très convenable, dit Sir Nigel. Il serait surprenant que n’importe quel vaisseau ne se transformât pas en navire de guerre sitôt mes hommes embarqués. Certes nous ferons comme je l’ai dit, et pas plus tard qu’aujourd’hui.
– Noble seigneur, intervint un homme aux traits durs et aux cheveux hirsutes qui marchait de l’autre côté du chevalier et qui écoutait attentivement, avec votre permission je ne doute pas de votre habileté dans les combats sur terre et dans le maniement de la lance, mais, sur mon âme, sur mer c’est différent ! Je suis le maître marinier de cette cogghe jaune ; je m’appelle Goodwin Hawtayne. J’ai navigué depuis ma plus tendre enfance. J’ai combattu les Normands, les Gênois, les Écossais, les Bretons, les Espagnols et les Maures. Je vous assure, messire, que mon bateau est trop léger et bien trop frêle, et que tout se terminera mal : nous aurons la gorge tranchée, ou nous serons vendus comme esclaves chez les Barbaresques.
– J’ai moi aussi quelque expérience de batailles navales, dit Sir Nigel, et je suis particulièrement heureux d’une si belle tâche en perspective. Je crois, mon bon maître marinier, que vous et moi pourrons gagner beaucoup d’honneur dans cette affaire ; déjà je devine que vous êtes brave et solide.
– Je n’aime pas cela, répondit l’autre avec entêtement. Par le saint nom de Dieu, je n’aime pas cela ! Et pourtant Goodwin Hawtayne n’est pas homme à reculer quand ses camarades vont de l’avant. Sur mon âme, que je coule ou que je flotte, je tournerai l’étrave vers Freshwater Bay, et si mon bon maître Witherton, de Southampton, n’aime pas ma manière de gouverner son navire, il ira chercher un autre maître marinier !
Ils étaient arrivés tout près de la vieille porte nord de la petite ville. Alleyne jeta un coup d’œil derrière lui : les archers et les hommes d’armes avaient rompu leurs rangs et ils se mêlaient aux pêcheurs et aux bourgeois dont les visages réjouis et les gestes chaleureux traduisaient le soulagement qu’ils ressentaient. Dans la foule, parmi les justaucorps noirs et les surcots blancs, il aperçut des taches rouges et bleues : c’étaient des guimpes et des châles de femmes. Aylward avait déjà une fille à chaque bras et prononçait des vœux alternés de fidélité, tandis que le gros John dominait l’arrière-garde de sa taille majestueuse (non sans avoir assis sur son épaule une petite fille joufflue qui caressait de son gracieux bras blanc son casque étincelant). Mais à la porte le cortège fut immobilisé par un homme monstrueusement gras, qui se précipitait hors de la ville avec la fureur inscrite sur tous ses traits.
– Alors, monsieur le Maire ? rugit-il. Où sont les palourdes et les coquilles saint-Jacques ?
– Par Notre Dame, cher Sir Oliver, s’écria le maire, j’ai eu tant de choses en tête, avec ces scélérats si près de nous, que je n’y ai plus du tout songé.
– Des mots ! hurla l’autre. Vous croyez peut-être que vous vous débarrasserez de moi avec des belles phrases ? Je vous le répète : où en sont les palourdes et les coquilles saint-Jacques ?
– Mon cher seigneur, ne me bousculez pas ! cria le maire à son tour. Je suis un paisible commerçant, et je ne veux pas être interpellé de la sorte pour une si petite affaire.
– Petite affaire ? Il a dit petite affaire ! Des palourdes et des coquilles saint-Jacques ! Vous me conviez à votre table pour goûter aux spécialités de la ville, et quand j’arrive c’est tout juste si on me dit bonjour et je trouve une table vide. Où est mon porte-lance ?
– Non, Sir Oliver ! s’exclama Sir Nigel en riant. Que votre colère s’apaise, puisqu’au lieu d’un plat vous avez tout servi un vieil ami et compagnon !
– Par saint Martin de Tours ! cria le gros chevalier dont la fureur se métamorphosa instantanément en joie. N’est-ce pas mon cher petit coq de la Garonne ? Ah, mon doux cousin, que je suis heureux de cette rencontre ! En avons-nous vu, ensemble !
– Oui, par ma foi, nous avons vu, des vaillants ! s’écria Sir Nigel, les yeux brillants. Et nous avons déployé nos pennons dans quelques belles escarmouches ! Par saint Paul, nous avons connu en France de grandes joies !
– Et des chagrins aussi. J’ai quelques mauvais souvenirs de ce pays. Vous rappelez-vous ce qui nous advint à Libourne ?
– Non, je ne me rappelle pas que nous ayons tiré l’épée à cet endroit.
– Voyons, voyons ! protesta Sir Oliver. Vous ne rêvez à rien d’autre qu’à des plates ou à des bassinets ! N’y a-t-il pas place en vous pour d’autres joies plus douces ? Ah, aujourd’hui encore, je peux à peine en parler sans être ému ! Un feuilleté si merveilleux ! Des pigeons si tendres ! Et du sucre dans la sauce au lieu de sel ! Vous étiez ce jour à côté de moi, avec Sir Claude Latour et Lord de Pommers.
– Je m’en souviens, fit Sir Nigel en riant. Et je vous revois poursuivant le cuisinier dans la rue et menaçant de mettre le feu à l’auberge. Par saint Paul, digne maire, mon vieil ami est un homme dangereux, et je crois que vous feriez bien de régler à l’amiable votre différend !
– Les palourdes et les coquilles saint-Jacques seront prêtes avant une heure, répondit le maire. J’avais prié Sir Oliver Buttesthorn de faire à ma modeste table l’honneur de goûter aux spécialités dont nous tirons vanité, mais pour dire vrai cette alerte de pirates a obscurci mon esprit et je suis un peu distrait. Mais j’espère, Sir Nigel, que vous voudrez bien partager notre repas de none ?
– J’ai trop à faire, répondit Sir Nigel, car nous devons être à bord, hommes et chevaux, le plus tôt possible. Combien de soldats avez-vous rassemblés, Sir Oliver ?
– Quarante-trois. Quarante sont des ivrognes. Trois ne boivent que de l’eau. Je les ai tous fait passer sur le bateau.
– Ils feraient bien d’avoir les idées claires, car j’ai de l’ouvrage à leur donner avant que le soleil soit couché. J’ai l’intention, si cela vous convient, de risquer une attaque contre ces pirates normands et gênois.
– Les bateaux gênois transportent du caviar et d’excellentes épices du Levant, dit Sir Oliver. Nous pourrions tirer un grand profit de cette expédition. Je vous commande donc, maître marinier, dès que vous serez rentré à votre bord, de verser un casque d’eau de mer sur chacun de mes drôles.
Sir Nigel quitta le gros chevalier et le maire de Lepe pour conduire la Compagnie au bord de l’eau ; des péniches furent utilisées pour le transbordement. Les uns après les autres les chevaux furent hissés de force, soulevés des chalands et précipités dans la profonde embelle de la cogghe jaune où des stalles d’écurie les attendaient. À cette époque les Anglais étaient adroits et prompts pour ce genre d’opérations, car peu de temps auparavant Édouard avait embarqué cinquante mille hommes dans le port d’Orwell, avec leurs chevaux et leur équipement, en l’espace de vingt-quatre heures. Sir Nigel se fit si pressant sur le rivage, Goodwin Hawtayne si efficace sur la cogghe, que Sir Oliver avait à peine englouti sa dernière palourde quand trompettes et tambours annoncèrent le branle-bas. Dans la dernière embarcation qui quitta la côte, les deux chevaliers s’assirent ensemble à l’arrière (ils formaient un couple bien curieux !) tandis que les rameurs avaient les pieds posés sur de grosses pierres que Sir Nigel voulait embarquer sur la cogghe. Une fois les pierres à bord, le navire déploya sa grand’voile ; elle était pourpre ; en son milieu un saint Christophe doré portait le Christ sur son épaule. La brise soufflait, la voile se gonfla, le majestueux vaisseau se souleva et plongea parmi les vagues bleues, sous les applaudissements de la foule sur le rivage. À gauche s’étendait l’île verte de Wight dont les collines arrondies s’épaulaient jusqu’à l’horizon ; à droite c’était la côte boisée du Hampshire. Au-dessus le ciel était bleu acier ; le soleil d’hiver dardait de faibles rayons ; il faisait assez frais pour que le souffle des hommes se transformât en buée.
– Par saint Paul ! s’exclama gaiement Sir Nigel debout sur la poupe en regardant le rivage. C’est un pays qui vaut bien qu’on se batte pour lui ; mais il serait dommage d’aller en France pour y chercher ce qu’on trouve chez soi. N’avez-vous pas vu un bossu avant l’embarquement ?
– Non, je n’ai rien vu, grommela Sir Oliver, car j’ai été délogé avec une palourde dans le gosier, sans avoir eu le temps de vider un gobelet de vin de Chypre.
– Je l’ai vu, messire, dit Terlake. Un vieillard avec une épaule plus haute que l’autre.
– Heureux présage ! commenta Sir Nigel. Nous avons aussi croisé une femme et un prêtre ; nous devrions donc avoir de la chance. Qu’en dis-tu, Edricson ?
– Je ne sais pas, noble seigneur. Les Romains d’autrefois étaient un peuple très sage et pourtant ils ajoutaient foi à de tels présages. Les Grecs faisaient de même, ainsi que divers peuples de l’Antiquité réputés pour leurs sciences. Mais aujourd’hui beaucoup de modernes se moquent des présages.
– Il faut croire aux présages ! intervint Sir Oliver Buttesthorn. Je me rappelle qu’un jour en Navarre il tonna alors que le ciel était sans nuages. Nous comprîmes qu’un malheur n’était pas loin, et nous n’eûmes pas longtemps à attendre. Treize jours après, un cuissot de venaison fut volé par des loups à la porte même de ma tente, et le même jour deux flacons de vin vieux tournèrent à l’aigre.
– Vous pouvez aller chercher en bas mon équipement, dit Sir Nigel à ses écuyers. Et aussi, s’il vous plaît, celui de Sir Oliver. Nous l’endosserons ici. Vous aurez ensuite à vous équiper ; car aujourd’hui vous entrerez, je l’espère, très honorablement dans la carrière de la chevalerie et vous vous affirmerez des écuyers dignes et vaillants. Et maintenant, Sir Oliver, prenons nos dispositions : vous plairait-il de les ordonner, ou préférez-vous que je m’en charge ?
– Vous, mon petit coq, vous ! Par Notre Dame, je n’ai rien d’un poulet, mais je ne prétends pas en savoir autant sur la guerre que l’ex-écuyer de Sir Walter Manny. Réglez l’affaire comme vous l’entendez.
– Votre pennon flottera donc sur l’avant, et le mien sur la poupe. Je vous donne vos quarante hommes pour l’avant, plus quarante archers. Quarante hommes, plus mes hommes d’armes et mes écuyers se posteront sur la poupe. Dix archers, avec trente marins sous la direction du maître marinier, pourront tenir l’embelle, tandis que dix grimperont sur la vergue avec des pierres et des arbalètes. Cela vous plaît-il ?
– Beaucoup, par ma foi ! Mais voici mon armure. Il faut que je prenne mon temps, car je ne l’endosse plus aussi facilement que lorsque je partis pour ma première guerre.
Pendant ce dialogue la fièvre des préparatifs s’était emparée de la cogghe. Les archers formaient de petits groupes sur le pont ; ils mettaient à leurs arcs des cordes neuves et vérifiaient leur solidité sur les coches. Aylward et quelques vétérans distribuaient recommandations et conseils.
– Sous les armes, cœurs d’or ! disait le vieil archer en allant de groupe en groupe. Par ma garde, ce voyage commence bien ! Gardez en mémoire le vieux dicton de la Compagnie.
– Lequel, Aylward ? interrogèrent plusieurs soldats appuyés sur leur arc et riant de bon cœur.
– « C’est le refrain du maître archer : l’arc bien courbé, la flèche bien envoyée, la tige bien cochée, la corde bien bandée. » Avec ce refrain en tête, un brassart sur la main gauche, un gant de tir sur la main droite et un farthing de cire dans la ceinture, que peut désirer de plus un archer ?
– Quatre farthings de vin sous sa ceinture, dit Hordle John.
– Le travail d’abord, le vin ensuite, mon camarade ! Mais il est temps que nous prenions nos places, car il me semble qu’entre les rochers de l’Aiguille et les falaises d’Alum j’aperçois les mâts des galères. Hewett, Cook, Johnson, Cunningham, vos hommes garderont la poupe. Thornbury, Walters, Hackett, Baddlesmere, allez avec Sir Oliver à l’avant. Simon, tu restes avec le pennon de notre chef.
Rapidement les soldats obéirent et se couchèrent à plat ventre sur le pont, car tel était l’ordre de Sir Nigel. Près de la proue était plantée la lance de Sir Oliver avec ses armes (une tête de sanglier sur champ d’or). Près de la poupe Black Simon se tenait avec le pennon de la maison de Loring. Dans l’embelle étaient rassemblés les marins de Southampton : c’étaient des hommes robustes et à cheveux longs ; ils avaient retiré leurs justaucorps, serré leurs ceintures, et ils avaient à la main une épée, une masse ou une hache d’armes. Leur chef, Goodwin Hawtayne, causait sur la poupe avec Sir Nigel Loring ; ses yeux allaient constamment de la voile bien gonflée aux deux matelots qui tenaient la barre.
– Passez le mot, dit Sir Nigel, que personne ne se relève ou ne décoche une flèche avant le signal de mes trompettes. Il vaudrait mieux que nous ayons l’air d’un navire marchand de Southampton qui fuirait devant eux.
– Nous ne tarderons pas à les voir, dit le maître marinier. Tenez ! N’avais-je pas raison ? Les voici, ces vipères d’eau, dans la baie de Freshwater. Et regardez là-bas : cette fumée signale l’endroit où ils ont accompli de la vilaine besogne. Voyez : ils nous ont aperçu, leurs canots regagnent les galères, ils rappellent leurs hommes à bord… Ils ont levé l’ancre. On dirait des fourmis sur le gaillard d’avant ! Ils se penchent, ils rentrent les amarres. Oh, ce sont de bons marins ! Mon cher seigneur, je me demande si l’entreprise n’est pas trop forte pour nous. Ces deux navires sont des galères ; de grosses galères, des galères rapides !
– Je voudrais posséder vos yeux, fit Sir Nigel qui regardait désespérément vers les bateaux pirates. Ces galères me font bonne impression, et je crois que nous retirerons un grand plaisir de notre rencontre. Il serait préférable de passer le mot que nous ne ferons et ne recevrons pas quartier aujourd’hui. Avez-vous un prêtre ou un religieux à bord, maître Hawtayne ?
– Non, mon noble seigneur.
– Oh ! c’est sans grande importance pour ma Compagnie car mes hommes se sont tous confessés et ont été absous avant notre départ de Twynham ; et le Père Christopher du prieuré m’a donné sa parole qu’ils étaient en état d’aller au Ciel aussi bien qu’en Gascogne. Mais j’ai des doutes en ce qui concerne les hommes de Winchester de Sir Oliver : ils ne paraissent guère pieux. Passez le mot pour que les soldats s’agenouillent, et que les sous-officiers leur répètent le pater, l’ave et le credo.
Dans un grand bruit d’armes, les rudes archers et marins s’agenouillèrent, baissèrent la tête et joignirent les mains pour écouter les prières dites par leurs chefs de sections ; un grand nombre d’archers avaient tiré de leur tunique des amulettes et des reliques ; ceux qui possédaient un trésor encore plus sanctifié le faisaient passer à leurs camarades afin qu’en le baisant ils en retiennent la vertu.
La cogghe jaune s’était maintenant échappée des eaux resserrées de la Solent pour rouler sur les bosses mouvantes de la haute mer. Le vent d’est était frais, coupant ; la grande voile s’arrondissait, couchait le navire ; l’eau sifflait sous sa rambarde sous le vent. Large et lourde, la cogghe sautillait de vague en vague, enfonçait son étrave dans les lames bleues, projetait des flocons d’écume qui éclaboussaient le pont. À bâbord, les deux galères noires avaient déjà déployé leurs voiles et s’élançaient de la baie de Freshwater pour lui donner la chasse. Leur double rangée d’avirons devait leur permettre de rattraper n’importe quel voilier. La cogghe était haute et ronde. Longues, noires, rapides étaient les galères des pirates : elles faisaient penser à deux loups efflanqués et féroces qui auraient vu passer un cerf majestueux non loin de leur repaire.
– Faisons-nous demi-tour, noble seigneur ? Ou continuons-nous tout droit ? demanda le maître marinier qui regardait derrière lui avec des yeux anxieux.
– Non, il faut continuer tout droit et jouer le rôle d’un navire marchand qui refuse le combat.
– Mais vos pennons ? Ils verront que nous avons deux chevaliers à bord.
– Il ne serait pas loyal ni conforme à l’honneur d’un chevalier d’abaisser les pennons. Laissez-les plantés où ils sont. Ils croiront que nous sommes un transport de vins pour la Gascogne, ou que nous portons les balles de coton d’un marchand de tissus. Ma foi, comme ils sont rapides ! Ils fondent sur nous comme deux autours sur un héron. N’y a-t-il pas un symbole ou un dessin sur leurs voiles ?
– Celle de droite, répondit Edricson, semble arborer une tête d’Éthiopien.
– C’est l’emblème de Tête-Noire le Normand ! s’écria le maître marinier. Je l’ai déjà vu une fois, quand il nous a harcelés à Winchelsea. C’est un homme terriblement grand et gros, qui n’épargne ni femmes, ni enfants, ni animaux. On dit qu’il est fort comme six. Certes il a bien les crimes de six sur la conscience. Regardez les pauvres diables qui se balancent au bout de sa vergue !
À chaque extrémité de la vergue, en effet, un homme était pendu ; à chaque embardée de la galère son corps dansait et sautait comme celui d’un pantin grotesque.
– Par saint Paul ! fit Sir Nigel. Avec le secours de saint Georges et de Notre Dame, ce serait bien étrange si notre ami à tête noire ne se balançait pas au même endroit avant d’avoir vieilli de quelques heures. Qu’y a-t-il sur l’autre galère ?
– La croix rouge de Gênes. Barbe-en-Pointe est un capitaine très remarquable ; il prétend qu’il n’existe pas de marins ni d’archers au monde comparables à ceux qui servent le doge.
– Nous lui prouverons le contraire, dit paisiblement Sir Nigel.
– Il serait préférable, poursuivit Goodwin Hawtayne, de ne pas attendre qu’ils soient trop près pour relever les mantelets et les pavois qui nous protégeront contre leurs flèches.
Il cria un ordre ; les marins levèrent les mantelets et les pavois et les fixèrent avec une silencieuse promptitude. Les trois ancres de la cogghe furent ramenées, au commandement de Sir Nigel, dans l’embelle et attachées au mât avec un jeu de huit mètres de câble, chacune sous la garde de quatre matelots. Huit autres reçurent des sacs de cuir pleins d’eau afin d’éteindre les flèches enflammées qui pourraient tomber à bord ; d’autres enfin furent dirigés sur le mât et s’installèrent sur la vergue pour projeter des pierres ou des carreaux si l’occasion s’en présentait.
– Il faut les munir de tout ce qui est lourd et pesant sur le bateau, précisa Sir Nigel.
– Alors il faut leur envoyer Sir Oliver Buttesthorn, dit Ford.
Le chevalier le regarda d’un air qui effaça le sourire sur ses lèvres.
– Un écuyer à mon service, dit-il, ne plaisantera jamais un haut et puissant chevalier !…
Son visage se détendit, et il ajouta :
– … Je sais qu’il ne s’agit que d’une gaminerie sans méchanceté. Cependant je m’acquitterais mal de mon devoir envers ton père si je ne t’enseignais pas à châtier ta langue.
– Ils vont nous aborder chacun sur un flanc, messire ! cria le maître marinier. Voyez : ils se séparent ! Le Normand a un mangonneau ou un tromblon sur le gaillard d’avant. Voyez : ils pèsent sur les leviers ! Ils vont lâcher leur coup !
– Aylward ! appela le chevalier. Choisis tes trois meilleurs archers et tâche de les empêcher de bien viser. Je pense qu’ils sont à portée d’une longue flèche.
– Trois cent quarante pas ! estima l’archer d’un coup d’œil. Par les os de mes dix doigts, ce serait bien malheureux si nous ne faisions pas mouche à cette distance. Ici, Watkin de Sowley, Arnold, Long Williams ! Montrons à ces drôles ce que valent des archers anglais !
Les trois archers interpellés se levèrent et se placèrent à l’extrémité de la poupe ; ils se tinrent en équilibre sur leurs pieds largement écartés, ils levèrent leurs arcs, ils amenèrent les fers de flèche de niveau avec le centre de la tige de l’arc.
– Tu es le plus sûr, Watkin, dit Aylward qui avait mis une flèche sur sa corde. Occupe-toi du bandit à coiffe rouge. Vous deux, descendez l’homme au casque. Je me tiens prêt si vous le manquez. Ma foi, ils vont lâcher leur coup. Tirez, mes garçons, sinon ce sera trop tard !
La foule des pirates s’était éloignée de la grande catapulte de bois ; deux hommes seuls demeurèrent pour la manœuvrer. L’un d’eux, coiffé d’un bonnet rouge, se pencha au-dessus d’elle et immobilisa le gros roc qui était posé sur le bout du long levier en forme de cuiller. L’autre tenait la boucle de la corde qui devait libérer la décharge et expédier en l’air le projectile. L’espace d’une seconde leurs silhouettes se détachèrent nettement sur la voile blanche en arrière-plan ; une seconde plus tard, le pirate au bonnet rouge s’affalait en travers de la pierre, avec une flèche entre les côtes, tandis que son camarade, touché à la jambe et à la gorge, se tordait sur le sol. En tombant il avait lâché la corde, et la grosse poutre de bois, tournant avec une force terrible, projeta le corps du pirate au bonnet rouge si près de la cogghe qu’elle eut sa proue ensanglantée par des membres tordus et disloqués ; quant à la pierre, elle ricocha obliquement pour retomber à mi-chemin entre les navires. Une tempête de bravos et de rires s’éleva chez les archers et les marins. Un cri de rage fut la réponse des poursuivants.
– Couchez-vous maintenant, mes enfants ! cria Aylward en agitant sa main gauche. Ils ont appris la sagesse. Ils lèvent pavois et mantelets. Avant longtemps nous pourrions bien entendre siffler à nos oreilles certains oiseaux de ma connaissance !
CHAPITRE XVI
Comment la cogghe jaune se battit contre les deux bateaux-pirates
Les trois navires avaient rapidement viré vers l’ouest. La cogghe était toujours en tête, mais l’écart diminuait régulièrement entre elle et les pirates. À gauche l’océan s’étendait jusqu’à l’horizon : pas une voile en vue. Déjà l’île n’était plus qu’un nuage derrière eux, tandis que juste en face se trouvait le cap St. Alban, avec Portland noyé dans la brume. Alleyne se tenait près de la barre ; il regardait les poursuivants ; le vent frais lui glaçait le visage, agitait ses boucles blondes rebelles au bassinet ; il avait les joues rouges et les yeux brillants ; dans ses veines le sang de cent ancêtres saxons commençait à s’échauffer.
– Qu’était cela ? murmura-t-il.
Il avait cru entendre une voix sifflante, aiguë, chuchoter à son oreille. L’homme de barre sourit et allongea le pied pour lui montrer un carreau d’arbalète, lourd et court, qui s’était fiché dans les planches et qui vibrait encore. Au même instant le matelot tomba sur les genoux et s’écroula sans vie sur le pont ; une plume tachée de sang était piquée sur son dos. Alleyne se pencha pour le relever ; l’air lui sembla tout à coup rempli du zip-zip des flèches ; il les entendit fouetter le pont ; il pensa à des pommes tombant d’un pommier secoué.
– Levez deux mantelets de plus à la poupe ! commanda tranquillement Sir Nigel.
– Un autre homme à la barre ! cria le maître-timonier.
– Amuse-les avec dix de tes hommes, Aylward ! dit le chevalier. Et que dix des archers de Sir Oliver en fassent autant avec les Gênois. Je ne tiens pas encore à leur montrer toute notre force.
Dix archers choisis par Aylward se rangèrent en ligne sur le pont. Les jeunes écuyers qui ignoraient tout de la guerre prirent là une belle leçon ; ces vieux soldats étaient méthodiques et froids, ils obéissaient avec une promptitude merveilleuse, ils manœuvraient à dix comme un seul homme. Leurs camarades, accroupis sous la rambarde, ne ménagèrent à mi-voix ni les plaisanteries ni les conseils.
– Plus haut, Wat ! Mets-y tout ton poids, Will ! N’oublie pas le vent, Hal !
Ainsi murmurait le chœur, que dominaient le bruit sec des cordes, le sifflement des flèches, et le bref : « Placez la flèche ! Cochez la flèche ! Tirez ensemble ! » du maître-archer.
Ce fut au tour des mangonneaux de se mettre à l’ouvrage ; ils étaient si bien couverts et protégés sur les galères que, sauf au moment de la décharge, ils étaient invisibles. Un gros bloc de pierre brun tiré de la galère gênoise déchira l’air au-dessus de leurs têtes et tomba dans le creux d’une vague. Un autre, tiré par les Normands, siffla dans l’embelle, fracassa le dos d’un cheval et troua le flanc de la cogghe. Deux autres, projetés en même temps, arrachèrent un grand morceau du saint Christophe sur la voile et balayèrent trois des hommes d’armes de Sir Oliver sur le gaillard d’avant. Le maître marinier tourna vers le chevalier un visage soucieux.
– Ils gardent leurs distances, dit-il. Nos archers sont trop forts pour eux ; ils ne se rapprocheront pas. Comment nous défendre contre des pierres ?
– Je pense que nous pouvons les appâter, répondit gaiement le chevalier.
Il passa un ordre aux archers qui tiraient. Instantanément cinq d’entre eux levèrent une main et tombèrent prostrés sur le pont ; un autre avait déjà été tué par une flèche ; il n’en restait plus que quatre debout.
– Voilà qui devrait les encourager ! fit Sir Nigel.
Il observait les galères ; leurs avirons battaient l’eau avec lenteur.
– Ils ne se décident pas encore ! cria Hawtayne.
– Alors, deux de plus ! cria le chef. Cela suffira. Ma foi, ils mordent à l’hameçon avec une voracité de petits goujons. À vos armes, soldats ! Le pennon derrière moi, et les écuyers autour du pennon. Tenez bien les ancres dans l’embelle, et soyez prêts à les lancer ! À présent, sonnez, trompettes ! Et que la bénédiction de Dieu protège les honnêtes gens !
Tandis qu’il parlait, un grondement de voix et un roulement de tambours s’élevèrent des deux galères ; aussitôt l’eau fut métamorphosée en écume sous les coups cinglants, précipités, d’une centaine d’avirons. Les bateaux-pirates se ruaient enfin à l’abordage, l’un à droite, l’autre à gauche ; les flancs et les haubans étaient noirs de monde, hérissés d’armes. En groupes serrés, des hommes étaient suspendus aux gaillards d’avant, prêts à sauter. Il y avait des blancs, des jaunes, des bistrés, des noirs, des Norvégiens blonds, des Italiens basanés, des pirates du Levant, des Maures venus des États barbaresques, des originaires de tous pays qu’animait une égale férocité de fauves. Les bandits se déversèrent en hurlant sur les deux côtés du navire marchand sans défense.
Mais plus sauvage encore fut leur deuxième cri, plus perçant, plus aigu, quand émergèrent de l’ombre des silencieuses rambardes les archers anglais ; les flèches ouvrirent une brèche terrible dans la masse des assaillants décontenancés. Des flancs plus hauts de la cogghe, les archers pouvaient tirer droit vers le bas, et à une distance si courte qu’ils transperçaient immanquablement les cottes de mailles et les boucliers. Alleyne avait vu la poupe de la galère remplie de silhouettes bondissantes, de bras qui s’agitaient, de visages exultants ; une seconde suffit pour transformer ce décor en abattoir : les corps s’entassèrent les uns sur les autres ; les survivants s’abritèrent derrière les cadavres. Les marins qu’avait désignés Sir Nigel avaient jeté leurs ancres sur les galères ; les trois navires, comme dans une étreinte de fer, embardaient lourdement sur la houle.
Alors commença une bataille acharnée, féroce, l’une des mille batailles ignorées des chroniqueurs et des poètes. Au long des siècles, sur toutes ces eaux du sud, des inconnus ont lutté dans des endroits inconnus ; pour tout monument ils ont une côte protégée et un arrière-pays intact.
De l’avant à l’arrière les archers avaient nettoyé les ponts des galères. Mais les pirates s’étaient déversés dans l’embelle de la cogghe ; là marins et archers furent repoussés et il s’ensuivit un tel corps à corps qu’il devint impossible aux archers anglais du dessus de secourir leurs camarades en décochant leurs flèches. La mêlée fut sauvage : l’épée et la hache se levaient, retombaient ; Anglais, Normands, Italiens vacillaient et tournoyaient sur un pont encombré de cadavres et poisseux de sang. Le cliquetis des armes, les hurlements des blessés, le cri bref des insulaires, les appels farouches des écumeurs des mers s’entrecroisaient dans un vacarme étourdissant. Tête-Noire, le géant qui dominait ses compagnons de la tête et qui était entièrement recouvert de plates à toute épreuve dirigeait ses pirates ; il brandissait une énorme masse d’armes qu’il abattait sur tous ceux qui s’attaquaient à lui. Sur l’autre bord Barbe-en-Pointe, de taille minuscule mais très large d’épaules avec de longs bras, s’était taillé un chemin presque jusqu’au mât ; soixante Gênois le suivaient. Pris entre deux tenailles formidables, les marins se replièrent et se regroupèrent au pied du mât, encerclés par les assaillants.
Mais l’aide était proche. Sir Oliver Buttesthorn et ses hommes d’armes déboulèrent du gaillard d’avant, tandis que Sir Nigel avec ses trois écuyers, Black Simon, Aylward, Hordle John et une vingtaine d’hommes surgissait de l’arrière pour se lancer au plus épais du combat. Alleyne, comme son devoir le lui commandait, ne quittait pas son maître des yeux, le suivait comme son ombre. Il avait déjà entendu exalter les prouesses de Sir Nigel et l’habileté avec laquelle il maniait toutes ses armes de chevalier, mais ce qu’il vit ce jour-là dépassa tous les récits, tant le sang-froid et la rapidité de son seigneur faisaient merveille. C’était comme s’il était possédé d’un démon ; il sautait à droite, il sautait à gauche, il poussait une pointe, il parait avec son écu les coups qu’il rendait avec sa lame, il virevoltait sous le balancement d’une hache, il bondissait par-dessus le moulinet d’une épée ; il se montrait si vif, si impromptu, que le soldat qui se préparait à lui assener un coup le trouvait à six pas de lui avant qu’il eût pu abattre son bras. Il avait tué trois pirates, et il avait blessé Barbe-en-Pointe au cou quand Tête-Noire sauta sur lui en l’attaquant de biais d’un terrible coup de sa masse d’armes, Sir Nigel se baissa pour l’éviter et, au même moment, poussa une botte en direction du Gênois, mais son pied glissa dans une mare de sang et il tomba lourdement. Alleyne bondit pour affronter le Normand ; hélas, son épée vola en éclats et il s’effondra sous un deuxième coup de la masse d’armes. Avant que le chef des pirates eût eu le temps de frapper une troisième fois, la main de fer de John s’abattit sur son poignet : pour une fois Tête-Noire trouva son maître. Luttant de toutes ses forces pour libérer son arme, il ne put empêcher Hordle John de lui tordre lentement le bras jusqu’à ce que, dans un craquement sec, le membre devînt mou et flasque ; la masse d’armes s’échappa de cette main privée de vie. En vain tenta-t-il de la ramasser de l’autre main : son ennemi pesa sur lui, le courba en arrière jusqu’à ce que, dans un rugissement de douleur et de fureur, le géant s’écroulât de tout son long sur le pont : la lueur d’un couteau devant les barres de son casque l’avertit qu’au moindre geste sa confession et l’absolution seraient brèves.
Découragés par la perte de leur chef, les Normands se replièrent ; ils ralliaient maintenant par-dessus les rambardes leur propre galère, sautant douze à la fois sur le pont. Mais l’ancre la retenait dans ses griffes recourbées, et Sir Oliver, à la tête de cinquante hommes, les pourchassait. À présent les archers avaient le champ libre pour décocher leurs flèches. À présent aussi les marins sur la vergue de la cogghe pouvaient projeter leurs grosses pierres ; elles vinrent s’écraser sur les pirates en déroute qui couraient en sacrant et en jurant, plongeaient sous la voilure, s’accroupissaient derrière les bouts-dehors, se pelotonnaient dans les coins tels le lapin quand le furet est sur lui. L’époque ne se prêtait pas à l’indulgence : si l’honnête soldat, trop pauvre pour payer rançon, n’avait aucune chance de salut sur le champ de bataille, quelle pitié pouvait s’exercer en faveur de ces écumeurs, ennemis du genre humain, pris en flagrant délit de crime ?
Sur l’autre bord le combat avait changé de tournure. Barbe-en-Pointe et ses hommes avaient dû reculer sous la pression de Sir Nigel, Aylward, Black Simon et des soldats de la poupe. Les Italiens battaient en retraite pied à pied ; Barbe-en-Pointe avait son armure ruisselante de sang, son bouclier fendu, la crête de son casque arrachée, la voix enrouée. Pourtant il faisait front avec un courage indomptable, poussant une botte, sautant en arrière, sûr de ses pieds comme de sa main ; quand il ferraillait, il s’attaquait à trois adversaires à la fois. Ramené jusque sur le pont de son propre navire et suivi de près par une douzaine d’Anglais, il rompit brusquement devant ses assaillants, descendit le pont en courant, remonta sur la cogghe, coupa le cordage qui retenait l’ancre, et retomba au milieu de ses arbalétriers ; le tout en un instant. Aussitôt les marins gênois prirent appui avec leurs avirons sur le flanc de la cogghe ; un écart grandissant se creusa entre les deux navires.
– Par saint Georges ! cria Ford. Nous sommes coupés de Sir Nigel.
– Il est perdu ! gémit Terkale. Sautons pour le rejoindre !
Les deux jeunes écuyers sautèrent d’un élan désespéré vers la galère qui dérivait. Les pieds de Ford atteignirent le bord de la rambarde ; il se rattrapa à une corde et se projeta sur le pont. Terlake sauta trop court : il vint s’écraser entre les avirons et coula. Alleyne, titubant, voulut aussi se précipiter, mais Hordle John le retint par la ceinture.
– Tu peux à peine te tenir debout, mon gars ! Encore moins sauter. Regarde : le sang coule sous ton bassinet.
– Ma place est auprès du drapeau ! s’écria Alleyne en cherchant à se dégager.
– Reste ici. Il te faudrait des ailes pour arriver aux côtés de Sir Nigel !
Les navires étaient maintenant séparés par un tel écart que les Gênois pouvaient déployer leurs avirons et ramer à l’aise ; la galère s’écarta rapidement.
– Mon Dieu, mais c’est une splendide bagarre ! cria le gros John en battant des mains. Ils ont déblayé toute la poupe ! Ils sautent dans l’embelle ! Bien frappé, messire ! Joli coup, Aylward ! Regarde Black Simon, comme il fonce sur les marins ! Mais ce Barbe-en-Pointe est un brave. Il rallie ses hommes sur le gaillard d’avant. Il a tué un archer. Ah ! Notre cher seigneur est sur lui. Regarde cela, Alleyne ! Regarde ce tourbillon, ces éclairs !
– Par le Ciel, Sir Nigel est à terre ! cria l’écuyer.
– Il est debout ! rugit John. C’était une feinte. Il le fait reculer. Il le pousse sur le côté. Ah, par Notre-Dame, il l’a transpercé d’un coup d’épée ! Ils demandent merci. La croix rouge est amenée, et Simon hisse les roses de Sir Nigel !
La mort du chef gênois mit effectivement un terme à la résistance. Sous un tonnerre d’acclamations jaillies de la cogghe et des galères, le pennon à pointe flotta bientôt sur le gaillard d’avant, et la galère, faisant demi-tour, revint vers la cogghe.
Les deux chevaliers se retrouvèrent sur la cogghe ; les grappins avaient été retirés ; les trois navires manœuvrèrent de front. Pendant toute la durée de la bataille, Alleyne avait entendu la voix de Goodwin Hawtayne, le maître marinier, avec ses incessants : « À la bouline ! Larguez la toile ! » Il fut surpris de voir la rapidité avec laquelle les matelots souillés de sang passèrent du combat à la manœuvre. À présent le nez de la cogghe était dirigé vers la France, et le maître marinier arpentait le pont, aussi pacifique qu’un vrai maître marinier.
– La cogghe a subi de gros dégâts, Sir Nigel ! fit-il. Voici un trou dans le côté : il a bien deux aunes de large. La voile est déchirée au centre. Le bois est aussi rasé que le crâne d’un religieux. Je ne sais pas trop ce que je dirai à maître Witherton quand je le reverrai.
– Par saint Paul ! s’exclama Sir Nigel. Il serait bien triste que notre ouvrage d’aujourd’hui vous attire des ennuis ! Vous ramènerez ces galères et maître Witherton pourra les vendre. Sur cette vente il prendra ce qui lui sera nécessaire pour la réparation des dégâts, et il gardera le reste jusqu’à notre retour afin que chaque homme ait sa part. J’ai fait le vœu à la Vierge de placer dans la chapelle du prieuré une statue en argent de quinze pouces de haut, puisqu’il lui a été agréable que je prenne le dessus sur ce Barbe-en-Pointe qui, d’après ce que j’ai vu de lui, m’a paru être un gentilhomme aussi intelligent que vaillant. Mais comment te sens-tu, Edricson ?
– Ce n’est rien, mon bon seigneur ! répondit Alleyne en desserrant son bassinet qui avait craqué sous le coup du Normand.
Mais bien que ce ne fût rien, il fut pris d’une faiblesse et tomba sur le pont, le sang s’échappant par ses narines et sa bouche.
– Il reviendra bientôt à lui, dit le chevalier qui s’était penché et avait promené ses doigts parmi les cheveux bouclés. J’ai perdu aujourd’hui un écuyer très courageux et très aimable. Je supporterais mal d’en perdre un deuxième. Combien d’hommes avons-nous perdu au total ?
– Nous avons perdu, répondit Aylward, sept hommes de Winchester, onze marins, votre écuyer le jeune maître Terlake, et neuf archers !
– Et les autres ?
– Tous tués. Sauf le chevalier normand qui est derrière vous. Que désirez-vous que nous fassions de lui ?
– Il sera pendu à sa propre vergue, dit Sir Nigel. J’en avais fait le vœu ; il sera tenu.
Encadré par deux solides archers, le chef pirate se tenait à côté de la rambarde, une corde autour de ses bras. Aux mots de Sir Nigel il sursauta et sa figure basanée devint grise.
– Comment, seigneur chevalier ? s’écria-t-il en mauvais anglais. Que dites-vous ? Pendu ? La mort d’un chien ! Pendu !
– C’est mon vœu ! déclara brièvement Sir Nigel. D’après ce que je crois, vous vous souciez peu de pendre les autres ?
– Des paysans, des bas roturiers ! cria le Normand. Pour eux c’était une mort convenable. Mais le seigneur d’Andelys, avec du sang de rois dans les veines, c’est incroyable !
Sir Nigel pivota sur ses talons, pendant que les matelots passaient une corde autour du cou du pirate. Quand celui-ci sentit la corde, il s’arracha aux liens qui le retenaient, bouscula l’un des archers qui tomba et, saisissant l’autre par la taille, sauta avec lui dans la mer.
– Par ma garde, il a disparu ! cria Aylward. Ils ont coulé ensemble comme une seule pierre !
– Je n’en suis pas mécontent, répondit Sir Nigel. Car mon vœu m’interdisait de le relâcher, mais j’estime qu’il s’est comporté en gentilhomme très honorable et très débonnaire.
CHAPITRE XVII
Comment la cogghe jaune franchit la barre de la Gironde
Pendant deux jours la cogghe jaune fut gentiment poussée par un vent de nord-est, et au matin du troisième jour l’île d’Ouessant se détacha de l’horizon embrumé. Vers midi une ondée survint et le vent tomba. Mais une brise se leva avant la chute du jour, et Goodwin Hawtayne remit cap au sud. Le lendemain matin la cogghe dépassait Belle-Isle ; elle rencontra toute une flotte de bateaux de transports qui revenaient de Guyenne. Sir Nigel Loring et Sir Oliver Buttesthorn suspendirent aussitôt leurs écus sur le flanc du navire et déployèrent leurs pennons comme le voulait l’usage ; ils observèrent avec beaucoup d’intérêt les armes qui répondirent aux leurs : elles leur apprenaient les noms des gentilshommes contraints par la maladie ou des blessures d’abandonner le Prince à un moment décisif.
Ce soir-là un grand nuage marron surgit de l’ouest, et Goodwin Hawtayne plissa le front. Il y avait de quoi : un tiers de son équipage avait été tué, et la moitié des marins valides se trouvait à bord des galères ; avec un bateau endommagé, il ne se sentait pas équipé pour affronter une tempête et des coups de roulis comme il y en a souvent dans ces parages. Toute la nuit le vent souffla par de brefs à-coups capricieux ; chaque fois la grande cogghe se couchait jusqu’à ce que l’eau vînt recouvrir la rambarde sous le vent. Comme la brise fraîchissait encore, la vergue fut abaissée au matin à mi-hauteur du mât. Alleyne, affreusement malade et affaibli, se hissa sur le pont : il avait encore la tête toute meurtrie du coup qu’il avait reçu, mais il préféra le pont inondé et oscillant aux bruyants cachots qui servaient de cabines et que hantaient les rats. Se cramponnant comme il le put, il contempla avec émerveillement les rangées de vagues noires coiffées d’une crête d’écume et qui roulaient sans fin de l’ouest, inépuisables. Un énorme nuage sombre, parsemé de taches livides, s’étendait sur tout l’horizon marin ; de longues banderoles déchiquetées le précédaient en tournoyant. Loin derrière la cogghe, les deux galères peinaient ; elles plongeaient entre les lames jusqu’à ce que leurs vergues fussent au niveau des vagues, puis elles se soulevaient si haut que les avirons et les cordages se détachaient nettement sur le fond noir du ciel. Sur la gauche, la terre plate s’allongeait en une ligne confuse, marquée ici ou là par une tache plus sombre qui indiquait un cap ou un promontoire. La terre de France !… Ces mots résonnaient dans les oreilles des jeunes Anglais comme une sonnerie de bugle. La terre où leurs pères avaient répandu leur sang, la patrie de la chevalerie et des exploits chevaleresques, le pays des braves, des femmes élégantes, des résidences princières, des sages, des raffinés et des saints… Elle était là, la terre de France, si tranquille, toute grise sous les nuages lourds. Il était là, le royaume des valeurs nobles et de certaines turpitudes, le théâtre où un nouveau nom pouvait s’affirmer, où une vieille réputation pouvait se corrompre. L’écuyer porta à ses lèvres le voile vert, et il prononça intérieurement le vœu que si le courage, la valeur et la bonne volonté pouvaient le hausser auprès de sa dame, seule la mort pourrait alors l’en éloigner. Ses pensées vagabondaient encore dans les bois de Minstead et dans la vieille armurerie du château de Twynham, quand la voix du maître-marinier les ramena vers la baie de Biscaye.
– Par ma foi, jeune seigneur, dit-il, vous avez la figure aussi longue que le diable à un baptême ! Je ne saurais m’en étonner, car j’ai navigué sur ces mers quand je n’étais pas plus haut que ça, et pourtant jamais n’ai-je vu plus menaçante promesse d’une mauvaise nuit.
– Non, j’avais autre chose en tête ! répondit l’écuyer.
– Tout le monde a autre chose en tête ! s’exclama Hawtayne d’une voix amère. Que le maître marinier se débrouille ! C’est l’affaire du maître marinier. Tout repose sur le bon maître Hawtayne ! Jamais on n’a tant compté sur moi depuis que j’ai sonné la trompe et montré mes papiers à la porte ouest de Southampton !
– Qu’est-ce qui ne va pas, donc ? interrogea Alleyne.
– Ce qui ne va pas ? Me voici avec la moitié de mes matelots et un trou dans le bateau là où cette maudite pierre du diable nous a frappés ; trou assez large pour y faire passer la veuve du gros Normand ! Pour l’instant, ça va assez bien, mais je voudrais que vous me disiez comment ça ira tout à l’heure. Nous nagerons dans l’eau salée, et nous resterons dans la saumure jusqu’à ce que nous ressemblions à des harengs en barils.
– Qu’en dit Sir Nigel ?
– Il est en bas à regarder la cotte d’armes de l’oncle de sa mère. « Ne me dérangez pas pour des bagatelles ! » voilà tout ce que j’ai pu tirer de lui. Quant à Sir Oliver : « Une friture dans l’huile, arrosée de Gascogne ! » m’a-t-il commandé, et il s’est emporté parce que je n’étais pas cuisinier. Je suis allé voir les archers. Malédiction ! Ils ont été pires que les autres.
– Ils n’ont pas voulu vous aider ?
– Non. Il y en a une vingtaine autour d’une planche avec celui qu’on appelle Aylward et le grand rouquin qui a démis le bras du Normand, et le noiraud de Norwich ; ils agitent leurs dés dans un gantelet d’archer, faute de cornet. J’ai dit : « Le navire ne va pas tenir longtemps, mes maîtres. » Le noiraud m’a répondu : « C’est ton affaire, vieille tête de cochon ! » Et Aylward : « Le diable t’emporte ! » Et le gros rouquin, d’une voix aussi forte que le claquement d’une voile : « Un cinq, un quatre, j’empoche ! » Écoutez-les maintenant, jeune seigneur, et dites-moi si je vous ai menti.
Dominant le fracas de la tempête et les gémissements du bois, une volée de jurons et un rugissement de joie s’échappèrent du gaillard d’avant où étaient réunis les joueurs.
– Puis-je vous être utile ? s’enquit Alleyne, dites-moi ce qu’il faut faire, et je le ferai si deux mains suffisent.
– Non, non ! Votre tête est encore peu solide, et ma foi vous l’auriez bien petite si votre bassinet n’avait pas amorti le choc ! Nous avons fait tout ce qui pouvait être tenté ; nous avons bourré le trou avec de la voilure et nous avons ajusté l’ensemble avec des cordages. Cependant quand nous courrons près du vent et changerons de bord, nos vies seront suspendues à ce colmatage. Voyez ce cap là-bas, qui se dessine dans la brume ! il nous faudra louvoyer à moins de trois portées de flèche, sinon nous pourrions heurter un récif. Allons, que saint Christophe soit loué ! Voici Sir Nigel, avec qui je vais conférer.
– Je vous prie de m’excuser, dit le chevalier en se cramponnant à la rambarde. Je ne voulais pas manquer de politesse envers un digne homme, mais j’étais absorbé dans une affaire d’importance au sujet de laquelle, Alleyne, je serais heureux d’avoir ton avis. Elle concerne les armes de mon oncle, Sir John Leighton de Shropshire qui prit pour femme la veuve de Sir Henry Oglander de Nunwell. Le cas a été longuement débattu par les poursuivants et les rois d’armes. Mais comment cela va-t-il pour vous, maître marinier ?
– Assez mal, mon bon seigneur. La cogghe va virer bientôt, et je ne sais pas comment nous pourrons l’empêcher d’embarquer de l’eau.
– Allez me chercher Sir Oliver ! ordonna Sir Nigel.
Le majestueux chevalier ne tarda pas à apparaître sur le pont glissant ; il avançait de côté comme un crabe.
– Sur mon âme, maître marinier, ceci passe toute patience ! cria-t-il en colère. Si votre bateau éprouve le besoin de danser et de gambader comme un clown dans une kermesse, je vous prie de me mettre dans l’une de ces galères. Je venais de m’asseoir devant une bouteille de malvoisie et un pâté de hure (comme j’en ai l’habitude à cette heure), quand le bateau fait un saut : je me retrouve avec le vin sur mes jambes et la bouteille entre mes genoux. Au moment où je me penche pour la saisir, voici qu’un autre maudit saut fait voltiger mon pâté : deux de mes pages viennent de se lancer à sa poursuite ; ils courent de bord en bord, comme deux limiers après un levraut. Jamais cochon vivant n’a gambadé avec autant de légèreté. Mais vous m’avez demandé, Sir Nigel ?
– J’aimerais bien avoir votre avis, Sir Oliver, car maître Hawtayne redoute que, lorsque nous virerons de bord, il n’y ait du danger à cause de la brèche ouverte dans le flanc de la cogghe.
– Alors, ne virez pas ! répondit vivement Sir Oliver. Et à présent, messire, je retourne voir si mes coquins ont rattrapé mon pâté.
– Mais, s’écria le marin, si nous ne virons pas, nous nous fracasserons contre les rochers avant une heure !
– Alors, virez de bord ! dit Sir Oliver. Voilà mon avis. Et maintenant, Sir Nigel, j’aspire à…
Il fut interrompu par un cri poussé par deux matelots sur le gaillard d’avant.
– Des rochers ! Des rochers par l’avant !
De fait, dans le creux d’une grande vague noire, à moins de cent pas devant eux, se dessina une grosse masse de pierres brunâtres qui rejetaient de l’écume comme un monstre accroupi ; un grondement menaçant remplit l’air.
– À la manœuvre ! cria Goodwin Hawtayne en s’installant lui-même à la barre.
Le grondement changea de bord ; la cogghe trembla à moins de cinq longueurs de lance des brisants.
– Nous aurons du mal à les éviter ! murmura Hawtayne dont le regard allait successivement de sa voile à la ligne d’écume. Puissent nous protéger saint Julien et le trois fois saint Christophe !
– Puisque le péril est si grand, Sir Oliver, dit Sir Nigel, il serait chevaleresque et décent que nous arborions nos pennons. Je te prie, Edricson, de commander à mon porte-guidon de déployer le mien.
– Et que sonnent les trompettes ! s’écria Sir Olivier. In manus tuas, Domine ! Je suis sous la sauvegarde de Jacques de Compostelle, à la châsse de qui j’ai fait pèlerinage, et en l’honneur duquel je fais vœu de manger une carpe chaque année le jour de sa fête. Mon Dieu, mais les vagues rugissent véritablement ! Où en sommes-nous, maître-marinier ?
– Nous approchons ! cria Hawtayne qui ne quittait pas des yeux l’écume qui sifflait sous le rebord même de la rambarde. Ah, sainte Mère, soyez avec nous maintenant !
Au même moment la cogghe racla le bord du récif, et une longue planche de bois blanc fut arrachée à son flanc de l’embelle à la poupe par un saillant du rocher. Mais le bateau se redressa, sa voile se gonfla à plein, et il retomba du côté de la mer au milieu des vivats des matelots et des archers.
– Nous pouvons louer la Vierge ! dit le marin en s’essuyant le front. Il y aura des cloches qui sonneront et des cierges qui brûleront quand je reverrai l’eau de Southampton ! Haut les cœurs, mes braves ! À la bouline !
– Sur mon âme, je préférerais mourir au sec ! dit Sir Oliver. Quoique, mordieu, j’aie mangé tellement de poissons qu’il ne serait que justice que les poissons me mangeassent à leur tour. Bon ! Je retourne à ma cabine, où certains détails requièrent mon attention.
– Non, Sir Oliver, je préférerais que vous demeuriez avec nous, et que vous gardiez votre pennon déployé, répondit Sir Nigel. Je crois que nous n’avons fait que changer de péril.
– Bon maître Hawtayne ! appela le maître d’équipage. L’eau pénètre rapidement. Les vagues ont défoncé la voilure qui bouchait le trou !
C’était vrai : des matelots remontaient en courant sur la poupe et le gaillard d’avant pour éviter le torrent qui déferlait par la grosse brèche de l’embelle. Perçant le mugissement du vent et le fracas de la mer, des cris presque humains retentirent : les chevaux s’effrayaient du flot qui commençait à les encercler.
– Colmatez de l’extérieur ! cria Hawtayne en saisissant l’extrémité de la voilure trempée avec laquelle le trou avait été bouché. Rapidement, mes cœurs ! Sinon, nous sombrons !
Très vite ils passèrent des cordages autour des coins, puis ils coururent vers l’avant, pour les glisser sous la quille ; ils les serrèrent de façon que la voilure pût recouvrir la surface extérieure de la brèche. Cet obstacle freina l’invasion de l’eau, mais elle s’infiltrait néanmoins tout autour. Les chevaux avaient de l’eau jusqu’au poitrail. La cogghe s’enfonçait.
– Nous ne pourrons pas nous maintenir sur cette bordée, cria Hawtayne. Mais l’autre nous dirigera droit sur les rochers.
– Ne pourrions-nous affaler la voile et attendre un moment plus propice ? suggéra Sir Nigel.
– Non, nous nous échouerions sur un rocher. Trente ans que je navigue sur ces eaux-là ! Mais jamais avec une marge aussi mince de salut ! Nous sommes dans la main des saints.
– Parmi lesquels, s’écria Sir Olivier, j’invoque plus particulièrement saint Jacques de Compostelle, qui nous a déjà aidés en ce jour ; s’il nous secourt une seconde fois, je fais vœu de manger une deuxième carpe pour sa fête !
Le varech s’était épaissi vers le large, la côte n’était plus qu’une ligne imprécise. Deux ombres confuses en pleine mer indiquaient l’endroit où les deux galères roulaient et tanguaient. Hawtayne réfléchissait.
– Si elles se rapprochaient, nous serions en sécurité, même au cas où la cogghe sombrerait. Vous me rendrez témoignage devant le bon maître Witherton de Southampton que j’ai fait tout ce qu’un marin pouvait faire. Il vaudrait mieux, Sir Nigel, que vous vous débarrassiez de vos jambières et de votre camail, car, par la croix noire, il est vraisemblable que nous devrons nous sauver à la nage.
– Non, répondit le petit chevalier. Il ne serait pas convenable qu’un gentilhomme retire son équipement par crainte d’un souffle de vent ou d’un barbotage. Je préfère que ma Compagnie se rassemble autour de moi ici sur la poupe : nous accueillerons ensemble ce que Dieu voudra bien nous envoyer. Mais enfin, maître Hawtayne, malgré les déficiences de ma vue, je suis sûr que ce n’est pas la première fois que je vois ce promontoire sur la gauche.
Le marin abrita ses yeux de sa main allongée et scruta avidement le rideau de brume et d’écume. Tout à coup il leva les bras et poussa un cri de joie.
– C’est la pointe de la Tremblade ! Je ne croyais pas que nous nous trouvions si avant. La Gironde est là, devant nous : une fois que nous aurons franchi sa barre et que nous serons à l’abri de la tour de Cordouan, tout ira bien. À la manœuvre, mes cœurs !
Une fois de plus la voile pivota et la cogghe, avec ses avaries et le poids de l’eau embarquée, avança vers ce havre de salut. Un gros cap au nord et une longue pointe de terre au sud marquaient l’embouchure de l’estuaire ; une île de sable et de vase s’étendait au milieu, cernée par l’écume des brisants. Une ligne révélait la barre dangereuse qui, par beau temps, défonçait parfois des coques de grande taille.
– Il y a un chenal, dit Hawtayne, que m’a indiqué le propre pilote du Prince. Vous voyez cet arbre sur le rivage, et la tour qui se dresse juste derrière lui ? Si nous les gardons tous deux sur la même ligne, comme nous les voyons maintenant, nous franchirons la barre, même avec un bateau en piteux état comme le nôtre.
– Que Dieu vous fasse prospérer, maître Hawtayne ! s’écria Sir Oliver. Deux fois nous sommes sortis indemnes d’un grand péril, et maintenant je me recommande à saint Jacques de Compostelle, à qui je fais vœu de…
– Non, non, mon vieil ami ! chuchota Sir Nigel. Vous allez nous attirer malheur avec ces vœux qu’aucun vivant ne pourrait accomplir. Ne vous ai-je pas déjà entendu jurer que vous mangeriez deux carpes en un seul jour ? Et maintenant vous prendriez le risque d’une troisième ?
– Je vous prie de donner l’ordre à la Compagnie de se coucher ! cria Hawtayne qui avait pris la barre et regardait devant lui sans bouger la tête. Dans trois minutes nous serons ou perdus ou sauvés.
Les archers et les matelots s’étendirent sur le pont pour attendre en silence les injonctions du destin. Hawtayne appuya de tout son poids sur la barre et s’accroupit pour regarder par-dessous la voile gonflée par le vent. Sir Oliver et Sir Nigel demeurèrent debout et droits sur la poupe, bras croisés. La grande cogghe pénétra dans le chenal étroit. De chaque côté mugissait la barre. Juste devant le pilote, un petit chemin d’eau noire tourbillonnante lui indiquait la direction. Mais il avait l’œil vif et la main ferme. Une sorte de raclage, par-dessous, fit trembler le navire à l’embelle et sur le gaillard d’arrière ; puis le sinistre grondement des vagues passa derrière la cogghe qui, dans un plongeon, avait franchi la barre et voguait à présent dans le large et paisible estuaire de la Gironde.
CHAPITRE XVIII
Comment Sir Nigel Loring posa une mouche sur son œil
Ce fut le vendredi 28 novembre au matin, deux jours avant la fête de saint André, que la cogghe et ses deux galères captives, après avoir remonté péniblement la Gironde et la Garonne, mouillèrent l’ancre en face de la noble cité de Bordeaux. Avec un étonnement admiratif Alleyne accoudé sur la rambarde contempla la forêt de mâts, l’incessant va-et-vient des navires sur la large courbe du fleuve, et la ville en forme de croissant gris qui jalonnait la rive ouest de ses tours et de ses coupoles. Jamais encore il n’avait vu d’aussi grande agglomération ; d’ailleurs dans toute l’Angleterre aucune cité, sauf Londres, ne pouvait rivaliser avec Bordeaux en étendue et en richesse. Ici aboutissaient tous les produits des belles contrées arrosées par la Garonne et la Dordogne : tissus du sud, peaux de Guyenne, vins du Médoc, etc. Ces marchandises étaient acheminées vers Hull, Exeter, Dartmouth, Bristol ou Chester, en échange des laines et des suints d’Angleterre. Ici aussi étaient établis les célèbres fondeurs et corroyeurs qui avaient fait de l’acier de Bordeaux le plus solide de la terre, et qui pouvaient donner à une lance ou à une épée la trempe qui valait pour son propriétaire une assurance sur la vie. Alleyne distingua la fumée des forges qui s’élevait dans l’air pur du matin. La tempête n’était plus qu’un mauvais souvenir ; une aimable brise lui avait succédé ; elle porta aux oreilles de l’écuyer les échos des sonneries de bugle qui retentissaient dans les anciens remparts.
– Holà, mon petit ! fit Aylward en le rejoignant. Tu es à présent écuyer, et vraisemblablement tu vas gagner les éperons dorés, tandis que moi je suis encore maître-archer et resterai maître-archer. Je n’ose plus jaser avec toi aussi librement que lorsque nous marchions ensemble passé Wilverley Chase. Autrement j’aurais pu être ton guide, car en vérité je connais toutes les maisons de Bordeaux aussi bien qu’un religieux connaît tous les grains de son rosaire.
– Non, Aylward ! déclara Alleyne en posant une main sur la manche du justaucorps usé de son compagnon. Tu ne me juges pas assez mal pour supposer que je vais écarter un vieil ami parce que j’ai eu un peu de chance ? Il me déplairait que tu me juges si mesquin.
– Bien, mon gars ! C’était une flèche tirée pour voir d’où soufflait le vent, mais j’ai été idiot de douter de toi.
– Voyons ! Si je ne t’avais pas rencontré à l’auberge de Lyndhurst, où serais-je à présent ? Je ne me serais certainement pas rendu au château de Twynham, je ne serais pas devenu l’écuyer de Sir Nigel, et je n’aurais pas connu…
Il s’arrêta brusquement et rougit jusqu’à la racine des cheveux ; mais l’archer était trop occupé par ses propres réflexions pour remarquer l’embarras de son jeune camarade.
– C’était une bonne hôtellerie, l’« Émerillon bigarré » ! observa-t-il. Par les os de mes dix doigts, quand je troquerais ma brigandine contre une tunique, je pourrais faire pis que m’occuper de la dame et de son affaire.
– Je croyais, dit Alleyne, que tu t’étais fiancé à quelqu’un de Christchurch ?
– À trois femmes, répondit lugubrement Aylward. J’ai peur de ne plus pouvoir revenir à Christchurch : j’aurais dans le Hampshire un service plus dur que je n’en ai jamais eu en Gascogne… Mais regarde cette tour élevée au centre, à l’écart du fleuve, et sur laquelle flotte une grande bannière. Tu vois : le soleil levant l’éclaire en plein et fait étinceler ses lions d’or. C’est la bannière royale d’Angleterre, traversée de biais par l’insigne du Prince. Il habite là, dans l’abbaye de Saint-André où ces dernières années il a tenu sa cour. À côté se dresse la cathédrale du même saint sous la protection de qui la cité s’est placée.
– Et cette tour grise sur la gauche ?
– C’est l’église de Saint-Michel ; la tour de droite est celle de Saint-Rémi. Là-bas, au-dessus de la poupe de ce navire, tu vois les tours de Sainte-Croix et de Pey-Berland. Remarque également les remparts ; ils sont percés de trois grilles donnant accès sur le fleuve et de seize autres du côté de la terre ferme.
– Et comment se fait-il, bon Aylward, qu’il s’échappe tant de musique de la ville ? Il me semble que j’entends une centaine de trompettes qui sonnent toutes en chœur.
– Le contraire serait bien étrange, étant donné que tous les grands seigneurs d’Angleterre et de Gascogne sont réunis entre ses murs ; chacun veut que son trompette souffle aussi fort que celui du voisin, sans quoi sa dignité en souffrirait ! Ma foi, ils font autant de bruit qu’une armée écossaise, quand chaque soldat se bourre de galettes et souffle toute la nuit dans sa cornemuse. Regarde : tout le long du fleuve les pages font boire les chevaux ; et, au-delà de la ville, admire comme ils galopent sur la plaine ! Pour un cheval, il y a un chevalier à ceinture qui est hébergé dans la ville, car, d’après ce que j’ai appris, les hommes d’armes et les archers sont déjà partis pour Dax.
– Je crois, Aylward, intervint Sir Nigel qui était monté sur le pont, que les hommes sont prêts à débarquer. Va leur dire que les péniches seront là dans une heure.
L’archer leva une main pour saluer, et se précipita. Sir Oliver avait rejoint le petit chevalier, et tous deux firent les cent pas sur la poupe en bavardant ; Sir Nigel était vêtu d’un costume de velours prune, et il était coiffé d’une toque plate de la même couleur, ornée sur le devant du gant de Lady Loring et entourée d’une plume d’autruche ; le gros chevalier au contraire s’était mis à la dernière mode avec une côte-hardie, un doublet, un pourpoint, un paletot vert olive à filets roses et découpé au bas ; son chaperon rouge à longue cornette tombante était négligemment rejeté en arrière ; il était chaussé de poulaines dorées ; ses orteils en poussaient la pointe qui devait parfois s’enrouler autour de sa jambe massive.
– Une fois de plus, dit Sir Nigel en regardant le port avec des yeux brillants, nous nous trouvons au seuil de l’honneur, devant la porte qui nous a si souvent introduits dans le chevaleresque. Voici la bannière du Prince : il serait bon que nous nous hâtions de descendre à terre pour lui rendre hommage. Les bateaux quittent le rivage, d’ailleurs.
– Il y a une bonne hôtellerie près de la grille d’ouest ; elle est renommée pour la cuisson à la casserole de ses poulets épicés, fit observer Sir Oliver. Nous pourrions apaiser notre appétit avant de nous mettre à la recherche du Prince, car bien que sa table soit richement décorée de damas et d’argent, il n’a rien d’un gros mangeur, et il n’éprouve aucune sympathie pour ceux qui le battent.
– Qui le battent ?
– Qui le battent devant le tranchoir, enfant ! Ne cherchez pas de la trahison là où il n’y en a point. Je l’ai vu sourire de son sourire tranquille parce que je rappelais pour la quatrième fois le gentilhomme de rôt. En vérité, le voir lambiner sur une bouchée de pain, ou déguster une coupe de vin trois fois trempé d’eau, voilà qui suffit à rendre un homme honteux de sa faim. Et pourtant, mon vieil ami, la guerre et la gloire (dont je ne médis pas, loin de là !) sont impuissantes à faire tenir ma ceinture sur ce ventre-là !
– Voici notre bateau, Sir Oliver. Je crois que nous ferions bien de nous rendre à l’abbaye avec nos écuyers et de laisser à maître Hawtayne le soin de veiller sur le débarquement.
Les chevaux des deux chevaliers et de leurs écuyers furent rapidement en place sur un large chaland et ils arrivèrent à terre presque aussi vite que leurs maîtres. Sir Nigel ploya pieusement le genou quand il mit pied à terre, et tirant de sa poitrine une petite mouche noire, il la fixa sur son œil gauche.
– Puisse saint Georges, puisse le souvenir de ma douce dame d’amour me soutenir ! dit-il. En échange je fais le vœu de ne pas retirer cette mouche de mon œil avant d’avoir vu ce pays d’Espagne et d’y avoir accompli l’un des modestes exploits qui sont dans mes capacités. Je le jure sur la croix de mon épée et sur le gant de ma dame !
– Vous me reportez vingt ans en arrière, Nigel ! dit Sir Oliver tandis qu’ils franchissaient à cheval la grille des remparts. Après Kadsand, je crois que les Français nous prirent pour une armée d’aveugles, car presque tous gardèrent un œil fermé pour le plus grand amour et honneur de leur dame. Mais cela m’ennuie pour vous, qui avec vos deux yeux ouverts distinguez mal un cheval d’un mulet. En vérité, mon ami, je pense qu’en cette affaire vous franchissez les bornes de la raison.
– Sir Oliver Buttesthorn, répondit sèchement le petit chevalier, je voudrais que vous compreniez que, tout aveugle que je sois, je distingue encore assez bien le chemin de l’honneur, et que c’est une route sur laquelle je ne désire pas de guide !
– Sur mon âme ! fit Sir Oliver. Mais vous êtes aussi acide que du verjus ce matin ! Si vous avez envie de me chercher querelle, je vous abandonne à votre humeur et je m’arrête ici à « La Tête d’Or » ; un valet vient d’en sortir, qui portait un plat fumant dont j’ai humé l’odeur excellente.
– Nenni ! cria son camarade en posant une main sur son genou. Nous nous connaissons depuis trop longtemps pour nous chamailler, Sir Oliver, comme deux pages à leur première épreuve ! Il faut que vous veniez d’abord avec moi chez le Prince, puis vous irez à l’hostellerie. Car je suis sûr qu’il aurait de la peine si un brave gentilhomme dédaignait sa table pour une taverne. Mais n’est-ce pas Lord Delawar qui nous fait signe ? Ah, mon bon seigneur, que Dieu et Notre-Dame soient avec vous ! Et voici Sir Robert Cheney. Bonjour, Robert ! Je suis heureux de vous revoir.
Les deux chevaliers chevauchaient de concert, tandis qu’Alleyne, Ford et John Norbury, écuyer de Sir Oliver, suivaient à quelques foulées derrière mais précédaient d’une longueur de lance Black Simon et le porte-guidon de Winchester. Norbury, maigre et taciturne, connaissait déjà la France, et sur son cheval il se tenait droit comme un cierge. Mais les deux jeunes écuyers regardaient avidement à droite et à gauche, et se tiraient par la manche quand un spectacle nouveau leur était offert.
– Regarde ces belles échoppes ! s’écriait Alleyne. Regarde ces magnifiques armures, ces taffetas de prix… Oh, Ford, regarde l’écrivain public assis avec ses couleurs et ses cornes à encre, et ses rouleaux de parchemin aussi blancs que le linge de table de Beaulieu ! Avais-tu déjà vu cela ?
– Oui, mon cher ! Il y a de plus belles échoppes à Cheapside, répondit Ford que son père avait conduit à Londres à l’occasion des joutes de Smithfield. J’ai vu la boutique d’un orfèvre dont le contenu aurait permis d’acheter les deux côtés de cette rue. Mais regarde ces maisons, Alleyne ; comme leurs toits s’élancent gracieusement ! Tu remarques qu’il y a un écu à chaque fenêtre, et une bannière ou un pennon sur chaque toit.
– Et les églises ! Le prieuré de Christchurch était certes un bel édifice, mais il était froid et nu à côté de ces églises où les sculptures, les ornements architecturaux, les découpures ressemblent à quelque grand lierre qui aurait festonné sur les murs pour l’éternité.
– Et écoute parler les gens ! dit Ford. As-tu déjà entendu siffler et chanter comme cela ? Je m’étonne qu’ils n’aient pas l’esprit d’apprendre l’anglais puisqu’ils sont à présent sujets de la couronne. Par Richard de Hampole, il y a de beaux types dans cette foule ! Regarde la fille qui passe, avec la guimpe brune. Attention, Alleyne ! Il conviendrait mieux à ton éducation que tu contemples des pierres mortes et non de la chair vivante…
Comment s’étonner que la richesse et la décoration non seulement des églises ou des boutiques, mais de toutes les maisons particulières, fissent impression sur les jeunes écuyers ? La ville se trouvait alors à l’apogée de sa fortune. En sus de ses commerces et de ses armuriers, les motifs de prospérité abondaient. La guerre, qui avait provoqué tant de maux dans de belles cités du Midi de la France, n’avait fait à Bordeaux que du bien. Au fur et à mesure que déclinaient ses voisines, Bordeaux se développait : du nord, de l’est et du sud arrivait le butin des soldats ainsi que l’argent des rançons (et Dieu sait s’il y était joyeusement dépensé !) Par ses seize grilles ouvrant sur le pays, une double marée se déversait depuis un quart de siècle : le flux des soldats aux mains et aux poches vides qui se précipitaient vers l’intérieur de la France, le reflux des vainqueurs enrichis qui ployaient sous le faix de leur butin. La cour du Prince, également, avec son essaim de nobles barons et de chevaliers fortunés (dont beaucoup, imitant leur maître, avaient fait venir d’Angleterre leurs épouses et leurs enfants) aidait à gonfler les coffres des citadins. Mais l’affluence des nobles et des gentilshommes compliquait tellement le ravitaillement et le logement que le Prince avait dû dépêcher son armée à Dax afin de limiter l’encombrement de sa capitale.
Sur une grande place devant la cathédrale et l’abbaye de Saint-André, une foule de prêtres, de soldats, de femmes, de religieux et de bourgeois était rassemblée. C’était le centre des cancans, le rendez-vous des badauds. Parmi les groupes de Bordelais bavards et gesticulants, les chevaliers suivis de leurs écuyers se frayèrent leur chemin vers la demeure du Prince ; les immenses portes cloutées de fer étaient grandes ouvertes : il tenait donc audience à l’intérieur. Une quarantaine d’archers étaient de faction près des grilles, et repoussaient périodiquement la foule curieuse et jacassante qui se pressait devant le portail. Deux chevaliers revêtus de l’armure complète, lances droites et visières baissées, caracolaient de chaque côté ; entre eux et escorté de deux pages, un homme au fier visage, enveloppé dans une ample robe pourpre, pointait sur une feuille de parchemin le nom et le titre des solliciteurs ; il les laissait mettre en file et accordait à chacun la place et les facilités de son rang. Sa barbe blanche fleurie et ses yeux perçants lui conféraient une dignité écrasante, que renforçaient au surplus son tabard et un chapeau à barrette orné d’un triple panache.
– C’est Sir William de Pakington, le héraut et secrétaire du Prince, murmura Sir Nigel quand ils s’arrêtèrent au milieu des chevaliers qui attendaient d’être introduits. Malheur à celui qui essaierait de le tromper ! Il sait par cœur le nom de tous les chevaliers de France et d’Angleterre, ainsi que l’arbre généalogique de chacun, avec ses parentés, ses armes, les mariages de la famille, etc. Laissons nos chevaux ici aux valets, et avançons avec nos écuyers.
Ils arrivèrent donc à pied jusqu’auprès du secrétaire du Prince, qui était engagé dans une chaude discussion avec un jeune chevalier à l’air fat.
– Mackworth ! disait le roi d’armes. J’ai dans l’idée, jeune seigneur, que vous n’avez pas encore été présenté.
– Non, il n’y a qu’un jour que je suis arrivé à Bordeaux, mais je craignais que le Prince ne s’étonnât que je ne me fusse pas présenté immédiatement à lui.
– Le Prince a d’autres choses en tête, répondit Sir William de Pakington. Mais si vous êtes un Mackworth, vous êtes sûrement un Mackworth de Normanton ; je vois en effet que votre écu est de sable et d’hermine.
– Je suis un Mackworth de Normanton, confirma l’autre visiblement gêné.
– Alors vous devez être Sir Stephen Mackworth, car je sais que lorsque mourut le vieux Sir Guy, il prit le titre et le nom, le cri de guerre et le bénéfice.
– Sir Stephen est mon frère aîné. Je suis Arthur, le deuxième fils.
– Vraiment ! s’exclama le roi d’armes avec un regard méprisant. Et s’il vous plaît, seigneur deuxième fils, où est l’insigne qui devrait marquer votre rang de cadet ? Oseriez-vous porter les armes de votre frère sans le croissant qui vous estampille comme son cadet ? Retournez chez vous, et n’approchez pas du Prince avant que l’armurier ait gravé la vérité sur votre écu !
Pendant que le jeune homme se retirait tout confus, l’œil vif de Sir William découvrit les cinq roses au milieu des écus et des pennons.
– Ah ! cria-t-il. Voici des recommandations que nul ne s’aviserait d’imiter ! Les roses de Loring et la tête de sanglier de Buttesthorn peuvent se tenir en retrait en temps de paix, mais, par ma foi, en temps de guerre ce n’est pas leur habitude ! Soyez les bienvenus, Sir Oliver, Sir Nigel ! Chandos, quand il vous verra, aura de la joie jusqu’aux racines de son cœur. Par ici, mes bons seigneurs. Vos écuyers sont certainement dignes de la réputation de leurs maîtres. Par ce couloir, Sir Oliver ! Edricson ? Ah ! Un rejeton de la vieille souche des Edricson du Hampshire, je suis sûr ! Et Ford ! Les Ford sont des Saxons du sud et de bonne renommée. Il y a des Norbury dans le Cheshire et dans le Wiltshire, et aussi, je crois, dans la région frontière du nord. Venez, mes chers seigneurs ! Je vais vous faire introduire tout de suite.
Il ouvrit une porte, et poussa le groupe dans une vaste salle remplie de la foule de ceux qui attendaient, comme eux, une audience. Trois fenêtres à meneaux déversaient la lumière du jour ; en face d’elles un grand feu de fagots crépitait dans une immense cheminée. Nombreux étaient les visiteurs qui se tenaient auprès des flammes, car il faisait très froid ; mais les deux chevaliers s’assirent sur une banquette, et leurs écuyers restèrent debout derrière eux. Alleyne inspecta du regard cette antichambre : le plancher et le plafond étaient d’un chêne somptueux ; le plafond était étayé par douze arceaux de bois, le premier et le dernier décoré des lis et des lions de l’écusson royal. Au bout de la pièce il y avait une petite porte que gardaient des hommes d’armes. Régulièrement un homme âgé, vêtu de noir et légèrement voûté, un long rouleau blanc à la main, entrait doucement par cette petite porte, faisait signe à quelqu’un qui se découvrait aussitôt et le suivait.
Les deux chevaliers étaient engagés dans une conversation sérieuse, quand Alleyne remarqua un homme d’allure peu banale qui se dirigeait de leur côté. Chaque fois qu’il passait près d’un groupe de gentilshommes, toutes les têtes se tournaient vers lui ; à voir les respectueuses salutations dont il était l’objet, l’intérêt qu’il suscitait n’était pas dû seulement à son physique étrange. Grand et droit comme une lance en dépit de son âge, il avait des cheveux blancs comme de la neige fraîche. L’élasticité de son pas prouvait qu’il n’avait rien perdu du feu et de l’activité de sa jeunesse. Son visage au profil de faucon était rasé comme celui d’un prêtre ; toutefois les deux pointes d’une longue moustache mince et blanche retombaient à mi-chemin des épaules. Il avait été beau : son nez aquilin et son menton volontaire l’attestaient encore ; mais sa physionomie, avec ses traits tirés par des rides et des cicatrices, avec l’absence d’un œil qui avait été arraché de l’orbite, ne rappelait plus guère l’étourdissant jeune premier qui avait été cinquante ans plus tôt le plus beau et le plus brave de tous les chevaliers d’Angleterre. Et cependant quel gentilhomme présent dans cette salle n’aurait pas joyeusement renoncé à sa jeunesse, à sa figure aimable et à tous ses biens, en échange d’une telle renommée ! Quelle réputation en effet pouvait rivaliser avec celle de Chandos, chevalier sans tache, conseiller avisé, guerrier vaillant, héros de Crécy, de Winchelsea, de Poitiers, d’Auray et d’autant de batailles qu’il comptait d’années ?
– Ah, mon petit cœur d’or ! s’écria-t-il en jetant ses bras autour de Sir Nigel. On m’a dit que vous étiez ici ; je vous cherchais.
– Cher et bon seigneur ! murmura le chevalier en rendant au guerrier la chaleur de son étreinte. Me voilà encore une fois à votre côté ; où donc pourrais-je apprendre ailleurs à être un brave et digne chevalier ?
– Par ma foi, dit Chandos en souriant, il convient parfaitement que nous nous tenions compagnie, Nigel, car puisque vous avez clos l’un de vos yeux et que j’ai eu la malchance de perdre l’un des miens, à nous deux nous ne faisons plus qu’un ! Ah, Sir Oliver ! Vous étiez du mauvais côté, et je ne vous avais pas vu. Une femme perspicace m’a prédit que de ce côté aveugle me viendrait la mort quelque jour. En attendant nous allons nous rendre chez le Prince ; en vérité il est fort affairé, car entre Pedro, le roi de Majorque, le roi de Navarre qui est l’inconstance personnifiée, et les barons de Gascogne qui marchandent leurs services comme autant de mercantis, il joue une partie difficile. Mais comment avez-vous quitté Lady Loring ?
– Elle allait bien, cher seigneur, et elle vous envoie ses vœux et ses compliments.
– Je serai toujours son chevalier et son esclave. J’espère que vous avez fait bon voyage ?
– Aussi bon que nous pouvions le souhaiter. Nous avons aperçu deux galères montées par des pirates, et nous leur avons demandé quelques petites explications.
– Toujours de la chance, Nigel ! s’écria Sir John. Il faudra que vous nous racontiez bientôt cette histoire. Mais laissez donc ici vos écuyers et suivez-moi ; tout bousculé que soit le Prince, je suis sûr qu’il serait désolé de faire attendre deux vieux compagnons d’armes. Je vais avertir notre vieux Sir William, car je ne prétends pas vous annoncer aussi bien que lui.
CHAPITRE XIX
Agitation à l’abbaye de Saint-André
Le salon réservé aux audiences du Prince n’était pas très vaste, mais son ameublement ne manquait ni du luxe ni de la majesté qu’exigeaient tant de renommée et de puissance. Une haute estrade, tout au fond, était surmontée d’un large dais de velours rouge parsemé de fleurs de lis en argent, que des verges d’argent soutenaient à chaque angle. Les quatre marches qui y donnaient accès étaient elles aussi recouvertes de velours rouge. Les coussins somptueux, les tapis d’Orient, les carpettes de fourrure abondaient dans la salle dont les murs étaient drapés par des tapisseries incomparables tissées par les métiers d’Arras ; elles reproduisaient les batailles de Judas Macchabée, mais les artistes naïfs de l’époque avaient représenté les guerriers juifs avec des cuirasses d’acier, des cimiers, des lances et des oriflammes. Canapés moelleux et banquettes sculptées complétaient l’ameublement. Sur un perchoir, près de l’estrade, trois gerfauts prussiens solennels, encapuchonnés, se tenaient aussi immobiles et silencieux que l’oiseleur royal de faction.
Deux fauteuils surélevés occupaient le centre de l’estrade ; leur dossier se recourbait en haut pour se prolonger au-dessus de la tête des occupants ; ils étaient tapissés d’une soie bleue claire saupoudrée d’étoiles d’or. Sur le fauteuil de droite un personnage très grand et bien bâti était assis : il avait des cheveux roux, une figure blême, des yeux bleus glacés dont le regard avait quelque chose de menaçant et de sinistre ; négligemment adossé, il bâillait sans discontinuer comme si cette réunion ne l’intéressait point ; de temps à autre il se baissait pour caresser un lévrier d’Espagne à poils longs qui était couché à ses pieds. L’autre trône était occupé par un petit homme tout rond qui avait le visage comme une pomme, qui souriait et faisait des signes de tête chaque fois que son regard croisait celui d’un assistant. Entre eux, légèrement en avant, un jeune homme brun et mince avait pris place sur un tabouret ; son costume sans éclat et la modestie de ses manières n’indiquaient guère qu’il était le Prince le plus célèbre de l’Europe ; il était vêtu d’un drap bleu sombre ferré de boucles et de lacets d’or qui contrastait singulièrement avec le déploiement des soies, des hermines et des futaines dorées qui l’entouraient. Il était assis les mains croisées sur un genou, la tête inclinée ; sur ses traits finement ciselés passait une expression d’impatience et d’ennui. Deux seigneurs en robe pourpre et au visage rasé, ascétique, ainsi qu’une demi-douzaine de hauts dignitaires et d’officiers d’Aquitaine, étaient debout derrière les trônes. En bas des marches cinquante barons, chevaliers et courtisans étaient rangés sur trois rangs face à l’estrade.
– Voici où se tient le Prince, chuchota Sir John Chandos quand ils firent leur entrée. Le personnage de droite est Pedro que nous allons installer sur le trône d’Espagne. L’autre est Don Jayme que nous nous proposons de maintenir sur son trône de Majorque avec l’aide de Dieu. À présent suivez-moi et ne vous formalisez pas si le Prince est un peu avare de paroles, car je vous assure qu’il a la tête pleine de grands projets et de nombreux soucis.
Mais le Prince les avait déjà aperçus ; il se leva d’un bond et s’avança à leur rencontre ; dans ses yeux brillait une lueur de contentement ; ses lèvres s’écartèrent pour un sourire aimable.
– Nous n’avons pas besoin de vos bons offices de héraut Sir John ! dit-il d’une voix claire. Ces vaillants chevaliers me sont bien connus. Soyez les bienvenus en Aquitaine, Sir Nigel Loring et Sir Oliver Buttesthorn. Non, gardez votre génuflexion pour mon cher père à Windsor. Je veux vous serrer la main, mes amis. Nous vous donnerons sans doute de l’ouvrage à accomplir avant que vous revoyiez les dunes du Hampshire. Connaissez-vous l’Espagne, Sir Oliver ?
– Pas du tout, monseigneur. J’ai seulement entendu parler d’un plat qui s’appelle l’olla ; mais je ne saurais dire s’il s’agit d’un simple ragoût du midi, ou d’un assaisonnement comme du fenouil ou de l’ail qui serait spécial à l’Espagne.
– Vos doutes, Sir Oliver, seront bientôt levés, répondit le Prince en s’associant de bon cœur aux rires des barons qui les entouraient. Sa Majesté veillera sans doute à ce que vous goûtiez de ce plat bien épicé quand nous serons tous établis sains et saufs en Castille.
– Je réserve un plat bien épicé à quelques personnes de ma connaissance ! déclara Don Pedro avec un sourire cruel.
– Mais mon ami Sir Oliver peut se battre très bien sans boire ni manger, reprit le Prince. À Poitiers ne s’est-il pas conduit de la manière la plus vaillante alors que nous n’avions dans l’estomac rien de plus qu’un croûton de pain et une coupe d’eau pourrie ? De mes propres yeux je l’ai vu décapiter un chevalier picard d’un seul coup d’épée.
– Ce coquin s’était interposé entre moi et le plus proche chariot de vivres des Français ! murmura Sir Oliver.
Un nouveau petit rire étouffé secoua les seigneurs qui se trouvaient assez près pour l’avoir entendu. Mais le visage du Prince redevint sérieux.
– Combien d’hommes avez-vous amenés ici ?
– Quarante hommes d’armes, monseigneur ! répondit Sir Oliver.
– Et moi, cent archers et vingt lances, mais deux cents hommes m’attendent de ce côté-ci de l’eau sur la frontière de la Navarre.
– Lesquels, Sir Nigel ?
– Une compagnie franche, monseigneur. La Compagnie Blanche.
À l’étonnement des chevaliers, ces mots provoquèrent chez les barons une explosion d’hilarité que partagèrent les deux rois et le Prince. Sir Nigel dévisagea tranquillement les nobles qui l’entouraient et tira par la manche un chevalier robuste qui à côté de lui riait un peu plus fort que les autres.
– Peut-être, beau seigneur, lui dit-il à voix basse, vous trouvez-vous sous quelque petit vœu dont je pourrais vous soulager. Ne pourrions-nous pas débattre cette affaire d’une manière fort honorable ? Votre bienveillante courtoisie m’accordera sans doute la faveur d’une rencontre.
– Non, Sir Nigel ! s’écria le Prince. N’imputez pas l’offense à Sir Robert Briquet, car nous sommes tous coupables. À vrai dire, nos oreilles viennent d’être chagrinées par les agissements de cette Compagnie, et j’ai même fait vœu à l’instant de pendre l’homme qui en était le chef. Je ne pensais guère le découvrir parmi les plus braves de mes capitaines ! Mais ce vœu s’annule puisque vous n’avez jamais vu votre Compagnie : en toute justice vous ne sauriez endosser la responsabilité de sa conduite.
– Monseigneur, répondit Sir Nigel, il importe réellement peu que je sois pendu, bien que ce genre de mort soit plus ignominieux que celui que j’aurais souhaité. D’autre part il serait extrêmement affligeant que vous, Prince d’Angleterre et fleur de la chevalerie, n’accomplissiez point un vœu que vous auriez formulé.
– Ne vous mettez pas en peine pour cela, déclara le Prince. Nous avons reçu aujourd’hui même la visite d’un citoyen de Montauban ; il nous a remué le sang par d’affreuses histoires de pillages et de meurtres ; mais notre colère visait l’homme qui les commandait et non celui qui ne les a pas encore vus.
– Cher et très honoré seigneur, insista Sir Nigel d’une voix anxieuse, j’ai grand-peur que votre complaisance à mon égard ne vous incite à renoncer à l’accomplissement d’un vœu. S’il subsiste l’ombre d’un doute quant à la manière dont vous l’avez formulé, il vaudrait mille fois mieux…
– Paix ! Paix ! s’écria le Prince impatienté. Je suis tout à fait capable de m’occuper moi-même de mes vœux et de leur accomplissement. Nous espérons vous voir bientôt tous deux dans la salle du banquet. En attendant, vous serez de service avec votre suite auprès de nous.
Il salua ; Chandos tira Sir Oliver par la manche et conduisit les deux chevaliers derrière la foule des courtisans.
– Hé bien, petit cousin, murmura-t-il, vous aviez donc tellement envie de passer votre cou dans le nœud coulant ? Sur mon âme, si vous en aviez demandé autant à notre allié Don Pedro, il ne vous l’aurait pas refusé ! Entre nous, il a trop l’âme d’un bourreau, et le Prince pas assez. Mais réellement cette Compagnie Blanche est une bande de sauvages, et il vous faudra la reprendre sérieusement en main avant de pouvoir en assurer le commandement normal.
– Je ne doute pas, répondit Sir Nigel, qu’avec l’aide de saint Paul je ne puisse restaurer la discipline. Mais j’aperçois ici quantité de figures nouvelles, à côté d’autres que j’avais déjà vues quand j’étais au service de mon cher et vénéré maître Sir Walter. Par exemple je vous serais obligé, Sir John, de me dire qui sont ces prêtres sur l’estrade.
– L’archevêque de Bordeaux et l’évêque d’Agen.
– Et le chevalier brun qui a une barbe grisonnante ? Par ma foi, on dirait un homme aussi vertueux que valeureux !
– C’est Sir William Felton. Il partage avec moi si indigne la charge de principal conseiller du Prince. Il est grand intendant et moi connétable d’Aquitaine.
– Et les chevaliers sur la droite, à côté de Don Pedro ?
– Des gentilshommes d’Espagne qui l’ont suivi en exil. Celui qui se tient contre son coude est Fernando de Castro, le plus brave et le plus loyal des hommes. Devant nous et à droite, voici les seigneurs de Gascogne. Vous les reconnaîtrez à leur mine maussade, car certains différends les ont récemment opposés au Prince. Ce grand gaillard est le captal de Buch que vous connaissez sans doute : jamais plus vaillant chevalier n’a mis sa lance en arrêt. Le gentilhomme au visage épais qui lui chuchote quelques mots à l’oreille est le sire Olivier de Clisson, surnommé le massacreur ; il provoque toujours des conflits et souffle constamment sur les braises chaudes pour attiser le feu. Celui qui a un grain de beauté sur la joue est Lord de Pommers ; ses deux frères sont debout derrière lui avec le seigneur de Lesparre, Lord de Rosem, le baron de Mussidan, le sire Perducas d’Albret, le vicomte de la Trane, etc. Derrière, vous avez des chevaliers du Quercy, du Limousin, de la Saintonge, du Poitou et de l’Aquitaine, avec le vaillant sire Guiscard d’Angle, qui a un doublet rose avec de l’hermine.
– Et les chevaliers sur la gauche ?
– Tous des Anglais. Quelques-uns appartiennent à la maison du Prince. D’autres, comme vous, commandent des compagnies. Voici Lord Neville, Sir Stephen Cossington, Sir Matthew Gourney, Sir Walter Huet, Sir Thomas Banaster et Sir Thomas Felton qui est le frère du grand intendant. Regardez l’homme au nez important et à la barbe blonde qui pose sa main sur l’épaule du gentilhomme basané…
– Par saint Paul ! fit Sir Nigel. Ils ont tous deux gardé l’empreinte de l’armure sur le pourpoint. J’ai l’impression qu’ils respirent plus librement dans un camp qu’à la cour !
– Nous sommes nombreux dans ce cas, Nigel ! dit Chandos. Et le maître de la cour partage, j’ose le garantir, ce sentiment. Ces deux seigneurs sont Sir Hugh Calverley et Sir Robert Knolles.
Sir Nigel et Sir Oliver se tordirent le cou pour mieux voir les célèbres guerriers dont l’un commandait des compagnies franches et l’autre avait mérité par sa valeur et son énergie farouche la deuxième place (derrière Chandos) dans l’estime de l’armée.
– En temps de guerre il n’a pas la main légère, Sir Robert ! commenta Chandos. S’il traverse un pays, cela se reconnaît encore plusieurs années après. On m’a assuré que dans le nord on appelle mitre de Knolles une maison à qui ne reste que les deux pignons.
– J’ai servi sous lui, dit Sir Nigel. Mais attention, Sir John, le Prince se met en colère !
Pendant que Chandos avait bavardé avec les deux chevaliers, un flot ininterrompu de solliciteurs avait pénétré dans le salon d’audiences : c’étaient surtout des aventuriers cherchant à vendre leur épée, ou des marchands exposant un grief (soit parce qu’un de leurs bateaux avait été réquisitionné pour le transport des troupes, soit parce qu’un tonnelet de vin doux avait été défoncé par des archers assoiffés). En quelques mots le Prince réglait chaque affaire. Si le solliciteur ne paraissait pas satisfait du jugement prononcé, un vif coup d’œil noir lui conseillait de dissimuler son mécontentement. Le jeune gouverneur était négligemment assis sur son tabouret, quand tout à coup son visage s’assombrit, et il se leva en proie à l’un de ces accès de passion qui étaient le seul défaut d’un caractère noble et généreux.
– Alors, Don Martin de la Carra ? s’écria-t-il. Alors, messire ? Quel message nous apportez-vous de notre frère de Navarre ?
L’interpellé qui venait d’être introduit était d’une beauté singulière. Son teint halé et sa chevelure noire corbeau révélaient une origine méridionale ; il portait sa longue cape noire jetée par-dessus ses épaules avec une grâce qui n’était ni anglaise ni française. À grands pas majestueux ponctués de révérences profondes il s’avança jusqu’au pied de l’estrade avant de répondre.
– Mon puissant et illustre maître, commença-t-il. Charles, Roi de Navarre, comte d’Évreux, comte de Champagne, suzerain du Béarn, envoie son affection et ses salutations à son cher cousin Édouard, Prince de Galles, Gouverneur de l’Aquitaine, Grand Commandeur de…
– Assez, Don Martin ! coupa le Prince qui avait tapé du pied en écoutant ce long préambule. Nous connaissons déjà les titres de notre cousin et, certes, nous connaissons aussi les nôtres. Au fait, et sans détours ! Les cols nous sont-ils ouverts, ou votre maître renie-t-il la parole qu’il m’a donnée à Libourne pas plus tard qu’à la Saint-Michel ?
– Il siérait mal à mon gracieux maître, monseigneur, de revenir sur une promesse. Il ne demande seulement qu’un court délai, certaines conditions, des otages…
– Des conditions ! Des otages ! S’adresse-t-il au Prince d’Angleterre ou au prévôt des bourgeois d’une ville à moitié prise ? Des conditions, dites-vous ? La sienne pourrait bien chanceler d’ici peu ! Les cols nous sont donc fermés ?
– Non, seigneur.
– Ils sont ouverts, alors ?
– Non, seigneur. Il vous suffirait…
– Assez, assez, Don Martin ! s’écria le Prince. Il est pénible de voir un chevalier aussi loyal plaider une cause aussi mauvaise. Nous sommes au courant des agissements de notre cousin Charles. Nous savons que pendant que sa main droite empoche nos cinquante mille couronnes pour que les cols nous soient ouverts, il tend la main gauche vers Henri de Transtamare ou vers le Roi de France et ne souhaite que recevoir davantage pour nous fermer les cols. Je connais notre bon Charles et, par mon saint patron le Confesseur, il apprendra à ses dépens que je le connais bien ! Il vend son royaume au plus offrant, tel un maquignon un cheval glandé. Il est…
– Monseigneur ! s’exclama Don Martin. Je ne peux pas demeurer ici à entendre un tel langage sur mon maître. Si ces mots étaient prononcés par une autre bouche, je saurais mieux leur répondre !
Don Pedro fronça les sourcils et abaissa dédaigneusement sa lèvre inférieure ; mais le Prince sourit et hocha la tête pour approuver Don Martin.
– Votre comportement et vos propos ne me surprennent pas, dit-il. Vous déclarerez au Roi votre maître que le prix qu’il demandait lui a été payé et que s’il tient parole, il a ma promesse qu’il ne sera fait aucun mal aux Navarrais, à leurs maisons, à leurs biens. Mais si nous n’avons pas son autorisation, nous arriverons néanmoins très près derrière ce message et nous apporterons une clef qui ouvrira tout ce qu’il pourrait avoir envie de fermer…
Il se pencha et chuchota quelques phrases à l’oreille de Sir Robert Knolles et de Sir Hugh Calverley qui sourirent et qui quittèrent précipitamment la salle d’audiences.
– … Notre cousin Charles a appris à connaître notre amitié, poursuivit le Prince. Et maintenant, par les Saints, il va sentir la pointe de notre déplaisir ! J’envoie sur-le-champ à notre cousin Charles un message que pourra lire tout son royaume. Qu’il prenne garde qu’il n’arrive pas pis ! Où est le seigneur Chandos ? Ah, Sir John, je recommande à vos bons soins ce digne chevalier. Vous veillerez à ce qu’il prenne collation, et qu’il reçoive une bourse d’or pour le défrayer de ses obligations, car en vérité c’est un grand honneur pour une cour de compter en son sein un gentilhomme si noble et si loyal. Que disiez-vous, sire ?
Il s’était retourné vers l’Espagnol exilé, pendant que le vieux soldat emmenait hors du salon le héraut du Roi de Navarre.
– En Espagne, nous n’avons pas pour coutume de récompenser l’effronterie d’un messager, répondit Don Pedro en caressant le museau de son lévrier. Cependant nous avons tous entendu les largesses de votre générosité royale.
– C’est vrai ! s’exclama le Roi de Majorque.
– Qui pourrait mieux les connaître que nous, continua Don Pedro avec un accent d’amertume, puisque nous avons dû nous réfugier auprès de vous comme auprès du protecteur naturel de tous les faibles ?
– Non, comme des frères auprès d’un frère ! cria le Prince avec des yeux étincelants. Nous ne doutons pas qu’avec l’aide de Dieu vous ne soyez bientôt remontés sur ces trônes d’où vous avez été si ignominieusement précipités.
– Quand viendra cet heureux jour, dit Pedro, l’Espagne sera à vous comme l’Aquitaine et, quels que soient vos projets, vous pourrez toujours compter sur toutes les troupes de terre et de mer qui sont rangées sous la bannière de la Castille.
– Et, ajouta l’autre, sur toute l’aide que pourront vous fournir la richesse et la puissance de Majorque.
– En ce qui concerne les cent mille couronnes dont je demeure votre débiteur, poursuivit négligemment Pedro, je peux sans aucun doute…
– Pas un mot, sire, plus un mot ! s’écria le Prince. Ce n’est pas en ce moment où vous êtes dans la peine que je vous embarrasserais par des affaires sordides. J’ai déclaré une fois pour toutes que je suis à vous avec toutes les cordes d’arc de mon armée et tous les florins de mes coffres.
– Ah, que voici réellement un miroir de chevalerie ! soupira Don Pedro. Je pense, Don Fernando, que puisque la bonté du Prince est si grande, nous pouvons à nouveau abuser de sa gracieuse bienveillance jusqu’à concurrence de cinquante mille couronnes. Le bon Sir William Felton voudra bien sans doute régler cela avec nous.
Le vieux conseiller anglais parut plutôt déconcerté par cette manifestation de l’estime dans laquelle était tenue la bonté de son maître.
– Je vous demande pardon, sire, dit-il, mais le Trésor public est au plus bas, car j’ai payé douze mille hommes des compagnies, et les nouveaux impôts (celui sur les foyers et celui sur le vin) ne sont pas encore rentrés. Si vous pouviez attendre l’arrivée de l’aide promise d’Angleterre…
– Non, mon cher cousin ! s’écria Don Pedro. Si nous avions su que le Trésor public était aussi bas, ou que cette pauvre somme pouvait revêtir une importance quelconque, jamais nous…
– Assez, sire ! interrompit le Prince rouge de vexation. Si les caisses sont dans un état qui inquiète Sir William, je dispose encore de ma cassette personnelle d’où je n’ai rien tiré pour mes propres besoins, mais qui est à la disposition d’un ami dans l’adversité. Sir William, vous prélèverez cette somme sur nos bijoux, s’il n’y a pas moyen de faire autrement, et vous veillerez à ce qu’elle soit remise à Don Fernando.
– En gage, j’offre… s’écria Don Pedro.
– Allons ! fit le Prince. Je ne suis pas un Lombard, sire. Votre parole royale est mon gage, sans contrat ni sceau. Mais j’ai une nouvelle pour vous, mes seigneurs et vassaux : notre frère de Lancastre est en route pour notre capitale avec quatre cents lances et autant d’archers afin de nous aider dans notre expédition. Quand il sera arrivé et quand notre digne épouse aura rétabli sa santé, c’est-à-dire d’ici quelques semaines avec l’aide de Dieu, nous rejoindrons l’armée à Dax et une foi de plus nos bannières flotteront au vent des combats…
Un joyeux bourdonnement s’éleva du groupe des guerriers. Le Prince sourit en passant en revue les visages qui l’entouraient : tous exprimaient la même ardeur martiale.
– … Vous serez heureux d’apprendre, poursuivit-il, que j’ai des renseignements sûrs sur cet Henri de Transtamare ; c’est un chef très vaillant, capable de nous opposer une résistance d’où nous pourrons tirer autant d’honneur que de plaisir. Il a rassemblé cinquante mille hommes de son peuple, il bénéficie également du concours de douze mille hommes des compagnies franches de France qui sont composées, vous le savez, de soldats courageux et éprouvés. D’autre part le brave et digne Bertrand Du Guesclin s’est rendu en France chez le duc d’Anjou et se dispose à lever des troupes en Picardie et en Bretagne. Nous tenons Bertrand en haute estime, car il a toujours fait de son mieux pour nous offrir d’honorables compétitions. Qu’en pensez-vous, digne captal ? Il vous a capturé une fois à Cocherel, mais, sur mon âme, vous aurez l’occasion de régler ce vieux compte.
Le Gascon n’eut pas l’air de priser cette allusion, non plus que ses compatriotes, car la seule fois qu’ils avaient affronté l’armée française sans l’appoint des Anglais ils avaient subi une lourde défaite.
– Certains soutiennent, monseigneur, déclara le sire de Clisson, que le compte se trouve déjà plus que réglé, étant donné que sans l’aide des Gascons, Bertrand n’aurait pas été capturé à Auray ni le Roi Jean battu à Poitiers.
– Par le Ciel, voilà qui est un peu fort ! s’écria un noble anglais. Il me semble que la Gascogne est un coq trop petit pour chanter aussi haut.
– Le plus petit coq, Lord Audley, peut avoir l’ergot le plus long, remarqua le captal de Buch.
– On peut aussi lui couper la crête s’il fait trop de bruit ! intervint un Anglais.
– Par Notre-Dame de Rocamadour ! s’écria le baron de Mussidan. En voici plus que je ne saurais supporter. Sir John Charnell, vous me répondrez de cette parole.
– Bien volontiers, et quand vous voudrez, messire, répliqua l’Anglais avec insouciance.
– Messire de Clisson, cria Lord Audley, vous regardez fixement dans ma direction. Par l’âme de Dieu, je serais heureux d’approfondir l’affaire avec vous !
– Et vous, Lord de Pommers, dit Sir Nigel, en se poussant au premier rang, j’ai dans l’idée que nous pourrions discuter agréablement et honorablement de la question en courant une lance.
En quelques secondes une douzaine de défis s’entrecroisèrent : c’était comme autant d’éclairs jaillissant du nuage sombre qui depuis longtemps menaçait les rapports entre les chevaliers des deux nations. Les Gascons gesticulaient et tempêtaient, les Anglais demeuraient de glace et ricanaient. Le Prince, un demi-sourire sur les lèvres, observait les deux camps : visiblement il ne détestait pas d’assister à une scène de fureur, mais il redoutait que les choses s’envenimassent au point d’échapper à son contrôle.
– Mes amis ! s’écria-t-il enfin. Cette querelle ne doit pas aller plus loin. L’homme qui la poursuivrait hors d’ici en répondra devant moi, qu’il soit Gascon ou Anglais. J’ai beaucoup trop besoin de vos épées pour que vous les croisiez entre vous. Sir John Charnell, Lord Audley, vous ne mettez pas en doute le courage de nos amis de Gascogne ?
– Pas moi, monseigneur ! répondit Lord Audley. Je les ai vus si souvent se battre que je sais qu’ils sont de très hardis et très vaillants gentilshommes.
– Je le pense aussi, déclara l’autre Anglais. Mais nous ne risquons pas de l’oublier tant qu’ils auront une langue pour parler.
– Non, Sir John ! répliqua le Prince sur un ton de reproche. Tous les peuples ont leurs mœurs et coutumes particulières. Certains pourraient nous reprocher d’être froids, ternes, taciturnes. Mais vous avez entendu, mes seigneurs de la Gascogne ? Ces gentilshommes ne songeaient nullement à entacher votre honneur ou à douter de votre valeur. Par conséquent, que la colère s’efface de vos pensées ! Clisson, Buch, Pommers, ai-je votre serment ?
– Nous sommes vos sujets, monseigneur ! répondirent sans bonne grâce les barons de Gascogne. Vos paroles sont notre loi.
– Nous enterrerons donc toute cause de malentendu dans un flacon de malvoisie, dit gaiement le Prince. Holà, les portes de la salle de banquet ! Je suis demeuré trop longtemps séparé de ma douce épouse, mais je vais vous retrouver bientôt. Que jouent les ménestrels et que le vin coule ! Nous boirons aux belles journées qui nous attendent dans le sud !
Il se détourna et sortit avec les deux monarques, tandis que le reste de la compagnie passait lentement dans la grande salle où étaient préparées les tables royales ; mais beaucoup avaient encore l’œil menaçant et la bouche crispée.
CHAPITRE XX
Comment Alleyne conquit sa place dans
une honorable guilde
Pendant que siégeait le conseil du Prince, Alleyne et Ford étaient demeurés dans l’antichambre ; ils furent bientôt entourés de plusieurs jeunes Anglais bruyants, écuyers comme eux, avides des dernières nouvelles d’Angleterre.
– Comment va le vieil homme de Windsor ? demanda l’un.
– Et la bonne Reine Philippa ?
– Et madame Alice Perrers ? cria un troisième.
– Le diable emporte ta langue, Wat ! s’exclama un grand jeune homme qui secoua durement par le col le dernier questionneur. Le Prince te ferait couper la tête pour ces mots-là !
– Par ma foi, elle ne lui manquerait guère ! s’écria celui qui avait posé la première question. Elle est aussi vide que la besace d’un mendiant.
– Aussi vide qu’un écuyer anglais, cousin ! répondit un autre. Que devient diable le maître des tables ? Les tréteaux ne sont pas encore installés.
– Mon Dieu ? Si un homme devenait chevalier par le ventre. Humphrey, tu serais au moins chevalier banneret !
Un éclat de rire salua cette saillie.
– Et si c’était en buvant, vieille outre de cuir, tu serais le premier baron du royaume ! cria Humphrey furieux. Mais comment va l’Angleterre, enfants de Loring ?
– J’ai l’impression, répondit Ford, qu’elle n’a pas beaucoup changé depuis que vous l’avez quittée, sauf peut-être qu’elle est un peu moins bruyante.
– Et pourquoi moins bruyante, jeune Salomon ?
– Mettons que ce soit une devinette.
– Pardieu ! Voilà un paladin qui arrive avec la boue du Hampshire collée encore à ses chausses : il veut dire que le bruit a diminué parce que nous avons quitté le pays.
– Ils ont l’esprit vif par ici ! commenta Ford en se tournant vers Alleyne.
– Comment devons-nous prendre cela, messire ? interrogea l’écuyer tout hérissé.
– Prenez-le comme vous voudrez, répondit Ford avec insouciance.
– Mais c’est de l’effronterie ! cria l’autre.
– Messire, je rends hommage à votre véracité, répondit Ford.
– Arrête-toi, Humphrey ! intervint en riant le grand écuyer. Tu n’as pas grand-chose à gagner de ce gentilhomme, j’imagine ! Les langues sont aiguisées dans le Hampshire, messire.
– Et les épées ?
– Hum ! Nous pourrons en avoir la démonstration. Après-demain, aux vêpres du tournoi, nous verrons si votre lance est aussi agile que votre esprit.
– Allons, allons ! s’écria un jeune homme au cou de taureau dont les épaules carrées et les membres massifs révélaient une force exceptionnelle. Tu prends l’affaire avec une trop grande légèreté, Roger Harcomb ! Nous ne nous laisserons pas encombrer aussi facilement. Le seigneur Loring a fait ses preuves ; mais nous ignorons tout de ses écuyers, sauf que l’un d’eux a la langue railleuse. Et vous, jeune seigneur ?
Il posa sa lourde main sur l’épaule d’Alleyne.
– Et quoi de moi, jeune seigneur ?
– Ma foi, c’est le page de madame qui nous est arrivé ! Tu auras les joues plus poilues et la main plus rude quand tu reverras ta mère.
– Si ma main n’est pas rude, elle est prête.
– Prête ? Prête pour quoi faire ? Prête pour tenir la traîne de madame ?
– Prête pour châtier l’insolence, messire ! cria Alleyne dont les yeux étincelaient.
– Mon doux petit cousin ! ironisa le gros écuyer. Un teint aussi délicat ! Une voix aussi moelleuse ! Des yeux de jeune vierge et des cheveux comme ceux d’un bébé de trois ans ! Voilà…
Il passa brutalement ses gros doigts à travers les boucles dorées du jeune homme.
– Vous cherchez une querelle, messire ! répondit Alleyne blanc de colère.
– Et alors ?
– Vous la cherchez comme un rustre de la campagne et non comme un écuyer correct. Avez-vous été si mal élevé ? Êtes-vous si peu instruit ? Je sers un maître qui pourrait vous montrer comment s’y prendre.
– Et comment s’y prendrait-il, mon écuyer rose ?
– Il ne parlerait pas fort, et il ne serait pas grossier. Il se montrerait plutôt plus aimable que d’habitude. Il dirait : « Messire, je considérerais comme un honneur de me livrer avec vous à une petite passe d’armes, non pas pour ma propre gloire ou pour me distinguer, mais pour la renommée de ma dame et la réputation de la chevalerie. » Puis il retirerait son gant, comme ceci, et le jetterait par terre ; ou, s’il avait motif de penser qu’il avait affaire avec un rustre, il le lui jetterait à la figure… comme cela !
Un murmure passionné parcourut le groupe des écuyers : de toute sa force Alleyne venait de lancer son gant à la figure de son adversaire. Écuyers et pages accoururent ; une vraie foule entoura bientôt les antagonistes.
– Vous me paierez cela avec votre vie ! dit le bravache.
La rage le rendait hideux.
– Si vous pouvez la prendre, répondit Alleyne.
– Brave enfant, chuchota Ford, tiens ferme, comme de la cire !
– Je verrai la justice ! s’écria Norbury, le silencieux écuyer de Sir Oliver.
– Tu l’as bien recherché, John Tranter ! déclara le grand écuyer qui portait le nom de Roger Harcomb. Il faut toujours taquiner les nouveaux, c’est entendu, mais il serait honteux que cette affaire aille plus loin : le jeune homme a montré qu’il avait du cœur.
– Mais un soufflet ! Un soufflet ! s’écrièrent plusieurs vieux écuyers. L’affaire doit aller jusqu’au bout !
– Non. Tranter a porté la main le premier à la figure de ce garçon, répondit Harcomb. Qu’en dis-tu, Tranter ? L’affaire peut-elle en rester là ?
– Mon nom est connu en Aquitaine, dit fièrement Tranter. Je puis dédaigner ce qui souillerait un autre nom. Qu’il ramasse son gant et qu’il dise qu’il a agi inconsidérément !
– Je le verrais d’abord dans les griffes du diable ! murmura Ford.
– Entendez-vous, jeune seigneur ? interrogea le conciliateur. Notre ami oubliera l’incident si vous dites simplement que vous avez agi sous l’empire de l’emportement.
– Je ne peux pas dire cela, répondit Alleyne.
– C’est notre coutume, jeune seigneur, de mettre à l’épreuve les écuyers qui arrivent d’Angleterre. Réfléchissez que si un homme se procure un nouveau destrier et une lance neuve, il les expérimente toujours en temps de paix, de peur qu’ils ne le déçoivent le jour où il en aura vraiment besoin. N’est-il pas naturel que nous éprouvions aussi nos futurs compagnons d’armes ?
– Je crois qu’il vaudrait mieux chercher un règlement honorable, chuchota Norbury à l’oreille d’Alleyne. Votre adversaire est très redoutable à l’épée, beaucoup plus fort que vous.
Mais Edricson était d’un vieux sang saxon, lent à s’échauffer et encore plus lent à se refroidir. L’allusion de Norbury au danger ne fit qu’endurcir sa résolution.
– Je suis venu ici à la suite de mon maître, dit-il. Je vous considérais tous comme des Anglais et des amis. Ce gentilhomme m’a réservé un accueil discourtois ; si je lui ai répondu de la même manière, il n’a qu’à s’en prendre à lui-même. Je vais donc ramasser mon gant ; mais certes je maintiens ce que j’ai dit et fait, à moins que lui ne me demande pardon le premier.
Tranter haussa les épaules.
– Tu as fait ton possible pour le sauver, Harcomb, dit-il. Nous ferions mieux d’en finir sur-le-champ.
– C’est mon avis ! cria Alleyne.
– Le conseil durera jusqu’au banquet, fit observer un écuyer grisonnant. Vous disposez de deux bonnes heures.
– Et l’endroit ?
– La cour d’entraînement est vide en ce moment.
– Non. Il ne faut pas rester dans l’abbaye. Autrement cela irait mal si le Prince était mis au courant.
– Il y a un endroit tranquille près du fleuve, proposa un jeune homme. Nous n’avons qu’à traverser le domaine de l’abbaye en longeant le mur de l’armurerie, dépasser l’église Saint-Rémi et descendre la rue des Apôtres.
– En avant donc ! s’écria Tranter.
Tous les assistants sortirent aussitôt, sauf quelques-uns que des consignes particulières retenaient à leur poste.
Auprès de la Garonne s’étendait une petite pelouse entre le haut mur du jardin d’un prieur et un verger de pommiers. Le long de la rive, le fleuve était profond et son courant rapide ; il n’y avait que peu de bateaux ; encore étaient-ils mouillés au milieu des eaux. Les deux adversaires tirèrent leur épée et ôtèrent leur doublet ; ni l’un ni l’autre n’avaient d’armure défensive. Le duel avec son étiquette imposante n’était pas encore à la mode, mais des rencontres impromptues étaient fréquentes entre jeunes gens impulsifs. Dans ce genre de combats comme dans les joutes plus formalistes de la lice, Tranter s’était acquis une solide réputation grâce à sa force et à sa dextérité. De son côté, Alleyne s’était entraîné chaque jour pendant plusieurs mois au maniement des armes ; comme il avait naturellement l’œil vif et la main prompte, il n’était pas un bretteur à dédaigner. Le contraste entre les deux adversaires apparut saisissant quand ils se placèrent face à face ; Tranter était tout brun, trapu, massif, avec un torse poilu et des bras noueux ; Alleyne, avec ses cheveux dorés et sa peau de jeune fille, était un modèle de grâce et de souplesse. À beaucoup le combat semblait inégal ; mais certains remarquèrent dans le calme regard gris et dans l’attitude circonspecte du jeune homme quelque chose qui rendait incertaine l’issue de la rencontre.
– Attention, messire, attention ! cria Norbury avant que le fer eût été croisé. Ce gentilhomme a une épée à deux mains, et elle a bien trente centimètres de plus que celle de notre ami !
– Prends la mienne, Alleyne ! proposa Ford.
– Non, mes amis, répondit-il. Je connais le poids et l’équilibre de mon arme. Dépêchons-nous, messire, car notre maître peut avoir besoin de nous à l’abbaye !
Il était exact que la grande épée de Tranter conférait à celui-ci un net avantage. Il se tenait talons joints, genoux ployés vers l’extérieur, prêt à pousser une pointe ou à esquiver. Il tendait l’épée devant lui, la lame bien droite en l’air, ce qui lui laissait le choix entre l’abattre d’un coup plongeant et détourner un coup qui viserait sa tête ou son buste. Il était protégé de surcroît par une large garde pourvue d’une encoche étroite et profonde où un épéiste exercé pouvait bloquer la lame de son adversaire, puis d’un rapide tour de poignet la casser en deux. Alleyne, lui, ne pouvait se fier qu’à son coup d’œil et à son agilité : son épée était légère ; le pommeau incliné petit ; l’acier très effilé.
Tranter ne tarda pas à vouloir tirer parti de son avantage. Quand son adversaire s’avança vers lui, il bondit et lui asséna un coup de taille qui l’aurait scié en deux si Alleyne n’avait pas légèrement sauté en arrière. Il s’en fallut de si peu que la pointe déchirât le bord de sa ceinture. Avec la vivacité d’une panthère Alleyne poussa une botte, mais Tranter, aussi agile que puissant, détourna le fer d’un revers de sa lourde lame. À nouveau il voulut frapper, et la violence de son coup laissa les spectateurs haletants : Alleyne l’esquiva encore une fois de justesse et répondit par deux coups de pointe rapides comme l’éclair que l’autre para avec difficulté. Ils se serraient de si près qu’Alleyne n’eut pas le temps d’éviter le coup de taille suivant qui rabattit son épée et lui érafla le front : le sang coula dans ses yeux et le long de ses joues. Il se jeta de côté hors de la portée de Tranter ; les deux écuyers s’immobilisèrent, haletants ; les spectateurs applaudirent.
– Beau sport ! cria Roger Harcomb. L’un comme l’autre vous sortez grandis de cette rencontre. Mais ce serait un péché et une honte de la poursuivre plus longtemps.
– Vous avez assez fait, Edricson ! dit Norbury.
– Vous vous êtes bien comporté ! s’exclamèrent plusieurs vieux écuyers.
– Pour ma part je ne désire nullement la mort de ce jeune homme, dit Tranter en essuyant la sueur de son front.
– Ce gentilhomme me demande-t-il pardon pour sa discourtoisie ? interrogea Alleyne.
– Non.
– Alors en garde, messire !
Dans un furieux cliquetis les deux épées s’entrecroisèrent à nouveau. Alleyne poussait constamment en avant pour empêcher Tranter de déployer toute la longueur de sa lame. Tranter reculait ou sautait de côté afin d’avoir le champ nécessaire pour assener l’un de ses terribles coups de taille. Un coup aux trois quarts paré entama l’épaule gauche d’Alleyne, mais celui-ci blessa légèrement Tranter à la cuisse. Hélas ! À la minute suivante sa lame glissa dans l’encoche fatale ; les spectateurs entendirent un craquement sec, et Alleyne se retrouva avec un morceau d’acier de cinquante centimètres de long dans la main : c’était tout ce qui lui restait de son épée.
– Votre vie est à ma merci ! cria Tranter avec un sourire ironique.
– Non, non ! Il fait soumission ! crièrent plusieurs écuyers.
– Une autre épée ! réclama Ford.
– Non ! dit Harcomb. Ce n’est pas la coutume.
– Jetez votre tronçon, Edricson ! cria Norbury.
– Jamais ! dit Alleyne. Me présentez-vous vos excuses, messire ?
– Vous êtes fou de me demander cela !
– Alors en garde ! cria le jeune écuyer.
Il s’élança avec une ardeur farouche qui cherchait à suppléer à la petite taille de son arme. Il avait remarqué que son adversaire soufflait comme un homme harassé. Le moment lui sembla donc propice de prouver la valeur d’une existence plus saine et de muscles plus souples. Tranter reculait, reculait dans l’espoir de pouvoir décocher le coup décisif. Alleyne avançait sur lui, le menaçait de sa pointe ébréchée, tantôt au visage, tantôt à la gorge, tantôt à la poitrine ; il multipliait les coups de pointe pour franchir la ligne d’acier. Mais son antagoniste expérimenté laissait passer l’orage : il savait bien qu’Alleyne ne pourrait pas soutenir longtemps des efforts pareils. Dès qu’il se relâcherait, ce serait sa mort. Il fallait qu’il se relâche ! Bientôt il allait être à bout de souffle ! Déjà ses bottes étaient moins vigoureuses, et son pied moins sûr, bien que le regard gris n’eût rien perdu de son éclat. Tranter, au cours de ses multiples combats, avait appris la prudence et la ruse. Tout à coup il détourna l’arme fragile de son adversaire, fit tournoyer sa lourde lame, sauta en arrière pour avoir plus de champ… et disparut dans les eaux de la Garonne.
Les écuyers, combattants ou spectateurs, s’étaient si passionnément intéressés aux péripéties du duel qu’ils avaient complètement oublié le fleuve qui coulait au-dessous de la berge à pic. C’est seulement lorsque Tranter, reculant devant les assauts d’Alleyne, atteignit le bord de la berge qu’un cri général l’avertit du danger qu’il courait. Son dernier bond en arrière, qui devait lui permettre d’assener le coup décisif, lui fut fatal : il se retrouva dans un courant glacé et rapide de trois mètres de fond. À deux reprises sa tête et ses doigts, qui essayaient vainement de se raccrocher à quelque chose de solide, émergèrent de l’eau verte, mais le tourbillon l’emportait. Ses compagnons lui jetèrent inutilement des fourreaux, des branches de pommiers, des ceintures. Alleyne avait laissé tomber son épée brisée et regardait la scène ; il tremblait de tous ses membres ; sa colère s’était muée en une pitié soudaine. Une troisième fois l’homme qui se noyait reparut à la surface ; ses mains étaient pleines d’algues ; il lança vers la berge un regard désespéré. Ses yeux rencontrèrent ceux d’Alleyne, qui ne put pas résister à la muette supplication qu’il y lut : il plongea à son tour dans la Garonne et nagea vigoureusement en direction de son adversaire.
Mais le courant était fort. Pour le bon nageur qu’était Alleyne, la tâche ne se révéla pas simple. Arriver jusqu’à Tranter et l’empoigner par les cheveux fut l’affaire de quelques secondes ; mais il fallait aussi lui maintenir la tête hors de l’eau et sortir du courant. Pendant une bonne centaine de brassées Alleyne ne parut pas gagner un centimètre. Puis enfin, tandis que sur la rive retentissait un chœur de cris de joie et de louanges, les deux hommes parvinrent dans une eau plus stagnante ; Ford leur lança adroitement une douzaine de ceinturons reliés par leurs agrafes ; ils s’y cramponnèrent avec l’énergie du désespoir ; dégouttant d’eau et blancs comme des linges, ils furent halés sur la berge, et s’affalèrent sur le gazon.
John Tranter fut le premier à revenir à lui : en effet, s’il était demeuré plus longtemps dans l’eau, il n’avait nullement participé à cette lutte farouche contre le courant. Il se remit debout en titubant et regarda son sauveteur qui venait de se soulever sur un coude et qui souriait faiblement au concert de compliments et de félicitations que lui adressaient les écuyers rassemblés autour de lui.
– Je vous suis fort obligé, messire ! dit Tranter d’une voix qui s’efforçait d’être amicale. Sans vous je me serais certainement noyé, car je suis originaire du Warwickshire ; dans ce comté sec, presque personne ne sait nager.
– Je ne réclame pas de remerciements, répondit Alleyne d’un ton froid. Donnez-moi votre main pour que je puisse me relever.
– Le fleuve a été mon ennemi, dit Tranter. Mais il a été pour vous un bon ami ; aujourd’hui il vous a sauvé la vie.
– C’est possible, répliqua Alleyne.
– Mais maintenant tout est terminé, dit Harcomb, et sans aucun mal, ce qui est mieux que je ne l’espérais tout à l’heure. Notre jeune ami a très joliment et honnêtement gagné sa place dans l’honorable guilde des écuyers de Bordeaux. Prends ton doublet, Tranter.
– Hélas, ma pauvre épée est au fond de la Garonne ! gémit l’écuyer.
– Voici votre pourpoint, Edricson ! cria Norbury. Mettez-le sur vos épaules, pour que vous ayez au moins un vêtement sec !
– Et maintenant rentrons à l’abbaye ! s’écrièrent plusieurs voix.
– Un moment, messires ! s’exclama Alleyne qui s’appuyait sur l’épaule de Ford et qui tenait dans sa main droite le tronçon d’épée qu’il avait ramassé. J’ai peut-être encore de l’eau dans mes oreilles, mais je n’ai pas entendu les excuses de ce gentilhomme pour les manières insultantes dont il a usé tout à l’heure avec moi à l’abbaye.
– Comment ! Vous poursuivez notre querelle ? demanda Tranter.
– Et pourquoi pas, messire ? Je suis lent à m’émouvoir, mais une fois l’affaire commencée, je la poursuivrai tant qu’il me restera un souffle de vie.
– Ma foi, il ne doit pas vous en rester beaucoup ! fit Harcomb. Suivez mon avis, messire : laissez tomber ! Vous vous en êtes fort bien tiré !
– Non, dit Alleyne. Je n’ai pas cherché cette querelle ; mais, puisque nous en sommes arrivés là, je jure que je ne quitterai pas les lieux sans avoir obtenu ce que j’y suis venu chercher. Demandez-moi pardon, messire, ou choisissez une autre épée et remettons-nous en garde.
Le jeune écuyer était mortellement pâle. Tout détrempé et taché de boue, l’épaule ensanglantée, le front égratigné, il s’était cependant figé dans une attitude empreinte d’une résolution inflexible. Le tempérament plus épais, plus matériel de son adversaire s’inclina devant l’ardente intensité d’une nature éminemment spirituelle.
– Je n’avais pas pensé que vous le prendriez si mal, répondit-il gauchement. Il ne s’agissait que d’une plaisanterie comme nous en faisons entre nous, mais puisque vous y tenez, je la regrette.
– Alors je vous exprime également mes regrets, dit Alleyne avec chaleur. Et voici ma main pour sceller notre réconciliation.
– La trompe du repas de none a sonné trois fois, ajouta Harcomb. Je me demande ce que pensera ou dira le maître des cuisines du Prince. Par ma foi, maître Ford, votre ami a bien besoin d’une coupe de vin car il a bu beaucoup d’eau de la Garonne ! Je n’aurais pas cru, à voir son jeune visage, qu’il se serait comporté avec autant de vaillance.
– Cet air de Bordeaux, répondit Ford, a métamorphosé notre colombe en coq de combat. Jamais le Hampshire n’a vu naître un garçon plus doux et plus courtois.
– Son maître également est un gentilhomme doux et courtois, murmura Harcomb. Et pourtant je ne crois pas qu’ils soient l’un et l’autre des hommes sur les pieds de qui il serait prudent de s’aventurer !
CHAPITRE XXI
Comment Agostino Pisano risqua sa tête
Lorsque le Prince tenait sa cour à Bordeaux la table des écuyers à l’abbaye de Saint-André était somptueuse. Après le régime austère de Beaulieu et les restrictions auxquelles était contrainte Lady Loring, Alleyne apprit jusqu’où pouvaient être poussés le luxe et les raffinements. Des paons rôtis dont les plumes avaient été replacées avec soin sur le plat pour donner l’impression qu’ils étaient encore en vie, des hures de sangliers avec les défenses dorées et le groin bordé de feuilles d’argent, des gelées dont le dessin prétendait représenter les douze apôtres, et un grand pâté qui était une reproduction réduite du nouveau château de Windsor, tels furent quelques-uns des mets peu ordinaires disposés devant lui. Un archer lui avait apporté de la cogghe des vêtements de rechange : déjà, avec l’aisance de la jeunesse, il avait oublié ses ennuis et ses fatigues de la matinée. Un page était venu de la salle du banquet l’informer que son maître avait l’intention de boire du vin le soir chez le seigneur Chandos, et qu’il désirait que ses écuyers dormissent à l’hôtel de la « Demi-Lune » dans la rue des Apôtres. Ford et Alleyne se dirigèrent donc de ce côté un peu avant la tombée de la nuit.
Une pluie fine les accompagna dans leur promenade à travers les rues de la vieille ville ; ils avaient laissé leurs chevaux dans les écuries royales ; ils s’étaient couverts la tête de leur cape ; une lampe à huile au coin d’une rue, ou sous le portail d’un riche citadin, projetait ici et là une faible lueur tremblotante sur les pavés luisants ; elle permettait aussi de distinguer quelques visages dans la foule bigarrée qui, en dépit du mauvais temps, arpenta lentement les artères principales. Ces cercles de lumière révélaient à l’improviste une scène de la vie bordelaise. Par exemple, un bourgeois à la figure ronde, tout gonflé de sa prospérité, avec un ample manteau de drap noir, une toque plate en velours, une large ceinture de cuir et une bourse dansante, précédait sa servante coiffée d’une guimpe bleue qui portait à bout de bras la lanterne destinée à éclairer le chemin de son maître. Ils étaient suivis de quelques originaires du Yorkshire à moitié ivres qui bavardaient dans un idiome que comprenaient à peine leurs compatriotes du Sud ; leur justaucorps marqué du lion rampant indiquait qu’ils faisaient partie de la suite des Stapleton du Nord. Se retournant fréquemment vers leurs visages farouches, le bourgeois accélérait l’allure, tandis que la jeune servante resserrait sa guimpe. Il faut dire que les regards qu’ils lançaient à la bourse et à la fille auraient été compris dans tous les pays du monde. Derrière eux avançaient des archers de la garde, des femmes du camp à la voix perçante, des pages anglais à la peau douce et aux yeux bleus émerveillés, des moines en robe noire, des hommes d’armes qui flânaient, des serviteurs gascons qui parlaient haut, des marins du fleuve, de rudes paysans du Médoc, des écuyers en cape qui jouaient des coudes dans ce flot ininterrompu autant que divers. Dans l’air s’entrecroisaient l’anglais, le français, le gallois, le basque, et tous les patois de la Gascogne et de la Guyenne. De temps à autre la foule s’écartait pour laisser passer une litière à chevaux qui conduisait une dame vers l’abbaye, à moins que ce ne fût pour une troupe d’archers portant des torches et accompagnant un baron gascon ou un chevalier anglais. Le martèlement des sabots, le cliquetis des armes, les cris des ivrognes, les rires aigus des femmes résonnaient dans les rues grouillantes de la cité.
Un couple retint particulièrement l’attention des deux jeunes écuyers, d’autant plus qu’il allait dans leur direction en les précédant de quelques pas. C’était un homme et une jeune fille. L’homme était très grand, voûté ; il boitait ; il portait sous le bras un gros paquet plat dans un drap noir. Sa compagne était jeune et se tenait bien droite ; elle avait le pas élastique et le maintien gracieux ; mais sa pèlerine noire l’enveloppait si bien qu’on ne voyait de son visage que deux yeux noirs brillants et une boucle de cheveux sombres. L’homme s’appuyait lourdement sur elle pour éviter de forcer sur son pied fragile ; il gardait son paquet entre lui et le mur, et poussait en avant la jeune fille pour qu’elle lui servît de bouclier chaque fois que la pression de la foule menaçait de le déporter. Son anxiété évidente, la beauté de sa compagne et leurs soins conjugués pour protéger leur paquet éveillèrent l’intérêt des deux jeunes Anglais qui marchaient derrière eux.
– Courage, mon enfant ! s’exclama l’homme dans un français aux intonations bizarres. Encore soixante pas et nous serons sauvés.
– Tenez-le bien, père ! répondit la jeune fille dans le même langage doux et affété. Nous n’avons rien à craindre.
– Ce sont vraiment des païens et des barbares ! s’écria l’homme. Des barbares insensés, furieux, ivres ! Encore quarante pas, Tita mia, et je jure par saint Éloi, patron des artisans, que je ne ressortirai plus avant que tout cet essaim soit rentré dans sa ruche de Dax, ou parti n’importe où. Plus que vingt pas, mon trésor ! Ah ! mon Dieu, comme ils poussent et braillent ! Joue bravement de ton petit coude, Tita mia ! Fonce droit sur eux ! Carre tes épaules, ma fille ! Pourquoi céder le passage à ces insulaires enragés ? Ah, cospetto ! Nous sommes ruinés, anéantis !
La foule, devant eux, s’était épaissie : le boiteux et la jeune fille furent contraints de s’arrêter. Plusieurs archers anglais à demi saouls, attirés comme les deux écuyers par leur allure singulière, leur barraient le chemin et les observaient dans la mauvaise lumière des lampes à huile et des torches.
– Par les trois rois ! cria l’un d’eux. Ce vieux gâteux est un malin : regardez la jolie béquille qu’il a dénichée ! Sers-toi de la jambe que Dieu t’a donnée, mon ami, et ne t’appuie pas aussi lourdement sur la fille !
– Que vingt diables l’emportent ! s’exclama un autre. Comment ! Est-ce que de braves archers vont se priver de femmes alors qu’un bonhomme utilise un pareil bâton de vieillesse ?
– Viens avec moi, mon petit chou ! cria un troisième en tirant sur la pèlerine de la jeune fille.
– Non, avec moi, désir de mon cœur ! intervint le premier. Par saint Georges notre vie est courte, et il nous faut de la joie tant qu’elle dure ! Que je ne revoie jamais Chester Bridge, si celle-ci n’est pas la fille la plus séduisante que j’aie jamais rencontrée !
– Que tient sous son bras le vieux crapaud ? s’écria un autre archer. Il se cramponne à son paquet comme le diable à un pécheur.
– Montre-nous ce qu’il y a dedans, vieux sac d’os ! Voyons un peu ce que tu as sous ton bras !
Ils se groupèrent autour de lui. Mais l’homme qui ne comprenait pas leur langue continuait à s’appuyer d’une main sur la jeune fille et de l’autre à tenir son paquet. Néanmoins il cherchait avidement du secours dans la foule.
– Non, les enfants, non ! cria Ford en écartant l’archer le plus proche de lui. Ce serait vous conduire indignement. Bas les pattes, ou tant pis pour vous !
– Ferme-la, ou tant pis pour toi ! répliqua le plus ivre des archers. Qui es-tu pour gâcher nos plaisirs ?
– Un simple écuyer, tout frais débarqué, dit un autre. Par saint Thomas de Kent, nous sommes venus derrière notre maître ! Nous ne nous laisserons pas commander par le premier bébé venu que sa mère aurait envoyé en Aquitaine !
– Oh, messires ! supplia la jeune fille. Pour l’amour du Christ ne nous abandonnez pas ! Ne permettez pas que ces individus nous maltraitent !
– N’ayez aucune crainte, madame ! répondit Alleyne. Nous veillerons à ce que tout se passe bien. Retire ta main du poignet de cette jeune fille, toi coquin du Nord !
– Ne la lâche pas, Wat ! ordonna un grand homme d’armes à barbe noire dont la cuirasse brillait dans l’ombre. Ôtez vos mains de vos poinçons, vous deux, car j’ai manié l’épée quand vous n’étiez pas encore au monde et, par l’âme de Dieu, je vous embrocherai avant que vous ayez le temps de bouger le petit doigt !
– Dieu merci ! fit soudain Alleyne qui avait aperçu à la lueur de la lampe une tignasse rousse sous un casque qui dominait toutes les têtes. Voici John, et Aylward aussi. À l’aide, camarades, car on en veut à cette jeune fille et à ce vieillard !
– Holà, mon petit ! intervint le vieil archer qui se fraya le passage avec Hordle John sur ses talons. Que veut dire tout cela ? Par la corde de mon arc, je pense que tu auras de l’ouvrage si tu veux redresser tous les torts que tu verras de ce côté de l’eau. Comment une troupe d’archers, avec le vin qui bourdonne aux oreilles, serait-elle aussi policée que de jeunes clercs dans un jardin ? Quand tu auras servi un an dans la Compagnie, tu prendras moins à cœur ce genre d’affaires. Qu’est-ce qui va de travers par ici ? Le grand prévôt avec ses archers n’est pas loin : certains d’entre vous pourraient bien se trouver au cachot d’ici peu !
– Mais c’est le vieux Sam Aylward de la Compagnie Blanche ! cria l’homme d’armes. Hé bien, Samkin, que t’est-il arrivé ? Je me rappelle le jour où ta lame faisait plus de bruit que toute une compagnie franche. Sur mon âme, entre Limoges et la Navarre, qui donc embrassait une fille ou tranchait une gorge plus facilement que l’archer Aylward de la Compagnie de Hawkhood ?
– Tu ne mens pas, Peter. Et, par ma garde, je n’ai pas beaucoup changé ! Mais avec moi tout a toujours été clair et net. La fille doit être consentante, sinon celui qui s’attaquera à elle s’attaquera à moi. Compris ?
Le visage résolu d’Aylward et les énormes épaules du gros John firent comprendre aux archers que la violence ne leur rapporterait guère. La jeune fille et le vieil homme avancèrent pour se perdre dans la foule ; personne ne se hasarda à les arrêter. Ford et Alleyne les suivirent à pas lents, mais Aylward retint Alleyne par le bras.
– Par ma garde, camarade ! fit-il. J’ai appris que tu t’étais magnifiquement conduit ce matin à l’abbaye ; mais je t’en prie, fais attention ! N’oublie pas que c’est moi qui t’ai entraîné dans la Compagnie, et que ce serait un sombre jour pour moi s’il t’arrivait quelque chose.
– Non, Aylward, je ferai attention.
– Ne te lance pas trop au milieu des dangers, mon petit ! Dans très peu de temps, ton poignet aura pris de la force, et tes coups de taille seront imbattables. Nous serons quelques-uns ce soir à la « Rose de Guyenne », qui se trouve à deux portes de la « Demi-Lune ». Si tu veux vider un gobelet avec de simples archers, tu seras le bienvenu.
Alleyne promit de s’y rendre si ses devoirs le lui permettaient ; puis il rejoignit Ford qui avait engagé la conversation avec les deux inconnus.
– Brave jeune signor ! s’écria le grand vieillard en passant ses bras autour d’Alleyne. Comment vous remercier d’avoir pris notre parti contre ces barbares à demi ivres ? Qu’aurions-nous fait sans vous ? Ma Tita m’aurait été enlevée, et ma tête aurait été fracassée en mille morceaux !
– Non, je ne pense pas qu’ils vous auraient maltraité à ce point ! protesta Alleyne.
– Oh ! oh ! cria-t-il en riant de bon cœur. Je ne parlais pas de la tête que je porte sur mes épaules. Cospetto, non ! C’est la tête que je porte sous mon bras que vous avez sauvée.
– Peut-être les signori daigneront-ils entrer sous notre toit, père ? dit la jeune fille. Si nous restons ici devant notre porte, qui sait si une nouvelle aventure ne nous arrivera pas ?
– Bien dit, Tito ! Bien parlé, ma fille ! Je vous prie, messires, d’honorer ma demeure de votre présence. Une lumière, Giacomo ! Il y a cinq marches à monter. Maintenant, deux de plus. Là ! Nous sommes enfin en sécurité ! Corpo di Bacchio ! Je n’aurais pas donné dix maravedis pour ma tête quand ces enfants du diable nous poussaient contre le mur. Tita mia, tu as été une brave fille. Il valait mieux te laisser bousculer et sauver ma tête.
– Certainement, père ! dit-elle.
– Mais ces Anglais ! Ah ! Prenez un Goth, un Hun, et un Vandale ; mélangez le tout, ajoutez un pirate des États barbaresques, puis prenez le produit et enivrez-le : vous avez un Anglais. Mon Dieu ! A-t-il jamais existé pareil peuple sur la terre ? Quel endroit se trouve à l’abri de leur sauvagerie ? On m’a dit qu’ils s’étaient répandus en Italie comme ils se sont répandus ici. On les trouve partout, sauf au paradis !
– Cher père, s’écria Tita en aidant le boiteux à grimper le tortueux escalier de chêne, vous ne devez pas oublier que ces bons signori sont des Anglais !
– Ah oui ! Je vous demande pardon, messires. Entrez ici. Certains prennent plaisir à regarder ces peintures, mais il paraît que dans votre île l’art de la guerre est le seul qui soit honoré.
La pièce basse de plafond mais décorée de panneaux de chêne était bien éclairée par quatre lampes à essences parfumées. Contre les murs, sur la table, par terre, partout, il y avait de grandes feuilles de verre peintes de couleurs très vives. Ford et Edricson ouvrirent de grands yeux : jamais ils n’avaient contemplé de plus authentiques chefs-d’œuvre.
– Vous les aimez ? s’écria l’artiste boiteux qui avait surpris leur regard admiratif. Y aurait-il donc dans votre pays quelques hommes capables d’apprécier ces bagatelles ?
– Incroyable ! s’exclama Alleyne. Quelle couleur ! Quel dessin ! Regarde le martyre de saint Étienne, Ford. Ne pourrais-tu ramasser l’une de ces pierres que les meurtriers vont lancer sur leur victime ?
– Et ce cerf, Alleyne, avec la croix entre ses bois ! Ma foi, je n’en ai pas vu de plus beaux dans la forêt de Bere !
– Et le vert de ce gazon ! Comme il est clair et brillant ! Toutes les peintures que j’avais vues jusqu’ici n’étaient que des coloriages d’enfant. Ce digne homme doit être l’un de ces grands peintres dont parlait si souvent le Frère Bartholomew à Beaulieu.
Le visage mobile de l’artiste s’illumina devant le ravissement sincère des deux jeunes Anglais. Sa fille avait retiré sa pèlerine : elle possédait le type italien le plus délicat et le plus pur, et elle captiva aussitôt l’attention de Ford. Alleyne, lui, allait de la table aux murs dont il faisait le tour, puis revenait à la table en ponctuant son inspection de petits cris de plaisir.
– Que pensez-vous de ceci, jeune seigneur ? demanda l’artiste en découvrant tout à coup l’objet qu’il avait tenu sous son bras.
C’était, peinte sur une feuille de verre, une tête couronnée d’une auréole : elle était dessinée avec tant de finesse, les couleurs en étaient si parfaites qu’en vérité on aurait dit une véritable figure humaine regardant le jeune écuyer avec des yeux tristes et pensifs. Alleyne battit des mains avec l’élan de joie que l’art authentique suscite toujours chez l’authentique artiste.
– C’est formidable ! cria-t-il. Merveilleux ! Mais je suis surpris, messire, que vous ayez fait courir tant de dangers à ce chef-d’œuvre en le transportant de nuit au milieu de la foule !
– J’ai été trop téméraire ! convint l’artiste. Un peu de vin de Florence, Tita ! Si vous n’aviez pas été là, je tremble à la pensée de ce qui serait arrivé. Regardez la couleur de la peau : elle est irremplaçable ! Peignez comme vous voulez, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent elle sera brûlée, donc trop foncée, par la chaleur du four, ou au contraire la couleur ne tiendra pas et vous n’aurez qu’un blanc maladif. Là au moins vous voyez les veines, vous devinez le sang qui circule. Oui, diavolo ! Si cette tête avait été cassée, mon cœur n’aurait pas résisté. Elle est destinée à la fenêtre du chœur de l’église de Saint-Rémi, et nous étions allés voir, ma petite aide et moi, si sa taille correspondait à la maçonnerie. La nuit est tombée avant que nous ayons terminé notre vérification ; que pouvions-nous faire, sinon la ramener ici ? Mais dites-moi, jeune seigneur ! Vous parlez comme si vous connaissiez les arts ?
– Si peu que j’ose à peine ouvrir la bouche en votre présence, répondit Alleyne. J’ai été élevé dans un couvent où je n’avais pas de peine à manier le pinceau mieux que mes frères novices.
– Voici des couleurs, un pinceau et du papier, dit le vieillard. Je ne vous donne pas de verre car la peinture sur verre est un art spécial qui requiert beaucoup d’habileté dans le mélange des couleurs. Je vous en prie, montrez-moi ce que vous savez faire. Merci, Tita ! Les verres de Venise, cora mia, et remplis-les jusqu’au bord. Asseyez-vous, signor !
Pendant que Ford conversait avec Tita, l’artiste examina avec soin la tête de son saint ; il avait peur qu’une éraflure ne l’eût abîmée. Quand il la reposa, Alleyne avait, en quelques hardis coups de pinceau, dessiné un buste féminin sur la feuille de papier blanc.
– Diavolo ! s’exclama le vieil artiste. Vous avez le don. Oui, cospetto ! Vous avez du talent. C’est une figure d’ange.
– Mais c’est la demoiselle Maude Loring ! s’écria Ford stupéfait.
– Tiens, il y a une vague ressemblance ! fit Alleyne un peu confus.
– Ah ! c’est un portrait ? Tant mieux ! Jeune homme, je suis Agostino Pisano, le fils d’Andrea Pisano, et je vous répète que vous avez le don. Mieux : je déclare que si vous restez auprès de moi, je vous initierai à tous les secrets des vitraux : les couleurs et leur densité, celles qui s’amalgameront avec le verre et celles qui ne s’amalgameront pas, la cuisson et le vernissage… toutes les méthodes et les recettes que vous devez connaître !
– Je serais très heureux d’étudier sous un maître tel que vous, répondit Alleyne. Mais j’ai juré de suivre mon seigneur jusqu’à la fin de la guerre.
– La guerre ! s’écria le vieil Italien. Toujours ce mot qui revient ! Mais vos grands hommes, que sont-ils ? Je les connais bien : des soldats, des destructeurs, des massacreurs ! Mais nous, per Baccho nous avons en Italie de véritables grands hommes ! Les vôtres démolissent, dépouillent ; eux reconstruisent, restaurent. Ah, si vous pouviez voir ma chère Pise, son dôme, le cloître de Campo Santo, le haut campanile avec le moelleux battement de ses cloches dans l’air chaud de l’Italie ! Voilà des œuvres de grands hommes ! Et je les ai vus de mes propres yeux, moi qui vous parle. J’ai vu Andrea Orcagna, Taddeo Gaddi, Giottino, Stefano, Simone Memmi : tous des maîtres dent je ne serais pas digne de mélanger les couleurs. J’ai vu aussi le vieux Giotto, et Giotto avait été l’élève de Cimabuë, avant qui l’art n’existait pas en Italie puisqu’on avait fait venir des Grecs pour peindre la chapelle des Gondi à Florence. Ah, signori, voilà les grands hommes dont il faut honorer le nom, et non vos soldats qui se sont révélés les ennemis du genre humain !
– Ma foi, messire, intervint Ford, les soldats ont bien leur utilité, aussi ! Comment ces gentilshommes dont vous avez cité les noms pourraient-ils préserver leurs œuvres s’ils n’étaient pas protégés par des soldats ?
– Mais toutes celles-ci ? interrogea Alleyne. Est-ce vous qui les avez exécutées ? Et à quoi sont-elles destinées ?
– Oui, signor, elles sont toutes de ma main. Certaines sont peintes, comme vous pouvez le voir, sur une seule feuille de verre ; d’autres l’ont été sur plusieurs feuilles qui peuvent être fixées ensemble. Voyez cette rosace, inspirée de l’église de la Sainte-Trinité à Vendôme, et cet autre vitrail « La découverte du Graal », pour l’abside de l’église de l’abbaye. Il fut un temps où mes compatriotes étaient les seuls à peindre sur verre. Mais en France à présent Clément de Chartres et d’autres sont de grands artistes. Ah ! voilà cette langue d’airain qui nous interdit d’oublier, ne fût-ce qu’une heure, que c’est le bras du sauvage et non la main du maître-artiste qui gouverne le monde.
Une sonnerie de bugles avait en effet retenti dans la rue pour rassembler une escorte quelconque.
– C’est le signal pour nous aussi, dit Ford. Je préférerais rester ici parmi tant de beautés…
Il décocha un regard vif dans la direction de Tita qui rougit.
– … Mais il faut que nous rentrions à l’hôtellerie de notre maître avant qu’il soit lui-même de retour.
Après avoir promis de revenir, les deux écuyers prirent congé du vieil artiste italien et de sa fille. Les rues étaient à présent presque vides, la pluie avait cessé ; aussi quittèrent-ils sans encombre la rue du Roi où habitaient leurs nouveaux amis pour se rendre rue des Apôtres où était située l’hôtellerie de la « Demi-Lune ».
CHAPITRE XXII
Une soirée avec les archers à la « Rose de Guyenne »
– Mon Dieu, Alleyne ! As-tu déjà vu plus beau visage ? s’écria Ford à peine la porte refermée. Si pur, si paisible, si merveilleux.
– C’est vrai. Et la couleur de peau la plus parfaite au monde. As-tu remarqué aussi le rouleau des cheveux sur le front ?
– Et ces yeux ! Limpides, tendres ! Bien clairs et cependant si pleins de choses !
– S’il y avait un petit défaut, dit Alleyne, je le verrais dans le menton.
– Non. Je n’ai remarqué aucun défaut.
– Il est bien arrondi, c’est vrai.
– Très délicatement arrondi.
– Et pourtant…
– Pourtant quoi, Alleyne ? Trouverais-tu une tache sur le soleil ?
– Vois-tu, Ford, je crois que l’expression et la puissance du visage auraient été renforcées par une longue barbe fleurie.
– Sainte Vierge ! cria Ford. Il est fou ! Une barbe sur le visage de la petite Tita !
– Tita ? Qui parlait de Tita ?
– Qui parlait de quelqu’un d’autre ?
– C’était du portrait de saint Rémi, Ford, que je parlais.
– En vérité tu es, s’exclama Ford en riant, un Goth, un Hun, et un Vandale, plus tous les autres noms de barbares dont le vieillard nous a gratifiés ! Comment peux-tu ne penser qu’à un frottis de couleurs, alors qu’il y avait à côté de toi un tableau peint par Dieu lui-même ? Mais que nous veut celui-ci ?
– S’il vous plaît, messires, dit un archer qui courait vers eux, Aylward et les autres seraient heureux de vous voir. Ils sont là-dedans. Il m’a prié de vous dire que le seigneur Loring n’aura pas besoin de vos services ce soir, car il dort chez le seigneur Chandos.
– Ma foi, observa Ford, nous n’avions pas besoin d’un guide pour deviner leur présence dans les parages.
D’une taverne sur la droite s’élevait en effet un chœur rugissant, ponctué de rires et de battements de pieds. Il passèrent sous une porte basse, descendirent un couloir mal pavé et arrivèrent dans une longue salle étroite éclairée par deux torches placées aux extrémités. Des bottes de paille avaient été disposées le long des murs ; vautrés sur elles vingt ou trente archers débraillés étaient allongés. Chaque homme avait à côté de lui son gobelet de bière ; dans un coin un fût percé était plein de promesses pour l’avenir. Autour du fût, assis sur des caisses, des boîtes et des escabeaux, étaient réunis Aylward, John, Black Simon et trois sous-officiers ainsi que le maître-marinier Goodwin Hawtayne qui avait quitté sa cogghe jaune pour boire une dernière tournée avec ses amis de la Compagnie. Ford et Alleyne s’assirent entre Aylward et Black Simon ; leur entrée n’avait nullement interrompu le vacarme qui régnait dans la salle.
– De la bière, mes camarades ? proposa l’archer. Ou préférez-vous du vin ? Vous aurez l’un ou l’autre. Ici, Jacques, fils du diable ! Apporte un flacon de ton plus vieux vin et prends garde à ne pas le secouer. Connaissez-vous la nouvelle ?
– Non, répondirent les deux écuyers.
– Nous allons assister à un beau tournoi.
– Un tournoi ?
– Oui, les enfants. Le captal de Buch a juré qu’il trouverait de ce côté-ci de l’eau cinq chevaliers qui désarçonneraient cinq Anglais, n’importe lesquels. Chandos a relevé le défi, et le Prince a promis un vase d’or à celui qui se comporterait le mieux. Toute la cour en parle !
– Pourquoi les chevaliers accaparent-ils le sport ? grommela Hordle John. Ils n’ont donc pas cinq archers à mettre en ligne pour défendre l’honneur de l’Aquitaine et de la Gascogne ?
– Ou cinq hommes d’armes ! approuva Black Simon.
– Mais qui sont les chevaliers anglais ? s’enquit Hawtayne.
– Il y en a trois cent quarante et un dans la ville, répondit Aylward. On m’a assuré que déjà trois cent quarante cartels et défis étaient parvenus ; le seul manquant est Sir John Ravensholme, qui est au lit avec des suées et qui ne peut pas mettre un pied par terre.
– J’en ai entendu parler par les archers de la garde, cria l’un des soldats allongés sur la paille. Ils disaient que le Prince voulait courir une lance, mais que Chandos s’y était opposé, car les joutes seront rudes.
– Alors il y a Chandos.
– Non. Le Prince ne le lui a pas permis. Il sera maréchal de la lice, ainsi que Sir William Felton et le duc d’Armagnac. Les Anglais seront représentés par Lord Audley, Sir Thomas Percy, Sir Thomas Wake, Sir William Beauchamp et notre bon et brave seigneur et maître.
– Hurrah pour Sir Nigel, et que Dieu soit avec lui ! cria-t-on dans la salle. C’est un honneur que de tirer à l’arc à son service !
– Vous avez raison, dit Aylward. Par les os de mes dix doigts, si vous marchez derrière le pennon des cinq roses vous avez une bonne chance de voir tout ce qu’un bon archer a envie de voir. Ah oui, mes garçons, vous riez ? Mais par ma garde, vous ne rirez pas toujours quand vous vous trouverez là où il vous mènera, car on ne peut jamais savoir quel genre de vœu il s’est juré d’accomplir ! J’ai vu qu’il avait posé une mouche sur son œil : ou je me trompe fort, ou cette mouche fera répandre du sang !
– Comment les choses se sont-elles passées à Poitiers, bon maître Aylward ? interrogea l’un des jeunes archers en regardant respectueusement le vieux soldat.
– Oui, Aylward, raconte ! insista Hordle John.
– À la santé du vieux Samkin Aylward ! crièrent plusieurs voix dans le fond de la salle.
Les gobelets s’agitèrent avec frénésie.
– Demandez-le-lui ! répondit modestement Aylward en désignant Black Simon. Il en a vu plus que moi. Et pourtant, par les saints clous, je crois avoir presque tout vu !
– Ah oui, fit Simon en secouant la tête, ce fut un grand jour ! Je ne crois pas en revoir un semblable. Il y avait quelques archers magnifiques qui ont tiré ce jour-là leur dernière flèche. Nous ne verrons jamais leurs pareils, Aylward !
– Non, par ma garde ! Il y avait le petit Robby Withstaff, et Andrew Salblaster, et Wat Alspaye qui rompit le cou du Germain. Mon Dieu, quels hommes c’étaient ! On pouvait leur demander n’importe quoi, de tirer long ou court, droit ou plongeant : jamais archers ne furent plus experts dans l’art de la flèche !
– Mais la bataille, Aylward ! La bataille !
– Laissez-moi remplir mon gobelet d’abord, les enfants, car un récit comme celui-là donne soif. C’est lorsque tombèrent les premières feuilles que le Prince se mit en route : il traversa l’Auvergne, le Berry, l’Anjou et la Touraine. En Auvergne les filles sont jolies, mais le vin est aigre. Dans le Berry ce sont les filles qui sont aigres et le vin riche. L’Anjou est un merveilleux pays pour les archers, car le vin et les femmes vont de pair. En Touraine je n’ai rien gagné sauf des coups sur ma caboche ; mais à Vierzon j’ai eu de la chance : j’ai obtenu un ciboire d’or de la cathédrale, et j’en ai tiré neuf ducats gênois chez l’orfèvre de la rue du Mont-Olive. De là nous sommes allés à Bourges, où j’ai conquis une tunique de soie couleur de feu et une très belle paire de souliers avec des glands de soie et des clous d’argent.
– Dans une boutique, Aylward ? interrogea un jeune archer.
– Non, mon garçon, je les ai retirés aux deux pieds d’un homme. J’avais quelques raisons de croire qu’il n’en aurait plus jamais besoin, puisqu’il avait dans le dos une flèche d’un mètre de long.
– Et ensuite, Aylward ?
– Nous sommes repartis, l’ami, environ six mille, en direction d’Issoudun ; et là il nous est arrivé quelque chose de sensationnel.
– Une bataille, Aylward ?
– Non, beaucoup mieux qu’une bataille. Il y a peu à gagner dans une bataille, si l’on n’a pas la chance de capturer un noble et d’en obtenir rançon. À Issoudun, moi et trois Gallois nous avons découvert une maison que les autres avaient dédaignée, et nous en avons eu tout le profit pour nous seuls. En ce qui me concerne, je me suis octroyé un splendide lit de plumes ; croyez-moi : il vous faudra voyager longtemps en Angleterre avant d’en trouver un comme celui-là ! Tu l’as vu, Alleyne, et toi aussi, John : n’est-ce pas un lit somptueux ? Nous l’avons mis sur le mulet d’une cantinière, et il a suivi l’armée. J’avais dans l’idée que je ferais de bons sommes dessus quand je m’établirais chez moi, et il est maintenant en sécurité du côté de Lyndhurst.
– Et ensuite, maître-archer ? demanda Hawtayne. Par saint Christophe, c’est en vérité une belle et bonne vie que tu as choisie là ! Tu ramasses ton butin comme le pêcheur ramasse ses langoustes, sans rien demander à personne.
– Tu as raison, maître-marinier ! fit un vieil archer. Un ancien dicton chez nous assure que la deuxième plume d’une oie sauvage est meilleure que la penne d’une oie domestique. Continue, vieux garçon !
– Nous avons donc repris la route, dit Aylward après avoir puisé une longue rasade dans son gobelet. Nous étions six mille avec le Prince et ses chevaliers et le lit de plumes au centre sur le mulet. Nous avons fait beaucoup de dégâts en Touraine, puis nous sommes arrivés à Romorantin où j’ai mis la main sur une chaîne en or et deux bracelets de jaspe, qui m’ont été volés le même jour par une fille des Ardennes aux yeux de feu. Mon Dieu ! Il y a des gens qui n’ont pas peur du Jugement dernier, et qui ne respectent rien : toujours leurs doigts crochus sur les biens d’autrui !
– Mais la bataille, Aylward ! crièrent les archers en riant.
– J’y arrive, jeunes foudres de guerre ! Hé bien donc, le Roi de France nous avait suivis avec cinquante mille hommes, et il se hâtait de nous rattraper ; mais quand il nous eut rejoints, il se demanda quoi faire, car nous étions si bien retranchés derrière des vignobles et des haies que les Français ne pouvaient nous approcher que par un chemin étroit. Des deux côtés de ce chemin se tenaient des archers, des hommes d’armes et les chevaliers derrière ; au centre, nos bagages, y compris mon lit de plumes à dos de mulet. Trois cents chevaliers d’élite se lancèrent à l’assaut. Vraiment c’étaient des braves ! Mais ils furent accueillis par une telle volée de flèches que bien peu en réchappèrent. Puis nous eûmes à soutenir le choc des Germains : eux aussi se battirent très vaillamment, puisque quelques-uns franchirent la ligne des archers et pénétrèrent dans nos lignes jusqu’à mon lit de plumes, peut-être pour le reprendre. Alors notre petit chef s’élança, puis Lord Audley avec ses quatre écuyers du Cheshire, ainsi que quelques autres du même calibre, et derrière eux le Prince et Chandos, et puis nous tous l’épée ou la hache à la main, car nous n’avions plus de flèches. Ma foi, c’était assez imprudent ! Nous étions sortis des haies et il ne restait plus personne pour garder nos bagages. S’ils nous avaient tournés !… Mais tout se termina bien. Le Roi fut fait prisonnier. Le petit Robby Withstaff et moi, nous tombâmes sur un chariot qui contenait quinze tonnelets de vin pour la table personnelle du Roi. Par ma garde, ne me demandez pas la suite ! Je serais bien incapable de vous la dire, et le petit Robby Withstaff pas davantage.
– Et le lendemain ?
– Ma foi, nous ne nous sommes pas attardés ! Nous sommes remontés sur Bordeaux, où nous sommes arrivés sains et saufs avec le Roi de France et le lit de plumes. J’ai vendu mon butin, mes garçons, pour autant de pièces d’or que ma bourse pouvait en contenir, et pendant sept jours j’ai allumé douze cierges sur l’autel de saint André. Car si vous oubliez les saints quand tout va bien, ils vous oublieront le jour où vous aurez besoin d’eux. J’en suis à cent dix-neuf livres de cire pour saint André ; comme c’était un homme très juste, je suis sûr que j’aurai bon poids et bonne mesure quand j’aurai besoin de son aide.
– Dis-moi, maître Aylward, cria un jeune archer, et pourquoi cette grande bataille ?
– Pourquoi, maître fou ? Tout simplement pour savoir qui ceindrait la couronne de France !
– Je croyais que c’était peut-être pour savoir qui coucherait dans ton lit de plumes…
– Si je me lève, Silas, tu pourrais bien recevoir ma ceinture sur les épaules ! répondit Aylward sous les rires. Mais voici l’heure où les jeunes poulets grimpent sur leurs perchoirs au lieu de caqueter contre leurs aînés. Il est tard, Simon.
– Non. Encore une autre chanson !
– Arnold de Sowley chante bien…
– Non, en voici un dont la voix ne le cède à personne, fit Hawtayne en posant une main sur l’épaule du gros John. Je l’ai entendu sur la cogghe : on dirait les vagues sur une plage. S’il te plaît, ami, chante-nous « Les cloches de Milton » ou, si tu préfères, « La fille du laboureur ».
Hordle John se redressa, fixa du regard un angle du plafond et entonna, d’une voix qui fit vaciller les torches, la ballade du Sud qui lui avait été demandée.
Le laboureur a dû partir se louer,
La fille du laboureur est restée à la maison.
Mais elle est timide et modeste et sage ;
Qui pourrait conquérir la fille du laboureur ?
Survint un chevalier de grand renom
En bassinet et camail ;
À genoux longtemps il la pria ;
Il ne put conquérir la fille du laboureur.
Survint un écuyer très débonnaire,
Richement vêtu et parlant joliment ;
Il chantait bien, jouait juste :
Il ne put pas conquérir la fille du laboureur.
Survint un marchand magnifique
Avec toque de velours et robe de drap fin ;
Malgré tous ses navires, tout son argent,
Il ne put pas acheter la fille du laboureur.
Survint un archer hardi et loyal,
Avec brassard et arc en bois d’if ;
Sa bourse était légère, son justaucorps usé ;
Haro, hélas ! La fille du laboureur !
Oh ! certains ont ri, d’autres ont crié,
Et quelques-uns ont battu la campagne ;
Mais ils sont partis ensemble à travers bois et clairières,
L’archer et la fille du laboureur.
Un grondement de joie s’éleva de l’assistance qui trépigna et brandit les gobelets. Visiblement la chanson avait plu, John se plongea dans un pot qu’il assécha en quelques lampées.
– Je chantais cet air-là à l’auberge de Hordle bien avant de penser qu’un jour je serais archer ! dit-il.
– Remplissez vos gobelets ! cria Black Simon en donnant l’exemple. Buvons une dernière fois à la Compagnie Blanche, et à tous les braves garçons qui marchent derrière les roses de Loring !
– Au bois, au lin, et à l’aile de jars ! dit un vieil archer à barbe grise.
– À une guerre sanglante ! cria un troisième. Que beaucoup partent et que peu reviennent !
– Avec beaucoup d’or pour la meilleure lame ! ajouta un quatrième.
– La dernière tournée à la fille de notre cœur ! cria Aylward.
Ils sortirent en criant, plaisantant, chantant ; et tout redevint paisible à la « Rose de Guyenne ».
CHAPITRE XXIII
Comment se comporta l’Angleterre sur la lice de Bordeaux
Les braves Bordelais étaient si habitués aux sports de la chevalerie et aux exhibitions martiales qu’une joute ou un tournoi ordinaire était pour eux d’une banalité quotidienne. La renommée et l’éclat de la cour du Prince avaient attiré sur les bords de la Garonne les chevaliers errants et les poursuivants d’armes de tous les pays d’Europe. Sur le long champ clos près du fleuve, à la porte du nord, de nombreux combats extraordinaires avaient eu lieu, par exemple quand des chevaliers teutoniques, frais émoulus de la conquête de la Prusse païenne, affrontèrent les chevaliers de Calatrava endurcis par leur lutte incessante contre les Maures, ou quand des gentilshommes du Portugal rompirent des lances avec des guerriers scandinaves descendus du pays le plus septentrional. Bien des pennons étrangers arborant des blasons des rives du Danube, des forêts sauvages de Lituanie et des châteaux forts de Hongrie avaient flotté au vent de la Gascogne. La chevalerie en effet n’était pas l’apanage d’un pays ni d’une race.
Toutefois une grande fièvre s’empara de la ville quand il fut annoncé que le troisième mercredi de l’Avent cinq chevaliers d’Angleterre tiendraient la lice contre n’importe quels adversaires. Le grand rassemblement des nobles et des soldats célèbres, le caractère national du défi, le fait qu’il s’agissait d’une dernière épreuve avant ce qui promettait d’être une guerre difficile et meurtrière, tout concordait pour faire de l’événement l’un des plus exceptionnels et des plus brillants que Bordeaux eut jamais vus. La veille du tournoi, les paysans affluèrent de tout le Médoc ; au-delà des remparts les champs étaient couverts des tentes blanches qui abritaient ceux qui n’avaient pu trouver de logement plus chaud. Du camp de Dax aussi, et de Blaye, de Bourg, de Libourne, de Saint-Émilion, de Castillon, de Saint-Macaire, de Cadillac, de Rions, et de toutes les villes florissantes qui considéraient Bordeaux comme leur mère, coula un flot ininterrompu de cavaliers et de piétons qui se dirigeaient tous vers la grande cité. Au matin du jour où les lances devaient être courues, il n’y avait pas moins de quatre-vingt mille personnes réunies autour de la lice et le long de la crête herbeuse qui dominait le champ clos.
On imagine aisément les difficultés qu’il fallut vaincre pour choisir, entre tant de gentilshommes réputés, les cinq qui, dans chaque camp, devaient avoir la préséance sur les autres. Pour annuler une vingtaine de duels provoqués par les rivalités et le dépit après la sélection des élus il ne fallut rien de moins que l’autorité du Prince et la ténacité des barons plus âgés.
La veille du tournoi les écus furent enfin suspendus pour l’inspection des hérauts et des dames : tout le monde devait en effet connaître les noms des champions et avoir la possibilité de dénoncer le moindre méfait ou crime qui aurait entaché l’honneur de l’un d’eux ; tout chevalier convaincu d’une faute contre l’honneur aurait été disqualifié et n’aurait pu prendre part à une cérémonie aussi noble et aussi honorable.
Sir Hugh Calverley et Sir Robert Knolles n’étaient pas encore rentrés de leur mission dans les marches de Navarre ; le camp anglais se trouva donc privé de deux de ses lances les plus fameuses. Il restait pourtant tellement de noms réputés que Chandos et Felton, à qui avait été dévolu le rôle de sélectionneurs, tinrent de nombreuses conférences ; les faits d’armes, les succès et les échecs de chaque candidat furent soigneusement mis en balance. Lord Audley du Cheshire, le héros de Poitiers, et Loring du Hampshire, qui passait pour la deuxième meilleure lance de l’armée, furent désignés sans contestation possible. Puis, parmi les plus jeunes, Sir Thomas Percy du Northumberland, Sir Thomas West du Yorkshire et Sir William Beauchamp du Gloucestershire furent finalement choisis pour soutenir l’honneur de l’Angleterre. Dans l’autre camp il y avait le captal de Buch, le sire Olivier de Clisson, le sire Perducas d’Albret, le baron de Mussidan et Sigismond von Altenstat, chevalier de l’Ordre Teutonique. Chez les Anglais les vieux soldats secouaient la tête en contemplant les écus de ces guerriers, qui avaient tous passé leur vie en selle : la bravoure et la force pèseraient peu contre l’expérience et la science de la guerre.
– Ma foi, Sir John, s’écria le Prince tandis qu’il se rendait au tournoi, j’aurais été satisfait de courir une lance aujourd’hui. Vous m’avez vu tenir la lance depuis que j’en ai eu la force, et vous devriez savoir que je mérite une place dans cette honorable société.
– Personne ne se tient mieux en selle et n’est plus habile à la lance, monseigneur ! approuva Chandos. Mais, si je puis m’exprimer ainsi sans vous offenser, il n’était pas correct que vous vous exposassiez dans ce concours.
– Et pourquoi, Sir John ?
– Parce que, monseigneur, ce n’est pas votre rôle de prendre parti pour les Gascons contre les Anglais, ni pour les Anglais contre les Gascons, étant donné que vous êtes le maître des Anglais et des Gascons. Nous ne sommes que médiocrement aimés des Gascons maintenant, et nous ne sommes plus liés avec eux que par l’anneau doré de votre couronne princière. Si cet anneau se rompt, je me demande ce qui s’ensuivra.
– Se rompre, sir John ! s’écria le Prince dans les yeux duquel s’alluma une lueur mauvaise. Quelle manière de parler est-ce là ? Vous vous exprimez comme si l’allégeance de nos peuples pouvait se rejeter comme le capuchon d’un faucon.
– Avec une haridelle on utilise le fouet et l’éperon, monseigneur ; mais avec un pur-sang un bon cavalier est doux et gentil : il cajole plus qu’il ne châtie. Ce peuple est bizarre : il faut que vous conserviez son affection, même pour ce qu’elle vaut maintenant, car vous obtiendrez de ses sentiments ce que tous les pennons de votre armée seraient impuissants à lui arracher de force.
– Vous êtes bien grave aujourd’hui, John ! répondit le Prince. Gardons ces questions pour notre chambre du conseil. Mais dites-moi, mes frères d’Espagne et de Majorque, ce que vous pensez de ce défi.
– J’aime les belles joutes, dit Don Pedro qui chevauchait avec le Roi de Majorque à la droite du Prince, tandis que Chandos était à sa gauche. Par saint Jacques de Compostelle, mais les bourgeois supporteraient de nouveaux impôts ! Regardez ce drap et ce velours que ces canailles portent sur le dos. Ma foi, s’ils étaient mes sujets, je ne laisserais pas la laine pousser ainsi sans la tondre !
– Nous sommes fiers, répondit froidement le Prince, de régner sur des hommes libres et non sur des esclaves.
– Chacun son goût, fit Pedro avec insouciance. Carajo ! Quel doux visage à cette fenêtre ! Don Fernando, je vous prie de noter la maison, pour que cette jeune fille nous soit amenée à l’abbaye.
– Non, mon frère, non ! s’écria le Prince impatienté. J’ai déjà eu l’occasion de vous dire et de vous redire qu’en Aquitaine les choses ne se passaient pas ainsi.
– Mille pardons, cher ami ! répondit vivement l’Espagnol qui avait remarqué que le rouge de la colère était monté aux joues brunies du Prince. Vous avez si courtoisement aménagé mon exil que je me crois chez moi et que j’oublie parfois que je ne suis pas encore de retour en Castille. Chaque pays a bien entendu ses mœurs et usages ; mais je vous promets, Édouard, que lorsque vous serez mon hôte à Tolède ou à Madrid vous ne soupirerez pas en vain après n’importe quelle fille sur laquelle vous auriez jeté les yeux.
– Votre langage, sire, répliqua le Prince avec froideur, n’est pas celui que j’aime entendre habituellement tomber de vos lèvres. Je n’ai pas le goût de ce genre d’amours, et j’ai fait le serment que mon nom ne serait accouplé qu’avec celui de ma chère épouse.
– Toujours le miroir fidèle de la chevalerie ! s’exclama Pedro.
Jayme de Majorque, effrayé de la réprobation qu’exprimait leur protecteur tout-puissant tira fortement sur la manche de son frère d’exil.
– Prenez garde, cousin ! lui chuchota-t-il. Pour l’amour de la Vierge prenez garde ! vous l’avez fâché.
– Peuh, ne craignez rien ! répondit l’autre sur le même ton. Si je rate une courbette, je me rattrape aussitôt. Tenez, vous allez voir… Beau cousin, poursuivit-il en se tournant vers le Prince, je vois de magnifiques hommes d’armes et des archers luisants de santé. Il doit être bien difficile de rivaliser avec eux.
– Ils ont voyagé loin, sire, mais jamais ils n’ont trouvé de rivaux à leur taille.
– Et ils n’en trouveront jamais, j’en suis sûr ! Quand je les regarde, il me semble que j’ai déjà reconquis mon trône. Mais dites-moi, cher cousin, que ferons-nous après avoir chassé du royaume ce bâtard d’Henri ?
– Ensuite ? Nous contraindrons le Roi d’Aragon à placer notre bon ami et frère Jayme de Majorque sur le trône.
– Noble Prince ! Généreux Prince ! cria le petit monarque.
– Cela fait, ajouta le Roi Pedro en lançant un coup d’œil oblique vers le jeune conquérant, nous unirons les forces de l’Angleterre, de l’Aquitaine, de l’Espagne et de Majorque. Il serait honteux qu’une telle coalition n’accomplisse pas de grandes choses !
– Vous parlez vrai, mon frère ! s’écria le Prince dont le regard s’adoucit à cette perspective. À mon avis, nous ne pourrions mieux plaire à Notre-Dame qu’en chassant les Maures païens de votre pays.
– Je suis avec vous, Édouard, aussi fidèle et loyal que la garde à sa lame. Mais par saint Jacques, nous ne permettrons pas aux Maures de se moquer de nous de l’autre côté de la mer. Il nous faudra équiper une flotte et débarquer en Afrique pour les en expulser.
– Oui, par le Ciel ! s’exclama le Prince. Le rêve de mon cœur est que nos pennons anglais flottent sur le mont des Oliviers, et que les lions et les lis protègent la cité sainte.
– Et pourquoi pas, cher cousin ? Vos archers ont libéré la route de Paris ; pourquoi pas celle de Jérusalem ? Une fois là-bas vous pourriez vous reposer.
– Non, il y a davantage à faire ! murmura le Prince emporté par l’ambition de ses projets. Il reste à conquérir la ville de Constantin, à gagner la guerre contre le sultan de Damas. Plus loin, il faudrait lever un tribut sur le Khan de Tartarie et sur le royaume de Cathay. Qu’en dites-vous, John ? Ne pouvons-nous avancer vers l’est aussi loin que Richard Cœur de Lion ?
– Le vieux John restera ici, monseigneur, répondit le vétéran. Sur mon âme, aussi longtemps que je serai connétable de l’Aquitaine, je ne manquerai pas d’ouvrage pour garder les marches que vous m’avez confiées ! Ce serait pour le Roi de France un beau jour que celui où il apprendrait que la mer nous sépare de lui.
– Sur mon âme, John, je ne vous connaissais pas traînard ! dit le Prince.
– Le limier qui aboie, monseigneur, n’est pas toujours le premier à l’hallali, répliqua le vieux chevalier.
– Non, mon fidèle ! Je vous ai trop souvent éprouvé pour l’ignorer. Mais, ma foi, je ne me rappelle pas avoir vu une foule pareille depuis le jour où nous avons fait descendre Cheapside au Roi Jean !
De fait, toute la vaste plaine était noire de monde, des vignobles jusqu’au fleuve. Par la porte du nord, le Prince et ses compagnons contemplèrent cette mer de têtes, éclairée ici et là par les capelines colorées des femmes ou par les casques étincelants des archers et des hommes d’armes. Au centre de cet immense rassemblement, la lice paraissait n’être qu’une étroite bande de gazon délimitée par des bannières et des oriflammes ; aux deux extrémités, des taches blanches surmontées de pennons indiquaient l’emplacement des tentes-marquises qui servaient de vestiaires aux combattants. Un chemin avait été dégagé entre la porte de la ville et les tribunes qui avaient été érigées pour la cour et la noblesse. Acclamé par la multitude, le Prince s’y engagea au petit galop ; il était suivi des deux Rois, de ses grands officiers de l’État, et d’une interminable escorte de seigneurs et de dames, de courtisans, de conseillers, de soldats ; les panaches s’agitaient ; les joyaux miroitaient ; les soies chatoyaient ; l’or ruisselait sur les robes et les uniformes ; la richesse du décor dépassait l’imagination. L’avant-garde de la cavalcade avait atteint la lice avant que l’arrière eût franchi la porte de la cité : c’est qu’en effet les plus jolies femmes et les hommes les plus braves étaient venus de toutes les vastes régions arrosées par la Dordogne et la Garonne. On pouvait reconnaître au passage des gentilshommes du Sud brunis par le soleil, des guerriers farouches de la Gascogne, de gracieux courtisans originaires du Limousin ou de la Saintonge et des jeunes sportifs d’Angleterre qui avaient traversé l’Océan. On y admirait aussi les splendides brunettes de la Gironde, dont le regard surpassait en éclat celui des bijoux, et que côtoyaient leurs sœurs blondes d’outre-Manche au visage aquilin, enveloppées d’hermine et de duvet de cygne car l’air était vif bien que le soleil fût clair.
Les chevaux furent confiés aux valets de service ; les seigneurs et les dames prirent place dans les tribunes qui bordaient chaque côté du champ clos et qui étaient décorées de tapisseries, de velours et d’armoiries.
Les tenants de la lice occupaient l’extrémité la plus proche de la porte de la cité. Là, devant leurs tentes respectives, flottaient les merlettes d’Audley, les roses de Loring, les barres écarlates de Wake, le lion de Percy, et les ailes d’argent de Beauchamp ; chaque pennon était porté par un écuyer vêtu d’une étoffe verte symbolisant un triton ; dans sa main gauche il tenait un énorme coquillage. Derrière les tentes les grands destriers tout harnachés mâchonnaient leurs mors et piaffaient, tandis que leurs maîtres étaient assis devant leur porte, le heaume sur les genoux, et discutaient paisiblement du programme de la journée. Les hommes d’armes et les archers anglais étaient rassemblés aux deux bouts de la lice ; mais bien plus nombreux étaient les spectateurs qui accordaient leurs faveurs au camp des attaquants, car la popularité des Anglais avait décliné depuis l’âpre querelle qui s’était élevée au sujet du Roi de France après la bataille de Poitiers. Voilà pourquoi les applaudissements furent clairsemés quand le héraut d’armes proclama, après une sonnerie de trompettes, les noms et titres des chevaliers qui étaient disposés, pour l’honneur de leur pays et l’amour de leurs dames, à tenir le champ contre tous ceux qui pourraient leur faire la faveur de courir une lance avec eux. Par contre un tonnerre d’ovations accueillit le héraut de l’autre camp quand, s’avançant de l’extrémité la plus éloignée de la lice, il annonça les titres bien connus des cinq fameux guerriers qui avaient relevé le défi.
– Je crois, John, fit le Prince, que tout à l’heure vous aviez raison. Ah, cher duc d’Armagnac, il me semble que nos amis des environs ne seraient pas contrariés si les champions anglais étaient aujourd’hui battus !
– C’est possible, monseigneur, répondit le noble gascon. Je ne doute d’ailleurs pas qu’à Smithfield ou à Windsor une foule anglaise ne favorise ses compatriotes.
– Par ma foi, c’est vérifiable ici même ! dit le Prince en riant. Quelques douzaines d’archers anglais s’égosillent là-bas, comme s’ils voulaient crier plus fort que cette foule innombrable. Je crains qu’ils n’aient pas beaucoup d’occasions de s’enrouer, car mon vase d’or a peu de chances de traverser la mer. Quel est le règlement du tournoi. John ?
– Chaque rencontre se dispute en trois courses si nécessaire, monseigneur, et la victoire finale sera attribuée au camp qui en aura gagné le plus grand nombre ; les combats doivent se poursuivre jusqu’à ce que l’un des deux adversaires prenne l’avantage. Le meilleur des vainqueurs remportera le vase d’or ; le meilleur de l’autre camp recevra une agrafe ornée de bijoux. Commanderai-je aux trompettes de sonner, monseigneur ?
Le Prince acquiesça de la tête. Les trompettes lancèrent vers le ciel pur leurs notes stridentes, et les deux premiers champions s’avancèrent à cheval pour se trouver face à face au centre de la lice. Sir William Beauchamp s’inclina devant la lance exercée du captal de Buch, Sir Thomas Percy prit l’avantage sur le baron de Mussidan, et Lord Audley fit tomber le sire d’Albret de sa selle. Le robuste de Clisson, toutefois, raffermit les espoirs des attaquants en expédiant à terre Sir Thomas West du Yorkshire. Jusque-là, il était difficile de trancher en faveur de l’un ou l’autre camp.
– Par saint Jacques de Santiago ! s’exclama Don Pedro dont les joues pâles avaient pris un peu de couleur. Gagnera qui pourra, mais c’est une belle lutte !
– Qui se présente maintenant pour l’Angleterre, John ? s’enquit le Prince dont la voix tremblait d’excitation.
– Sir Nigel Loring du Hampshire, monseigneur.
– Ah ! C’est un homme d’un grand courage, et habile à se servir de n’importe quelle arme.
– En effet, monseigneur. Mais ses yeux, comme les miens, ne valent plus grand-chose pour la guerre. Cependant il peut courir une lance ou pratiquer le combat de près avec un égal bonheur. C’est lui, monseigneur, qui a remporté la couronne d’or que la Reine Philippa, votre royale mère, avait mise en jeu entre tous les chevaliers d’Angleterre après le sac de Calais. J’ai entendu dire qu’au château de Twynham un buffet gémit sous le poids des prix qu’il a gagnés.
– Je prie pour que mon vase leur tienne compagnie ! dit le Prince. Mais voici le gentilhomme germain et, sur mon âme, il donne l’impression d’un homme de grande valeur. Qu’ils courent donc leurs trois courses, car l’issue est trop importante pour dépendre d’une seule.
Tandis que le Prince parlait à Chandos, le dernier des « défiants » s’élança sur la lice ; les trompettes sonnèrent ; les Gascons hurlèrent et trépignèrent. C’était un homme de haute taille revêtu d’une armure noire sans blason ni ornement car le moindre étalage des honneurs de ce monde était interdit par les règles de l’Ordre militaire auquel il appartenait. Aucun panache ne flottait au-dessus de sa salade massive, et sa lance était privée de la flamme habituelle. Une cape blanche se soulevait derrière lui ; sur le côté gauche était dessinée la large croix noire rehaussée d’argent qui était l’emblème bien connu de l’Ordre Teutonique. Monté sur un cheval aussi austère que lui, il avança au petit galop, sans sacrifier aux caracoles et aux fringants exercices qu’affectionnaient les gentilshommes désireux d’exhiber leurs talents de cavalier. Il inclina gravement la tête devant le Prince et prit sa place au bout du champ clos.
À ce moment Sir Nigel sortit de l’enclos réservé aux tenants et galopa d’une course folle sur la lice ; il s’arrêta devant le Prince en imprimant aux rênes une secousse qui rejeta son cheval sur l’arrière-train. Avec son armure blanche, son écu blasonné et un panache de plumes d’autruche sur le casque, il avait l’air si désinvolte et si gai que des applaudissements éclatèrent dans l’assistance. Comme l’aurait fait un invité se hâtant vers un joyeux festival, il inclina sa lance pour saluer et, sans permettre à son cheval de poser sur le sol ses pattes antérieures, il le fit pivoter pour regagner son poste.
Un grand silence tomba sur la foule. Un double enjeu s’attachait au duel des deux champions : leur réputation personnelle et l’honneur de leur camp. Ils étaient l’un et l’autre des guerriers célèbres, mais comme ils avaient accompli leurs prouesses dans des régions diamétralement opposées, ils ne s’étaient encore jamais affrontés. Entre de tels hommes une course aurait soulevé par elle-même un grand intérêt ; celui-ci s’accroissait du fait qu’elle allait décider des vainqueurs de la journée. Pendant un moment ils attendirent. Le Germain était sombre et calme. Sir Nigel frémissait par toutes ses fibres d’une résolution farouche. Enfin, pendant que les spectateurs retenaient leur souffle, le gant tomba de la main du maréchal du tournoi. Couverts d’acier les deux cavaliers se heurtèrent dans un bruit de tonnerre en face de la tribune royale. Le Germain, bien qu’il eût chancelé un instant sous la pointe de l’Anglais, frappa son adversaire sur la visière avec une telle précision que les tourillons cédèrent et que le heaume empanaché vola en éclats : Sir Nigel continua à galoper sur la lice ; son crâne chauve luisait au soleil. Des milliers d’écharpes et de toques s’agitèrent pour annoncer que la première manche avait été gagnée par le camp le plus populaire.
Le chevalier du Hampshire n’était pas homme à se laisser abattre par un revers. Il regagna sa tente et en ressortit un peu plus tard avec un heaume neuf. La deuxième course fut si égale que les juges se refusèrent à départager les deux antagonistes. Chacun fit jaillir des étincelles sur l’écu de l’autre, et tous deux demeurèrent rivés sur leurs chevaux comme des centaures. Dans la reprise finale, Sir Nigel porta un coup si bien dirigé que la pointe de sa lance frappa entre les barres de la visière et arracha le devant du heaume. Le Germain, visant légèrement trop bas et étourdi par le choc, eut la malchance de toucher son adversaire à la cuisse ; non seulement c’était une entorse aux règles du tournoi (entorse qui suffisait pour lui retirer toutes chances de se voir attribuer la victoire) mais encore il risquait de perdre son cheval et son armure si le chevalier anglais les réclamait. Un tonnerre d’applaudissements s’éleva du côté des archers et des hommes d’armes, tandis que le silence de la foule massée autour de la lice annonçait que la balance avait penché du côté des tenants. Déjà les dix champions étaient réunis devant le Prince pour la remise de la récompense, quand une sonnerie de bugle à un bout de la lice attira tous les regards vers un nouvel arrivant imprévu.
CHAPITRE XXIV
Comment un champion surgit de l’est
Le champ clos de Bordeaux était situé, comme nous l’avons expliqué, sur la plaine longeant le fleuve ; vers l’est, cette plaine montait doucement, s’étageait en vignobles. Une route blanche à multiples virages la traversait ; d’habitude fort fréquentée, elle était déserte ce jour-là à cette heure car les joutes avaient littéralement vidé la région de sa population.
Peu après le début du tournoi, si un spectateur avait tourné la tête vers la route, il aurait pu remarquer très loin, très loin, deux points qui scintillaient et miroitaient sous le soleil d’hiver. Moins d’une heure plus tard, ces points s’étaient rapprochés et étaient devenus plus nets : le spectateur se serait rendu compte qu’ils étaient le reflet des casques de deux cavaliers galopant à vive allure dans la direction de Bordeaux. Au bout d’une demi-heure, il aurait distingué plus de détails. Le cavalier de tête était un chevalier revêtu d’une armure complète, et son cheval brun avait une flamme blanche sur le front et le poitrail. Il n’était pas grand, mais la largeur de ses épaules faisait impression ; la visière de son heaume était fermée ; il ne portait aucun blason sur son modeste surcot blanc et sur son écu noir. L’autre, évidemment son écuyer ou quelqu’un à son service, avait pour toute armure un casque sur la tête ; mais il tenait dans sa main droite une lance très longue et très lourde qui appartenait à son maître ; sa main gauche serrait non seulement les rênes de son propre cheval mais encore celles d’un grand destrier noir tout harnaché qui galopait à côté de lui. Finalement ces trois chevaux et les deux cavaliers arrivèrent à l’extrémité du champ clos, et c’était la sonnerie de bugle exécutée par l’écuyer au moment où son maître pénétrait sur la lice qui avait interrompu la distribution des prix et distrait l’attention des spectateurs.
– Ah, John ! s’écria le Prince en se redressant. Qui est ce gentilhomme, et que désire-t-il ?
– Ma parole, monseigneur, répliqua Chandos qui ne cherchait pas à dissimuler sa surprise, je crois que c’est un Français.
– Un Français ! répéta Don Pedro. Et comment pouvez-vous l’affirmer, seigneur Chandos, alors qu’il n’a ni cotte d’armes ni blason ?
– D’après son armure, sire, qui est plus arrondie au coude que celles que l’on fait en Angleterre ou à Bordeaux. Il pourrait être Italien si son bassinet était plus incliné ; mais je jurerais que ces plates ont été soudées entre ici et le Rhin. Voici d’ailleurs son écuyer : nous allons savoir quel curieux hasard l’amène à Bordeaux.
De fait, l’écuyer avait arrêté sa monture devant la tribune du Prince, qu’il salua d’une deuxième sonnerie de bugle ; c’était un homme maigre, au teint basané ; il avait une barbe noire hérissée ; son maintien frisait l’arrogance. Il remit son bugle dans sa ceinture, s’avança entre les deux groupes de chevaliers gascons et anglais, et immobilisa sa monture à une longueur de lance du Prince.
– Je viens, cria-t-il d’une rude voix rauque marquée d’un fort accent breton, en qualité d’écuyer et de héraut de mon maître, qui est un très vaillant poursuivant d’armes, vassal du grand et puissant monarque Charles, Roi de France. Mon maître a appris qu’un tournoi offre ici d’honorables perspectives de distinction. Aussi est-il venu demander si quelque gentilhomme anglais voudrait daigner pour l’amour de sa dame courir une course avec lui à la lance affilée, ou le rencontrer à l’épée, à la masse d’armes, à la hache de bataille ou au poignard. Il m’a prié de préciser toutefois qu’il ne se battrait que contre un véritable Anglais, et non pas contre l’un de ces bâtards qui ne sont ni Anglais ni Français, mais qui parlent la langue des uns et se battent sous la bannière des autres.
– Messire ! cria Olivier de Clisson d’une voix tonnante.
Ses compatriotes portèrent la main à l’épée. Mais l’écuyer ne s’inquiéta nullement de leurs visages irrités et continua à transmettre le message de son maître.
– Il est maintenant prêt, monseigneur, dit-il, bien que son destrier ait galopé de nombreuses lieues aujourd’hui car nous avions peur d’arriver trop tard.
– Vous êtes en effet arrivés trop tard, répondit le Prince, puisque le prix allait être remis. Cependant je ne doute pas que l’un de ces gentilshommes n’accepte de courir une course pour l’honneur avec ce chevalier de France.
– Quant au prix, monseigneur, intervint Sir Nigel, je suis sûr d’être l’interprète de tous en déclarant que ce chevalier français a notre parole de l’emporter s’il parvient à le gagner.
– Communiquez ceci à votre maître, dit le Prince, et demandez-lui lequel de ces cinq Anglais il désire rencontrer. Mais, un instant : votre maître ne porte pas d’armoiries et nous ne savons pas son nom ?
– Mon maître, monseigneur, a fait à la Vierge le vœu de ne pas révéler son nom et de ne pas ouvrir sa visière avant qu’il soit de retour en territoire français.
– Mais quelle assurance avons-nous, fit observer le Prince, qu’il ne s’agit pas d’un valet déguisé ou d’un chevalier ayant forfait à l’honneur et dont la lance est entachée d’infamie ?
– Ce n’est pas cela, monseigneur ! cria l’écuyer. Il n’existe pas d’homme au monde qui dérogerait en courant une lance contre mon maître.
– Vous parlez hardiment, écuyer ! Mais si je ne possède pas une preuve plus valable de la noble origine et de la bonne réputation de votre maître, je ne permettrai pas aux meilleures lances de ma cour de le rencontrer.
– Vous refusez, monseigneur ?
– Je refuse.
– Alors, monseigneur, j’ai été autorisé par mon maître à vous demander si vous reviendriez sur votre refus dans le cas où Sir John Chandos, connaissant le nom de mon maître, vous assurerait qu’il est vraiment un homme avec lequel vous pourriez vous-même croiser l’épée sans déchoir ?
– Je ne demande rien de plus, répondit le Prince.
– Dans ces conditions je dois vous prier, seigneur Chandos, de vous avancer. J’ai votre parole que le nom restera toujours un secret, et que vous ne le prononcerez ni ne l’écrirez pour le trahir ? Ce nom est…
Il se pencha au-dessus de l’encolure de son cheval et murmura quelque chose à l’oreille du vieux chevalier qui sursauta et observa avec une curiosité accrue le nouveau « défiant ».
– Est-ce vraiment lui ? s’exclama-t-il.
– Oui, messire. Je le jure par saint Yves de Bretagne.
– J’aurais pu le deviner, fit Chandos en tortillant sa moustache et en fixant méditativement le gentilhomme.
– Hé bien, Sir John ? interrogea le Prince.
– Monseigneur, il s’agit réellement d’un chevalier qu’il y a grand honneur à rencontrer, et je voudrais que Votre Grâce m’autorise à envoyer mon écuyer quérir mon équipement, car je serais vraiment très heureux de courir une lance avec lui.
– Non, non, Sir John ! Vous avez gagné autant d’honneur qu’il est possible à un homme d’en gagner ; il serait malheureux que vous ne puissiez pas vous reposer maintenant. Mais je vous prie, écuyer, d’informer votre maître qu’il est le très bienvenu à notre cour, et que du vin et des épices lui seront servis s’il désire se rafraîchir avant les joutes.
– Mon maître ne désire pas boire.
– Alors, qu’il nomme le gentilhomme avec qui il voudrait courir une lance.
– Il voudrait combattre ces cinq chevaliers, avec les armes que chacun d’eux lui désignera.
– Je comprends, dit le Prince, que votre maître est animé d’un grand courage et de nobles ambitions. Mais le soleil est déjà bas vers l’ouest, et il restera à peine assez de jour pour ces joutes. Je vous prie, mes seigneurs, de prendre vos places, afin que nous puissions voir si les actes de ce chevalier seront à la hauteur de ses intentions.
Le chevalier inconnu était assis en selle, immobile comme une statue de métal ; pendant ces préliminaires il ne regarda ni à droite ni à gauche. Il avait enfourché son grand destrier noir. La carrure de ses épaules, son attitude toute de fermeté et de sang-froid, la manière dont il portait l’écu et la lance suffisaient à convaincre les sceptiques qu’il serait un adversaire redoutable. Aylward, qui se tenait au premier rang des archers en compagnie de Simon, du gros John et d’autres soldats, avait fait la critique des opérations depuis le début avec la liberté et l’aisance de l’homme qui avait passé sa vie sous les armes et qui avait appris à évaluer d’un seul regard les points faibles d’un cheval et de son cavalier. À présent il contemplait l’étranger en fronçant le sourcil ; visiblement il cherchait à rassembler certains souvenirs.
– Par ma garde, j’ai déjà vu cette silhouette trapue quelque part ! Et pourtant je suis incapable de préciser l’endroit. À Nogent peut-être, ou à Auray ? Je vous le dis, mes garçons, cet homme est sûrement l’une des plus fortes lances de France, et il n’y en a pas de meilleures au monde !
– Ce n’est qu’un jeu d’enfant, leur pousse-pousse ! fit John. J’aimerais bien m’y essayer un jour, car, par la croix noire, il me semble qu’on pourrait y jouer autrement !
– Et que ferais-tu, John ? interrogèrent ses voisins.
– Il y a un certain nombre de possibilités, répondit le forestier en réfléchissant. Je crois que je commencerais par briser ma lance.
– C’est ce qu’ils s’efforcent tous de faire.
– Non, pas sur l’écu de l’adversaire. Je la briserais sur mon genou.
– Et pourquoi cela vaudrait-il mieux, vieux sac à viande ? demanda Black Simon.
– Parce qu’ainsi je transformerais en un très beau gourdin ce qui n’est qu’une grande épingle pour damoiselles.
– Et ensuite, John ?
– Ensuite ? Je prendrais la lance de l’autre dans le bras ou la jambe ou à tel endroit qu’il préférerait, mais moi je lui fracasserais le crâne avec mon gourdin.
– Par les os de mes dix doigts, John, déclara Aylward, je donnerais volontiers mon lit de plumes pour te voir courir une lance ! C’est un jeu très sportif et très courtois que tu nous indiques là.
– N’est-ce pas ? répondit John sérieusement. Ou encore, l’un des deux pourrait saisir l’autre par la taille, le soulever de sa selle, et l’emporter dans sa tente où il ne le relâcherait que contre rançon.
– Bon ! s’écria Simon pendant que les archers riaient aux éclats. Par Thomas de Kent, nous ferons de toi un maréchal de camp, et tu établiras un règlement pour nos joutes. Mais, John, que soutiendrais-tu dans ce genre de combats ?
– Que veux-tu dire ?
– Voyons, John ! Un briseur de lances aussi fort que toi doit se battre pour les beaux yeux de sa dame ou pour la courbure de ses cils, comme le fait Sir Nigel en l’honneur de Lady Loring.
– Ça je ne le sais pas, répondit le gros archer en se grattant la tête avec embarras. Depuis que Mary s’est moquée de moi, je ne peux plus me battre pour elle.
– Tant pis ! N’importe quelle femme fera l’affaire.
– Il y a ma mère, dit John. Elle s’est donnée beaucoup de peine pour m’élever et sur mon âme, je soutiendrais la courbure de ses cils, car quand je pense à elle cela me chatouille jusqu’au plus profond de mon cœur. Mais qui s’avance ?
– Sir William Beauchamp. C’est un vaillant, mais je crains qu’il ne soit pas assez ferme sur sa selle pour supporter la pointe que cet étranger lui poussera.
Le pronostic d’Aylward se vérifia promptement : les deux cavaliers se rencontrèrent au milieu de la lice. Beauchamp atteignit son adversaire au heaume, mais il reçut en échange une pointe si formidable qu’il tournoya sur sa selle, tomba et roula plusieurs fois sur lui-même. Sir Thomas Percy lui succéda ; il n’obtint guère plus de succès car son écu fut fendu, sa ventaille arrachée, et il fut légèrement blessé au flanc. Lord Audley et l’inconnu se touchèrent admirablement bien au heaume ; mais tandis que l’étranger demeurait rigide sur son destrier, la violence du choc avait repoussé l’Anglais sur la croupe de sa monture qui galopa un bon moment avant qu’il pût recouvrer son équilibre. Sir Thomas Wake fut abattu d’un coup de hache d’armes, qui était l’arme qu’il avait choisie, et il fallut le transporter dans sa tente. Ces succès rapides, obtenus aux dépens de quatre guerriers célèbres, déclenchèrent l’admiration et l’émerveillement de la foule. Les acclamations des soldats anglais se mêlèrent à celles des paysans et des citadins : l’amour des actions d’éclat et des exploits chevaleresques pouvait s’élever au-dessus des rivalités de races.
– Sur mon âme, John ! cria le Prince les joues en feu et les yeux brillants. Voici un homme d’un grand courage et d’une audace peu commune ! Je n’aurais jamais cru qu’il existât sur la terre un bras capable de surclasser ces quatre champions.
– Je vous l’avais dit, monseigneur : c’est vraiment un chevalier qu’il y a grand honneur à rencontrer. Mais le bord inférieur du soleil se mouille ; d’ici peu il aura disparu sous la mer.
– Voici Sir Nigel Loring, à pied avec son épée ! annonça le Prince. J’ai entendu dire qu’il était bon épéiste.
– Le meilleur de votre armée, monseigneur ! répondit Chandos. Mais aujourd’hui il lui faudra toute son habileté.
Les deux combattants avancèrent l’un vers l’autre ; ils étaient revêtus de l’armure complète et tenaient inclinées sur l’épaule leurs épées à deux mains. L’étranger marchait d’un pas pesant et mesuré, tandis que l’Anglais avait le pas si vif qu’on n’aurait pas cru que ses membres étaient embarrassés par leur coquille d’acier. À quatre pas de distance ils s’arrêtèrent, se dévisagèrent du regard un moment, puis tout à coup un cliquetis d’acier se déchaîna, si bruyant qu’on aurait dit deux forgerons s’affairant sur leur enclume. Les longues lames luisantes se dressaient, se rabattaient, tournoyaient, se croisaient, se heurtaient, se désengageaient ; des étincelles jaillissaient à chaque parade. Sir Nigel bondissait, la tête rejetée en arrière, son panache désinvolte voletant au vent, tandis que son sombre adversaire décochait des coups fracassants, alternant la taille avec la pointe, sans toutefois franchir le mur d’acier que lui opposait l’épée de l’Anglais. La foule hurlait sa joie quand Sir Nigel baissait la tête pour éviter un coup ou quand par une esquive rapide du buste il s’écartait de la trajectoire d’une botte terrible. Mais son heure sonna enfin. Le Français, en faisant tournoyer son épée, découvrit un instant une fente entre son épaulière et le brassard qui protégeait son bras. Sir Nigel y plongea sa lame, avec une vitesse telle que les spectateurs ne purent pas la suivre du regard ; mais une tache rouge s’élargissant rapidement sur le surcot blanc attesta que le coup de pointe avait porté. La blessure n’était que légère et le Français allait repartir à l’assaut quand Chandos, à un signal du Prince, jeta son bâton ; les juges se précipitèrent sur la lice, relevèrent les épées, et arrêtèrent le combat.
– Il était temps d’y mettre fin, dit le Prince en souriant, car Sir Nigel m’est trop précieux pour que je le perde et, par les cinq plaies sacrées, si l’un de ces coups de taille avait atteint son but, j’aurais redouté le pire pour notre champion. Qu’en pensez-vous, Pedro ?
– Je pense, Édouard, que votre petit homme était tout à fait capable de veiller sur lui-même. Pour ma part, j’aurais aimé voir le combat se poursuivre jusqu’à la dernière goutte de sang.
– Il faut que nous parlions à cet étranger. Un champion de cette valeur ne doit pas quitter ma cour sans avoir pris du repos et des forces. Menez-le ici, Chandos, et certes, puisque le seigneur Loring a renoncé à revendiquer ce vase, il est juste et décent que ce gentilhomme le rapporte en France en témoignage des prouesses qu’il a accomplies aujourd’hui.
Le chevalier errant, qui était remonté en selle, galopa vers la tribune du Prince ; il avait noué un foulard de soie autour de son bras blessé. Le soleil couchant faisait rougeoyer son armure et projetait sa longue ombre noire derrière lui sur le gazon. Le Français arrêta sa monture, inclina légèrement la tête et demeura assis imperturbable, tandis que retentissaient les bravos des soldats et des jolies femmes qui l’admiraient.
– Seigneur chevalier, dit le Prince, nous avons tous été émerveillés ce jour par la grande habileté et la valeur dont Dieu a bien voulu vous pourvoir. Je serais heureux que vous vous attardiez à notre cour, au moins pour quelque temps, jusqu’à ce que votre blessure soit guérie et que vos chevaux soient reposés.
– Ma blessure n’est rien, monseigneur, et mes chevaux ne sont pas fatigués, répliqua l’étranger d’une voix grave et ferme.
– Ne voudrez-vous pas du moins regagner Bordeaux avec nous pour boire une coupe et souper à notre table ?
– Je ne boirai pas de votre vin et je ne m’assoirai pas à votre table, répondit le Français. Je ne vous porte aucune tendresse, ni à vous ni à votre race, et il n’y a rien que je souhaite autant que de voir la dernière voile vous ramenant dans votre île disparaître dans le ciel d’ouest.
– Ce sont des mots amers, messire chevalier ! fit le Prince Édouard dont le regard se courrouça.
– Qui viennent d’un cœur amer, confirma le chevalier inconnu. Depuis combien de temps mon malheureux pays n’a-t-il pas connu la paix ? Où sont les fermes, les vergers, les vignobles qui étaient la beauté de la France ? Où sont les cités qui en faisaient la grandeur ? De la Provence à la Bourgogne nous sommes harcelés par tous les mercenaires de la Chrétienté, qui ruinent un pays que vous avez trop affaibli pour qu’il puisse garder ses propres marches. Le peuple ne dit-il pas qu’un homme peut galoper tout un jour sur cette misérable terre sans voir du chaume sur un toit ou sans entendre le cri d’un coq ? Un seul beau royaume ne vous suffit-il donc pas, que vous vous efforciez de conquérir celui-ci qui ne vous aime pas ? Pardieu ! Les mots d’un vrai Français peuvent bien être amers, car amer est son lot, et amères ses pensées quand il voyage à travers ce pays trois fois malheureux !
– Messire chevalier, dit le Prince, vous parlez comme un homme brave, et notre cousin de France est heureux de posséder un gentilhomme capable de soutenir sa cause aussi bien avec l’épée qu’avec la langue. Mais si vous nous jugez si mal, comment se fait-il que vous vous soyez fié à nous sans la garantie d’un sauf-conduit ?
– Parce que je savais que vous seriez ici, monseigneur. Si l’homme qui est assis à votre droite avait été le gouverneur de ce pays, j’y aurais regardé à deux fois, car je le prends pour quelqu’un qui ignore tout ce qui est chevaleresque et généreux.
Sur un salut martial, il fit pivoter son cheval, descendit la lice au galop et disparut parmi la foule dense des piétons et des cavaliers qui quittaient le champ clos.
– L’insolent ! Le scélérat ! cria Pedro furieux. J’ai vu arracher des langues pour moins que cela. Ne serait-il pas d’un bon exemple, Édouard, de lui dépêcher quelques cavaliers pour le ramener ? Réfléchissez qu’il appartient peut-être à la maison royale de France, ou qu’il doit être l’un de ces chevaliers dont la perte serait cruellement ressentie par son maître ! Sir William Felton, vous avez un bon cheval : galopez après ce lâche, je vous prie !
– Galopez et rejoignez-le, dit le Prince. Mais donnez-lui cette bourse de cent nobles en signe du respect que je lui porte. Car, par saint Georges, il a servi son maître aujourd’hui comme je voudrais que me servent toujours mes vassaux !
Sur ces mots, le Prince tourna le dos au Roi d’Espagne et, sautant en selle, rentra au pas à l’abbaye de Saint-André.
CHAPITRE XXV
Comment Sir Nigel écrivit au château de Twynham
Le lendemain matin après les joutes, lorsque Alleyne Edricson entra selon son habitude dans la chambre de son maître pour l’aider à s’habiller et à lui boucler les cheveux, il le trouva déjà levé et au travail. Sir Nigel était assis à une table près de la fenêtre entre un lévrier d’Écosse et un chien de berger, les pieds ramenés sous son siège et la langue collée dans la joue : il avait l’air de se débattre avec une grande perplexité. Une feuille de vélin était déroulée devant lui. Il tenait une plume avec laquelle il venait de griffonner quelques lignes d’une écriture d’écolier maladroit. Le vélin toutefois était parsemé de tant de taches, de ratures et d’égratignures qu’il avait renoncé à poursuivre. De son œil découvert il fixait le plafond et attendait l’inspiration.
– Par saint Paul ! s’écria-t-il quand il vit Alleyne. Tu es exactement l’homme qu’il me faut pour cette affaire. J’ai cruellement besoin de toi, Alleyne.
– Que Dieu soit avec vous, noble seigneur ! répondit Alleyne. J’espère que vous ne vous ressentez pas trop douloureusement de vos efforts d’hier.
– Non, je me sens beaucoup plus frais au contraire. Ces exercices ont assoupli mes jointures que les années de paix avaient rouillées. J’espère, Alleyne, que tu as très soigneusement observé l’allure et le comportement de ce chevalier de France ; car tu es jeune, et c’est maintenant que tu dois noter tout ce qui est excellent et modeler tes propres actions sur de tels exemples. Il y avait beaucoup d’honneur à gagner auprès d’un tel adversaire, et j’ai rarement rencontré quelqu’un pour qui j’aie conçu autant d’affection et d’estime. Si je pouvais connaître son nom, je t’adresserais à lui avec mon cartel, afin que nous ayons une autre occasion d’applaudir ses faits d’armes.
– On dit, noble seigneur, que personne ne sait son nom, à l’exception du seigneur Chandos et que celui-ci a fait vœu de ne pas le révéler. Voilà les bruits qui couraient à la table des écuyers.
– Quel qu’il soit, c’est un gentilhomme de très grande valeur. Mais je me trouve devant une tâche, Alleyne, qui m’est beaucoup plus malaisée que celle d’hier.
– Puis-je vous aider, noble seigneur ?
– Oui, réellement tu le peux. J’ai écrit pour envoyer mes salutations à ma douce épouse ; un messager du Prince va en effet partir pour Southampton, et il se chargera volontiers de mon paquet. Je te prie, Alleyne, de regarder ce que j’ai écrit et de voir si j’ai employé des mots que ma dame pourra comprendre. Mes doigts, ainsi que tu t’en apercevras, sont plus habitués à manier le fer ou le cuir qu’à tirer des traits et à tourner des lettres. Quoi donc ? Y a-t-il quelque chose de travers, pour que tu aies l’air si étonné ?
– C’est le premier mot, seigneur. En quelle langue vous a-t-il plu d’écrire ?
– En anglais ; mon épouse le parle mieux que le français.
– Et pourtant ce n’est pas un mot anglais, mon bon seigneur. Voici quatre t, et pas une seule lettre entre eux.
– Par saint Paul, je le trouvais bizarre en effet ! dit Sir Nigel. Il me faisait penser à une parade de lances. Je vais te lire ma lettre, Alleyne, et tu la récriras de ta belle écriture. Nous quittons Bordeaux aujourd’hui : je serais heureux de penser que Lady Loring va recevoir quelques lignes de moi.
Alleyne s’assit, prit une plume et un nouveau parchemin ; Sir Nigel lui épela lentement la lettre en suivant chaque mot avec son index.
– « Que mon cœur soit avec vous, ma chère douceur, est ce que votre cœur vous assurera toujours. Tout va bien ici, sauf que Pépin a la gale sur le dos, et que Pommers a du mal à se débarrasser de la raideur qu’il a contractée pendant les quatre jours de bateau ; d’autant plus que la mer était très haute et que nous avons failli sombrer à cause d’un trou dans son côté, qui a été provoqué par une pierre que nous ont jetée des pirates, que les saints veuillent bien protéger car ils ont été perdus, comme l’a été le jeune Terlake ainsi qu’une quarantaine de marins et d’archers qui seraient pourtant très utiles ici, parce que probablement il y aura une très belle guerre, avec beaucoup d’honneur et de belles perspectives de distinction ; en vue de quoi je pars pour rassembler ma Compagnie qui est à Montauban où ils pillent et détruisent ; cependant j’espère, avec l’aide de Dieu, pouvoir leur montrer que je suis leur maître, de même que, ma douce dame, je suis votre serviteur. » Qu’en penses-tu, Alleyne ? demanda Sir Nigel en clignant de l’œil dans la direction de l’écuyer et en affectant une certaine fierté. Ne lui ai-je pas raconté tout ce qui nous était arrivé ?
– Vous avez dit beaucoup, beau seigneur ; et pourtant, si je puis me permettre une remarque, c’est un peu trop condensé : Lady Loring vous suivra peut-être malaisément. Si les phrases étaient plus brèves…
– Non, peu importe l’ordre selon lequel on les dispose, du moment qu’elles sont toutes présentes au rassemblement. L’essentiel est que mon épouse ait les mots : elle les arrangera dans l’ordre qui lui plaira le mieux. Mais je voudrais que tu ajoutes ce qu’elle aimerait savoir.
– Oh volontiers ! fit Alleyne joyeusement.
Il se pencha sur le parchemin et écrivit :
« Madame et bonne maîtresse, Dieu nous a pris sous sa garde, et mon seigneur est en bonne santé et content. Il s’est grandement honoré dans un tournoi devant le Prince : lui seul a remporté la victoire sur un très vaillant chevalier venu de France. En ce qui concerne l’argent, nous possédons plus que ce qu’il nous faudra pour atteindre Montauban. Sur ce, Madame, je vous adresse mes humbles hommages, en vous priant de transmettre les mêmes à votre fille, la damoiselle Maude. Puissent les saints vous tenir toutes deux sous leur protection : ce sera toujours la prière de votre serviteur Alleyne Edricson. »
– C’est très bien dit ! commenta Sir Nigel qui avait incliné son crâne chauve pour approuver chaque phrase. Et toi, Alleyne, si tu as un ami cher à qui tu voudrais envoyer ton salut, je mettrai ta lettre dans mon paquet.
– Je n’en ai pas, répondit tristement Alleyne.
– Tu n’as donc pas de famille ?
– Personne, sauf mon frère.
– Ah, j’avais oublié qu’il y avait de la rancune entre vous ! Mais en Angleterre tu n’as personne qui t’aime ?
– Personne dont j’ose dire que je suis aimé.
– Et personne que tu aimes ?
– Je n’en suis pas aussi sûr, répondit Alleyne.
Sir Nigel hocha la tête et se mit à rire gentiment.
– Je vois ce qu’il en est ! dit-il. Crois-tu que je n’avais pas remarqué tes fréquents soupirs, et ton regard vide ? Est-elle belle ?
– Oh oui ! s’écria Alleyne avec tout son cœur.
Il était bouleversé par ce tour imprévu de la conversation.
– Et bonne ?
– Comme un ange.
– Et cependant elle ne t’aime pas ?
– Je ne peux pas dire qu’elle en aime un autre.
– Alors tu as bon espoir ?
– Je ne pourrais pas vivre autrement.
– Il faut donc que tu t’efforces d’être digne d’elle. Sois brave et pur, impavide devant les forts, humble devant les faibles ; et ainsi, que cet amour prospère ou non, tu te mettras en condition d’être honoré par l’amour d’une jeune fille. À vrai dire c’est la plus haute récompense que puisse briguer un vrai chevalier.
– Je m’y efforce réellement, dit Alleyne. Mais elle est si belle, si délicate, et d’un caractère si noble que je crains de n’être jamais digne d’elle.
– En pensant cela tu le deviens au contraire. Est-elle donc de noble naissance ?
– Oui, seigneur.
– D’une maison de chevalier ?
– Oui.
– Prends garde, Alleyne, prends garde ! fit Sir Nigel avec bonté. Plus haute est la monture, plus lourde est la chute. Ne chasse pas au faucon ce que ses ailes ne peuvent atteindre !
– Noble seigneur, s’écria Alleyne, je connais peu les manières et usages de ce monde, mais je voudrais vous demander votre avis. Vous avez connu mon père et mes parents. Est-ce que ma famille ne serait pas de bonne réputation et d’un milieu honorable ?
– Si, assurément !
– Et pourtant vous me mettez en garde : vous me conseillez de ne pas viser trop haut en amour !
– Si Minstead était à toi, Alleyne, alors, par saint Paul, je crois qu’il n’y aurait pas une famille dans le pays qui ne serait fière de t’accueillir, étant donné l’ancienneté de ta souche. Mais tant que vit ton frère… Ah, sur mon âme, ou je me trompe fort, ou je reconnais le pas de Sir Oliver !
Un pas pesant approchait en effet, et le majestueux chevalier ouvrit la porte.
– Je suis venu, mon petit cousin, dit-il, pour vous informer que je loge au-dessus du barbier dans la rue de la Tour, et qu’il y a un pâté de venaison dans le four et sur la table deux flacons d’un vin correct. Par saint Jacques, un aveugle trouverait le chemin ! Il n’aurait qu’à prendre le vent et suivre de savoureux fumets. Mettez donc votre cape et venez, car Sir Walter Hewett et Sir Robert Briquet, plus un ou deux autres, nous attendent.
– Non, Oliver, je ne puis vous accompagner : je pars aujourd’hui pour Montauban.
– Pour Montauban ? Mais j’avais appris que votre Compagnie devait se rendre à Dax avec mes quarante coquins de Winchester.
– Voudrez-vous en prendre le commandement, Oliver ? Car je pars pour Montauban avec mes deux écuyers et deux archers. Là, quand j’aurai trouvé le reste de mes hommes, je les mènerai à Dax. Nous partons ce matin.
– Alors je retourne vers mon pâté, répondit Sir Oliver. Vous nous retrouverez à Dax, sans doute, à moins que le Prince ne me jette en prison car il est très en colère contre moi.
– Et pourquoi, Oliver ?
– Pardieu ! Parce que j’ai envoyé mon cartel, gantelet et défi à Sir John Chandos et à Sir William Felton.
– À Chandos ? Au nom du Ciel, Oliver, pourquoi avez-vous fait cela ?
– Parce que l’un et l’autre se sont mal conduits envers moi.
– Comment ?
– Parce qu’ils m’ont dédaigné quand ils ont choisi ceux qui jouteraient pour l’Angleterre. Vous et Audley, je pouvais passer là-dessus, cousin, car vous êtes deux hommes mûrs ; mais qui sont Wake, et Percy, et Beauchamp ? Sur mon âme, je pêchais ma nourriture dans une marmite de camp quand ils braillaient pour avoir leur bouillie ! Est-ce qu’un homme de mon poids et de ma qualité peut se voir préférer trois garçons à moitié poussés qui ont encore pas mal de choses à apprendre sur les lances ? Mais écoutez, cousin ! Je crois que je vais également envoyer mon cartel au Prince.
– Oliver ! vous êtes fou !
– Non, je ne suis pas fou ! Je me moque comme d’un denier qu’il soit prince ou pas prince. Par saint Jacques, je vois les yeux de votre écuyer qui lui sortent de la tête comme s’il était un crabe farci. Allons, mon ami, nous sommes trois hommes du Hampshire, et nous n’allons pas nous laisser plaisanter !
– Il vous a donc plaisanté ?
– Pardieu, oui ! « Le cœur du vieux Sir Oliver est encore robuste », dit quelqu’un de la cour. « Autrement son cœur ne s’harmoniserait pas avec le reste », répondit le Prince. « Et son bras est fort », dit un autre. « L’échine de son cheval ne l’est pas moins », répondit le Prince. Oui, ce jour même, je vais lui envoyer mon cartel et mon défi !
– Non, mon cher Oliver ! dit Sir Nigel en posant une main sur le bras de son ami courroucé. Dans tout cela il n’y a rien d’autre que son estime : il n’a fait que dire que vous étiez un homme fort et robuste qui avait besoin d’un bon destrier. Quant à Chandos et à Felton, réfléchissez que si, lorsque vous étiez plus jeune, de plus vieilles lances vous avaient été préférées, comment auriez-vous pu acquérir le renom et la réputation qui sont aujourd’hui les vôtres ? Vous n’êtes plus aussi léger à cheval qu’autrefois, Oliver, et moi je suis plus léger puisque j’ai en moins le poids de mes cheveux, mais ce serait une vilaine affaire si au soir de notre vie nous montrions que nos cœurs sont moins fidèles et loyaux que jadis. Quand un chevalier comme Sir Oliver Buttesthorn peut se tourner contre son Prince à cause d’un simple mot, alors où chercherons-nous des modèles de constance et de fidélité ?
– Ah, mon cher petit cousin, il est facile de s’asseoir au soleil et de prêcher celui qui est à l’ombre ! Cependant vous me convaincrez toujours avec votre voix douce. N’y pensons plus ! Mais, Sainte Mère, j’avais oublié mon pâté ! Il sera aussi desséché que Judas Iscariote ! Venez, Nigel, de peur que le démon ne s’empare à nouveau de moi !
– Je ne vous tiendrai compagnie qu’une heure, car nous partirons à midi. Préviens Aylward, Alleyne, qu’il m’escorte à Montauban ; dis-lui aussi qu’il choisisse un archer que nous emmènerons. Les autres iront à Dax quand le Prince partira, c’est-à-dire avant l’Épiphanie. Que Pommers soit prêt à midi avec ma lance d’érable, et place mon équipement sur le mulet de somme.
Les deux soldats partirent ensemble, et Alleyne s’affaira pour que tout soit prêt pour le voyage.
CHAPITRE XXVI
Comment les trois camarades se procurèrent
un grand trésor
L’air était vif et le soleil clair quand le petit groupe quitta Bordeaux pour Montauban, où se trouvait aux dernières nouvelles la moitié manquante de la Compagnie Blanche. Sir Nigel et Ford étaient partis en tête ; le chevalier montait un bon trotteur, et son grand destrier trottait à côté de l’écuyer. Alleyne se mit en route deux heures plus tard ; il avait eu à régler les notes d’hôtellerie et à pourvoir aux diverses tâches qui lui incombaient en sa qualité d’écuyer de corps. Il était accompagné d’Aylward et de Hordle John, armés de pied en cap, que suivaient les mulets de somme portant dans des paniers la garde-robe et le service de table de Sir Nigel ; car le chevalier, bien qu’il n’eût rien d’un fat ni d’un épicurien, était très pointilleux sur certains petits détails et il aimait, même si la table était modeste et la vie dure, avoir une nappe blanche et une cuiller en argent.
Il avait gelé pendant la nuit ; la route blanche résonnait sous les fers des chevaux au-delà de la porte est de la ville. C’était la même route que celle qu’avait empruntée l’inconnu venu de France pour le tournoi. Ils chevauchaient tous les trois de front. Alleyne Edricson gardait les yeux baissés et il avait l’esprit ailleurs : il réfléchissait à la conversation qu’il avait eue le matin avec Sir Nigel. Avait-il bien fait d’en dire tant ? Ou n’aurait-il pas mieux fait d’en dire davantage ? Comment aurait réagi le chevalier s’il lui avait avoué son amour pour la damoiselle Maude ? L’aurait-il rejeté en disgrâce ? Lui aurait-il reproché d’avoir abusé de son hospitalité ? Il avait été sur le point de tout dire quand Sir Oliver avait interrompu leur entretien. Peut-être Sir Nigel, avec son amour anachronique de tous les usages moribonds de la chevalerie, l’aurait-il soumis à une épreuve sortant de l’ordinaire, ou contraint à un fait d’armes qui aurait servi de test à son amour ? Alleyne sourit en se demandant quel acte fantastique et merveilleux il aurait exigé de lui… ou exigerait peut-être. En tout cas, il était prêt à l’accomplir, qu’il s’agisse de tenir la lice à la cour du Roi de Tartarie, de porter un cartel au Sultan de Bagdad, ou de servir un trimestre contre les sauvages païens de Prusse. Sir Nigel avait déclaré qu’il était de naissance assez noble pour briguer n’importe quelle damoiselle, mais que sa fortune devait être améliorée. Alleyne avait souvent manifesté du dédain à l’égard de ce désir de terres ou d’or qui aveuglait les hommes au point de leur cacher d’autres buts plus nobles et moins éphémères. Or voici qu’il avait l’impression qu’il ne pourrait réaliser le vœu de son cœur que par des terres ou de l’or… Et de surcroît le seigneur de Minstead n’était pas l’ami du connétable de Twynham ! Cette inimitié pourrait, même s’il amassait des richesses au cours de la guerre, séparer longtemps encore les deux familles. Et en admettant que Maude l’aimât, il la connaissait trop bien pour imaginer qu’elle l’épouserait sans la bénédiction de son père. Tout était sombre, ténébreux ; cependant l’espoir est tenace chez les jeunes ; celui d’Alleyne, en dépit de toutes ses incertitudes, flottait comme un panache dans une mêlée de cavalerie.
Si Alleyne Edricson avait de quoi méditer en traversant les plaines dénudées de la Guyenne, ses deux compagnons s’occupaient davantage du présent que de l’avenir. Aylward chevaucha pendant un demi-kilomètre le menton sur l’épaule, les yeux tournés vers un mouchoir qui s’agitait d’une fenêtre au-dessus de l’angle des remparts. Quand enfin un crochet de la route le dissimula à sa vue, il inclina son casque sur l’oreille, haussa ses larges épaules et poursuivit son chemin le sourire aux lèvres ; d’agréables souvenirs éclairaient son visage dur. John chevauchait lui aussi en silence, mais ses yeux allaient continuellement d’un côté de la route à l’autre ; il observait, réfléchissait, hochait la tête comme le voyageur qui regarde autour de lui pour ne rien omettre dans le récit qu’il fera de ses aventures.
– Par la Croix ! s’écria-t-il tout à coup en frappant sa cuisse de sa grosse main rouge. Je savais qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas, mais je ne pouvais pas comprendre ce que c’était.
– Et qu’était-ce donc ? interrogea Alleyne tiré de ses pensées.
– Hé bien, ces bordures d’arbustes qui forment haies ! rugit John en éclatant de rire. Le pays est bien ratissé, aussi net que le crâne d’un moine. Mais je trouve que les gens qui vivent par ici exagèrent : pourquoi n’ont-ils pas le courage d’arracher ces longues rangées de souches d’arbre noires et tordues que je vois de chaque côté ? N’importe quel fermier du Hampshire aurait honte de laisser un pareil fouillis sur son sol !
– Tu es fou, vieux John ! répondit Aylward. J’aurais cru que tu en savais davantage puisqu’on m’avait dit que les moines de Beaulieu pouvaient presser leurs raisins pour avoir du bon vin. Apprends donc que si ces arbustes étaient arrachés, toute la richesse du pays serait anéantie, et que sans doute il y aurait quelques gosiers assoiffés en Angleterre : en trois mois de temps ces souches noires fleurissent, s’épanouissent, et leurs fruits donnent une bonne cargaison de Médoc et de vin de Gascogne qui traverse la mer. Mais regardez la petite église dans la vallée, avec la foule rassemblée. Par ma garde, c’est un enterrement : j’entends sonner le glas !
Il se découvrit et se signa, en murmurant une courte prière pour le repos de l’âme du défunt.
– Là également, dit Alleyne, ce qui semble mort à l’œil est encore plein de la sève de la vie, comme ces vignobles. Ainsi Dieu s’est inscrit Lui-même et a inscrit Ses lois sur tout ce qui nous entoure ; il reste à nos pauvres yeux ternes et à nos âmes encore plus ternes le soin de lire ce qu’Il a inscrit pour nous.
– Ah, mon petit, s’écria l’archer, tu me reportes aux jours où tu sortais de l’œuf monacal ! J’avais craint qu’en gagnant un jeune et débonnaire homme d’armes nous n’ayons perdu notre clerc au doux parler. En vérité tu as beaucoup changé depuis notre départ du château de Twynham !
– Le contraire serait surprenant, puisque je vis dans un monde nouveau pour moi. J’espère tout de même que je n’ai pas trop changé. Parce que je sers un maître de la terre et que je porte les armes pour un Roi de la terre, comment oublierais-je le grand Roi et Maître de tout et de tous, dont j’étais le serviteur très indigne et humble avant d’avoir quitté Beaulieu ? Toi, John, tu sors aussi du couvent, mais je ne pense pas que tu aies l’impression d’avoir déserté ton ancien service en t’engageant dans un nouveau.
– Je suis lent d’esprit, répondit John. Pour tout dire, quand j’essaie de réfléchir sur des questions de cet ordre, je m’embrouille. Pourtant je ne me trouve pas plus mauvais, maintenant que je porte un justaucorps d’archer, que lorsque je portais la robe blanche, si c’est cela que tu veux dire.
– Tu n’as fait que changer de compagnie blanche, dit Aylward. Mais par les os de ces dix doigts, je suis bien étonné quand je pense que ce n’est qu’à la dernière chute des feuilles que nous sommes partis ensemble de Lyndhurst, lui si gentil, si jeune fille, et toi, John, qui ressemblais à un veau rouge phénoménal ! Vous voici à présent, lui écuyer accompli et toi hardi archer, tandis que moi je suis toujours le même vieux Samkin Aylward, qui n’a changé en rien, sauf que j’ai quelques péchés de plus sur l’âme et quelques couronnes de moins dans ma bourse. Mais tu ne m’as pas encore expliqué, John, pour quelles raisons tu avais quitté Beaulieu.
– Il y avait sept raisons, répondit John pensif. La première est qu’ils m’ont chassé.
– Ma foi, camarade, au diable les six autres ! Cela me suffit, et à toi aussi. Je m’aperçois qu’à Beaulieu les moines sont avisés. Ah, mon ange, qu’as-tu dans ton pot ?
– Du lait, digne seigneur, répondit la jeune paysanne qui se tenait sur le pas de sa porte. Vous ferait-il plaisir, gentils sires, et voulez-vous que je vous en apporte trois mesures ?
– Non, ma petite. Mais voici une pièce de deux sous pour ta gentillesse et pour le spectacle de ton frais minois. Ma foi, elle est jolie ! J’ai envie de m’arrêter pour lui dire deux mots.
– Non, Aylward ! s’écria Alleyne. Sir Nigel nous attendrait et il est pressé.
– C’est vrai, camarade ! Adieu, ma chérie : mon cœur est pour toujours à toi. Sa mère aussi est bien faite. Regardez-la bêcher près de la route. Ma foi, le fruit le plus mûr est toujours le plus sucré. Bonjour, ma belle dame ! Que Dieu vous tienne en Sa sauvegarde ! Tu dis que Sir Nigel nous attend ?
– À Marmande ou à Aiguillon. Il m’a assuré que nous ne pourrions pas le manquer, puisqu’il n’y a qu’une route.
– Oui, et c’est une route que je connais aussi bien que les prés de Midhurst, dit l’archer. Je l’ai prise trente fois, dans un sens ou dans l’autre ; mais, par ma corde d’arc, j’ai l’habitude d’être plus chargé au retour qu’à l’aller ! Quand je venais en France je pouvais mettre dans un sac tout ce que je possédais, mais quand je rentrais sur Bordeaux il me fallait quatre mulets de somme. Que la bénédiction de Dieu s’étende sur l’homme qui le premier s’est servi de ses mains pour faire la guerre ! Mais voici, dans le creux de ce vallon, l’église de Cadillac ; l’auberge est plus loin, là où sont plantés les trois peupliers. Après tout, une lampée de vin ne nous fera pas de mal !
La route avait parcouru la région ondulée des vignobles qui s’étendait vers le nord et l’est ; des clochers, des tours féodales, des agglomérations de maisons se détachaient au loin avec netteté. À leur droite la Garonne bleue roulait ses algues et entraînait des bateaux et des chalands. À gauche, au-delà d’une étroite bande de vignes, les Landes sablonneuses et tristes où poussaient le genêt et la bruyère étalaient leur monotonie lugubre jusqu’aux hauteurs bleutées qui délimitaient l’horizon. Derrière eux apparaissait encore le large estuaire de la Garonne ; les hautes tours de Saint-André et de Saint-Rémi se dressaient au-dessus de la plaine. En face c’était le village de Cadillac aux remparts gris et aux maisons blanches ; un panache de fumée grimpait paresseusement à l’assaut du ciel.
– Voici le « Mouton d’Or », annonça Aylward en arrêtant son cheval devant une hôtellerie à l’écart. Holà ! appela-t-il en cognant à la porte avec le pommeau de son épée. Holà, cabaretier, palefrenier, valet ! Ici ! Ah, Michel ! Il a toujours le nez aussi rouge ! Trois gobelets de vin du pays, Michel, car l’air est piquant. Je te prie, Alleyne, de te rappeler cette porte, car j’ai une bonne histoire à te raconter à son sujet.
– Dis-moi, ami, demanda Alleyne à l’aubergiste, est-ce qu’un chevalier et son écuyer ne seraient pas passés par ici il y a moins d’une heure ?
– Il y a bien deux heures de cela, messire. N’était-ce pas un homme de petite taille, chauve, qui a la vue basse et qui parle fort doucement quand il est très en colère ?
– Exactement. Mais je me demande comment tu peux savoir la façon dont il parle quand il est en colère, car il est très bon et très simple.
– Louanges aux saints ! Ce n’est pas moi qui l’ai mis en colère ! dit le gros Michel.
– Qui, alors ?
– Le jeune sieur de Brissac, de la Saintonge, qui se trouvait ici par hasard et qui s’est moqué de l’Anglais parce qu’il l’a vu petit et pacifique. Réellement ce bon chevalier a été bien paisible, bien patient ! Car il s’est rendu compte que le sieur de Brissac était encore un jeunôt, un bavard sans cervelle, et il est resté en selle à boire son vin, comme vous le faites maintenant, sans prêter attention à cette mauvaise langue.
– Et que s’est-il passé ensuite, Michel ?
– Hé bien, messire, il s’est passé que le sieur de Brissac, après avoir fait le malin devant les valets, s’en est pris au gant que porte le chevalier à sa toque ; il a demandé tout fort si c’était la coutume en Angleterre qu’un homme accroche à son chapeau le gant d’un grand archer. Pardieu ! Je n’ai jamais vu quelqu’un descendre de cheval aussi vite que cet Anglais ! Avant même que l’autre eût fini sa phrase, il se trouvait à côté de lui ; leurs deux visages se touchaient presque ; et aux joues il avait chaud ! « Je pense, jeune seigneur, dit-il tout doucement en regardant l’autre dans les yeux, que maintenant que je suis plus près, vous êtes à même de constater que ce gant n’est pas un gant d’archer. » Le sieur de Brissac fit retomber le coin de· sa bouche : « En effet », dit-il. « De même qu’il n’est pas grand : il est petit ! » insista l’Anglais. « Moins grand que je ne l’avais cru », répondit l’autre en baissant les yeux « Et capable d’être porté par la plus belle et la plus douce des dames d’Angleterre », dit encore l’Anglais. « Peut-être, murmura le sieur de Brissac en détournant la tête, « je suis moi-même affligé d’une mauvaise vue, et il m’arrive comme vous de prendre une chose pour une autre », dit le chevalier. Il remonta en selle et partit au galop, abandonnant le sieur de Brissac qui se rongeait les ongles devant ma porte. Ah, par les cinq plaies sacrées, j’ai vu beaucoup de guerriers boire mon vin, mais jamais aucun ne m’a plu davantage que ce petit Anglais !
– Par ma garde, il est notre maître, Michel ! fit Aylward. Des gens comme nous ne servent pas un pleutre ! Voici quatre deniers, Michel et que Dieu te garde ! En avant, camarades ! Nous avons une longue route devant nous.
Au grand trot les trois amis quittèrent Cadillac et son auberge ; sans plus s’arrêter ils dépassèrent Saint-Macaire et prirent le bac pour traverser la Dropt. Sur l’autre rive la route passait par La Réole, Sainte-Bazeille et Marmande ; John et Alleyne se taisaient, mais chaque auberge, chaque château, chaque ferme étaient pour Aylward l’occasion de rappeler un souvenir d’amour, de pillage, de combat.
– Voici les fumées de Bazas, de l’autre côté de la Garonne, dit-il. Il y avait là trois sœurs, filles d’un maréchal ferrant, et, par les os de mes dix doigts, on aurait pu galoper tout un jour de juin sans en rencontrer de pareilles ! Marie était grande et sérieuse, Blanche était petite et gaie, la brune Agnès avait des yeux qui vous transperçaient comme la flèche d’un bon archer. Je me suis attardé quatre jours, et je me suis fiancé à toutes les trois : il me semblait en effet honteux d’en préférer une aux deux autres ; et puis cette préférence aurait pu provoquer une mésentente dans la famille. Cependant, en dépit de tous mes efforts, les choses ont pris une fâcheuse tournure, et j’ai pensé qu’il valait mieux que je quitte la maison. Là-bas, c’est le moulin de la Souris. Le vieux Pierre Carron, le meunier, était un brave ami : il avait toujours, un siège et une croûte pour un archer fatigué. Quand il faisait quelque chose, il y mettait tout son cœur. Il s’échauffa à moudre des os qu’il voulait mélanger avec sa farine ; en voulant faire trop bien il attrapa la fièvre, et il mourut.
– Dis-moi, Aylward, questionna Alleyne, pourquoi tu m’as demandé de te rappeler la porte de l’auberge de Cadillac ?
– Pardieu ! J’avais oublié. Qu’as-tu remarqué sur cette porte ?
– Un trou carré, à travers lequel l’aubergiste peut sans doute regarder quand il ne sait pas quels clients lui arrivent.
– Et tu n’as rien vu d’autre ?
– Au-dessous du trou, il y avait une entaille profonde comme si on avait enfoncé un gros clou.
– Rien d’autre ?
– Non.
– Si tu avais fait bien attention, tu aurais observé une tache sur le bois. La première fois que j’ai entendu le rire de Black Simon, c’était devant cette porte. La seconde fois c’était quand il tua à coups de dents un écuyer français, alors qu’il était sans armes et que le Français avait un poignard.
– Et pourquoi Black Simon riait-il devant la porte ? interrogea John.
– Quand Simon n’est pas de bonne humeur, il est dangereux. Par ma garde, il était né pour la guerre, car il ne sait guère ce qu’est la douceur ou le repos ! Cette auberge, le « Mouton d’Or », était tenue autrefois par un certain François Gourval qui avait le poing dur et le cœur plus dur encore. On racontait que bon nombre d’archers revenant de la guerre y avaient bu du vin qui contenait des simples et les assommait de sommeil, et qu’ensuite ils étaient dévalisés par ledit Gourval ; si le lendemain ils se plaignaient, Gourval les mettait dehors et les rossait, car c’était un homme très vigoureux qui avait des valets robustes à son service. Cette histoire parvint aux oreilles de Simon pendant que nous étions ensemble à Bordeaux, et il décida que nous irions à Cadillac avec une bonne corde de chanvre et que nous punirions ce Gourval comme il le méritait. Nous arrivâmes donc au « Mouton d’Or », mais Gourval avait été prévenu : il avait barré la porte qui était le seul moyen d’accès dans la maison. « Laisse-nous entrer, bon maître Gourval ! » crie Simon. Et moi : « Laisse-nous entrer, bon maître Gourval ! » Mais par le trou de la porte la seule réponse qui nous vint fut qu’il tirerait une flèche sur nous si nous ne passions pas notre chemin. « Bien, maître Gourval ! déclara Simon. Cette réception est regrettable, d’autant plus regrettable que nous sommes venus de loin pour te serrer la main. » Gourval répond : « Tu peux me serrer la main sans entrer. » Simon interroge : « Comment cela ? » Gourval lui dit : « En passant ta main à travers le trou. » Simon refuse : « Je ne peux pas : j’ai une blessure à la main, qui a enflé et qui est trop grosse pour passer par le trou. » Gourval avait hâte de nous voir partir : « Ça ne fait rien ; tu n’as qu’à passer ta main gauche par le trou. » Mais Simon insiste : « J’avais quelque chose pour toi. Gourval. » L’aubergiste demande ce qu’il a. « Il y a eu un archer anglais qui a couché ici la semaine dernière ; il s’appelait Hugh de Nutbourne. » Gourval l’interrompt : « Nous avons beaucoup de coquins qui couchent ici. Je ne connais pas ton Hugh de Nutbourne. » Simon ne se laisse pas démonter : « Il a beaucoup de remords parce qu’il te doit quatorze deniers de vin qu’il a bu sans payer ; pour le soulagement de sa conscience il m’a prié de te remettre l’argent quand je passerais par ici. » Ce Gourval était très cupide : voici qu’il avance la main par le trou pour recevoir ses quatorze deniers ; mais Simon tenait son poignard prêt, lui cloue la main sur la porte : « J’ai payé la dette de l’Anglais, Gourval ! » lui dit-il. Là-dessus il a éperonné son cheval en riant si fort qu’il pouvait à peine se tenir en équilibre sur sa selle. Telle est l’histoire du trou que tu avais remarqué, et de la fente sous le trou. Je me suis laissé dire que depuis cet incident les archers anglais avaient été mieux traités dans l’auberge de Cadillac. Mais qui vois-je sur le bas-côté de la route ?
– Apparemment un saint homme, répondit Alleyne.
– Qui a, par la Croix, de bizarres marchandises ! s’écria John. Regardez ces fragments de pierres, ces bouts de bois et ces clous rouillés qui sont disposés devant lui !
L’homme qu’ils avaient aperçu était assis, adossé à un cerisier, et il avait allongé ses jambes pour être plus à son aise. Sur ses genoux il avait posé une planche où étaient étalés toutes sortes de petits débris de bois, de briques et de pierres, bien rangés comme les denrées d’un marchand ambulant. Il était vêtu d’une longue robe grise et était coiffé d’un chapeau de la même couleur, défraîchi, au bord duquel dansaient trois coquilles de palourdes. En s’approchant les trois voyageurs remarquèrent qu’il était âgé, et que ses yeux jaunes étaient révulsés.
– Chers chevaliers et gentilshommes ! s’écria-toi ! d’une voix grinçante. Dignes chrétiens ! Poursuivrez-vous votre chemin en laissant un vieux pèlerin mourir de faim ? Mes yeux ont été brûlés par les sables de la Terre Sainte, et je n’ai ni mangé ni bu depuis deux jours.
– Par ma garde, père, dit Aylward en l’examinant avec attention, je m’émerveille que ta ceinture si large te tienne si serrée, puisque tu as eu si peu à mettre dessous !
– Aimable inconnu, répondit le pèlerin, tu as sans le vouloir prononcé des paroles qu’il m’a été très douloureux d’entendre. Cependant j’aurais honte de t’en blâmer, car je suis sûr que tu n’as pas parlé ainsi pour m’affliger, ni pour me rappeler mon mal. Il ne me plaît guère d’évoquer ce que j’ai enduré pour la foi ; mais puisque tu es observateur, je dois te dire que la grosseur de mon ventre provient d’une hydropisie que j’ai contractée en montant trop vite de la maison de Pilate au mont des Oliviers.
– Que cela, Aylward, fit Alleyne qui avait rougi, arrondisse ta langue trop pointue ! Comment as-tu osé ajouter aux douleurs de ce saint homme qui a tant souffert et qui est allé jusqu’au tombeau sacré du Christ ?
– Que le diable me coupe la langue ! s’écria l’archer repentant.
– Je te pardonne de tout mon cœur, mon cher frère ! balbutia le vieil aveugle. Mais, oh, les mots impies qui viennent de t’échapper me font plus mal aux oreilles que tout ce que tu pourrais dire de moi !
– Je n’ouvrirai plus la bouche ! s’exclama Aylward. Voici un florin pour toi, et je te demande de me bénir.
– En voici un autre, dit Alleyne.
– Plus un troisième ! cria Hordle John.
Mais le pèlerin ne voulut pas accepter leurs aumônes.
– Orgueil ! Orgueil puéril ! s’écria-t-il en se frappant la poitrine de sa large main brune. Combien de temps me faudra-t-il pour que je m’en débarrasse ? Ne le vaincrai-je jamais ? Forts, forts, forts sont les liens de la chair ! Comme il est difficile de les soumettre à l’esprit ! Je suis issu, amis, d’une noble maison, et je ne peux pas me résoudre à accepter cet argent, quand bien même il me sauverait de la tombe.
– Hélas, père ! dit Alleyne. Comment donc pourrions-nous vous aider ?
– Je m’étais assis ici pour mourir, répondit l’aveugle. Mais depuis de nombreuses années je promène dans ma besace ces objets précieux que vous voyez étalés. Et j’ai pensé que je commettrais un péché si j’acceptais que mon secret meure avec moi. Je vendrai donc aux premiers passants venus, pourvu qu’ils en soient dignes, ces objets dont le prix me suffira pour me rendre à la chapelle de Notre-Dame de Rocamadour, où je souhaite donner à mes vieux os leur repos éternel.
– Quels sont donc ces trésors, père ? interrogea Hordle John. Je ne vois qu’un vieux clou rouillé, des fragments de pierre et des bouts de bois.
– Mon ami, répondit le pèlerin, tout l’argent qu’il y a dans ce pays ne suffirait pas pour payer le juste prix de ces choses. Vois-tu ce clou ? fit-il en se découvrant et en levant vers le ciel ses yeux privés de vue. Il est l’un de ceux grâce auxquels a été assuré le salut des hommes. Je l’ai acquis, ainsi que ce morceau de la vraie Croix, auprès du vingt-cinquième descendant de Joseph d’Arimathie, qui vit encore à Jérusalem en bonne santé, en dépit d’une furonculose incurable. Oui, vous pouvez vous signer ; je vous prie de ne pas les baiser, et de ne pas les toucher avec vos doigts.
– Et le bois et la pierre, père ? demanda Alleyne en retenant son souffle devant les précieuses reliques.
– Ce morceau de bois vient, je te l’ai dit, de la vraie Croix ; cet autre vient de l’arche de Noé, et ce troisième d’un montant de porte du temple du sage Salomon. Cette pierre-ci a été lancée contre saint Étienne ; les deux autres ont été prises à la tour de Babel. Voici aussi un fragment du roseau d’Aaron, et enfin une boucle de cheveux du prophète Élie.
– Mais, père, fit Alleyne, le saint Élie était chauve, ce qui lui attira les injures et les insultes des enfants du mal.
– Il est très exact qu’il n’avait pas beaucoup de cheveux, répliqua le pèlerin. C’est justement ce qui rend cette relique extrêmement précieuse. Faites à présent votre choix, dignes gentilshommes, et vous me donnerez contre ces objets que vous emporterez la somme que vous dictera votre conscience. Car je ne suis ni un colporteur ni un mercanti, et je ne m’en sépare que parce que je me sais près de ma récompense.
– Aylward, s’écria Alleyne très énervé, voici une chance que l’on ne rencontre pas deux fois dans sa vie ! Je veux avoir le clou, et j’en ferai don à l’abbaye de Beaulieu afin que tous les chrétiens d’Angleterre s’y rendent pour adorer et prier.
– Et moi je prends la pierre du temple, déclara John. Que ne donnerait pas ma vieille mère pour l’avoir suspendue au-dessus de son lit !
– Je choisis la baguette d’Aaron, dit Aylward. Je ne possède que cinq florins au monde : en voici quatre.
– En voici trois de plus, dit John.
– Et en voici cinq, ajouta Alleyne. Bon père, je te remets douze florins, qui est tout ce que nous pouvons te donner, bien que nous sachions que c’est un bien pauvre prix pour les trésors que tu nous vends !
– Abaisse-toi, orgueil ! Abaisse-toi, vanité ! cria le pèlerin en recommençant à se frapper la poitrine. Ne puis-je donc pas me courber assez pour accepter cette somme dérisoire en l’échange de ce qui m’a coûté toute une vie de souffrances et d’épreuves ? Donnez-moi cet argent impur ! Prenez ces reliques précieuses ! Oh, je vous prie de les manipuler avec douceur et respect ! Autrement je préférerais laisser pourrir mes vieux os indignes sur le bas-côté de la route.
Ils s’étaient découverts. Ils tendirent des mains tremblantes pour recevoir leurs trésors. Puis ils repartirent en laissant le vieux pèlerin assis sous le cerisier.
Ils chevauchèrent en silence. Ils tenaient leurs trésors dans leurs mains et les regardaient de temps en temps. Ils avaient du mal à croire en cette chance qui les avait transformés en détenteurs de reliques que n’importe quelle abbaye ou église de la Chrétienté aurait souhaité posséder. Ils voyagèrent donc, riches de cette bonne fortune, jusqu’à ce que, non loin d’un village, le cheval de John perdît un fer ; un maréchal ferrant se trouvait heureusement dans les environs ; pendant qu’il s’affairait sur la monture de l’archer, Alleyne lui conta le grand événement dont ils venaient d’être les héros. Mais le maréchal ferrant, quand il regarda les reliques, s’appuya sur son enclume et rit aux larmes en se tenant les côtes.
– Ma foi, mes maîtres, dit-il, cet homme est un coquillard, c’est-à-dire un vendeur de fausses reliques ! Il était ici devant ma forge il n’y a pas plus de deux heures. Ce clou qu’il vous a vendu, il me l’a pris dans ma boîte ; quant au bois et aux fragments de pierre, vous voyez ce tas dans la cour ? Il en a rempli sa besace.
– Mais non ! protesta Alleyne. C’était un saint homme qui avait voyagé jusqu’à Jérusalem et qui avait contracté une hydropisie en montant trop vite de la maison de Pilate au mont des Oliviers !
– Cela, je n’en sais rien ! répondit le maréchal ferrant. Mais je connais un homme coiffé d’un grand chapeau gris et vêtu d’une robe grise de pèlerin, qui était ici il n’y a pas longtemps, puis qui s’est assis sur cette souche un peu plus loin pour manger un poulet froid et boire un flacon de vin. Puis il m’a demandé l’un de mes clous, il a rempli de pierres sa besace, et il est reparti sur la route. Regardez mes clous : vous voyez bien que ce sont les mêmes que celui qu’il vous a vendu !
– Que Dieu nous protège ! s’écria Alleyne bouleversé. N’y a-t-il donc aucune borne à la méchanceté de l’espèce humaine ? Si humble, si âgé, si peu pressa de prendre notre argent, et pourtant scélérat et escroc ! En qui croire ? À qui se fier ?
– Je cours après lui ! fit Aylward en sautant sur sa selle. Viens, Alleyne ! Nous le rattraperons avant que le cheval de John soit ferré.
Ils partirent au galop ; bientôt ils aperçurent le vieux pèlerin en robe grise qui marchait lentement sur la route. Quand il entendit les sabots des chevaux, il se retourna. Sa cécité devait être un mensonge comme le reste, car il se mit à courir pour traverser un champ et s’enfoncer dans un bois touffu où les cavaliers ne purent le suivre. Ils jetèrent les reliques dans sa direction, puis rebroussèrent chemin, plus pauvres à la fois d’argent et de confiance.
CHAPITRE XXVII
Comment Roger Pied-bot fut dépêché au Paradis
Les trois camarades n’arrivèrent à Aiguillon que le soir. Ils y retrouvèrent Sir Nigel Loring et Ford décemment installés au « Bâton Rouge » ; ils soupèrent ensemble ; la chère était bonne ; ils dormirent dans des draps qui sentaient la lavande. Mais auparavant le hasard voulut qu’un chevalier du Poitou, Sir Gaston d’Estelle, descendît à la même hôtellerie ; il rentrait de Lituanie où il venait de servir avec les chevaliers teutoniques sous le commandement de l’évêque de Marienberg. Il entama avec Sir Nigel une longue discussion sur la technique des embuscades, des assauts et des sièges ; chaque argument était étayé sur l’avis de guerriers célèbres ou le récit d’actions d’éclat. Puis ils en vinrent à parler de musique et de chants : le chevalier étranger prit une citole ; jouant des lieder du Nord, il chanta d’une voix aiguë les aventures d’Hildebrand, de Brunehilde et de Siegfried, ainsi que toute la beauté et la force du pays d’Allemagne. Sir Nigel lui donna la réplique avec les Romans de Sir Eglamour et de Sir Isumbras. La longue nuit d’hiver s’écoula en chants alternés devant un feu de bois jusqu’à ce que les coqs se joignissent au concert. Pourtant, n’ayant dormi qu’une heure, Sir Nigel était gai et reposé lorsque après le petit déjeuner ils se remirent en route.
– Ce Sir Gaston est un très digne chevalier, dit-il à ses écuyers quand ils eurent quitté le « Bâton Rouge ». Il est animé d’un grand désir de se distinguer, et il n’aurait pas demandé mieux que d’ouvrir avec moi une discussion chevaleresque s’il n’avait pas eu le coude fracturé par un coup de sabot de cheval. J’ai conçu une grande amitié pour lui, et je lui ai promis qu’une fois son bras guéri nous échangerions quelques bottes. Mais il nous faut tourner à gauche.
– Non, mon beau seigneur, dit Aylward. La route de Montauban est de l’autre côté du fleuve, à travers le Quercy et l’Agenois.
– C’est exact, brave Aylward ; mais j’ai appris de la bouche de ce digne chevalier qui vient des marches de France, qu’une compagnie d’Anglais est en train d’incendier et de piller les environs de Villefranche. Je pense, d’après ce qu’il m’a dit, qu’il s’agit de nos hommes.
– Par ma garde, c’est assez vraisemblable ! répondit Aylward. Aux dernières nouvelles ils étaient demeurés si longtemps à Montauban qu’il ne devait plus rien y rester qui valût la peine d’être pris. Comme ils avaient déjà écumé le sud, ils sont remontés au nord du côté de l’Aveyron.
– Nous suivrons le Lot jusqu’à Cahors, puis nous traverserons les marches jusqu’à Villefranche, dit Sir Nigel. Par saint Paul, comme nous ne formons qu’une petite armée, il est probable que nous aurons quelques aventures agréables ! La frontière française est en effet assez agitée.
Toute la matinée ils abattirent des lieues sur une route bordée de peupliers. Sir Nigel chevauchait en tête avec ses écuyers ; les deux archers suivaient en encadrant le mulet. Ils avaient quitté Aiguillon et la Garonne qui se trouvaient loin au sud à présent, et ils suivaient le Lot placide dont les boucles bleues et calmes arrosaient une campagne légèrement ondulée. En Guyenne, remarqua Alleyne, les bourgades avaient été plus nombreuses que les châteaux ; à présent c’était l’inverse ; les châteaux abondaient et les maisons étaient rares. À gauche et à droite des murs gris et des donjons carrés menaçants émergeaient fréquemment des forêts ; les quelques villages qu’ils dépassèrent étaient tous ceints de remparts élevés par les habitants qui redoutaient les soudaines incursions ennemies dans cette région frontalière. Dans le courant de la matinée, à deux reprises, des escouades de cavaliers sortirent des places fortes aux noirs portails pour leur demander sans aménité d’où ils venaient et où ils allaient. Des bandes d’hommes armés circulaient sur la route ; des cortèges de mulets chargés de marchandises étaient gardés par des valets en armes ou par des archers loués par les commerçants.
– La paix de Brétigny n’a pas modifié grand-chose, dit Sir Nigel, car le pays est parcouru par des compagnies franches et des aventuriers. Entre les bois et cette colline lointaine, ces tours sont celles de Cahors ; au-delà c’est la France. Mais voici un voyageur sur le bas-côté de la route ; il a deux chevaux et un écuyer ; c’est sans doute un chevalier. Je te prie, Alleyne, de lui porter mon salut et de lui demander son titre et ses armes. Peut-être pourrai-je le relever d’un vœu, à moins qu’il n’ait une dame en l’honneur de qui il voudrait se distinguer.
– Non, mon bon seigneur, répondit Alleyne. Ce ne sont point des chevaux et un écuyer, mais des mulets et un valet. L’homme en question est un marchand, car il a un gros ballot à côté de lui.
– Que la bénédiction de Dieu soit sur vos honnêtes voix anglaises ! cria l’inconnu qui avait dressé l’oreille en entendant les paroles d’Alleyne. Jamais musique ne m’a été plus agréable à l’ouïe. Allons, Watkin, mets les ballots sur le dos de Laura ! J’avais le cœur presque brisé, car il me semblait que j’avais laissé derrière moi tout ce qui était anglais, et que je ne reverrais plus jamais le marché de Norwich.
Il était grand, vigoureux ; il pouvait avoir quarante ans ; il avait le visage rouge brique, une barbe brune grisonnante, et il était coiffé d’un large chapeau des Flandres rejeté sur la nuque. Son serviteur était aussi grand, mais très maigre et d’aspect farouche ; il équilibra les ballots sur le dos d’un mulet pendant que le marchand sautait sur l’autre et se dirigeait vers le groupe. Quand il s’approcha, nos voyageurs purent deviner, à la qualité de son vêtement et à la richesse du harnachement, qu’il avait une situation aisée.
– Messire chevalier, dit-il, je m’appelle David Micheldene, et je suis bourgeois et magistrat municipal de la bonne ville de Norwich. J’habite à cinq portes de l’église de Notre-Dame, comme vous le diraient tous ceux du bord de la Yare. J’ai ici des ballots de drap que je porte à Cahors… Maudit soit le jour où je suis parti ! Je sollicite votre précieuse protection pour moi, mon serviteur et mes tissus ; car j’ai déjà traversé des passes dangereuses, et je viens d’apprendre que Roger Pied-bot, le chevalier-brigand du Quercy, se trouve quelque part sur la route. Je suis donc disposé à vous donner un noble à la rose si vous me menez sain et sauf à l’auberge de « L’Ange » à Cahors, la même somme devant m’être versée à moi ou à mes héritiers s’il m’arrivait malheur à moi ou à mes marchandises.
– Par saint Paul, répondit Sir Nigel, je serais un triste chevalier si je réclamais un salaire pour assister un compatriote sur une terre étrangère ! Accompagnez-moi et soyez le bienvenu, maître Micheldene ; votre valet suivra avec mes archers.
– Que Dieu bénisse votre bonté ! s’écria l’Anglais. Si vous venez un jour à Norwich, vous aurez motif de vous rappeler que vous avez rendu service à Micheldene. Cahors n’est pas loin, car voici sûrement les tours de sa cathédrale qui se profilent à l’horizon ; mais j’ai beaucoup entendu parler de ce Roger Pied-bot, et plus on m’en a dit, moins je souhaite le regarder en face. Oh, je suis fatigué, las ! Je donnerais la moitié de mes biens pour voir ma belle dame assise tranquillement à mon côté et entendre les cloches de Norwich !
– Vos paroles me surprennent, dit Sir Nigel. Vous avez l’air d’un homme vigoureux, et je vois que vous portez une épée.
– Mon métier n’est pas de porter l’épée, répondit le marchand. Je suis sûr que si je vous installais dans ma boutique de Norwich, vous pourriez difficilement distinguer entre le velours de Gênes et le drap à trois poils de Bruges. Vous vous tourneriez alors vers moi pour que je vous aide. Or ici, seul sur une route, avec de grandes forêts et des chevaliers-brigands, je me tourne vers vous, car c’est une affaire qui est de votre ressort.
– Il y a du vrai dans ce que vous dites, maître Micheldene, fit Sir Nigel. Et j’espère que nous rencontrerons ce Roger Pied-bot, car on m’a assuré que c’était un soldat très robuste et expérimenté, bref un homme auprès de qui il y a beaucoup d’honneur à gagner.
– C’est un voleur sanguinaire ! répliqua le marchand. Et je voudrais le voir se balancer au bout d’une corde.
– Des hommes comme lui, fit observer Sir Nigel, permettent au véritable chevalier d’accomplir des actions honorables au cours desquelles il peut avancer en distinction.
– Des hommes comme lui, répliqua Micheldene, sont comme des rats dans un grenier ou comme des mites dans un drap : un malheur et un obstacle pour tous les pacifiques et les honnêtes gens.
– Mais si les périls de la route vous effraient à ce point, maître Micheldene, je m’étonne que vous vous soyez aventuré si loin de chez vous.
– Et parfois, messire chevalier, je m’en étonne moi-même. Je suis peut-être bougon et grognon ; mais quand j’ai décidé de faire quelque chose, je n’ai de cesse qu’elle soit faite. Il y a à Cahors un certain François Villet qui m’enverra du vin contre mon drap ; aussi vais-je à Cahors, malgré tous les chevaliers-brigands de la Chrétienté qui jalonnent ma route comme ces peupliers.
– Fièrement parlé, maître-magistrat municipal ! Mais comment s’est passé votre voyage jusqu’ici ?
– J’ai voyagé comme un agneau dans un pays de loups. Cinq fois nous avons dû supplier et prier pour avoir le passage. Deux fois j’ai payé le péage aux gardiens de la route. Trois fois nous avons tiré l’épée. Une fois à La Réole nous nous sommes retranchés derrière nos ballots de drap pendant tout le temps d’une litanie, et nous avons tué un bandit et blessé deux autres. Pardieu ! Nous sommes pacifiques, mais nous sommes aussi de libres bourgeois anglais qui ne souffrons pas d’être malmenés ni chez nous ni ailleurs. Aucun baron, aucun chevalier, aucun malandrin ne tirera de moi une fibre de lin tant que mon bras aura la force de dégainer cette épée.
– Une épée peu banale ! fit Sir Nigel. Que dis-tu, Alleyne, de ces lignes noires dessinées sur le fourreau ?
– Je n’en dis rien, mon beau seigneur !
– Moi non plus, dit Ford.
Le marchand émit un petit rire.
– C’est une idée à moi, dit-il. L’épée a été façonnée par Thomas Wilson, armurier, qui est fiancé à ma seconde fille Marguerite. Sachez donc que le fourreau a un mètre de long, et qu’il porte sur toute sa longueur les subdivisions de la mesure. Il pèse exactement deux livres, si bien que je peux aussi m’en servir comme d’un instrument de poids.
– Par saint Paul, s’exclama sir Nigel, l’épée vous ressemble, bon maître Micheldene : bonne pour la guerre ou pour la paix ! Mais même en Angleterre vous devez redouter les voleurs et les hors-la-loi, n’est-ce pas ?
– Le 1er août dernier, messire chevalier, j’ai été laissé pour mort près de Reading tandis que je me rendais à la foire de Winchester. Cependant j’ai réussi à traîner mes coquins devant le tribunal, et ils ne feront plus de mal aux marchands.
– Vous voyagez donc beaucoup ?
– Je me rends à Winchester, au marché de Linn, à la foire de Bristol, à Stourbridge et à Londres. Le reste de l’année vous pouvez toujours me trouver à cinq portes de l’église de Notre-Dame, où je voudrais bien être en ce moment, car l’air de Norwich n’a pas son pareil, et il n’y a pas de rivière plus belle que la Yare, et tous les vins de France ne valent pas la bière du vieux Sam Yelverton qui est le patron de la « Vache Brune ». Mais, holà ! Un mauvais fruit a poussé sur ce châtaignier.
Au bout d’un tournant en effet se dressait un grand arbre dont l’une des grosses branches se projetait en travers de la route. Au milieu de cette branche un homme était pendu ; sa tête faisait avec le corps un angle horrible ; ses orteils frôlaient le sol. Pour tous vêtements il n’avait qu’une chemise de fil et un caleçon de laine. Un petit homme au visage solennel était assis à côté du pendu sur le gazon ; d’une besace sortait un lot de papiers de toutes les couleurs ; il était somptueusement vêtu : chapeau écarlate, robe à fourrure, grandes manches tombantes bordées de soie couleur de feu. Il portait autour du cou une grande chaîne d’or ; des bagues scintillaient à chacun de ses doigts. Sur ses genoux il avait un petit tas de pièces d’or et d’argent qu’il laissait tomber une par une dans une bourse rebondie accrochée à sa ceinture.
– Que les saints vous protègent, braves voyageurs ! cria-t-il quand le groupe de cavaliers s’approcha. Que les quatre Évangélistes soient avec vous ! Que les douze Apôtres vous soutiennent ! Que l’armée bénie des martyrs dirige vos pas et vous conduise à la félicité éternelle !
– Grand merci pour ces bons vœux l répondit Sir Nigel. Mais je m’aperçois, maître Micheldene, que ce pendu est, d’après la forme de son pied, le chevalier brigand dont vous m’avez parlé. D’ailleurs un écriteau est apposé sur sa poitrine. Alleyne, je te prie de me le lire.
Le pendu se balançait doucement au vent de l’hiver ; un sourire figé apparaissait sur sa figure basanée ; ses yeux exorbitants fixaient la route qu’il avait terrorisée. En caractères grossiers cette oraison funèbre était écrite sur un parchemin :
« ROGER PIED-BOT
Par l’ordre du Sénéchal de
Castelnau, et de l’échevin
de Cahors, servants fidèles du
très vaillant et très puissant
Édouard, Prince de Galles et
d’Aquitaine.
Ne touchez pas,
Ne coupez pas,
Ne dépêchez pas. »
– Ça n’a pas été drôle de le voir mourir, dit l’homme qui était assis à côté du pendu. Il pouvait poser un orteil par terre et se soutenir : je croyais qu’il n’en finirait jamais. Mais maintenant il est enfin au Paradis ; je peux donc aller mon petit bonhomme de chemin terrestre.
Sur ces mots il enfourcha une mule blanche qui paissait derrière le châtaignier, pimpante avec sa futaine d’or et ses clochettes d’argent, et il se joignit au groupe de Sir Nigel qui repartait pour Cahors.
– Comment savez-vous qu’il est au Paradis ? interrogea Sir Nigel. Rien n’est impossible à Dieu, mais tout de même il faudrait une sorte de miracle pour que l’âme de Roger Pied-bot soit dans la compagnie des justes !
– Je sais qu’il est au Paradis parce que je viens de l’y introduire, répondit l’inconnu en frottant avec satisfaction ses mains baguées. Ma sainte mission est d’être pardonnaire. Vous voyez devant vous l’indigne serviteur et délégué de celui qui tient les clefs. Un cœur repentant et dix nobles à notre sainte mère l’Église peuvent éviter la perdition éternelle ; mais celui-ci a eu un pardon du premier degré, avec une bénédiction de vingt-cinq livres ; aussi je pense qu’il est passé devant le Purgatoire sans y entrer. Je suis arrivé quand les archers du sénéchal étaient en train de le suspendre, et je lui ai promis de demeurer avec lui jusqu’à la fin. Dans ses pièces d’argent j’ai bien trouvé deux couronnes de plomb, mais pour si peu je ne m’opposerai pas à son salut.
– Par saint Paul, s’écria Sir Nigel, si vous détenez vraiment le pouvoir d’ouvrir et de fermer les portes de l’espérance, vous vous placez nettement au-dessus du reste des hommes ! Mais si c’est de votre part une prétention injustifiée, je crains fort, maître clerc, que vous ne trouviez la porte fermée quand vous vous présenterez devant elle.
– Homme de peu de foi ! soupira le pardonnaire. Ah, messire Didyme se promène encore sur la terre ! Et cependant le scepticisme que je rencontre ne saurait ni aigrir mon cœur ni m’arracher un mot amer ; ne suis-je pas le pauvre artisan indigne d’une cause de douceur et de paix ? Tous les pardons que j’accorde sont contresignés par notre saint-père, le pivot et le centre de la Chrétienté.
– Lequel ? interrogea Sir Nigel.
– Ah, ah ! s’écria le pardonnaire en brandissant un index surchargé de pierreries. Vous cherchez à plonger profond dans les secrets de notre mère l’Église ? Apprenez donc que j’ai les deux Papes dans ma besace. Ceux qui sont pour Urbain ont le pardon d’Urbain, mais je suis aussi dépositaire du pardon de Clément pour les clémentistes. Quant au moribond qui n’a pas fait son choix il peut recevoir les deux pardons : advienne que pourra, le voilà tranquille. Je vous conseille vivement de m’en acheter un, car la guerre est un métier sanglant, et la mort survient brusquement sans laisser au soldat beaucoup de temps pour réfléchir, se confesser et recevoir l’absolution. Pour vous, messire, je vous adresse la même recommandation, car vous me paraissez être un homme qui aurait tort de se fier à ses propres mérites.
Ces derniers mots s’adressaient au marchand de Norwich qui l’avait écouté en fronçant le sourcil et en plissant la lèvre dédaigneusement.
– Quand je vends mon drap, répondit-il, celui qui achète peut le peser, le palper, le sentir. Ces marchandises que vous vendez sont invisibles, et il n’y a aucune preuve que vous les possédiez réellement. Par ailleurs, si un mortel avait le contrôle de la miséricorde divine, il devrait mener une vie haute et quasi divine, et nom pas s’endimancher avec des bagues, des chaînes et des soieries comme une fille de joie dans une kermesse.
– Le méchant homme sans vergogne ! cria le clerc. Oses-tu élever la voix contre l’indigne serviteur de notre mère l’Église ?
– Assez indigne, en effet ! dit David Micheldene. Je voudrais que tu saches, clerc, que je suis un libre bourgeois anglais, et que je dirais ce que je pense à notre père le Pape en personne. À plus forte raison à un laquais de laquais dans ton genre !
– Coquin de basse naissance ! Scélérat imbécile ! cria le pardonnaire. Tu parles sur des choses saintes à la hauteur desquelles ton intelligence de taupe ne saurait jamais t’élever. Tais-toi, sinon j’appelle sur toi la malédiction !
– Tais-toi toi-même ! rugit l’autre. Ignoble vautour ! Nous t’avons trouvé près de la potence comme un charognard. Ah, tu mènes une jolie existence, avec tes joyaux et ton vêtement de soie, en escroquant aux mourants leurs derniers shillings ! Je me moque de ta malédiction ! Reste par ici, si tu veux mon avis, car en Angleterre tu serais brûlé vif le jour où maître Wicliff y fera la loi. Vil voleur ! C’est toi, ce sont des hommes comme toi qui discréditent les nombreux hommes d’Église qui mènent une vie pure et sainte. Tu demeureras derrière la porte du Ciel, ou plus vraisemblablement tu tomberas derrière celle de l’enfer !
Cette dernière insulte fit pâlir de rage le pardonnaire qui leva une main frémissante et déversa sur le marchand en colère un flot d’imprécations en latin. Mais David Micheldene n’était pas homme à se laisser convaincre par des phrases : il empoigna le fourreau de son épée et se mit à taper sur la tête du commissionnaire en anathèmes. Le clerc, incapable d’esquiver l’averse de coups qui s’abattait sur lui, enfonça ses éperons dans le ventre de sa mule qui piqua des deux ; son adversaire se lança aussitôt à sa poursuite ; quand Watkin vit son maître partir au galop, il démarra à son tour en entraînant le mulet chargé des ballots de tissu. Le bruit des voix et des sabots mourut bientôt en s’éloignant : Sir Nigel et Alleyne se regardèrent avec stupéfaction, tandis que Ford éclatait de rire.
– Pardieu ! dit le chevalier. Ce David Micheldene doit être l’un de ces Lollards sur le compte desquels le Père Christopher du prieuré en savait long. Pourtant il ne m’avait pas fait l’impression d’un mauvais homme !
– Je savais que Wicliff avait beaucoup de partisans à Norwich, répondit Alleyne.
– Par saint Paul ! Je ne les aime guère, dit Sir Nigel. Je suis lent à changer : si l’on me retire la foi dans laquelle j’ai été élevé, il se passerait du temps avant que j’en apprenne une autre qui la remplacerait. Un copeau ici, un copeau là, ce n’est pas grand-chose, mais à la longue l’arbre pourrait bien tomber ! D’autre part, je suis bien obligé de considérer comme une honte qu’un homme décide de la miséricorde divine et la distribue comme un aubergiste sert son vin avec un robinet !
– Et cela ne fait pas partie, ajouta Alleyne, de l’enseignement de notre mère l’Église dont il avait la bouche pleine. Il y avait du vrai dans ce que disait le marchand.
– Par saint Paul, conclut Sir Nigel, qu’ils règlent donc entre eux leur différend ! Moi, je sers Dieu, le Roi et ma dame ; et tant que je pourrai suivre le chemin de l’honneur je m’en contenterai. Mon credo sera toujours celui de Chandos :
Fais ce que dois, advienne que pourra !
C’est commandé au chevalier.
CHAPITRE XXVIII
Comment les camarades passèrent dans les marches de France
Après avoir traversé Cahors, Sir Nigel et ses compagnons abandonnèrent la grand-route, laissèrent la rivière sur leur nord, et suivirent un petit chemin qui serpentait dans une plaine aussi vaste que désolée. Ce chemin les fit passer parmi des marécages et des bois, puis les mena dans une clairière au milieu de laquelle coulait un cours d’eau rapide. Les chevaux le franchirent sans difficulté ; en abordant sur l’autre rive, Sir Nigel annonça à son escorte qu’ils se trouvaient à présent sur la terre de France. Pendant quelques lieues ils reprirent le petit chemin qui aboutit enfin dans une région découverte et accidentée comme celle qu’ils avaient traversée entre Aiguillon et Cahors.
Si le paysage avait été sinistre aux abords de la frontière anglaise, il se révéla bien pire au-delà. Qui en effet pourrait dépeindre la hideuse désolation de cette terre française dix fois dévastée ? Le sol portait d’affreuses cicatrices qui le défiguraient. Par places subsistaient des taches noires : c’étaient les décombres de fermes incendiées. Ici et là surgissait la pointe d’un pignon délabré de ce qui autrefois avait été un château. Des haies brisées, des clôtures défoncées, des murs croulants, des vignobles parsemés de pierres, des ponts aux arches fracassées… De quelque côté que se tournât le regard, il ne discernait que des traces de ruine et de rapines. Parfois, loin à l’horizon, les tourelles rébarbatives d’un château, une flèche gracieuse de monastère ou d’église indiquaient les lieux où les forces de l’épée et de l’esprit avaient pu préserver un petit îlot de sécurité dans ce décor de misère. Taciturnes, Sir Nigel et son escorte trottaient sur cette route déprimante. Ils savaient par ouï-dire que de l’Auvergne au nord jusqu’aux marches de Foix dans le Midi il n’y avait plus un seul village souriant, plus une seule maison prospère.
Ils aperçurent d’étranges silhouettes faméliques qui grattaient et raclaient le sol là où poussaient des herbes folles et des chardons ; à la vue des cavaliers les pauvres hères levaient les bras en l’air et s’enfuyaient parmi les broussailles, craintifs et lestes comme des bêtes sauvages. Ils rencontrèrent aussi des familles entières prostrées sur le côté de la route, trop affaiblies par la faim et la maladie pour s’enfuir : elles demeuraient assises, tels des lièvres sur une touffe d’herbe, haletant de terreur et les yeux fous. Ces malheureux étaient si décharnés, si épuisés, si courbés, si moroses, si désespérés que les jeunes Anglais n’osaient plus les regarder : leur aspect faisait mal. On aurait dit des êtres à qui toute espérance et toute lumière auraient été à jamais retirées : lorsque Sir Nigel leur lançait une poignée de monnaie, leurs visages durs ne s’adoucissaient pas ; ils se jetaient avidement sur les pièces, puis l’interrogeaient du regard en mâchonnant des pousses sauvages. Les voyageurs aperçurent aussi dans des sous-bois des assemblages de brindilles et de rameaux : c’était là qu’ils dormaient, sur ce qui ressemblait davantage à des nids pour gibier à plumes qu’à une demeure humaine. Mais pourquoi auraient-ils construit autre chose ? Pourquoi se donneraient-ils du mal, puisque le premier aventurier venu aurait le droit d’incendier leur toit de chaume, et que leur seigneur confisquerait, en les accablant de coups et de malédictions, le fruit de leurs efforts ? Ils s’étaient installés au dernier degré de la misère ; leur seule consolation était de savoir qu’ils ne pouvaient pas descendre plus bas. Ils avaient néanmoins conservé le don de parole ; aussi tenaient-ils des assemblées au sein des sous-bois ; avec des yeux larmoyants ils regardaient en les désignant de leurs doigts amaigris les grands châteaux qui dévoraient comme un cancer la vie de la campagne. Quand de tels hommes parvenus au-delà de l’espoir et de la peur commencent à entrevoir la source de leurs malheurs, que les responsables prennent garde ! Le faible qui ne possède rien devient redoutable quand il n’est plus mû que par l’aiguillon du désespoir. Hauts et puissants sont les châteaux, basses et misérables les huttes des sous-bois ? Que Dieu aide le seigneur et sa dame le jour où les hommes des sous-bois entreprennent de se venger !
Le soleil commençait à décliner vers l’ouest. Les cavaliers anglais devaient se méfier et scruter soigneusement leur droite et leur gauche, car ils se trouvaient dans un no man’s land, et leurs seuls passeports étaient ceux qui étaient suspendus à leur ceinture. Français et Anglais, Gascons et Provençaux, Brabançons, Tardvenus, Écorcheurs, Francs Compagnons se disputaient cette région maudite. Celle-ci était si nue, si triste, et les habitations si rares et si pauvres que Sir Nigel commençait à se demander s’il trouverait des vivres et un gîte pour lui et son escorte. Il fut donc soulagé quand, leur chemin débouchant sur une grand-route, ils aperçurent une maison carrée blanche dont l’une des fenêtres du haut supportait un gros bouquet de houx au bout d’un bâton.
– Par saint Paul, fit-il, je ne suis pas mécontent ! Je redoutais le pire pour nous et nos chevaux. Galope en avant, Alleyne, et informe l’aubergiste qu’un chevalier anglais et son escorte logeront cette nuit chez lui.
Alleyne obéit et atteignit la porte de l’auberge alors que ses compagnons étaient encore à une portée de flèche. Comme il ne vit ni valet, ni palefrenier, il poussa la porte et appela l’aubergiste. Il cria trois fois ; ne recevant pas de réponse, il entra, poussa une porte au bout d’un couloir et pénétra dans la grande salle d’hôte de l’auberge.
Un agréable feu de bois crépitait dans l’âtre à un bout de la pièce ; auprès des flammes une dame était assise dans un fauteuil à haut dossier, le visage tourné vers la porte ; les lueurs dansantes l’éclairaient en plein ; Alleyne se dit qu’il n’avait jamais vu tant de majesté royale, de dignité et de force sur une figure de femme. Elle pouvait avoir trente-cinq ans ; la nature l’avait dotée d’un nez aquilin, d’une bouche ferme et pourtant sensible, de sourcils noirs bien arqués, et de deux yeux profondément enfoncés qui brillaient comme deux pierres de jais.
Son extrême beauté produisit pourtant sur Alleyne une impression moins vive que l’intensité de puissance et de sagacité qui se lisait sur le front haut, que la résolution inscrite dans la mâchoire carrée et le menton délicatement moulé. Un chapelet de perles étincelait dans ses cheveux noirs ; une gaze de fils d’argent retombait sur ses épaules ; enveloppée d’une cape sombre, elle se reposait au fond d’un fauteuil comme quelqu’un qui vient de faire un voyage.
Dans l’angle opposé, un homme trapu et large d’épaules lui faisait vis-à-vis ; il était vêtu d’un justaucorps noir bordé de zibeline, et il avait posé légèrement de travers sa toque de velours noir surmontée d’une plume blanche. Un flacon de vin rouge se trouvait à portée de la main ; il se tenait comme chez lui : les pieds sur un tabouret, et une assiette pleine de noix en équilibre sur ses cuisses. Il cassait les noix à grands coups de dents blanches, les mangeaient et jetaient leurs coques dans le feu. Pendant qu’Alleyne le regardait, il tourna la tête à demi et lui lança un coup d’œil par-dessus son épaule. Le jeune Anglais pensa qu’il n’avait jamais vu visage aussi hideux : ses yeux étaient vert clair, il avait le nez cassé et repoussé en dedans, la peau était grêlée et couverte de blessures. Sa voix résonna dans la pièce, aussi grave et féroce que le grognement d’un fauve.
– Jeune homme, lui dit-il, je ne sais pas qui vous pouvez être, et je ne suis guère enclin à me remuer ; si ce n’était que je désire prendre mes aises, je jure par l’épée de Josué que je vous lacérerais les épaules avec mon fouet à chiens pour vous punir d’empoisonner l’air que je respire !
Ahuri par cette entrée en matières et hésitant sur la réponse convenable qu’il pouvait faire en présence de la dame, Alleyne demeura la main sur la poignée de la porte tandis que Sir Nigel et ses compagnons descendaient de cheval. Au bruit de ces voix nouvelles qui s’exprimaient en anglais, l’inconnu jeta par terre son assiette de noix qui se brisa en mille morceaux et appela l’aubergiste par des cris qui firent trembler les murs. Tout pâle dans son tablier blanc, l’aubergiste accourut : ses mains tremblaient, ses cheveux se hérissaient d’effroi.
– Pour l’amour de Dieu, nobles seigneurs, chuchota-t-il en passant devant les Anglais, parlez-lui avec douceur et ne le brusquez pas ! Pour l’amour de la Vierge, soyez gentils avec lui !
– Qui est-ce donc ? s’enquit Sir Nigel.
Alleyne allait lui fournir quelques explications, quand un nouveau rugissement de l’inconnu l’interrompit.
– Coquin d’aubergiste ! criait-il. Ne t’ai-je pas demandé quand j’ai amené ici ma dame si ton établissement était propre ?
– Si en effet, seigneur !
– Ne t’ai-je pas demandé en particulier s’il n’y avait pas de vermine ?
– Si, seigneur !
– Et que m’as-tu répondu ?
– Qu’il n’y en avait pas, seigneur.
– Or cependant voilà moins d’une heure que je suis chez toi et des Anglais se sont déjà insinués ici. Où serons-nous donc libérés de cette race pestilentielle ? Est-ce qu’un Français en terre de France ne peut pas s’asseoir dans une auberge française sans avoir l’oreille blessée par leur ignoble manière grimaçante de parler ? Envoie-les au diable, aubergiste ! Sinon il t’arriverait de grands malheurs, à toi et à eux !
– Je le ferai, seigneur, je le ferai !… cria l’aubergiste épouvanté.
Il sortit de la salle d’hôte les yeux hors de la tête pendant que de sa voix douce la dame essayait d’apaiser la fureur de son compagnon.
– … Réellement, nobles seigneurs, vous feriez mieux de vous en aller ! vint dire l’aubergiste à Sir Nigel. Villefranche n’est qu’à une dizaine de kilomètres, et vous trouverez tout ce qu’il vous faut au « Lion Rouge ».
– Non, répondit Sir Nigel, je ne m’en irai pas avant d’avoir vu de plus près ce personnage qui me fait l’effet d’un homme dont il y a beaucoup à espérer. Quel est son nom, quels sont ses titres ?
– Je ne les dirai que s’il y consent. Mais je vous conjure, nobles seigneurs, de quitter ma maison, car je ne sais à quelles extrémités le pousserait sa rage s’il lui cédait !
– Par saint Paul, fit Sir Nigel, il s’agit certainement d’un homme qui vaut ce long déplacement ! Va lui dire qu’un modeste chevalier d’Angleterre désirerait faire plus ample connaissance, non pas par présomption, orgueil, ou mauvais vouloir, mais pour se distinguer en chevalerie et pour la gloire de sa dame. Transmets-lui le salut de Sir Nigel Loring, et informe-le que le gant que je porte sur ma toque appartient à la plus incomparable beauté de son sexe, et que je suis disposé à la soutenir contre n’importe quelle dame qu’il aurait le désir d’honorer.
L’aubergiste était en train de se demander s’il communiquerait ce message, quand la porte de la salle d’hôte s’ouvrit brusquement ; l’inconnu bondit comme une panthère hors de son repaire ; la colère bouleversait ses traits.
– Encore ici ? grommela-t-il. Chiens d’Angleterre, faudra-t-il vous chasser à coups de fouet ? Tiphaine, mon épée…
Il se retourna pour prendre son arme, mais en même temps il aperçut le blason sur l’écu de Sir Nigel : alors il interrompit son geste, et les flammes qui avaient allumé son regard s’éteignirent pour faire place à une lueur espiègle.
– … Mort Dieu ! s’écria-t-il. C’est mon petit épéiste de Bordeaux. Comment n’aurais-je pas reconnu cette cotte d’armes puisqu’il n’y a que trois jours que je l’ai vue sur la lice au bord de la Garonne. Ah, Sir Nigel ! Sir Nigel ! Vous me devez un dédommagement pour ceci…
Il toucha son bras droit qui, juste sous l’épaule, était ceint d’un mouchoir de soie.
Mais la surprise de l’inconnu à la vue de Sir Nigel n’était rien à côté de l’étonnement ravi qui illumina le visage du chevalier du Hampshire quand il reconnut la figure peu banale du Français. Deux fois il ouvrit la bouche ; deux fois il le dévora du regard comme pour s’assurer que ses yeux ne lui jouaient pas un mauvais tour.
– Bertrand ! balbutia-t-il enfin. Bertrand Du Guesclin !
– Par saint Yves ! s’esclaffa le guerrier français. J’ai bien fait de me présenter aux joutes avec la visière baissée, car celui qui m’a vu une fois n’a pas besoin qu’on lui dise mon nom. C’est bien moi, Sir Nigel, et voici ma main ! Je vous donne ma parole qu’il n’y a que trois Anglais au monde que je toucherais autrement que du tranchant de mon épée : le Prince en est un ; Chandos le deuxième ; vous le troisième. Car j’ai entendu dire beaucoup de bien de vous.
– Je prends de l’âge, et les guerres m’ont un peu fatigué, dit Sir Nigel. Mais je puis à présent mettre mon épée en repos sans regret, en me disant que j’ai croisé le fer avec celui qui possède le plus grand courage et le bras le plus fort de tout ce grand royaume de France. Je l’avais longtemps désiré, j’y avais rêvé ; et maintenant encore je peux difficilement admettre que ce grand honneur m’est réellement échu.
– Par la Vierge de Rennes ! Vous m’avez donné motif d’en être sûr, répondit Du Guesclin en riant de toutes ses dents blanches.
– Et peut-être, très honoré messire, vous plairait-il de poursuivre notre débat ? Peut-être condescendrez-vous à approfondir l’affaire ? Dieu sait que je suis indigne d’un tel honneur ! Et cependant je peux montrer mes soixante-quatre quartiers, et au cours de ces dernières vingt années j’ai participé à quelques combats et échauffourées !
– Votre réputation m’est bien connue, et je demanderai à ma dame d’inscrire votre nom sur mes tablettes, dit messire Bertrand. Nombreux sont ceux qui veulent avancer en chevalerie et qui réclament leur tour, car je ne me dérobe devant personne. Mais pour le moment je suis obligé de décliner votre proposition, car mon bras est encore raide depuis cette petite touche, et je voudrais vous faire plein honneur quand nous croiserons l’épée à nouveau. Entrez avec moi, et que vos écuyers viennent aussi, afin que ma douce épouse, dame Tiphaine, puisse se vanter d’avoir vu un chevalier si renommé et si courtois.
Ils pénétrèrent donc dans la salle d’hôte, pacifiques et réconciliés, où dame Tiphaine était assise comme une reine sur son trône afin que les nouveaux arrivants lui fussent présentés tour à tour. À vrai dire le solide courage de Sir Nigel, qui se souciait peu des courroux de sa tigresse d’épouse, fut un peu ébranlé par le visage calme et froid de cette dame majestueuse : vingt années de camp le rendaient plus à l’aise sur une lice que dans un boudoir. Pendant qu’il regardait ses lèvres fermes et ses yeux inquisiteurs, il se rappela avoir entendu raconter d’étranges histoires sur cette dame Tiphaine Du Guesclin. N’était-ce pas d’elle dont on disait qu’elle imposait les mains sur les malades et qu’elle les faisait lever de leurs grabats alors que les charlatans avaient épuisé vainement leurs remèdes ? N’avait-elle pas prédit l’avenir ? En certaines occasions ne l’avait-on pas entendue dans la solitude de sa chambre converser avec un être invisible, un esprit familier qui venait la trouver lorsque les barres étaient mises aux portes et aux fenêtres ? Sir Nigel baissa les yeux et esquissa le signe de croix sur le côté de sa jambe en saluant cette dangereuse personne ; mais au bout de cinq minutes il fut conquis, et avec lui ses deux jeunes écuyers. Ils ne pouvaient plus qu’être suspendus aux mots qui tombaient de ses lèvres parce que ces mots les remuaient jusqu’au plus profond d’eux-mêmes comme une sonnerie de bugles avant la bataille.
Plus tard, Alleyne devait souvent se rappeler cette scène vécue dans une auberge. Les ombres du soir étaient tombées, les angles de la salle longue et basse se drapaient d’obscurité. Le foyer projetait un cercle de lumière rouge dont le flamboiement jouait sur le petit groupe des voyageurs et donnait du relief à leurs attitudes respectives. Sir Nigel était assis, les coudes sur les genoux, le menton appuyé sur ses mains, un œil toujours recouvert d’une mouche mais l’autre brillant comme une étoile, le crâne chauve reflétant les lueurs du feu. Ford était assis à sa gauche, bouche bée, regard fixe, joues rouges, pétrifié comme s’il avait peur de remuer un membre. Le chevalier français s’était rejeté au fond de son fauteuil, le ventre et les cuisses parsemés de coques de noix, sa grosse tête calée et enfoncée dans un coussin, pendant que son regard amusé voyageait sans cesse de sa dame aux Anglais captivés. Enfin le visage presque blanc aux traits fermes, la voix claire et douce qui évoquait l’exaltation et l’immortalité de la gloire, le peu de valeur de la vie, la souffrance tirée de joies ignobles et la joie tirée de toutes les souffrances à fin noble… Tandis que les ombres s’épaississaient, dame Tiphaine discourait sur la valeur et la vertu, sur la loyauté, l’honneur et la renommée ; tous buvaient ses paroles sans se soucier du feu qui baissait et des cendres qui viraient du rouge au gris.
– Par saint Yves ! s’écria enfin Du Guesclin. Il est l’heure de réfléchir à ce que nous allons faire ce soir, car je ne crois pas que dans cette auberge de campagne nous trouvions un cantonnement convenable pour une honorable société.
En s’éveillant des rêves de chevalerie et de grandeur où l’avait entraîné le discours de cette dame extraordinaire, Sir Nigel émit une sorte de soupir.
– Peu importe où je dormirais, répondit-il, mais pour cette noble dame en effet ce genre de logement me semble un peu inconfortable.
– Ce qui satisfait mon seigneur me satisfait, dit-elle. Je constate, Sir Nigel, que vous êtes sous un vœu.
Elle regardait son œil recouvert de la mouche.
– J’ai l’intention d’essayer quelques petites choses, répondit-il.
– Et le gant ? Il appartient à votre dame ?
– Il appartient en effet à ma tendre épouse.
– Qui sans aucun doute est fière de vous !
– Dites plutôt que je suis fier d’elle, rectifia-t-il aussitôt. Dieu sait que je ne suis pas digne d’être son humble serviteur. Un homme, madame, peut toujours galoper à la lumière du jour et faire son devoir quand tout le monde a les yeux fixés sur lui. Mais dans le cœur féminin, il y a une force et une loyauté qui ne sollicitent aucune louange, et qui ne sont connues que de celui dont elles sont le trésor.
Madame Tiphaine sourit en regardant son mari.
– Vous m’avez souvent dit, Bertrand, qu’il y avait chez les Anglais de très courtois chevaliers.
– Oui, oui ! maugréa-t-il. Mais à cheval, Sir Nigel, vous et votre escorte ! Nous allons nous rendre au château de messire Tristan de Rochefort, qui est à une lieue de Villefranche. Messire Tristan de Rochefort, sénéchal d’Auvergne, est un vieux camarade de guerre à moi.
– Il sera certainement ravi de vous accueillir, répondit Sir Nigel. Mais peut-être regardera-t-il de travers quelqu’un qui est passé sur les marches sans autorisation.
– Par la Vierge, quand il saura que vous êtes venu pour faire partir ces bandits, il sera bien heureux de vous voir ! Aubergiste, voici dix pièces d’or. Tu garderas le surplus de mon compte pour en faire profiter le premier chevalier dans le besoin qui s’arrêtera ici. Partons, car il se fait tard et j’entends piaffer les chevaux.
Dame Tiphaine et son époux sautèrent en selle sans mettre le pied à l’étrier, et ils descendirent la route que blanchissait un rayon de lune. Sir Nigel se tenait à côté de la dame, et Ford à une longueur de lance derrière eux. Alleyne, qui s’était attardé un instant dans le couloir, entendit un grand cri ; ce cri provenait d’une salle d’où sortaient justement Aylward et John qui riaient comme deux écoliers qui auraient fait une bonne farce. Quand ils aperçurent Alleyne, ils prirent un air vaguement penaud et enfourchèrent leurs chevaux pour rejoindre Sir Nigel. De nouveaux cris s’élevèrent :
– À moi, mes amis ! À moi, camarades ! À moi, l’honorable champion de l’évêque de Montauban ! À la rescousse de la Sainte Église !
Les cris étaient si perçants qu’Alleyne, l’aubergiste et ses valets se précipitèrent.
Le spectacle qui les attendait ne manquait pas d’originalité. La salle était haute de plafond et longue, dallée, avec des murs nus. Sur une table en bois blanc placée au milieu il y avait un pichet de vin et deux gobelets. Un autre gobelet et une bouteille cassée se trouvaient sur une deuxième table plus petite. Fixés aux solives épaisses des crochets bien alignés supportaient des tranches de bacon, des morceaux de bœuf fumé, et des chapelets d’oignons. Mais au plus gros crochet, celui du milieu, était suspendu un petit homme rouge et gras pourvu d’énormes favoris, qui s’agitait désespérément en l’air et qui essayait d’agripper les jambons et tout ce qui était à portée de sa main. Le crochet avait été passé dans le col de son justaucorps de cuir ; il était suspendu comme un poisson au bout d’une ligne ; il frétillait ; il se tordait ; il était absolument incapable de se tirer de sa position incommode. Alleyne et l’aubergiste durent monter sur la table pour le dépendre ; il s’affala sur un siège, pantelant, furieux, et regarda autour de lui.
– Est-il parti ? bégaya-t-il.
– Parti ? Qui ?
– Lui, l’homme à la tignasse de rouquin, le géant.
– Oui, répondit Alleyne, il est parti.
– Et il ne reviendra pas ?
– Non.
– Tant mieux pour lui ! cria le petit bonhomme en poussant un soupir de soulagement. Mon Dieu ! Comment ! Moi, le champion de l’évêque de Montauban ! Ah, si j’avais pu descendre, avant qu’il prît la fuite ! Alors vous auriez vu. Vous auriez vu un beau spectacle ! Il y aurait eu un bandit de moins sur la terre. Ma foi oui !
– Mon bon maître Pelligny, dit l’aubergiste, ces seigneurs ne sont pas partis bien vite, et j’ai à l’écurie un cheval que je mets à votre disposition, car je préférerais que vous exécutiez vos menaces sanguinaires hors des quatre murs de mon auberge.
– J’ai mal à la jambe et je ne peux pas monter à cheval, répondit le champion de l’évêque. Je me suis déchiré un muscle le jour où j’ai tué trois hommes à Castelnau.
– Que Dieu vous sauve, maître Pelligny ! s’écria l’aubergiste. Ce doit être terrible d’avoir tant de sang sur la conscience ! Mais comme je ne veux pas voir maltraité un vaillant de votre trempe, je vais, moi, par amitié pour vous, courir après cet Anglais et vous le ramener.
– Tu n’iras pas ! cria le champion en saisissant convulsivement l’aubergiste au collet. Je t’aime beaucoup, Gaston ! Je ne voudrais pas faire de tort à ta maison, ni l’abîmer, ce qui se produirait immanquablement si un homme comme moi corrigeait cet Anglais.
– Non, ne pensez pas à moi ! protesta l’aubergiste. Que m’importe ma maison quand on a attenté à l’honneur de François Poursuivant d’Amour Pelligny, champion de l’évêque de Montauban ? Mon cheval, André !
– Non, par tous les saints ! Gaston, je ne veux pas ! Tu as eu raison tout à l’heure quand tu as dit que c’était terrible d’avoir tant de sang sur la conscience. Je ne suis qu’un soldat impitoyable, mais j’ai une âme. Mon Dieu ! Je réfléchis, je pèse, je balance… Ne retrouverai-je pas cet Anglais ? Ne suis-je pas capable de me souvenir de lui ? Si, si, je le reconnaîtrai à ses grosses pattes et à ses cheveux rouges !
– Et puis-je vous demander, messire, interrogea Alleyne, pourquoi vous vous intitulez champion de l’évêque de Montauban ?
– Rien de plus simple. L’évêque a besoin d’un champion parce que, si un combat est nécessaire à la défense d’une cause, il peut difficilement descendre en personne sur la lice, étant donné sa fonction, avec un écu de cuir et une trique pour échanger des coups avec le premier valet venu. Il lui faut donc un combattant éprouvé, un cogneur capable de donner ou de rendre des coups. Il ne m’appartient pas de dire s’il a eu raison, mais il est certain que celui qui croit n’avoir affaire qu’avec l’évêque de Montauban et qui se trouve face à face avec François Poursuivant d’Amour Pelligny…
À ce moment résonna sur la route un bruit de sabots et un valet cria qu’un Anglais revenait à l’auberge. Le champion affolé chercha des yeux un abri et il se préparait déjà à sauter par la fenêtre, quand du dehors Ford appela Alleyne en le priant de se hâter s’il voulait ne pas se perdre sur la route. L’écuyer descendit donc après avoir fait ses adieux à l’aubergiste et au champion ; un court galop l’amena à la hauteur des deux archers.
– Tu as fait du joli, John, s’écria-t-il. Tu auras bientôt toute la sainte Église à tes trousses si tu pends ses champions aux crochets d’une auberge de campagne !
– Je l’ai fait sans penser à mal, répondit le gros John sur un ton d’excuse.
Aylward pouffa.
– Par ma garde, mon petit, tu aurais bien ri toi aussi si tu nous avais vus ! Car ce bonhomme était si bouffi d’orgueil qu’il ne voulait ni boire avec nous, ni s’asseoir à la même table, ni répondre à nos questions ; par contre il ne cessait de raconter au valet qu’il était bien heureux pour nous que la guerre fût terminée parce qu’il avait tué plus d’Anglais qu’il n’avait de ferrets sur son doublet. Notre brave vieux John ne connaissait pas assez le français pour lui donner la réplique : alors il a allongé le bras et l’a placé fort gentiment à l’endroit où tu l’as découvert. Mais dépêchons-nous ; je n’entends presque plus les sabots de leurs chevaux.
– Je crois que je les aperçois, dit Ford.
– Pardieu oui ! Ils sortent de l’ombre. Et là-bas cette masse sombre est le château de Villefranche. En avant, camarades ! Sinon, Sir Nigel arrivera au portail avant nous. Mais écoutez, mes amis ! Quel est ce bruit ?
Un son de trompe retentit dans des bois sur leur droite. Il fut suivi d’une autre sonnerie en réponse sur la gauche, puis de deux autres derrière eux.
– Ce sont des trompes de porchers, dit Aylward. Mais je me demande pourquoi elles sonnent à une heure si tardive.
– Peu importe, avançons, dit Ford.
Toute l’escorte galopa alors jusqu’au seuil du château de Villefranche dont le pont-levis avait déjà été baissé et la herse levée devant les sommations de Du Guesclin.
CHAPITRE XXIX
Comment dame Tiphaine eut son heure bénie de voyance
Messire Tristan de Rochefort, sénéchal d’Auvergne et seigneur de Villefranche, était un guerrier réputé qui avait blanchi sous les guerres contre l’Angleterre. Comme il avait la garde d’un pays exposé, il ne savait guère ce qu’était le repos, même en ce temps dit de paix ; il consacrait ses journées à lutter contre les Brabançons, les Tardvenus, les Écorcheurs, les Compagnons Francs et les archers pirates qui maraudaient sur sa province. Tantôt il rentrait en triomphateur, et une douzaine de cadavres se balançant au haut de son donjon avertissaient les malfaiteurs que la loi n’était pas lettre morte. Tantôt ses expéditions étaient moins heureuses, et il se hâtait alors de se réfugier, lui et ses soldats, derrière le pont-levis tandis que sifflaient à ses oreilles les flèches de ses poursuivants. Il était dur de poigne et de cœur, haï de ses ennemis, détesté de ses protégés car il avait été capturé deux fois et deux fois sa rançon avait été arrachée, sous les coups et les tortures, aux paysans affamés et aux fermiers ruinés.
Le château de Villefranche était aussi rébarbatif et farouche que son propriétaire. Le clair de lune montra aux voyageurs une large douve, une haute muraille extérieure garnie de tourelles aux angles, et un grand donjon noir qui dominait l’ensemble. Grâce à deux flambeaux allumés aux étroites ouvertures pratiquées de chaque côté du pesant portail, ils aperçurent les têtes menaçantes et les armes du corps de garde. Toutefois l’aigle à deux têtes de Du Guesclin était un passeport qui ouvrait toutes les forteresses de France. À peine avaient-ils franchi le portail que le vieux chevalier accourut les bras ouverts pour accueillir son illustre camarade. Il ne fut pas moins content de voir Sir Nigel quand il apprit le but de sa mission, car les archers de la Compagnie Blanche lui tenaient la dragée haute et avaient mis en déroute deux expéditions qu’il avait organisées contre eux. Ce serait un vrai jour de fête pour le sénéchal d’Auvergne quand le dernier archer anglais aurait quitté les marches.
Il y avait toujours de quoi préparer un festin dans un château, à une époque où la chère était si maigre dans les chaumières. En moins d’une heure les hôtes du sénéchal se trouvèrent assis autour d’une table qui craquait sous le poids des pâtés et des quartiers de viande, qu’accompagnaient ces plats délicats où excellent les Français et qui s’appelaient ortolans aux épices et bécasses farcies. Madame de Rochefort, une blonde qui aimait à rire, était placée à la gauche de son guerrier de mari et dame Tiphaine à la droite. Ensuite venaient Du Guesclin et Sir Nigel, ainsi que le sire Amory Monticourt, de l’Ordre des Hospitaliers, et le seigneur Otto Harnit, chevalier errant de Bohême. Ces convives, auxquels s’ajoutaient Alleyne et Ford, quatre écuyers français et le chapelain du château, constituaient la société rassemblée ce soir-là au château de Villefranche pour festoyer. Un grand feu de bois brûlait dans la cheminée, des faucons encapuchonnés dormaient sur leurs perchoirs, des lévriers aux yeux interrogateurs étaient couchés sur le plancher ; des pages en costume lilas se tenaient près des invités. Rires et plaisanteries fusaient de tous côtés ; l’ambiance était à la concorde et au confort. Ils songeaient peu aux hommes des sous-bois qui étaient couchés dans leurs haillons à la lisière des forêts et qui regardaient de leurs yeux hagards, sauvages, les lumières dorées qui éclairaient les hautes fenêtres du château.
Lorsque le souper fut achevé, les tables disparurent comme par enchantement, et des banquettes furent disposées devant le feu, car il faisait froid. Dame Tiphaine s’était enfoncée dans les coussins d’un fauteuil, et ses longs cils noirs étaient retombés sur ses yeux brillants. Alleyne, regardant dans sa direction, remarqua que son souffle était devenu rapide et bref, et que ses joues avaient pris la pâleur du lis. Du Guesclin l’observait par instants, et il passait ses larges doigts brunis à travers ses boucles noires avec un air de perplexité.
– Le peuple par ici, disait le chevalier de Bohême, ne me semble pas trop bien nourri.
– Ah, la canaille ! s’écria le seigneur de Villefranche. Vous le croirez à peine, mais quand j’ai été fait prisonnier à Poitiers, ma femme et mon frère de lait ont été obligés de prélever l’argent de ma rançon : eh bien, ces chiens auraient préféré subir deux tours de chevalet, ou les poucettes pendant une heure, plutôt que de payer un denier pour leur suzerain et seigneur ! Cependant il n’y en a pas un qui n’ait caché quelque part un vieux bas rempli de pièces d’or !
– Alors pourquoi n’achètent-ils pas de quoi manger ? demanda Sir Nigel. Par saint Paul, on dirait que les os risquent de traverser leur peau !
– C’est leur mauvais esprit qui les rend maigres. Nous avons un dicton, Sir Nigel, qui court le pays : « Oignez vilain, il vous poindra ; poignez vilain, il vous oindra ! » Ce doit être la même chose en Angleterre.
– Ma foi non ! répondit Sir Nigel. Dans mon escorte j’ai deux Anglais de cette classe populaire, qui sont en ce moment, j’en suis sûr, aussi pleins de votre vin que les tonneaux de votre cave. Celui qui se hasarderait à les poindre pourrait se faire oindre d’une manière dont il se souviendrait toute sa vie.
– Je ne comprends pas cela, dit le sénéchal, car les chevaliers et les nobles anglais que j’ai connus n’étaient pas hommes à tolérer l’insolence des mal-nés.
– Peut-être, mon beau seigneur, les vilains d’Angleterre ont-ils le caractère plus doux et une meilleure contenance ! dit en riant madame de Rochefort. Mon Dieu ! Vous ne pouvez pas imaginer comme ici ils sont laids ! Ils n’ont plus de cheveux, plus de dents, ils sont tordus et voûtés ; je me demande comment le bon Dieu a pu créer de tels êtres. Je ne peux pas supporter de les voir, moi ! Et mon fidèle Raoul me précède toujours avec une trique pour les chasser de mon chemin.
– Et cependant, belle dame, et cependant ils ont une âme ! murmura le chapelain.
– Je vous ai entendu le leur dire, fit le seigneur du château. Et pour ma part, mon Père, bien que je sois un fils loyal de la sainte Église, je pense que vous emploieriez plus utilement votre temps en disant votre messe et en instruisant les enfants de mes hommes d’armes qu’en vous promenant dans la campagne pour mettre dans la tête de ces gens des idées qu’ils n’auraient jamais eues si vous ne vous en étiez pas mêlé. Il paraît que vous leur avez dit que leurs âmes valaient les nôtres et que dans l’autre vie ils pourraient être placés au même rang que le plus vieux sang d’Auvergne. À mon avis, il y a au Ciel tant de dignes chevaliers et de vaillants gentilshommes qui savent comment arranger ces choses-là que nous avons peu à craindre de nous trouver mélangés avec ces bas roturiers et ces gardiens de cochons. Récitez vos prières, chapelain, et égrenez votre rosaire, mais ne vous interposez pas entre moi et ceux que le Roi m’a donnés.
– Que Dieu les aide ! s’écria le chapelain. Un plus haut Roi que le vôtre me les a donnés à moi, et je vous dis bien haut dans votre propre château, messire Tristan de Rochefort, que vous avez grandement péché dans votre comportement à l’égard de ces pauvres gens, et que l’heure viendra (elle est peut-être toute proche) où la main de Dieu s’abattra lourdement sur vous à cause de ce que vous avez fait.
Il s’était levé ; à pas lents il sortit de la pièce.
– La peste l’emporte ! cria le chevalier français. À présent, comment doit-on agir avec un prêtre, messire Bertrand ? On ne peut ni le rosser comme un homme ni le cajoler comme une femme !
– Hé, messire Bertrand le sait bien, le méchant ! s’écria madame de Rochefort. Tous ici nous n’ignorons pas comment il est allé en Avignon pour extorquer cinquante mille couronnes au Pape.
– Ma foi ! s’exclama Sir Nigel en regardant Du Guesclin avec une admiration non dépourvue d’horreur. Votre cœur n’a pas frémi de crainte ? Vous n’avez pas senti la menace d’une malédiction suspendue au-dessus de votre tête ?
– Je n’ai rien remarqué, répondit négligemment le Français. Mais, par saint Yves, votre chapelain, Tristan, me paraît être un fort digne homme, et vous devriez écouter ses propos, car moi qui ne me soucie guère de la malédiction d’un mauvais Pape, je serais fâché d’être privé de la bénédiction d’un bon prêtre !
– Prenez garde, mon beau seigneur ! s’écria madame de Rochefort. Prenez garde, je vous en supplie, car je ne tiens pas à ce qu’un mauvais sort me soit jeté : la peste ou une paralysie des membres. Je me rappelle qu’une fois vous avez mis en colère le Père Étienne, et ma dame d’atours m’a dit ensuite qu’en sept jours j’avais perdu plus de cheveux que jamais auparavant en un mois.
– Si c’est là un signe de péché, alors par saint Paul je dois être grand pécheur ! fit Sir Nigel parmi les rires. Mais en vérité, messire Tristan, si j’ose aventurer un avis personnel, je vous conseillerais de faire votre paix avec ce brave homme.
– Je lui donnerai quatre chandeliers d’argent, murmura le sénéchal rembruni. Et pourtant je voudrais bien qu’il laisse le peuple tranquille ! Vous ne pouvez pas concevoir le degré de stupidité et d’entêtement auquel les manants sont arrivés. Les mulets et les cochons sont pleins de raison à côté d’eux. Dieu sait pourtant si je suis patient ! Tenez, pas plus tard que la semaine dernière, j’ai eu à leur soutirer un peu d’argent. J’ai convoqué au château Jean Goubert qui, comme chacun le sait, a une petite cassette remplie de pièces d’or cachée dans un tronc creux. Je vous donne ma parole que je ne lui ai même pas caressé le dos de mon fouet. Je lui ai parlé, je lui ai dit pourquoi j’avais besoin d’argent, et je l’ai enfermé dans mon donjon pour qu’il réfléchisse pendant la nuit. Que pensez-vous qu’a fait ce chien ? Au matin, nous l’avons trouvé pendu à un barreau de la fenêtre : il s’était confectionné une corde avec des morceaux de son justaucorps en cuir !
– Cette méchanceté est incompréhensible ! s’écria madame de Rochefort.
– Et il y a eu aussi Gertrude Le Bœuf ; c’était une servante aussi jolie qu’on pouvait le souhaiter, mais méchante et aigrie comme les autres. Quand le jeune Amory de Valence est venu ici, le 1er août dernier, il a gentiment regardé cette jeune fille et il lui a même proposé de la prendre à son service. Qu’a-t-elle fait, elle et son chien de père ? Hé bien, ils se sont attachés ensemble et ils se sont jetés dans l’étang qui a deux mètres de fond. Je vous jure, le jeune Amory en a eu beaucoup de chagrin, et il a fallu plusieurs jours pour le consoler ! Comment voulez-vous bien servir des gens qui sont aussi ingrats que déraisonnables ?
Pendant que le sénéchal d’Auvergne narrait par le menu les actes répréhensibles de ses serfs, Alleyne s’était laissé captiver par le visage de dame Tiphaine. Elle s’était enfoncée davantage dans son fauteuil ; elle avait fermé ses paupières ; le sang s’était retiré de sa figure. Alleyne crut d’abord que la fatigue du voyage était la cause de cette transformation, et qu’une faiblesse l’avait prise. Mais un nouveau changement se produisit bientôt : la couleur reparut sur ses joues, les paupières se soulevèrent lentement, et ses yeux brillèrent d’un éclat extraordinaire ; ils fixaient leur regard non sur l’assemblée, mais sur une tapisserie sombre qui était accrochée à un mur. Son expression était devenue éthérée. Rêvant à des archanges ou à des séraphins, Alleyne n’avait jamais imaginé un visage plus doux, plus féminin, et cependant plus sage. Il regarda Du Guesclin : lui aussi surveillait sa femme ; le tiraillement de ses traits, des gouttes de sueur sur son front traduisaient son émoi devant la métamorphose qu’il observait.
– Comment vous sentez-vous, madame ? interrogea-t-il d’une voix frémissante.
Elle n’abaissa pas son regard qui demeura posé sur la tapisserie, et il s’écoula un long moment avant qu’elle lui répondît. Sa voix qui avait été si chantante, si claire, retentit étrangement étouffée et basse, comme si elle venait de loin.
– Je me sens très bien, Bertrand. L’heure bénie de la voyance approche encore.
– Je la voyais approcher ! Oui, je la voyais ! s’exclama-t-il en promenant ses doigts dans sa chevelure. Il s’agit d’un incident fortuit, messire Tristan, et je me demande comment vous l’expliquer en termes clairs, à vous, à votre noble épouse, à Sir Nigel et à ces autres chevaliers étrangers. Ma langue est brusque : elle est plus apte à donner des ordres qu’à vous éclaircir une affaire de ce genre dont moi-même je comprends peu de choses. Ce que je sais toutefois, c’est que ma femme est issue d’une très sainte race et que Dieu dans Sa sagesse l’a dotée de grandes vertus : Tiphaine Raguenel était célèbre dans toute la Bretagne avant que je la visse pour la première fois à Dinan. Ces vertus, ces pouvoirs ne sont utilisés que pour le bien ; ils sont un don de Dieu et non pas un présent du diable ; voilà toute la différence entre la magie blanche et la magie noire.
– Peut-être devrions-nous faire quérir le Père Étienne ? suggéra messire Tristan.
– Il vaudrait mieux qu’il vienne ! cria le chevalier de l’Ordre des Hospitaliers.
– Et qu’il apporte de l’eau bénite, ajouta le chevalier de Bohême.
– Non, messires ! répondit Bertrand Du Guesclin. Il n’est nullement nécessaire de faire venir ce prêtre ; j’ai d’ailleurs dans l’idée qu’en réclamant sa présence, vous jetez une ombre, voire une tache sur le bon renom de mon épouse, comme si vous vous demandiez d’où elle détient ce pouvoir, d’en haut ou d’en bas. Pour peu que vous ayez un doute, je vous prie de bien vouloir m’en informer, afin que nous en discutions d’une manière appropriée.
– En ce qui me concerne, dit Sir Nigel, j’ai entendu tomber de la bouche de cette dame de telles paroles que je crois qu’il n’existe aucune femme, sauf une seule, qui puisse lui être comparée sous le double rapport de la beauté et de la bonté. Si l’un des gentilshommes présents est d’un avis différent, je considérerais comme un grand honneur de courir une petite lance avec lui, ou de discuter de l’affaire de la manière qui lui conviendrait le mieux.
– Il serait malséant de ma part, déclara le sénéchal d’Auvergne, de douter d’une dame qui est à la fois mon invitée et la femme de mon compagnon d’armes. Je vois d’autre part sur sa capeline une croix d’argent : ce signe suffirait à me convaincre qu’il n’y a aucune diablerie dans les pouvoirs extraordinaires que selon vous elle possède.
Cet argument du seigneur de Villefranche impressionna le Bohêmien et l’Hospitalier qui convinrent tout de suite que leurs objections avaient été mal fondées. Quant à madame de Rochefort, qui s’était signée à plusieurs reprises en tremblant, elle cessa de regarder du côté de la porte, et la curiosité l’emporta sur ses frayeurs.
– Parmi les dons qui ont été accordés à mon épouse, dit Bertrand Du Guesclin, figure celui, merveilleux, de lire dans l’avenir ; mais il ne s’exprime que fort rarement, et il s’enfuit aussi vite, car personne ne peut le commander. L’heure bénie de la voyance, comme elle l’a appelée, ne lui est venue que trois fois depuis que je la connais, et je puis jurer que tout ce qu’elle m’a annoncé s’est vérifié : par exemple, au soir de la bataille d’Auray, elle m’a dit que le lendemain serait un mauvais jour pour moi et Charles de Blois : or avant que le soleil se fût couché une deuxième fois il était tué, et moi prisonnier de Sir John Chandos. Toutefois elle ne peut pas répondre à n’importe quelle question, mais simplement à celles…
– Bertrand, Bertrand ! cria la dame de la même voix lointaine. L’heure bénie est là. Profitez-en, Bertrand, pendant que vous le pouvez !
– Je vais le faire, ma douceur ! Dites-moi donc quelle fortune m’attend ?
– Du danger, Bertrand ! Un danger mortel, pressant, qui rampe autour de vous et que vous ne soupçonnez pas.
Le guerrier français éclata de rire, et ses yeux verts pétillèrent de gaieté.
– Quel jour depuis vingt ans cela n’a-t-il pas été vrai ? s’écria-t-il. L’air que je respire s’appelle danger ! Mais celui-ci est-il proche, Tiphaine ?
– Ici. Maintenant. Tout proche de vous !
Les mots avaient jailli, tandis que le masque si beau de dame Tiphaine se contractait, se tordait comme devant une vision horrible qui arrache au spectateur des paroles brèves, entrecoupées. Du Guesclin regarda la salle, les tapisseries, les tentures, les tables, la crédence, le buffet avec son aiguière d’argent, et le demi-cercle des visages amicaux qui l’entouraient. Un silence tomba ; on n’entendait plus que le souffle oppressé de dame Tiphaine et le doux murmure du vent à l’extérieur, que dominait l’appel intermittent d’une trompe de porcher.
– Le danger peut attendre, fit-il en haussant ses larges épaules. Et maintenant, Tiphaine, dites-moi ce qui sortira de cette guerre d’Espagne ?
– Je ne discerne pas grand-chose, répondit-elle en écarquillant les yeux et en plissant le front. Il y a des montagnes, des plaines arides, des armes qui scintillent, des cris de guerre. Pourtant il m’est chuchoté à l’oreille que c’est par un échec que vous réussirez.
– Ah, Sir Nigel, que dites-vous de cela ? fit Bertrand en hochant la tête. C’est l’hydromel et le vinaigre, demi-doux et demi-acide. Mais y a-t-il une question que vous désireriez poser à ma dame ?
– Certes il y en a une. J’aimerais savoir, noble dame, comment vont les choses au château de Twynham, et par-dessus tout comment s’occupe ma chère épouse.
– Pour vous répondre, je voudrais poser ma main sur quelqu’un dont les pensées s’orientent fixement vers ce château que vous avez nommé. Non, seigneur Loring, il m’est dit à l’oreille que quelqu’un d’autre ici y pense plus profondément que vous.
– Qui pense plus que moi aux miens ? s’écria Sir Nigel. Madame, je crains que sur ce point au moins vous ne soyez dans l’erreur.
– Ne le croyez pas, Sir Nigel. Venez là, jeune homme, jeune écuyer anglais aux yeux gris ! Maintenant donnez-moi votre main et posez-la en travers de mon front afin que je puisse voir ce que vous avez vu. Qu’est-ce qui se lève devant moi ? De la brume, du brouillard, de la brume qui roule avec une grande tour noire au-dessus. Je la vois qui s’étend, qui se soulève : il y a un château dans une plaine verte, avec la mer au-dessous, et une grande église à une portée de flèche. Il y a deux rivières qui coulent à travers champs, et entre elles se dressent les tentes des assiégeants.
– Des assiégeants ! se récrièrent Alleyne, Ford et Sir Nigel d’une même voix.
– Oui, réellement. Ils exercent sur le château une forte pression, car ils sont nombreux et pleins de courage. Voyez comme ils se jettent contre le portail, tandis que derrière eux des gens du peuple arrosent de flèches les murailles. Il y a plusieurs chefs qui crient et qui commandent : j’en vois un, de haute taille avec une barbe dorée, qui se tient devant le portail en tapant du pied et en encourageant ses hommes, comme un piqueur ses chiens. Mais les défenseurs du château se battent courageusement. Il y a une femme, deux femmes, qui sont debout sur les remparts et qui donnent l’exemple aux hommes d’armes. Elles déversent des flèches, des traits, de grosses pierres. Ah, elles ont abattu le grand chef, et les autres reculent. La brume s’épaissit, je ne vois plus rien.
– Par saint Paul ! s’exclama Sir Nigel. Je ne pense pas que de telles choses puissent se passer à Christchurch, et je suis fort tranquille sur le sort de ma place forte tant que ma chère épouse suspend la clef du baile extérieur à la tête de son lit ! Cependant je ne nie point que vous ayez décrit le château aussi bien que j’aurais pu le faire moi-même, et je suis émerveillé de tout ce que j’ai entendu.
– Je voudrais, dame Tiphaine, s’écria madame de Rochefort, que vous utilisiez votre grand pouvoir pour me dire ce qui est arrivé au bracelet d’or que je portais quand j’ai chassé au faucon le deuxième dimanche de l’Avent, et que je n’ai jamais retrouvé depuis.
– Non, madame ! intervint Bertrand Du Guesclin. Il ne convient pas à une si grande et merveilleuse vertu de chercher et fouiller et jouer au valet même pour plaire à la belle châtelaine de Villefranche. Posez une question valable et, avec la bénédiction de Dieu, vous aurez une réponse valable.
– Alors je désirerais savoir, s’écria l’un des écuyers français, quelle conquête peut être espérée dans ces guerres entre nous et les Anglais.
– Les deux camps feront des conquêtes ; chacun conservera sa part.
– Alors nous conserverons la Gascogne et la Guyenne, s’écria Sir Nigel.
La dame secoua la tête.
– Terre de France, sang de France, langue de France, répondit-elle. Elles sont françaises, la France les reprendra.
– Mais Bordeaux ? s’exclama Sir Nigel avec passion.
– Bordeaux aussi reviendra à la France.
– Mais Calais ?
– Calais aussi.
– Alors malheur à moi ! Si Bordeaux et Calais sont perdus, que restera-t-il à l’Angleterre ?
– Il me semble que votre pays va connaître des heures pénibles, dit Bertrand Du Guesclin. Nous n’osions jamais espérer, même au fond de notre cœur, reprendre Bordeaux ! Par saint Yves, ces nouvelles me réchauffent ! Notre cher pays sera grand dans l’avenir, Tiphaine.
– Grand, et riche, et beau ! s’écria-t-elle. Loin dans le cours du temps, je vois la France à la tête des nations, souveraine parmi les peuples, grande pour la guerre, plus grande encore dans la paix, prompte d’esprit, habile à l’action, avec tous ses fils rassemblés autour d’un monarque unique, depuis les sables de Calais jusqu’aux mers bleues du sud !
– Ah ! cria Du Guesclin dont les yeux flamboyaient de triomphe. Vous l’avez entendue, Sir Nigel ? Et elle n’a jamais prédit en vain !
Le chevalier anglais secoua tristement la tête.
– Et mon pauvre pays ? demanda-t-il. Je crains, madame, que vous n’ayez de sombres présages à m’annoncer.
La dame s’assit avec les lèvres entrouvertes ; son souffle s’accéléra soudain.
– Mon Dieu ! cria-t-elle. Que vois-je ? D’où viennent-ils, ces peuples, ces nations puissantes, ces pays qui se lèvent devant mes yeux ? Je regarde plus loin, et d’autres apparaissent, et encore d’autres, jusqu’aux extrémités de la terre. Ils sont une foule ! Ils se répandent ! Le monde leur est donné ; et il résonne du bruit de leurs marteaux et de leurs sonneries de cloches. On les appelle par des noms différents, ils se gouvernent chacun à sa guise, mais ils sont tous Anglais, car j’entends leurs voix. Je vais plus loin, je vois un grand pays de l’autre côté des mers où n’a encore jamais abordé aucun homme, et je vois une grande terre sous de nouvelles étoiles et un ciel inconnu, et pourtant cette terre est anglaise. Où ne sont pas allés les enfants de l’Angleterre ? Que n’ont-ils accompli ? Sa bannière est plantée sur la glace. Sa bannière est inondée de soleil. L’Angleterre s’étire sur le monde entier, et son ombre se profile sur toutes les mers. Bertrand, Bertrand ! Nous sommes surpassés car les bourgeons de son bourgeon valent notre fleur la plus épanouie !
Sa voix s’était élevée jusqu’à une sorte de cri sauvage ; elle tendit les bras avant de retomber blanche et inanimée dans le fauteuil.
– C’est fini, expliqua Bertrand Du Guesclin en lui soulevant la tête. Du vin pour ma dame, écuyer ! L’heure bénie de la voyance est passée.
CHAPITRE XXX
Comment les hommes des sous-bois se rendirent au château de Villefranche
Il était tard lorsque Alleyne, ayant apporté à Sir Nigel le gobelet de vin épicé qui était de tradition après les soins que méritaient les boucles du chevalier, s’en fut à la recherche de sa chambre. Elle était située au deuxième étage. C’était une pièce qui contenait un lit pour lui dans une alcôve et deux paillasses sur lesquelles ronflaient déjà Aylward et Hordle John. Alleyne s’agenouilla pour dire sa prière du soir, mais un petit coup fut frappé à sa porte et Ford entra avec une lampe à la main. Il était mortellement pâle, et ses mains tremblaient, faisant danser les ombres sur le mur.
– Qu’y a-t-il, Ford ? s’écria Alleyne en se relevant d’un bond.
– Je puis à peine te l’expliquer ! répondit Ford en s’asseyant sur le lit et en enfouissant son menton entre ses mains. Je ne sais ni quoi dire ni quoi penser.
– Quelque chose t’est-il arrivé ?
– Oui. À moins que je n’aie été le jouet de mon imagination. Je te l’affirme, mon ami, je suis complètement anéanti ! Écoute, Alleyne ! Il est impossible que tu aies oublié la petite Tita, la fille du vieil artiste de Bordeaux ?
– Je me la rappelle parfaitement.
– Elle et moi, Alleyne, nous avons échangé nos promesses avant de nous séparer, et elle porte ma bague au doigt. « Caro mio, m’a-t-elle dit quand je l’ai vue pour la dernière fois, je serai près de toi pendant la guerre, et ton danger sera mon danger. » Alleyne, aussi vrai que je crois en Dieu, quand j’ai gravi l’escalier ce soir, je l’ai vue qui se tenait devant moi, en pleurs ; elle tendait les bras comme pour m’avertir… Je l’ai vue, Alleyne, comme je vois ces deux archers sur leurs paillasses. Nous allions nous toucher du bout des doigts, lorsqu’elle s’est évanouie comme une brume sous le soleil.
– Je n’accorderais pas trop d’importance à cela, répondit Alleyne. Nos esprits peuvent nous jouer d’étranges tours. Réfléchis aussi que les propos de dame Tiphaine nous ont impressionnés et un peu secoués.
Ford hocha la tête.
– J’ai vu la petite Tita aussi nettement que si j’avais été de retour dans la rue des Apôtres à Bordeaux. Mais il est tard ; je vais me retirer.
– Où dors-tu ?
– Dans la chambre au-dessus de la tienne. Que les saints nous protègent tous !
Il se leva et quitta la chambre. Alleyne entendit son pas qui montait l’escalier en colimaçon. Le jeune écuyer alla à la fenêtre et regarda le paysage éclairé par la lune. Il avait encore à l’oreille les phrases qu’avait prononcées dame Tiphaine, en particulier celles qui avaient trait au château de Twynham. Il appuya ses coudes sur le rebord et se laissa absorber par une rêverie d’où il fut brusquement tiré pour revenir à Villefranche.
Sa fenêtre était située au deuxième étage de la partie du château la plus proche du donjon. En face s’étendait la large douve qui réfléchissait le cercle pur de la lune. Au-delà la plaine descendait vers un bois épais. Plus loin à gauche un autre bois bouchait l’horizon. Entre ces deux bois une clairière à découvert était traversée à la partie inférieure par les lacets de la rivière.
Il aperçut tout à coup un homme sortir furtivement du bois et avancer dans la clairière. Il marchait la tête basse, les épaules voûtées, les genoux pliés, comme quelqu’un qui s’efforce de ne pas être vu. Il franchit une dizaine de pas, regarda autour de lui, agita sa main, s’accroupit et disparut dans une bordure d’ajoncs. Après lui avança un deuxième individu ; puis un troisième, un quatrième, un cinquième, tous courant pour traverser la clairière et s’abriter ensuite sous l’autre bois. Alleyne compta soixante-dix-neuf silhouettes sombres qui défilèrent ainsi au clair de lune. La plupart portaient de lourds fardeaux sur le dos, mais étant donné la distance il ne put pas distinguer ce que c’était. Ils sortaient d’un bois pour entrer dans l’autre ; tous avaient la même démarche craintive, furtive, inquiétante.
Alleyne demeura quelques instants devant sa fenêtre à fouiller du regard la forêt silencieuse ; que penser de ces promeneurs de minuit ? Puis il réfléchit qu’il avait auprès de lui quelqu’un qui était apte à porter un jugement sain. À peine avait-il touché l’épaule d’Aylward que l’archer se mit debout, la main sur son épée.
– Qui va là ? cria-t-il. Holà, mon petit ! Par ma garde, je croyais que c’était une camisade ! Que se passe-t-il, mon gars ?
– Viens à la fenêtre, Aylward. J’ai vu quatre-vingts hommes sortir de la forêt pour aller s’abriter là-bas ; presque tous avaient un paquet sur le dos. Qu’en penses-tu ?
– Rien du tout, mon camarade ! Il y a autant de hors-la-loi dans ce pays que de lapins sur Cowdray Down, et beaucoup n’osent se montrer qu’à la nuit, sinon ils danseraient au bout d’une corde de chanvre. Toutes les marches françaises regorgent de bandes de voleurs, de proscrits, de pillards, de tire-laine ; sans doute est-ce là ce que tu as vu. Je m’étonne pourtant qu’ils osent rôder si près du château du sénéchal… Tout semble paisible maintenant, ajouta-t-il après avoir soigneusement inspecté les environs.
– Ils sont dans l’autre bois.
– Hé bien, qu’ils y restent ! Viens te reposer, mon petit ! À chaque jour suffit sa peine. Tout de même, mieux vaudrait tirer la barre sur cette porte, puisque nous cantonnons en pays inconnu ! Là !
Il retourna vers sa paillasse et se rendormit aussitôt. Il pouvait être trois heures du matin quand Alleyne fut tiré du sommeil par un cri étouffé ou une exclamation. Il dressa l’oreille mais, n’entendant plus rien, il pensa qu’il devait s’agir de la relève de la garde et se rendormit. Quelques minutes plus tard il sursauta : il aurait juré que quelqu’un essayait de pousser la porte. En tout cas il entendit immédiatement après des pas furtifs monter l’escalier qui conduisait à la chambre du dessus ; un bruit confus et une sorte de gémissement s’ensuivirent. Alleyne se redressa sur son séant, les nerfs à vif ; il se demanda si ces bruits provenaient d’une cause futile (un archer malade et, pourquoi pas, un médecin venu le visiter ?) ou s’ils n’avaient pas une signification plus menaçante. Mais quel danger pouvait les guetter dans ce château fort gardé par des soldats, protégé par de hautes murailles et une large douve ? Qui pouvait leur vouloir du mal ? Il s’était presque persuadé que ses craintes étaient purement imaginaires quand son regard s’arrêta sur quelque chose qui lui glaça le sang et l’immobilisa bouche ouverte, mains crispées sur la courtepointe.
Juste en face de lui se trouvait la large fenêtre qu’éclairait la lune. Depuis quelques instants la lumière était masquée ; une tête se déplaça au-dehors de haut en bas ; puis le visage se tourna vers lui, et se balança dans l’encadrement de la fenêtre. Même avec un éclairage affaibli, Alleyne ne pouvait pas se tromper. Ces traits anormalement bouleversés, tachés de sang étaient bien ceux de son jeune compagnon qui s’était assis tout à l’heure sur son lit. Alleyne poussa un cri d’horreur ; il sauta à bas du lit et se précipita vers la fenêtre. Réveillés en sursaut, les deux archers empoignèrent leurs armes et regardèrent autour d’eux en se demandant ce qui arrivait. Un seul regard suffit à convaincre Edricson que ses craintes étaient fondées. Assassiné, avec d’innombrables blessures sur son corps, une corde autour de son cou, son malheureux ami avait été défenestré et se balançait lentement au vent de la nuit ; son visage était juste à la hauteur de la fenêtre d’Alleyne.
– Mon Dieu ! s’écria Alleyne tremblant de tous ses membres. Que nous arrive-t-il ? Quels démons… ?
– Voici le briquet à silex, dit John sans broncher. La lampe, Aylward ! Ce clair de lune amollit. À présent nous pouvons nous servir des yeux que Dieu nous a donnés.
– Par ma garde ! cria Aylward quand la flamme jaune jaillit. C’est bien le jeune maître Ford. Je pense que ce sénéchal est un scélérat, qui n’a pas osé nous affronter en pleine lumière, mais qui a voulu nous assassiner pendant notre sommeil. Par le sifflement de ma flèche ! Si je ne décoche pas une plume d’oie dans le sang de son cœur, ce ne sera pas de la faute de Samkin Aylward, de la Compagnie Blanche !
– Mais, Aylward, pense aux individus que j’ai vus tout à l’heure ! dit Alleyne. Il ne s’agit peut-être pas du sénéchal. Peut-être d’autres hommes sont-ils venus au château ? Je vole chez Sir Nigel avant qu’il soit trop tard. Laisse-moi aller, Aylward : ma place est à son côté.
– Un instant, mon gars ! Mets ce casque d’acier au bout de mon arc. Là ! À lui l’honneur de passer le premier par la porte : car il est très mauvais de sortir quand on ne peut pas voir ni se garder. Maintenant, camarades, l’épée à la main ! Holà, par ma garde ! Il est temps de nous remuer !
En effet des clameurs s’élevaient dans le château ; une femme hurla ; de nombreux pieds s’élancèrent ; puis ce fut un cliquetis d’acier, et enfin un rugissement de lion en furie :
– Notre-Dame Du Guesclin ! Saint Yves ! Saint Yves !
L’archer retira la barre de la porte et projeta dans le couloir le casque au bout de son arc. Un coup précéda la chute du casque, mais avant que l’homme qui avait frappé eût eu le temps de se redresser, l’archer lui avait percé le corps de son épée.
– En avant, camarades ! En avant ! cria-t-il.
S’ouvrant le passage entre deux individus qui lui barraient le chemin, il s’élança dans le grand couloir vers l’endroit d’où provenaient les cris.
Un tournant brusque, un deuxième angle droit les amenèrent en haut d’un court escalier d’où ils dominèrent la scène du tumulte. Sur un vestibule carré s’ouvraient les portes des chambres des principaux invités. Ils virent aussi clair qu’en plein jour car de nombreuses torches brûlaient dans des appliques. Au pied de l’escalier, sur le seuil de leur chambre, gisaient le sénéchal et sa femme : elle avec la tête arrachée des épaules, lui transpercé de part en part par un pieu qui était demeuré fiché dans son corps. Trois serviteurs étendus à côté d’eux étaient déchirés, mutilés comme si une meute de loups les avait dépecés. En face de la chambre centrale se tenaient Bertrand Du Guesclin et Sir Nigel, à demi vêtus et sans armures. La folle excitation du combat brillait dans leurs yeux. Ils avaient les lèvres serrées, l’épée tachée de sang reposant sur l’épaule droite, le pied gauche en avant. Trois cadavres étaient prostrés à leurs pieds ; un quatrième assaillant, dont le sang coulait à flots, était tombé à la renverse et haletait. Soufflant comme le vent dans un arbre, des hommes à demi sauvages, bras nus et jambes nues, efflanqués, barbus, les entouraient de leurs faces bestiales, de leurs yeux meurtriers. Avec leurs dents étincelantes, leurs cheveux hirsutes, leurs hurlements, ils ressemblaient davantage à des démons de l’enfer qu’à des hommes de chair et de sang. Ils poussèrent un cri furieux et se ruèrent à nouveau sur les deux chevaliers ; s’agrippant à ce qu’ils pouvaient saisir, ils griffaient, ils mordaient, ils déchiraient, ils dédaignaient les coups de pointe ; ils n’avaient qu’un but : faire tomber ces champions d’épée. Sir Nigel perdit son équilibre sous le poids des hommes qui l’attaquaient ; messire Bertrand répétait d’une voix tonnante son cri de guerre et faisait tournoyer sa lourde lame afin d’avoir du champ pour frapper. Mais le sifflement de deux longues flèches anglaises, l’offensive de l’écuyer et des deux archers qui dévalèrent l’escalier changèrent la fortune des armes. Les assaillants reculèrent, les chevaliers s’élancèrent en avant ; en une minute le vestibule fut nettoyé ; Hordle John jeta en bas des marches le dernier des sauvages qui s’y cramponnait encore.
– Ne les poursuivez pas ! cria Du Guesclin. Si nous nous éparpillons, nous sommes perdus. Je me soucie de ma peau comme d’un denier, bien que je trouverais lamentable de tomber entre les mains de cette canaille ; mais j’ai ici ma chère épouse, dont je ne risquerais la vie à aucun prix. Nous avons le temps de souffler à présent, et je vous demande, Sir Nigel, ce que vous nous conseilleriez de faire.
– Par saint Paul, répondit Sir Nigel, je ne comprends rien à ce qui nous est arrivé ! Je sais seulement que j’ai été réveillé par votre cri de guerre et, quand je me suis précipité hors de ma chambre, je me suis trouvé en pleine mêlée. Hélas, cette dame et le sénéchal !… Quels sont les chiens qui se sont livrés à cette curée ?
– Jacques Bonhomme ! Les hommes des sous-bois ! Ils tiennent le château. J’ignore encore comment ils l’ont pris. Regardez par cette fenêtre dans le baile !
– Par le Ciel ! s’exclama Sir Nigel. On y voit aussi clair qu’à midi. Le portail est grand ouvert. Ils sont au moins trois mille à l’intérieur des murs. Regardez comme ils crient et se précipitent ! Qu’est-ce qu’ils jettent dehors par la poterne ? Mon Dieu ! C’est un homme d’armes ; ils l’écartèlent membre après membre. On dirait des limiers sur un loup ! En voici un autre, puis un troisième ! Ils occupent tout le château. Je vois leurs têtes aux fenêtres. Tenez, ils sont plusieurs à porter de gros paquets sur leur dos.
– C’est du bois sec de la forêt. Ils l’empilent contre les murs et l’allument. Qui essaie de leur tenir tête ? Par saint Yves, le bon prêtre qui plaidait pour eux tout à l’heure ! Il est à genoux, il prie, il implore ! Quoi ! Bandits, allez-vous porter la main sur celui qui vous défendait ? Ah, un manant l’a frappé ! Il est à terre ! Ils le piétinent, l’écrasent à coups de pieds. Ils lui retirent sa robe et la promènent en triomphe ! Voyez, les flammes lèchent les murs ! N’y a-t-il donc personne que nous pourrions rallier ? Avec une centaine d’hommes nous saurions leur résister !
– Oh, ma Compagnie ! s’écria Sir Nigel. Mais où est Ford, Alleyne ?
– Il a été abominablement assassiné, mon beau seigneur.
– Que les saints le reçoivent ! Qu’il repose en paix ! Mais voici venir quelqu’un enfin qui peut nous donner un conseil, car avec ces couloirs il est difficile de se risquer sans guide !
Un écuyer français et le chevalier de Bohême descendaient en effet l’escalier ; le chevalier saignait au front.
– Tout est perdu ! cria-t-il. Le château est pris ; le feu est allumé ; le sénéchal est tué ; nous sommes perdus !
– Au contraire, dit Sir Nigel, rien n’est perdu ! Il nous reste à livrer un combat très honorable et il y a une belle dame pour laquelle nous donnerons notre vie. Il existe beaucoup de manières de mourir, mais pas de meilleure que celle-ci.
– Tu vas pouvoir nous dire, Godefroy, demanda Du Guesclin à l’écuyer français, comment ces hommes sont entrés dans le château et sur quels secours nous pouvons compter. Par saint Yves ! Si nous ne prenons pas une décision rapide, nous serons brûlés comme de jeunes freux dans leur nid.
L’écuyer, brun et mince, s’exprima avec assurance et rapidité ; c’était un homme habitué à l’action.
– Il y a un passage souterrain dans le château, dit-il et par là quelques manants sont passés et ont ouvert le portail pour les autres. Ils avaient des complices à l’intérieur et les hommes d’armes étaient ivres morts : ils ont dû être exterminés dans leurs lits, car ces démons ont fait le tour des chambres, le couteau à la main. Le chevalier de l’Ordre des Hospitaliers a été assommé d’une hache d’armes sous nos yeux quand il s’est précipité hors de sa chambre. En dehors de nous, je crois qu’il n’y a pas un survivant.
– Que nous conseilles-tu ?
– Que nous nous rendions dans le donjon. Il est inutilisé, sauf en temps de guerre, et les clefs sont accrochées à la ceinture de mon pauvre seigneur et maître.
– Il y a deux clefs.
– C’est la plus grosse. Une fois là, nous pourrons tenir l’escalier ; il est étroit ; et les murs sont très épais ; ils ne seront pas incendiés de sitôt. Si nous pouvions transporter la dame de l’autre côté du baile, tout pourrait encore changer.
– Non. La dame sait déjà ce que c’est que la guerre, déclara Tiphaine qui survint, blanche, grave, impassible comme toujours. Je ne voudrais pas être un embarras pour vous, mon cher époux et mes braves amis. Soyez assurés de ceci : si tout le reste échoue, j’ai ici ma sauvegarde…
Elle tira de son sein un petit poignard d’argent.
– … Qui m’empêche de craindre ces bandits et brigands assoiffés de sang !
– Tiphaine ! s’écria Du Guesclin. Je vous ai toujours aimée et maintenant, par Notre-Dame de Rennes, je vous aime plus que jamais ! Si je n’étais pas sûr que vous tinssiez parole, je tournerais contre vous le dernier de mes coups, plutôt que de vous voir tomber entre leurs mains. Conduis-nous, Godefroy ! Un nouveau ciboire en or brillera dans la cathédrale de Dinan si nous nous en sortons !
L’envie de piller avait distrait les attaquants de l’envie de tuer. À travers tout le château des cris de joie se faisaient écho. Les manants déchiraient les tapisseries somptueuses, s’emparaient des flacons d’argent et des meubles sculptés. Dans la cour, en bas, des misérables à demi nus, les membres souillés de sang, se pavanaient coiffés de casques empanachés, ou enroulés dans les robes de soie de madame de Rochefort qui traînaient sur le sol derrière eux. Des barriques de vin avaient été montées des caves ; des paysans affamés s’étaient accroupis, le gobelet à la main, et buvaient les bouteilles que Rochefort avait mises de côté pour ses hôtes nobles ou royaux. D’autres avaient des jambons et de la viande séchée au bout de leurs piques : ils les faisaient rôtir dans le brasier ou les dévoraient crues à coups de dents. Toute discipline pourtant n’était pas abandonnée : quelques centaines d’hommes armés se tenaient rassemblés en groupes silencieux, s’appuyaient sur leurs instruments grossiers et contemplaient l’incendie qui se propageait rapidement sur tout un côté du château. Déjà Alleyne entendait le crépitement et le grondement des flammes. L’air était lourd de chaleur et devenait âcre sous l’effet du bois qui brûlait.
CHAPITRE XXXI
Comment cinq hommes tinrent le donjon de Villefranche
Guidé par l’écuyer français, le petit groupe descendit deux couloirs resserrés. Le premier était libre, mais à l’entrée du second un paysan se tenait en sentinelle ; quand il les vit arriver, il s’enfuit en courant et appela ses camarades.
– Arrêtez-le ! Sinon nous sommes perdus ! cria Du Guesclin qui se mit à courir pour le rattraper.
Mais le grand arc de guerre d’Aylward vibra comme une corde de harpe, et l’homme tomba en avant. À cinq pas de l’endroit où il gisait une petite porte ouvrait sur le baile. Derrière elle montait un tel brouhaha, fait de hurlements sauvages, de jurons horribles et de rires terrifiants, que le plus résolu aurait hésité avant de franchir le fragile obstacle qui les en séparait.
– Droit au donjon ! ordonna Du Guesclin d’une voix sourde et décidée. Les deux archers en tête, la dame au milieu entre les deux écuyers, les trois chevaliers à l’arrière-garde pour repousser ceux qui nous serreraient de trop près. Là ! Maintenant ouvrez la porte, et que Dieu nous ait en Sa sainte garde !
Pendant quelques secondes, tout se passa comme s’ils allaient atteindre leur objectif sans encombre, tant leurs mouvements avaient été rapides et silencieux. Ils avaient traversé la moitié du baile, et la plupart des fanatiques n’avaient pas encore esquissé un geste pour les arrêter. Les rares qui essayèrent de leur barrer le chemin furent abattus ou écartés, tandis que les poursuivants tombaient sous les épées des trois chevaliers. Sans aucun mal ils arrivèrent à la porte du donjon, devant laquelle ils se retournèrent pour faire face à la foule grouillante, pendant que l’écuyer enfonçait la grosse clef dans la serrure.
– Mon Dieu ! s’écria-t-il. Je me suis trompé de clef !
– Trompé de clef ?
– Fou, imbécile que je suis ! J’ai pris la clef du portail ; c’est l’autre qui ouvre le donjon. Je retourne la chercher !
Il voulut courir, mais à peine avait-il fait quelques pas qu’une grosse pierre, lancée par un paysan vigoureux, le frappa à la tempe : il s’écroula inanimé.
– Cette clef-ci me suffira ! cria Hordle John.
Il ramassa la lourde pierre qui était en fait un quartier de roche, et il la lança de toute sa force contre la porte. La serrure trembla, le bois vola en éclats, la pierre se partagea en cinq morceaux, mais les agrafes de fer maintinrent la porte debout. Hordle John se baissa, passa ses gros doigts sous le battant et d’une secousse souleva toute la masse de bois et de fer sur ses gonds. Pendant quelques instants elle oscilla, puis elle retomba à l’extérieur et ensevelit l’archer sous ses débris ; le reste du groupe se précipita sous le porche.
– Montez, Tiphaine ! Montez vite l’escalier ! cria Du Guesclin. À présent demi-tour, amis, et repoussons-les !
La populace s’était élancée à leur poursuite, mais les deux meilleures lames d’Europe luisaient sur les dernières marches ; quatre assaillants tombèrent juste sur le seuil. Les autres reculèrent, firent cercle devant la porte ouverte ; ils grinçaient des dents, ils brandissaient leurs poings à l’adresse des défenseurs. Ils se ruèrent sur le corps de l’écuyer français et le mirent en pièces. Trois ou quatre autres avaient tiré le gros John de dessous les débris de la porte ; mais brusquement il se remit debout, empoigna un manant dans chaque main et les cogna l’un contre l’autre avec une telle force qu’ils s’effondrèrent sans connaissance, assommés comme par un merlin. Il se libéra des autres qui s’étaient accrochés à lui et bondit pour se mettre à l’abri sous le porche.
Leur position n’en était pas moins désespérée. Pour exécuter leur acte de vengeance les paysans des environs s’étaient rassemblés au nombre de six mille ; ils se trouvaient à l’intérieur ou autour des murailles du château de Villefranche. Mal armés, à demi morts de faim, c’étaient néanmoins des hommes prêts à tout ; aucun danger ne les aurait arrêtés ; au nom de quoi se seraient-ils raccrochés à la vie misérable qu’ils menaient ? Ils tenaient le château ; les flammes s’échappaient des fenêtres, grimpaient haut au-dessus des tourelles. De tous côtés ils déferlaient maintenant vers le donjon. Face à une armée, six hommes et une femme étaient entourés d’une ceinture de feu, mais presque tous avaient tellement l’habitude du danger que le combat était moins inégal qu’il ne semblait.
– Il n’y a place que pour deux sur une marche, dit Du Guesclin. Demeurez avec moi, Nigel, sur la dernière. La France et l’Angleterre cette nuit seront alliées. Messire Otto, je vous prie de vous tenir derrière nous avec ce jeune écuyer. Les archers monteront un peu plus haut et tireront par-dessus nos têtes. Je regrette que nous ne soyons pas mieux équipés, Nigel !
– J’ai souvent entendu dire par mon cher Sir John Chandos qu’un chevalier ne devrait jamais, même chez son hôte, se séparer de son armure. Après tout, nous gagnerons plus d’honneur si nous nous en tirons. Nous avons un avantage car nous les voyons en pleine lumière tandis qu’ils nous voient mal. Je crois qu’ils se rassemblent pour l’assaut.
– Si nous pouvons les occuper quelque temps, dit le chevalier de Bohême, ces flammes pourraient nous attirer du secours pour peu qu’il y ait des hommes loyaux dans le pays.
– Réfléchissez, mon noble seigneur, dit Alleyne à Sir Nigel, que nous n’avons jamais fait le moindre mal à ces hommes, et que nous n’avons aucun motif de querelle contre eux. Ne vaudrait-il pas mieux, ne serait-ce que dans l’intérêt de la dame, leur parler à cœur ouvert et voir si nous ne pourrions pas traiter honorablement avec eux ?
– Sûrement pas, par saint Paul ! protesta Sir Nigel. Cela ne s’accorderait pas avec mon honneur, et il ne sera pas dit que moi, chevalier anglais, j’ai voulu parlementer avec des hommes qui ont tué une belle dame et un saint prêtre !
– Autant parlementer avec une meute de loups dévorants ! ajouta le chevalier français. Ah ! Notre-Dame Du Guesclin ! Saint Yves ! Saint Yves !
Les manants qui s’étaient massés devant la voûte sombre de la porte venaient de s’élancer follement pour enlever l’escalier. Ils avaient pour chefs un petit homme brun qui portait une barbe tressée, et un grand gaillard qui tenait à la main une énorme massue garnie de clous. Le premier n’avait pas fait trois pas qu’une flèche d’Aylward lui perfora la poitrine : il s’écroula sur le seuil en toussant et crachant du sang. L’autre bondit entre Du Guesclin et Sir Nigel et d’un seul coup de sa massue fendit le crâne du chevalier de Bohême. Avec trois épées dans le ventre il luttait encore ; il s’était presque frayé le passage quand il tomba mort sur les marches. Derrière lui cent paysans fous de rage se ruèrent en une vague formidable sur les cinq épées qui défendaient l’escalier. Coups de taille, parades et bottes se succédèrent à une cadence diabolique. Les cadavres s’amoncelaient au bas des marches de pierre, glissantes et poissées de sang. Le grand cri de Bertrand Du Guesclin, la respiration sifflante qui s’échappait des poitrines de la foule, le bruit mat des corps qui s’effondraient, les hurlements des blessés constituaient un concert infernal ; de nombreuses années plus tard, Alleyne l’entendait encore dans son sommeil. Enfin la multitude des assaillants lâcha pied, recula non sans darder sur les défenseurs des regards féroces ; onze cadavres gisaient en tas sur le seuil du donjon.
– Les chiens en ont eu assez ! dit Du Guesclin.
– Par saint Paul, il semble que cette foule comptait quelques hommes tout à fait dignes et valeureux ! remarqua Sir Nigel. Des hommes dont nous aurions pu gagner, s’ils avaient été d’une origine plus relevée, beaucoup d’honneur et de distinction. Tout compte fait, ils valaient la peine d’être vus. Mais qu’apportent-ils là ?
– Ce que je craignais ! grommela Du Guesclin. Ils vont nous faire rôtir, puisqu’ils n’ont pu nous saigner. À vous, archers ! Tirez droit et juste ! Car, par saint Yves, nos épées ne nous serviront plus à grand-chose !
Une douzaine d’hommes s’étaient élancés ; chacun se dissimulait derrière un gros tas de fagots. Empilant le bois sous le porche, ils y jetaient des torches enflammées. Le bois avait dû être arrosé d’huile, car il se transforma en un véritable brasier ; une longue flamme jaune déchira l’air au-dessus des têtes des défenseurs qui reculèrent jusqu’au premier étage du donjon. À peine l’avaient-ils atteint cependant qu’ils s’aperçurent que les madriers et les planches brûlaient déjà. Le plancher était si sec, si mangé aux vers qu’une étincelle provoquait immédiatement une combustion lente, puis des flammes. L’air était empesté d’une fumée âcre ; les cinq défenseurs eurent des difficultés à grimper l’escalier qui les amena au sommet du donjon.
Ah, l’étrange panorama qui se déploya alors sous leurs yeux ! De chaque côté s’étendait la campagne paisible faite de plaines doucement vallonnées et de bois touffus que baignaient les flots argentés de la lune. Aucune lumière en vue, aucun mouvement, rien qui ressemblât à l’arrivée d’un secours. Très loin, le glas d’une lourde cloche s’élevait et retombait dans l’air froid de l’hiver. Le feu gigantesque brûlait au-dessous d’eux, autour d’eux ; il grondait, il crépitait sur chaque face du baile. Dans un fracas assourdissant les deux tourelles d’angle s’effondrèrent ; tout le château ne fut plus qu’une masse informe crachant des flammes et de la fumée par toutes ses embrasures. La grande tour noire sur laquelle ils étaient perchés se dressait comme un suprême îlot de refuge sur une mer de feu ; mais des craquements de mauvais augure et le rugissement de l’incendie sous leurs pieds annonçaient l’imminence d’une catastrophe. En bas, la cour carrée était pleine de paysans qui hurlaient et dansaient ; tous regardaient en l’air ; ils tendaient le poing ; ils étaient ivres de sang et de vengeance. De la foule jaillit un cri de haine auquel succéda un éclat de rire épouvantable, quand elle aperçut les derniers survivants qui la regardaient du haut du donjon. Alors ils entassèrent de nouveaux fagots au pied de la tour, et ils dansèrent autour du brasier une farandole infernale ; se tenant par la main ils entonnèrent le refrain qui avait été le mot de passe des jacqueries :
Cessez, cessez, gens d’armes et piétons,
De piller et manger le bonhomme
Qui de longtemps Jacques Bonhomme
Se nomme !
Leurs voix perçantes dominaient le grondement de l’incendie et les craquements de la maçonnerie : on aurait dit les hurlements d’une meute de loups apercevant leur proie devant eux et n’ayant plus que quelques mètres à franchir pour la rattraper.
– Par ma garde ! dit Aylward à John. J’ai dans l’idée que cette fois-ci nous ne verrons pas l’Espagne. Je suis rudement content d’avoir légué mon lit de plumes et d’autres objets de valeur à cette digne femme de Lyndhurst ; elle pourra s’en servir en toute quiétude d’âme. Il me reste treize flèches ; si une seule manque sa cible, alors je n’aurai pas volé mon destin ! Tiens ! La première à celui qui se pavane dans la robe de soie de madame. En plein cœur, par Dieu ! Je visais pourtant une main plus haut. Maintenant, le bandit qui se promène avec une tête au bout de sa pique. Ah, dans le mille, John ! Un joli coup de toi aussi, John ! Le brigand est tombé la tête la première dans le feu. Mais je te prie, John, de garder le poignet souple, et de ne pas tirer d’un petit coup sec en retenant la main : cette erreur-là a gâché la carrière de plus d’un bon archer.
Pendant que les deux camarades déclenchaient leur tir sur la foule, Du Guesclin et dame Tiphaine s’entretenaient avec Sir Nigel de leur situation désespérée.
– C’est une fin peu banale pour quelqu’un qui a vu tant de champs de bataille ! soupira le chevalier français. Pour moi, peu importe cette mort-ci ou une autre ; mais c’est la mort de ma douce épouse qui m’afflige !
– Non, Bertrand, je n’ai pas plus peur que vous ! dit-elle. Mon vœu le plus cher a toujours été que nous partions ensemble.
– Bien répondu, noble dame ! s’écria Sir Nigel. Et je suis sûr que ma tendre épouse aurait dit la même chose. Si c’est la fin, j’aurai eu du moins la bonne fortune de vivre en un temps où tant de gloire était à glaner et où l’on pouvait rencontrer tant de vaillants gentilshommes et chevaliers. Mais pourquoi me tires-tu par la manche, Alleyne ?
– S’il vous plaît, mon noble seigneur, il y a dans ce coin deux grands tubes de fer, avec beaucoup de boulets lourds : il s’agit peut-être de ces bombardes dont j’ai entendu parler.
– Par saint Yves, c’est exact ! s’écria messire Bertrand en approchant du coin où étaient installées ces machines de guerre. Ce sont des bombardes, et de bonne taille. Nous allons pouvoir tirer sur eux.
– Tirer avec ça, dites-vous ? s’exclama Aylward avec infiniment de dédain (car la menace d’un péril abolit les distances entre classes sociales). Comment peut-on viser avec ces joujoux stupides ? Comment peut-on espérer tirer juste avec ça ?
– Je vais te montrer, répondit Sir Nigel. Voici la grande caisse de poudre. Si tu veux me la soulever, John, je t’indiquerai comment t’en servir. Viens ici, où la foule est plus dense. À présent, Aylward, tords-toi le cou et regarde bien ce qui aurait été pris pour un conte de bonnes femmes quand nous sommes partis la première fois pour la guerre. Retire le couvercle, John, et précipite ta caisse dans le feu.
Un grondement formidable, une traînée de lumière bleuâtre, et la grande tour carrée vacilla sur ses fondations, oscilla comme un roseau sous le vent. Étourdis, pris de vertige, les défenseurs se cramponnèrent au parapet, et ils virent de grosses pierres, des poutres de bois enflammées, et des corps mutilés voler dans les airs. Quand ils se redressèrent, tout le donjon s’était affaissé sur un côté ; ils eurent du mal à conserver leur équilibre sur la plate-forme en pente. Ils regardèrent par-dessus le parapet pour observer les effets de l’explosion. Sur quarante mètres autour du porche, le sol était noir de taches noires qui hurlaient, se tordaient, se soulevaient, retombaient aveuglés, écorchés vifs, brûlés par le feu qui dévorait leurs guenilles. Au-delà de ce cercle de mort leurs camarades stupéfaits s’éloignaient de la tour noire et de ces hommes invincibles qui étaient d’autant plus à craindre que tout espoir les avait abandonnés.
– Une sortie, Du Guesclin ! Une sortie ! s’écria Sir Nigel. Par saint Paul, ils hésitent, et un assaut peut les décider à fuir !
Il dégaina et se rua dans l’escalier en colimaçon, suivi de près par ses quatre compagnons d’infortune.
Mais avant d’être parvenu au premier étage, il leva les bras en l’air et s’arrêta.
– … Mon Dieu ! s’exclama-t-il. Nous sommes perdus !
– Qu’y a-t-il ?
– Le mur s’est effondré à l’intérieur. L’escalier est bloqué, et le feu continue à faire rage au-dessous. Par saint Paul, mes amis, nous avons mené un combat très honorable, et en toute humilité nous avons le droit de dire que nous avons fait notre devoir. Mais je pense que nous pouvons rejoindre dame Tiphaine et nous mettre en oraison, car nous avons joué notre rôle en ce monde, et le moment est venu de nous préparer pour l’autre.
L’étroit passage était en effet bloqué par d’énormes blocs de pierre entassés les uns sur les autres ; la fumée bleue passait entre les interstices. L’explosion avait soufflé dans le mur et coupé la seule voie qu’ils auraient pu emprunter. Enfermés à une trentaine de mètres au-dessus du sol, avec un brasier qui faisait rage sous leurs pieds, cernés par une multitude délirante assoiffée de leur sang, ils ne pouvaient guère attendre autre chose que la mort. Lentement ils rebroussèrent chemin ; quand ils arrivèrent sur la plate-forme, dame Tiphaine s’élança vers son mari.
– Bertrand ! fit-elle. Faites tous silence et écoutez ! J’ai entendu au loin des voix qui chantaient dans une langue étrangère.
Retenant leur souffle, ils écoutèrent ; mais ils n’entendirent rien d’autre que le crépitement des flammes et les clameurs de leurs ennemis.
– Rien, madame ! dit Du Guesclin. Cette nuit vous a épuisée, et vos sens vous trompent. Qui pourrait se trouver dans le pays pour chanter en une langue étrangère ?
– Holà ! cria Aylward soudain hilare. Il m’avait semblé l’entendre avant que nous descendions, et voici que maintenant je l’entends encore. Nous sommes sauvés, camarades ! Par les os de mes dix doigts, nous sommes sauvés ! C’est la chanson de marche de la Compagnie Blanche. Silence !
Un doigt en l’air et la tête inclinée, il écouta avidement. De l’obscurité un chœur de voix graves déferla vers le château. Jamais délicat refrain de Provence ou du Languedoc n’aurait résonné avec plus de douceur aux oreilles des six survivants que cette rude chanson saxonne.
Nous boirons tous ensemble
À la plume de l’oie grise
Et au pays des oies grises.
– Ah, par ma garde ! cria Aylward. C’est le cher vieux chant de la Compagnie ! Voici deux cents garçons robustes qui n’ont pas leurs pareils pour cocher leurs arcs. Malheur aux chiens ! Écoutez comme ils chantent !
De plus en plus proche, de plus en plus clair, le gai refrain de marche trouait la nuit.
Que dire de l’arc ?
L’arc vient d’Angleterre,
En bois loyal, en bois d’if,
Le bois des arcs anglais.
Car les hommes libres
Aiment le vieil if
Et le pays où pousse l’if.
Que dire des hommes ?
Les hommes sont nés en Angleterre,
Les archers, les cavaliers,
Les gars des vallons et des crêtes.
À votre santé, à la vôtre !
Buvons aux cœurs fidèles,
Et au pays des cœurs loyaux !
– Ils chantent aussi gaiement, dit Du Guesclin, que s’ils se rendaient à un festival !
– C’est leur habitude quand ils ont de l’ouvrage à faire !
– Par saint Paul, fit Sir Nigel, j’ai l’impression qu’ils arrivent trop tard, car je ne vois pas comment nous descendrons de cette tour !
– Les voici, ces cœurs d’or ! cria Aylward. Regardez, ils sortent de l’ombre. À présent ils traversent le champ. Ils sont de l’autre côté de la douve. Holà, camarades, holà ! Johnston, Eccles, Cooke, Harward, Bligh ! Voudriez-vous assister à la mise à mort d’une noble dame et de deux braves chevaliers ?
– Qui est là ? tonna une voix grave au-dessous. Qui vient de parler avec une langue anglaise ?
– C’est moi, vieux garçon ! C’est Sam Aylward de la Compagnie. Et voici votre capitaine, Sir Nigel Loring, et quatre autres qui vont être grillés comme des harengs !
– Que je sois maudit si je n’avais pas reconnu l’accent de ce vieux Samkin Aylward ! fit la voix tandis qu’un bourdonnement s’élevait des rangs. Partout où il y a des coups à recevoir, Sammy se trouve en plein dedans ! Mais quels sont ces bandits qui nous barrent le chemin ? Rentrez dans vos chenils, chiens ! Comment ! Vous osez nous regarder dans les yeux ? À l’épée, les enfants, et tapez dessus avec le plat de la lame ! Ne gaspillez pas vos flèches pour une telle canaille !
L’esprit combatif des paysans avait baissé de ton : l’explosion les avait ahuris, leurs pertes avaient été nombreuses, l’arrivée imprévue des archers disciplinés les découragea. Quelques minutes plus tard, ils s’étaient tous enfuis vers leurs sous-bois. Le soleil allait se lever sur des ruines noircies et souillées de sang, alors qu’il s’était couché sur le magnifique château du sénéchal d’Auvergne. Déjà à l’est des lignes blanches rosissaient. Les archers se rassemblèrent au pied du donjon en se demandant comment sauver les rescapés.
– Si nous avions une corde, dit Alleyne, nous pourrions nous laisser glisser sur cette face qui n’est pas encore en feu.
– Mais comment avoir une corde ?
– C’est un vieux truc ! dit Aylward. Holà, Johnston ! Lance-moi une corde, comme tu l’as fait à Maupertuis pendant la guerre.
L’archer interpellé réunit alors plusieurs cordes ; il les noua serrées, puis il les étendit sur l’ombre longue du donjon que projetait le soleil levant. Alors il détendit son arc et mesura la fine ligne noire qu’il projetait sur le gazon.
– Un arc de deux mètres projette une ombre de quatre mètres, murmura-t-il. Le donjon projette une ombre de soixante pas. Trente pas de corde suffiront largement. Un autre bout, Watkin ! Maintenant tire à une extrémité pour vérifier la solidité. Là ! C’est prêt.
– Mais comment l’attraperont-ils ? interrogea le jeune archer qui se tenait à côté de lui.
– Attends et regarde, jeune tête folle ! grogna le vieil archer.
Il tira de sa poche une longue ficelle qu’il attacha à une flèche.
– Tu es prêt, Samkin ?
– Prêt, camarade !
– Alors, attention à ta main !
Il tira avec légèreté ; la flèche monta doucement et retomba sur le parapet à vingt centimètres d’Aylward. L’autre bout de la ficelle était attaché à la corde ; aussi en moins d’une minute la corde pendit-elle le long de l’unique face solide de la tour en feu. Dame Tiphaine fut descendue au moyen d’un nœud coulant passé sous ses bras, et les cinq autres survivants se laissèrent glisser en bas sous les acclamations et les bravos de leurs sauveteurs.
CHAPITRE XXXII
Comment la Compagnie tint conseil autour de l’arbre déraciné
– Où est Sir Claude Latour ? demanda Sir Nigel quand ses pieds touchèrent terre.
– Il est au camp, près de Montpezat, à deux heures de marche d’ici, noble seigneur ! répondit Johnston.
– Alors nous allons nous y rendre directement, car je désire que vous soyez tous de retour à Dax assez tôt pour servir d’avant-garde au Prince.
– Noble seigneur ! s’écria Alleyne tout joyeux. Voici nos montures dans le champ, et j’aperçois votre équipement au milieu du butin que ces bandits ont abandonné.
– Par saint Yves, tu dis vrai, jeune écuyer ! dit Du Guesclin. Je reconnais mon cheval et le genet de ma dame. Les coquins les ont sortis des écuries, mais ils se sont enfuis sans les emmener… Nigel, j’ai été très heureux d’avoir vu de près quelqu’un dont j’avais tant entendu parler. Mais nous sommes obligés de vous quitter, car je dois être auprès du Roi d’Espagne avant que votre armée ait franchi les montagnes.
– J’avais cru que vous étiez en Espagne avec le vaillant Henri de Transtamare.
– J’y étais, mais je suis rentré en France pour lever des troupes. Je reviendrai, Nigel, avec quatre mille des meilleures lances de France : votre Prince pourrait bien se trouver devant une tâche digne de lui. Que Dieu soit avec vous, ami, et puissions-nous nous revoir sous de meilleurs auspices !
– Je ne crois pas, dit Sir Nigel à Alleyne en regardant s’éloigner le chevalier français et sa dame, que dans toute la Chrétienté tu puisses rencontrer un homme plus brave et une dame plus courageuse et plus douce. Mais tu es pâle et triste, Alleyne, aurais-tu été blessé pendant cette bagarre ?
– Non, mon bon seigneur. Mais je pensais à mon ami Ford qui hier soir encore bavardait avec moi assis sur mon lit.
Sir Nigel hocha la tête.
– J’ai perdu deux braves écuyers, dit-il. Je ne sais pas pourquoi les jeunes pousses sont détruites alors qu’une vieille herbe folle reste debout. Il doit y avoir pourtant une bonne raison, puisque Dieu en a décidé ainsi. As-tu remarqué, Alleyne, que dame Tiphaine nous avait avertis hier soir d’un péril imminent ?
– Oui, seigneur.
– Par saint Paul ! J’ai l’esprit empoisonné par ce qu’elle a vu au château de Twynham. Et cependant je ne peux pas croire que des pirates écossais ou français puissent débarquer en force suffisante pour assiéger la place. Rassemble la Compagnie, Aylward ! Et partons car ce serait une honte si nous n’arrivions pas à Dax au jour dit.
Les archers s’étaient égaillés à travers les ruines, mais une sonnerie de bugles les fit accourir aussitôt ; le butin qu’ils avaient pu amasser gonflait leurs poches ou pendait par-dessus leurs épaules. Pendant qu’ils reformaient leurs rangs, chacun reprit sa place en silence et Sir Nigel les examina attentivement : un sourire satisfait détendit ses traits. Ils étaient grands, musclés, brunis ; ils avaient l’œil clair, la physionomie rude ; leur allure était celle de soldats expérimentés, rapides et solides. Un chef aurait difficilement réuni plus belle collection de guerriers. De vieux militaires, vétérans chevronnés et grisonnants des guerres de France, avaient un visage féroce, des sourcils hirsutes, le front couvert de rides. Mais il y avait aussi nombre de jeunes archers frais émoulus, avec de jolis visages anglais, la barbe bien peignée, les cheveux bouclant sous leur casque. Des boucles d’oreille en or ou en pierreries, un baudrier ruisselant d’or, une ceinture de soie, un collier autour d’un cou bruni évoquaient le bon temps qu’ils avaient connu comme compagnons francs. Ils avaient tous sur l’épaule l’arc en if ou en coudrier ; les arcs des vétérans étaient sans ornements ; ceux des plus jeunes étaient peinturlurés et sculptés aux extrémités. Le casque d’acier, la brigandine aux mailles serrées, le surcot blanc avec le lion rouge de saint Georges complétaient l’équipement. À la ceinture pendait l’épée ou la hache d’armes, à moins qu’une massue d’un mètre de long ne fût accrochée au cuir du baudrier par un trou au centre du manche.
Pendant deux heures ils marchèrent à travers des forêts et des marécages en longeant la rive gauche de l’Aveyron. Sir Nigel chevauchait derrière la Compagnie, encadré par Alleyne à sa droite et Johnston, le vieil archer, à sa gauche.
Avant d’être arrivé à destination, Sir Nigel savait déjà tout ce qu’il désirait connaître de ses soldats, de leurs agissements et de leurs projets. Il aperçut tout à coup sur l’autre rive une troupe d’hommes d’armes français qui galopait en direction de Villefranche.
– C’est le sénéchal de Toulouse avec son escorte, dit Johnston en abritant ses yeux de sa main. S’il s’était trouvé de ce côté-ci du fleuve, il aurait sans doute entrepris quelque chose contre nous.
– Dans ce cas traversons la rivière, dit Sir Nigel. Il serait dommage de ne pas accéder au désir de ce digne sénéchal s’il souhaite accomplir un fait d’armes.
– Non. Il n’y a pas de gué avant Tourville, répondit le vieux maître-archer. Il se rend à Villefranche, et les manants qui lui tomberont entre les mains auront peu de temps pour se confesser et recevoir l’absolution car il a le parler bref. C’est lui et le sénéchal de Beaucaire qui ont pendu Peter Wilkins, de la Compagnie, le 1er août dernier. Pour cela, je le jure par la croix noire de Waltham, ils seront pendus eux aussi si jamais nous les tenons ! Mais voici nos camarades, Sir Nigel, et voici notre camp.
Le sentier forestier débouchait sur une vaste clairière verte qui descendait en pente douce vers la rivière. Sur trois côtés elle était entourée d’une ceinture de grands arbres dépouillés et d’épais buissons de houx. Au bout de cette clairière il y avait une cinquantaine de cabanes bâties très convenablement avec du bois et de l’argile ; de la fumée s’échappait des toitures. Une douzaine de chevaux et de mulets attachés paissaient autour du campement ; les archers flânaient dans les environs ; certains s’entraînaient sur des cibles, d’autres édifiaient de grands feux de bois à ciel ouvert pour faire chauffer leurs marmites. Quand ils aperçurent leurs camarades qui rentraient, ils poussèrent un cri de bienvenue, et un cavalier, qui était en train de faire manœuvrer son destrier derrière le camp, s’approcha au petit galop. C’était un homme fringant, vif, très richement vêtu, qui avait un visage rasé tout rond et des yeux noirs brillants d’excitation.
– Sir Nigel ! cria-t-il. Sir Nigel Loring, enfin ! Sur mon âme, nous vous attendons depuis un mois ! Soyez le très bienvenu, Sir Nigel ! Vous avez reçu ma lettre ?
– C’est elle qui m’a amené ici, répondit Sir Nigel. Mais vraiment, Sir Claude Latour, je suis très étonné que vous n’ayez pas pris vous-même le commandement de ces archers, car ils ne pourraient sûrement pas trouver de meilleur chef !
– Pas de meilleur, par la Vierge de Lesparre ! cria le petit Gascon. Mais vous connaissez vos insulaires, Sir Nigel. Ils ne veulent pour chef qu’un homme de leur sang et de leur race. Rien à faire pour les persuader du contraire ! Même moi, Claude Latour, seigneur de Montchâteau, maître de la haute justice, de la moyenne et de la basse, je n’ai pu gagner leurs suffrages. Il faut qu’ils tiennent un conseil et qu’ils réunissent leurs deux cents têtes épaisses ; et puis survient cet Aylward ou un autre, en qualité de héraut, pour me dire que la Compagnie se licenciera si un Anglais de bonne réputation n’en prend pas la tête. Je crois qu’il y en a beaucoup de je ne sais quelle grande forêt dans le Hampi, ou Hampti… j’ai le nom au bout de la langue. Le fait que vous êtes de cette région les a décidés à vous choisir comme chef. Mais nous avions espéré que vous arriveriez avec une centaine d’hommes.
– Ils sont déjà à Dax, où nous allons les rejoindre, dit Sir Nigel. Mais que les hommes déjeunent ; ensuite nous tiendrons conseil pour décider de ce que nous ferons.
– Venez dans ma cabane, proposa Sir Claude. Je ne peux vous offrir qu’une maigre chère : du lait, du fromage, du vin et du lard. J’espère que votre écuyer et vous ne m’en tiendrez pas rigueur. Ma demeure est celle devant laquelle flotte le pennon : modeste résidence pour le seigneur de Montchâteau !
Pendant le repas, Sir Nigel demeura silencieux et songeur, pendant qu’Alleyne écoutait les bavardages du Gascon qui vantait la richesse de son domaine, ses succès d’amour et ses triomphes militaires.
– Maintenant que vous êtes ici, dit-il enfin à Sir Nigel, j’ai quelques belles aventures toutes prêtes pour nous. J’ai appris que Montpezat n’est pas fortement défendu et qu’il y a deux cent mille couronnes dans le château. À Castelnau j’ai aussi un colporteur à ma solde, qui nous lancera une corde n’importe quelle nuit bien noire par-dessus les remparts. Je vous promets qu’avant la nouvelle lune vous plongerez vos bras jusqu’au coude dans un tas de pièces d’or ; nous trouverons également de jolies femmes, du bon vin, et tout le butin souhaitable.
– J’ai d’autres projets, répondit Sir Nigel non sans brusquerie. Je suis venu ici pour conduire ces archers au service du Prince, notre maître, qui peut en avoir grand besoin avant d’installer Pedro sur le trône d’Espagne. Je pense donc que nous nous mettrons en route dès aujourd’hui pour Dax sur l’Adour, où son camp est maintenant établi.
Le visage du Gascon se rembrunit et ses yeux lancèrent une flamme de colère.
– Pour moi, dit-il, je ne me soucie point de cette guerre, et je trouve très agréable la vie que je mène. Je n’irai pas à Dax.
– Réfléchissez encore, Sir Claude ! fit gentiment Sir Nigel. Vous portez le nom d’un vrai et fidèle chevalier. Sûrement, vous ne resterez pas en arrière quand le Prince a besoin de vous ?
– Je n’irai pas à Dax ! cria l’autre.
– Mais votre devoir… Votre serment d’allégeance ?
– Je vous dis que je n’irai pas !
– Dans ces conditions, Sir Claude, j’y conduirai la Compagnie sans vous.
– S’ils vous suivent ! s’écria le Gascon en ricanant. Ce ne sont pas des esclaves à louer : ce sont des compagnons francs qui ne feront rien contre leur gré. À vrai dire, seigneur Loring, ils ne se laissent pas manier facilement ; il serait plus simple de retirer un os à un ours affamé que de mener un archer hors d’une région où abondent les plaisirs.
– Alors je vous prie de les rassembler, dit Sir Nigel, et je vais leur dire ce que j’ai en tête ; car si je suis leur chef ils iront à Dax, et si je ne le suis pas, je me demande ce que je fais en Auvergne. Tiens mon cheval prêt, Alleyne. Par saint Paul, advienne que pourra, je me mettrai en route avant midi !
Une sonnerie de bugle convoqua les archers en conseil ; ils se réunirent par petits paquets autour d’un grand arbre déraciné qui gisait en travers la clairière. Sir Nigel sauta légèrement sur le tronc et regarda de son œil clignotant le cercle des visages qui l’entouraient.
– On me dit, archers, déclara-t-il, que vous êtes devenus si amoureux de vos aises, de butin et de vie confortable que vous ne voulez plus bouger de cette agréable région. Mais, par saint Paul, je me refuse à le croire, car je vois bien que vous êtes tous très vaillants, et que vous vous mépriseriez si vous choisissiez de vivre ici en paix alors que votre Prince va entreprendre une grande aventure ! Vous m’avez élu pour chef. Chef je serai si vous me suivez en Espagne ; et je vous promets que mon pennon aux cinq roses sera toujours, si Dieu me donne la force et la vie, sur le chemin de l’honneur. Mais si vous désirez paresser et fainéanter dans ces clairières, troquer la gloire et la renommée pour de l’or vil et des richesses mal acquises, alors trouvez un autre chef ; car j’ai toujours vécu dans l’honneur, et dans l’honneur je mourrai. S’il y a parmi vous des forestiers du Hampshire, je les invite à me dire s’ils acceptent de suivre le pennon des Loring.
– Voici un gars de Romsey qui dit oui ! cria un jeune archer qui avait un rameau vert à son casque.
– Et un gars d’Alresford !
– Et de Milton !
– Et de Burley !
– Et de Lymington !
– Et un tout petit de Brockenhurst ! cria un immense gaillard allongé sous un arbre.
– Par ma garde, les enfants ! cria Aylward en sautant sur le tronc déraciné. Je crois que nous ne pourrons plus jamais regarder les filles en face si nous laissons le Prince franchir les montagnes et si nous ne tirons pas quelques flèches pour lui faciliter le passage ! Il est bon en temps de paix de mener la vie que nous avons menée tous ensemble, mais à présent l’étendard de la guerre est levé une fois de plus, et, par les os de mes dix doigts, le vieux Samkin Aylward, même seul, marchera sous ses plis !
D’un homme aussi populaire qu’Aylward, ces simples phrases décidèrent beaucoup d’hésitants, et l’assistance éclata en applaudissements.
– Loin de moi, déclara suavement Sir Claude Latour, de vouloir vous convaincre contre ce digne archer ou contre Sir Nigel Loring ! Cependant nous nous sommes trouvés ensemble dans de nombreuses aventures, et peut-être serait-il incorrect que je ne vous expose pas ma façon de voir.
– Place pour le petit Gascon ! crièrent les archers. Tout le monde a le droit de parler ! Droit à la cible, mon gars, et fair play pour tous !
– Réfléchissez bien, dit Sir Claude. Vous vous engagez sous une dure férule, sans plus de liberté ni de plaisirs. Et pourquoi ? Pour six pence par jour, au mieux. Tandis qu’à présent vous pouvez circuler à votre guise dans le pays et vous n’avez qu’à allonger le bras pour saisir ce qui vous tente. Qu’avons-nous entendu raconter sur nos camarades qui sont partis pour l’Italie avec Sir John Hawkwood ? En un soir ils ont rançonné six cents des plus riches seigneurs de Mantoue. Campent-ils devant une grande ville ? Aussitôt les bourgeois leur apportent les clefs : ils n’ont qu’à entrer et à piller ; ou, si cela leur plaît davantage, ils n’entrent pas mais réclament en compensation tant de chevaux chargés d’argenterie. Voilà comment ils voyagent d’État en État, riches, libres, redoutés de tous. Voyons, n’est-ce pas la vie normale d’un soldat ?
– La vie normale d’un voleur ! rugit Hordle John d’une voix tonnante.
– Et pourtant il y a du vrai dans ce que dit le Gascon, dit un archer noiraud dont le doublet était décoloré par les intempéries. Moi je préfère prospérer en Italie plutôt que mourir de faim en Espagne !
– Tu as toujours été un lâche et un traître, Mark Shaw ! cria Aylward. Par ma garde ! Si tu tires ton épée je te garantis que tu ne verras ni l’Italie, ni l’Espagne !
– Non, Aylward, dit Sir Nigel, les choses ne s’arrangent pas par des querelles. Sir Claude, je crois que ce que vous avez dit vous honore assez peu, et, si mes mots vous blessent, je suis prêt à approfondir ce débat avec vous. Mais vous serez suivi par les hommes qui vous choisiront, et vous irez où vous voudrez, sauf avec nous. Que tous ceux qui aiment leur Prince et leur Patrie demeurent ici ! Ceux qui préfèrent une bourse bien garnie passeront de l’autre côté.
Treize archers, tête basse et regards honteux, suivirent Mark Shaw et se rangèrent derrière Sir Claude. Sous les huées et les sifflets de leurs camarades ils se rendirent devant la cabane du Gascon. Le reste de la Compagnie se mit aussitôt en devoir de se préparer et de fourbir les armes. De l’autre côté du Tarn et de la Garonne, à travers les fondrières de l’Armagnac, jusqu’à la longue vallée de l’Adour, il leur faudrait marcher pendant de très nombreuses lieues avant de rejoindre le nuage noir de la guerre qui dérivait lentement vers le sud, vers la ligne des pics enneigés au-delà desquels la bannière d’Angleterre n’avait jamais flotté.
CHAPITRE XXXIII
Comment l’armée passa le col de Roncevaux
Toute la vaste plaine de la Gascogne et du Languedoc est en hiver une région aride et stérile, sauf dans la vallée de l’Adour et de ses gaves tributaires, lorsque cette rivière au débit rapide se jette dans la mer de Biscaye. Au sud de l’Adour de hauts pics bouchent l’horizon ; ils sont précédés par de longues griffes de granit qui s’enfoncent loin dans l’intérieur des terres.
Pays tranquille que celui-ci : le Basque aux gestes mesurés, coiffé d’un béret, ceint d’une écharpe rouge, chaussé de sandales de corde, cultive ses terres insuffisantes ou conduit ses moutons efflanqués sur les pâturages à flanc de coteaux. C’est le royaume du loup et de l’isard, de l’ours brun et de la chèvre montagnarde, des rochers dénudés et des torrents. Là pourtant, la volonté d’un grand Prince avait rassemblé une armée de vaillants : de l’Adour aux cols de la Navarre, les vallées désolées et les déserts balayés par le vent étaient peuplés de soldats, retentissaient des cris de commandement et des hennissements de chevaux. Car l’étendard de la guerre flottait encore une fois au vent, et au-delà des pics éblouissants s’étirait la grand-route de l’honneur.
Tout était prêt pour l’expédition. De Dax à Saint-Jean-Pied-de-Port, Anglais, Gascons et Aquitains attendaient impatiemment l’ordre de marche. De tous côtés les compagnons francs avaient afflué ; il n’y avait pas moins de douze mille vétérans cantonnés le long des frontières de la Navarre. Le frère du Prince, le duc de Lancastre, était arrivé d’Angleterre avec quatre cents chevaliers et une forte compagnie d’archers. Par-dessus tout, un héritier du trône venait de naître à Bordeaux : le Prince pouvait quitter son épouse l’esprit libre, car la mère et l’enfant se portaient également bien.
Les clefs des cols de la Navarre étaient entre les mains de Charles de Navarre, roublard ignoble, qui avait marchandé et barguigné avec les Anglais et avec les Espagnols, prenant de l’argent aux Anglais pour que les cols leur soient ouverts, et aux Espagnols pour les tenir fermés. Une rapide décision d’Édouard, toutefois, avait démoli les plans et les intrigues du comploteur. Le Prince anglais ne supplia pas, ne reprocha rien. Mais Sir Hugh Calverley franchit silencieusement la frontière avec sa compagnie, et les remparts incendiés des deux villes de Miranda et de Puenta de la Reyna avertirent le monarque déloyal qu’il existait d’autres métaux que l’or, et qu’il avait affaire avec un homme à qui il serait périlleux de mentir. Le prix qu’il exigea fut payé, ses objections réduites au silence, les gorges de la montagne ouvertes aux Anglais. À partir de la fête de l’Épiphanie un grand rassemblement de masses s’opéra et, dès les premières semaines de février (trois jours après l’arrivée de la Compagnie Blanche), l’avance générale par le défilé de Roncevaux fut ordonnée. À cinq heures du matin, par grand froid, les bugles sonnaient dans le hameau de Saint-Jean-Pied-de-Port, et à six heures la compagnie de Sir Nigel, forte de trois cents hommes, se mit en marche vers le défilé et commença à gravir d’un pas leste la route escarpée toute en lacets. Le Prince l’avait en effet désignée pour qu’elle franchît le col la première ; elle devait stationner ensuite à la sortie du col pour le garder jusqu’à ce que toute l’armée eût émergé des montagnes. Le jour commençait à poindre vers l’est, les sommets des grands pics devenaient roses et rouges tandis que les vallées restaient plongées dans l’ombre ; bientôt la Compagnie Blanche se trouva engagée dans le défilé, avec le long col accidenté devant elle.
Sir Nigel, à la tête de ses archers, montait son grand destrier noir ; il avait revêtu l’armure complète. Black Simon derrière lui portait le pennon aux cinq roses ; Alleyne à côté du chevalier tenait l’écu blasonné et la lance de frêne. Sir Nigel était fier et heureux ; à plusieurs reprises il se retourna sur sa selle pour contempler la longue colonne d’archers qui serpentait derrière son cheval.
– Par saint Paul, Alleyne, ce col est un endroit fort dangereux, et j’aurais aimé que le Roi de Navarre le tînt contre nous, car ç’aurait été une très honorable aventure si nous avions dû nous ouvrir le passage ! J’ai entendu des ménestrels chanter la gloire d’un certain messire Roland qui fut tué ici même par les infidèles.
– S’il vous plaît, mon bon seigneur, intervint Black Simon, je connais un peu la région car j’ai servi deux fois un trimestre chez le Roi de Navarre. Là-bas, ce toit que vous voyez entre les arbres est celui d’un hospice de moines ; c’est à cet endroit que messire Roland trouva la mort. Le village sur la gauche est Orbaiceta, et je connais une maison où l’on peut acheter du vrai vin de Jurançon, s’il vous plaît de boire la coupe du matin.
– Il y a de la fumée sur la droite.
– C’est un village qui s’appelle Les Aldudes ; j’y connais aussi une hôtellerie où le vin est du meilleur. On dit que l’aubergiste a enterré un trésor ; mais je suis sûr, beau seigneur, que si vous m’en donnez l’autorisation je l’obligerai bien à nous dire où il l’a caché.
– Non, je t’en prie, Simon ! s’écria Sir Nigel. Oublie tes tours de compagnon franc. Ah, Edricson, je vois que tu ouvres de grands yeux : pour dire vrai ces montagnes doivent sembler merveilleuses à quelqu’un qui n’a admiré que la colline de Portsdown !
La route avait longé la bordure des crêtes inférieures : du col ils apercevaient maintenant les plus hauts pics, des bois de hêtres et un désert apocalyptique de pierres et de roches recouvert de neige blanche vers la sortie du défilé. Derrière eux ils distinguaient encore une partie de la plaine de Gascogne à travers laquelle se déroulaient les anneaux d’argent des rivières. Aussi loin que pouvait embrasser le regard, parmi les gorges rocheuses et les hérissons de bois de pins, l’acier scintillait au soleil d’hiver ; le vent apportait des bouffées de chants martiaux ; par tous les chemins et sentiers, la grande armée du Prince convergeait vers le défilé de Roncevaux. Mais de chaque côté du col sur les crêtes, des armes miroitaient et les pennons flottaient : l’armée navarraise observait d’en haut l’armée étrangère qui traversait son territoire.
– Par saint Paul ! fit Sir Nigel en clignant de l’œil dans leur direction. Je pense que nous avons beaucoup à espérer de ces gentilshommes, car je trouve qu’ils se rassemblent bien serrés sur nos flancs. Donne l’ordre aux hommes, Alleyne, de détacher leurs arcs : certainement il se trouve là-bas de dignes seigneurs qui pourraient nous fournir l’occasion de nous distinguer honorablement.
– J’ai appris que le Prince emmène le Roi de Navarre en otage, répondit Alleyne. Et on dit qu’il a juré de le mettre à mort si nous étions attaqués.
– Ce n’était pas ainsi que nous faisions la guerre quand le bon Roi Édouard Ier la déclarait ! murmura tristement Sir Nigel. Ah, Alleyne, je crains que tu ne vives pas les heures que j’ai vécues, car les hommes s’intéressent bien plus à l’or et au profit qu’autrefois. Par saint Paul ! C’était un noble spectacle quand deux grandes armées s’affrontaient, et que tous ceux qui étaient sous un vœu galopaient en tête pour s’en délivrer ! Que j’en ai vu d’assauts magnifiques à la lance ! J’y ai parfois apporté ma modeste contribution. Les chevaliers couraient une lance pour la paix de leurs consciences et l’amour de leurs dames ! Jamais je n’aurai un mot désobligeant pour les Français : bien que je leur aie livré une vingtaine de batailles rangées, j’ai toujours trouvé en face de moi un digne chevalier fort courtois, ou un écuyer, qui faisait son possible pour me permettre d’accomplir un petit fait d’armes. Une fois qu’avaient été satisfaits tous les gentilshommes à cheval, alors seulement les deux armées en venaient au combat de près, et luttaient gaiement jusqu’à ce que l’une des deux prît l’avantage. Par saint Paul, nous n’avions pas l’habitude à cette époque de verser de l’or pour obtenir le passage des cols, ni de prendre un Roi comme otage dans la crainte que son peuple ne nous taillât des croupières ! À vrai dire, si la guerre doit être menée de cette manière, je regretterai d’avoir quitté le château de Twynham ! Je n’aurais certes pas délaissé ma tendre dame si j’avais pensé qu’il n’y avait plus de faits d’armes à accomplir !
– Mais voyons, seigneur, vous avez à votre actif de grands faits d’armes depuis que vous êtes parti du château de Twynham !
– Je ne vois pas lesquels, répondit Sir Nigel.
– La capture des pirates, la défense du donjon…
– Pas du tout ! déclara le chevalier. Il ne s’agissait pas de faits d’armes, mais d’incidents de route, de hasards du voyage… Par saint Paul, si ces montagnes n’étaient pas trop escarpées pour Pommers, j’irais voir de plus près ces chevaliers de Navarre pour leur demander si l’un d’entre eux ne consentirait pas à me rendre le service d’ôter cette mouche à mon œil ! Il m’est très pénible de regarder ce fort joli col que ma compagnie pourrait tenir contre une armée, et de le parcourir avec autant de tranquillité que le sentier qui va de mes chenils à l’Avon.
Toute la matinée Sir Nigel fut de mauvaise humeur. Sa Compagnie avançait lourdement derrière son cheval. C’était une marche fatigante, sur du terrain inégal et dans la neige. Les archers enfonçaient parfois jusqu’au genou. Néanmoins avant que le soleil eût commencé de décliner, ils étaient arrivés à l’endroit où la gorge débouche sur les hautes terres de la Navarre, et ils aperçurent les tours de Pampelune qui se profilaient contre l’horizon du sud. La Compagnie installa son cantonnement dans un village de montagne. Quant à Alleyne, il passa la journée à contempler l’armée qui à son tour s’engageait dans le défilé.
– Holà, mon gars ! dit Aylward qui vint s’asseoir à côté de lui sur un rocher. C’est vraiment un spectacle réconfortant, n’est-ce pas ? Il faudrait aller loin avant de voir un pareil rassemblement de braves gens et de beaux chevaux. Par ma garde, notre petit seigneur est en colère parce que nous avons franchi tranquillement le col ! Mais je suis prêt à parier que les combats ne nous manqueront pas avant que nous fassions demi-tour vers le nord. On dit qu’il y a quatre-vingt mille hommes derrière le Roi d’Espagne, avec Du Guesclin et les meilleures lances de France, qui ont juré de verser tout le sang de leur cœur pour empêcher Pedro de remonter sur le trône.
– Mais notre armée est formidable ! dit Alleyne.
– Non. Elle n’est forte que de vingt-sept mille hommes. Chandos a convaincu le Prince de laisser du monde à l’arrière, et je pense qu’il a raison, car il y a peu à manger et encore moins à boire dans les pays du sud. Un soldat sans viande et un cheval sans fourrage, c’est comme une corde d’arc mouillée : ça ne vaut pas grand-chose. Mais voilà, mon petit, Chandos et sa compagnie ; et dans les escadrons qui le suivent je vois beaucoup de pennons et de bannières, ce qui prouve que le meilleur sang d’Angleterre s’est réuni derrière lui.
Pendant le bref discours d’Aylward, une forte colonne d’archers avait défilé sous leurs pieds. Ces archers précédaient un porte-bannière qui tenait haut l’emblème du célèbre chevalier. Sir John en personne chevauchait à une longueur de lance derrière son étendard ; il était vêtu d’acier du cou aux pieds, mais drapé dans la longue robe de parade qui devait être la cause de sa mort. Son casque à panache était porté par son écuyer de corps ; il était coiffé d’une petite toque de velours pourpre, d’où descendaient ses boucles blanches jusqu’aux épaules. Quand Alleyne aperçut le fier profil du nez en bec d’aigle et l’œil unique qui brillait clair sous des sourcils broussailleux, il trouva qu’il ressemblait à un vieil oiseau de proie féroce. Sir John aperçut les cinq roses flottant au-dessus du hameau, et il sourit ; mais Pampelune était sa destination ; sans s’arrêter il suivit ses archers.
Derrière lui venaient seize écuyers, tous choisis dans les meilleures familles ; et derrière les écuyers s’avancèrent douze cents chevaliers anglais empanachés et couverts d’acier ; leurs équipements cliquetaient ; leurs longues épées droites battaient contre leurs étriers ; le martèlement des sabots faisait penser au grondement sourd de la mer escaladant une falaise. Marchaient ensuite six cents archers du Cheshire et du Lancashire sous la bannière des Audley ; ils étaient conduits par le fameux Lord Audley lui-même, et par ses vaillants écuyers : Dutton de Dutton, Delves de Doddington, Fowlehurst de Crewe et Hawkestone de Wainehill qui s’étaient tous les quatre couverts de gloire à Poitiers. Deux cents cavaliers lourds suivaient, toujours derrière la bannière des Audley. Immédiatement après, apparut le duc de Lancastre devant une escorte éblouissante et derrière des hérauts en tabards aux armes royales qui menaient à trois de front des destriers couleur crème. Le jeune prince était entouré des deux sénéchaux d’Aquitaine, le sire Guiscard d’Angle et Sir Stephen Cossington, l’un portant la bannière de la province et l’autre celle de saint Georges. Et puis, dans une procession interminable, se déversa un flot d’acier, rang après rang, colonne après colonne ; les panaches s’agitaient, les armes miroitaient au soleil, les blasons succédaient aux blasons. Toute la journée Alleyne assista au défilé sans cesse changeant, toujours divers ; le vieil archer ne l’avait pas quitté et lui désignait les armoiries des grandes maisons d’Angleterre. Toute la chevalerie anglaise franchit le col de Roncevaux en direction des plaines d’Espagne.
C’était un lundi lorsque le duc de Lancastre fit passer sa division de l’autre côté des Pyrénées. Le mardi il faisait encore plus froid ; le sol résonnait comme du fer sous les sabots des chevaux. Pourtant, avant le soir, le Prince et le gros de son armée avaient rejoint l’avant-garde. Aux côtés du Prince chevauchaient le Roi de Majorque, le Roi de Navarre qui était l’otage, et le cruel Don Pedro d’Espagne dont les yeux bleus pâles s’allumèrent d’une lumière sinistre quand ils se posèrent sur les cimes montagneuses du pays qui l’avait chassé. Sous la bannière royale s’étaient rangés de nombreux barons gascons et beaucoup d’insulaires. Aylward indiqua à Alleyne les grands intendants d’Aquitaine, de la Saintonge, de La Rochelle, du Quercy, du Limousin, de l’Agenois, du Poitou, et de la Bigorre, avec les bannières et les volontaires de chaque province. Il y avait aussi le vaillant comte d’Angus, Sir Thomas Banaster avec sa jarretière sur sa jambière, Sir Nele Loring, cousin au second degré de Sir Nigel, et une longue colonne de Gallois qui marchaient sous la bannière rouge de Merlin. De l’aurore au coucher du soleil l’armée avança à travers le défilé.
Le mercredi le froid fut moins vif ; l’arrière-garde passa sans difficulté avec les bombardes et les fourgons. Composée de compagnons francs et de Gascons, elle atteignait le chiffre de dix mille hommes. L’ardent Sir Hugh Calverley à la crinière jaune et le rude Sir Robert Knolles, à la tête de leurs compagnies d’archers anglais vétérans, conduisaient la colonne, précédant les turbulents partisans du bâtard de Breteuil, de Nondon de Bagerant, de Camus le borgne, d’Ortingo le Brun, de La Nuit, et de bien d’autres. Ils étaient accompagnés du gratin de la chevalerie gasconne : le vieux duc d’Armagnac, son neveu le sire d’Albret, le gigantesque Olivier de Clisson, le captal de Buch, le sire Perducas d’Albret, le seigneur de Lesparre à barbe rousse, et d’une longue suite de seigneurs besogneux de la frontière, tous pourvus d’un long pedigree et d’une petite bourse, qui étaient descendus des montagnes pour participer au pillage et aux rançons d’Espagne. Le jeudi matin toute l’armée campait dans le val de Pampelune, et le Prince réunissait ses conseillers dans le vieux palais de l’antique cité de Navarre.
CHAPITRE XXXIV
Comment la Compagnie fit du sport dans le val de Pampelune
Pendant que siégeait le conseil à Pampelune, la Compagnie Blanche qui cantonnait dans une vallée des environs, non loin des compagnies de La Nuit et d’Ortingo le Brun, s’amusa à ferrailler, à lutter et à tirer sur des boucliers disposés à flanc de montagne pour servir de cibles. Les plus jeunes archers avaient retiré leurs cottes de maille ; cheveux au vent, justaucorps retourné pour libérer torses et bras, ils décochaient leurs flèches à tour de rôle. Johnston, Aylward, Black Simon et une douzaine de vétérans les surveillaient, accordant à chacun la louange ou le blâme qu’il méritait. Derrière eux des arbalétriers brabançons des compagnies d’Ortingo et de La Nuit, ainsi que des petits groupes de Gascons, regardaient les Anglais s’entraîner.
– Joli coup, Hewett, joli coup ! dit le vieux Johnston à un jeune archer qui, l’arc dans la main gauche, suivait bouche bée le vol de sa flèche. Tu vois, elle trouve le centre du rond ; je le savais depuis le moment où ta corde a vibré.
– Lâche la flèche en souplesse, calmement, et pourtant assez sec, conseillait Aylward. Par ma garde, mon gars, c’est très bien quand tu ne tires que sur un bouclier, mais quand il y a un homme derrière le bouclier et qu’il galope vers toi en brandissant son épée et en te regardant bien sous sa visière, tu t’apercevras que la cible est moins facile à atteindre !
– Je m’en suis déjà aperçu, répondit le jeune archer.
– Et tu t’en apercevras encore, camarade, sois-en sûr ! Mais holà, Johnston, qui est celui-ci qui tient son arc comme une gaule ?
– Silas Peterson, de Horsham. Ne cligne pas d’un œil pour regarder avec l’autre, Silas, et ne saute pas, ne danse pas après avoir tiré, car ta flèche n’en sera ni plus droite, ni plus rapide ! Tiens-toi solidement dressé, comme Dieu t’a créé. Ne remue pas le bras qui tient l’arc, et garde ferme la main qui tend la corde.
– Ma foi, dit Black Simon, je suis un lancier, moi, et le combat de près me convient mieux que ce genre d’exercice. J’ai cependant passé ma vie au milieu des archers, et j’ai vu beaucoup de flèches splendides. Je constate que nous avons ici de bons tireurs et que cette Compagnie n’a jamais manqué d’excellents archers ; mais je cherche en vain des hommes qui courbent l’arc et décochent la flèche comme certains que j’ai connus.
– Tu dis vrai, répondit Johnston. Regarde cette bombarde là-bas. C’est elle qui a fait du tort à la science de l’arc, avec sa fumée immonde et sa gueule idiote. Je ne comprends pas qu’un véritable chevalier, comme notre Prince, se fasse accompagner d’objets aussi vils. Robin, lourdaud de rouquin, combien de fois devrai-je te dire de ne pas tirer droit sur la cible avec un vent de côté ?
– Par les os de mes dix doigts, il y avait quelques bons archers à la prise de Calais ! dit Aylward. Je me rappelle qu’au cours d’une sortie, un Gênois leva le bras par-dessus sa cape et le brandit dans notre direction, à cent pas de notre première ligne. Vingt archers de chez nous le prirent pour cible ; l’homme tomba ; quand on retrouva son cadavre, il avait eu l’avant-bras transpercé de dix-huit flèches !
– Et je n’oublie pas non plus, observa Johnston, que lorsque la grande cogghe « Christopher », que les Français avaient capturée, fut mouillée à deux cents pas du rivage, deux archers, le petit Robin Withstaff et Elias Baddlesmere, coupèrent en quatre coups chacun les fibres de chanvre de sa corde d’ancre, si bien qu’elle s’échappa et s’échoua sur les rochers.
– Les bons tireurs se font rares, soupira Black Simon. Mais je t’ai vu, Johnston, et toi aussi, Samkin Aylward, tirer aussi bien que les meilleurs. N’est-ce pas toi, Johnston, qui a remporté le bœuf gras à Finsbury contre toute l’élite de Londres ?
Un Brabançon hâlé aux yeux noirs était venu se placer auprès des vieux archers ; appuyé sur son arbalète il les écoutait bavarder dans le dialecte des camps que tous les soldats comprennent. Il était trapu, il avait un cou de taureau, il portait un casque en fer, une cotte de mailles et les chausses de laine des gens de sa classe. Une tunique à manches pendantes bordée de velours au cou et aux poignets montrait qu’il était au moins sous-officier ou chef de section de sa compagnie.
– Je ne peux pas comprendre, dit-il pourquoi vous autres Anglais vous êtes si satisfaits de votre baguette de six pieds. Si cela vous amuse de la courber, alors tant mieux ! Mais pourquoi consentirais-je cet effort, puisque mon petit moulinet fera tout à ma place, et mieux que je ne saurais le faire moi-même ?
– On peut tirer avec n’importe quoi, répondit Aylward. Mais par ma garde, camarade, avec tout le respect que je te dois, à toi et à ton arbalète, je pense qu’elle n’est qu’une arme de femme, qu’une femme peut pointer et manier aussi aisément qu’un homme !
– Cela je ne le sais pas, répliqua le Brabançon. Mais ce que je sais, c’est qu’après quatorze ans de service, je n’ai encore jamais vu un Anglais réussir avec son arc de guerre un coup que je ne pourrais surpasser avec mon arbalète. Par les trois rois ! J’irai même plus loin, et je dirai que j’ai fait des choses avec mon arbalète qu’aucun Anglais n’aurait pu faire avec son arc.
– Bien dit, mon gars ! cria Aylward. Un bon coq est toujours doué d’une belle voix. Quant à moi, j’ai peu tiré ces temps-ci, mais Johnston va te prendre pour l’honneur de la Compagnie.
– Et je mets un gallon de Jurançon sur l’arc, dit Black Simon, quoique je préférerais, pour mon goût personnel un quart de bière de Twynham.
– Je relève le défi et j’accepte le pari, déclara l’homme du Brabant en retirant sa tunique et en cherchant autour de lui un endroit convenable. Mais je cherche une cible décente ; naturellement je ne gaspillerai pas un trait sur ces boucliers qu’un ivrogne de village serait incapable de manquer à une kermesse.
– C’est un dangereux ! chuchota à l’oreille d’Aylward un homme d’armes anglais. C’est le meilleur tireur de toutes les compagnies d’arbalétriers ; c’est lui qui a abattu à Brignais le connétable de Bourbon. Je crains que ton ami ne s’en sorte pas à son honneur.
– Moi, j’ai vu Johnston tirer depuis vingt ans, et je mise sur lui.
– Hélas, Aylward, mon temps est passé ! fit le vieil archer. Je trouve inamical de ta part, Samkin, que tu fasses ainsi d’un vieil archer démoli qui jadis pouvait tirer juste le point de mire de tous les regards. Laisse-moi palper cet arc, Wilkins ! C’est un arc écossais, je vois. Par la croix noire, c’est un beau morceau d’if, bien coché, bien cordé, bien ciré, bien plaisant au toucher ! Je crois que même à présent je pourrais trouer une bonne cible avec un arc comme celui-là. Passe-moi le carquois, Aylward. Ah, vieux Samkin, l’œil se brouille et la main tremble quand les années passent !
– Es-tu prêt ? demanda le Brabançon qui commençait à s’impatienter.
– À mon avis, répondit le vieil archer, l’arc de combat est une meilleure arme que l’arbalète ; mais je peux avoir du mal à le prouver.
– C’est ce que je pense, fit l’autre en ricanant.
Il tira de sa ceinture son moulinet, le fixa et ramena en arrière la puissante double corde jusqu’à ce qu’elle s’insérât dans l’encoche. Il tira de son carquois un carreau court et épais, qu’il plaça soigneusement dans la rainure. La nouvelle du match s’était répandue, et les deux rivaux étaient déjà entourés non seulement des archers de la Compagnie, mais par des centaines d’arbalétriers et hommes d’armes des compagnies d’Ortingo et de La Nuit ; le Brabançon appartenait à la compagnie de La Nuit.
– Il y a une cible là-bas sur la montagne, dit-il. Tu la vois peut-être ?
– Je vois quelque chose, répondit Johnston en abritant ses yeux avec sa main. Mais c’est un coup très long.
– Un joli coup ! Oui, un joli coup… Tiens-toi de côté, Arnaud, si tu ne veux pas recevoir un trait dans la gorge. Maintenant, camarade, je ne tirerai pas un coup d’essai, et je te donne l’avantage de suivre ma flèche.
Tout en parlant il leva son arbalète et il allait tirer la détente quand une grosse cigogne grise apparut en battant lourdement des ailes ; elle frôla la crête de la montagne et s’éleva en planant pour franchir la vallée. Ses cris aigus, perçants, attirèrent l’attention générale. Quand elle approcha, un point noir qui dessinait des cercles au-dessus d’elle se révéla comme étant un faucon pèlerin qui guettait l’occasion de fondre sur sa proie. Trop absorbés par leur lutte, les deux oiseaux se désintéressèrent des soldats : la cigogne s’efforçant de prendre de l’altitude en tournant en rond, le faucon planant néanmoins au-dessus d’elle, ils arrivèrent à une centaine de pas du camp. Le Brabançon pointa son arme vers le ciel et sa corde puissante se détendit sèchement. Son trait atteignit la cigogne juste au bréchet ; l’oiseau tournoya d’abord en précipitant le battement de ses ailes, puis il tomba lentement, encore soutenu par son envergure. Les arbalétriers applaudirent ; mais à l’instant même où le carreau avait touché sa cible, le vieux Johnston qui avait pris un air distrait tendit son arc et expédia sa flèche en plein dans le corps du faucon. À peine la flèche était-elle partie qu’il en saisit une autre, l’ajusta et tira presque à l’horizontale avec tant de bonheur qu’il transperça la malheureuse cigogne une deuxième fois avant qu’elle eût touché terre. Un long cri d’allégresse jaillit des archers à la suite de ce doublé ; Aylward, dansant de joie, jeta ses bras autour du vieux tireur d’élite et l’enlaça avec une telle vigueur que leurs brigandines s’entrechoquèrent.
– Ah, camarade ! cria-t-il. Tu boiras un coup avec moi pour ces flèches-là ! Le faucon ne te suffisait pas, vieux chien ? Tu as voulu avoir la cigogne par-dessus le marché ? Oh, il faut que je t’embrasse encore !
– C’est un joli morceau d’if, et bien cordé ! fit Johnston avec une lueur de malice dans ses deux yeux gris. Avec un arc pareil, même un vieil archer impotent trouverait la cible !
– Tu as bien tiré ! commenta le Brabançon avec une certaine amertume. Mais il me semble que tu ne t’es pas révélé meilleur que moi, car j’ai touché ce que je visais, et, par les trois rois, personne n’aurait fait mieux !
– Il serait malséant de ma part de me proclamer meilleur tireur que toi, répondit Johnston, car j’ai beaucoup entendu vanter ton adresse. Je voulais simplement te montrer que l’arc de guerre pouvait faire ce que l’arbalète ne pouvait pas faire, car tu n’aurais pas pu avec ton moulinet avoir ta corde prête pour tirer une deuxième flèche avant que l’oiseau soit tombé à terre.
– En cela tu as l’avantage, dit l’arbalétrier. Par saint Jacques, c’est maintenant à moi de te montrer comment mon arme peut être meilleure que la tienne. Je te prie de tirer une flèche de toute ta force dans la vallée, afin que nous voyions la longueur de ton tir.
– Tu possèdes une arme très puissante, dit Johnston en considérant l’arbalète de son rival. Je suis à peu près certain que tu tireras plus loin que moi, et pourtant j’ai vu des archers qui pouvaient envoyer leur flèche une aune plus loin qu’un carreau d’arbalète.
– Je l’ai entendu dire aussi, répondit le Brabançon. Mais c’est tout de même curieux que ces archers merveilleux ne se soient jamais trouvés là où j’étais ! Marquons les distances avec une baguette, tous les cent pas. Arnaud, tu te tiendras à la cinquième marque pour me rapporter mes traits.
Une ligne fut mesurée dans la vallée. Johnston tira ; sa flèche passa en sifflant au-dessus des baguettes.
– Bien tiré ! C’est un coup extraordinaire ! applaudirent les assistants. Elle est tombée tout près de la quatrième marque !
– Par ma garde, elle est tombée plus loin ! cria Aylward. Je vois l’endroit où les camarades se penchent pour la ramasser.
– Nous le saurons bientôt ! fit tranquillement Johnston.
Un jeune archer accourut pour annoncer que la flèche était tombée vingt pas au-delà de la quatrième marque.
– Quatre cent vingt pas ! cria Black Simon. Ma foi, c’est tirer long ! Cependant le bois et le métal peuvent faire mieux que la chair et le sang !
Le Brabançon fit un pas en avant ; un sourire de triomphe éclairait son rude visage ; il lâcha la corde de son arme. Ses camarades poussèrent un cri de satisfaction.
– Au-delà de la quatrième ! grommela Aylward. Par ma garde, je crois qu’il n’est pas loin de la cinquième !
– Il a dépassé la cinquième ! hurla un Gascon.
Un soldat vint annoncer que le carreau était tombé à huit pas au-delà de la cinquième marque.
– Quelle arme a l’avantage maintenant ? cria le Brabançon en se pavanant, l’arbalète sur l’épaule, parmi ses compagnons.
– Tu peux me vaincre dans le tir long, répondit gentiment Johnston.
– Toi, et tous les archers du monde ! fit son adversaire victorieux.
– Pas si vite ! intervint un archer bâti en colosse dont les épaules et la tête rousse dominaient la foule des spectateurs. J’ai deux mots à te dire avant que tu cries si fort. Où est mon petit joujou ? Par saint Dick de Hampole, je serais bien étonné si je ne pouvais pas surclasser ta machine qui ressemble davantage à un piège à rat qu’à un arc. Veux-tu essayer un nouveau carreau, ou t’en tiens-tu à celui-là ?
– Cinq cent huit pas me suffisent, répondit le Brabançon en regardant de travers ce nouvel adversaire.
– Tut, John ! murmura Aylward. Tu n’as jamais été tireur d’élite : pourquoi trempes-tu ta cuiller dans ce plat ?
– Du calme, Aylward ! Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire, mais il y en a aussi une ou deux dont je connais le truc. J’ai dans l’idée que je pourrai tirer plus long, si mon arc est assez solide.
– Allez ! Assez de bavardages ! Vas-y, enfant des bois ! Montre-leur que tu es du Hampshire ! crièrent les archers en riant.
– Vous pouvez rire, sur mon âme ! fit John. Mais c’est le vieux Hob Miller de Milford qui m’a appris le tir long.
Il s’empara d’un grand arc noir, s’assit par terre et plaça ses pieds sur les deux extrémités de la tige d’arc. Il prit une flèche et tira la corde vers lui avec ses deux mains jusqu’à ce que le fer de la flèche soit de niveau avec le bois. Le grand arc gémit ; la corde surtendue vibrait.
– Qui est cet idiot qui se tient sur le parcours de ma flèche ? demanda-t-il toujours assis par terre en se tordant le cou.
– Il est posté au-delà de ma tombée, répondit le Brabançon. Il n’a donc rien à craindre de toi.
– Hé bien, que les saints le protègent ! s’écria John. Il est trop près heureusement pour que je lui fasse du mal.
Tout en parlant, il avait levé les deux pieds, avec la tige recourbée de l’arc sur les semelles, et sa corde vibra sur une note grave qui aurait pu être entendue de l’autre côté de la vallée. Le préposé aux mesures tomba à plat ventre, se releva et courut plus loin.
– Bien tiré, vieil ami ! Elle est passée au-dessus de sa tête ! crièrent les archers.
– Mon Dieu ! s’exclama le Brabançon. Qui a jamais vu un coup pareil ?
– C’est un truc à apprendre, dit John modestement. Il m’est arrivé plusieurs fois de gagner un gallon de bière en couvrant un mille rien qu’en trois flèches dans la descente de Wilverley Chase.
– Elle est tombée à cent trente pas au-delà de la cinquième marque ! cria un archer qui accourait.
– Six cent trente pas ! Mon Dieu ! Quel coup ! Un coup pourtant qui ne signifie rien pour ton arme, mon gros camarade, car c’est en la maniant comme une arbalète que tu l’as réussi !
– Par ma garde, il y a du vrai dans ce que tu dis ! s’écria Aylward. Et maintenant, l’ami, je vais te montrer l’un des avantages de l’arc de guerre. Veux-tu, s’il te plaît, expédier un trait contre ce bouclier là-bas, avec toute ta force ? C’est un morceau d’orme recouvert de cuir de taureau.
– J’ai à peine tiré plus de traits à Brignais, grommela l’homme du Brabant, et pourtant j’ai trouvé une meilleure cible qu’un bout de peau de taureau. Mais que veux-tu me prouver, l’Anglais ? Le bouclier n’est pas à plus de cent pas. Un aveugle ne pourrait pas le manquer !
Il visa à peine et tira son carreau en direction du bouclier suspendu. Aylward, qui avait pris une flèche dans son carquois et en avait soigneusement graissé le fer, l’expédia sur la même cible.
– Cours, Wilkins, dit-il, et rapporte-nous le bouclier. Les visages des Anglais s’allongèrent et les bouches des arbalétriers s’élargirent quand le lourd bouclier leur fut apporté : au centre il y avait le gros trait du Brabançon fiché profondément dans le bois, mais il n’y avait aucune trace de la flèche.
– Par les trois rois ! cria le Brabançon. Cette fois au moins il est inutile de discuter pour savoir quelle est la meilleure arme et quel est le meilleur tireur. Tu es passé à côté de la cible, l’Anglais !
– Un moment ! Un moment, mon gars ! dit Aylward qui, retournant le bouclier, montra un trou rond bien net dans le bois derrière. Ma flèche l’a traversé, camarade ; tu conviendras que l’engin qui traverse une cible est plus redoutable que celui qui s’arrête en route.
Le Brabançon mortifié tapa du pied ; il aurait sans doute répondu avec aigreur si Alleyne Edricson n’était arrivé au galop.
– Sir Nigel va venir, et il désire parler à la Compagnie.
L’ordre et la discipline remplacèrent aussitôt la confusion qui était générale. Les arcs, les casques, les épées furent ramassés. Un long cordon d’archers nettoya le camp de tous les étrangers, tandis que le gros de la troupe s’alignait sur quatre rangs avec les sous-officiers et les chefs de section en tête ou sur les flancs. Ils se figèrent ainsi, immobiles et silencieux, pour accueillir leur chef qui arrivait à cheval ; il avait le visage radieux ; toute sa petite silhouette se gonflait de la nouvelle qu’il apportait.
– Un grand honneur vient de nous être fait ! s’écria-t-il. Entre toute l’armée, le Prince nous a choisis pour que nous pénétrions en terre d’Espagne afin d’explorer ce pays ennemi. Cependant, comme nos adversaires sont en nombre, et comme cette mission ne sera peut-être pas du goût de tout le monde, je prie ceux qui veulent me suivre de faire un pas vers moi.
Un brouhaha s’ensuivit. Quand Sir Nigel regarda à nouveau, personne ne se trouvait en avant ; les quatre rangs étaient aussi impeccablement alignés qu’avant sa communication. Stupéfait Sir Nigel les contempla, et le plus profond chagrin assombrit sa figure.
– Pourquoi ai-je vécu pour voir ce jour ! s’écria-t-il. Quoi ! Pas un…
– Mon noble seigneur, chuchota Alleyne, ils ont tous avancé d’un pas.
– Par saint Paul ! Je vois ce qu’ils valent. Je ne pouvais pas croire qu’ils m’auraient abandonné. Nous partons demain à l’aube, et vous aurez les chevaux de la compagnie de Sir Robert Cheney. Soyez prêts, je vous en prie, pour le chant du coq !
Un murmure joyeux parcourut les archers. Ils rompirent leurs rangs, coururent, sautèrent, gambadèrent comme des enfants une veille des vacances. Sir Nigel les suivit d’un regard amusé, mais une main lourde s’abattit sur son épaule.
– Hé bien, mon chevalier errant de Twynham ! fit une voix. Vous partez pour l’Èbre, d’après ce que j’ai appris. Mais, par le saint poisson de Tobie, vous me prendrez sous votre pennon !
– Sir Oliver Buttelsthorn ! s’exclama Sir Nigel. On m’avait dit que vous étiez arrivé au camp, et j’avais espéré vous revoir. Je serai fier et heureux que vous veniez avec moi !
– J’ai des motifs personnels et d’importance pour vouloir partir en tête, dit le gros chevalier.
– Je le crois aisément, répondit Sir Nigel. Je ne connais personne plus prompt que vous à suivre le chemin de l’honneur.
– Non, ce n’est pas pour l’honneur que je vous accompagne, Nigel.
– Pour quelle raison alors ?
– À cause des poulets.
– Des poulets ?
– Oui. Ces coquins de l’avant-garde ont fait main basse sur tous les poulets de la campagne. Ce matin même, Norbury, mon écuyer, a éclopé son cheval en faisant une tournée pour m’en apporter un, car nous avons un sac de truffes, mais rien pour manger avec. Jamais je n’ai vu de telles sauterelles dans une avant-garde ! Pas moyen de dénicher un poulet après leur passage. Du coup, j’abandonne mes renégats de Winchester aux bons soins du grand prévôt, et je pars en éclaireur avec vous, Nigel, mon sac de truffes à mes arçons.
– Oliver, Oliver, je vous connais trop bien ! fit Sir Nigel en secouant la tête.
CHAPITRE XXXV
Comment Sir Nigel prit un faucon pour un aigle
Au sud de Pampelune, dans le royaume de Navarre, s’étendait un haut plateau désolé, aride, brun ou gris, parsemé de gros rocs de granit. Sur le versant gascon des Pyrénées il y avait des gaves, des champs, des forêts et de petits villages nichés ici ou là ; par contre, sur le versant espagnol, il n’y avait que des rochers nus, de rares pâturages maigres et des déserts de pierres. Des défilés sinistres ou barrancas entrecoupaient ce pays sauvage, ainsi que des torrents qui déferlaient en cascades écumantes entre leurs rives escarpées. Le fracas des eaux, le cri des aigles, le hurlement des loups étaient les seuls bruits qui rompaient le silence.
C’était dans cette région terriblement inhospitalière qu’avançaient Sir Nigel et sa Compagnie ; tantôt ils chevauchaient dans de vastes défilés entre des montagnes brunes, où le ciel n’était qu’une mince ligne bleue ; tantôt ils menaient leurs chevaux sur les sentiers muletiers qui longeaient des précipices profonds de plusieurs centaines de mètres. Pendant deux jours ils s’enfoncèrent ainsi en Navarre : ils dépassèrent Fuente, ils franchirent l’Ega, ils traversèrent Estella. Enfin, par une soirée d’hiver, les montagnes s’abaissèrent devant eux et ils aperçurent l’Èbre large qui serpentait entre des villages. Cette nuit-là les pêcheurs de Viana furent réveillés par des voix rudes qui parlaient une langue étrangère ; avant le matin Sir Nigel et ses hommes avaient passé la rivière en bac et se trouvaient en terre d’Espagne.
Tout le lendemain ils campèrent dans un bois de pins proche de la ville de Logrono ; leurs chevaux avaient besoin de repos. Un conseil se réunit. Sir Nigel avait été accompagné par Sir William Felton, Sir Oliver Buttesthorn, le vieil et robuste Sir Simon Burley, le chevalier errant écossais, comte d’Angus et Sir Richard Causton, qui comptaient tous parmi les plus vaillants chevaliers de l’armée. Il avait avec lui soixante hommes d’armes éprouvés et trois cent vingt archers. Des espions envoyés en mission dès le matin étaient revenus le soir pour annoncer que le Roi d’Espagne campait à vingt kilomètres de là en direction de Burgos, et qu’il avait à sa disposition vingt mille cavaliers et quarante-cinq mille fantassins.
Un feu de bois sec avait été allumé ; autour de ses flammes les chefs s’accroupirent, tandis que les archers bavardaient auprès des chevaux.
– Pour ma part, dit Sir Simon Burley, je pense que nous avons déjà accompli notre mission. Ne savons-nous pas où se tient le Roi et de quelles forces il dispose, ce qui était le but de notre expédition ?
– C’est vrai, répondit Sir William Felton. Mais j’ai voulu participer à cette entreprise parce qu’il y a longtemps que je n’ai pas rompu de lances au cours d’une guerre ; aussi ne prendrai-je pas le chemin du retour avant d’avoir couru contre un gentilhomme d’Espagne. Ceux qui veulent rentrer n’ont qu’à rentrer. Moi je veux voir de plus près ces Espagnols.
– Je ne vous abandonnerai pas, Sir William, répliqua Sir Simon Burley. Et cependant, en ma qualité de vieux soldat et de vétéran des guerres, je me vois contraint de souligner que c’est une bien mauvaise chose pour quatre cents hommes de se trouver entre une armée de soixante mille hommes d’un côté et un large fleuve de l’autre.
– Et cependant, dit Sir Richard Causton, nous ne pouvons pas, pour l’honneur de l’Angleterre, faire demi-tour sans avoir frappé un coup !
– Ni pour l’honneur de l’Écosse ! s’écria le comte d’Angus. Par saint André, que je ne revoie jamais l’eau de la Leith si je tourne bride avant de m’être rapproché de leur camp !
– Par saint Paul, vous avez très bien parlé ! dit Sir Nigel. J’ai d’ailleurs toujours entendu dire qu’il y avait de très dignes gentilshommes parmi les Écossais, et qu’on pouvait faire d’intéressantes rencontres près de leurs frontières. Réfléchissez, Sir Simon, que nous tenons nos renseignements d’espions ordinaires, qui ne sont guère en mesure de nous dire de l’ennemi et de ses forces autant de choses que le désirerait le Prince.
– Vous êtes le chef de cette expédition, Sir Nigel, répondit l’autre. Je ne fais que chevaucher sous votre pennon.
– Pourtant je désire avoir votre opinion et votre conseil, Sir Simon. Mais à propos de ce que vous avez dit concernant le fleuve, nous pouvons nous arranger pour ne pas l’avoir derrière nous. Le Prince en effet a avancé maintenant jusqu’à Salvatierra et vers Vittoria : si nous tombions sur leur camp par l’autre côté, nous pourrions opérer une bonne retraite.
– Que nous proposez-vous alors ? demanda Sir Simon en hochant sa tête grisonnante comme quelqu’un qui ne serait qu’à demi convaincu.
– Que nous avancions jusqu’à ce qu’ils apprennent que nous avons franchi le fleuve. De cette façon nous pourrons voir de plus près leur armée, et peut-être trouver l’occasion d’un petit exploit.
– Qu’il en soit ainsi ! fit Sir Simon.
Les autres membres du conseil ayant approuvé la suggestion de Sir Nigel, un repas hâtif fut préparé, puis l’avance reprit sous le couvert de l’obscurité. Toute la nuit ils menèrent leurs chevaux, trébuchant et peinant dans des défilés sauvages et des vallées escarpées, sous la conduite d’un paysan épouvanté dont le poignet était attaché au cuir de l’étrier de Black Simon. À l’aube ils se trouvèrent dans un ravin noir, au milieu d’autres ravins qui dévalaient de chaque côté ; tout autour d’eux, des rochers bruns s’étageaient en longues terrasses balayées par le vent.
– S’il vous plaît, noble seigneur, dit Black Simon à Sir Nigel, cet homme s’est moqué de nous ; comme il n’y a pas d’arbre où le pendre, nous pourrions le jeter dans ce précipice.
Aux accents rudes de la voix du soldat le paysan avait deviné le sens des paroles ; il tomba à genoux et implora miséricorde.
– Comment cela se fait-il, chien ? demanda en espagnol Sir William Felton. Où est ce camp où tu avais juré de nous conduire ?
– Par la douce Vierge ! Par la Mère bénie de Dieu ! cria le paysan tout tremblant. Je vous jure que dans la nuit je me suis perdu !
– Qu’on le jette dans le précipice ! s’écrièrent une demi-douzaine de voix.
Mais avant que les archers eussent pu l’arracher au roc auquel il se cramponnait, Sir Nigel était intervenu.
– Que veut dire ceci, mes seigneurs ? Tant que le Prince me fait l’honneur de me confier cette expédition, c’est à moi seul de donner des ordres ; et, par saint Paul, je serais très heureux d’approfondir complètement l’affaire avec celui d’entre vous qui prendrait ombrage de mes paroles ! Qu’en dites-vous, Sir William ? ou vous, messire d’Angus ? ou vous, Sir Richard ?
– Non, Nigel ! s’écria Sir William. Ce vil paysan est un trop petit motif de dispute pour de vieux camarades. Mais le fait est qu’il nous a trahis, et qu’il a mérité la mort d’un chien.
– Écoute-moi, l’homme ! dit Nigel. Nous t’accordons encore une chance pour trouver ton chemin. Nous nous disposons à gagner beaucoup d’honneur, Sir William, dans cette entreprise et il serait affligeant que le premier sang versé soit celui d’un rustre. Disons nos oraisons du matin ; peut-être avant que nous ayons fini aura-t-il repéré sa route.
La tête inclinée et le casque à la main, les archers se tinrent immobiles et silencieux à côté de leurs chevaux, tandis que Sir Simon Burley répétait le Pater, l’Ave Maria, et le Credo. Longtemps Alleyne garda cette scène en mémoire : le groupe des chevaliers dans leur armure couleur de plomb, le visage rougeaud de Sir Oliver, les traits anfractueux du comte écossais, le crâne luisant de Sir Nigel, le cercle dense des visages barbus et farouches, les longues têtes brunes des chevaux, avec pour décor les montagnes et les précipices. À peine le dernier Amen avait-il été prononcé par la Compagnie que cent bugles sonnèrent, des tambours battirent, des cymbales s’entrechoquèrent. Chevaliers et archers bondirent sur leurs armes ; ils croyaient qu’une grande armée fondait sur eux ; mais le guide s’agenouilla pour rendre grâces au Ciel de sa miséricorde.
– Nous les avons trouvés, caballeros ! cria-t-il. C’est leur appel du matin. Si vous daignez me suivre, je vais vous les faire voir avant que vous ayez le temps d’égrener un chapelet.
Il dégringola l’un des ravins, escalada ensuite une crête basse, et les conduisit dans une courte vallée qu’arrosait un ruisseau en son milieu et que bordaient de chaque côté d’épais fourrés de sureaux et de buis. Se frayant un passage à travers les arbustes, ils aperçurent un panorama qui fit battre plus vite leurs cœurs.
Devant eux s’étalait une grande plaine parcourue par deux cours d’eau et couverte d’herbe ; elle s’étendait jusqu’à l’endroit où, très loin sur l’horizon, se dressaient contre la lumière bleue les tours de Burgos. Sur toute cette vaste prairie une grande cité de tentes s’était édifiée ; il y en avait des milliers formées en carrés et qui dessinaient des rues comme une ville bien ordonnée. De hautes tentes de soie, des marquises bariolées dominaient la masse des habitations moins somptueuses ; elles indiquaient les emplacements où les grands seigneurs et les barons du Léon et de la Castille avaient déployé leurs bannières, tandis qu’au-dessus des toits blancs, et jusqu’à la limite du visible, l’agitation des pavillons, pennons et banderoles ruisselant d’or et de couleurs vives proclamait que toute la chevalerie d’Espagne était rassemblée. Au milieu du camp, un grand palais de soie blanche et rouge au-dessus duquel flottaient les armes de la Castille confirmait la présence du brave Henri de Transtamare parmi ses soldats.
Les Anglais, derrière l’écran des buissons, contemplaient ce spectacle merveilleux ; toute l’armée qu’ils avaient sous les yeux était déjà debout. La première lueur rose de l’aurore fit scintiller les casques d’acier et les cuirasses des épais bataillons d’arbalétriers et de frondeurs qui faisaient l’exercice dans des champs de manœuvres. Un millier de colonnes de fumée grimpaient dans l’air pur du matin. Des essaims de cavaliers légers galopaient à découvert en lançant des javelots et en se penchant de côté, comme les Maures le leur avaient enseigné. Tout le long des cours d’eau des pages menaient boire les chevaux de leurs maîtres, tandis que les chevaliers vêtus de clair bavardaient entre eux devant la porte de leurs tentes, ou s’en allaient caracolant, un faucon sur le poignet et suivi de limiers, en quête de cailles ou de levrauts.
– Par ma garde, mon gars ! chuchota Aylward à l’oreille d’Alleyne, nous les avons cherchés toute la nuit, mais maintenant que nous les avons trouvés, je me demande ce que nous allons en faire !
– Tu as raison, Samkin, dit le vieux Johnston. Je voudrais bien que nous soyons de retour du côté de l’Èbre, car je ne vois ni honneur, ni profit à gagner ici. Qu’en dis-tu, Simon ?
– Par la Croix ! s’écria le farouche vieil homme d’armes. Je verrai la couleur de leur sang avant de tourner la tête de ma jument en direction des montagnes. Suis-je un enfant qu’on mène chevaucher pendant trois jours dans les montagnes pour rien d’autre que des mots ?
– Bien dit, tendre chèvrefeuille ! approuva Hordle John. Je suis avec toi, comme le manche à la lame. Si je pouvais seulement mettre la main sur l’un de ces fringants personnages, je suis sûr que je tirerais de lui une rançon assez forte pour acheter une nouvelle vache à ma mère !
– Une vache ? dit Aylward. Dis plutôt dix acres et une maison de campagne sur les bords de l’Avon !
– Tu crois ? Alors, par Notre-Dame, je choisis celui qui a le justaucorps rouge.
Il était sur le point de s’avancer tranquillement à découvert, quand Sir Nigel en personne s’élança et l’arrêta.
– Arrière ! dit-il. Notre heure n’est pas encore venue. Nous nous cacherons là jusqu’à ce soir. Retirez vos casques et vos cuirasses, de peur qu’ils n’aperçoivent leurs reflets, et attachez les chevaux au milieu des rochers.
L’ordre fut rapidement exécuté ; dix minutes plus tard les archers s’étaient allongés au bord du ruisseau, mangeaient le pain et le lard qu’ils avaient apportés dans leurs sacs, et tendaient le cou pour guetter le moindre changement sur la scène qu’ils dominaient. Ils demeurèrent silencieux, exception faite de quelques plaisanteries à mi-voix ou d’un ordre chuchoté, car deux fois pendant cette longue matinée ils entendirent des sonneries de bugle dans les montagnes et autour d’eux, ce qui tendait à indiquer qu’ils s’étaient infiltrés entre les avant-postes ennemis. Les chefs s’étaient assis dans les fourrés de buis, et ils tinrent conseil sur l’opération à entreprendre, pendant que montait vers eux le concert des voix bourdonnantes, des cris, des chevaux qui hennissaient, et de tous les bruits d’un grand camp.
– À quoi bon attendre ? disait Sir William Felton. Fonçons sur leur camp avant qu’ils nous aient découverts !
– J’opine dans le même sens ! s’écria le comte écossais. Car ils supposent qu’ils n’ont pas d’ennemis dans un rayon de trente lieues.
– Pour ma part, dit Sir Simon Burley, je pense que c’est une folie, car vous ne pouvez pas espérer mettre en déroute cette grande armée ; et où irez-vous, et que ferez-vous quand ils se tourneront contre vous ? Qu’en pensez-vous, Sir Oliver Buttesthorn ?
– Par la pomme d’Ève ! s’écria le gros chevalier. Il me semble que ce vent nous apporte une odeur très savoureuse d’ail et d’oignons qui émane de leurs marmites. Je suis donc disposé à foncer immédiatement sur les dites marmites, si mon vieil ami et camarade partage cette opinion.
– Non, répondit Sir Nigel. J’ai un autre plan. Nous pourrons tenter un petit fait d’armes contre eux et pourtant, avec l’aide de Dieu, nous retirer sans mal : ce qui, comme l’a exposé Sir Simon Burley, est assez difficile.
– Quel est votre plan, Sir Nigel ? interrogèrent plusieurs voix.
– Nous allons demeurer cachés ici tout le jour ; il serait bien extraordinaire qu’ils nous repèrent. Puis, quand le soir sera venu, nous prendrons notre élan et nous verrons si nous ne pourrons pas nous distinguer très honorablement contre eux.
– Mais pourquoi ce soir et pas maintenant ?
– Parce que nous bénéficierons du couvert de la nuit pour battre en retraite, et que nous pourrons rentrer par les montagnes. Je mettrai ici en faction une vingtaine d’archers dans le défilé, avec tous nos pennons plantés dans le roc, avec tous les bugles et les tambours que nous avons, afin que ceux qui nous poursuivront dans la lumière déclinante puissent penser que c’est toute l’armée du Prince qui arrive, et qu’ils n’osent pas aller plus loin. Que dites-vous de mon plan, Sir Simon ?
– Ma foi, j’en dis beaucoup de bien ! s’écria le vieux chef prudent. Si quatre cents hommes doivent s’attaquer à soixante mille, je ne crois pas qu’il existe de meilleur plan avec autant de chances de succès.
– Et je l’approuve moi aussi ! cria Felton avec chaleur. Mais je voudrais que le jour soit tombé, car ce serait un désastre s’ils nous découvraient.
Il venait de terminer sa phrase quand ils entendirent un bruit de pierres qui roulaient et le martèlement de quatre sabots : un gentilhomme très brun, monté sur un cheval blanc, traversa le rideau des fourrés et descendit dans la vallée ; il avait débouché par l’extrémité la plus éloignée du camp espagnol. Il n’avait qu’une armure légère ; sa visière était levée ; un faucon était perché sur son poignet gauche, et il le regardait avec l’air insouciant de l’homme qui ne pense qu’à son plaisir et qui ignore la présence d’un danger. Tout à coup cependant, il aperçut les visages farouches qui l’observaient entre les buissons. Alors il poussa un cri de terreur, enfonça ses éperons dans les flancs de son cheval et se rua vers l’étroite ouverture de la gorge. Il faillit l’atteindre, car il avait renversé ou évité les archers qui s’étaient jetés au-devant de lui ; mais Hordle John le saisit par un pied ; de sa poigne de fer il le tira de sa selle, tandis que deux autres soldats maîtrisaient le cheval effrayé.
– Oh, oh ! rugit le grand archer. Combien de vaches achèteras-tu à ma mère si je te libère ?
– Faites taire ce buffle ! s’écria Sir Nigel impatienté. Qu’on m’amène cet homme. Par saint Paul, ce n’est pas la première fois que nous nous rencontrons ! Si je ne me trompe, vous êtes Don Diego Alvarez, autrefois familier de la cour du Prince.
– C’est moi en effet, dit l’Espagnol en français. Et je vous serais reconnaissant de me passer le fil de votre épée en plein cœur. Car comment pourrais-je vivre, moi, un caballero de Castille, après avoir été arraché de mon cheval par les mains sales d’un archer ?
– Que cela ne vous contrarie pas, répondit Sir Nigel. S’il ne vous avait pas fait tomber, votre corps serait transpercé d’une douzaine de flèches.
– Par saint Jacques, j’aurais préféré mourir plutôt que d’avoir été pollué par son contact ! affirma l’Espagnol dont les yeux noirs étincelaient de rage et de haine. J’espère que je suis maintenant le prisonnier d’un honorable chevalier ou gentilhomme ?
– Vous êtes le prisonnier de l’homme qui vous a capturé, messire Diego, déclara Sir Nigel. Et je puis vous dire que de meilleurs hommes que vous et moi ont déjà été capturés par des archers anglais.
– Quelle rançon demande-t-il ? interrogea l’Espagnol.
Le gros John se gratta la tête, mais sourit de toutes ses dents quand cette question lui fut répétée.
– Dites-lui, répondit-il, qu’il me faut dix vaches et un taureau, même si ce n’est qu’un petit taureau. Il me faut aussi une robe de cendal bleu pour ma mère et une en rouge pour Joan ; avec cinq acres de pâturages, deux faux, et une belle meule. De même une petite maison, avec des étables pour les vaches, et trente-six gallons de bière pour la saison sèche.
– Tut, tut ! s’écria Sir Nigel en riant. Ces choses-là s’expriment en argent. Je crois, messire Diego, que cinq mille couronnes ne représentent pas une somme excessive pour un chevalier de votre renommée.
– Elle lui sera payée en temps voulu.
– Pendant quelques jours nous devrons vous garder avec nous ; et je dois vous prier de nous accorder la permission d’utiliser votre bouclier, votre armure, et votre cheval.
– Mon équipement vous appartient selon les lois de la guerre, dit lugubrement l’Espagnol.
– Je ne vous demande qu’un emprunt. J’en ai besoin aujourd’hui, mais il vous sera dûment restitué. Installe des gardes, Aylward, avec la flèche sur la corde, aux deux extrémités de ce col ; car il se pourrait que d’autres gentilshommes viennent nous rendre visite avant que l’heure soit venue.
Toute la journée les Anglais demeurèrent dans la gorge abritée et contemplèrent les différents mouvements de leurs ennemis inconscients du péril qui les menaçait. Peu après midi, de nombreux cris et des applaudissements retentirent dans tout le camp ; il y eut des rassemblements, des sonneries de bugles. Escaladant les rochers, les chefs aperçurent un long nuage roulant de poussière le long de l’horizon de l’est ; un scintillement de lances et une agitation, de pennons annoncèrent bientôt qu’un nombreux corps de cavalerie approchait. Pendant quelques instants ils espérèrent que le Prince avait avancé plus vite que prévu, qu’il avait franchi l’Èbre, et que son avant-garde se préparait à attaquer.
– Je suis sûr que je vois la pile de gueules de Chandos en tête du premier escadron ! cria Sir Richard Causton.
– Non ! répliqua Sir Simon Burley dont le visage s’assombrit. C’est exactement ce que je craignais. C’est l’aigle à deux têtes de Du Guesclin.
– Vous avez raison ! s’exclama le comte d’Angus. Ce sont les troupes qu’il a levées en France. Je reconnais l’emblème du maréchal d’Andreghen, celui du baron d’Antoing et de Briseuil, et d’autres qui viennent de Bretagne et d’Anjou.
– Par saint Paul, je suis ravi de ces bonnes nouvelles ! fit Sir Nigel. Je ne sais rien de ces Espagnols ; mais les Français sont de très dignes gentilshommes : ils feront tout ce qu’ils pourront pour que nous nous distinguions.
– Ils sont au moins quatre mille, et tous des hommes d’armes ! s’écria Sir William Felton. Tenez, voici Bertrand en personne, à côté de sa bannière, et voici le Roi Henri qui galope pour l’accueillir. Maintenant ils rentrent tous ensemble dans le camp.
Tout au long du jour le bruit des divertissements et des réjouissances monta du camp en liesse aux oreilles des Anglais qui voyaient les soldats des deux nations s’embrasser et danser la main dans la main autour des feux. Le soleil venait de disparaître derrière un banc de nuages à l’ouest quand Sir Nigel fit transmettre l’ordre aux hommes de reprendre leurs armes et de tenir leurs chevaux prêts. Lui-même avait délaissé son armure personnelle, et il s’était habillé de pied en cap avec l’équipement de l’Espagnol capturé.
– Sir William, dit-il, j’ai l’intention d’essayer une petite chose ; je vous demande donc de commander cette expédition sur le camp. Quant à moi, je pénétrerai à l’intérieur du camp avec mon écuyer et deux archers. Je vous prie de ne pas me quitter des yeux, et de vous élancer seulement quand je serai arrivé au milieu des tentes. Vous laisserez vingt hommes ici derrière vous, comme nous l’avons projeté ce matin, et vous regagnerez cette gorge après vous être aventuré aussi loin qu’il vous plaira.
– Je ferai comme vous me l’ordonnez, Nigel. Mais que vous proposez-vous d’accomplir ?
– Vous le verrez bientôt. Il ne s’agit que d’une plaisanterie. Alleyne, tu viendras avec moi, et tu conduiras un cheval de rechange par la bride. J’emmènerai aussi les deux archers qui nous ont accompagnés à travers la France, car ce sont des fidèles et des braves… Laissez vos arcs ici dans les buissons, car je ne souhaite pas qu’on sache trop tôt que nous sommes Anglais. Pas un mot à quiconque, en cas de rencontre, et si l’on vous adresse la parole, agissez comme si vous n’aviez rien entendu. Êtes-vous prêts ?
– Je suis prêt, mon noble seigneur, répondit Alleyne.
– Moi aussi ! crièrent d’une seule voix Aylward et John.
– J’abandonne donc le reste à votre sagesse, Sir William ; si Dieu est avec nous, vous nous retrouverez dans cette gorge avant la nuit.
Sur ces mots, Sir Nigel enfourcha le cheval blanc du gentilhomme espagnol et sortit paisiblement de sa cachette, suivi de ses trois compagnons. Alleyne menait par la bride le destrier de son maître. Il y avait tellement de petits groupes de cavaliers français et espagnols disséminés dans les environs que celui-ci n’éveilla pas l’attention. Au petit trot Sir Nigel et ses compagnons débouchèrent dans la plaine et arrivèrent jusqu’au camp sans avoir été questionnés ni arrêtés. Ils entrèrent alors dans les interminables files de tentes autour desquelles bavardaient cavaliers et fantassins, puis ils aperçurent en face d’eux le pavillon royal. Ils étaient parvenus à ses abords quand éclata soudain un vacarme fait de cris de guerre et de tous les bruits d’un combat dans une partie éloignée du camp. Des soldats sortirent de leurs tentes avec leurs armes ; des chevaliers hélaient leurs écuyers ; le désordre fut bientôt à son comble. Devant la tente royale une foule de serviteurs somptueusement vêtus couraient dans une panique indescriptible, car les soldats de garde s’étaient déjà précipités dans la direction de l’alarme. De chaque côté de la porte se tenait un homme d’armes : ils étaient les seuls protecteurs de la résidence royale.
– Je suis venu pour le Roi ! chuchota Sir Nigel. Par saint Paul, je le ramènerai ou je resterai ici !
Alleyne et Aylward sautèrent à bas de leurs montures et bondirent sur les deux sentinelles qui furent désarmées et abattues sur-le-champ. Sir Nigel se rua dans la tente royale ; Hordle John le suivit dès que les chevaux furent attachés. De l’intérieur jaillirent des hurlements sauvages, accompagnés d’un cliquetis d’épées. Sir Nigel et John reparurent ; ils avaient du sang jusqu’au coude. John portait sur ses épaules le corps inanimé d’un homme dont le surcot orné des lions et des tours de Castille attestait qu’il appartenait à la maison royale. Une foule de serviteurs et de pages décomposés les suivait ; les derniers poussaient en avant les premiers, mais ceux-ci reculaient devant les épées anglaises. Le corps inanimé fut jeté en travers du cheval de rechange ; les quatre compagnons sautèrent en selle, et s’enfuirent au galop à travers le camp en effervescence.
Mais la confusion et le désordre continuaient de régner parmi les Espagnols, car dans leur élan Sir William Felton et ses hommes avaient parcouru une bonne moitié du camp, et ils avaient jalonné leur route d’une longue traînée de morts et de mourants. Ne sachant pas qui étaient leurs agresseurs, incapables de distinguer leurs ennemis anglais de leurs alliés nouvellement arrivés, les chevaliers espagnols caracolaient en vain dans une fureur aveugle. Le désordre, le mélange des races, la lumière qui faiblissait, tout favorisa les quatre chevaliers. Deux fois avant de sortir du camp ils durent se frayer le passage à travers de petits détachements de cavalerie ; une fois ils entendirent siffler des flèches et chanter des pierres à leurs oreilles. Mais, sans interrompre leur course, ils se trouvèrent bientôt hors des tentes et rejoignirent leurs camarades qui battaient en retraite vers les montagnes. Après cinq minutes de galop furieux dans la plaine, tous avaient regagné la gorge ; leurs poursuivants s’arrêtèrent quand ils entendirent les tambours et les trompettes qui semblaient annoncer que toute l’armée du Prince émergeait des cols de la montagne.
– Sur mon âme, Nigel cria Sir Oliver en brandissant un gros jambon, je suis tombé sur quelque chose que je pourrai manger avec mes truffes ! J’ai dû livrer un dur combat, car ils étaient trois avec la bouche ouverte et le couteau à la main, assis pour leurs agapes, quand je me suis présenté. Que diriez-vous, Sir William, de tâter de ce pourceau d’Espagne, bien que nous n’ayons que l’eau du ruisseau pour l’arroser ?
– Plus tard, Sir Oliver ! répondit le vieux soldat en s’essuyant le visage. Il faut que nous nous enfoncions dans l’intérieur des montagnes pour avoir un peu de sécurité. Mais qui avez-vous avec vous, Nigel ?
– Un prisonnier que j’ai capturé. À vrai dire il vient de la tente royale, porte les armes royales sur son surcot. Je pense que c’est le Roi d’Espagne.
– Le Roi d’Espagne ! crièrent les compagnons stupéfaits.
– Non, Sir Nigel ! dit Felton en se penchant vers le prisonnier. J’ai vu deux fois Henri de Transtamare ; cet homme ne lui ressemble nullement.
– Mais, par la lumière du Ciel… ? Alors je retourne le chercher ! fit Sir Nigel.
– Non. Le camp est en alerte ; ce serait folie pure. Qui es-tu ? ajouta-t-il en espagnol. Et comment se fait-il que tu oses porter les armes de la Castille ?
Le prisonnier commençait à se remettre du choc qu’il avait éprouvé quand la poigne de Hordle John s’était appesantie sur lui.
– S’il vous plaît, répondit-il, je suis, avec neuf autres, écuyer de corps du Roi, et je dois porter ses armes pour le mettre à l’abri de dangers dans le genre de celui qui le menaçait ce soir. Le Roi est dans la tente du brave Du Guesclin, chez qui il soupe. Mais je suis Don Sancho Penelosa, caballero d’Aragon, et, bien que je ne sois pas le Roi, je suis prêt à payer le prix de ma rançon.
– Par saint Paul, je ne toucherai pas à votre or ! s’écria Sir Nigel. Retournez chez votre maître, saluez-le de la part de Sir Nigel Loring du château de Twynham, dites-lui que j’espérais faire plus ample connaissance avec lui ce soir et que, si j’ai mis un peu de désordre dans sa tente, ce n’était que dans ma hâte de connaître un chevalier réputé si courtois. Éperonnons nos montures, camarades ! Car il nous faut couvrir quelques lieues avant de nous aventurer à allumer un feu ou à desserrer la ceinture. J’avais espéré galoper sans ma mouche cette nuit, mais je crois que je vais devoir la porter encore un peu de temps.
CHAPITRE XXXVI
Comment Sir Nigel retira la mouche de son œil
C’était un matin froid du début de mars ; le brouillard roulait ses masses denses à travers les cols des monts cantabriques. La Compagnie, qui avait passé la nuit dans un petit ravin abrité, était déjà debout ; les uns entouraient les feux allumés, d’autres jouaient à saute-mouton, car ils avaient les membres engourdis par le froid. Des cimes élevées, de gros entassements de rochers se dessinaient confusément dans le brouillard. Dominant de haut la mer de nuages, un pic gigantesque coiffé de neige commença à rosir sous le premier rayon du soleil. La terre était mouillée, les rochers s’égouttaient, l’herbe et les fougères étaient saupoudrées de gouttes de rosée ; pourtant la joie régnait dans le camp et les éclats de rire fusaient, car un messager du Prince venait d’arriver pour leur transmettre des compliments fort flatteurs touchant leur expédition au camp espagnol, et pour leur commander de demeurer en éclaireurs à la tête de l’armée.
Autour d’un feu, quatre ou cinq chefs de file des archers étaient réunis : ils ôtaient la rouille de leurs armes, et ils jetaient des coups d’œil impatients vers le grand pot qui fumait sur le brasier. Jambes croisées, Aylward était accroupi à l’orientale : il frottait sa brigandine en sifflotant. Le vieux Johnston s’affairait pour ajuster des plumes à quelques flèches de son goût. Hordle John était allongé de tout son long, et il tenait son casque en équilibre au bout de son pied levé. Black Simon, recroquevillé au milieu des rochers, fredonnait une ballade tout en aiguisant son épée contre une pierre plate calée entre ses genoux. Alleyne Edricson et Norbury, l’écuyer taciturne de Sir Oliver, tendaient leurs mains glacées vers les flammes des fagots.
– Jette une autre brassée de petit bois, John, et remue la soupe avec ton fourreau ! grommela Johnston qui regardait pour la vingtième fois la marmite.
– Par ma garde ! s’écria Aylward. Depuis que John a la promesse de cette belle rançon, c’est tout juste s’il consent à s’occuper de la soupe des pauvres archers ! Qu’en dis-tu, camarade ? Quand tu reverras Hordle, il n’y aura plus de mauvaise bière ni de lard gras, mais des vins de Gascogne et des viandes rôties chaque jour de la semaine.
– Cela je ne le sais pas, répondit John en lançant son casque en l’air et en le rattrapant d’une main. Mais ce que je sais, c’est que je vais plonger ceci dans la soupe, qu’elle soit cuite ou non.
– Elle bout ! cria Johnston.
Immédiatement la marmite fut retirée du feu, et son contenu réparti dans une demi-douzaine de casques d’acier posés entre les genoux de leurs propriétaires. Ce repas matinal fut englouti avec délices.
– Mauvais temps pour les flèches ! fit observer John quand il eut avalé la dernière goutte de sa soupe. Mes cordes ce matin sont aussi molles qu’une queue de vache.
– Tu devrais les frotter avec de la glu, dit Johnston. Te rappelles-tu, Samkin, qu’il faisait encore plus humide au matin de Crécy ? Pourtant je ne crois pas que nos cordes nous aient causé beaucoup de soucis.
– J’ai dans l’idée, fit Black Simon en se remettant à aiguiser son épée, que nous pourrions avoir besoin de vos cordes avant la chute du jour. J’ai rêvé de la vache rouge cette nuit.
– Et quelle est cette vache rouge, Simon ? interrogea Alleyne.
– Je ne sais pas, jeune seigneur. Mais je peux te dire qu’à la veille de Cadsand, et à la veille de Crécy, et à la veille de Nogent, j’ai rêvé d’une vache rouge ; comme le rêve est revenu me visiter cette nuit, je fourbis consciencieusement mon arme pour lui donner un fil convenable.
– Bien parlé, vieux chien de guerre ! s’écria Aylward. Par ma garde, je prie pour que ton rêve soit vrai, car le Prince ne nous a pas postés ici pour boire de la soupe ou cueillir des myrtilles. Encore une bataille, et je suis prêt à suspendre mon arc, à me marier et à me retirer au coin du feu. Que se passe-t-il, Robin ? Qui cherches-tu ?
– Le seigneur Loring vous requiert dans sa tente, dit un jeune archer à Alleyne.
L’écuyer se leva et se dirigea vers la tente où il trouva le chevalier assis sur un coussin avec un large ruban de parchemin posé sur ses genoux ; il avait le front plissé et les lèvres crispées.
– Ce pli m’est arrivé ce matin par le messager du Prince, dit-il. Et c’est Sir John Fallislee, qui vient d’arriver du Sussex, qui l’a apporté. Que penses-tu de ce qui est écrit sur le côté extérieur ?
– L’écriture est belle et nette, répondit Alleyne. Je lis : « À Sir Nigel Loring, chevalier, connétable du château de Twynham, de la part de Christopher, serviteur de Dieu au prieuré de Christchurch. »
– J’avais bien lu, dit Sir Nigel. Maintenant je te prie de lire l’intérieur.
Alleyne tourna le rouleau de parchemin et, quand il y posa ses yeux, il devint pâle : un cri de surprise et de douleur s’échappa de ses lèvres.
– Qu’y a-t-il ? interrogea le chevalier anxieusement. Il ne se passe rien de grave pour Lady Mary ou pour la damoiselle Maude ?
– C’est mon frère, mon pauvre malheureux frère ! s’écria Alleyne en portant une main à son front. Il est mort.
– Par saint Paul, il ne t’avait pas témoigné tellement d’affection que tu dusses te lamenter ainsi !
– Il était mon frère pourtant, le seul parent qui me restait sur cette terre. Peut-être n’avait-il pas tort de me témoigner de l’amertume, puisqu’une partie de ses terres avait été cédée à l’abbaye pour mon éducation. Hélas, hélas ! Et j’ai levé mon bâton contre lui quand je l’ai rencontré ! Il a été tué. Tué, je le crains, dans le crime et la violence.
– Ah ! fit Sir Nigel. Lis donc, je te prie.
– « Que Dieu soit avec vous, très honoré seigneur, et qu’il vous tienne en Sa sainte garde ! Lady Loring m’a prié de vous coucher par écrit ce qui est arrivé à Twynham, et la mort de votre méchant voisin, le seigneur de Minstead. Car quand vous nous avez quittés, ce mauvais homme a rassemblé autour de lui des hors-la-loi et tous les scélérats et les serfs évadés jusqu’à ce qu’il puisse disposer d’une force qui a tué et dispersé les soldats que le Roi avait envoyés contre eux. Puis ils sont sortis des bois et ils ont assiégé votre château ; pendant deux jours ils nous ont cernés et ils nous ont criblés de flèches ; ils étaient incroyablement nombreux. Cependant Lady Loring a fermement tenu la place ; le deuxième jour, le seigneur de Minstead a été tué (sans doute par ses propres partisans, disent certains) et nous avons été délivrés. Louange pour cela à tous les saints, et plus spécialement à saint Anselme dont c’était la fête. Lady Loring et la damoiselle Maude, votre jolie fille, sont en bonne santé. Moi aussi, à l’exception d’une faiblesse aux orteils, qui m’a été envoyée pour mes péchés. Que tous les saints vous préservent ! »
– C’était la vision de dame Tiphaine, commenta Sir Nigel après un silence. Peut-être n’avais-tu pas remarqué qu’elle avait décrit le chef des assaillants comme un homme de grande taille et à barbe blonde ? Elle avait dit également qu’il était tombé devant le portail. Mais comment se fait-il, Alleyne, que cette femme pour qui toute chose est cristal et qui n’a pas prononcé une parole erronée, se soit trompée au point de dire que tes pensées se tournaient plus souvent que les miennes vers le château de Twynham ?
– Noble seigneur, répondit Alleyne en rougissant, dame Tiphaine a pu ne pas se tromper ; car le château de Twynham est dans mon cœur le jour et dans mes rêves la nuit.
– Ah ! s’écria Sir Nigel avec un coup d’œil oblique.
– Oui, noble seigneur. Car réellement j’aime votre fille, la damoiselle Maude ; et tout indigne que je sois, je donnerais pour la servir tout le sang de mon cœur !
– Par saint Paul, Edricson ! fit froidement le chevalier en arquant les sourcils. Tu vises haut. Notre sang est très ancien.
– Le mien l’est aussi, répondit l’écuyer.
– Et la damoiselle Maude est notre enfant unique. Notre nom et nos terres se concentrent sur elle.
– Hélas, je suis aussi maintenant le seul Edricson !
– Pourquoi ne m’en as-tu pas parlé d’abord, Alleyne ? Pour tout dire, je pense que tu as mal agi.
– Non, noble seigneur, ne croyez pas cela ! Car je ne sais pas si votre fille m’aime, et il n’y a aucune parole échangée entre nous.
Sir Nigel réfléchit un moment, puis éclata de rire.
– Par saint Paul, dit-il, je ne vois pas pourquoi je me mêlerais de cette affaire ! Car j’ai toujours constaté que la damoiselle Maude était très capable de s’occuper de ses propres intérêts. À partir du jour où elle a pu taper de son petit pied, elle a constamment fini par avoir tout ce qu’elle désirait. Or donc si elle te voue son cœur, Alleyne, et si toi tu lui voues le tien, je ne crois pas que ce Roi d’Espagne, avec ses soixante mille hommes, parviendrait à vous séparer. Cependant je te dis ceci : je veux te voir chevalier avant que tu ailles conter fleurette à ma fille. J’ai toujours soutenu qu’elle épouserait un brave coureur de lance ; et, sur mon âme, Edricson, si Dieu t’épargne, je crois que tu le seras… Mais assez de bagatelles ! Nous avons de l’ouvrage devant nous, et il sera temps de reconsidérer l’affaire quand nous reverrons les blanches falaises de l’Angleterre. Va, je te prie, trouver Sir William Felton et demande-lui de venir ici, car il est temps que nous nous mettions en route. Il n’y a pas de passage à l’autre bout de la vallée, et l’endroit deviendrait dangereux si l’ennemi tombait sur nous.
Alleyne transmit son message, puis s’éloigna du camp. Les nouvelles tourbillonnaient dans sa tête : la mort de son frère, son entretien avec Sir Nigel… Il s’assit sur un rocher et reposa son front brûlant sur ses mains. Il pensait à son frère, à leur querelle, à la damoiselle dans sa robe déchirée, au vieux château gris, au fier visage pâli dans l’armurerie, aux derniers mots enflammés qui avaient été leur adieu. À présent c’était lui le seigneur de Minstead, le chef d’une vieille famille, le propriétaire d’un domaine qui, en dépit de ses amputations, suffisait encore à assurer la dignité de son nom. Par ailleurs il était devenu un homme d’expérience, il avait pris rang parmi les braves des braves, il avait conquis l’estime et la confiance du père de la damoiselle, il avait été écouté quand il lui avait avoué le secret de son amour. Pour ce qui était de gagner le titre de chevalier, ces temps agités étaient propices ; un écuyer courageux et de bonne naissance pouvait raisonnablement aspirer à cet honneur. Oui, ou bien il laisserait ses os dans ces ravins d’Espagne, ou bien il accomplirait une action d’éclat qui attirerait sur lui l’attention générale.
Assis sur son rocher, avec les joies et les chagrins qui alternaient dans son esprit comme des ombres de nuages sur une plaine ensoleillée, il prit soudainement conscience d’un bruit sourd, profond, qui parvenait à ses oreilles à travers le brouillard. Derrière lui il entendait bien les murmures des archers, leurs éclats de rire, le piétinement des chevaux. Mais en bruit de fond il y avait maintenant cette sorte de vrombissement grave qui semblait envahir tout l’air. Il se rappela un bruit semblable qui remontait à ses années de couvent : par une nuit d’hiver il était sorti à Bucklershard et il était resté longtemps à écouter le bruit des vagues qui se brisaient sur le rivage couvert de galets. Ici pourtant il ne s’agissait ni du vent ni de la mer. Et ce sourd murmure s’élevait de plus en plus fort, de plus en plus puissant au cœur de cette ouate brumeuse. Il se leva et prit le pas de course, en donnant l’alarme du plus clair de sa voix.
Il n’était qu’à cent mètres du camp ; quand il y arriva, tous les archers étaient déjà à la tête de leurs chevaux, et les chevaliers, tirés de leurs tentes par les cris d’Alleyne, écoutaient ce bruit de mauvais augure.
– C’est un fort détachement de cavalerie, dit Sir William Felton, et qui approche rapidement.
– Ils font sans doute partie de l’armée du Prince, fit observer Sir Richard Causton, puisqu’ils viennent du nord.
– Non, déclara le comte d’Angus, je n’en suis pas aussi sûr. Car le paysan auquel nous avons parlé hier soir a fait état d’une rumeur selon laquelle Don Tello, frère du Roi d’Espagne, était parti avec six mille cavaliers d’élite pour attaquer le camp du Prince. Il se pourrait fort bien qu’au retour de leur expédition ils passent par ici.
– Par saint Paul ! s’écria Sir Nigel. Je crois que vous avez raison : ce paysan-là avait l’œil sournois et le visage aigre ; il ne nous portait pas dans son cœur. Je parie qu’il a lancé les cavaliers sur notre piste.
– Mais le brouillard nous protège, dit Sir Simon Burley. Nous avons donc le temps de galoper jusqu’à l’autre extrémité du col.
– Si nous étions un troupeau de chèvres de montagne, nous y parviendrions peut-être, répliqua Sir William Felton. Mais une compagnie de cavaliers ne passera pas. S’il s’agit réellement de Don Tello et de ses hommes, nous n’avons qu’à demeurer là où nous sommes et faire l’impossible pour qu’ils maudissent le jour où ils nous ont trouvés sur leur chemin.
– Bien parlé, Sir William ! fit Sir Nigel visiblement ravi. S’ils sont aussi nombreux qu’on le dit, alors ils nous procureront beaucoup d’honneur et de distinction. Mais le bruit a cessé : je crains qu’ils ne se soient éloignés.
– À moins qu’ils ne soient arrivés à l’entrée de la gorge, et qu’ils ne reforment leurs rangs. Écoutons !
La Compagnie immobilisée fouillait le brouillard du regard, au milieu d’un silence si profond que le souffle des chevaux et l’eau qui s’égouttait des rochers frappaient bizarrement l’oreille. Tout à coup un cheval se mit à hennir dans la mer de brume, et un bugle sonna.
– C’est une sonnerie espagnole, noble seigneur, expliqua Black Simon. Elle est d’usage entre piqueurs et veneurs quand la bête n’a pas fui et se trouve encore dans son repaire.
– Par ma foi, dit Sir Nigel en souriant, s’ils ont l’humeur à la vénerie, nous leur promettons du beau sport avant qu’ils sonnent l’hallali. Mais il y a une colline au centre de la gorge : nous pourrions y établir notre résistance.
– Je l’avais remarquée hier soir, dit Felton. Nous ne trouverons rien de mieux, car elle est presque à pic par-derrière. Elle se trouve à une portée d’arc sur la gauche ; j’en vois l’ombre.
Toute la Compagnie, tenant les chevaux par la bride, se rendit sur la petite colline qui se profilait confusément dans le brouillard. Elle était effectivement très bien située et d’une défense facile ; sa face s’inclinait en pente douce parmi de gros rochers, mais sa paroi de derrière retombait toute lisse sur une cinquantaine de mètres de hauteur. Le sommet était coiffé d’un petit plateau au sol inégal qui avait bien une centaine de pas de largeur.
– Détachez les chevaux, ordonna Sir Nigel. Il n’y a pas assez de place ici pour eux ; si nous faisons du bon travail, nous acquerrons plus de montures qu’il nous en faudra. Aylward, Johnston, que vos hommes forment la herse de chaque côté de la crête. Sir Oliver et vous, messire d’Angus, je vous confie l’aile droite, et à vous Sir Simon et Sir Richard, l’aile gauche. Moi et Sir William Felton, nous tiendrons le centre avec nos hommes d’armes. En ligne ! Déployez pennons et bannières, car nos âmes appartiennent à Dieu, nos corps au Roi, nos épées à saint Georges et à l’Angleterre !
À ce moment le brouillard sembla s’amincir dans la vallée, et il se déchira en longs nuages déchiquetés. La gorge dans laquelle ils avaient campé était une simple crevasse en forme de coin au milieu des montagnes ; elle avait à peu près un kilomètre de long : la petite colline, sur laquelle ils se tenaient était adossée à des rochers à pic qui la cernaient sur trois côtés. Quand le brouillard se fut dissipé, et quand le soleil perça, ils furent éblouis par le miroitement des armures et des casques d’une très nombreuse force de cavalerie qui s’engageait dans la gorge et dont les rangs s’étiraient au loin dans la plaine où était stationnée l’arrière-garde. Leur masse bouchait littéralement le goulet de la vallée. Les pennons s’agitaient, les lances scintillaient, les panaches se balançaient, les flammes des lances ondulaient, les destriers piaffaient… Un cri de joie précéda le déploiement d’une forêt d’acier : les Espagnols avaient enfin aperçu leurs ennemis pris au piège. Une centaine de bugles et de tambours, auxquels se mêlait le fracas des cymbales mauresques, entonnèrent une musique triomphale. En considérant cette poignée d’hommes sur la colline, les lignes minces des archers, le petit groupe des chevaliers et des hommes d’armes dont l’armure était rouillée et décolorée après tant d’années de service, les fringants gentilshommes d’Espagne devaient avoir du mal à croire qu’ils se trouvaient en face de ces mêmes soldats dont la réputation et les exploits étaient un intarissable sujet de conversation autour des feux de camp dans toute la Chrétienté. Les Anglais étaient immobiles, silencieux ; ils s’appuyaient sur leurs arcs ; leurs chefs délibéraient auprès d’eux. Il n’y eut pas de sonnerie de bugle. Mais au centre se dressaient les léopards d’Angleterre, à droite l’emblème de la Compagnie avec les roses de Loring, à gauche, au-dessus des soixante archers gallois, la bannière rouge de Merlin avec les têtes de sanglier des Buttesthorn. Gravement, paisiblement, ils attendaient sous le soleil du matin l’assaut de leurs ennemis.
– Par saint Paul ! fit Sir Nigel en regardant la vallée de son œil clignotant. On dirait qu’il y a quelques personnages très dignes parmi ces gens-là. Quelle est la bannière dorée sur la gauche ?
– L’emblème des chevaliers de Calatrava, répondit Felton.
– Et l’autre sur la droite ?
– Celle des chevaliers de Santiago ; je vois d’après son drapeau que leur grand-maître chevauche à leur tête. Il y a aussi la bannière de la Castille au milieu de l’escadron étincelant qui précède le gros des forces. D’après moi, ils sont six mille hommes d’armes, plus dix escadrons de frondeurs.
– Des Français figurent dans cette armée, noble seigneur, dit Black Simon. Je reconnais les pennons de Couvette, de Brieux, de Saint Pol et de plusieurs autres qui intervinrent contre nous pour Charles de Blois.
– Tu as raison, dit Sir William. Il y a beaucoup de blasons espagnols, mais je ne les connais guère. Don Diego, les armes de votre propre pays n’ont pas de secret pour vous. Quels sont ceux qui nous ont fait tant d’honneur ?
Le prisonnier espagnol regarda avec une évidente satisfaction les rangs serrés de ses compatriotes.
– Par saint Jacques, s’exclama-t-il, si vous êtes vaincus aujourd’hui, vous ne tomberez pas entre des mains viles ! La fleur de la chevalerie castillane est rangée sous la bannière de Don Teno, avec la chevalerie des Asturies, de Tolède, du Léon, de Cordoue, de Galice et de Séville. Je vois les guidons de Caçoria, d’Albornez, de Rodriguez, de Tavora. Il y a aussi les deux grands ordres, et les chevaliers de France et d’Aragon. Si vous voulez mon avis, venez-en à composition avec eux, car ils vous réduiront à l’état où vous m’avez mis.
– Non, par saint Paul ! Il serait dommage que tant de braves soient réunis sans qu’en sorte un petit fait d’armes. Ah, William, ils avancent sur nous ! Ma foi, c’est un spectacle qui valait bien une traversée des mers !
En effet, les deux ailes de l’armée espagnole, composée des chevaliers de Calatrava d’un côté et des chevaliers de Santiago de l’autre, déclenchaient une attaque simultanée en descendant la vallée ; le gros de l’armée suivait plus lentement. À cinq cents pas des Anglais, les deux grandes unités de cavalerie se rejoignirent, entremêlèrent leurs rangs, virèrent en dessinant une courbe et se retirèrent vers le centre dans un désordre simulé. Souvent jadis les Maures, par de fausses fuites, avaient incité les impétueux Espagnols à sortir de leurs places fortes pour leur donner la chasse ; mais sur la colline étaient réunis des hommes qui avaient fait des ruses et de tous les artifices de la guerre leur pain quotidien. À nouveau, et plus près cette fois, les Espagnols recommencèrent leur manœuvre : avec des cris de frayeur et en baissant la tête ils crochetèrent à droite et à gauche, mais les Anglais demeurèrent impassibles sur leur rocher. L’avant-garde s’était arrêtée à une portée d’arc ; les hommes brandissaient leurs lances, criaient, défiaient leurs ennemis. Deux gentilshommes sortirent des rangs et poussèrent leurs chevaux entre les deux lignes ; ils avaient l’écu au bras et la lance en arrêt comme les concurrents d’un tournoi.
– Par saint Paul ! s’écria Sir Nigel dont l’œil s’enflamma comme une braise, voici deux gentilshommes qui me semblent très dignes et fort débonnaires. Je ne me rappelle pas avoir vu déjà un peuple paraissant animé d’un tel courage et d’une si noble audace. Nous avons nos chevaux, Sir William ; les délivrerons-nous d’un vœu qu’ils pourraient avoir sur le cœur ?
Pour toute réponse Felton bondit sur son destrier et le lança sur la pente. Sir Nigel le suivit à trois longueurs de lance. La lice était accidentée, inégale, rocheuse ; mais les deux chevaliers ayant choisi chacun son adversaire foncèrent au triple galop, tandis que les braves Espagnols enlevaient leurs montures pour les rencontrer. Celui à qui Felton était opposé se trouva être un grand jeune homme qui avait une tête de cerf sur son écu ; l’adversaire de Sir Nigel, large et trapu, recouvert d’acier plein, portait autour de son casque une torsade rose et blanche. Le premier frappa l’écu de Felton avec une telle force qu’il le fendit d’un bout à l’autre, mais la lance de Sir William transperça le camail protégeant la gorge de l’Espagnol qui tomba en poussant des cris affreux. Emporté par la chaleur de l’action le chevalier anglais ne tira pas sur les rênes : il chargea droit sur la ligne des chevaliers de Calatrava. Longtemps les hommes silencieux massés sur la colline assistèrent aux violents remous qui secouaient la colonne espagnole ; les destriers se cabraient, les lames étincelaient avant de s’abattre. Le panache blanc du casque anglais se dressait, retombait comme l’écume d’une vague dans le cercle d’acier qui l’entourait. Finalement il disparut : un brave de plus avait quitté la guerre pour la paix.
Pendant ce temps, Sir Nigel avait trouvé un adversaire à sa taille, qui n’était autre que Sebastian Gomez, la meilleure lance des chevaliers de Santiago, qui avait conquis une réputation d’invincibilité dans cent combats contre les Maures d’Andalousie. Leur choc fut si violent que leurs lances se fendirent jusqu’à la poignée, et que leurs chevaux se cabrèrent sur leurs pattes postérieures au point que leurs cavaliers manquèrent d’être désarçonnés. Cependant avec un égal talent d’écuyer, ils firent tous deux pivoter leurs montures puis, après avoir pris un virage allongé, ils tirèrent l’épée et se fouaillèrent l’un l’autre comme deux forgerons tapant sur une enclume. Les destriers tournaient l’un derrière l’autre, se heurtaient, se mordaient, et les deux lames sifflaient en tournoyant. Coups de taille, parades, coups de pointe se succédaient si rapidement que l’œil ne pouvait les suivre ; enfin, cuisse contre cuisse, ils s’enlacèrent et roulèrent à bas de leurs selles. Plus lourd, l’Espagnol se jeta sur son ennemi, l’aplatit sous lui et leva son épée pour le mettre à mort sous les cris de triomphe de ses compatriotes. Mais le coup fatal ne s’abattit point : le bras tendu s’amollit, et l’Espagnol roula pesamment sur le côté ; le sang s’échappait de son aisselle et par la fente de sa visière. D’un bond Sir Nigel se remit debout : dans sa main gauche il tenait un poignard rouge de sang ; il regarda son adversaire à terre, mais le coup qu’il avait si soudainement porté à un endroit vital avait entraîné une mort immédiate. L’Anglais sauta sur son cheval et remonta lentement la colline ; alors un hurlement de rage s’échappa d’un millier de poitrines, et la sonnerie de vingt bugles annonça l’assaut espagnol.
Mais les Anglais en avaient vu d’autres : ils étaient prêts. Ils avaient posé solidement le pied et relevé leurs manches pour ne pas être gênés dans le jeu de leurs muscles ; ils tenaient leur long arc jaune dans la main gauche ; les carquois étaient à portée de leurs doigts agiles ; ils attendaient l’assaut dans la formation en herse sur quatre rangs qui donnait plus de force à leur ligne et qui permettait à chaque archer de tirer sans se soucier de ses camarades devant lui. Aylward et Johnston avaient lancé en l’air de petits brins d’herbe pour calculer la force du vent ; un murmure rude parcourut les rangs ; les chefs de section multiplièrent les conseils et les remontrances.
– Ne tirez pas avant que l’ennemi soit à moins de trois cents pas ! cria Johnston. Nous aurons peut-être besoin de toutes nos flèches avant d’en avoir fini avec eux.
– Tirez plutôt trop long que trop court ! ajouta Aylward. Mieux vaut atteindre l’arrière-garde que planter une plume dans le sol.
– Décochez vite et sec quand ils arriveront, reprit Johnston. L’œil sur la corde, la corde à la flèche, la flèche dans la cible. Par Notre-Dame, leurs bannières avancent ! Il nous faut tenir bon maintenant si nous voulons revoir les eaux de Southampton !
Alleyne, debout avec son épée nue au milieu des archers, vit osciller lentement et se soulever les escadrons éblouissants. Puis les rangs de tête s’ébranlèrent d’abord au pas, puis au trot, puis au petit galop, puis au galop ; en quelques instants toute l’armée s’était élancée à l’assaut, rang après rang. L’air retentissait du tonnerre de ses cris. Le sol tremblait du martèlement de ses sabots. Dans la vallée s’engouffra un torrent d’acier surmonté de panaches qui frémissaient, de lances obliques, de flammes qui voletaient. Les Espagnols déferlèrent sur le terrain plat, puis attaquèrent la pente ; une grêle de flèches anglaises les accueillit ; ce fut une hécatombe ; des rangs entiers redescendirent dans une confusion totale : des chevaux tombaient, ruaient ; des hommes s’écroulaient, se relevaient, titubaient, avançaient, reculaient ; de nouveaux rangs de cavaliers comblaient les trous creusés par les flèches et poussaient leurs chevaux sur la côte de la mort. Alleyne entendait autour de lui les ordres brefs des maîtres-archers, la vibration des cordes, le sifflement des flèches. Juste au pied de la colline s’édifia un long mur de chevaux qui se débattaient et de cavaliers rigides ; chaque fois qu’un escadron frais se lançait à l’attaque ce mur augmentait en hauteur et en profondeur. Un jeune chevalier qui montait un genet gris sauta l’obstacle des cadavres de ses camarades et gravit la pente au galop en criant : « Saint Jacques ! Saint Jacques ! » Il s’effondra à moins d’une longueur de lance de la ligne anglaise : des plumes de flèches sortaient par tous les défauts et les jointures de sa cuirasse. Ainsi, pendant cinq longues minutes, les braves cavaliers d’Espagne et de France se relayèrent à l’assaut de la colline jusqu’à ce que la note lugubre d’un bugle les rappelât en arrière ; alors ils firent demi-tour, lentement, pour se placer hors de portée des flèches, en abandonnant les plus braves et les meilleurs d’entre eux sur ce tas ensanglanté.
Mais les vainqueurs ne jouirent pas d’un long repos. Pendant que les chevaliers avaient chargé de front, les frondeurs avaient rampé sur chaque flanc et s’étaient établis sur les montagnes environnantes à l’abri des rochers. Une tempête de pierres se déchaîna soudainement sur les défenseurs qui, rangés en ligne sur le plateau à découvert, offraient une cible facile à leurs ennemis camouflés. Johnston, le vieil archer, fut atteint à la tempe ; il tomba mort sans un gémissement. Dans la même minute quinze archers et six hommes d’armes furent abattus. Les autres se couchèrent pour éviter cette grêle mortelle. Aux deux extrémités du plateau des archers ripostèrent en visant surtout les frondeurs et les arbalétriers qui avaient escaladé les montagnes, et ils riaient aux éclats lorsqu’un de leurs adversaires dégringolait de son perchoir.
– Je pense, Nigel, dit Sir Oliver, que nous nous acquitterions mieux de notre tâche si nous prenions notre repas de none, car le soleil est haut dans le ciel.
– Par saint Paul ! s’exclama Sir Nigel en retirant la mouche qu’il avait sur l’œil depuis son débarquement à Bordeaux. Je pense que je suis maintenant quitte de mon vœu, car ce chevalier d’Espagne était un combattant contre qui beaucoup d’honneur pouvait être gagné. C’était en vérité un digne gentilhomme, courageux, hardi et je suis désolé qu’il soit mort d’un pareil coup. Quant à ce que vous me dites pour le déjeuner, Oliver, mieux vaut n’y point penser, car ici nous n’avons strictement rien !
– Nigel ! cria Sir Simon Burley en accourant, le visage consterné. Aylward me dit qu’il ne reste pas plus de deux cents flèches. Regardez ! Ils descendent de cheval. Ils vont nous donner l’assaut. Ne pourrions-nous pas encore maintenant opérer notre retraite ?
– Mon âme fera retraite hors de mon corps, d’abord ! cria le petit chevalier. Ici je suis, ici je reste, tant que Dieu me donnera la force de lever une épée !
– Moi aussi ! cria Sir Oliver qui jeta en l’air sa masse d’armes et la rattrapa par le manche.
– À vos armes, les hommes ! rugit Sir Nigel. Tirez tant que vous le pourrez ! Ensuite à l’épée ! Et nous vivrons ou nous mourrons ensemble !
CHAPITRE XXXVII
Comment la Compagnie Blanche reçut son licenciement
Alors s’éleva de la montagne, dans la vallée cantabrique, un bruit qui n’avait jamais été entendu dans cette région, et qui ne le fut jamais depuis lors. Grave, ample, puissant, il tonna en bas du ravin. C’était le féroce cri de guerre d’une race de guerriers, le suprême salut aux adversaires pour ce jeu vieux comme le monde et qui a la mort comme enjeu. Trois fois il retentit ; trois fois les rochers en renvoyèrent les échos. Alors, résolument, la Compagnie se mit debout sous la grêle de pierres pour contempler les milliers d’hommes qui s’élançaient. Plus de chevaux, plus de lances : à pied, avec l’épée et la hache d’armes, le large bouclier en sautoir, la chevalerie d’Espagne se rua à l’attaque.
Le combat commença : si impitoyable, si long, si bien équilibré par la valeur et le courage des participants qu’aujourd’hui encore les montagnards en parlent entre eux, et que les pères désignent à leurs enfants cette butte funeste sous le nom de « Altura de los Inglesos ».
Les Anglais furent bientôt à court de flèches ; les frondeurs espagnols durent cesser de lancer leurs pierres, tant se confondaient amis et adversaires. D’un bout à l’autre du plateau s’étendait le mince cordon d’Anglais contre qui se pressaient les vagues des Espagnols et des Bretons. Le cliquetis des lames, le bruit mat des coups pesants, le halètement des combattants essoufflés, tout cela se mélangeait dans une même note sauvage et interminable. Des paysans ahuris regardaient du haut des montagnes ce tourbillon humain en dessous d’eux. La bannière aux léopards avançait, reculait ; tantôt elle était ramenée au haut de la pente sous la violence de l’assaut ; tantôt elle redescendait quand Sir Nigel, Burley et Black Simon à la tête des hommes d’armes se jetaient follement au cœur de la mêlée. Alleyne, à la droite de son maître, était balayé par les remous de cette lutte désespérée : il échangeait des bottes furieuses contre un gentilhomme espagnol, pour se trouver, l’instant d’après à plusieurs mètres de là en face d’un nouvel adversaire. Sur la droite Sir Oliver, Aylward, Hordle John et les archers de la Compagnie se heurtaient aux chevaliers monastiques de Santiago conduits par leur prieur, un homme grand et ascétique qui portait une robe de moine sur sa cotte de mailles. En trois coups gigantesques il tua trois archers, mais Sir Oliver glissa ses bras autour de sa taille, et tous deux, vacillant et luttant, basculèrent enlacés par-dessus la crête du plateau. Vainement les chevaliers de Santiago s’acharnèrent-ils contre la ligne qui leur barrait le passage ; l’épée d’Aylward et la grande hache de John luisaient au premier rang de la bataille, et de gros morceaux de roc, précipités par les archers, vinrent s’écraser sur eux. Ils redescendirent lentement ; les archers les suivirent et en massacrèrent un bon nombre. Au même instant les Gallois sur la gauche, conduits par le comte d’Angus, avaient émergé des rochers derrière lesquels ils s’étaient abrités ; ils avaient chargé, et la fureur de leur élan avait obligé les Espagnols qui se trouvaient devant eux à se replier eux aussi en bas de la pente. C’était seulement au centre que les défenseurs paraissaient en mauvaise posture. Black Simon était à terre, mourant comme il voulait mourir, tel un vieux loup gris dans son repaire avec un cercle de victimes autour de lui. Deux fois Sir Nigel avait été renversé ; deux fois Alleyne s’était battu au-dessus de son corps pour lui permettre de se relever. Burley gisait inanimé, étourdi par un coup de masse ; la moitié de ses hommes d’armes étaient tombés auprès de lui. Sir Nigel avait son écu brisé, son cimier déchiré, son armure bosselée et tailladée, la visière de son casque arrachée ; cependant il bondissait encore, léger et la main toujours prête ; à la fois il attaquait deux Espagnols et un Breton. Alleyne à son côté contenait avec une poignée d’hommes le flot dévastateur qui montait sans cesse. Tout de même les choses auraient pris mauvaise tournure si les archers des deux ailes n’étaient venus à la rescousse : ils se refermèrent comme les pinces d’une tenaille sur les flancs des attaquants qui reculèrent enfin pied à pied, et furent repoussés jusqu’au bas de la pente, sur la plaine où déjà leurs camarades se reformaient pour un nouvel assaut.
Mais celui qui venait d’être endigué avait coûté cher aux défenseurs. Sur les trois cent soixante-dix occupants du plateau, cent soixante-douze restaient debout ; encore beaucoup étaient-ils grièvement blessés ou affaiblis par le sang qu’ils avaient perdu. Sir Oliver Buttesthorn, Sir Richard Causton, Sir Simon Burley, Black Simon, Johnston, cent cinquante archers et quarante-sept hommes d’armes étaient morts. Et la grêle de pierres recommençait de s’acharner sur les survivants dont le nombre risquait ainsi d’être encore réduit.
Sir Nigel regarda sa troupe décimée ; son visage s’enflamma d’orgueil.
– Par saint Paul, s’écria-t-il, j’ai participé dans ma vie à beaucoup de combats, mais j’aurais regretté d’avoir manqué celui-ci ! Alleyne, serais-tu blessé ?
– Ce n’est rien, répondit l’écuyer en essuyant son front entamé d’un coup d’épée.
– Ces gentilshommes d’Espagne m’ont l’air fort dignes et courtois. Je vois qu’ils se préparent à poursuivre ce débat avec nous. Archers, formez-vous sur deux rangs au lieu de quatre ! Par ma foi, nous avons perdu beaucoup d’hommes courageux ! Aylward, tu es un soldat fidèle et sûr, bien que ton épaule n’ait jamais reçu l’accolade et que tu n’aies pas d’éperons dorés aux talons. Prends le commandement de l’aile droite. Je m’occuperai du centre. Et vous, comte d’Angus, prenez l’aile gauche.
– Hurrah pour Sir Samkin Aylward ! cria une grosse voix parmi les archers.
Une tempête de rire salua le nouveau chef.
– Par ma garde, cria le vieil archer, jamais je n’aurais pensé commander une aile sur un champ de bataille ! Serrez les rangs, camarades, car, par les os de mes dix doigts, il nous faut jouer à l’homme aujourd’hui !
– Viens ici, Alleyne ! ordonna Sir Nigel en se dirigeant vers la crête qui constituait le dos de leur retranchement. Et toi, Norbury, viens aussi ! ajouta-t-il en s’adressant à l’écuyer de Sir Oliver.
Les deux écuyers accoururent. Tous les trois contemplèrent le ravin rocheux qui s’étendait à cinquante mètres au-dessous d’eux.
– Il faut que le Prince apprenne le déroulement des opérations, dit le chevalier. Nous résisterons à une nouvelle attaque, mais ils sont en force et nous restons peu nombreux ; bientôt nous ne pourrons même plus former une ligne continue sur toute la longueur de ce plateau. Mais si du secours devait arriver, nous tiendrions en l’attendant. Voyez-vous les chevaux dans les rochers au-dessous de nous ?
– Oui, noble seigneur.
– Voyez-vous le chemin qui serpente à flanc de montagne à l’autre bout de la vallée ?
– Oui.
– Si vous étiez à cheval, et si vous suiviez ce chemin, vous pourriez atteindre l’autre vallée derrière. Et de là, foncer chez le Prince, que vous informeriez.
– Mais, noble seigneur, comment arriver jusqu’aux chevaux ? demanda Norbury.
– Vous ne pouvez pas espérer descendre par la pente et faire le tour : ils seraient sur vous avant que vous soyez arrivés jusqu’aux chevaux. Vous croyez-vous capables de descendre par cette paroi ?
– Oui, si vous nous donnez une corde.
– Il y en a une ici. Elle n’a que trente mètres ; pour le reste vous vous fierez à Dieu et à vos doigts. Voudras-tu essayer, Alleyne ?
– De tout mon cœur, cher seigneur ! Mais comment puis-je vous laisser dans un tel embarras ?
– Non. C’est pour me rendre service que tu me quitteras. Et toi, Norbury ?
L’écuyer taciturne ne répondit rien ; mais il s’empara de la corde, l’examina et en fixa solidement un bout autour d’un rocher en surplomb. Puis il retira sa cuirasse, ses cuissards et ses jambières. Alleyne l’imita.
– Prévenez Chandos, ou Calverley, ou Knolles, si le Prince n’est pas là ! cria Sir Nigel. À présent, que Dieu vous protège, car vous êtes deux braves, deux dignes hommes !
C’était réellement une tâche qui avait de quoi faire reculer les plus courageux. La corde mince qui dansait le long de la paroi brune semblait, vue d’en haut, n’atteindre que la moitié de la descente. Au-dessous s’étirait le roc à pic, humide, luisant, avec ici et là une touffe d’herbe, mais sans saillie apparente pour poser un pied. Tout en bas un lit de gros rochers pointus semblait guetter les audacieux. Norbury tira trois fois de toute sa force sur la corde, puis enjamba le parapet et se suspendit de l’autre côté ; cent visages anxieux suivirent sa descente le long de la paroi. À deux reprises, quand il fut arrivé au bout de la corde, son pied chercha un point d’appui ; les deux fois il manqua l’endroit qu’il visait. Il était en train de se balancer pour une troisième tentative quand une pierre lancée par une fronde bourdonna comme une guêpe entre les rochers et l’atteignit juste sur la tempe. Ses mains s’ouvrirent ; ses pieds glissèrent ; une seconde plus tard il s’était écrasé sur les rocs pointus d’en bas.
– Si je n’ai pas plus de chance, dit Alleyne en prenant Sir Nigel à part, je vous prie, mon cher seigneur, de bien vouloir transmettre mon humble souvenir à la damoiselle Maude, et de lui dire que j’ai toujours été son fidèle serviteur et son très indigne soupirant.
Le vieux chevalier ne prononça aucune parole, mais il posa une main sur l’épaule de son écuyer et l’embrassa ; il avait les yeux pleins de larmes. Alleyne bondit vers la corde, sauta, glissa rapidement tout au long et en deux ou trois secondes se trouva au bout. D’en haut, il avait eu l’impression que la corde et la paroi se touchaient presque ; mais quand il se balança au bout des trente mètres de corde, il découvrit qu’il pouvait à peine atteindre la face de la paroi avec son pied, que cette face était aussi lisse que du verre, et qu’il n’y avait pas un endroit où une souris aurait pu se poser. À un mètre au-dessous de ses pieds, toutefois, il aperçut une longue crevasse verticale et légèrement oblique : il lui fallait l’atteindre s’il voulait non seulement sauver sa vie mais encore sauver celle des cent soixante hommes qui guettaient sa progression. Pourtant ç’aurait été de la folie de sauter en visant cette fente étroite, en ne pouvant se raccrocher à rien d’autre qu’à du roc lisse et humide. Il se balança un moment en réfléchissant ; mais une volée de pierres expédiée par les frondeurs siffla à ses oreilles, et l’une d’elle effrita une pointe rocheuse contre son épaule. Alors il remonta d’un mètre, prit le bout de la corde dans sa main, défit sa ceinture, se maintint en équilibre en s’arc-boutant du coude et du genou, et attacha sa ceinture au bout de la corde. Une autre pierre le frappa dans le côté ; il entendit un bruit comme celui d’un bâton qui se casse, et il ressentit un douloureux coup de poignard dans la poitrine. Mais ce n’était pas le moment de souffrir et de penser à sa souffrance. Seuls comptaient son maître et ses cent soixante camarades : il avait à les arracher aux griffes de la mort. Il descendit. Ses mains se traînèrent le long de la crevasse ; tantôt il se suspendait à bout de bras, tantôt il trouvait une touffe d’herbe ou une pierre sur laquelle il reposait ses pieds. Ces vingt mètres lui semblèrent interminables. Il n’osait pas regarder sous lui ; il ne pouvait que continuer à avancer en tâtonnant, face à la paroi, cramponné par ses doigts, les pieds grattant la pierre pour trouver un support. Jamais il ne devait oublier l’aspect de cette paroi, ses veines, ses fentes, ses moindres reliefs. Enfin son pied se posa sur une large plate-forme, et il risqua un coup d’œil en bas. Dieu merci, il avait atteint le plus élevé des rocs sur lesquels Norbury s’était rompu les os. Il sauta rapidement de roc en roc vers les chevaux ; au moment où il allongeait le bras pour ramasser les rênes de l’un d’eux, une pierre le frappa sur la tête ; il s’écroula inanimé.
C’était un mauvais coup pour Alleyne ; mais ce fut un coup bien pire pour celui qui l’avait porté. Le frondeur espagnol vit le jeune écuyer tomber raide ; reconnaissant à ses vêtements qu’il ne s’agissait pas d’un homme du commun, il se précipita pour le dépouiller, car il savait bien que les archers au-dessus de lui avaient épuisé leurs flèches. Il était arrivé à trois pas de sa victime quand John, du haut de la crête, s’empara d’un gros roc et le bascula. Le roc tomba juste sur l’épaule du frondeur qui s’effondra en hurlant. Ses cris sortirent Alleyne de sa torpeur. Il se releva en titubant et regarda autour de lui, comme s’il se réveillait d’un cauchemar. Les chevaux paissaient non loin. Immédiatement tout lui revint en mémoire : sa mission, ses camarades, l’urgence du devoir à accomplir. Il était affaibli, étourdi, blessé, mais il n’avait pas le droit de mourir ; il lui fallait même se hâter, car sa vie aujourd’hui valait beaucoup d’existences. Il sauta en selle et descendit la vallée au galop.
Des pierres le pourchassèrent ; sous les sabots de sa monture des étincelles jaillissaient du sol rocailleux. Des vertiges l’assaillirent ; son front saignait ; il avait dans la bouche un violent goût de sang. La douleur lui transperçait le flanc comme une flèche rougie au feu. Il sentait que ses yeux s’embuaient, que l’évanouissement le guettait et que ses doigts se relâchaient sur les rênes. Alors, au prix d’un suprême effort, il fit appel à toutes ses forces pour une minute. Il se pencha, desserra les étrivières, attacha ses genoux aux quartiers de la selle, enroula la bride autour de ses mains, plaça la tête du cheval dans la direction du chemin de montagne, donna de sauvages coups d’éperons et s’affala en avant, la tête enfouie dans la crinière noire.
Il ne garda que peu de souvenirs de cette chevauchée fantastique. À demi évanoui, il avait une seule idée, toujours la même, qui battait dans sa tête : arriver au camp du Prince. Comme dans un rêve il entrevit des ravins profonds, des pierres énormes, des précipices sombres comme la mort, des parois à pic, des cabanes devant lesquelles se tenaient des paysans stupéfaits, des ruisseaux écumants, des hêtres serrés les uns contre les autres. À travers ce décor cauchemardesque il guidait son cheval, le jetait en avant plus vite, toujours plus vite. À un moment donné, alors qu’il galopait déjà depuis longtemps, il entendit trois cris au loin, et apprit ainsi que ses camarades subissaient un nouvel assaut. Alors il perdit conscience jusqu’à ce qu’il vît penchés au-dessus de lui de bons yeux bleus et qu’il entendît la musique bénie de la langue de son pays.
Il ne s’agissait que d’un détachement cherchant du ravitaillement : mais il était fort de cent archers et d’autant d’hommes d’armes ; et surtout il était commandé par Sir Hugh Calverley, qui n’était pas homme à flâner quand il y avait de bons coups à échanger à moins de trois lieues. Il expédia un messager au camp et partit aussitôt avec ses deux cents soldats au secours de Sir Nigel. Alleyne, attaché sur sa selle, dégouttant de sang, s’évanouissant, reprenant ses sens, s’évanouissant à nouveau, refit en sens contraire le chemin qu’il venait de parcourir. Dans un bruit de tonnerre ils galopèrent, galopèrent : enfin, parvenus en haut d’une crête, ils plongèrent leurs regards dans la vallée fatale. Hélas ! Trois fois hélas !…
Là, sous leurs yeux, s’étalait la petite colline baignée de sang ; au sommet flottait la bannière jaune et blanche, avec les lions et les tours de la maison royale de Castille. Gravissant la côte en rangs serrés des soldats exultants criaient, brandissaient des armes et des pennons. Le plateau qui la couronnait était encombré d’une foule dense : il ne semblait pas qu’il y eût encore un seul Anglais pour tenir tête aux chevaliers d’Espagne. À y regarder de plus près, pourtant des remous dans un angle donnèrent l’impression que toute résistance n’avait pas absolument cessé. Un cri de rage et de désespoir gronda chez les sauveteurs déçus ; éperonnant à nouveau leurs chevaux, ils s’élancèrent dans le chemin qui descendait vers la vallée.
Arrivés trop tard pour secourir leurs compatriotes, ils furent aussi impuissants à les venger. Bien avant qu’ils eussent atteint le terrain plat, les Espagnols les avaient aperçus ; comme ils ignoraient leur nombre, ils s’étaient retirés du plateau conquis après avoir libéré leurs quelques compatriotes prisonniers ; ils quittèrent la vallée en colonne, tambours et cymbales en tête. Leur arrière-garde disparaissait quand les premiers soldats de Sir Hugh Calverley poussèrent leurs chevaux écumants, haletants vers la côte qui avait été le théâtre de la bataille.
L’épouvantable vision ! Au bas de la pente, les hommes et les chevaux abattus par la première volée des flèches anglaises. Plus haut, les corps des morts et des mourants français, espagnols, aragonais, de plus en plus nombreux, serrés, empilés les uns sur les autres. Plus haut encore les Anglais, couchés sur la ligne qu’ils avaient tenue jusqu’à la fin. Plus haut toujours sur le plateau, pêle-mêle, des morts de toutes nationalités, étendus là où le dernier coup les avait frappés. Dans l’angle le plus éloigné, à l’ombre d’un gros rocher, sept archers étaient accroupis ; le gros John se trouvait au milieu d’eux ; tous étaient blessés, épuisés, hagards, mais invaincus ; ils agitèrent leurs armes rougies de sang, et leurs voix rauques saluèrent leurs camarades. Alleyne se dirigea vers John ; Sir Hugh Calverley le suivit.
– Par saint Georges ! s’écria Sir Hugh. Jamais je n’ai vu trace d’une bataille plus acharnée. Je suis bien heureux que nous ayons pu vous sauver.
– Vous avez sauvé mieux que nous ! répondit Hordle John en désignant la bannière qui était appuyée contre le rocher derrière lui.
Le vieux Compagnon franc regarda avec une admiration de connaisseur la puissante charpente et la figure hardie de l’archer.
– Vous vous êtes noblement conduits ! dit-il. Mais pourquoi, mon brave garçon, es-tu assis sur cet homme ?
– Par la Croix, je l’avais oublié !…
John se leva et tira de dessous lui l’illustre personnage qui s’appelait Don Diego Alvarez.
– Cet homme, noble seigneur, représente pour moi une maison neuve, dix vaches, un taureau, même si c’est un petit taureau, une meule, et je ne sais plus quoi d’autre. Alors j’ai jugé bon de m’asseoir sur lui, de peur qu’il ne lui prenne la fantaisie de me quitter.
– Dis-moi, John ! s’écria Alleyne faiblement. Où est mon cher seigneur, Sir Nigel Loring ?
– Mort, je le crains. Je les ai vus jeter son corps en travers d’un cheval et l’emmener avec eux, mais j’ai peur qu’ils ne l’aient pas emporté vivant.
– Malheur à moi ! Et où est Aylward ?
– Il a sauté sur un cheval sans cavalier et s’est élancé derrière Sir Nigel pour le sauver. Je l’ai vu entouré d’une masse d’ennemis : il est prisonnier ou mort.
– Que les bugles sonnent ! cria Sir Hugh, le front sombre. Il faut que nous retournions au camp. Mais avant trois jours j’espère que nous reverrons ces Espagnols. Je voudrais bien vous avoir tous dans ma compagnie.
– Nous appartenons à la Compagnie Blanche, noble seigneur ! répondit John.
– Non, la Compagnie Blanche s’est licenciée ici, répliqua solennellement Sir Hugh en promenant son regard sur les rangs pétrifiés par la mort. Occupez-vous de ce brave écuyer, car je crains qu’il ne voie plus jamais le soleil se lever.
CHAPITRE XXXVIII
Retour dans le Hampshire
Quatre mois après ce terrible combat dans un défilé d’Espagne, par un clair matin de juillet, le ciel bleu planait au-dessus d’une grande plaine verte doucement ondulée, divisée par des haies d’arbustes ; des moutons y paissaient tranquillement. Le soleil était encore bas. Des vaches rouges qui ruminaient à l’ombre longue des ormes regardèrent de leurs yeux vides deux cavaliers qui galopaient sur la longue route blanche de Winchester.
L’un des cavaliers était jeune, gracieux et svelte, blond, habillé d’un simple doublet et de chausses de drap bleu de Bruxelles qui faisaient ressortir sa silhouette élancée et robuste. Il avait ramené en avant sa toque plate de velours pour protéger ses yeux de l’éclat du soleil. Il serrait les dents et fronçait les sourcils : visiblement il avait beaucoup de soucis en tête. Tout jeune qu’il parut, et tout pacifique que fut son costume, il n’en avait pas moins de jolis éperons d’or qui attestaient son titre de chevalier. Un sillon allongé sur son front et une cicatrice à la tempe paraient de virilité sa physionomie aux traits raffinés et délicats. Son compagnon était un colosse roux monté sur un grand cheval noir ; un gros sac de toile posé en travers de sa selle cliquetait et résonnait agréablement à chaque foulée de sa monture ; un large sourire éclairait son visage hâlé ; il regardait les champs et les prés avec des yeux pleins da malice et de ravissement. John avait bien des raisons de se réjouir : n’était-il pas de retour dans son Hampshire natal ? N’avait-il pas bringuebalant contre ses jambes les cinq mille couronnes de la rançon de Don Diego ? Et surtout n’était-il pas devenu l’écuyer de Sir Alleyne Edricson, le jeune seigneur de Minstead, que l’épée du Prince Noir en personne venait de sacrer chevalier et que toute l’armée considérait comme l’un des soldats les plus prometteurs de l’Angleterre ?
Car le dernier exploit de la Compagnie Blanche s’était répandu à travers la Chrétienté, partout où l’on aimait les hauts faits d’armes, et ses rares survivants avaient été comblés d’honneurs. Pendant deux mois Alleyne avait oscillé entre la vie et la mort, avec une côte brisée et une tête sévèrement endommagée ; mais sa jeunesse et sa saine constitution l’avaient sauvé ; il émergea d’un long délire pour apprendre que la guerre était terminée, que les Espagnols et leurs Alliés avaient été écrasés à Navaretta, que le Prince lui-même avait entendu le récit de sa chevauchée héroïque et qu’il s’était rendu à son chevet pour lui toucher l’épaule de son épée en déclarant qu’un homme aussi brave et aussi fidèle mourrait chevalier s’il ne survivait pas. Dès qu’Alleyne fut rétabli, il se mit en quête de son maître ; mais en vain ; il ne put même pas savoir s’il était mort ou vivant. Il était alors reparti pour l’Angleterre dans l’espoir de prélever sur ses biens de quoi reprendre ses recherches, et, à peine débarqué à Londres il s’était remis en selle, rongé d’inquiétudes, car il n’avait reçu aucune nouvelle du Hampshire depuis qu’il avait appris la mort de son frère.
– Par la Croix ! s’écria John qui regardait toujours autour de lui avec extase. Où avons-nous vu depuis notre départ d’aussi belles vaches, des moutons aussi pelucheux, de l’herbe aussi verte, et un homme aussi ivre que ce coquin que je vois couché là-bas dans le trou de la haie ?
– Ah, John ! soupira Alleyne. Tu es heureux, toi, mais je n’aurais jamais cru que mon retour serait empreint d’une telle tristesse. Mon cœur est lourd à cause de mon cher seigneur et d’Aylward, et je ne sais pas comment communiquer ces nouvelles à Lady Mary et à la damoiselle Maude si elles les ignorent encore !
John poussa un gémissement qui fit faire un écart aux chevaux.
– C’est vraiment une sale affaire ! fit-il. Mais ne te mets pas en peine, Alleyne, car je ne donnerai à ma mère que la moitié de ces couronnes, et l’autre moitié complètera la somme que tu réuniras ; nous pourrons donc acheter cette grosse cogghe jaune à bord de laquelle nous avons navigué jusqu’à Bordeaux ; nous retournerons là-bas et nous irons chercher Sir Nigel.
Alleyne sourit, mais secoua la tête.
– S’il était en vie, nous aurions eu de ses nouvelles. Mais quelle est cette ville devant nous ?
– Romsey ! cria John. Regarde la tour de la vieille église grise, et les longs murs du couvent des nonnes. Mais voici un très saint homme : je vais lui donner une couronne pour ses prières.
Trois grosses pierres sur un bas-côté de la route constituaient une sorte de cabane ; devant elle, en plein soleil, un ermite était assis ; il avait le visage couleur d’argile, les yeux ternes, de longues mains décharnées ; avec ses jambes croisées et sa tête baissée sur la poitrine, il ressemblait à un homme que toute vie aurait quitté ; seuls ses doigts maigres et jaunes remuaient pour glisser lentement sur les grains de son chapelet. Sa cellule étroite était humide, inconfortable, sordide. Derrière elle, plus loin parmi les arbres, une chaumière de laboureur avait sa porte grande ouverte ; l’homme, rougeaud et roux, s’appuyait sur la bêche avec laquelle il travaillait dans son petit jardin ; soudain éclata la modulation d’un rire de femme heureuse ; deux solides bambins aux jambes nues s’élancèrent par la porte et se mirent à courir ; la mère sortit à son tour et posa une main sur le bras de l’homme en regardant les gambades de leurs enfants. L’ermite fronça les sourcils quand il entendit ce bruit qui interrompait ses prières, mais son mécontentement disparut quand il vit la large pièce d’argent que John lui tendait.
– Voilà la double image de notre passé et de notre avenir ! s’écria Alleyne quand ils reprirent leur route. Maintenant, qu’est-ce qui est préférable ? Cultiver la terre du bon Dieu, avoir des visages heureux autour de soi, aimer et être aimé ? Ou bien demeurer assis en ne cessant de gémir sur son âme comme une mère sur son bébé malade ?…
– Je n’en sais rien, répondit John. Car quand je réfléchis sur ces choses, un gros nuage m’obscurcit la cervelle. Mais je crois que ma couronne a été bien dépensée, car l’ermite avait l’air d’un saint. Quant à l’autre, je n’ai rien vu de saint qui soit répandu sur sa personne, et il me coûterait moins cher de prier pour moi-même que de donner une couronne à quelqu’un qui passe ses journées à planter des laitues.
Avant qu’Alleyne eût eu le temps de répondre, un attelage déboucha du virage de la route ; trois chevaux de front tiraient une voiture de dame ; un postillon montait en croupe celui qui se tenait à l’extérieur. La voiture était richement décorée : le bois était peint et doré ; les roues et leurs rayons affectaient des formes recherchées ; un dais de tapisserie rouge et blanche abritait une dame forte et d’un certain âge, vêtue de rose, appuyée sur de nombreux coussins, qui épilait ses sourcils avec une petite pince d’argent. Alleyne rangea son cheval sur le côté de la route mais une roue se détacha et la voiture culbuta, ensevelissant la dame sous la tapisserie et des débris de bois peint et sculpté. Alleyne et John se précipitèrent et retirèrent la voyageuse de sa position inconfortable : elle n’était pas blessée, mais elle avait eu peur.
– Malheur à moi ! cria-t-elle. Et que le diable emporte Michael Easover de Romsey ! Je lui avais dit que la clavette ne tenait pas ; il m’a affirmé le contraire, comme un écervelé qu’il est.
– J’espère, madame, que vous ne vous êtes pas fait de mal, dit Alleyne en la conduisant sur le talus où John avait déjà posé un coussin.
– Non, je n’ai eu aucun mal, mais j’ai perdu ma pince d’argent. Mais pourquoi Dieu a-t-il donné le souffle de la vie à un fou comme ce Michael Easover de Romsey ! Je vous suis bien obligée, bons seigneurs ! Vous êtes des soldats ; cela se reconnaît aisément. Moi-même je suis fille de soldat, ajouta-t-elle en lançant un coup d’œil languissant vers John. Et j’aime beaucoup les hommes braves.
– Nous rentrons d’Espagne, dit Alleyne.
– D’Espagne ? Ah, c’est un affreux malheur que tant d’hommes aient perdu la vie que Dieu leur avait donnée ! À vrai dire, il est triste que des hommes tombent, mais plus triste encore est le destin de celles qui restent. Je viens de dire adieu à quelqu’un qui a tout perdu dans cette guerre cruelle.
– Comment cela, madame ?
– C’est une jeune damoiselle. Elle va entrer en religion. Hélas ! Il n’y a qu’un an encore, elle était la plus belle jeune fille du pays, et maintenant je n’ai pu supporter d’attendre au couvent de Romsey pour la voir prendre le voile. Elle était tellement mieux faite pour être femme que pour être nonne ! Avez-vous entendu parler, bons seigneurs, de la Compagnie Blanche en Espagne ?
– Bien sûr ! s’écrièrent les deux camarades.
– Son père en était le chef, et l’amant de son cœur était l’écuyer de son père. On a appris ici que toute la Compagnie avait été exterminée jusqu’au dernier des archers ; alors, pauvre agnelle, elle…
– Madame ! s’exclama Alleyne hors de lui. Est-ce de la damoiselle Maude Loring que vous parlez ?
– Mais oui !
– Maude ! Dans un couvent ! La mort de son père l’avait-elle donc tant bouleversée ?
– Son père ? répéta la dame en souriant. Non. Maude a toujours été une bonne fille, mais je pense que c’est le sort de certain jeune écuyer aux cheveux d’or qui l’a décidée à quitter le monde.
– Et moi qui reste ici à bavarder ! s’écria Alleyne. Viens, John, viens !
Il se précipita vers son cheval, sauta en selle et partit au galop dans un nuage de poussière en direction de Romsey.
On s’était beaucoup réjoui au couvent de Romsey quand la damoiselle Maude Loring avait sollicité son admission dans cet ordre religieux : n’était-elle pas fille unique et seule héritière du vieux chevalier, avec des fermes et des biens qu’elle apporterait ainsi au grand couvent ? L’Abbesse ascétique lui avait parlé avec autant d’ardeur que de fermeté : dans de multiples entretiens elle lui avait conseillé de se détourner à jamais du monde et d’abriter son cœur brisé dans le grand et paisible refuge de l’Église. Mais à présent que l’Abbesse et la Mère supérieure avaient convaincu la postulante, il leur avait paru décent qu’une certaine pompe entourât cette heureuse cérémonie. Voilà pourquoi les bons bourgeois de Romsey étaient tous dans les rues, pourquoi des étendards aux couleurs vives et des fleurs épanouies jalonnaient le chemin du couvent à l’église, pourquoi une longue procession se dirigeait vers le vieux porche : il s’agissait de conduire une fiancée à ses noces spirituelles. Agatha en sœur laie portait la croix d’or, trois sœurs balançaient les encensoirs, vingt-deux religieuses en robe blanche jetaient des fleurs à droite et à gauche en chantant un cantique. Puis, escortée de quatre compagnes, venait la novice dont la tête baissée était ceinte d’une guirlande blanche. L’Abbesse et son conseil de vieilles nonnes la suivaient de près : elles calculaient déjà si leur propre bailli pourrait s’occuper des fermes de Twynham, ou s’il ne lui faudrait pas un adjoint pour tirer le maximum des nouveaux biens que cette jeune fille allait leur apporter en dot.
Mais que valent de tels plans quand l’amour, la jeunesse, la nature et surtout la chance s’y opposent ? Qui donc est ce garçon couvert de poussière qui galope follement parmi la foule étonnée ? Pourquoi saute-t-il à bas de son cheval ? Pourquoi regarde-t-il autour de lui avec des yeux égarés ? Regardez-le : il a bondi ; il bouscule les encensoirs ; il écarte la sœur Agatha, il fend le troupeau des vingt-deux religieuses qui chantent d’une voix éthérée, il ne s’arrête que devant la novice. Alors il ouvre ses bras, ses yeux gris s’illuminent, son visage resplendit d’amour. Elle a le pied sur le seuil de l’église ; il lui barre le passage. Et elle, qui ne pense plus aux conseils avisés et aux saints avis de l’Abbesse, pousse un cri déchirant avant de tomber dans les deux bras qui se referment sur elle ; elle pose sa joue humide de larmes sur la poitrine du jeune homme… Ah, le triste spectacle pour l’ascétique Abbesse ! Et quel triste exemple aussi pour les vingt-deux damoiselles immaculées à qui l’on avait appris que les voies de la nature étaient toujours le chemin du péché ! Mais Maude et Alleyne ne s’en soucient guère. Du sombre portail ouvert devant eux s’échappe un air humide et froid. Dehors le soleil brille, les oiseaux pépient dans le lierre et sur les hêtres. Leur choix est vite fait. La main dans la main ils tournent le dos à l’obscurité et avancent vers la lumière.
Le mariage fut célébré très paisiblement dans la vieille église du prieuré ; le père Christopher lut le service ; il n’y avait que peu d’assistants : Lady Loring, John, et une douzaine d’archers du château. La châtelaine de Twynham s’était voûtée, et elle dépérissait ; elle avait les traits durcis et elle était moins avenante qu’autrefois ; pourtant elle continuait d’espérer : son seigneur avait traversé tant de dangers qu’elle ne pouvait pas croire qu’il avait finalement succombé ! Elle avait exprimé le désir de partir pour l’Espagne à sa recherche, mais Alleyne l’avait convertie à l’idée de le laisser aller à sa place. Il y avait beaucoup à surveiller, puisque les terres de Minstead se trouvaient maintenant réunies à celles de Twynham, et Alleyne lui avait promis que si elle consentait à demeurer avec sa fille, il ne reviendrait pas dans le Hampshire avant d’avoir obtenu des nouvelles, bonnes ou mauvaise, de son seigneur et maître.
La cogghe jaune avait été louée ; Goodwin Hawtayne en était le maître-marinier ; un mois après les noces, Alleyne descendit à Bucklershard pour s’assurer qu’elle était arrivée de Southampton. En route il passa devant le village de Pitt’s Deep, et il aperçut au large un petit brick qui louvoyait comme s’il s’apprêtait à mouiller l’ancre. Quand il prit le chemin du retour, il repassa devant le même village ; le brick avait effectivement mouillé l’ancre, et plusieurs chalands l’entouraient pour porter sur le rivage sa cargaison.
Une grande auberge était située à une portée d’arc de Pitt’s Deep, un peu en retrait ; à l’une des fenêtres du haut une grosse branche de houx était pendue au bout d’un bâton. Alleyne remarqua de la route qu’un homme assis devant cette fenêtre semblait se démancher le cou pour l’examiner. Alleyne à son tour le regarda, mais une femme sortit en courant par la porte et fit mine de grimper à un arbre, tout en riant aux éclats et en se retournant vers l’auberge. Surpris, Alleyne descendit, attacha son cheval à un arbre et avança entre les troncs. Une deuxième femme sortit alors en courant et, comme la première, fit semblant de grimper à l’arbre. Sur ses talons apparut un homme robuste, bronzé, qui s’appuya au chambranle de la porte et qui riait de bon cœur en portant la main à son côté.
– Ah, mes belles ! s’écria-t-il. C’est ainsi que vous me traitez ? Ah, mes petites ! Je jure par les os de ces dix doigts que je ne ferais pas de mal à un cheveu de vos jolies têtes ! Mais je suis allé chez les païens noirs et, par ma garde, il m’est doux de regarder vos frimousses d’Anglaises. Venez boire une tournée de muscat, mes anges ! J’ai chaud au cœur d’être de nouveau parmi vous.
Alleyne avait été frappé de stupeur quand il avait vu cet homme ; mais dès qu’il l’entendit son cœur bondit d’un tel élan qu’il dut se mordre les lèvres pour ne pas crier. Une joie plus grande encore lui était cependant réservée, car la fenêtre du dessus s’ouvrit, et la voix du premier voyageur s’en échappa :
– Aylward, criait-elle, je viens d’apercevoir un très digne personnage descendant la route ; mais mes yeux n’ont pas très bien vu s’il portait une cotte d’armes. Je te prie d’aller le trouver et de lui dire qu’un très humble chevalier d’Angleterre est descendu ici, et que s’il désire un peu de distinction ou s’il a l’âme chargée d’un petit vœu, ou s’il veut exalter sa dame, je suis à sa disposition pour l’aider.
À cet ordre Aylward s’avança aussitôt vers la route ; les deux hommes tombèrent dans les bras l’un de l’autre ; ils riaient, ils criaient, ils s’embrassaient tant leur joie était vive. Le vieux Sir Nigel crut qu’une bagarre avait éclaté ; il accourut avec son épée nue ; alors il embrassa autant qu’il fut embrassé. Tous trois n’en finissaient plus de se congratuler et de se poser des questions.
Pendant leur voyage de retour à travers les bois, Alleyne apprit leur merveilleuse histoire : comment Sir Nigel avait repris ses sens, comment il avait été dépêché aussitôt avec son compagnon de captivité sur la côte ; comment ils avaient été conduits par mer vers le château de leur ravisseur ; · comment ils avaient été attaqués en route par des pirates barbaresques ; comment ils avaient troqué leur légère captivité pour un siège de galérien et des travaux forcés aux avirons des pirates ; comment, dans le port barbaresque, Sir Nigel avait pourfendu le capitaine maure et s’était emparé, toujours en compagnie d’Aylward, d’un petit caboteur qu’ils avaient ramené en Angleterre avec une cargaison de prix qui allait largement les dédommager de leurs épreuves. Alleyne écouta toutes ces aventures jusqu’à ce que le sombre donjon de Twynham se dressât au-dessus d’eux au crépuscule et que le soleil rouge se couchât dans les eaux de l’Avon. Inutile de décrire la joie qui régna ce soir-là au château, ni de dresser la liste des somptueuses offrandes qui furent prélevées sur la cargaison mauresque pour orner la chapelle du père Christopher.
Sir Nigel Loring vécut de nombreuses années, dans les honneurs et les bénédictions. Il ne partit plus pour les guerres, mais il participa à toutes les joutes qui se disputèrent dans le pays à trente lieues à la ronde ; la jeunesse du Hampshire n’était pas peu fière quand de ses lèvres tombait un compliment pour le dressage d’un cheval ou la manière de courir une lance. Tel il avait vécu, tel il mourut, le plus respecté et le plus heureux des hommes de son comté natal.
À Sir Alleyne Edricson et à sa resplendissante épouse l’avenir n’apporta aussi que du bonheur. Deux fois il alla se battre en France, et il en revint comblé de distinctions. Un haut poste lui fut attribué à la cour, et il passa de nombreuses années à Windsor sous Richard II et Henry IV ; il reçut la Jarretière et conquit la réputation d’un brave soldat, d’un gentilhomme loyal et fidèle, d’un mécène qui protégea les arts et les sciences qui affinent et ennoblissent la vie.
Quant à John, il épousa une jeune fille de la campagne et s’établit à Lyndhurst, où ses cinq mille couronnes firent de lui le plus riche des petits propriétaires de la région. Pendant longtemps il but sa bière chaque soir à « L’Émerillon bigarré », que tenait maintenant son ami Aylward, lequel avait en effet convolé en justes noces avec la bonne veuve à qui il avait confié son butin. Les hommes forts et les archers du pays prirent l’habitude de s’arrêter à l’auberge, soit pour faire un peu de lutte avec John, soit pour provoquer Aylward à l’arc ; un shilling d’argent était l’enjeu de ces concours ; la légende ne rapporte pas qu’Aylward ou John ait jamais perdu. Ainsi vécurent ces hommes, à leur manière simple et aimable, parfois un peu fruste, mais honnête, probe, loyale. Si nous avons extirpé leurs défauts, rendons grâces à Dieu. Et prions Dieu pour que nous conservions leurs vertus. Le ciel peut s’assombrir, des nuages se rassembler ; le jour reviendra peut-être où l’Angleterre aura besoin de tous ses fils éparpillés de par le monde. Pourraient-ils ne pas répondre présents à son appel ?
FIN