
André Gide
VOYAGE AU CONGO
Carnets de route
(1927)
Table des matières
CHAPITRE PREMIER – Les escales – Brazzaville
CHAPITRE II – La lente remontée du fleuve
CHAPITRE IV – La grande forêt entre Bangui et Nola
CHAPITRE VI – De Bosoum à Fort-Archambault
CHAPITRE VII – Fort-Archambault, Fort-Lamy
À propos de cette édition électronique

À la Mémoire de
JOSEPH CONRAD
Better be imprudent moveables than prudent fixtures.
KEATS.
CHAPITRE PREMIER – Les escales – Brazzaville
21 juillet. – Troisième jour de traversée.
Indicible langueur. Heures sans contenu ni contour.
Après deux mauvais jours, le ciel bleuit ; la mer se calme ; l’air tiédit. Un vol d’hirondelles suit le navire.
On ne bercera jamais assez les enfants, du temps de leur prime jeunesse. Et même je serais d’avis qu’on usât, pour les calmer, les endormir, d’appareils profondément bousculatoires. Pour moi, qui fus élevé selon des méthodes rationnelles, je ne connus jamais, de par ordre de ma mère, que des lits fixes ; grâce à quoi je suis aujourd’hui particulièrement sujet au mal de mer.
Pourtant je tiens bon ; je tâche d’apprivoiser le vertige, et constate que, ma foi, je tiens mieux que nombre de passagers. Le souvenir de mes six dernières traversées (Maroc, Corse, Tunisie) me rassure.
Compagnons de traversée : administrateurs et commerçants. Je crois bien que nous sommes les seuls à voyager « pour le plaisir ».
– Qu’est-ce que vous allez chercher là-bas ?
– J’attends d’être là-bas pour le savoir.
Je me suis précipité dans ce voyage comme Curtius dans le gouffre. Il ne me semble déjà plus que précisément je l’aie voulu (encore que depuis des mois ma volonté se soit tendue vers lui) ; mais plutôt qu’il s’est imposé à moi par une sorte de fatalité inéluctable – comme tous les événements importants de ma vie. Et j’en viens à presque oublier que ce n’est là qu’un « projet de jeunesse réalisé dans l’âge mûr » ; ce voyage au Congo, je n’avais pas vingt ans que déjà je me promettais de le faire ; il y a trente-six ans de cela.
Je reprends, avec délices, depuis la fable I, toutes les fables de La Fontaine. Je ne vois pas trop de quelle qualité l’on pourrait dire qu’il ne fasse preuve. Celui qui sait bien voir peut y trouver trace de tout ; mais il faut un œil averti, tant la touche, souvent, est légère. C’est un miracle de culture. Sage comme Montaigne ; sensible comme Mozart.
Hier, inondation de ma cabine, au petit matin, lors du lavage du pont. Un flot d’eau sale où nage piteusement le joli petit Gœthe letherbound, que m’avait donné le Comte Kessler (où je relis les Affinités).
25 juillet.
Ciel uniformément gris ; d’une douceur étrange. Cette lente et constante descente vers le sud doit nous amener à Dakar ce soir.
Hier des poissons volants. Aujourd’hui des troupeaux de dauphins. Le commandant les tire de la passerelle. L’un d’eux montre son ventre blanc d’où sort un flot de sang.
En vue de la côte africaine. Ce matin une hirondelle de mer contre la lisse. J’admire ses petites pattes palmées et son bec bizarre. Elle ne se débat pas lorsque je la prends. Je la garde quelques instants dans ma main ouverte ; puis elle prend son vol et se perd de l’autre côté du navire.
26 juillet.
Dakar la nuit. Rues droites désertes. Morne ville endormie. On ne peut imaginer rien de moins exotique, de plus laid. Un peu d’animation devant les hôtels. Terrasses des cafés violemment éclairées. Vulgarité des rires. Nous suivons une longue avenue, qui bientôt quitte la ville française. Joie de se trouver parmi des nègres. Dans une rue transversale, un petit cinéma en plein air, où nous entrons. Derrière l’écran, des enfants noirs sont couchés à terre, au pied d’un arbre gigantesque, un fromager sans doute. Nous nous asseyons au premier rang des secondes. Derrière moi un grand nègre lit à haute voix le texte de l’écran. Nous ressortons. Et longtemps nous errons encore ; si fatigués bientôt que nous ne songeons plus qu’à dormir. Mais à l’hôtel de la Métropole, où nous avons pris une chambre, le vacarme d’une fête de nuit, sous notre fenêtre, empêche longtemps le sommeil.
Dès six heures, nous regagnons l’Asie, pour prendre un appareil de photo. Une voiture nous conduit au marché. Chevaux squelettiques, aux flancs rabotés et sanglants, dont on a badigeonné les plaies au bleu de Prusse. Nous quittons ce triste équipage pour une auto, qui nous mène à six kilomètres de la ville, traversant des terrains vagues que hantent des hordes de charognards. Certains perchent sur le toit des maisons, semblables à d’énormes pigeons pelés.
Jardin d’Essai. Arbres inconnus. Buissons d’hibiscus en fleurs. On s’enfonce dans d’étroites allées pour prendre un avant-goût de la forêt tropicale. Quelques beaux papillons, semblables à de grands machaons, mais portant, à l’envers des ailes, une grosse macule nacrée. Chants d’oiseaux inconnus, que je cherche en vain dans l’épais feuillage. Un serpent noir très mince et assez long glisse et fuit.
Nous cherchons à atteindre un village indigène, dans les sables, au bord de la mer ; mais une infranchissable lagune nous en sépare.
27 juillet.
Jour de pluie incessante. Mer assez houleuse. Nombreux malades. De vieux coloniaux se plaignent : « Journée terrible ; vous n’aurez pas pire »… Somme toute, je supporte assez bien. Il fait chaud, orageux, humide ; mais il me semble que j’ai connu pire à Paris ; et je suis étonné de ne pas suer davantage.
Le 29, arrivée en face de Konakry. On devait débarquer dès sept heures ; mais depuis le lever du jour, un épais brouillard égare le navire. On a perdu le point. On tâtonne et la sonde plonge et replonge. Très peu de fond ; très peu d’espace entre les récifs de corail et les bancs de sable. La pluie tombait si fort que déjà nous renoncions à descendre, mais le commandant nous invite dans sa pétrolette.
Très long trajet du navire au wharf, mais qui donne au brouillard le temps de se dissiper ; la pluie s’arrête.
Le commissaire qui nous mène à terre nous avertit que nous ne disposons que d’une demi-heure, et qu’on ne nous attendra pas. Nous sautons dans un pousse, que tire un jeune noir « mince et vigoureux ». Beauté des arbres, des enfants au torse nu, rieurs, au regard languide. Le ciel est bas. Extraordinaire quiétude et douceur de l’air. Tout ici semble promettre le bonheur, la volupté, l’oubli.
31 juillet.
Tabou. – Un phare bas, qui semble une cheminée de steamer. Quelques toits perdus dans la verdure. Le navire s’arrête à deux kilomètres de la côte. Trop peu de temps pour descendre à terre ; mais, du rivage s’amènent deux grandes barques pleines de Croumens. L’Asie en recrute soixante-dix pour renforcer l’équipage – qu’on rapatriera au retour. Hommes admirables pour la plupart, mais qu’on ne reverra plus que vêtus.
Dans une minuscule pirogue, un nègre isolé chasse l’eau envahissante, d’un claquement de jambe contre la coque.
1er août.
Image de l’ancien « Magasin Pittoresque » : la barre à Grand-Bassam. Paysage tout en longueur. Une mer couleur thé, où traînent de longs rubans jaunâtres de vieille écume. Et, bien que la mer soit à peu près calme, une houle puissante vient, sur le sable du bord, étaler largement sa mousse. Puis un décor d’arbres très découpés, très simples, et comme dessinés par un enfant. Ciel nuageux.
Sur le wharf, un fourmillement de noirs poussent des wagonnets. À la racine du wharf, des hangars ; puis, de droite et de gauche, coupant la ligne d’arbres, des maisons basses, aplaties, aux couvertures de tuiles rouges. La ville est écrasée entre la lagune et la mer. Comment imaginer, tout près, sitôt derrière la lagune, l’immense forêt vierge, la vraie…
Pour gagner le wharf, nous prenons place à cinq ou six dans une sorte de balancelle qu’on suspend par un crochet à une élingue, et qu’une grue soulève et dirige à travers les airs, au-dessus des flots, vers une vaste barque, où le treuil la laisse lourdement choir.
On imagine des joujous requins, des joujous épaves, pour des naufrages de poupées. Les nègres nus crient, rient et se querellent en montrant des dents de cannibales. Les embarcations flottent sur le thé, que griffent et bêchent de petites pagaies en forme de pattes de canard, rouges et vertes, comme on en voit aux fêtes nautiques des cirques. Des plongeurs happent et emboursent dans leurs joues les piécettes qu’on leur jette du pont de l’Asie. On attend que les barques soient pleines ; on attend que le médecin de Grand-Bassam soit venu donner je ne sais quels certificats ; on attend si longtemps que les premiers passagers, descendus trop tôt dans les nacelles, et que les fonctionnaires de Bassam, trop empressés à les accueillir, balancés, secoués, chahutés, tombent malades. On les voit se pencher de droite et de gauche, pour vomir.
Grand-Bassam. – Une large avenue, cimentée en son milieu ; bordée de maisons espacées, de maisons basses. Quantité de gros lézards gris fuient devant nos pas et regagnent le tronc de l’arbre le plus proche, comme à un jeu des quatre coins. Diverses sortes d’arbres inconnus, à larges feuilles, étonnement du voyageur. Une race de chèvres très petite et basse sur jambes ; des boucs à peine un peu plus grands que des chiens terriers ; on dirait des chevreaux, mais déjà cornus et qui dardent par saccade un très long aiguillon violâtre.
Transversales, les rues vont de la mer à la lagune ; celle-ci, peu large en cet endroit, est coupée d’un pont qu’on dirait japonais. Une abondante végétation nous attire vers l’autre rive ; mais le temps manque. L’autre extrémité de la rue se perd dans le sable d’une sorte de dune ; un groupe de palmiers à huile ; puis la mer, qu’on ne voit pas, mais que dénonce la mâture d’un grand navire.
Lomé (2 août).
Au réveil, un ciel de pluie battante. Mais non ; le soleil monte ; tout ce gris pâlit jusqu’à n’être plus qu’une buée laiteuse, azurée ; et rien ne dira la douceur de cette profusion d’argent. L’immense lumière de ce ciel voilé, comparable au pianissimo d’un abondant orchestre.
Cotonou (2 août).
Combat d’un lézard et d’un serpent d’un mètre de long, noir lamé de blanc, très mince et agile, mais si occupé par la lutte que nous pouvons l’observer de très près. Le lézard se débat, parvient à échapper, mais abandonnant sa queue, qui continue longtemps de frétiller à l’aveuglette.
Conversations entre passagers.
Je voudrais comme dans le Quotidien ouvrir une rubrique, dans ce carnet : « Est-il vrai que… » Est-il vrai qu’une société américaine, installée à Grand-Bassam, y achète l’acajou qu’elle nous revend ensuite comme « mahogany » du Honduras ?
Est-il vrai que le maïs que l’on paie 35 sous en France ne coûte que… etc.
Libreville (6 août), Port-Gentil (7 août).
À Libreville, dans ce pays enchanteur,
où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux,
l’on meurt de faim. L’on ne sait comment faire face à la disette. Elle règne, nous dit-on, plus terrible encore à l’intérieur du pays.
La grue de l’Asie va cueillir à fond de cale les caisses qu’elle enlève dans un filet à larges mailles, puis déverse dans le chaland transbordeur. Des indigènes les reçoivent et s’activent avec de grands cris. Coincée, heurtée, précipitée, c’est merveille si la caisse arrive entière. On en voit qui éclatent comme des gousses, et répandent comme des graines leur contenu de boîtes de conserve. J’en saisis une. F., agent principal d’une entreprise d’alimentation, à qui je la montre, reconnaît la marque et m’affirme que c’est un lot de produits avariés qui n’a pu trouver acheteur sur le marché de Bordeaux.
8 août.
Mayoumba. – Lyrisme des pagayeurs, au dangereux franchissement de la barre. Les couplets et les refrains de leur chant rythmé se chevauchent[1]. À chaque enfoncement dans le flot, la tige de la pagaie prend appui sur la cuisse nue. Beauté sauvage de ce chant semi-triste ; allégresse musculaire ; enthousiasme farouche. À trois reprises la chaloupe se cabre, à demi dressée hors du flot ; et lorsqu’elle retombe un énorme paquet d’eau vous inonde, que vont sécher bientôt le soleil et le vent.
Nous partons à pied, tous deux, vers la forêt. Une allée ombreuse y pénètre. Étrangeté. Clairières semées de quelques huttes de roseaux. L’administrateur vient à nous en tipoye[2], et en met aimablement deux autres à notre disposition. Il nous emmène, alors que nous étions déjà sur le chemin du retour ; et nous rentrons de nouveau dans la forêt. À vingt ans je n’aurais pas eu joie plus vive. Cris et bondissements des porteurs. Nous revenons par le bord de la mer. Sur la plage, fuite éperdue des troupeaux de crabes, hauts sur pattes et semblables à de monstrueuses araignées.
9 août, 7 heures du matin.
Pointe Noire[3]. – Ville à l’état larvaire, qui semble encore dans le sous-sol.
9 août, 5 heures du soir.
Nous entrons dans les eaux du Congo. Gagnons Banane dans la vedette du commandant. Chaque occasion de descendre à terre nous trouve prêts. Retour à la nuit tombante.
La joie est peut-être aussi vive ; mais elle entre en moi moins avant ; elle éveille un écho moins retentissant dans mon cœur. Ah ! pouvoir ignorer que la vie rétrécit devant moi sa promesse… Mon cœur ne bat pas moins fort qu’à vingt ans.
Lente remontée du fleuve dans la nuit. Sur la rive gauche, au loin, quelques lumières ; un feu de brousse, à l’horizon ; à nos pieds l’effrayante épaisseur des eaux.
(10 août).
Un absurde contretemps m’empêche, en passant à Bôma (Congo belge), d’aller présenter mes respects au Gouverneur. Je n’ai pas encore bien compris que, chargé de mission, je représente, et suis dès à présent un personnage officiel. Le plus grand mal à me gonfler jusqu’à remplir ce rôle.
Matadi[4] (10 août), 6 heures du soir
Partis le 12, à 6 heures du matin – arrivés à Thysville à 6 h. 1/2 du soir.
Nous repartons vers 7 heures du matin, pour n’arriver à Kinshassa qu’à la nuit close.
Le lendemain traversée du Stanley-Pool. Arrivée vendredi 14 à 9 heures du matin à Brazzaville[5].
Brazzaville.
Étrange pays, où l’on n’a pas si chaud que l’on transpire.
À chasser les insectes inconnus, je retrouve des joies d’enfant. Je ne me suis pas encore consolé d’avoir laissé échapper un beau longicorne vert pré, aux élytres damasquinés, zébrés, couverts de vermiculures plus foncées ou plus pâles ; de la dimension d’un bupreste, la tête très large, armée de mandibules-tenailles. Je le rapportais d’assez loin, le tenant par le corselet, entre pouce et index ; sur le point d’entrer dans le flacon de cyanure, il m’échappe et s’envole aussitôt.
Je m’empare de quelques beaux papillons porte-queue, jaune soufré maculés de noir, très communs ; et d’un autre un peu moins fréquent, semblable au machaon, mais plus grand, jaune zébré de noir (que j’avais vu au Jardin d’Essai de Dakar).
Ce matin, nous sommes retournés au confluent du Congo et du Djoué, à six kilomètres environ de Brazzaville. (Nous y avions été hier au coucher du soleil.) Petit village de pêcheurs. Bizarre lit de rivière à sec, tracé par une incompréhensible accumulation de « boulders » presque noirs ; on dirait la morène d’un glacier. Nous bondissons de l’une à l’autre de ces roches arrondies, jusqu’aux bords du Congo. Petit sentier, presque au bord du fleuve ; crique ombragée, où une grande pirogue est amarrée. Papillons en grand nombre et très variés ; mais je n’ai qu’un filet sans manche et laisse partir les plus beaux. Nous gagnons une partie plus boisée, tout au bord de l’affluent, dont les eaux sont sensiblement plus limpides. Un fromager énorme, au monstrueux empattement, que l’on contourne ; de dessous le tronc, jaillit une source. Près du fromager, un amorphophallus violet pourpré, sur une tige épineuse de plus d’un mètre. Je déchire la fleur et trouve, à la base du pistil, un grouillement de petits asticots. Quelques arbres, auxquels les indigènes ont mis le feu, se consument lentement par la base.
J’écris ceci dans le petit jardin de la très agréable case que M. Alfassa, le Gouverneur général intérimaire, a mis à notre disposition. La nuit est tiède ; pas un souffle. Un incessant concert de grillons et, formant fond, de grenouilles.
23 août.
Troisième visite aux rapides du Congo. Mais cette fois, nous nous y prenons mieux, et du reste guidés avec quelques autres par M. et Mme Chaumel, nous traversons un bras du Djoué en pirogue et gagnons le bord même du fleuve, où la hauteur des vagues et l’impétuosité du courant sont particulièrement sensibles. Un ciel radieux impose sa sérénité à ce spectacle, plus majestueux que romantique. Par instants, un remous creuse un sillon profond ; une gerbe d’écume bondit. Aucun rythme ; et je m’explique mal ces inégalités du courant.
– « Et croiriez-vous qu’un pareil spectacle attend encore son peintre ! » s’écrie un des invités, en me regardant. C’est une invite à laquelle je ne répondrai point. L’art comporte une tempérance et répugne à l’énormité. Une description ne devient pas plus émouvante pour avoir mis dix au lieu d’un. On a blâmé Conrad, dans le Typhon, d’avoir escamoté le plus fort de la tempête. Je l’admire au contraire d’arrêter son récit précisément au seuil de l’affreux, et de laisser à l’imagination du lecteur libre jeu, après l’avoir mené, dans l’horrible, jusqu’à tel point qui ne parût pas dépassable. Mais c’est une commune erreur, de croire que la sublimité de la peinture tient à l’énormité du sujet. Je lis dans le bulletin de la Société des recherches Congolaises (n° 2) :
« Ces tornades, dont la violence est extrême, sont, à mon avis, la plus belle scène de la nature intertropicale. Et je terminerai en exprimant le regret qu’il ne se soit pas trouvé, parmi les coloniaux, un musicien né pour les traduire en musique. » Regret que nous ne partagerons point.
24 et 25 août.
Procès Sambry.
Moins le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête.
L’on juge un malheureux administrateur, envoyé trop jeune et sans instructions suffisantes, dans un poste trop reculé. Il y eût fallu telle force de caractère, telle valeur morale et intellectuelle, qu’il n’avait pas. À défaut d’elles, pour imposer aux indigènes, on recourt à une force précaire, spasmodique et dévergondée. On prend peur ; on s’affole ; par manque d’autorité naturelle, on cherche à régner par la terreur. On perd prise, et bientôt plus rien ne suffit à dompter le mécontentement grandissant des indigènes, souvent parfaitement doux, mais que révoltent et poussent à bout les injustices, les sévices, les cruautés[6].
Ce qui paraît ressortir du procès, c’est surtout l’insuffisance de surveillance. Il faudrait pouvoir n’envoyer dans les postes reculés de la brousse, que des agents de valeur déjà reconnue. Tant qu’il n’aura pas fait ses preuves, un administrateur encore jeune demande à être très étroitement encadré.
L’avocat défenseur profite de cette affaire, pour faire le procès de l’administration en général, avec de faciles effets d’éloquence et des gestes à la Daumier, que j’espérais hors d’usage depuis longtemps. Prévenu de l’attaque, et pour y faire face, M. Prouteaux, chef de cabinet du Gouverneur, avait courageusement pris place aux côtés du ministère public ; ce que certains ne manquèrent pas de trouver « déplacé ».
À noter l’effarante insuffisance des deux interprètes ; parfaitement incapables de comprendre les questions posées par le juge, mais que toujours ils traduisent quand même, très vite et n’importe comment, ce qui donne lieu à des confusions ridicules. Invités à prêter serment, ils répètent stupidement : « Dis : je le jure », aux grands rires de l’auditoire. Et lorsqu’ils transmettent les dépositions des témoins, on patauge dans l’à-peu-près.
L’accusé s’en tire avec un an de prison et le bénéfice de la loi Bérenger.
Je ne parviens pas à me faire une opinion sur celle des nombreux indigènes qui assistent aux débats et qui entendent le verdict. La condamnation de Sambry satisfait-elle leur idée de justice ?…
Durant la troisième et dernière séance de ce triste procès, un très beau papillon est venu voler dans la salle d’audience, dont toutes les fenêtres sont ouvertes. Après de nombreux tours, il s’est inespérément posé sur le pupitre devant lequel j’étais assis, où je parviens à le saisir sans l’abîmer.
Le lendemain, je reçois la visite de M. X, l’un des juges assesseurs.
– « Voulez-vous le secret de tout ceci ? me dit-il ; Sambry couchait avec les femmes de tous les miliciens à ses ordres. Il n’y a pas pire imprudence. Dès qu’on ne les tient plus en main, ces gardes indigènes deviennent terribles. Presque toutes les cruautés qu’on reproche à Sambry sont leur fait. Mais tous ont déposé contre lui, vous l’avez vu. »
Je prends ces notes trop « pour moi » ; je m’aperçois que je n’ai pas décrit Brazzaville. Tout m’y charmait d’abord : la nouveauté du climat, de la lumière, des feuillages, des parfums, du chant des oiseaux, et de moi-même aussi parmi cela, de sorte que par excès d’étonnement, je ne trouvais plus rien à dire. Je ne savais le nom de rien. J’admirais indistinctement. On n’écrit pas bien dans l’ivresse. J’étais grisé.
Puis, passé la première surprise, je ne trouve plus aucun plaisir à parler de ce que déjà je voudrais quitter. Cette ville, énormément distendue, n’a de charmant que ce qu’elle doit au climat et à sa position allongée près du fleuve. En face d’elle Kinshassa paraît hideuse. Mais Kinshassa vit d’une vie intense ; et Brazzaville semble dormir. Elle est trop vaste pour le peu d’activité qui s’y déploie. Son charme est dans son indolence. Surtout je m’aperçois qu’on ne peut y prendre contact réel avec rien ; non point que tout y soit factice ; mais l’écran de la civilisation s’interpose, et rien n’y entre que tamisé.
Et je ne doute pas qu’il n’y aurait beaucoup à apprendre sur le fonctionnement des rouages de l’administration en particulier ; mais pour le bien comprendre, il faudrait connaître déjà le pays. Ce qui pourtant commence à m’apparaître, c’est l’extraordinaire complication, l’enchevêtrement de tous les problèmes coloniaux. La question de chemin de fer de Brazzaville à Pointe-Noire serait particulièrement intéressante à étudier ; mais je n’en puis connaître que ce que l’on m’en raconte, et tous les récits que j’entends se contredisent ; ce qui m’amène à me méfier de tous et de chacun. On parle beaucoup de désordre, d’imprévoyance et d’incurie… Je ne veux tenir pour certain que ce que j’aurai pu voir moi-même, ou pu suffisamment contrôler. Sans interprète, comment interroger les « Saras » que je rencontre, ces grands et fort Saras que l’on fait venir de la région du Tchad pour les travaux de la voie ferrée ? Et ceux-ci ne savent rien encore : ils arrivent. Ils sont là, devant la mairie, en troupeau, répondant à l’appel et attendant une distribution de manioc, que d’autres indigènes apportent dans de grands paniers. Comment savoir s’il est vrai que, parmi ceux qui les ont précédés sur les chantiers, la mortalité a été, comme on nous le dit, consternante ?… Je suis trop neuf dans le pays[7].
Nous engageons, au petit bonheur, deux boys et un cuisinier. Ce dernier, qui répond au nom ridicule de Zézé, est hideux. Il est de Fort-Crampel. Les deux boys, Adoum et Outhman, sont des Arabes du Oua-daï, que ce voyage vers le nord va rapprocher de leur patrie.
30 août.
Engourdissement, peut-être diminution. La vue baisse ; l’oreille durcit ; aussi bien portent-elles moins loin des désirs sans doute plus faibles. L’important, c’est que cette équation se maintienne entre l’impulsion de l’âme et l’obéissance du corps. Puissé-je, même alors et vieillissant, maintenir en moi l’harmonie. Je n’aime point l’orgueilleux raidissement du stoïque ; mais l’horreur de la mort, de la vieillesse et de tout ce qui ne se peut éviter, me semble impie. Je voudrais rendre à Dieu quoi qu’il m’advienne, une âme reconnaissante et ravie.
2 septembre.
Congo-Belge. – Nous prenons une auto pour Léopoldville. Visite au Gouverneur Engels. Il nous conseille de pousser jusqu’à Coquillatville (Équateur-ville) et propose de mettre une baleinière à notre disposition, pour nous ramener à Liranga, que nous pensions d’abord gagner directement.
Notre véranda est encombrée de caisses et de colis. Le bagage doit être fractionné en charges de vingt à vingt-cinq kilos[8]. Quarante-trois caissettes, sacs ou cantines, contenant l’approvisionnement pour la seconde partie de notre voyage, seront expédiés directement à Fort Archambault, où nous avons promis à Marcel de Coppet d’arriver pour la Noël. Nous n’emporterons avec nous, pour le crochet en Congo belge, que le « strict nécessaire » ; nous retrouverons le reste à Liranga, apporté par le Largeau, dans dix jours. Brazzaville ne nous offre plus rien de neuf ; nous avons hâte d’aller plus loin.
CHAPITRE II – La lente remontée du fleuve
5 septembre
Ce matin, au lever du jour, départ de Brazzaville. Nous traversons le Pool pour gagner Kinshassa où nous devons nous embarquer sur le Brabant. La duchesse de Trévise, envoyée par l’Institut Pasteur, vient avec nous jusqu’à Bangui, où son service l’appelle.
Traversée du Stanley-Pool. Ciel gris. S’il faisait du vent, on aurait froid. Le bras du pool est encombré d’îles, dont les rives se confondent avec celles du fleuve ; certaines de ces îles sont couvertes de buissons et d’arbres bas ; d’autres, sablonneuses et basses, inégalement revêtues d’un maigre hérissement de roseaux. Par places, de larges remous circulaires lustrent la grise surface de l’eau. Malgré la violence du courant, le cours de l’eau semble incertain. Il y a des contre-courants, d’étranges vortex, et des retours en arrière, qu’accusent les îlots d’herbe entraînés. Ces îlots sont parfois énormes ; les colons s’amusent à les appeler des « concessions portugaises ». On nous a dit et répété que cette remontée du Congo, interminable, était indiciblement monotone. Nous mettrons un point d’honneur à ne pas le reconnaître. Nous avons tout à apprendre et épelons le paysage lentement. Mais nous ne cessons pas de sentir que ce n’est là que le prologue d’un voyage qui ne commencera vraiment que lorsque nous pourrons prendre plus directement contact avec le pays. Tant que nous le contemplerons du bateau, il restera pour nous comme un décor distant et à peine réel.
Nous longeons la rive belge d’assez près. À peine si l’on distingue, là-bas, tout au loin, la rive française. Énormes étendues plates, couvertes de roseaux, où mon regard cherche en vain des hippopotames. Sur le bord, par instants, la végétation s’épaissit ; les arbrisseaux, les arbres remplacent les roseaux ; mais toujours, arbre ou roseau, la végétation empiète sur le fleuve – ou le fleuve sur la végétation du bord, comme il advient en temps de crue (mais dans un mois les eaux seront beaucoup plus hautes, nous dit-on). Branches et feuilles baignent et flottent, et le remous du bateau, comme par une indirecte caresse, en passant les soulève doucement.
Sur le pont, une vingtaine de convives à la table commune. Une autre table, parallèle à la première, où l’on a mis nos trois couverts.
Une montagne assez haute ferme le fond du pool, devant laquelle le pool s’élargit. Les remous se font plus puissants et plus vastes ; puis le Brabant s’engage dans le « couloir ». Les rives deviennent berges et se resserrent. Le Congo coule alors entre une suite rompue d’assez hautes collines boisées. Le faîte des collines est dénudé, ou du moins semble couvert d’herbes rases, à la manière des « chaumes » vosgiens ; pacages où l’on s’attend à voir des troupeaux.
Arrêt devant un poste à bois, vers deux heures (j’ai cassé ma montre hier soir). Aimables ombrages des manguiers. Peuple indolent, devant quelques huttes. Je vois pour la première fois des ananas en fleurs. Surprenants papillons, que je poursuis en vain avec un filet sans monture, car j’ai perdu le manche à Kinshassa. La lumière est glorieuse ; il ne fait pas trop chaud.
Le navire s’arrête à la tombée du jour sur la rive française, devant un misérable village : vingt huttes clairsemées autour d’un poste à bois, où le Brabant se ravitaille. Chaque fois que le navire accoste, quatre énormes nègres, deux à l’avant, deux à l’arrière, plongent et gagnent la rive pour y fixer les amarres. La passerelle est rabattue ; elle ne suffit pas, et de longues planches la prolongent. Nous gagnons le village, guidés par un petit vendeur de colliers qui fait avec nous le voyage ; une bizarre résille bleue marbrée de blanc couvre son torse et retombe sur une culotte de nankin. Il ne comprend pas un mot de français mais sourit, lorsqu’on le regarde, d’une façon si exquise que je le regarde souvent. Nous parcourons le village, profitant des dernières lueurs. Les indigènes sont tous galeux ou teigneux, ou rogneux, je ne sais ; pas un n’a la peau nette et saine. Vu pour la première fois l’extraordinaire fruit des « barbadines » (passiflores).
La lune encore presque pleine transparaît derrière la brume, exactement à l’avant du navire, qui s’avance tout droit dans la barre de son reflet. Un léger vent souffle continûment de l’arrière et rabat de la cheminée vers l’avant une merveilleuse averse d’étincelles : on dirait un essaim de lucioles. Après une contemplation prolongée, il faut me résigner à regagner ma cabine, à étouffer et suer sous la moustiquaire. Puis lentement l’air fraîchit, le sommeil vient… De curieux cris me réveillent : je me relève et descends sur le premier pont à peine éclairé par les lueurs du four où les cuisiniers préparent le pain avec de grands rires et des chants. Je ne sais comment les autres, étendus tout auprès, font pour dormir. À l’abri d’un amoncellement de caisses, éclairés par une lanterne-tempête, trois grands nègres autour d’une table jouent aux dés ; clandestinement, car les jeux d’argent sont interdits.
5 et 6 septembre.
Je relis l’oraison funèbre d’Henriette de France. À part l’admirable portrait de Cromwell et certaine phrase du début sur les limites que Dieu impose au développement du schisme, je n’y trouve pas beaucoup d’excellent, du moins à mon goût. Je relève pourtant cette phrase : « … parmi les plus mortelles douleurs, on est encore capable de joie » ; et : « … entreprise… dont le succès paraît infaillible, tant le concert en est juste ». Abus de citations flasques.
L’oraison d’Henriette d’Angleterre, que je relis sitôt ensuite, me paraît beaucoup plus belle, et plus constamment. Ici je retrouve mon admiration la plus vive. Mais quel spécieux raisonnement ! Imagine-t-on quelqu’un qui dirait à un voyageur : « Ne regardez donc pas le fuyant paysage, contemplez plutôt la paroi du wagon, qui elle, du moins, ne change pas. » Eh parbleu ! lui répondrais-je, j’aurai tout le temps de contempler l’immuable, puisque vous m’affirmez que mon âme est immortelle ; permettez-moi d’aimer bien vite ce qui disparaîtra dans un instant.
Après une seconde journée un peu monotone, nous avons passé la nuit devant la mission américaine de Tchoumbiri, où nous avions amarré dès six heures. (La nuit précédente le Brabant ne s’était pas arrêté.) Le soleil se couchait tandis que nous traversions le village ; palmiers, bananiers abondants, les plus beaux que j’aie vus jusqu’ici, ananas, et ces grands arums à rhizomes comestibles (taros). L’aspect de la prospérité. Les missionnaires sont absents. Tout un peuple était sur la rive, attendant le débarquement du bateau ; car avant d’accoster nous avions longé quantité d’assez importants villages.
Nous sommes redescendus à terre après le dîner, à la nuit close, escortés par un troupeau d’enfants provocants et gouailleurs. Sur les terres basses, au bord du fleuve, d’innombrables lucioles paillettent l’herbe, mais s’éteignent dès qu’on veut les saisir. Je remonte à bord et m’attarde sur le premier pont, parmi les noirs de l’équipage, assis sur une table auprès du petit vendeur de colliers qui somnole, la main dans ma main et la tête sur mon épaule.
Lundi matin, 7 septembre.
Au réveil, le spectacle le plus magnifique. Le soleil se lève tandis que nous entrons dans le pool de Bolobo. Sur l’immense élargissement de la nappe d’eau, pas une ride, pas même un froissement léger qui puisse en ternir un peu la surface ; c’est une écaille intacte, où rit le très pur reflet du ciel pur. À l’orient quelques nuages longs que le soleil empourpre. Vers l’ouest, ciel et lac sont d’une même couleur de perle, un gris d’une délicatesse attendrie, nacre exquise où tous les tons mêlés dorment encore, mais où déjà frémit la promesse de la riche diaprure du jour. Au loin, quelques îlots très bas flottent impondérablement sur une matière fluide… L’enchantement de ce paysage mystique ne dure que quelques instants ; bientôt les contours s’affirment, les lignes se précisent ; on est sur terre de nouveau.
L’air parfois souffle si léger, si suave et voluptueusement doux, qu’on croit respirer du bien-être.
Tout le jour nous avons circulé entre les îles ; certaines abondamment boisées, d’autres couvertes de papyrus et de roseaux. Un étrange enchevêtrement de branches s’enfonce épaissement dans l’eau noire. Parfois quelque village, dont les huttes se distinguent à peine ; mais on est averti de sa présence par celle des palmiers et des bananiers. Et le paysage, dans sa monotonie variée, reste si attachant que j’ai peine à le quitter pour la sieste.
Admirable coucher de soleil, que double impeccablement l’eau lisse. D’épaisses nuées obscurcissent déjà l’horizon ; mais un coin de ciel s’ouvre, ineffablement, pour laisser voir une étoile inconnue.
8 septembre.
Il est réjouissant de penser que c’est précisément à ses qualités les plus profanes et qui lui paraissaient les plus vaines, que l’orateur sacré doit sa survie dans la mémoire des hommes.
Je m’attendais à une végétation plus oppressante. Épaisse, il est vrai, mais pas très haute et n’encombrant ni l’eau ni le ciel. Les îles, ce matin, se disposent sur le grand miroir du Congo d’une manière si harmonieuse qu’il semble que l’on circule dans un parc d’eau.
Parfois quelque arbre étrange domine le taillis épais de la rive et fait solo dans la confuse symphonie végétale. Pas une fleur ; aucune note de couleur autre que la verte, un vert égal, très sombre et qui donne à ce paysage une tranquillité solennelle, semblable à celle des oasis monochromes, une noblesse où n’atteint pas la diversité nuancée de nos paysages du Nord[9].
Hier soir, arrêt à N’Kounda, sur la rive française. Étrange et beau village, que l’imagination embellit encore ; car la nuit est des plus obscures. L’allée de sable où l’on s’aventure luit faiblement. Les cases sont très distantes les unes des autres ; voici pourtant une sorte de rue, ou de place très allongée ; plus loin, un défoncement de terrain, marais ou rivière, qu’abritent quelques arbres énormes d’essence inconnue ; et, tout à coup, non loin du bord de cette eau cachée, un petit enclos où l’on distingue trois croix de bois. Nous grattons une allumette pour lire leur inscription. Ce sont les tombes de trois officiers français. Auprès de l’enclos une énorme euphorbe candélabre se donne des airs de cyprès.
Terrible engueulade du colon « Léonard », sorte de colosse court, aux cheveux noirs plaqués à la Balzac, qui retombent par mèches sur son visage plat. Il est affreusement ivre et, monté sur le pont du Brabant, fait d’abord un raffut de tous les diables au sujet d’un boy qu’un des passagers vient d’engager et dont il prétend se ressaisir. On tremble pour le boy, s’il y parvient. Puis c’est à je ne sais quel Portugais qu’il en a et vers lequel il jette ses imprécations ordurières. Nous le suivons dans la nuit, sur la rive, jusqu’en face d’un petit bateau que, si nous comprenons bien, ledit Portugais vient de lui acheter, mais qu’il n’a pas encore payé.
« Il me doit quatre-vingt-six mille francs, ce fumier, cette ordure, ce Ppportugais. C’est même pas un vrai Portugais. Les vrais Portugais, ils restent chez eux. Il y a trois espèces de Portugais, les vrais Portugais ; et puis les Portugais de la merde ; et puis la merde de Portugais. Lui, c’est de la merde de Portugais. Fumier ! Ordure ! Tu me dois quatre-vingt-six mille francs… » Et il recommence, répétant et criant à tue-tête les mêmes phrases, exactement les mêmes, dans le même ordre, inlassablement. Une négresse se suspend à son bras ; c’est sa « ménagère », sans doute. Il la repousse brutalement, et l’on croit qu’il va cogner. On le sent d’une force herculéenne…
Une heure plus tard, le voici qui rapplique sur le pont du Brabant. Il veut trinquer avec le commandant ; mais, comme celui-ci, très ferme, lui refuse le champagne qu’il demande, s’abritant derrière un règlement qui interdit de servir des consommations passé neuf heures, l’autre s’emporte et l’enguirlande. Il descend enfin, mais, de la rive, invective encore, tandis que, reculé dans la nuit à l’autre bout du pont, le pauvre commandant à qui je vais tenir compagnie, tout tremblant et les larmes aux yeux, boit la honte sans souffler mot. C’est un Russe, de la suite du Tsar, condamné à mort par le tribunal révolutionnaire, qui a pris du service en Belgique, laissant à Leningrad sa femme et ses deux filles.
Après que Léonard est enfin parti, rentrant dans la nuit, cette pauvre épave proteste : « Amiral ! Il me traite d’amiral… Mais je n’ai jamais été amiral… » Il craint que la duchesse de Trévise n’ait ajouté foi aux perfides accusations de Léonard. Le lendemain, il nous dira qu’il n’a pas pu dormir un seul instant. Et par protestation, par sympathie, les passagers, qui jusqu’alors l’appelaient simplement : « capitaine », ce matin lui donnent du « commandant » à qui mieux mieux.
Le spectacle se rapproche de ce que je croyais qu’il serait ; il devient ressemblant. Abondance d’arbres extrêmement hauts, qui n’opposent plus au regard un trop impénétrable rideau ; ils s’écartent un peu, laissent s’ouvrir des baies profondes de verdure, se creuser des alcôves mystérieuses et, si des lianes les enlacent, c’est avec des courbes si molles que leur étreinte semble voluptueuse et pour moins d’étouffement que d’amour.
8 septembre.
Mais cette orgie n’a pas duré. Ce matin, tandis que j’écris ces lignes, les îles entre lesquelles nous voguons n’offrent plus qu’une touffe uniforme.
Hier, nous avions navigué toute la nuit. Ce soir, à la nuit tombante, nous jetons l’ancre au milieu du fleuve pour repartir aux premières lueurs.
Hier, l’escale à Loukoléla fut particulièrement émouvante. Profitant de l’heure d’arrêt, tous trois nous avons gravi en hâte le bel escalier de bois qui relie l’importante scierie de la rive au village qui la domine ; puis, suivant le sentier devant nous, qui pénètre dans la forêt, nous nous sommes enfoncés presque anxieusement dans une Broceliande enchantée. Ce n’était pas encore la grande forêt ténébreuse, mais solennelle déjà, peuplée de formes, d’odeurs et de bruits inconnus.
J’ai rapporté quelques très beaux papillons ; ils volaient en grand nombre sur notre sentier, mais d’un vol si fantasque et rapide qu’on avait le plus grand mal à les saisir. Certains, azurés et nacrés comme des morphos, mais aux ailes très découpées et portant queue, à la manière des flambés de France.
Parfois d’étroits couloirs liquides s’ouvrent profondément sous les ramures, où l’on souhaite s’aventurer en pirogue ; et rien n’est plus attirant que leur mystère ténébreux. La liane la plus fréquente est cette sorte de palmier flexible et grimpant qui dispose en un rythme alterné, tout au long de sa tige courbée, de grandes palmes-girandoles, d’une grâce un peu maniérée.
12 septembre.
Arrivés le 9 à Coquillatville. J’ai perdu prise. Je crains de me désintéresser de ce carnet si je ne le tiens pas à jour. Le gouverneur a mis à notre disposition une auto et l’aimable M. Jadot, procureur du Roi, nous accompagne à travers les quartiers de cette vaste et encore informe ville. On admire non tant ce qu’elle est, que ce que l’on espère qu’elle sera dans dix ans. Remarquable hôpital indigène, non encore achevé, mais où déjà presque rien ne manque[10].
Le directeur de cet hôpital est un Français, un Algérien d’aspect énergique, médecin de grande valeur, paraît-il, et qu’il est bien regrettable qu’un traitement suffisant n’ait pas pu retenir au Congo français, où l’assistance médicale fait si grand défaut[11].
Le 11, visite au jardin d’essai d’Eala, le vrai but de ce détour en Congo belge. M. Goosens, le directeur de ce jardin, présente à notre émerveillement les plus intéressants de ses élèves : cacaoyers, caféiers, arbres à pain, arbres à lait, arbres à bougies, arbres à pagnes, et cet étrange bananier de Madagascar, l’« arbre du voyageur », dont les larges feuilles laissent sourdre, à la base de leur pétiole qu’un coup de canif a crevé, un verre d’eau pure pour le voyageur altéré. Déjà nous avions passé à Eala, la veille, quelques heures exquises. Inépuisable science de M. Goosens, et complaisance inlassable à satisfaire notre insatiable curiosité.
13 septembre.
Les journées les plus intéressantes sont précisément celles où le temps manque pour rien noter. Hier, interrompu par l’auto qui vient nous prendre de bon matin pour nous mener à Eala, où nous nous embarquons en baleinière. Une tornade, durant la nuit, avait un peu rafraîchi l’atmosphère ; néanmoins il faisait encore une belle chaleur. Nous remontons la « Bousira », et débarquons parmi les roseaux en face de Bolombo, dépendance d’Eala, où M. Goosens a établi ses plus importantes pépinières et vergers de palmiers à huile. Sur ma demande, on nous promène dans la forêt durant deux heures, le long d’un très petit sentier presque indistinct, où nous précède un indigène armé d’une machette pour frayer la route. Si intéressante que soit cette circulation parmi les végétaux inconnus, il faut bien avouer que cette forêt me déçoit. J’espère trouver mieux ailleurs. Celle-ci n’est pas très haute ; je m’attendais à plus d’ombre, de mystère et d’étrangeté. Ni fleurs, ni fougères arborescentes ; et lorsque je les réclame, comme un numéro du programme que la représentation escamote, on me répond que « ce n’est pas la région ».
Vers le soir, remontée en pirogue jusqu’à X… où nous attendent les autos. De grandes étendues de roseaux étalent au bord de la rivière un vert plus tendre. La pirogue circule sur une plaque d’ébène à travers les nymphéas blancs, puis s’enfonce sous les branches dans une clairière inondée ; les troncs se penchent sur leur reflet ; des rayons obliques trouent les feuillages. Un long serpent vert court de branche en branche, que nos boys poursuivent, mais qui se perd au plus épais du taillis.
14 septembre.
Départ de Coquillatville à huit heures sur un petit huilier qui devait nous mener au lac Tomba ; mais l’obligation de retrouver le Largeau à Liranga, le 17, nous presse. Le lac est « dangereux » ; nous pourrions être retardés par une tornade. Nous quitterons le Ruby à Irébou, où nous passerons le 15, et d’où une baleinière nous mènera à Liranga. Le ciel est très chargé. Hier soir, de monstrueux éclairs trifourchus illuminaient le ciel ; beaucoup plus grands, m’a-t-il semblé, que ceux d’Europe, mais muets ou trop distants pour nous permettre d’entendre leur tonnerre. À Coquillatville, nous avions été dévorés par les moustiques. La nuit on suffoquait sous la moustiquaire, trempé de sueur. D’énormes blattes s’ébattaient sur nos objets de toilette.
Hier, au marché, vente à la criée de viande d’hippopotame : puanteur insoutenable. Foule grouillante et hurlante ; beaucoup de discussions, de disputes, entre femmes surtout, mais qui toujours se terminent par des rires.
Le Ruby est flanqué de deux baleinières aussi longues que lui, chargées de bois, de caisses et de nègres. Il fait frais, moite et terriblement orageux. Dès que le Ruby se met en marche, trois nègres commencent un assourdissant tam-tam, sur une calebasse et un énorme tambour de bois, long comme une couleuvrine, grossièrement sculpté et peinturluré.
Relu l’oraison funèbre de Marie-Thérèse d’Autriche. Admirables passages ; je crois bien que je la préfère à celles des deux Henriettes.
15 septembre.
Le Ruby nous a débarqués à Irébou, à la nuit tombante. Reçus par le commandant Mamet, qui dirige le campement militaire, un des plus anciens du Congo belge. Une belle avenue de palmiers de trente ans, longeant le fleuve (ou du moins le bras qui alimente le lac Tomba), nous mène à la case qu’on nous a réservée. Dîner chez le commandant. Dévorés de moustiques.
Ce matin, promenade en baleinière vers le lac Tomba. Admirables chants des pagayeurs. La caisse de métal, à l’arrière de la baleinière, sert de tambour sur laquelle, avec une grosse bûche, tape un des noirs, inlassablement ; et la baleinière, toute de métal, vibre toute ; on dirait le rythme régulier d’un piston, réglant l’effort des pagayeurs. Derrière celui qui tape la grosse caisse, un indigène plus jeune, armé d’une baguette, brise le rythme implacable par un système régulier de syncopes dans l’entre-temps.
Arrêt à Makoko (Boloko), petit village sur le large chenal qui relie le Congo au lac Tomba. Le temps manque pour pousser jusqu’au lac. Il fait très chaud. Le soleil de midi tape dur. Sur la rive, je poursuis de grands papillons noirs lamés d’azur. Puis, tandis que notre déjeuner se prépare, je m’enfonce, avec mes deux compagnons, dans la forêt qui touche au village. De grands papillons inconnus naissent devant nos pas, nous précèdent d’un vol fantasque dans le sentier sinueux, puis se perdent dans l’entrelacs des lianes où ne peut les atteindre mon filet. Il y en a d’énormes, et j’enrage de ne pouvoir m’en saisir. (J’en capture pourtant quelques-uns ; mais les plus surprenants m’échappent). Ce petit coin de forêt nous paraît plus beau que tout ce que nous avons vu dans notre longue promenade aux environs d’Eala. Nous parvenons à un contrebas inondé ; l’eau noire double la profondeur de la voûte ; un arbre au tronc monstrueux élargit son empattement ; et tandis que l’on s’en approche, un chant d’oiseau jaillit des profondeurs de l’ombre, lointain, tout chargé d’ombre, de toute l’ombre de la forêt. Étrange descente chromatique de son garulement prolongé.
16 septembre.
Départ d’Irébou en baleinière. Liranga est presque en face, un peu en aval ; mais le Congo, en cet endroit, est extrêmement large, et encombré d’îles ; la traversée prend plus de quatre heures. Les pagayeurs rament mollement. On traverse de grands espaces où l’eau semble parfaitement immobile, puis, par instants, et particulièrement au bord des îles, le courant devient brusquement si rapide que tout l’effort des pagayeurs a du mal à le remonter. Car nous sommes descendus trop bas, je ne sais pourquoi ; les pagayeurs semblent connaître la route, et sans doute la traversée plus en amont est-elle moins sûre.
Un Portugais, prévenu de notre arrivée par dépêche de Brazzaville, seul blanc demeuré à Liranga, nous accueille. Le Père qui dirige l’importante mission de Liranga, malade, a dû quitter son poste le mois dernier pour aller se faire soigner à Brazzaville, emmenant avec lui les enfants les plus malades de cette contrée que décime la maladie du sommeil. La mission, où nous devons loger, est à plus d’un kilomètre du point d’atterrissage ; au bord du fleuve encore, mais dont la berge rocheuse empêche ici l’approche des navires d’un certain tonnage, en temps de basses eaux du moins. Le village, coupé de vergers, s’étend le long de la rive.
Après une belle avenue de palmiers, on parvient devant une église de brique, à côté de la grande bâtisse basse qui va nous héberger. Un « catéchiste » noir nous ouvre les portes et, comme toutes les pièces sont mises à notre disposition, nous serons fort à l’aise. Il fait terriblement chaud, humide, orageux. On étouffe. La salle à manger est heureusement très aérée. Après le repas, sieste ; d’où je me relève ruisselant. Promenade le long d’un sentier, qui se rétrécit après avoir traversé de grands vergers de bananiers à très larges feuilles, différents de ceux que j’ai vus jusqu’à présent, et très beaux ; puis s’enfonce dans la forêt. On marcherait ainsi pendant des heures, requis tous les vingt pas par une surprise nouvelle. Mais la nuit tombe. Un orage effrayant se prépare, et l’enchantement cède à la crainte.
Trois fois par jour, catéchisme d’une heure, en langue indigène. Cinquante-sept femmes et quelques garçons répètent mécaniquement les réponses aux questions que répète monotonement le catéchiste instructeur. On distingue parfois les mots que l’on n’a pu traduire : « Saint Sacrement ; Extrême-Onction ; Eucharistie… »
18 septembre.
La température n’est pas très élevée (elle ne dépasse pas 32°), mais l’air est chargé d’électricité, de moiteur, de tsé-tsés et de moustiques. C’est aux jambes particulièrement que ces derniers s’attaquent ; aux chevilles, que ne protègent pas les souliers bas ; ils s’aventurent dans le pantalon, attaquent les mollets ; même à travers l’étoffe on a les genoux dévorés. La sieste est impossible. C’est du reste l’heure des papillons. Je commence à les connaître à peu près tous ; lorsqu’un nouveau paraît, la joie en est plus vive.
19 septembre.
Le Largeau, vainement attendu depuis deux jours, s’amène au petit matin. Nous arborons un drapeau blanc en face de la mission, et le Largeau s’arrête au petit débarcadère, ce qui épargne le difficile trimballement de notre bagage en pirogue. Le harcèlement constant des moustiques et des tsé-tsés nous fait abandonner Liranga sans regrets.
Le Largeau est un navire de cinquante tonnes ; fort agréable ; bonnes cabines ; salon à l’avant ; grande salle à manger ; électricité partout. Il est flanqué de deux chalands-baleinières, selon l’usage de ce pays. En plus du capitaine Gazangel, nous sommes les seuls blancs à bord ; mais voyage avec nous le « fils Mélèze », un mulâtre assez agréable d’aspect et de manières. Son père est l’un des plus célèbres colons du « couloir ».
Nous quittons le Congo pour l’Oubangui. Les eaux chargées de limon prennent une couleur de café-crème.
Vers deux heures, une tornade nous force d’accoster pendant une heure à l’avant d’une île. Aspect préhistorique du paysage. Trois noirs superbes ont gagné la rive à la nage. Ils circulent à travers l’enchevêtrement de la forêt inondée et cherchent à couper de grandes gaules pour le sondage.
Vers le soir, une pirogue très étroite vient à nous. C’est W., le propriétaire du prochain poste à bois, qui voudrait savoir si nous ne lui apportons pas de courrier. Il gagne Coquillatville pour se faire soigner, ayant reçu, dit-il, « cinq ou six coups de godiche bien tapés ». C’est ainsi qu’on appelle ici les accès de fièvre.
Arrêt à Boubangui pour la nuit. Le peuple qui s’empresse n’est ni beau, ni sympathique, ni étrange. L’on nous confirme ce que nous disait le fils Mélèze : les cases de ce village, à l’époque des crues, sont inondées durant un mois et demi. On a de l’eau jusqu’à mi-cuisses. Les lits sont alors juchés sur des pilotis. On cuisine au sommet de petits monticules de terre. On ne circule plus qu’en pirogue. Comme les cases sont en torchis, l’eau désagrège le bas des murs. Le capitaine nous affirme que certains villages restent inondés pendant trois mois.
20 septembre.
En excellente humeur de travail. Le monotone aspect du pays y invite. J’achève un petit livre de Cresson : Position actuelle des problèmes philosophiques. Son exposé de la philosophie de Bergson me persuade que j’ai longtemps été bergsonien sans le savoir. Sans doute trouverait-on même dans mes Cahiers d’André Walter telles pages que l’on dirait inspirées directement par l’Évolution Créatrice, si les dates permettaient de le croire. Je me méfie beaucoup d’un système qui vient à point pour répondre aux goûts d’une époque et doit une partie de son succès à ce qu’il offre de flatteur.
21 septembre.
Traité de la Concupiscence. Rien à en retenir que précisément ce que Bossuet considérait comme la qualité la plus vaine, de sorte qu’il en va à rencontre de son affirmation.
Je le sais de reste, et pour m’être souvent prêté à ce jeu : il n’est rien, dans la vie d’un peuple, aussi bien que dans notre vie particulière, qui ne puisse prêter à une interprétation mystique, téléologique, etc. où l’on ne puisse reconnaître, si l’on y tient vraiment, l’action contrebattue de Dieu et du démon ; et même cette interprétation risque de paraître la plus satisfaisante, simplement parce qu’elle est la plus imagée. Tout mon esprit, aujourd’hui, se révolte contre ce jeu complaisant qui ne me paraît pas très honnête. Au demeurant la langue de ce « traité » est des plus belles et Bossuet ne s’est montré nulle part meilleur écrivain ni plus grand artiste.
22 septembre.
Pluie presque sans arrêt depuis deux jours. Le Largeau s’est arrêté cette nuit devant Bobolo, sur la rive belge ; poste à bois et briquetterie.
Arrivés ce matin à Impfondo, à huit heures. Une longue et belle avenue s’élargit en jardin public le long du rivage. En amont et en aval, villages indigènes ; cases minables et délabrées ; mais toute la partie française du moins est riante, bien ordonnée et d’aspect prospère. Elle laisse entrevoir ce que pourraient des soins intelligents et continus. M. Augias, l’administrateur, en tournée, ne doit arriver que demain. Les alentours d’Impfondo sont beaux ; criques au bord du fleuve, où s’abritent des pirogues ; inattendues perspectives des jeux de la terre et de l’eau. Sitôt ensuite, la forêt prend un plus grand air. Mais il faut bien avouer que cette remontée de l’Oubangui est désespérément monotone.
Le ciel est très couvert, sans être bas. Depuis trois jours il pleut fréquemment ; pluie fine que le vent promène ; puis, par instants, averse épaisse. Et rien n’est plus triste que le lever d’un de ces jours pluvieux. Le Largeau avance avec une lenteur désespérante ; nous devions coucher à Bétou ; par suite de la mauvaise qualité du bois de chauffage, nous n’y arriverons sans doute que demain vers midi. Les postes à bois, non surveillés, ne nous livrent qu’un bois pourri. L’insuffisance de personnel se fait partout sentir. Il faudrait plus de sous-ordres. Il faudrait plus de main-d’œuvre. Il faudrait plus de médecins. Il faudrait d’abord plus d’argent pour les payer. Et partout les médicaments manquent. Partout on se ressent d’une pénurie lamentable qui laisse triompher et s’étendre même les maladies dont on pourrait le plus aisément triompher. Le service de santé, si l’on réclame des remèdes, n’envoie le plus souvent, avec un immense retard, que de l’iode, du sulfate de soude, et de… l’acide borique[12] !
On rencontre, dans les villages le long du fleuve, bien peu de gens qui ne soient pas talés, tarés, marqués de plaies hideuses (dues le plus souvent au pian). Et tout ce peuple résigné rit, s’amuse, croupit dans une sorte de félicité précaire, incapable même d’imaginer sans doute un état meilleur.
Arrêt à Dongou pour la nuit. C’est à Dongou qu’on a transporté le poste administratif d’Impfondo. Nous débarquons à la tombée du jour. Il y a là, devant des habitations d’Européens disposées de manière à se faire face, et les séparant mais sans les isoler suffisamment, une sorte de jardin public. Des orangers en avenue plient sous le poids des oranges vertes (car, ici, même les oranges et les citrons perdent leur couleur, leur éclat, pour se confondre dans une sombre verdure uniforme). Les arbres sont encore jeunes, mais ce jardin pourra devenir très beau dans quelques années. En face du débarcadère, un écriteau porte : « Impfondo ; 45 kilomètres ». La route qui y mène se prolonge dans l’autre sens jusqu’au village indigène où nous nous rendons à la nuit.
23 septembre.
La forêt change un peu d’aspect ; les arbres sont plus beaux ; désencombrés de lianes, leurs troncs sont plus distincts ; de leurs branches pend une profusion de lichen vert tendre, comme on en voit aux mélèzes de l’Engadine. Certains de ces arbres sont gigantesques, d’une taille qui doit dépasser de beaucoup celle de nos arbres de France ; mais dès qu’on se trouve à quelque distance, et tant le fleuve est immense, on ne peut en juger. Le palmier-liane, si fréquent il y a quelques jours, a disparu.
Vers le soir, le ciel s’éclaircit enfin ; on revoit l’azur avec ravissement et la surface libre des eaux reflète, non vers le couchant, mais vers l’est, une apothéose dorée, où de tendres nuances pourpres se mêlent.
Couché devant Laenza. Au crépuscule, nous parcourons ce médiocre petit village sans intérêt. Dans une case, une femme vient d’accoucher. L’enfant n’a même pas encore commencé à crier ; il tient encore au placenta. Devant nous une sage-femme tranche avec un couteau de bois le cordon ; elle en laisse à l’enfant une longueur qu’elle mesure soigneusement à la nuque après avoir fait passer le cordon par-dessus la tête du petit. Le placenta est alors enveloppé dans une feuille de bananier ; sans doute doit-il être enterré selon certains rites. À la porte se pressent des curieux ; elle est si basse qu’il faut se baisser beaucoup pour entrer. Nous donnons un « pata » (cinq francs) pour fêter la venue au monde de la petite Véronique, et remontons à bord, où nous sommes bientôt assaillis par une horde de charmantes petites cigales vertes. Le Largeau repart à deux heures du matin. La lune est à son premier quartier ; le ciel est très pur ; l’air est tiède.
24 septembre.
Relu les trois premiers actes du Misanthrope. Ce n’est pas, à beaucoup près, la pièce de Molière que je préfère. À chaque lecture nouvelle se précise mon jugement. Les sentiments qui font les ressorts de l’intrigue, les ridicules que Molière satirise, comporteraient une peinture plus nuancée, plus délicate, et supportent assez mal ce grossissement et cette « érosion des contours » que j’admire tant dans le Bourgeois, le Malade, ou l’Avare. Le caractère d’Alceste me paraît un peu fabriqué, et, précisément parce qu’il y met du sien, l’auteur s’y montre moins à l’aise. Souvent on ne sait trop de quoi ni de qui il se moque. Le sujet prêtait au roman plutôt qu’au théâtre où il faut extérioriser trop ; les sentiments d’Alceste souffrent de cette expression forcée qui ajoute à son caractère un ridicule de surface et de moins bonne qualité. Les meilleures scènes sont peut-être celles où lui-même ne paraît pas. Enfin l’on ne voit pas, mise à part sa franchise (qui n’est le plus souvent qu’une insupportable brutalité), quelles sont ces éminentes qualités qui, nous est-il donné à entendre, le rendraient digne de hauts emplois.
Arrêt à dix heures devant Bétou. Les indigènes, de race Modjembo, sont plus sains, plus robustes, plus beaux ; ils paraissent plus libres, plus francs. Tandis que mes deux compagnons gagnent le village le long le la rive, je m’achemine vers le poste de la Compagnie Forestière. Une escouade de très jeunes filles est occupée à sarcler le terrain devant le poste. Elles travaillent en chantant ; vêtues d’une sorte de tutu fait de fibres de palmes tressées ; beaucoup ont des anneaux de cuivre aux chevilles. Le visage est laid, mais le torse admirable. Longue promenade solitaire, à travers des champs de manioc, à la poursuite d’extraordinaires papillons.
Le village, où je vais ensuite, est énorme, mais sans attraits. Plus loin, à demi perdue dans la brousse, l’église, abandonnée depuis deux ans, car ce peuple n’a jamais consenti à écouter l’enseignement des missionnaires, ni à se soumettre à leur morale. L’église, porte et fenêtres ouvertes, est déjà tout envahie par les herbes. Le long du fleuve, un peuple d’enfants s’amuse à plonger du haut de la berge.
Vers deux heures, le fils Mélèze nous quitte. Il gagne en pirogue la rive belge, à Boma-Matangué, avec sa « ménagère » et un petit boy de douze ans, chargé d’espionner la femme, et de faire office de rapporteur.
25 septembre.
Nous accostons à la rive belge, au pied d’un arbre énorme, pour passer la nuit. Arrivés devant Mongoumba vers onze heures. Un monumental escalier de bois, bordé de manguiers, mène au poste. La berge est haute d’une quinzaine de mètres.
Le cours de l’Oubangui devient beaucoup plus rapide, et la marche du Largeau en est d’autant retardée. De très beaux arbres ne parviennent pas à rompre la monotonie de la forêt riveraine. Nous apercevons dans les branches quatre singes noir et blanc, de ceux qu’on appelle, je crois, des « capucins ».
Je relis le Master of Ballantrae.
Il y a chaque jour, entre une et quatre, quelques heures assez pénibles ; mais nous lisons, dans le paquet de journaux que nous prête le commandant, qu’on a eu jusqu’à 36 degrés à Paris, à la fin de juillet.
La belle demi-lune, comme une coupe au-dessus du fleuve, verse sur les eaux sa clarté. Nous avons accosté au flanc d’une île ; le projecteur du navire éclaire fantastiquement le maquis. La forêt vibre toute d’un constant crissement aigu. L’air est tiède. Mais bientôt les feux du Largeau s’éteignent. Tout s’endort.
26 septembre.
Nous approchons de Bangui. Joie de revoir un pays dégagé des eaux. Les villages, ce matin, se succèdent le long de la rive, d’aspect moins triste, moins délabrés. Les arbres, dont plus aucun taillis ne cache la base, paraissent plus hauts. Bangui, qu’on aperçoit depuis une heure, s’étage jusqu’à mi-flanc de la très haute colline qui se dresse devant le fleuve et incline son cours vers l’est. Maisons riantes, à demi cachées par la verdure. Mais il pleut, une pluie qui va bientôt devenir diluvienne. Les paquets sont faits, les cantines sont refermées. Dans un quart d’heure nous aurons quitté le Largeau.
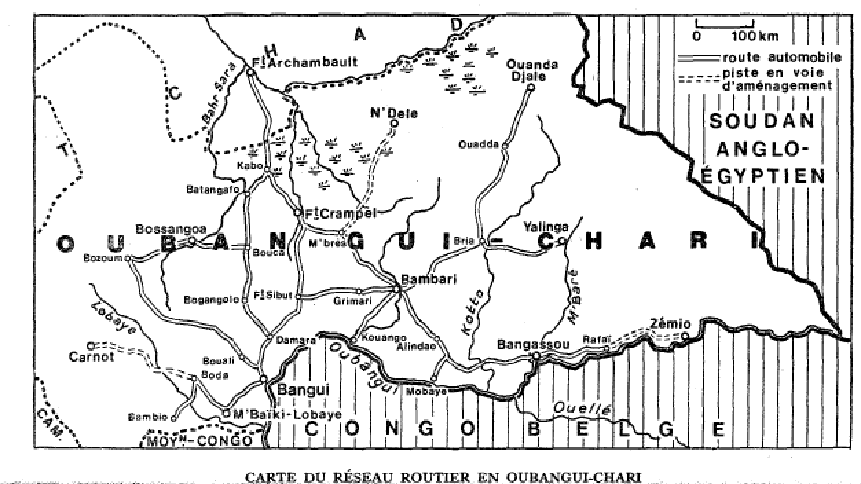
CHAPITRE III – En automobile
10 heures.
M. Bouvet, chef de cabinet, monte à bord pour nous saluer de la part du Gouverneur qui nous attend à déjeuner. Laissant nos bagages aux soins de notre boy Adoum, nous prenons place dans deux autos et, sous la pluie qui ne cesse pas, l’on nous mène aux deux cases qui nous ont été réservées. Celle de Mme de Trévise est charmante ; la nôtre, très agréable, vaste et bien aérée. J’écris ces lignes tandis que Marc est allé s’occuper de notre bagage. Dans un grand fauteuil de jonc, près d’une fenêtre ouverte, je regarde l’averse noyer le paysage ; puis me replonge dans le Master of Ballantrae.
28 septembre.
Très réconfortante conversation avec le Gouverneur Lamblin, qui nous invite à prendre avec lui tous nos repas. Combien me plaît cet homme modeste, dont l’œuvre admirable montre ce que pourrait obtenir une administration intelligente et suivie.
Visite aux villages du bord du fleuve, en aval de Bangui. Je regarde longuement la préparation de l’huile de palme, cette première huile qu’on extrait de la pulpe ligneuse. Une autre huile[13] sera plus tard extraite de l’amande, après écrasement du noyau. Mais d’abord il s’agit de séparer celui-ci de la pulpe qui l’enveloppe. Pour cela l’on fait bouillir la graine, puis on la pile dans un mortier, avec le manche du pilon qui offre si peu de surface que la coque dure fuit de côté tandis que son enveloppe froissée se détache. Elle forme bientôt une étoupe couleur safran qui, pressée entre les doigts, laisse échapper son huile. Les femmes qui se livrent à ce travail se récompensent en chiquant le tourteau. Tout cela n’est pas bien intéressant à dire (encore que fort intéressant à observer) ; j’abandonne le reste aux manuels.
Partis en auto ce matin à 9 heures pour les chutes de la M’Bali. Une camionnette nous accompagne, avec notre attirail de couchage, car nous ne devons rentrer que le lendemain. Mme de Trévise, que sa mission appelait à Bambari, a obtenu, pour nous accompagner, que son départ soit remis de deux jours. Route admirable ; ce mot revient souvent sous ma plume, surtout après une nuit de bon sommeil. Je me sens le cœur et l’esprit légers, point trop bête, et tout ce que je vois me ravit. La route s’enfonce bientôt sous une futaie très haute, spacieuse. Le tronc des arbres, que n’engonce plus le taillis, apparaît dans toute sa noblesse. Ils sont extraordinairement plus grands que nos arbres d’Europe. Nombre d’entre eux portent, au point d’épanouissement de leur ramure – car le fût s’élance sans branche aucune et d’un seul jet jusqu’au couronnement de verdure – d’énormes fougères épiphytes vert pâle, semblables à des oreilles d’éléphant. Tout le long de la route, des groupes d’indigènes, hommes et femmes, s’empressent vers la ville, portant sur la tête les produits de leur lointain village : manioc, farine de mil, on ne sait, dans de grands paniers recouverts de feuilles. Tous ces gens, à notre passage, se mettent au port d’arme et font le salut militaire, puis, pour peu qu’on leur réponde, poussent des grands cris et des éclats de rire. Si j’agite ma main vers des enfants, en traversant un des nombreux villages, c’est un délire, des trépignements frénétiques, une sorte d’enthousiasme joyeux. Car la route, au sortir de la forêt, s’engage dans une région très cultivée, où tout semble prospère, où le peuple paraît heureux.
Nous nous arrêtons pour déjeuner, à l’extrémité d’un des plus importants villages, dans la case des passagers[14], et bientôt, tout le long de la balustrade qui ceinture la case, le troupeau des enfants se rassemble ; j’en compte quarante. Ils restent à nous regarder manger, comme la foule, au Jardin d’Acclimatation, se presse pour assister au repas des otaries. Puis, peu à peu, encouragés par nous, ils s’enhardissent, envahissent l’enceinte, et viennent se grouper contre nous. L’un deux, qui s’agenouille devant ma chaise, porte une grande plume au sommet de la tête, à la manière des Mohicans.
Avant le déjeuner, nous avions été, sous un soleil de feu, jusqu’à un autre village, dépendant du premier, le touchant presque, dans une clairière de la forêt : village si beau, si étrange qu’il nous semblait trouver ici la raison de notre voyage, entrer au cœur de son sujet.
Et, peu de temps avant la halte, il y avait eu un étonnant passage de rivière. Un peuple de noirs était sur la berge ; en face, sur l’autre rive, un autre peuple attendait. Trois grandes pirogues conjuguées forment bac ; sur le plancher qui les rejoint, les deux autos s’installent. Un câble de métal, dont s’emparent les nautoniers, est tendu d’une rive à l’autre et permet de résister à la violence du courant.
Les chutes de la M’Bali, si l’on était en Suisse, d’énormes hôtels se seraient élevés tout autour. Ici, la solitude ; une hutte, deux huttes au toit de paille, où nous allons coucher, ne déparent pas la sauvage majesté du pays. À cinquante mètres de la table où j’écris, la cascade, grand rideau vaporeux qu’argente la clarté de la lune entre les branches des grands arbres.
Bouali, 29 septembre.
Première nuit dans le lit de camp, où l’on dort mieux que dans aucun autre. Au lever du soleil, la chute d’eau, que dore le rayon oblique, est de la plus grande beauté. Un vaste îlot de verdure divise le courant et l’eau forme vraiment deux cascades, disposées de telle sorte qu’on ne les puisse contempler à la fois. Et l’on reste surpris lorsqu’on comprend que celle que l’on admire ne doit sa majesté, son ampleur, qu’à la moitié des eaux du fleuve. Celle que l’on découvre en s’approchant du bord, et que cachait un repli des roches, reste dans l’ombre et comme enfouie à demi sous l’abondance de la végétation. Arbustes et plantes d’aspect, à vrai dire, fort peu exotique et, sans un étrange îlot de pandanus aux racines aériennes, un peu en amont de la chute, rien ne rappellerait ici qu’on est presque au cœur de l’Afrique.
Soir du même jour. Bangui.
Retour sans autre épisode qu’une tornade, qui nous surprend heureusement tandis que nous achevions de déjeuner au même poste et aussi agréablement que la veille. Le vent subit abat un petit arbre près de nous. Pluie diluvienne pendant près d’une heure, que nous occupons à organiser des jeux avec le peuple d’enfants qui nous entoure. Exercices de gymnastique, chants et danses. Tout se termine par un grand monôme. J’oubliais de dire que d’abord il y avait eu des baignades sous la pluie qui ruisselait du toit, de sorte que les premiers exercices avaient pour but de réchauffer les enfants un peu transis au sortir de la douche.
Bangui, 30 septembre.
Départ de Mme de Trévise avec le docteur Bossert. Ils vont expérimenter, dans la région de Grimari, l’action préventive du « 309 Fourneau », sur la maladie du sommeil. Le Gouverneur Lamblin nous propose une tournée en auto, de deux semaines[15]. La région très cultivée, que nous nous proposons de retraverser plus tard à pied, il souhaite que nous la voyions avant la récolte, de manière à mieux juger de sa prospérité. Il ne peut nous accompagner lui-même, mais son chef de cabinet, M. Bouvet nous fera les honneurs du pays.
1er octobre.
L’auto qui doit nous emmener rentre de Fort-Sibut en mauvais état. Des réparations nous retiennent à Bangui jusqu’à six heures. La camionnette qui nous suit est à ce point encombrée de bagages, que nos deux boys doivent se mettre « en lapin » dans notre auto. La nuit tombe vite et nous n’avons pas de phares ; mais bientôt la pleine lune qui monte dans un ciel très pur, nous permet de continuer notre route. J’admire la résistance de notre chauffeur, le brave Mobaye, un indigène formé par Lamblin. Il rentrait à peine d’une très fatigante tournée ; il repart sans avoir pris aucun repos. À plusieurs reprises nous lui demandons s’il ne préfère pas que nous couchions en route, à la prochaine étape. Il fait signe que non, qu’il peut « tenir ». Et nous ne nous arrêtons que, vers minuit, le temps de dévorer un insuffisant petit poulet, arrosé de pinard sur une table vite dressée au milieu de la route, au clair de lune. Arrivons à Fort-Sibut à 3 heures du matin, fourbus. Trop fatigués pour dormir.
2 octobre.
Par une heureuse chance nous tombons à Sibut le jour du marché mensuel. Affluence des indigènes ; ils apportent, dans de grands paniers, leur récolte de caoutchouc (de céaras, dont les récentes plantations, grâce à l’initiative de Lamblin, couvrent les régions en bordure des routes), sous forme des lanières jaunâtres, semblables à des nids d’hirondelles, ou à des algues séchées. Cinq commerçants, accourus en autos, attendent l’ouverture du marché. La région n’a pas été concédée ; le marché reste libre[16] et les enchères sont ouvertes. Nous sommes surpris de les voir s’arrêter aussitôt. Mais l’on ne tarde pas à comprendre que ces messieurs sont « de mèche ». L’un deux se porte acquéreur de la totalité de la récolte, à raison de sept francs cinquante le kilo ; ce qui peut paraître un prix fort raisonnable à l’indigène qui ne vendait le caoutchouc, récemment encore, que trois francs ; mais à Kinshassa, où les commerçants le revendent, les cours se maintiennent depuis quelque temps entre trente et quarante, ce qui laisse une jolie marge. Que vont donc faire ces messieurs ? Sitôt l’affaire conclue avec l’indigène, ils se réunissent à huis clos dans une petite salle, où commencent d’autres enchères, dont ne profitera pas l’indigène, dont ils sauront se partager entre eux le bénéfice. Et l’administrateur reste impuissant devant des enchères clandestines qui, pour paraître illicites, ne tombent pourtant pas sous le coup de la loi, paraît-il.
Ces petits commerçants, jeunes pour la plupart, n’ont souvent qu’une existence assez hasardeuse et précaire, sans magasins propres et, partant, sans frais généraux. Ils sont venus dans le pays avec l’idée bien arrêtée d’y faire fortune, et rapidement. Au grand dam de l’indigène et du pays, ils y arrivent.
De Fort-Sibut à Grimari, pays un peu monotone ; sur le bord de la route, plantations presque continues de céaras ; ceux de plus de quatre ans forment déjà de beaux ombrages ; ce n’est qu’à cet âge que l’on commence à les saigner à des périodes déterminées. Cette opération, qui les épuise assez vite, laisse le long du tronc de longues cicatrices obliques.
Parfois un petit cours d’eau coupe la plaine ; c’est alors, dans le vallonnement, un étroit rappel de forêt où règne une fraîcheur exquise. De très beaux papillons hantent les endroits ensoleillés des rives.
Bambari, 3 octobre.
Bambari est situé sur une élévation de terrain d’où l’on domine toute la contrée, par-delà la Ouaka qui coule à trois cents mètres du poste, et que nous avons traversée en bac hier soir. Ce matin, visites à l’école et au dispensaire. C’est le jour du marché mensuel. Nous nous y rendons, curieux de voir si ces messieurs d’hier y viendront et si le même scandale s’y reproduira. Mais aujourd’hui n’a lieu que la pesée ; à demain les enchères. Le caoutchouc se payait ici seize francs cinquante le mois dernier, nous dit-on.
Marché de Bambari. 5 octobre.
Les enchères montent à 18 francs pour un caoutchouc de qualité égale à celui que nous avons vu vendre 7 fr. 50 la veille. M. Brochet, représentant de la Compagnie du Kouango, important commerçant établi à Bambari, tient tête aux trafiqueurs. L’un de ceux-ci, qui sait que Brochet désire la récolte et veut du moins la lui faire payer cher, pousse l’enchère. Mais Brochet abandonne brusquement, et l’autre se trouve quinaud, car il en a pour plus gros que sa bourse ; de sorte qu’ensuite il doit revendre le tout à Brochet.
Bangassou, 8 octobre.
Je n’ai pu trouver le temps de rien noter ces derniers jours. Le pays a changé d’aspect. De très étranges mamelons mouvementent la plaine ; sortes de collines basses, régulièrement arrondies, dômes que M. Bouvet nous dit formés par d’anciennes termitières. Et je ne vois point quelle autre explication donner à ces soulèvements du sol. Mais ce qui me surprend, c’est de ne voir dans toute la contrée aucune termitière monumentale récente ; celles, immenses, dont ont pu se former ces tumulus, doivent, désertées depuis longtemps, vraisemblablement être vieilles de plusieurs siècles ; l’action des pluies n’a pu que très lentement désagréger ces sortes de châteaux forts ou de cathédrales aux murs quasi verticaux et durs comme de la brique, que j’admirais dans la forêt des environs d’Eala. Ou bien est-ce là l’œuvre de termites d’une race différente ? Et ces termitières ont-elles été de tout temps arrondies ? Toutes, pourtant, semblent déshabitées depuis longtemps. Pourquoi ? Il semble qu’une autre race de termites à petites constructions soit ici venue occuper le sol à la place des termites monumentaux. Certains de ces tumulus, que je vois un peu plus tard tranchés net pour laisser passer la route, montrent leur mystère intérieur : couloirs, salles, etc. Je peste contre l’auto qui ne me laisse pas le loisir d’examiner un peu mieux cela.
Tout le long de la route, sur un parcours de 50 kilomètres, suite presque ininterrompue de villages, et de cultures des plus variées : céaras, riz, mil, maïs, ricin, manioc, coton[17], sésame, café, taro (grand arum aux rhizomes comestibles), palmiers à huile et bananiers. Des deux côtés bordée de citronnelles, la route semble une allée de parc. Et, cachée à demi dans le feuillage, tous les trente mètres environ, une hutte de roseaux en forme de casque à pointe. Ces cités-jardins, étalées le long de la route, forment un décor sans épaisseur. La race qui les habite et les surpeuple n’est pas très belle ; soumise depuis deux ans seulement, elle vivait éparse dans la brousse ; les vieux demeurent farouches ; accroupis à la manière des macaques, c’est à peine s’ils regardent passer la voiture ; l’on n’obtient d’eux aucun salut[18]. Par contre les femmes accourent, secouant et brinquebalant leurs balloches ; le sexe ras, parfois caché par un bouquet de feuilles, dont la tige, ramenée en arrière et pincée entre les fesses est rattachée à la ceinture, puis retombe ou se dresse en formant une sorte de queue ridicule. Quantité d’enfants ; certains, à l’approche de la voiture, courent s’asseoir ou se coucher au milieu de la route ; par jeu ? par défi ? Bouvet croit à de la curiosité : « Ils veulent voir comment ça marche. »
Le 6 nous avons couché à 20 kms de Mobaye, où nous préférions ne pas arriver à la nuit. Devant le gîte d’étape de Moussareu, ahurissant tam-tam ; d’abord à la clarté de photophores, tenus à bras tendus par nos boys ; puis au clair de la pleine lune. D’admirables chants alternés rythment, soutiennent et tempèrent l’enthousiasme et la frénésie du pandémonium. Je n’ai rien vu[19] de plus déconcertant, de plus sauvage. Une sorte de symphonie s’organise ; chœur d’enfants et soliste ; la fin de chaque phrase du soliste se fond dans la reprise du chœur. Hélas ! notre temps est compté. Nous devrons repartir avant le jour.
Le 7, au petit matin, nous ne quittons ce poste qu’avec l’espoir d’y revenir dans quelques mois, à notre retour d’Archambault. L’aube argentée se mêle au clair de lune. Le pays devient accidenté ; collines rocheuses de 100 à 150 mètres de haut, que contourne la route. Nous arrivons à Mobaye vers 10 heures.
Le poste est admirablement situé sur les bords du fleuve qu’il domine. En amont, les rapides de l’Oubangui, dont les hautes eaux inondent presque, sur la rive belge, un charmant petit village de pêcheurs qu’abrite un groupe de palmiers.
Le docteur Cacavelli nous fait visiter son dispensaire-hôpital. Les malades viennent de villages parfois lointains se faire opérer de l’éléphantiasis des parties génitales, très fréquent dans ces régions. Il nous présente quelques cas monstrueux qu’il se dispose à opérer ; et l’on reste saisi de stupeur, sans comprendre aussitôt ce que peut bien être ce sac énorme, que l’indigène trimballe sous lui… Comme nous nous étonnons, le docteur Cacavelli nous dit que les éléphantiasis que nous voyons ici ne pèsent sans doute pas plus de 30 à 40 kg. Les masses de tissu conjonctif hypertrophié, dont il débarrasse les patients, atteignent parfois 70 kg, s’il faut l’en croire. Il aurait même opéré un cas de 82 kg. « Et, ajoute-t-il, ces gens trouvent encore le moyen de faire, à pied, quinze à vingt kilomètres pour venir se faire soigner. » J’admets, sans plus pouvoir comprendre.
Un des malades de ce matin, tout jeune encore, a tenté de s’opérer lui-même et s’est abominablement charcuté, lardant de coups de couteau cette poche affreuse, qu’il croyait pleine de pus et espérait pouvoir vider.
– « Ce qu’il y a dedans ? Vous voulez le voir ? » Et Cacavelli nous mène, près de la table d’opération, devant un baquet presque plein d’une sorte de maton sanguinolent et blanchâtre, premier résultat du travail de ce jour. Bien faite, nous dit-il, l’opération respecte et ménage la virilité du patient, enfouie dans l’excès du tissu conjonctif, mais nullement endommagée. Et c’est ainsi que depuis trois ans il a fait recouvrer la puissance procréatrice à 236 impotents.
– « Allons, 237 ; approchez »…
Nous le quittons bien vite, désireux de garder quelque appétit.
Sitôt après déjeuner, départ pour Foroumbala. Pays mouvementé mais pas très intéressant. Le peuple des villages traversés est laid. L’auto fait fuir quelques pintades. Un effrayant orage menace ; mais se détourne au dernier moment. Arrivée à Foroumbala vers 5 heures. Poste inoccupé[20], belle position sur la Kotto ; quelques arbres admirables. Sur la place ombragée, devant le gîte d’étape, les enfants de l’école ; comme on leur apprend à filer, chacun tient une petite quenouille d’où pend, comme une araignée au bout de son fil, la bobine qu’un coup de pouce fait tourner. Tous en rang, le sourire aux lèvres, on s’attend à les entendre entonner un chœur de Gounod. Puis, exercices de gymnastique sous la surveillance d’un maître indigène. Puis, football très joyeux auquel nous prenons part ; une orange tient lieu de ballon. Ces enfants parlent tous un peu le français.
Je les retrouve après dîner qui dansent à la clarté d’un feu de paille, avec les femmes des miliciens absents. Un de ces enfants, d’aspect très misérable, se tient dans l’ombre, loin des autres ; comme la nuit est un peu froide et qu’il semble grelotter, je le fais s’approcher du feu. Mais les autres aussitôt s’écartent. C’est un lépreux. Chassé de son village[21], à trois jours de marche, il ne connaît ici personne. Marc qui me rejoint me dit l’avoir rencontré déjà, et lui avoir donné à manger. Même il a laissé à une femme indigène de quoi assurer la nourriture de ce petit paria pour huit jours ; la femme a promis d’y veiller. Nous devons repasser par ici et saurons si elle a tenu sa promesse. Mais hélas ! si l’enfant ne doit pas guérir, que sert de prolonger sa triste vie…
Le 8, sitôt au sortir de Foroumbala, traversée en barque de la Kotto débordée. Assez vastes champs de coton coupés de champs de manioc, carrés et réguliers comme nos cultures de France. Par places, quantité de gourdes parfaitement rondes, comme des coloquintes, de la grosseur d’un œuf d’autruche, jonchent le sol ; sortes de courges dont, nous dit-on, les indigènes mangent la graine.
Tandis que l’on approche de Bangassou, l’on commence à rencontrer des gens coiffés de façon extrêmement bizarre : un côté de la tête est rasé, l’autre couvert de petites tresses flottantes, ramenées en avant. Ce sont des N’Zakaras, une des tribus les plus intéressantes des Sultanats.
Bangassou, 8 octobre.
J’écris ces lignes sous la véranda de notre case. Bangassou me déçoit un peu. La ville se ressent sans doute de l’occupation militaire et a beaucoup perdu de son étrangeté. Mauvaise journée. J’ai commencé par me casser une dent ; puis, extraction pénible d’une chique monstre, qui me laisse le pied tout endolori. J’ai mal à la tête et la visite à la mission américaine où m’entraîne M. Bouvet, m’exténue. Interminable déjeuner chez M. Eboué, chef de la circonscription, originaire de la Guyane, (auteur d’une petite grammaire sango que je travaille depuis huit jours) homme remarquable et fort sympathique… Mais mon mal de tête augmente ; je grelotte ; c’est un accès de fièvre ; je rentre me coucher, laissant Marc aller seul au tam-tam que va bientôt disperser une formidable tornade.
9 octobre.
J’ai pu dormir et me sens assez dispos ce matin pour accompagner mes compagnons à Ouango. Poste pittoresquement situé sur une élévation qui domine un coude du M’Bomou (nom que prend l’Oubangui dans son cours supérieur). M. Isambert, qui l’administre, vient de se convertir au protestantisme et occupe son peu de loisirs à poursuivre des études d’exégèse et de théologie. Je suis trop fatigué, malheureusement, pour pouvoir causer avec lui comme je le voudrais. Du reste, et de plus en plus, toute conversation m’exténue. Je fais semblant. On ne parvient à s’entendre que sur le plus banal, ou le « matter of fact », et encore. J’ai du mal à finir mes phrases, tant est grande ma crainte que celles où j’exprimerais vraiment ma pensée, ne puissent trouver un écho.
Ici toutes les femmes qui viennent danser au tam-tam sont vêtues de cotonnades aux couleurs vives et seyantes, formant corsages et jupes. Toutes sont propres, ont le visage riant, l’air heureux. Devons-nous en conclure que tout ce peuple noir n’attend qu’un peu d’argent pour se vêtir[22] ?
10 octobre.
Je me sens assez bien pour me lancer dans la longue course de Rafaï à laquelle je me désolais de devoir renoncer. Le sultanat de Rafaï est le dernier de l’Oubangui-Chari qui ait encore son sultan. Avec Hetman (qui a pris le pouvoir en 1909) s’éteindra définitivement le régime. On laisse à celui-ci un semblant de cour et de pouvoir. Il est inoffensif. Il accepte la situation en souriant et ne revendique le pouvoir pour aucun de ses fils. Le gouvernement de l’A. E. F. a inventé pour lui un bel uniforme d’opérette qu’il semble revêtir volontiers. Les trois aînés de ses fils ont fait un an d’étude dans l’île de Gorée, en face de Dakar (où les fils de chefs et de notables indigènes reçoivent une éducation française, en prévision d’un commandement) ; l’un d’eux est à Bangui, le second sert dans l’armée à Fort-Lamy ; le troisième, qui n’a pas vingt ans, est revenu à Rafaï où il reste auprès de son père. C’est un grand garçon timide, qui vient nous serrer la main, puis se retire. La résidence du sultan est sur une éminence qui fait face à celle du poste. Nous nous y rendons en auto, deux heures après notre arrivée. (Mais déjà le sultan nous avait devancés et s’était assis quelques instants sur notre terrasse). Sur le plateau, c’est d’abord une grande esplanade où un peuple, qui fait haie d’un seul côté de la route, nous acclame. Puis on entre dans la sorte de zaouïa où se tiennent les familiers du sultan.
11 octobre.
Le sultan vient nous dire adieu, flanqué de toute sa maisonnée et de son escorte ordinaire. Assez piteux spectacle de cette cour déchue. Quelques joueurs de flûte, survivants derniers de sa splendeur, semblent sortir d’une mascarade. Les flûtes verticales sont ornées de deux ceintures de longs poils, qui s’épanouissent en corolles dès que l’on souffle dans l’instrument.
Le poste même de Rafaï, abandonné depuis six mois par insuffisance de personnel, est délabré ; l’aspect des pièces est sordide ; vastes et agréablement disposées, mais emplies d’un rubbish innommable, instruments détériorés, meubles vermoulus et brisés, le tout épaissement recouvert de poussière. On coucherait sous la véranda, n’étaient les panthères qui, nous dit-on, ne craignent pas de venir dans le village et qui récemment ont dévoré un indigène dans sa case, à cinquante mètres du poste.
Pourtant nous ne quitterons Rafaï qu’à regret. La terrasse où s’étend le jardin du poste, dominant le cours majestueux du Chinko, est très belle. Je crois même que je la préfère à celle de Ouango.
12 octobre.
Retour de Rafaï[23]. Arrêt à Bangassou d’où nous sommes repartis ce matin. Nous couchons de nouveau à Foroumbala ; les voitures ont besoin d’être nettoyées. Le poste est agréable ; mais le peuple galeux à l’excès. Mon pied me fait mal et je ne puis me chausser. Forcé de demeurer assis, je continue le Master of Ballantrae.
Le petit orphelin lépreux, abandonné de tous, à qui Marc avait assuré huit jours de manioc (mais la femme qui devait le nourrir n’a pas tenu parole)… de ma vie je n’ai vu créature plus misérable.
Bambari, 13 octobre.
Hanté par le souvenir du petit lépreux, par le son grêle et comme déjà lointain de sa voix – de Foroumbala à Alindao, où nous déjeunons ; puis à Bambari où nous n’arrivons qu’à la nuit tombante (soit dix heures de Ford) maints menus accidents tout le long de la route ; pannes diverses ; un pont crève sous nous et je ne sais comment nous ne culbutons pas dans la rivière.
Bambari, 14 octobre.
Ce matin, dès l’éveil, danse des Dakpas[24]. Vingt-huit petits danseurs, de 8 à 13 ans, badigeonnés de blanc de la tête aux pieds ; coiffés d’une sorte de casque que hérissent une quarantaine de dards noirs et rouges ; sur le front une frange de petits anneaux de métal. Chacun tient à la main un fouet fait en jonc et cordes tressées. Certains ont les yeux encerclés d’un maquillage en damier noir et rouge. Une courte jupe en fibre de rafia complète cet accoutrement fantastique. Ils dansent en file indienne, gravement, aux sons de vingt-trois trompes de terre ou de bois d’inégales longueurs (trente centimètres à un mètre cinquante) dont chacune ne peut donner qu’une note. Une autre bande de douze Dakpas, plus âgés, ceux-ci tout noirs, déroule ses évolutions en sens inverse de la première. Une douzaine de femmes se mêlent bientôt à la danse. Chaque danseur avance à petits pas saccadés qui font tinter les bracelets de ses chevilles. Les joueurs de trompe forment cercle ; au milieu d’eux une vieille femme bat la mesure avec un plumeau de crins noirs. À ses pieds un grand démon noir se tord dans la poussière, en proie à de feintes convulsions, sans cesser de souffler dans sa trompe. Le vacarme est assourdissant, car, dominant le beuglement des trompes, tous, à la seule exception des petits danseurs blancs, chantent, hurlent à tue-tête, inlassablement, un air étrange (que par ailleurs j’ai noté).
Départ vers deux heures pour les Moroubas. Beau temps. Peuple très beau ; enfin des peaux nettes et saines. Très beau village. Les cases rondes seraient toutes semblables, n’étaient les peintures qui les décorent extérieurement ; sortes de fresques sommaires à trois couleurs, noir, rouge et blanc, représentations schématiques, parfois élégantes, d’hommes, d’animaux et de voitures automobiles. Ces décorations sont abritées par le toit de chaume, qui déborde amplement, couvrant une sorte de couloir circulaire tout autour de la case.
Admirables graminées, des deux côtés de la route, semblables à des avoines gigantesques, en vieil argent doré.
En pleine brousse, émouvante rencontre du Gouverneur Lamblin.
Une heure plus tard ; nous retrouvons, à vingt kilomètres des Moroubas où nous devons passer la nuit, Mme de Trévise et le docteur Bossert, fort occupés à recenser les indigènes qu’ils viennent de vacciner.
15 octobre.
Coucher aux Moroubas[25].
Lamblin, hier, nous a conseillé de pousser jusqu’à Fort-Crampel, au lieu de gagner directement Fort-Sibut.
La contrée change d’aspect : forêt clairsemée ; arbres pas plus hauts que les nôtres, ombrageant de hautes graminées, et une nouvelle sorte de fougère. Déjeuner aux M’Bré. Paysage très pittoresque, entouré de rochers ; on se croirait aux environs de Fontainebleau. De mon premier coup de fusil, j’abats un grand vautour, perché tout au sommet d’un arbre mort. N’ayant encore jamais chassé, je suis émerveillé de ce succès[26].
Entre les M’Bré et Fort-Crampel, rencontre d’une bande de cynocéphales ; ils se laissent approcher de très près ; quelques-uns sont énormes.
Villages assez beaux, mais très pauvres. Dans l’un d’eux, une soixantaine de femmes pilonnent les rhizomes à caoutchouc en chantant ; travail interminable, très misérablement rémunéré.
À Fort-Crampel, une formidable et subite tornade, à la tombée de la nuit, couche bas quantité de céaras fragiles, dont on voit s’envoler au loin les ramures, tout autour du poste et particulièrement entre notre gîte et la demeure de M. Griveau, l’administrateur chez qui nous dînons. La tornade nous surprend au moment où nous traversons cet espace. Elle est si violente qu’emportés à demi par le vent, aveuglés par les éclairs et par l’averse, nous nous trouvons séparés Marc et moi, comme dans un film de Griffith, et, tout submergés, ne parvenons à nous rejoindre qu’au poste.
Adoum et Outhman, qui ont retrouvé ici des amis d’Abécher, demandent, à notre retour, une permission de nuit et s’en vont festoyer dans le village arabe, sur l’autre rive de la Nana. Nous ne les entendons pas rentrer ; mais, au petit jour, ils sont à l’œuvre, cuisant le pain, repassant notre linge, etc.
Fort-Sibut, 16 octobre.
Violente tornade à mi-route. Les changements de paysage (je veux dire : de l’aspect du pays) sont très lents à se produire ; sinon à l’approche du moindre cours d’eau, marigots, dévalements, où reparaissent soudain les très grands arbres à empattements, à racines aériennes, l’enchevêtrement des lianes, et tout le mystère humide du sous-bois. Durant de longs espaces, entre deux « galeries forestières », les bois peu élevés, les taillis, sont à ce point couverts de plantes grimpantes, qu’on ne distingue plus qu’une sorte de capiton continu. Ces intumescences vertes ne s’interrompent que pour faire place à des cultures de maïs ou de riz, lesquelles dégagent le tronc des arbres demeurés abondants parmi la culture ; quantité de ces arbres sont morts, d’une mort qui ne semble pas toujours due à l’incendie. Même dans les marigots, de larges groupes d’arbres morts m’intriguent. Leur écorce, souvent, est complètement tombée, et l’arbre prend l’aspect d’un perchoir à vautours. Je doute si, dans quelques années, ce déboisement continu, systématique et volontaire, ou accidentel, n’amènera pas de profonds changements dans le régime des pluies.
Toujours des saluts enthousiastes de femmes et d’enfants à la traversée des villages. Tous accourent ; les enfants s’arrêtent net sur le rebord du fossé de la route et nous font une sorte de salut militaire ; les plus grands saluent en se penchant en avant, comme on fait dans les music-halls, le torse un peu de côté et rejetant la jambe gauche en arrière, montrant toutes leurs dents dans un large sourire. Lorsque, pour leur répondre, je lève la main, ils commencent par prendre peur et s’enfuient ; mais dès qu’ils ont compris mon geste (et je l’amplifie de mon mieux, y joignant tous les sourires que je peux) alors ce sont des cris, des hurlements, des trépignements, de la part des femmes surtout, un délire d’étonnement et de joie que le voyageur blanc consente à tenir compte de leurs avances, y réponde avec cordialité.
17 octobre.
Lever dès 4 heures. Mais il faut attendre les premières lueurs de l’aube pour partir. Que j’aime ces départs avant le jour ! Ils n’ont pourtant pas, dans ce pays, l’âpre noblesse et cette sorte de joie farouche et désespérée que j’ai connue dans le désert.
Retour à Bangui vers 11 heures.
APPENDICE AU CHAPITRE III
Le réseau routier établi en Oubangui-Chari par le Gouverneur Lamblin, depuis qu’il a pris en main la direction de la colonie en 1917, est de 4 200 kms.
Au Gabon, le grand nombre de Gouverneurs qui s’y sont succédé, n’a pas su donner à cette colonie plus de 12 kms de routes (praticables pour l’automobile). Aussi voyons-nous sévir encore dans cette contrée les obligations du portage.
Je sais bien que le Gouverneur Lamblin a été particulièrement servi par la nature du terrain et le peu de relief du sol. Mais, quoi que ce soit de grand que l’homme entreprenne, il peut sembler toujours, après l’accomplissement, avoir été « servi » par quelque chose. Le plus remarquable, dans cet énorme travail entrepris, c’est qu’il a été mené à bien sans l’assistance des ingénieurs, agents-voyers, etc.[27] Les budgets très restreints de la colonie ne pouvaient faire face aux dépenses qu’auraient entraîné les conseils et la direction des techniciens. J’admire le Gouverneur Lamblin pour avoir fait confiance aux indigènes et s’être persuadé qu’ils pourraient suffire aux difficiles travaux qu’il leur proposait. Les équipes qu’il a formées ont fait leurs preuves ; elles ont montré que l’ingéniosité et l’industrie des noirs savent être à la hauteur d’un travail dont ils comprennent le but et l’utilité. Si le nombre des journées de prestation a parfois été dépassé, peu m’importe ; l’indigène lui-même ne proteste pas contre un travail dont il est le premier à recueillir le bénéfice. (Il accepte moins volontiers, par contre, de se soumettre à ce travail dans les régions où il sait que les routes, périodiquement inondées, et par conséquent sans cesse à refaire, ne le récompenseront jamais de ses peines. Ce sont les régions précisément où, d’autre part, le transport fluvial est praticable.)
Pour comprendre à quelle agonie le réseau routier de l’Oubangui-Chari a mis fin, il n’est que de se reporter à la situation faite aux indigènes par le régime obligatoire du portage.
Nous lisons dans un rapport de 1902 :
« Depuis plus d’un an la situation devient de jour en jour plus difficile. Les Mandjias épuisés n’en peuvent plus et n’en veulent plus. Ils préfèrent tout, actuellement, même la mort, au portage…
« Depuis plus d’un an la dispersion des tribus est commencée. Les villages se désagrègent, les familles s’égaillent, chacun abandonne sa tribu, son village, sa famille et ses plantations, va vivre dans la brousse comme un fauve traqué, pour fuir le recruteur. Plus de cultures, partant plus de vivres… La famine en résulte et c’est par centaines que, ces derniers mois, les Mandjias sont morts de faim et de misère… Nous en subissons nous-mêmes le rude contrecoup ; Fort-Crampel est plus que jamais menacé de se trouver à court de vivres, il est nourri par les postes du Kaga M’Brès et de Batangafo, qui viennent en 5 jours de marche lui porter de la farine et du mil ; d’où, pour chaque porteur de vivres, un déplacement mensuel moyen de 10 à 12 jours de marche.
« Les recruteurs doivent se livrer, pour trouver des porteurs, à une véritable chasse à l’homme, à travers les villages vides et les plantations abandonnées. Il n’est pas de mois où des gardes régionaux, des auxiliaires même du pays, Mandjias à notre service envoyés au recrutement dans leur propre pays, ne soient attaqués, blessés, fréquemment tués et mangés.
« Refoulés partout au Nord, à l’Est, à l’Ouest et au Sud, par nos petits postes “manu militari” pour s’opposer à leur exode en masse au-delà de la Fafa et de l’Ouam, le Mandjia reste caché, comme un solitaire traqué, dans un coin de brousse, ou se réfugie dans les cavernes de quelques « Kafa » inaccessible, devenu troglodyte, vivant misérablement de racines jusqu’à ce qu’il meure de faim plutôt que de venir prendre des charges.
« Tout a été tenté… Il le fallait. (C’est moi qui souligne.) Le ravitaillement prime toute autre considération. Les armes, les munitions, les marchandises d’échange devaient passer. Douceur et encouragements, menaces, violences, répressions, cadeaux, salaires, tout échoue aujourd’hui devant l’affolement terrible de cette race Mandjia, il y a quelques années, quelques mois encore, riche, nombreuse et groupée en immenses villages.
« Quelques mois encore et toute la partie du cercle de Gribingui comprise entre le Gribingui à l’Est, la Fafa à l’Ouest, les Ungourras au Sud et Crampel au Nord, ne sera plus qu’un désert, semé de villages en ruine et de plantations abandonnées. Plus de vivres et de main-d’œuvre ; la région est perdue.
« Si dans un délai très rapproché le portage n’est pas entièrement supprimé, entre Nana et Fort-Crampel au moins, le cercle de Gribingui est irrémédiablement perdu, et il ne nous restera qu’à évacuer un pays désert, ruiné, sans bras et sans vivres… »
Et dans le « rapport de M. l’Administrateur-adjoint Bobichon – sur la situation politique pour les mois de juillet et d’août 1904 » :
« … Dans la zone de Nana, la question du portage devient de plus en plus ardue. Les Mandjias de Nana sont épuisés ; ils font et feront tout pour fuir le portage dont ils ne veulent plus. Ils préfèrent tout actuellement, même la mort, au portage.
« Les groupes se disloquent les uns après les autres sans qu’il soit possible de faire quoi que ce soit pour arrêter ces migrations qui ont fait un vrai désert d’un pays autrefois riche en cultures et où était installé une nombreuse population.
« Cette année, contrairement aux promesses faites antérieurement, la tâche demandée à ces populations, au lieu de diminuer, n’a fait qu’augmenter. Comme supplément de corvée, c’est d’abord le recrutement de nombreux travailleurs pour les travaux de la route, le passage de la relève et de son matériel, un convoi de cartouches qui doit être enlevé en une seule fois, enfin le transport du « d’Uzès ». À cela il faut ajouter des demandes de vivres plus importantes et plus fréquentes, à ces indigènes qui n’ont même pas le nécessaire pour subvenir à leurs propres besoins. Tous ces efforts sont demandés en pleine saison des pluies et au moment où l’indigène a le plus besoin de s’occuper de ses cultures.
« Si nous compulsons les rapports de nos prédécesseurs, nous y trouvons qu’en 1901, 1902 et 1903 un repos de deux mois avait été laissé aux Mandjias pour leur permettre de s’occuper de leurs plantations. Cette année, rien… aucun repos. Ces malheureux meurent de faim et de fatigue ; n’étant jamais chez eux, ils ne peuvent faire de plantations.
« Cet état de choses a été maintes fois exposé dans les rapports de M. l’Administrateur Bruel, commandant de la région, et de mes prédécesseurs MM. Thomasset, de Roll, et Toqué.
« Nous ne sortirons de cette fausse situation qu’en poussant activement les travaux de la route et en commandant sans retard en France le matériel nécessaire aux transports et devant supprimer le portage[28]. »
« Il le fallait… » J’ai souligné plus haut ces mots tragiques.
Il le fallait, pour l’entretien, la subsistance des postes de l’intérieur. Il le fallait, sous peine de laisser péricliter l’œuvre entreprise, et de voir tourner à néant le résultat d’immenses efforts. Le service d’autos, régulièrement organisé, qui rend aujourd’hui le portage inutile, c’est ce portage même, et ce portage seul qui d’abord l’a permis ; car ces autos, il fallait les transporter là-bas, et seuls ont pu les faire parvenir à destination des navires qu’il fallait transporter, démontés, à dos d’hommes, au Stanley-Pool, par-delà les premiers rapides du Congo tout d’abord, puis dans le bassin du Tchad. Ce régime affreux, mais provisoire, était consenti en vue d’un plus grand bien, tout comme les souffrances et la mortalité qu’entraîne nécessairement l’établissement d’une voie ferrée. Le pays entier, les indigènes mêmes, en fin de compte et en dernier ressort, en profitent.
L’on ne peut en dire autant du régime abominable imposé aux indigènes par les Grandes Compagnies Concessionnaires. Au cours de notre voyage, nous aurons l’occasion de voir que la situation faite aux indigènes, aux « Saigneurs de caoutchouc », comme on les appelle, par telle ou telle de ces Compagnies, n’est pas beaucoup meilleure que celle que l’on nous peignait ci-dessus ; et ceci pour le seul profit, pour le seul enrichissement de quelques actionnaires.
Qu’est-ce que ces Grandes Compagnies, en échange, ont fait pour le pays ? Rien[29]. Les concessions furent accordées dans l’espoir que les Compagnies « feraient valoir » le pays. Elles l’ont exploité, ce qui n’est pas la même chose ; saigné, pressuré comme une orange dont on va bientôt rejeter la peau vide[30].
« Ils traitent ce pays comme si nous ne devions pas le garder », me disait un Père missionnaire.
Il n’y a plus ici d’il le fallait qui tienne. Ce mal est inutile et il ne le faut pas.
Par ses plantations de céaras qui permettent aux indigènes de se soustraire aux exigences des Compagnies (puisque celles-ci n’ont pas droit au caoutchouc de culture, mais seulement à celui de brousse), le Gouverneur Lamblin a rendu aux indigènes, et, partant, à la colonie, un aussi grand service que par l’établissement de son réseau routier.
Je lis à l’instant le rapport de M. D. R., président du conseil d’administration de la Société du Haut-Ogooué (assemblée ordinaire du 9 novembre 1926). Je n’ai pas circulé au Gabon et ne connais la lamentable situation du pays que par ouï-dire. Je ne sais rien de la Société du Haut-Ogooué et veux la croire à l’abri de tous reproches, de tous soupçons. Mais j’avoue ne rien comprendre à ces quelques phrases du rapport :
« Un redressement momentané du marché nous a permis de poursuivre nos opérations, et nous nous en sommes réjouis, car sans cette source d’activité économique, la seule existant dans ces régions, nous nous demandons avec anxiété ce que deviendrait le sort des indigènes dont votre Société ne s’est désintéressée à aucun moment de sa longue existence. À qui mettrait en doute cette affirmation, il nous serait facile de répondre par des chiffres officiels et de montrer que la concession de la Société de Haut-Ogooué a été la sauvegarde et est aujourd’hui le réservoir de la population indigène au Gabon[31]. »
Allons, tant mieux ! Cette société diffère donc des autres et fait preuve de louables soucis. Mais, tout de même, aller jusqu’à dire : Que deviendraient sans nous les indigènes ? me paraît faire preuve d’un certain manque d’imagination.
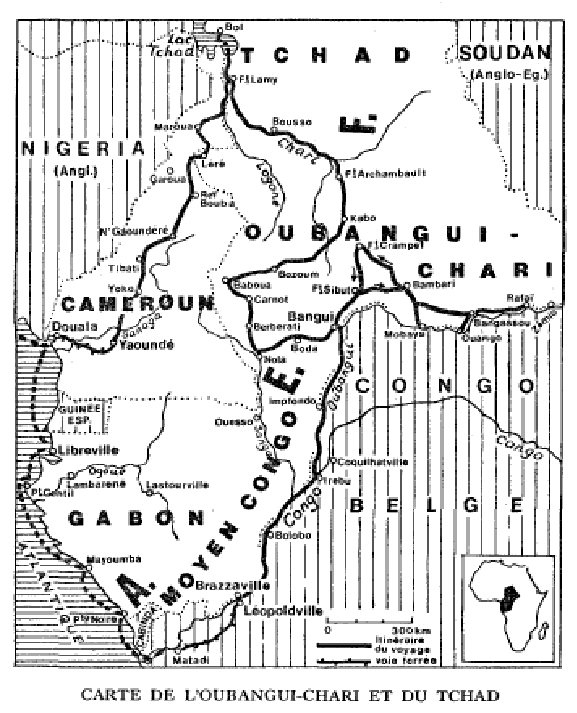
CHAPITRE IV – La grande forêt entre Bangui et Nola
18 octobre.
Matinée brumeuse ; il ne pleut pas, mais le ciel est couvert, tout est gris. Marc me dit : « Pas plus triste qu’en France » ; mais en France un pareil temps vous replie vers la méditation, la lecture, l’étude. Ici, c’est vers le souvenir.
Ma représentation imaginaire de ce pays était si vive (je veux dire que je me l’imaginais si fortement) que je doute si, plus tard, cette fausse image ne luttera pas contre le souvenir et si je reverrai Bangui, par exemple, comme il est vraiment, ou comme je me figurais d’abord qu’il était.
Tout l’effort de l’esprit ne parvient pas à recréer cette émotion de la surprise qui ajoute au charme de l’objet une étrangeté ravissante. La beauté du monde extérieur reste la même, mais la virginité du regard s’est perdue.
Nous devons quitter Bangui définitivement dans cinq jours. À partir de quoi commencera vraiment le voyage. Il est aisé de gagner Archambault, où nous attend Marcel de Coppet, par une route beaucoup plus courte ; et plus aisée surtout ; c’est celle que suivent les colis postaux et les gens pressés : deux jours d’auto jusqu’à Batangafo, et quatre ou cinq jours de bateau. Quittant le bassin de l’Oubangui, on rejoint à Batangafo les eaux qui se jettent dans le lac Tchad ; on n’a qu’à se laisser porter. Mais ce n’est pas cela qui nous tente, et nous ne sommes pas pressés. Ce que nous voulons, c’est précisément quitter les routes usuelles ; c’est voir ce que l’on ne voit pas d’ordinaire, c’est pénétrer profondément, intimement, dans le pays. Ma raison me dit parfois que je suis peut-être un peu vieux pour me lancer dans la brousse et dans l’aventure ; mais je ne le crois pas.
20 octobre.
À la tombée du jour, j’ai repris, seul, hier, cette route qui, sitôt au sortir de Bangui, gagne le haut de la colline en s’enfonçant dans la forêt. Je ne me lasse pas d’admirer l’essor vertigineux de ces fûts énormes et leur brusque épanouissement. Les derniers rayons éclairaient encore leurs cimes. Un grand silence d’abord ; puis, tandis que l’ombre augmentait, la forêt s’est emplie de bruits étranges, inquiétants, cris et chants d’oiseaux, appels d’animaux inconnus, froissements de feuillage. Sans doute une troupe de singes agitait ainsi les ramures non loin de moi, mais je ne parvenais pas à les voir. J’avais atteint le haut de la colline. L’air était tiède ; je ruisselais.
Aujourd’hui je suis retourné aux mêmes lieux, une heure plus tôt. J’ai pu m’approcher d’une troupe de singes et contempler longtemps leurs bonds prodigieux. Capturé quelques papillons admirables.
21 octobre.
En auto jusqu’à M’Baïki, admirable traversée de forêt. L’auto passe trop rapidement. Ce trajet, que nous serons heureux de refaire dans quelques jours, méritait d’être fait à pied[32]. Dans la forêt avoisinant M’Baïki, les arbres sont d’une prodigieuse hauteur. Certains, les fromagers, ont un empattement gigantesque[33]. On dirait les plis d’une robe. On dirait que l’arbre est en marche.
Soulevant l’écorce à demi pourrie d’un fromager abattu, je découvre quantité de grosses larves de coléoptères. Séchées et fumées, elles servent, paraît-il, de nourriture aux indigènes.
À M’Baïki, visite à M. B…, représentant de la Compagnie Forestière. Nous trouvons, assis sous sa véranda, devant des apéritifs, deux Pères missionnaires.
Que ces agents des Grandes Compagnies savent donc se faire aimables ! L’administrateur qui ne se défend pas de leur excès de gentillesse, comment, ensuite, prendrait-il parti contre eux ? Comment, ensuite, ne point prêter la main, ou tout au moins fermer les yeux, devant les petites incorrections qu’ils commettent ? Puis devant les grosses exactions ?
Les huttes des indigènes dans les villages aux environs de M’Baïki, sont très différentes de celles que nous avions vues dans la région des Sultanats ; beaucoup moins belles, moins propres ; souvent même sordides. On reconnaît à ceci que nous ne sommes déjà plus dans l’Oubangui-Chari, où le gouverneur Lamblin exige la réfection des cases indigènes selon un type à peu près unique adopté par l’administration. Certains protestent contre cette indiscrète exigence et voudraient qu’on laissât les noirs construire des cases à leur goût ; mais ces dernières semblent donner raison à Lamblin. Reliées les unes aux autres en une seule longue file, sans doute pour économiser le travail ; murs droits en torchis, maintenus par des bambous horizontaux ; toits très bas. Et peut-être, après tout, ces affreux corons sont-ils également construits par ordre. (Nous ne rencontrerons nulle part, par la suite, villages d’aspect moins exotique, ni plus laids.)
Bangui, 26 octobre.
Grands préparatifs de départ. Nous envoyons directement à Archambault trente-quatre caisses. Les colis qui doivent voyager avec nous prennent place dans deux camionnettes. Adoum monte dans la Ford avec nous. Départ de Bangui à trois heures. La nuit nous surprend en pleine forêt. Malgré le clair de lune, on distingue à peine la route.
Dîner très agréable chez M. Bergos, chef de subdivision de M’Baïki.
27 octobre.
Déjeuner à Boda avec le sinistre Pacha (v. plus loin) et M. Blaud, administrateur de Carnot, qui rentre en France. Pacha n’a pas le sourire. Certainement c’est un malade.
Départ de Boda vers trois heures. Dans les villages que l’on traverse, l’on ne voit que des vieillards, des enfants et des femmes.
La route s’élève lentement. Tout à coup le terrain dévale ; on domine une immense étendue de forêts. La nuit est close quand nous arrivons à N’Goto.
N’Goto est sur une hauteur ; simple pli de terrain, mais qui domine une assez vaste contrée. La Forestière y a un poste ; maison inhabitée que des représentants de la Compagnie nous avaient indiquée comme un endroit possible pour un séjour. Nous sommes plutôt un peu déçus par l’aspect du pays. En outre, nous voulons ne rien devoir à la Forestière. Nous ne songeons qu’à repartir. Mais les autos manquent d’essence et d’huile. Nous nous reposions sur l’assurance que nous avait donnée M. Bergos, que l’on pourrait se ravitailler en route. Rien à Boda ; non plus qu’à N’Goto. Force sera d’abandonner ici deux voitures. Mobaye, le chauffeur de Lamblin, qui déjà nous accompagnait à Rafaï, nous mènera en camion jusqu’au point terminus, avec Zézé notre cuisinier et nos sacs de couchage, puis retournera seul à M’Baïki, chercher l’huile et l’essence qu’il rapportera aux deux autres voitures en panne. Nos deux boys partent en avant vers six heures, avec les soixante porteurs qu’on a mis à notre disposition. Nous les retrouverons, partie au « Grand Marigot », point terminus de la route automobile ; partie à Bambio, où ils arriveront vers midi après avoir marché toute la nuit. C’est ici que va commencer vraiment le voyage.
Invités à dîner par M. Garron, grand chasseur[34], établi depuis quatre mois à N’Goto, qu’il songe à quitter du reste, car la chasse y est peu fructueuse, et il s’y ennuie à périr.
Retirés de bonne heure, nous dormions tous deux d’un profond sommeil, à l’abri de nos moustiquaires, dans la case des passagers. Vers deux heures du matin un bruit de pas et de voix nous réveille. Quelqu’un veut entrer. Nous crions en sango : « Zo nié ? » (Qui est là ?). C’est un important chef indigène, qui déjà s’était présenté durant notre dîner. Craignant alors de nous gêner, il avait d’abord remis au lendemain l’entretien qu’il se promettait d’avoir avec nous ; mais un messager que Pacha, l’administrateur de Boda, lançait à ses trousses venait de lui transmettre l’ordre de regagner aussitôt son village. Il ne pouvait qu’obtempérer. Mais, désolé de voir s’échapper l’espoir qu’il avait eu de nous parler, il avait pris sur lui de venir nous trouver à cette heure indue. Il parlait avec une volubilité extrême, dans une langue dont nous ne comprenions pas un mot. Nous le priâmes de nous laisser dormir. Il reviendrait plus tard, quand nous aurions un interprète. Nous prenions la responsabilité de ce retard, lui promettant de le couvrir auprès du terrible Pacha. Quel intérêt avait celui-ci à empêcher Samba N’Goto, le chef en question, de nous délivrer son message, c’est ce que nous devions comprendre sans peine lorsque, au matin, à travers Mobaye interprète, nous apprîmes de Samba N’Goto ceci :
Le 21 octobre dernier (il y avait donc de cela six jours) le sergent Yemba fut envoyé par l’administrateur de Boda à Bodembéré pour exercer des sanctions contre les habitants de ce village (entre Boda et N’Goto). Ceux-ci avaient refusé d’obtempérer à l’ordre de transporter leurs gîtes sur la route de Carnot, désireux de n’abandonner point leurs cultures. Ils arguaient, en outre, que les gens établis sur la route de Carnot, sont des Bayas, tandis qu’eux sont des Bofis.
Le sergent Yemba quitta donc Boda avec trois gardes (dont nous prîmes soigneusement les noms[35]). Ce petit détachement était accompagné de Baoué, capita, et de deux hommes commandés par ce dernier. En cours de route, le sergent Yemba réquisitionna deux ou trois hommes dans chaque village traversé, et les emmena après les avoir enchaînés. Arrivés à Bodembéré, les sanctions commencèrent : on attacha douze hommes à des arbres, tandis que le chef du village, un nommé Cobelé prenait la fuite. Le sergent Yemba et le garde Bonjo tirèrent sur les douze hommes ligotés et les tuèrent. Il y eut ensuite grand massacre de femmes, que Yemba frappait avec une machette. Puis, s’étant emparé de cinq enfants en bas âge, il enferma ceux-ci dans une case à laquelle il fit mettre le feu. Il y eut en tout, nous dit Samba N’Goto, trente-deux victimes.
Ajoutons à ce nombre le capita de M’Biri, qui s’était enfui de son village (Boubakara, près de N’Goto) et que Yemba retrouva à Bossué, premier village au nord de N’Goto.
Nous apprîmes aussi que Samba N’Goto regagnait Boda, où il réside et y était presque arrivé lorsqu’il croisa sur la route l’auto du Gouverneur Lamblin qui nous emmenait à N’Goto. C’est alors qu’il avait rebroussé chemin, croyant avoir affaire au Gouverneur lui-même, désireux d’en appeler à lui. Il avait dû marcher bien vite, puisqu’il était arrivé à N’Goto très peu de temps après nous. Cette occasion inespérée d’en appeler au chef des blancs, il ne voulait pas la laisser échapper[36].
28 octobre.
La déposition de Samba N’Goto avait duré plus de deux heures. Il pleuvait. Ce n’était point la passagère averse des tornades. Le ciel était épaissement couvert ; la pluie installée pour longtemps. Nous partîmes néanmoins vers dix heures. J’étais assis à côté de Mobaye ; Marc et Zézé, dans l’intérieur du camion, s’installèrent tant bien que mal sur les sacs de couchage, étouffant un peu sous la bâche. La route était profondément détrempée et l’auto n’avançait qu’avec une désespérante lenteur. Aux moindres montées, aussi bien qu’aux passages où la route était trop sablonneuse, nous devions mettre pied à terre, sous la pluie, et pousser le camion qui s’enlisait.
Nous avions le cœur si serré par la déposition de Samba N’Goto et par les récits de Garron, qu’à la rencontre que nous fîmes d’un groupe de femmes en train de travailler à la réfection de la route, nous ne pouvions même plus leur sourire. Ce pauvre bétail ruisselait sous l’averse. Nombre d’entre elles allaitaient tout en travaillant. Tous les vingt mètres environ, aux côtés de la route, un vaste trou, profond de trois mètres le plus souvent ; c’est de là que sans outils appropriés, ces misérables travailleuses avaient extrait la terre sablonneuse pour les remblais. Il était arrivé plus d’une fois que le sol sans consistance s’effondrât, ensevelissant les femmes et les enfants qui travaillaient au fond du trou. Ceci nous fut redit par plusieurs[37]. Travaillant le plus souvent trop loin de leur village pour pouvoir y retourner le soir, ces femmes se sont construit dans la forêt des huttes provisoires, perméables abris de branches et de roseaux. Nous avons appris que le milicien qui les surveille les avait fait travailler toute la nuit pour réparer les dégâts d’un récent orage et permettre notre passage.
Arrivés au « Grand Marigot », point terminus de la route carrossable. Là nous attend le gros des porteurs. Nos boys ont pris les devants avec le reste de la troupe que nous ne devons retrouver qu’à Bambio. Il est deux heures. La pluie a cessé. Nous dévorons rapidement un poulet froid et repartons. Dix kilomètres seulement nous séparent de Bambio. Nous les ferons sans peine. En général, nous n’userons que très peu des tipoyes[38] autant par amour de la marche, que pour épargner nos tipoyeurs piteux.
Le « Grand Marigot » est admirable ; encore rien vu de si étrange et de si beau dans ce pays. Cette sorte de grand marais, que l’on traverse sur d’étroites passerelles de lianes et de branches, écarte une forêt pas très haute ; des plantes d’eau le couvrent, inconnues pour la plupart ; d’énormes arums dressent leurs cornets entr’ouverts et laissent paraître un secret blanc, tigé de pourpre sombre ; tiges aux cannelures épineuses. Cinq cents mètres plus loin, on atteint la rivière. Un mystérieux silence traversé de chants d’oiseaux invisibles. Quantité de palmiers bas se penchent et trempent leurs palmes dans l’eau courante. On gagne l’autre rive de la M’Baéré en pirogue. Ici la forêt vous enveloppe et se fait plus charmante encore ; l’eau la pénètre de toutes parts, et la route sur pilotis est constamment coupée de petits ponts de bois. Quelques fleurs enfin : des balsamines mauves et d’autres fleurs qui rappellent les épilobes de Normandie, j’avance dans un état de ravissement et d’exaltation indicibles (sans me douter hélas ! que nous ne reverrions rien d’aussi beau). Ah ! pouvoir s’arrêter ici, pouvoir y revenir sans cette escorte de porteurs qui fait s’enfuir au loin tout le gibier… Parfois cette constante compagnie m’importune, m’excède. Désireux de goûter ma solitude et l’enveloppement étroit de la forêt, je presse le pas, m’échappe en courant, tâchant de distancer les porteurs. Mais aussitôt ils partent tous au petit trot pour me rejoindre. Impatienté je m’arrête, les arrête, trace un trait sur le sol qu’ils ne devront dépasser qu’à mon coup de sifflet lorsque je serai déjà loin. Mais un quart d’heure après il faut retourner en arrière, les chercher ; car ils n’ont pas compris et tout le convoi reste en panne.
Peu de temps avant Bambio, la forêt cesse, ou du moins des clairières s’ouvrent. Des cris, des chants, nous avertissent de la proximité du village. Un peuple de femmes et d’enfants accourt à notre rencontre. Nous serrons la main de quelques chefs alignés et au port d’armes – et même, par enthousiasme et par erreur, la main de quelques simples plantons. Nous jouons aux grands chefs blancs, très dignes, avec des saluts de la main et des sourires de ministres en tournée. Un énorme gaillard affublé de peaux de bêtes tape sur un gigantesque xylophone qu’il porte pendu à son cou ; il dirige la danse des femmes qui chantent, poussent des hurlements sauvages, balaient la route devant nous, agitent de grandes tiges de manioc, ou les brisent sous nos pas en fouettant le sol bruyamment ; c’est un délire. Les enfants bondissent et trépignent. La traversée du village est glorieuse. Notre cortège nous mène à la case des passagers où nous retrouvons enfin nos braves boys et le premier convoi des porteurs.
29 octobre.
Ce matin, j’étais allé voir l’un des chefs indigènes venus hier à notre rencontre. Ce soir, il me rend ma visite. Longue conversation. Adoum sert d’interprète, assis à terre, entre le chef et moi.
Les récits du chef de Bambio confirment tout ce que Samba N’Goto m’avait appris. Il me raconte en particulier le « bal » du dernier marché de Boda. J’en transcris ici le récit, tel que je l’ai copié d’un carnet intime de Garron.
« À Bambio, le 8 septembre, dix récolteurs de caoutchouc, (vingt, disent les renseignements complémentaires[39]) de l’équipe de Goundi, travaillant pour la Compagnie Forestière – pour n’avoir pas apporté de caoutchouc le mois précédent (mais, ce mois-ci, ils apportaient double récolte, de 40 à 50 kilogrammes) – furent condamnés à tourner autour de la factorerie sous un soleil de plomb et porteurs de poutres de bois très pesantes. Des gardes, s’ils tombaient, les relevaient à coups de chicotte.
« Le « bal » commencé dès huit heures, dura tout le long du jour sous les yeux de MM. Pacha et Maudurier, agent de la Forestière. Vers onze heures, le nommé Malingué, de Bagouma, tomba pour ne plus se relever. On en avertit M. Pacha, qui dit simplement : « Je m’en f… » et fit continuer le « bal » Tout ceci se passait en présence des habitants de Bambio rassemblés, et de tous les chefs des villages voisins venus pour le marché[40]. »
Le chef nous parle encore du régime de la prison de Boda, de la détresse des indigènes, de leur exode vers une moins maudite contrée…
Et certes je m’indigne contre Pacha, mais le rôle de la Compagnie Forestière, plus secret, m’apparaît ici bien autrement grave. Car enfin, elle n’ignorait rien (Je veux dire les représentants de ladite). C’est elle (ou ses agents) qui profitait de cet état de choses. Ses agents approuvaient Pacha, l’encourageaient, avaient avec lui partie liée. C’est sur leur demande que Pacha jetait arbitrairement en prison les indigènes de rendement insuffisant ; etc.…[41]
Désireux de mener à bien ma lettre au Gouverneur, je décide de remettre au surlendemain notre départ. Le peu de mois que j’ai passés en A. E. F., m’a déjà mis en garde contre les « récits authentiques », les exagérations et les déformations des moindres faits. Hélas ! cette scène de « bal » n’eut, je le crains, rien d’exceptionnel, s’il faut en croire divers témoins directs que j’interroge tour à tour. La terreur que leur inspire Pacha les fait me supplier de ne les point nommer. Sans doute, ils se « défileront » par la suite, nieront avoir rien vu. Lorsqu’un Gouverneur parcourt le pays, ses subordonnés se présentent, et présentent dans leurs rapports, de préférence, les faits qu’ils jugent les mieux capables de contenter. Ceux que je dois rapporter au Gouverneur risquent d’échapper à son investigation, je le crains, et l’on étouffera soigneusement les voix qui pourraient les lui faire connaître. Voyageant en simple touriste, je me persuade qu’il peut m’arriver parfois de voir et d’entendre ce qui est trop bas pour l’atteindre.
En acceptant la mission qui me fut confiée, je ne savais trop tout d’abord à quoi je m’engageais, quel pourrait être mon rôle, et en quoi je serais utile. À présent, je le sais, et je commence à croire que je ne serai pas venu en vain.
Depuis que me voici dans la colonie, j’ai pu me rendre compte du terrible enchevêtrement de problèmes qu’il ne m’appartient pas de résoudre. Loin de moi la pensée d’élever la voix sur des points qui échappent à ma compétence et nécessitent une étude suivie. Mais il s’agit ici de certains faits précis, complètement indépendants des difficultés d’ordre général. Peut-être le chef de circonscription en est-il avisé d’autre part. D’après ce que me disent les indigènes, il semblerait qu’il les ignore. La circonscription est trop vaste ; un seul homme, et sans moyens de transport rapide, ne peut suffire à tout surveiller. L’on se heurte ici, comme partout en A. E. F. à ces deux constatations angoissantes : insuffisance de personnel ; insuffisance d’argent.
Deux hommes, venus de N’Goto (environ 48 kilomètres), me rapportent mon écorçoir que j’avais égaré là-bas. Ils paraissent stupéfaits quand je leur donne un « matabiche[42] ».
Au clair de lune, sur la vaste arène qui s’étend derrière le gîte d’étape, grande revue des porteurs. Marc les dénombre ; les range par groupes de 10 ; leur apprend à se compter. Grands éclats de rire de ceux qui comprennent, devant l’incompréhension de certains autres. Nous distribuons à chaque homme une cuillerée de sel ; d’où reconnaissance lyrique et protestations enthousiastes.
30 octobre.
Impossible de dormir. Le « bal » de Bambio hante ma nuit. Il ne me suffit pas de me dire, comme l’on fait souvent, que les indigènes étaient plus malheureux encore avant l’occupation des Français. Nous avons assumé des responsabilités envers eux auxquelles nous n’avons pas le droit de nous soustraire. Désormais, une immense plainte m’habite ; je sais des choses dont je ne puis pas prendre mon parti. Quel démon m’a poussé en Afrique ? Qu’allais-je donc chercher dans ce pays ? J’étais tranquille. À présent je sais ; je dois parler.
Mais comment se faire écouter ? Jusqu’à présent, j’ai toujours parlé sans aucun souci qu’on m’entende ; toujours écrit pour ceux de demain, avec le seul désir de durer. J’envie ces journalistes dont la voix porte aussitôt, quitte à s’éteindre sitôt ensuite. Circulais-je jusqu’à présent entre des panneaux de mensonges ? Je veux passer dans la coulisse, de l’autre côté du décor, connaître enfin ce qui se cache, cela fût-il affreux. C’est cet « affreux » que je soupçonne, que je veux voir.
Journée toute occupée à la rédaction de ma lettre.
31 octobre.
Levés avant cinq heures. Thé sommaire. On plie bagages. Sur l’arène, derrière la maison, sont groupés nos porteurs (60 hommes, plus un milicien, un guide indigène, nos deux boys et le cuisinier ; plus encore trois femmes, accompagnant le milicien et le guide). Le chef est venu nous dire adieu. Clair de lune brumeux. Nous partons dans la douteuse clarté d’avant l’aube, précédant le gros de la troupe, avec nos boys, nos tipoyeurs, le guide, le garde, et les porteurs de nos sacs.
L’interminable forêt met à l’épreuve notre inépuisable patience. Je n’ai pu achever hier ma lettre au Gouverneur. Hélas ! impossible d’écrire, ni même de prendre des notes ou de lire en tipoye. Je ne me résigne à y monter qu’après cinq heures de marche assez fatigante, car le terrain, sablonneux d’abord, devient, durant les derniers kilomètres, argileux et glissant. Après un court repos en tipoye, cinq kilomètres de marche encore. Pas de poste intermédiaire. Si longue que soit l’étape, il faut la fournir, car on ne peut passer la nuit en forêt, sans gîte, sans nourriture pour les porteurs. Forêt des plus monotones, et très peu exotique d’aspect. Elle ressemblerait à telle forêt italienne, celle d’Albano par exemple, ou de Némi, n’était parfois quelque arbre gigantesque, deux fois plus haut qu’aucun de nos arbres d’Europe, dont la cime s’étale loin au-dessus des autres arbres, qui, près de lui, paraissent réduits en taillis. Les troncs de ces derniers, à demi couverts de mousse, semblent des troncs de chênes-verts, ou de lauriers. Les petites plantes vertes qui bordent la route rappellent nos myrtilles ; d’autres, les « herbes à Circé » ; tout comme, dans le marigot d’avant-hier, des plantes d’eau rappelaient nos épilobes et nos balsamines du Nord. Nos châtaignes ne sont pas moins bizarres, pas moins belles que ces graines dont on ne voit à terre que les cosses velues. Pas de fleurs. Pourquoi nous signalait-on cette partie de la forêt comme particulièrement intéressante et belle ?
À l’extrémité du parcours, le terrain, jusqu’alors parfaitement plan, dévale faiblement jusqu’à une petite rivière peu profonde, ombragée ; l’eau claire coule sur un lit de sable blanc. Nos porteurs se baignent.
Les bains, dit-on, sont dangereux dans ce pays. Je ne parviens pas à le croire, lorsqu’il n’y a lieu de redouter ni crocodiles, ni insolations. Il ne s’agit pas de cela, disent certains docteurs, (et Marc me le répète après eux) mais bien de congestion du foie, de fièvre, de filariose… Hier, déjà je me suis baigné. Qu’en est-il résulté ? Un grand bien-être. Aujourd’hui, je ne résiste pas davantage à l’appel de l’eau et me plonge délicieusement dans sa transparente fraîcheur. Je n’ai jamais pris de bain plus exquis.
Des chefs viennent à notre rencontre, avec deux tam-tams portés par des enfants. Deux importants villages de « Bakongos » (l’on appelle indifféremment ainsi les indigènes qui travaillent pour la Forestière). Un tout petit village à côté, N’Délé, habité seulement aujourd’hui par cinq hommes valides (qui sont dans la forêt à récolter le caoutchouc) et cinq impotents qui s’occupent des plantations. Inutile de dire que ces hommes dans la forêt, non surveillés, ne se livrent que le moins possible à un travail qui leur est si mal rétribué. De là les châtiments par lesquels le représentant de la Forestière s’efforce de les rappeler au sentiment du devoir.
Longue conversation avec les deux chefs du village bakongo. Mais celui qui parlait d’abord, lorsqu’il était seul avec nous, se tait aussitôt qu’approche l’autre. Il ne dira plus rien ; et rien n’est plus émouvant que ce silence et cette crainte de se compromettre lorsque nous l’interrogeons sur les atrocités qui se commettent dans la prison de Boda où il a été lui-même enfermé. Il nous dira plus tard, de nouveau seul avec nous, qu’il y a vu mourir par suite de sévices, dix hommes en un seul jour. Lui-même garde des traces de coups de chicotte, des cicatrices, qu’il nous montre. Il confirme, ce que l’on nous disait déjà[43], que les prisonniers ne reçoivent pour toute nourriture, une seule fois par jour, qu’une boule de manioc, grosse comme (il montre son poing).
Il parle des amendes que la Compagnie Forestière a coutume d’infliger aux indigènes (j’allais dire : de prélever sur ceux-ci), qui n’apportent pas de caoutchouc en quantité suffisante, – amendes de quarante francs ; c’est-à-dire tout ce qu’ils peuvent espérer toucher en un mois. Il ajoute que, lorsque le malheureux n’a pas de quoi payer l’amende, il ne peut éviter la prison qu’en empruntant à un plus fortuné que lui, s’il en trouve – et encore est-il parfois jeté en prison « par-dessus le marché ». La terreur règne et les villages des environs sont désertés. Plus tard, nous parlerons à d’autres chefs. Quand on leur demande : « Combien y a-t-il d’hommes dans ton village ? » ils font le dénombrement en les nommant et pliant un doigt pour chacun. Il y en a rarement plus de dix. Adoum sert d’interprète.
Adoum est intelligent, mais ne sait pas très bien le français. Lorsque nous nous arrêtons en forêt, c’est, dit-il, que nous avons trouvé « un palace » (pour : une place). Il dit : « un nomme » et quand, à travers lui, nous demandons à quelque chef : « Combien y en a-t-il de ton village qui se sont enfuis, ou qui ont été mis en prison ? » Adoum répond : « Ici, dix nommes ; là-bas, six nommes, et huit nommes un peu plus loin. »
Beaucoup de gens viennent nous trouver. Tel demande un papier attestant qu’il est grand sorcier de beaucoup de villages ; tel, un papier l’autorisant à aller plus loin « faire petit village tout seul ». Quand on s’informe sur le nombre de prisonniers qu’enferme la prison de Boda, la seule réponse que j’obtiens, quel que soit celui qui me la donne : « Beaucoup ; beaucoup ; trop ; peux pas compter. » Il y aurait parmi les incarcérés nombre de femmes et d’enfants.
1er novembre.
Trop préoccupé pour pouvoir dormir. Départ avant cinq heures. Étape de 25 à 28 kilomètres sans user des tipoyes un seul instant. L’on ne peut évaluer la longueur d’une route non jalonnée, que d’après le temps mis à la parcourir. Nous devons faire, en moyenne, de cinq à six kilomètres par heure. Les derniers kilomètres, dans le sable et en plein soleil, ont été particulièrement fatigants. La forêt est de nouveau très monotone, et sans rien de particulier d’abord, puis, tout à coup, à mi-route, une large et profonde rivière aux eaux admirablement claires ; on voyait, à plus de cinq mètres de profondeur je pense, d’abondantes plantes d’eau s’agiter au-dessous d’un pont sinueux, incertain, d’apparence extrêmement fragile, formé de tiges rondes retenues par des lianes et mal fixées, presque à ras de l’eau, sur de grands pilotis. On eût dit l’un de ces petits couloirs de branches et de bûches qui permettent de traverser à pied sec les fondrières, et l’on ne se penchait point sans vertige au-dessus de l’inquiétante profondeur. Passé la rivière (la Bodangué ?), durant un kilomètre ou deux la forêt est de nouveau des plus étranges et des plus belles. J’associe volontiers dans ce carnet ces deux épithètes, car le paysage vient-il à cesser d’être étrange, il rappelle aussitôt quelque paysage européen, et le souvenir qu’il évoque est toujours à son désavantage. Peut-être, si j’avais vu Java ou le Brésil, en irait-il de même pour ce sous-bois encombré de fougères épiphytes et de grands arums ; mais, comme il ne me rappelle rien, je puis le trouver merveilleux.
On traverse, avant d’arriver à Dokundja-Bita, où nous campons, trois misérables petits villages. Rien que des femmes. Les hommes, comme toujours, sont au caoutchouc. Les chefs viennent d’assez loin à notre rencontre, avec trois tam-tams frappés par un vieux hors d’usage et des enfants. Puis, un peu avant Dokundja, réception par les femmes et les mioches ; vociférations suraiguës, chants, trémoussements frénétiques. Les plus vieilles sont les plus forcenées ; et ce gigotement saugrenu des dames mûres est assez pénible. Toutes ont à la main des palmes, et de grandes branches avec lesquelles elles nous éventent ou balaient le sol que nous allons fouler. Très « entrée à Jérusalem ». Les femmes n’ont d’autre vêtement qu’une feuille (ou un chiffon) cache-sexe dont la tige, passant entre les fesses, rejoint par-derrière la ficelle qui sert de ceinture. Et certaines portent, par-derrière, un gros coussinet de feuilles fraîches, ou sèches, pas beaucoup plus ridicule après tout que le « pouf » ou tournure à la mode vers 1880. Mais, dans le dernier village où nous nous arrêtons, elles sont, en plus, toutes parées de lianes.
Un coureur parti de Bambio, nous a précédés de deux jours, pour annoncer notre arrivée. À l’entrée et à la sortie des villages, sur plusieurs centaines de mètres, parfois, (et parfois en pleine forêt ou en pleine brousse, on ne sait trop pourquoi) on a sarclé, coupé les herbes, et répandu du sable sur la route. Par endroits, à ras du sable, d’admirables fleurs mauves qui rappellent les cattléyas (et que j’avais déjà vues dans notre promenade en forêt aux environs d’Eala). Ne serait-ce pas elles qui donnent ces gros fruits couleur corail, de la forme d’une gousse d’ail, que l’on trouve, eux aussi, à ras du sol, et dont les indigènes mangent l’intérieur, une pulpe blanche au goût anisé. Tout auprès, la feuille, semblable à une petite palme, d’un mètre 50 environ. Ces fleurs se sont-elles ouvertes depuis que l’on a nettoyé la route ? ou plutôt ne les a-t-on pas laissées intentionnellement ? J’aime à le croire et j’admire cette piste de sable, où l’on a tout ôté, sauf les fleurs.
À chaque arrêt dans un village, nous parlons au chef et le persuadons de ne laisser le caoutchouc que si la Compagnie Forestière consent à le payer 2 francs le kilo, comme elle le doit. Car il nous est dit qu’elle ne le paie souvent qu’un franc cinquante, qu’elle n’accepte de le payer deux francs qu’à partir du vingtième kilo. Et, de plus, nous voudrions persuader les indigènes d’apprendre à peser le caoutchouc eux-mêmes ; car ils ne connaissent que les mesures de volume (ils comptent par paniers) ce qui permet au représentant de la Forestière de les tromper sur le poids, pour peu qu’il ne soit pas honnête, et que l’administrateur ne soit pas là pour protester[44].
Dès que nous sommes arrêtés, un tas d’hommes s’empressent pour en appeler à nous, nous soumettre des différends, se faire soigner, etc. Tel, flanqué de son frère et de sa sœur, nous demande de faire payer un voisin qui a couché avec sa femme enceinte de trois mois, ce qui, dit-il, a fait avorter la femme. Il demande 50 francs d’indemnité pour la mort de l’enfant, etc.
2 novembre.
Il est plus de midi quand nous arrivons à Katakouo ; partis de Dokundja-Bita à 5 heures, nous avons marché sans arrêt durant 7 heures, dont 1/2 heure en tipoye. Un seul très beau passage de rivière, sur des tiges reliées par des lianes ; une petite liane couverte de fourmis sert de rampe. Partout ailleurs, monotone contrée ; steppe de graminées hautes, semée de petits arbres semblables à des chênes-lièges, parfois en lisière de forêt, et sans doute longeant le cours caché d’une rivière.
Énormes champs de manioc non récolté formant taillis ; et plus loin des champs de ricin également non récolté, tous les hommes étant au caoutchouc, ou en prison, ou morts, ou en fuite. Après avoir quitté le dernier village de cette maudite subdivision de Boda, un énorme gaillard, qui nous accompagnait depuis l’entrée du précédent village, qui marchait près de moi, la main dans la main (je croyais avoir affaire à un chef), déclare soudain qu’il ne veut plus retourner en arrière, rentrer dans son village et continuer plus longtemps à faire du caoutchouc. Il prétend ne plus nous quitter. Mais son frère (du même père et de la même mère, dit-il avec insistance, car dans ce pays on appelle bien souvent « frère » un simple ami) qui est capita, s’efforce de s’opposer à ce départ. Long palabre. « C’est sur lui que ça va retomber. C’est lui qu’on va f… en prison, etc. » Un matabiche le calme et le décide à s’en retourner seul.
Katakouo (Katapo sur certaines cartes). On reconnaît qu’on n’est plus dans la subdivision de Boda, à ceci qu’on revoit des hommes. Le chef du village s’empresse de nous présenter son livret, sur lequel nous lisons : « Chef incapable ; sans aucune énergie ; ne peut être remplacé ; pas d’indigène supérieur dans le village. »
Katakouo est un énorme village de près d’un kilomètre de long. Une seule rue, si l’on peut appeler ainsi cette interminable place oblongue aux côtés de laquelle toutes les cases sont alignées.
Vers le soir, gagnant une petite rivière ombragée, je me suis baigné, me laissant glisser d’un grand tronc d’arbre mort dans un clair bassin au fond de sable blanc. Un petit écureuil est venu me regarder, semblable aux écureuils de nos pays, mais de pelage beaucoup plus sombre.
3 novembre.
Départ de Katakouo bien avant l’aube ; durant longtemps, nous cheminons dans la forêt, si obscure que, sans le guide qui nous précède, nous ne pourrions distinguer le sentier sinueux. Très lente venue du jour, un jour gris, terne, indiciblement triste. Monotonie de la forêt ; quelques futaies assez belles (mais beaucoup de troncs morts) au milieu des cultures de manioc – de nouveau non récolté, bien que nous ne soyons plus sur Boda. Je tâche d’interroger le chef d’un village où nous nous arrêtons, homme stupide (comme le chef du village précédent et du suivant) qui tend un livret où je lis de nouveau : « Chef incapable, n’a aucune autorité sur ces gens. » Cela se voit du reste. Impossible d’obtenir une réponse à ma question : « Pourquoi n’a-t-on pas récolté le manioc en temps voulu ? » En général, le « pourquoi » n’est pas compris des indigènes ; et même je doute si quelque mot équivalent existe dans la plupart de leurs idiomes. Déjà j’avais pu constater, au cours du procès à Brazzaville, qu’à la question : « Pourquoi ces gens ont-ils déserté leurs villages ? », il était invariablement répondu « comment, de quelle manière… ». Il semble que les cerveaux de ces gens soient incapables d’établir un rapport de cause à effet[45] ; (et ceci, j’ai pu le constater maintes fois dans la suite de ce voyage).
Danses de femmes à l’entrée de chaque village. Extrêmement pénible, le trémoussement éhonté des matrones sur le retour. Les plus vieilles sont toujours les plus frénétiques. Certaines se démènent comme des forcenées.
Un de nos porteurs est malade. Un comprimé Dower le soulage beaucoup ; mais il ne peut marcher ; on le porte dans un hamac ; Marc soigne le pied d’un autre. Nous n’avons pas du tout usé de nos tipoyes ; Outhman qui s’est coupé profondément le pied a occupé l’un d’eux assez longtemps. Rien à noter, sinon la descente vers la rivière, à la fin du jour (nous étions arrivés à Kongourou vers midi). Raté plusieurs coups de fusil, ce qui m’enlève beaucoup de mon assurance. D’avoir réussi mes premiers coups m’avait empli de superbe. Je ne visais déjà plus.
4 novembre.
Arrivés à Nola vers trois heures, ayant brûlé l’étape de Niémélé, et fait plus de 40 kilomètres dont une bonne trentaine à pied. La lune, au départ, était encore presque au zénith – « à midi » comme disait Adoum. – (Il n’était pas plus de 4 heures.) Rien de plus triste, de plus morne, que l’abstraite clarté grise qui la remplace. Matinée très brumeuse ; mais la steppe boisée, que l’on traverse durant des heures, doit une grâce passagère à l’abondance de grandes graminées très légères, que cette brume charge de rosée. Ces hautes herbes se penchent sur la route et mouillent le front, les bras nus du passant. Bientôt on est trempé comme par une averse. Abondance de traces sur la route sablonneuse (biches, sangliers, buffles), mais on ne voit aucun gibier. Le bruit, et sans doute le parfum, de notre escorte, fait tout fuir. Nous ratons quelques coups de fusil contre des oiseaux trop distants. Au passage d’une rivière, un peuple de cigales fait un vacarme assourdissant. Le milicien s’empare de la grande sagaie du petit boy qui nous accompagne depuis deux jours (avec son maître, le messager du chef Yamorou) – et cloue contre un tronc d’arbre un de ces insectes énormes, aux ailes tigrées, à reflets d’émeraude (les ailes de dessous sont pourprées). Hier au soir, nous étions arrivés à la nuit close dans le village où nous avons dû camper ; à trois kilomètres de Kongourou où se trouve le gîte d’étape, mais où venait de descendre un voyageur de commerce, raflant tout le manioc qu’on avait réservé pour nos porteurs. C’est ce que nous avions appris lorsque, ce même soir, désespérant d’attendre les rations promises, nous avions été retrouver le chef de Kongourou, nous collant ainsi 6 kilomètres supplémentaires. Ce chef était venu nous saluer ; vêtu à l’arabe ; extrêmement sympathique ; il nous explique qu’il n’a pu faire autrement que de servir d’abord les premiers arrivés, ce que nous admettons sans peine ; mais nos porteurs ont besoin de manger. À force de courir de case en case, armés de torches, nous parvenons, aidés du chef, à réunir une quantité de manioc suffisante, et nous rentrons exténués.
Quelques kilomètres avant d’arriver à Nola, le sentier, sortant de la forêt épaisse, débouche brusquement sur l’Ekéla (qui devient plus loin la Sangha). Nous quittons un instant nos tipoyes et nous nous asseyons sur un tronc de rônier, à l’ombre d’une case, dans le petit village de pêcheurs construit sur le bord de la rivière, à regarder danser six pauvres femmes ; par politesse, car elles sont vieilles et hideuses. Encore trois kilomètres de sentier dans la steppe et dans les cultures de bananiers et de quelques cacaoyers ; puis on arrive en face de l’étrange Nola, dont on aperçoit quelques toits, de l’autre côté du fleuve que nous traversons en pirogue. Nous touchons au but. Il était temps. Nous sommes recrus de fatigue, tous. Mais somme toute aucun accroc sérieux, durant ces cinq jours de marche. (Hier, par prudence, nous avions recruté cinq tipoyeurs de renfort, car les nôtres font pitié.)
Le capita prêté par le chef Yamorou (de Bambio) pour nous montrer la route, avait mission de lui ramener de Nola une de ses femmes qu’un milicien avait enlevée. Arrivés à Nola, nous apprenons que le milicien et la femme sont partis la veille pour Carnot.
CHAPITRE V – De Nola à Bosoum
5 novembre.
Crise du portage. Nos porteurs veulent tous repartir ; du moins les soixante recrutés par l’administration. On a apporté pour eux, hier, une grande quantité de bananes, mais très peu de manioc, ce qui cause un grand mécontentement. L’Administration paie 1 fr. 25 par journée d’homme avec charge, et 75 centimes l’homme non chargé ; mais souvent, la somme est remise globalement au chef, de sorte qu’il arrive que les intéressés ne touchent rien. C’est, affirment nos porteurs, ce qui va se passer. Nous voici fort embarrassés, car, dans l’absence de tout représentant de l’autorité française, il est extrêmement difficile de trouver ici des remplaçants ; et d’autre part il nous paraît inhumain d’emmener ces gens beaucoup trop loin de leurs villages. Nous pensions d’abord pouvoir remonter la rivière en pirogue jusqu’à Nola, mais l’Ekela, grossie par les pluies, coule à pleines eaux et n’est plus navigable qu’à la descente ; les rapides sont dangereux. Force sera de revenir sur nos pas jusqu’à Kongourou et de gagner Nola par la rive gauche, car, nous dit-on, l’autre route est abandonnée. Dès qu’une route n’est pas entretenue, la végétation qui l’envahit la rend à peu près impraticable.
Nos porteurs, à l’aide d’une très longue baguette de bambou, dont l’extrémité est fendue en fourche, s’emparent avec une grande habileté des nids des « mouches-maçonnes » suspendus aux poutrelles de la toiture qui abrite notre véranda ; ce sont de petites colonies d’une vingtaine d’alvéoles ; les larves, ou les chrysalides lorsqu’elles sont encore d’un blanc de lait, sont, nous disent nos gens, délectables. Nous les avons vus également se jeter sur les termites ailés qu’attire par essaims notre lampe-phare, et les croquer aussitôt sans même les plumer de leurs énormes ailes.
6 novembre.
Difficulté de trouver du manioc pour nos gens. On finit par en apporter ; mais il n’est pas pilé ; les porteurs boudent. Pour permettre le recrutement d’un nouveau contingent, nous décidons de ne partir qu’après-demain. Toutefois nous n’osons congédier déjà ceux-ci, qui cependant se démoralisent et s’encouragent à l’insoumission.
Vers le soir nous traversons l’Ekela en pirogue. Visite à l’établissement de la Forestière que dirigent deux très sympathiques et tout jeunes agents. Ils paraissent honnêtes[46]. Nous achetons diverses fournitures à leurs « magasins », puis gagnons un grand village au bord du fleuve, à l’endroit où la Kadei rejoint l’Ekela pour former la Sanga. En face du village, un mont aux pentes brusques, couvertes d’une forêt épaisse. On la dit hantée de singes de toutes sortes ; en particulier quantité de gorilles énormes, que l’on chasse au filet. Les gens du village nous montrent ces filets robustes aux larges mailles, pendus aux portes de leurs cases. À l’entrée du village, un piège à panthères.
Brusque retournement de la crise du portage. On vient nous persuader que nous pourrons remonter l’Ekela en baleinière jusqu’à Bania, et que cela ne nous prendra pas plus de quatre jours.
7 novembre.
Deux indigènes viennent de tuer à coups de machettes un serpent d’un mètre cinquante de long, très gros proportionnellement à la longueur. Fâcheux que les coups de machettes aient endommagé la peau. Elle est très belle ; marquetée sur le dos, non de losanges, mais de rectangles très réguliers gris clair, encerclés de noir dans une parenthèse plus pâle ; variété de python que je n’ai revue nulle part ailleurs.
Nous avons à déjeuner le Docteur B… et un représentant de la Compagnie Wial, qui fait le commerce des peaux[47]. Tous deux reviennent de Bania. Le Docteur nous parle longuement de la Compagnie Forestière, qui trouve le moyen, nous dit-il, d’échapper aux sages règlements médicaux, éludant les visites sanitaires et se moquant des certificats pour tous les indigènes qu’elle recrute de village en village et dont elle forme les groupements « bakongos » à son service ; d’où propagation de la maladie du sommeil, incontrôlable[48]. Il considère que la Forestière ruine et dévaste le pays. Il a envoyé à ce sujet des rapports confidentiels adressés au Gouverneur, mais est convaincu que ceux-ci restent embouteillés à Carnot (dont, faute de personnel administratif, Nola dépend provisoirement), de sorte que le Gouverneur continue d’ignorer la situation.
Dans la nuit d’hier, une tornade avortée ; on étouffe ; on espère en vain une averse qui rafraîchisse un peu l’atmosphère. Le ciel est encombré. Quantité d’éclairs, mais dans des régions supérieures si reculées, que l’on n’entend aucun tonnerre ; ils éclairent de revers et dénoncent soudain de compliquées superpositions de nuages. Je me suis relevé, vers minuit, et reste longtemps assis devant la case dans la contemplation de ce spectacle admirable.
Deux nuits de suite, un grand singe (?) est venu danser sur notre case, faisant des bonds à crever la toiture.
On n’imagine rien de plus morne, de plus décoloré, de plus triste que les matinées de ciel gris sous les tropiques. Pas un rayon, pas un sourire du ciel avant le milieu du jour.
Dîné hier chez le Docteur B…, avec le représentant de la Compagnie Wial. Vers le milieu du repas, on entend sonner « la générale ». Serait-ce un incendie ? Ils sont fréquents dans ce pays où l’indigène met le feu à la brousse sans beaucoup de soucier des cases que la flamme pourrait atteindre. Grand bruit de voix qui se rapprochent. Et tout à coup fait irruption sous la véranda où nous sommes installés, le Portugais d’une factorerie voisine, où nous avions été acheter du tabac pour nos porteurs, dans la matinée. Il n’a pour tout costume que son pantalon. Avec une grande exaltation et comme hors de lui, il nous explique que les miliciens veulent lui « casser la gueule », parce que son cuisinier s’est emparé de la femme d’un garde, etc., etc. Le Docteur lui parle avec la plus grande fermeté, fort bien ma foi ; et le renvoie. Il se découvre, à l’examen, que la femme en question est précisément celle que le garde a enlevée à Yamorou et que le capita Boboli, qui nous accompagnait, avait mission de lui ramener. Ce dernier est reparti hier sans la femme, après qu’on lui eut dit que la femme et le garde avaient émigré à Carnot.
Ce matin nous faisons comparaître les délinquants. Le garde séducteur, un autre garde-interprète (celui de notre escorte) affligé d’un bégaiement incoercible, le cuisinier du Portugais, et la femme enfin, sa maîtresse depuis quatre jours. Celle-ci n’a pour vêtement qu’un petit paquet de feuilles maintenu par une ceinture de perles. Très Ève, « éternel féminin » ; elle est belle, si l’on accepte les seins tombants ; la ligne des hanches, du bassin et des jambes, d’une courbe très pure. Elle se tient devant nous, les bras levés prenant appui sur les bambous de la toiture qui abrite notre véranda.
Interminable interrogatoire. Tous les indigènes baragouinent le français avec une volubilité incompréhensible. Il ressort pourtant qu’il n’y a, dans toute l’histoire, comme presque toujours, qu’une question d’argent. Yamorou ne réclame point tant la femme que les 150 francs qu’il a payés aux parents pour l’avoir. Il y a en plus 10 francs d’impôt pour la femme, que le garde a payés, que le cuisinier lui a remboursés… On s’y perd. Nous décidons que la femme doit retourner à Yamorou, puisque ni le garde, ni le cuisinier ne consentent à donner à Yamorou les 150 francs qu’elle a coûté. La femme écoute d’un air indiciblement résigné ses deux derniers maris lui dire qu’elle est trop putain pour qu’on cherche à la conserver. Le garde dit même : « Elle est devenue trop crapule. » Nous faisons rendre néanmoins à la femme le pagne qu’elle avait lorsqu’elle a quitté Yamorou, plus 5 francs – mi-donnés par garde et cuisinier – pour assurer sa nourriture pendant le voyage. Tout cela prend un temps infini.
Ensuite nous examinons longuement des entonnoirs de fourmis-lions, où nous faisions dégringoler de petites fourmis en pâture.
Hier soir j’ai pu lire avec délices quelques pages du Master of Ballantrae.
8 novembre.
Décidément nous renonçons à la baleinière, mais du même coup renonçons à Bania ; nous gagnerons Carnot par Berberati. Nous avons licencié nos soixante-cinq porteurs ; on nous en promet une quarantaine d’autres, qui devront suffire. Presque tout le temps est pris par divers soins matériels et par la révision et dactylographie de ma longue lettre au Gouverneur. Un coureur m’apporte hier soir une lettre de Marcel de Coppet, laquelle m’attendait depuis plus de deux mois à Mongoumba. Ce coureur, hier soir, racontait à un garde l’emprisonnement de Samba N’Goto, que j’avais prévu ; mais lorsque, ce matin, nous interrogeons le coureur, il nie tout, et même d’avoir parlé. Prenant du sable à terre, il le porte à son front et jure que Samba N’Goto est en liberté. On le sent terrifié à l’idée des représailles possibles. Nous partons demain.
9 novembre.
Gama, sur l’Ekela. Mokélo en face, de l’autre côté du fleuve ; car je n’ose appeler rivière un cours d’eau qui ferait honte à la Seine. Quelques huttes sur un terrain en pente, dont la très vaste que nous occupons. Désagréablement chatouillés par des essaims de très petites mouches, des « fourous » sans doute. L’intérieur de la hutte, les bambous et le chaume de la toiture sont complètement lustrés, laqués par la fumée ; cela donne à cette hutte sordide un aspect luisant et propre. Il s’est mis à pleuvoir dès notre arrivée et la nuit est presque aussitôt tombée. L’étape était beaucoup plus longue qu’on ne nous avait dit et, partis à huit heures, nous n’avons atteint Gama que le soir. Certains de nos porteurs étaient recrus de fatigue ; un pauvre vieux en particulier nous montrait les ganglions de son aine, gros comme des œufs de poule. Nous n’avions pu obtenir que quarante porteurs, de sorte que quelques charges, portées par deux jusqu’alors, devaient être assumées par un seul. Cette question du portage, et même celle des tipoyeurs, me gâte le voyage ; tout le long de la route je ne puis cesser d’y penser.
Traversée de forêt beaucoup plus intéressante que celle avant Nola, à cause des fréquents petits ruisseaux qui la coupent. Le sentier dévale vers eux brusquement. La forêt elle-même est plus étrange ; une grande plante dont j’ignore le nom, à très larges et belles feuilles, donne au taillis une apparence très exotique. Quelques arbres admirables, au large empattement. La température est accablante ; non qu’il fasse très chaud, mais l’air est si lourd, si vaporeux, que l’on ruisselle. Mon gilet, que je quitte, est trempé ; ma chemise, que je quitte également, est à tordre. Je les suspends aux tipoyes, mais ils ne sécheront pas de tout le jour. Le ciel est bas, uniformément gris ; tout est terne ; on circule comme en un rêve oppressant, un cauchemar. Quantité de chants d’oiseaux, bizarres, inquiétants, font battre le cœur si l’on s’arrête – comme j’ai fait, seul, ayant pris de l’avance sur le reste de la troupe, perdu dans cette immensité.
Je voudrais bien laisser ici quelques traces de la fantastique soirée d’hier. Nous dînions chez le Docteur B…, avec A…, le jeune agent de la Société Wial (il n’a que 22 ans) et L…, capitaine de navigation fluviale qui venait d’arriver de Brazzaville. Nous ne tardâmes pas à nous apercevoir que le Docteur n’était pas dans son état normal ; en plus de ses propos exaltés, je remarquai que, lorsqu’il m’offrait à boire, j’avais quelque peine à maintenir mon verre sous le goulot de la bouteille, qu’il voulait toujours diriger au-delà. Et, à plusieurs reprises, il posa sur la nappe sa fourchette avec la bouchée qu’il avait piquée dans son assiette, au lieu de la porter à sa bouche. Il ne s’exalta que peu à peu, sans pourtant beaucoup boire ; mais peut-être avait-il déjà beaucoup bu, pour fêter l’arrivée du navire. Et pourtant je soupçonnais autre chose que la boisson. La veille, je lui avais donné connaissance de ma lettre au Gouverneur Alfassa, contenant les lourdes charges contre Pacha ; il avait paru s’indigner, puis pris de peur sans doute lorsque je parlais imprudemment d’envoyer le double de cette lettre au ministre, et par une sorte de sentiment de solidarité, le voici, ce soir, qui proteste que nombre d’administrateurs et de fonctionnaires étaient des travailleurs honnêtes, dévoués, consciencieux, remarquables. Je protestai à mon tour que je n’en avais jamais douté, et que j’en connaissais maint exemple ; mais qu’il importait d’autant plus que certaines fâcheuses exceptions (et j’ajoutais que, sur le grand nombre de fonctionnaires de tous grades que j’avais vus, je n’en avais rencontré qu’une) ne risquassent pas de déconsidérer l’ensemble des autres.
– Mais vous n’empêcherez pas, s’écria-t-il, que l’attention du public ne soit attirée surtout par l’exception ; et c’est sur elle que va se former l’opinion. C’est déplorable.
Il y avait, dans ce qu’il disait là, beaucoup de vrai, à quoi, certes, j’étais sensible. Il m’apparaissait aussi qu’il craignait d’avoir été trop loin dans l’approbation, la veille, après lecture de ma lettre, et que c’est contre cette approbation même qu’il protestait. Car, sitôt après, il versa dans l’approbation de la politique brutale envers les noirs, affirmant qu’on n’obtenait rien d’eux qu’avec des coups, des exemples, fussent-ils sanglants. Il alla jusqu’à dire que lui-même, certain jour, avait tué un nègre ; puis ajouta bien vite que c’était un cas de légitime défense, non de lui-même, mais d’un ami, qui sinon eût été sûrement sacrifié. Puis dit qu’on ne pouvait se faire respecter des noirs qu’en se faisant craindre, et parla d’un confrère, le docteur X…, celui même qui l’avait précédé à Nola, qui, traversant pacifiquement le village de Katakuo (ou Catapo) que nous avions traversé la veille, fut pris, ligoté, mis à nu, peinturluré de la tête aux pieds, et qu’on força de danser au son du tam-tam deux jours durant. Il ne put être délivré que par une escouade envoyée de Nola… Tout cela, de plus en plus bizarre, de plus en plus incohérent, exalté. Nous nous taisions tous ; il n’y avait plus que B… qui parlât. Et si nous n’avions enfin levé la séance, ayant à faire nos paquets pour le départ du lendemain, il eût sans doute parlé bien davantage. Peu s’en fallait qu’il n’approuvât Pacha ; du moins tout ce qu’il en disait était avec une arrière-pensée d’excuse, et de se désolidariser d’avec moi. Il nous dit encore (et, si vrai, ceci est très important) que les chefs reconnus des villages ne sont le plus souvent que des hommes ne jouissant d’aucune considération parmi les indigènes qu’ils sont censés commander, d’anciens esclaves, des hommes de paille, choisis pour endosser les responsabilités, subir les peines, les « sanctions », et que tous les habitants de leurs villages se réjouissaient lorsqu’ils étaient foutus en prison. Le vrai chef était un chef secret, que le gouvernement français n’arrivait pas, le plus souvent, à connaître.
Je ne puis, ici, que rapporter à peu près les propos ; je ne puis donner l’atmosphère inquiétante, fantastique, de la soirée. On ne pourrait y arriver qu’avec beaucoup d’art ; et j’écris au courant de la plume. À noter que le Docteur était tout brusquement entré dans le sujet par une attaque directe, évidemment préméditée, me demandant, dès le potage : « Êtes-vous allé visiter le cimetière de Nola ? » et, sur ma réponse négative : « Eh bien ! il y a là, déjà, les tombes de seize blancs, etc. »
10 novembre.
Les panthères abondent dans la région et, nous dit-on, ne répugnent pas aux visites domiciliaires. Mais on étouffe dans la case et, plutôt que de manquer d’air en ramenant l’énorme opercule d’écorce, nous dressons nos chaises de bord en travers de la porte.
Dans l’absence de montre, ma vigilance fait du zèle et me lève beaucoup trop tôt ; mais ne lève que moi. La nuit est encore trop sombre, il faut attendre ; se recoucher.
Nous partons à l’aube encore ivres de sommeil, cette étape, qu’on nous disait très courte, nous a paru interminable entre toutes. Nous n’avons atteint le gîte de M’Bengué que vers quatre heures, après un court arrêt vers midi. La quinzaine de kilomètres que j’ai faite à pied, ce fut avec un effort extrême ; mais je prends de plus en plus en horreur le tipoye, où l’on est inconfortablement secoué et où je ne puis perdre un instant le sentiment de l’effort des porteurs. Chaque jour nous nous enfonçons un peu plus dans l’étrange. J’ai vécu tout aujourd’hui dans un état de torpeur et d’inconscience,
as though of hemlock I had drunk
perdant notion du temps, du lieu, de moi-même.
Le ciel s’est un peu éclairci vers le soir et, tandis que j’écris ceci, la nuit monte dans un ciel admirable. Enfin nous échappons à l’oppression de la forêt. Par moments, elle était très belle et les arbres gigantesques, aux troncs dont la base semble atteinte d’éléphantiasis, se montraient de plus en plus nombreux. Mais, dans l’absence de rayons, elle semblait toute endormie, désespérément triste. Toutes les feuilles sont luisantes et fermes, analogues à celles du laurier, de l’yeuse ; pas d’équivalent de celles du coudrier, par exemple, dont la consistance molle et feutrée, comme spongieuse à la lumière, donne au rayon qui les traverse une coloration verdorée, et fait aux halliers normands leur mystère. L’humidité, jusqu’au milieu du jour, était telle que les branchages ruisselaient, rendant la glaise du sentier incertaine et la marche des plus pénibles. À trois reprises, mes tipoyeurs se sont plaqués. Parfois la traversée d’une rivière où l’on eût voulu s’attarder. M’Bengué, de même que Gama, est établi sur un vaste champ libre, conquis sur la forêt qui l’enveloppe de toutes parts, une brusque savane de très hautes graminées, parmi lesquelles, si l’on avance, on disparaît. Je rate trois coups de fusil contre des oiseaux bizarres que j’aurais bien voulu voir de près.
Nos boys sont d’une obligeance, d’une prévenance, d’un zèle au-dessus de tout éloge ; quant à notre cuisinier, il nous fait la cuisine la meilleure que nous ayons goûtée dans le pays. Je continue de croire, et crois de plus en plus, que la plupart des défauts que l’on entend reprocher continuellement aux domestiques de ce pays, vient surtout de la manière dont on les traite, dont on leur parle. Nous n’avons qu’à nous féliciter des nôtres – à qui nous n’avons jamais parlé qu’avec douceur, à qui nous confions tout, devant qui nous laissons tout traîner et qui se sont montrés jusqu’à présent d’une honnêteté parfaite. Je vais plus loin : c’est devant tous nos porteurs, devant les habitants inconnus des villages, que nous laissons traîner les menus objets les plus tentants pour eux, et dont le vol serait le plus difficilement vérifiable – ce que, certes, nous n’aurions jamais osé faire en France – et rien encore n’a disparu. Il s’établit, entre nos gens et nous, une confiance et une cordialité réciproques, et tous, sans exception aucune, se montrent jusqu’à présent aussi attentionnés pour nous, que nous affectons d’être envers eux[49].
Je continue mes leçons de lecture à Adoum, qui fait preuve d’une émouvante application et progresse de jour en jour ; et je m’attache à lui chaque jour un peu plus. De quelle sottise, le plus souvent, le blanc fait preuve, quand il s’indigne de la stupidité des noirs ! Je ne les crois pourtant capables, que d’un très petit développement, le cerveau gourd et stagnant le plus souvent dans une nuit épaisse – mais combien de fois le blanc semble prendre à tâche de les y enfoncer !
11 novembre.
Enfin une étape courte ; partis vers six heures, nous arrivons deux heures et demie plus tard, après une assez belle traversée de forêt, à Sapoua. Réapparition du palmier-liane.
Fait la route à pied. Sapoua, triple ou quadruple village, de plus d’un kilomètre de long, dans un grand espace de savane, semé de grands palmiers rôniers – encerclé lointainement par la forêt. Quantité d’enfants ; certains exquis, que nous retenons près de nous. Un joueur d’instrument bizarre : une calebasse, qu’on tient entre les jambes, au milieu d’un bambou, comme un arc tendu sur six (?) cordes. Il chante avec beaucoup de subtilité, de délicatesse, de nuances, ce que notre interprète traduit : « J’ai tellement de chiques dans mon pied, que je ne peux plus marcher. »
Vers le soir je traverse la savane accompagné de quatre enfants, et gagne la lisière de la forêt. Bain général dans les eaux couleur de thé d’une claire rivière à fond de sable blanc. D’autres enfants m’apportent une quantité de jolis petits hannetons. J’admire combien, quoique de même espèce et de même sexe, ceux-ci peuvent différer les uns des autres. Au muséum, l’on m’avait déjà montré divers exemples de cette diversité, à laquelle ne semblent avoir droit que les mâles. Serait-elle particulière aux régions tropicales ?
Il fait une chaleur étouffante.
Arrivée du manioc pour nos porteurs. Vingt-quatre petits paniers, portés par vingt-quatre petites filles. Sur chaque pain de manioc, une poignée de chenilles frites ; quelques cannes à sucre. « Il y en a pour 5 francs », dit le caporal ; j’en donne le double – car j’ai compris depuis hier, que l’on fait payer au blanc un prix établi fort au-dessous de la valeur réelle. C’est ainsi que le poulet, pour lequel le blanc donne 1 franc, est payé 3 francs par l’indigène. Un de nos porteurs, hier, nous demandait d’acheter à sa place un poulet, que lui paierait trois fois plus cher[50].
On nous apporte des crevettes de rivière ; très grosses, semblables à du « bouquet », n’étaient les pattes de devant, extrêmement longues et terminées par de très petites pinces. Cuites, leur chair reste molle et gluante.
12 novembre.
Cette nuit, médiocre tam-tam, commandé par nous ; que je quitte vite, mais qui retient Marc jusqu’à une heure tardive. Nuit très médiocre ; bêlements incessants des chèvres autour de notre case. Lever à cinq heures et demie ; aube pure, ciel lavé où baigne, presque au zénith, un quartier de lune. Quantité d’énormes palmiers rôniers (tronc renflé, feuilles en éventail ; grappes d’énormes pommes orangées) donnent à la steppe un aspect noble et étrange. Pas un souffle n’agite les hautes herbes ; la route que nous devons suivre est une allée de sable blanc. Départ un peu difficile car nous avons, hier soir, renvoyé quatre hommes prêtés par M’Bengué, sur l’assurance qui nous fut donnée par les chefs, que Sapoua les pourrait remplacer. Les quatre hommes attendus ne sont pas présents à l’appel. Il faut partir. Nous laissons le garde derrière nous. Ce n’est qu’à la première étape (je veux dire au premier village traversé, à dix kilomètres de Sapoua), que nous constatons que les quatre nouveaux porteurs sont des femmes, tous les hommes valides, nous dit le garde, s’étant esquivés dans la brousse au dernier moment, pour échapper à la réquisition. Ce qui ajoute à notre indignation, c’est que les charges laissées aux femmes par nos autres porteurs, sont de beaucoup les plus lourdes. Souvent, les types les plus costauds s’emparent ainsi des charges légères et partent vite de l’avant, pour éviter le contrôle. Nous donnons à chaque femme un billet de cent sous, espérant par notre générosité provoquer le regret des hommes ; – espoir bien vain, car, sitôt de retour dans leur village, les femmes remettront aux hommes ces billets.
La marche de ce matin eut une allure triomphale ; dès le premier village, réception enthousiaste ; chants, cris admirablement rythmés ; peuple d’aspect propre et vigoureux ; nous mettons pied à terre ; les porteurs de mon tipoye ont pris de l’avance. Ce n’est plus de la marche, c’est une sorte de course, escortée de tam-tams, d’une troupe d’enfants rieurs ; plusieurs se proposent comme boys. À partir de ce village, et jusqu’à Pakori, où nous arrivons vers onze heures pour camper, une escorte se forme ; les chants (chœurs alternés) des tipoyeurs, des gens des villages, ne cessent plus. On traverse, avant Pakori, quatre ou cinq villages, de plus en plus étranges, aux habitants toujours plus exaltés. De tout cela, je crains de ne garder qu’un souvenir confus ; c’est trop étrange. Nous sommes enfin sortis du cauchemar de la forêt. La savane prend l’aspect d’un bois clairsemé ; arbres pas très grands, semblables à des chênes-lièges et que souvent une belle plante grimpante, on dirait un pampre, recouvre. Beaucoup de pintades, nous a-t-on dit ; mais les hurlements de tout ce peuple en délire font tout fuir. Les habitants de ce pays, je l’ai dit, ont l’aspect heureux et robuste ; les hommes portent presque tous un étrange tatouage[51] qui, parti du sommet du front, trace jusqu’au bas du nez une ligne médiane, d’un relief très accentué.
Notre escorte (quarante porteurs, plus huit femmes de porteurs, dont trois avec leur nourrisson suspendu au flanc) s’est démesurément grossie. On ne s’y reconnaît plus. C’est le « nous partîmes cinq cents… » Même les chefs veulent nous suivre ; jusqu’au village suivant, tout au moins. On s’arrête pour serrer des mains, en signe d’adieux. Mais quelques kilomètres plus loin l’on retrouve encore ceux dont on avait cru prendre congé.
À Pakori, le plus beau des villages vus jusqu’à présent, où l’on s’arrête, la quantité d’enfants est inimaginable. Je tâche de les dénombrer ; à cent quatre-vingt je m’arrête, pris de vertige ; ils sont trop. Et tout ce peuple vous enveloppe, s’empresse pour la joie de serrer la main qu’on leur tend ; tous avec des cris et des rires, une sorte de lyrisme dans les démonstrations d’amour. C’est presque du cannibalisme.
Pakori ; au soir. Ce grand village est merveilleux. Il a du style, de l’allure ; et le peuple y paraît heureux. L’énorme rue-place (qu’on se figure une Piazza Navone prolongée) est une arène de sable fin. Les cases ne sont plus ces huttes sordides, insalubres et uniformément laides des environs de M’Baîki ; mais vastes, de bel aspect, différenciées ; certaines sont plus grandes, dont celle que nous occupons, où l’on accède par six marches, bâties sur des sortes de monticules, de formation que je ne m’explique guère, semblables à ceux qu’on croit être d’anciennes termitières, qui mamelonnent la plaine entre Mobaye et Bambari. Nous avons longuement parlé avec le sergent-infirmier de Fort-Archambault, en congé de six mois (resté depuis 1906 sans permission, dont dix ans avec le docteur Ouzio). Nous apprenons qu’ici, que dans tout le pays avoisinant[52] (et je pense, dans toute la subdivision de Carnot), on laisse l’indigène vaquer à ses cultures après qu’il s’est acquitté de l’impôt, c’est-à-dire après qu’il a récolté dans la forêt la quantité de caoutchouc suffisante à en assurer le paiement – ce qui lui prend un mois environ. Il ne cultive ici que manioc, sésame, patates et un peu de ricin.
Il est vrai, nous dit l’infirmier, que le blanc paie beaucoup moins cher que l’indigène les cabris et les poulets – qu’il ne les paierait du moins, car celui-ci n’en achète jamais, ou du moins ne les consomme jamais, presque jamais. (De même qu’il ne mange jamais les œufs. Tout au plus donne-t-il aux enfants les œufs gâtés – et pour les autres, ceux qui sont soustraits à la couvée, il les réserve pour le blanc qui passe.) Cabris et poulets sont objets d’échange. La monnaie, encore récemment, encore aujourd’hui, c’est le fer de sagaie, qu’il forge lui-même, estimé cinq francs la pièce. Le cabri vaut de quatre à huit fers de sagaie. On achète une femme indifféremment avec des sagaies ou des cabris (de dix à cinquante fers de sagaie, soit de cinquante à deux cent cinquante francs). Le blanc n’est pas censé acheter le cabri que lui présente le chef. Celui-ci le donne ; puis le blanc, qui en principe ne doit rien, donne un matabiche notoirement inéquivalent, mais que le chef doit toujours accepter avec reconnaissance. Pourtant un certain tarif s’établit : 1 franc par poulet ; 4 à 5 francs par cabri. Il est établi que l’indigène ne sait la vraie valeur de rien. Il n’y a, dans tout le pays, aucun marché, aucune offre, aucune demande. D’un bout à l’autre du village, il n’est pas un indigène qui possède quoi que ce soit d’autre que ses femmes, son troupeau, et peut-être quelques bracelets ou fers de sagaies. Aucun objet, aucun vêtement, aucune étoffe, aucun meuble – et, quand bien même il aurait de l’argent, rien à acheter ne se présente pour éveiller aucun désir.
13 novembre.
Vers 11 heures, nous sommes arrivés à Berberati. Pays tout différent ; même le ciel est changé, la qualité de l’air. Enfin l’on respire. Belle traversée de lande, savane aux graminées hautes de 3 mètres ; coupée par instants de reprises de forêt. Le pays assez puissamment vallonné ; la vue s’étend au loin. Le poste même, maison de l’administrateur, où nous couchons (abandonné faute de personnel), est fort bien situé, sur un revers de plateau, d’où l’on domine une vaste contrée ; mais, comme toujours dans ce pays démesuré, rien ne fait centre ; les lignes fuient éperdument dans tous les sens ; tout est illimité. Seuls, les villages parfois s’organisent. Ils ne sont plus établis seulement le long de la route ; des perspectives se creusent, et les cases sont groupées, non plus en ligne, mais forment divers petits hameaux, parfois charmants.
Le chef de Zaoro Yanga, premier village après Pakori, nous a fait cadeau d’un petit animal bizarre, enfermé dans cette sorte de panier en palmes tressées, qui sert ici de cage à poules. Je crois que c’est un « paresseux »[53]. Il n’a que quatre doigts aux pattes de devant ; l’index restant atrophié ; les pattes de derrière sont prenantes, les pouces nettement opposés au reste des doigts. Les vertèbres cervicales ont des apophyses aiguës, qui soulèvent la peau. Il a la taille d’un chat, une queue très courte ; les oreilles comme coupées. Très lent de mouvements. Très maladroit lorsqu’il marche sur le sol, et disgracieux, mais fort habile à grimper et à se suspendre la tête en bas, à n’importe quel support. Il mange volontiers ce que nous lui offrons, des confitures, du pain, du miel, et se montre particulièrement friand de lait concentré.
On est venu m’apporter un énorme « goliath » que j’ai le plus grand mal à faire entrer dans mon flacon de cyanure, si large que soit son embouchure.
Visite à la mission, où les Pères nous reçoivent très aimablement et nous régalent d’un lait excellent.
De retour au poste, nous observons longuement l’extraordinaire travail de la mouche-maçonne (celle-ci a l’étranglement de son abdomen jaune canari, et non noir comme l’espèce la plus commune). En quelques minutes, elle a complètement muré une araignée dans l’alvéole de terre où elle l’avait forcée d’entrer. D’un coup de couteau, j’ai défait ce travail, découvrant, à côté de la grosse araignée, plusieurs petites ; quelques instants après, les dégâts étaient réparés. Le soir, je me suis emparé de la construction tout entière, la détachant avec peine d’une latte de bambou, où elle était fortement maçonnée. Le tout, gros comme un œuf de pigeon, formé de quatre alvéoles oblongues ; en terre dure comme de la brique, ou presque. Chaque alvéole que j’ai crevée contenait quatre ou cinq araignées assez petites, mais dodues ; toutes fraîches, et qui semblaient moins mortes qu’endormies ; parmi elles, un seul ver, de la taille et de l’aspect d’un asticot. Certainement, c’est là le garde-manger des larves, et je pense que la mouche-maçonne (n’est-ce pas un sphex ?) avait pondu, à côté des araignées, ou dans l’abdomen des araignées, un œuf, dont déjà le ver en question provenait. Malheureusement, ma vue baisse beaucoup, et je ne parviens plus à « mettre au point » les objets un peu délicats.
Magistrale engueulade de Marc à l’un des « gardes » du poste, qui s’est permis de gifler notre cuisinier.
14 novembre.
Sur l’aimable insistance du Père de la Mission, nous nous sommes décidés à demeurer à Berberati un jour de plus. Notre paresseux a trouvé moyen, pendant la nuit, de dénouer la ficelle qui lui tenait la patte et de s’enfuir. Après quelques recherches, on le retrouve juché sous le toit de la véranda. On nous envoie deux chevaux de la mission, où nous sommes attendus à déjeuner.
Il a fallu, ce matin, congédier nos quarante porteurs. Certains d’entre eux étaient de si bon naturel que les larmes me venaient aux yeux en leur disant adieu. Ceux-ci nous accompagnaient depuis Nola. L’un en particulier, une sorte de grand diable, l’air d’un Mohican, une plume du faucon que nous avions tué passée dans un trou de l’oreille, dégingandé, un peu clown, blagueur – qui voulait nous accompagner jusqu’à Carnot et lui aussi était aux regrets de nous quitter. Quand on lui montrait les traces d’un gibier, empreintes sur le sable de la route, il disait : « C’est petit la viande… »
Très intéressante conversation avec le Père Supérieur de la Mission. Avant le déjeuner il nous mène, à deux kilomètres de là, voir l’important troupeau de vaches zébus qu’il a fait venir de N’Gaoundéré. Nous ne quittons la mission que le soir.
16 novembre.
Pas pu prendre de notes hier ; arrivés trop fatigués au poste de Bafio, vers le soir. Étape de trente-cinq kilomètres, faite pourtant presque entièrement en tipoye. Rien de plus lassant que ce mode de locomotion, lorsque les tipoyeurs ne sont pas supérieurement dressés. C’est un menu trot qui secoue comme celui d’un mauvais cheval. Impossible de lire. Le pays a changé. Plus profondément vallonné. Grands plateaux. Depuis Berberati, plus de tsé-tsés, plus de maladie du sommeil ; d’où les troupeaux de la mission, et les chevaux des chefs de villages. Ceux-ci ne sont plus uniformément établis le long des routes en longues suites rectilignes ; les cases, non plus carrées, mais rondes, aux murs de terre et au toit pointu de chaume et de roseaux. L’influence arabe commence à se faire sentir ; les chefs ont enfin un costume et ne sont plus ridiculement affublés de dépouilles européennes. Ils portent le boubou des Bornouans ou des Haoussas, bleu ou blanc, orné de broderies. Chose assez déconcertante : à notre passage dans les villages, c’est bien à notre occasion que l’on organise le tam-tam, mais c’est autour du chef que les danses se groupent ; ce n’est plus à nous, c’est à lui que les habitants des villages rendent les honneurs. Ces chefs, le plus souvent, sont à cheval ; un cheval qu’ils se plaisent à faire galoper, piaffer ; c’est déjà presque la fantasia arabe ; ils ont de l’allure, de la noblesse et sans doute une incommensurable vanité. L’un d’eux, à qui je tends un billet de cinq francs, en plus du paiement du manioc apporté pour nos hommes, et des œufs ou poulets pour nous, prend avec morgue le billet et le passe aussitôt, dédaigneusement, à un serviteur qui l’accompagne. Un autre, qui n’a pas de cheval, est porté sur les épaules de ses sujets, comme en triomphe ; toutes les acclamations vont vers lui. Les deux fils de Bafio[54], fort beaux, propres (en apparence) et dignes, sont venus à cheval à notre rencontre. En arrivant ici, ils ont soif et demandent à boire. Me trompé-je ? L’un d’eux se signe avant d’approcher la calebasse de ses lèvres. Fort intrigué je m’informe. Serait-ce un « converti » ?… Mais non. Il n’a pas abjuré l’Islam. S’il se signe, c’est en surplus. Tous deux jeunes encore, et d’une courtoisie charmante. Le père a le menton enveloppé dans une lehfa qui l’enturbanne ; on nous dit que c’est pour cacher sa barbe, à la manière des Haoussas (?).
De très beaux papillons, à chaque passage de rivière. Ils sont par « bancs » ; et, pour la première fois, hier, je vois un banc de porte-queue, la plupart noirs zébrés d’azur ; un, que je vois pour la première fois, noir, largement lamé de sinople ; le revers des ailes porte une ligne courbe de taches d’or ; c’est la première fois que je vois de l’or sur les ailes d’un papillon ; non point du jaune, mais de l’or. Ces papillons sont en essaim, à terre, probablement sur une trace d’excrément, si pressés que leurs ailes se touchent, bien que refermées ; immobiles et si occupés ou si engourdis qu’ils se laissent saisir entre le pouce et l’index – et non point par les ailes qu’on risquerait ainsi de détériorer, mais par le corselet. Et j’en capture ainsi une dizaine d’admirables, dans un état de fraîcheur parfaite.
Chose ahurissante : une quantité d’abeilles se promènent et s’activent sur le bord de leurs ailes, sur le tranchant ; il me semble d’abord qu’elles les mordillent et les coupent ; mais non ; tout au plus les sucent-elles… je crois ; les papillons les laissent faire, et tout cela reste incompréhensible[55].
Marc, qui a dû attraper un coup de soleil, est assez souffrant. L’atmosphère est étouffante ; il ne fait pas très chaud, mais l’air semble chargé d’électricité, de je ne sais quoi qui le rend difficilement respirable. Nous décidons de nous reposer ici tout un jour.
Je passe un temps considérable, ce matin, à apprivoiser mon paresseux, qui se montre extrêmement sensible à la caresse, et qu’il n’y a plus moyen de déloger de mon giron lorsqu’il s’y est blotti.
Hier, à dix kilomètres environ de Bafio, en pleine brousse, un exprès dépêché de Carnot est venu nous apporter le plus inattendu des courriers de France.
Carnot, 19 novembre.
Carnot ne ressemble en rien à ce que je l’imaginais.
Le bourg s’étale sur l’épaule de la colline d’où l’on domine le pays, par-delà la Mambéré ; mais le paysage reste informe ; immenses vagues d’un terrain couvert de forêts. Incertitude même de la pente générale, de la direction ; une sorte de difficulté d’option pour la répartition des eaux.
Le grand événement du 17 (avant-hier) ç’a été la rencontre de l’administrateur Blaud que vient de rappeler brusquement dans le pays (nous étions avisés de cela) une demande d’enquête administrative, à la suite d’un acte d’accusation lancé contre lui par la direction de la Forestière. Blaud est un gros garçon bien en chair, le teint frais, la face réjouie ; fils d’un pharmacien de Beaucaire ; il accuse 42 ans, mais ne paraît pas son âge. Nous l’avions précédemment rencontré, je l’ai dit, à notre passage à Boda. À fin de séjour, il repartait pour la France où l’attendaient sa femme et une fillette de six ans. Pendant le déjeuner que nous avions pris ensemble à la table du sinistre Pacha, Blaud nous avait dit qu’il poursuivait la Forestière pour infractions graves aux clauses du règlement et de la convention. Sitôt avisée de cette accusation, la Forestière prit les devants, et, après échange de télégrammes avec la direction de Paris, décida de discréditer Blaud. Le moyen est bien simple : l’accuser très fort et très haut d’avoir lié partie avec les commerçants libres et de s’être laissé corrompre par eux. Comment sinon pourrait-il trouver rien à redire à la Forestière ? Donc, avisés du rappel brusque de Blaud à Carnot (où l’administrateur-maire de Bangui, M. Marchessou, doit enquêter sur ses actes de service), puis de son retour vers Nola, nous savions que nous devions le rencontrer. Nous avions pris nos mesures pour le croiser à mi-route, à l’heure du déjeuner que nous espérions pouvoir prendre ensemble. Mais au moment de quitter Bafio, il y eut défection de porteurs, désordre et confusion, ce qui nous retarda de près d’une heure. Il était onze heures environ quand, à un détour de la route, brusquement, nos tipoyeurs et les siens se trouvèrent nez à nez. Nous étions en pleine savane ; les quelques arbres rabougris qui la parsèment ne fournissent qu’une ombre dérisoire… Blaud, plus désireux encore que nous de causer, proposa de revenir jusqu’au passage de la rivière où l’on a coutume de s’arrêter pour le repas. Ainsi fut fait. – Le site était merveilleusement bien choisi ; grands arbres sous lesquels l’eau coulait, rapide, abondante et si claire que j’eus bien du mal à résister à la tentation du bain. Il me semble par là communier plus intimement avec la nature… Bref, je me contentai d’un bain de pieds. On dressa la grande table de Blaud, trois couverts et tandis que le repas se préparait, Blaud sortit tout le dossier de son accusation. Je ne connaissais rien des faits que lui reprochait la Forestière, mais ne pouvais, après ce que j’avais vu et appris en cours de route, mettre en doute ceux que Blaud reprochait aux agents de la Compagnie ; de sorte que je souhaitais vivement qu’il n’eût pas, lui, prêté le flanc à la contre-attaque ; mais sur ce point je devais faire toutes réserves. Blaud semblait extrêmement affecté ; et vraiment il y avait de quoi, car la puissance et l’entregent de ces Grandes Compagnies sont formidables. Blaud nous apprit incidemment le changement du ministère et la prolongation du séjour d’Antonetti à Paris.
21 novembre.
Le chauffeur de Lamblin que nous retrouvons ici (celui qui nous menait à Bambio) où il est venu amener M. Marchessou, nous dit qu’en traversant Boda il a pu apprendre l’emprisonnement de Samba N’Goto et de son fils. Cependant Pacha est en tournée, et le sergent Yemba l’accompagne.
M. Marchessou n’est du reste plus à Carnot ; il enquête à Nola, où a dû le rejoindre Blaud.
Longues conversations avec M. Labarbe, qui remplace l’administrateur absent. Labarbe est un homme volumineux, au coffre sonore, à la voix chaude, vibrante et bien timbrée ; jeune encore, intelligent, très conscient de l’effet qu’il veut produire, et de celui qu’il produit. Parfois il porte l’index de la main gauche à son œil, pour indiquer qu’« il la connaît » et qu’« on ne la lui fait pas ». Comme pour justifier son nom, une épaisse barbe noire cache le bas de son visage. Il n’est aidé que par le doux M. Chambeaux ; anémié, demandant son retour à Bordeaux, où il doit retrouver sa femme et une petite fille de deux ans, qu’il ne connaît pas encore. Labarbe lui-même déclare qu’il en a assez, qu’il en a trop… Il demande en vain du secours. M. Staup, qui le précédait et a été déplacé, avait renvoyé l’« écrivain » de la circonscription, qui devait servir de secrétaire à l’administrateur, sous prétexte que sa femme à lui « tapait à la machine » ; à présent, plus moyen de s’en ressaisir ; il est obligé, lui, Labarbe, de tout faire lui-même. Et Antonetti qui parlait, à son passage, de « coup de balai » ! Il n’y avait déjà personne, et il voulait encore renvoyer du monde ! D’ailleurs c’était bien simple : il était résolu, lui, Labarbe, à laisser les papiers s’accumuler sur sa table ; on verrait bien ce que ça donnerait ; puisqu’on ne lui envoyait personne pour l’aider. Il avait laissé toutes ses affaires à Baboua d’où il venait d’être brusquement rappelé pour remplacer Blaud à Carnot ; il partirait dès demain pour les rechercher. Un poste de plus à l’abandon. Tout marchait à la déroute dans ce pays. Pas de médecins, pas de fonctionnaires. Le peu de monde qui restait encore était sur les dents et ne songeait plus qu’à partir. Oui, tout le monde fichait le camp : c’était la pagaïe. Dans ce sacré pays de la Haute-Sangha où personne ne voulait venir, on ne trouvait rien, pas le moindre objet, pas de vivres ; l’application stricte des tarifs douaniers faisait revenir la moindre denrée à des prix prohibitifs[56] Et que d’embêtements, de tracasseries !… On lui avait confisqué sa jumelle à la douane, à son dernier retour ; une jumelle qui l’avait accompagné partout et que tout le monde connaissait… parce qu’il avait égaré les reçus des droits payés précédemment et n’avait pu montrer les factures dénonçant le prix d’achat. On ne pouvait pas toujours conserver tous ses papiers, que diable !… D’ailleurs, ils n’avaient qu’à la garder, sa jumelle ; il n’irait même pas la réclamer à son départ…, etc.
Nous nous sommes fait conduire en tipoye, hier – après une forte tornade (avec éclairs, tonnerre et tout le tremblement) que nous entendions vaguement à travers le sommeil de la sieste – à Saragouna, à une demi-heure de Carnot (amusante et un peu dangereuse traversée d’une très belle rivière, sur un pont chancelant et à demi ruiné). Nous doutions d’abord de la véracité de Psichari, qui situe à trois jours de Carnot cet « oasis de verdure », mais nous apprenons que le village a déménagé, comme tant d’autres ; les habitants ont brusquement abandonné leurs huttes pour les reconstruire à quelques jours de là. – Pourquoi ? – Parce que quelques morts leur avaient fait croire que l’emplacement était maudit, hanté, que sais-je… Les gens qui ne possèdent rien, et n’ont rien à quitter, n’ont jamais beaucoup de mal à partir.
À noter : le brusque travail de désherbement sur lequel se précipitent toutes les femmes du village, à notre approche.
Nous avons quitté Carnot ce matin, beaucoup plus tard que nous n’eussions voulu, ayant dû attendre plus d’une heure les nouveaux porteurs. Il était huit heures passées quand nous prenons le bac, au sortir de la ville. Trois fournées ; nous étions de la dernière, et pas très rassurés, car le courant est extrêmement rapide. À une heure de marche dans la steppe monotone (sorte de forêt clairsemée, d’arbres à peine un peu plus hauts que les herbes, très hautes et belles graminées qui les enveloppent, les noient et dont l’épais rideau constant arrête incessamment le regard) nous croisons un grand nombre de porteurs ; puis, escortés par des gardes armés de fouets à cinq lanières, une enfilade de quinze femmes et deux hommes, attachés au cou par la même corde. Une de ces femmes porte un enfant au sein. Ce sont des « otages » enlevés au village de Dangolo, où les gardes avaient été réquisitionner quarante porteurs, sur l’ordre de l’administration. Tous les hommes, en les voyant venir, avaient fichu le camp dans la brousse[57]… Marc prend une photographie de ce pénible cortège. L’étape est beaucoup plus longue que Labarbe ne nous l’avait dit. Force est de coucher où nous pensions arriver pour le repos de midi et où nous n’arrivons qu’après quatre heures : à Bakissa-Bougandui, – sorte de village, très différent de ceux de la région de Bambio et de tous ceux traversés avant Carnot. Les cases rondes, aux murs de terre très bas, aux toits de chaume pointus, s’éparpillent, se groupent au gracieux hasard, sans plan aucun, sans rue, sans alignement, ni circulairement autour d’aucune place. Nous sommes au plus haut d’un plateau dégarni. Tout autour de nous, du moins à l’est, au nord et à l’ouest, la vue s’étend très loin sur de mornes et immenses vagues de terrain couvertes de forêts d’un vert uniformément sombre, sous un ciel désespérément gris.
Pour n’être point injuste, il me faut dire qu’il a fait beau, très beau, vers le milieu du jour. Mais tous les matins, tous, sans exception, sont gris, ternes, voilés, d’une tristesse indicible, incomparable. Ce matin, au départ du moins, un assez épais brouillard adoucissait les tons des verdures et limitait heureusement la vue – qui sinon ne s’étend, au lever, que sur du terne, du vert sans joie sous un ciel sans promesses, un paysage que ne semble habiter aucun dieu, aucune dryade, aucun faune ; un paysage implacable, sans mystère et sans poésie.
En tipoye, ne pouvant lire, je repasse tout ce que je sais des Fleurs du Mal, et apprends quelques pièces nouvelles.
Ce soir, dans le village, non loin de moi, un tam-tam s’organise ; mais je reste assis devant la petite table dressée, à l’insuffisante clarté de la lanterne-tempête, avec les Wahlverwandtschaften, ayant achevé de relire le Master of Ballantrae. La lune, à son premier quartier, est presque au-dessus de ma table. Je sens m’environner de toutes parts l’étrange immensité de la nuit.
Un peu plus tard je vais pourtant rejoindre la danse. Un maigre feu de broussailles, au milieu d’un grand cercle ; une ronde qu’activent deux tambours et trois calebasses sonores, emplies de graines dures, et montées sur un manche court qui permet de les agiter rythmiquement. Rythmes savants, impairs ; groupes de dix battements (cinq plus cinq) puis, sur le même espace de temps, succède un groupe de quatre battements – qu’accompagne une double cloche ou castagnette de métal[58]. Les joueurs d’instruments sont au milieu. Près d’eux un groupe de quatre danseurs forme vis-à-vis, deux à deux. Les gens de la ronde se suivent par rang de taille, les plus grands d’abord, puis les enfants, jusqu’à des tout petits de quatre ou cinq ans ; les femmes suivent. Chacun se trémousse en agitant les épaules, les bras ballants, et progresse très lentement de gauche à droite, à la fois morne et forcené. Quand je pose ma main sur l’épaule d’un des enfants, il se détache du cercle et vient se presser contre moi. Des hommes, qui contemplent la danse, voyant cela, en appellent un autre qui vient à mon autre côté. À une suspension de la danse, les deux enfants m’entraînent. Ils resteront assis à terre, près de ma chaise, durant notre repas. Ils voudraient devenir nos boys. D’autres se sont joints à eux. Dans la nuit qui les absorbe, on ne distingue exactement que leurs yeux qui restent fixés sur nous et, quand ils sourient, leurs dents blanches. Si je laisse pendre ma main, ils la saisissent, la pressent contre leur poitrine ou leur visage et la couvrent de baisers. À côté de moi, sur ma chaise, le petit paresseux sommeille ; je sens sa chaleur douce contre mes reins. Je l’appelle à présent Dindiki, du nom que lui donnent les indigènes.
À noter le mauvais vouloir, presque l’hostilité de ce village (et du précédent) lorsque nous arrivons ; hostilité qui bientôt cède et fond devant nos avances, et fait place à un excès de sympathie aux effusions et démonstrations chaleureuses. Le chef même, qui d’abord se dérobait et déclarait ne pouvoir trouver des œufs pour nous, du manioc pour nos hommes, s’empresse à présent et propose plus qu’on ne lui demandait d’abord.
22 novembre.
Nous quittons Bakissa-Bougandui (quel nom de banlieue !) avant six heures ; tous les enfants accourent et nous escortent jusqu’à la sortie du village. Nous nous enfonçons dans un brouillard épais. Le paysage s’agrandit ; les plis de terrain deviennent plus vastes. Nous suivons longtemps « la ligne des crêtes », puis descendons dans un vallonnement profond. Marche prolongée tout le matin, jusqu’à midi presque (avec une heure d’arrêt), sans aucune fatigue ; nous avons dû bien faire ainsi près de 25 kilomètres. La pluie, qui s’est mise à tomber avec abondance, seule nous a forcés à monter en tipoye, avant d’avoir atteint l’étape. Jusqu’à présent nous avions évité les tornades ; elles n’éclataient que pendant la nuit ou pendant nos repas. Mais à présent ce n’est pas un orage ; le ciel est uniformément gris et l’on sent que l’averse va durer longtemps. La pluie redouble tandis que nous atteignons le premier village ; ce qui n’empêche ni les tam-tams, ni les cris, ni les chants. Mais il n’y a plus désormais de chœurs de bacchantes ; en particulier celle que nous appelions « la vieille folle » et que, de village en village, il nous semblait toujours retrouver, est absente.
Après une heure d’attente un peu morne, la pluie cesse ; nous repartons. J’ai pris Dindiki dans mon tipoye, ce qui m’y fait remonter un instant. À une heure et demie de là, Cessana, important village (disposé comme Bakissa-Bougandui, comme tous ceux de la région) où nous nous arrêtons pour déjeuner. Puis, de nouveau, sitôt après, très longue étape ; mais cette fois en tipoye. Nous arrivons à Abo-Boyafé, vers quatre heures, exténués. Et c’était ce village où l’administrateur nous affirmait que nous pourrions coucher le premier jour. Presque toujours les renseignements que nous ont donnés les Européens se sont trouvés faux[59].
23 novembre.
Par crainte d’exagérer, j’ai sous-estimé la longueur de notre marche, hier. Nous avons fait une journée de dix heures – dont deux heures d’arrêt, et une heure et demie de tipoye. Soit six heures et demie à pied, à raison de près de six kilomètres à l’heure ; car nous marchions très vite. Trop fatigué, c’est à peine si j’ai pu dormir. Il fait à la fois presque frais et étouffant. On nous a parlé de l’étape du lendemain comme très courte ; mais force est de constater que ce renseignement, pour être donné par des indigènes, n’est pas plus exact que les précédents. Abba, où nous devions arriver à midi, nous ne l’atteindrons pas avant quatre heures du soir, bien que partis dès avant six heures, et ayant marché bon train. Il faut bien avouer que cette immense traite a été des plus décevantes. La même savane s’est déroulée devant nous durant des heures et des lieues. Les graminées géantes se sont faites roseaux. Au-dessus d’eux, toujours les mêmes arbres rabougris, déjetés, fatigués je pense par les incendies périodiques, forment une sorte de taillis clairsemé. Le seul intérêt de tout le jour, ç’a été le passage d’un pont de lianes – notre premier – jeté sur une rivière large, profonde, au cours rapide – la « Goman », – en remplacement d’un pont de bois effondré. Rien de plus élégant que cet arachnéen réseau, d’apparence si fragile que l’on s’y aventure en tremblant. Non loin, plongeant dans la rivière, un pandanus gigantesque, ajoute à l’exotisme du tableau. Et, durant tout le trajet qui nous éloigne si redoutablement – je pense éperdument à des choses de France : à M… avec une angoisse continue. Ah ! si du moins je pouvais savoir qu’elle va bien, qu’elle supporte bien mon absence… Et je m’imagine au Tertre près de Martin du Gard, à Carcassonne près d’Alibert…
Mauvais vouloir du chef du village. Arrivés à Niko. Nous nous étions fait précéder d’un coureur, afin de trouver le manioc de nos hommes tout préparé et de pouvoir repartir aussitôt. Pas de manioc. Force a été de perquisitionner dans les cases. Nous avons néanmoins payé cet homme stupide et buté, lui laissant entendre que nous lui eussions donné le double, s’il avait apporté de lui-même et de bonne grâce cette nourriture dont nos porteurs avaient besoin et qu’il lui était facile de récupérer dans les champs aussitôt. C’est la première fois qu’il nous arrive de devoir faire acte d’autorité.
Sitôt qu’il a triomphé du brouillard, le soleil est devenu accablant. Nous usons largement des tipoyes, car, au bout d’un petit temps de marche, je sue comme il n’est pas croyable. Vers le soir la lumière devient admirable. On approche d’Abba. Un messager envoyé à notre rencontre à deux kilomètres du village, commence à sonner de la cloche pour nous annoncer. Il nous précède, et les tipoyeurs se mettent à courir. Voici le chef à cheval. Comme il met pied à terre, nous descendons aussi. Un peuple se tient sur une éminence. Ça fait grand, et nous avançons très dignes. Les cases du village sont vastes, belles, semblables à celles des villages précédents, mais portant au sommet de leur toit pointu une grande cruche ronde de terre noire, goulot en l’air ; sans ordre, mais formant, à cause des mouvements de terrain, d’harmonieux groupements. On domine une immense contrée. Le soleil se couche glorieusement et, tout aussitôt, un rideau de brume bleue très légère, faite aussi des fumées du village, s’étend horizontalement et recule la lisière de la forêt voisine. Plus un nuage au ciel. Au zénith, la lune à sa première moitié ; loin d’elle, deux étoiles extraordinairement brillantes. Des feux s’allument dans le village. C’est d’abord un immense silence, puis l’air s’emplit du concert strident des grillons.
Les porteurs retardataires s’amènent un à un ; plusieurs clopinent et paraissent fourbus. À certains nous faisons prendre de la quinine. On a distribué le manioc. Ils se groupent autour d’un grand feu. Le ciel s’emplit d’étoiles.
Je n’ai pas remis mon Dindiki dans sa cage. Il est resté tout le jour (et hier déjà) dans mon tipoye ; agrippé à l’une des tiges de bambou qui soutiennent les nattes du shimbeck, ou blotti contre moi. On n’imagine pas animal plus confiant. Il accepte sans hésiter toute nourriture qu’on, lui offre et mange indifféremment du pain, du manioc, de la crème, de la confiture ou des fruits. Il n’y a qu’une chose qu’il ne supporte pas, c’est qu’on le force à se hâter ou qu’on tente de lui faire quitter son appui. Il entre alors dans de terribles rages, pousse des cris aigus et mord tant qu’il peut. Impossible de lui faire lâcher prise ; on le disloquerait plutôt. Puis, sitôt qu’on le tient dans ses bras, il se calme et vous lèche. Aucun chien, aucun chat n’est plus caressant. Tandis que je me promène dans le village, il reste accroché à ma ceinture, ou au col de ma chemise, à mon oreille, à mon cou.
Lu avec ravissement quelques pages des Affinités. Je donne chaque soir une leçon de lecture à Adoum.
25 novembre.
Passé le jour d’hier à Abba ; repos. Marc visite l’intérieur des cases et m’emmène admirer, dans certaines, une sorte d’épais mur-paravent de terre, légèrement concave et formant dossier surélevé au banc bas qui se dresse face à l’entrée. Bien à l’abri derrière cette paroi, le « créquois »[60] ou la natte sur laquelle on dort. Ce large paravent est sobrement orné d’une très large décoration géométrique, noir luisant et couleur de terre rouge (réservée) d’un fort bel effet. De côté, contre les murs de la case circulaire, entassement de ces énormes vases de terre vernissée, décorés de reliefs, comme tatoués, dans lesquels ils mettent l’eau, le manioc, et qui sont, avec le créquois ou la natte, les seuls objets ou meubles de la case. Un troupeau d’enfants, comme toujours, nous escorte ; la plupart sont mal lavés ; on leur fait honte. Ils rentrent dans leurs cases et reparaissent bientôt après tout lustrés par l’ablution.
Marc organise de grandes courses d’enfants sur la place. Ils sont plus de soixante à concourir sous les yeux des parents amusés et ravis. Chef de village très sympathique, qu’on sent conquis par nos manières et que nous payons largement. Les porteurs ont organisé un tam-tam ; un danseur soliste excite l’enthousiasme des spectateurs (des enfants en particulier, qui s’empressent) – en imitant, dans une danse extraordinairement stylisée, la poule, la cavale en rut, et je ne sais quels animaux.
Plusieurs de nos porteurs viennent se faire soigner les pieds ; nous devons en licencier quatre. Un cinquième, qui se traîne à peine, nous paraît tirer la carotte. En effet il nous accompagne le lendemain, et ne parle plus de son mal lorsqu’il comprend qu’il ne sera pas payé s’il refuse sa charge.
Ce matin, départ avant six heures.
À midi, arrêt à un très beau et grand village (Barbaza). Même forme de cases et même disposition d’icelles en petits groupements, sans ordre apparent, mais répondant aux mouvements du sol. Et peu à peu des sortes de sentiers se forment, presque des rues, bordées parfois de claires-voies, séparant les groupes de cases. Toujours ces grosses poteries noir vernissé, au sommet des toits.
Encore une étape beaucoup plus longue que celles entre Bambio et Nola (à la seule exception de la première, de Bambio à N’Délé). Partis d’Abba avant six heures, nous n’arrivons à Abo-Bougrima qu’à quatre heures, ne nous étant arrêtés qu’une heure pour déjeuner. La vue devient de plus en plus étendue, les vallées plus larges et profondes, les plis de terrain plus accentués.
Au premier village où nous nous sommes arrêtés après Abba (n’était-ce pas déjà Barbaza ?) très grand, très important et que je décrivais tout à heure, nous avons été attirés par des chants. C’étaient des chants funèbres. Nous avons pénétré dans un de ces enclos, minuscule agglomération de quatre à six huttes, subdivision du grand village. Une vieille femme était morte. Il y avait là ses enfants, ses parents, ses amis. Tous exhalaient leur douleur en un chant rythmé, une sorte de psalmodie. On nous présente le fils, un grand homme déjà âgé lui-même ; sa face était ruisselante de larmes ; tandis que nous le saluions, il ne s’arrêta pas de chanter en pleurant ou de pleurer en chantant, avec force sanglots coupant la mélopée. Du reste, tous les visages étaient baignés de pleurs. Nous nous approchâmes de la hutte d’où sortait le plus épais des cris. Nous n’osions entrer, mais comme nous nous penchions vers l’ouverture de la hutte, analogue à l’entrée d’un pigeonnier ou d’une ruche, les chants s’arrêtèrent. Un mouvement se fit dans la hutte et quelques gens en sortirent. C’était pour nous faire place et nous permettre de voir le corps. Il était étendu sur le sol, sans apprêt, de côté, comme celui de quelqu’un qui dort. Dans la demi-obscurité nous pûmes entrevoir une cohue de gens, qui bientôt reprirent leur train funèbre. Certains s’approchaient du corps de la vieille et se penchaient, et se précipitaient sur elle comme tentant de l’éveiller, et caressaient et soulevaient ses membres. Toutes les faces que l’on pouvait distinguer paraissaient luisantes de pleurs. Dans l’enclos, non loin de la case, deux indigènes creusaient un trou très profond et peu large, ce qui nous laissa supposer qu’on ensevelit les morts verticalement, tout debout. Continuant notre tournée dans le village, nous vîmes de-ci de-là, près des cases, de très petits rectangles semés de gravier blanc et entourés d’un treillis bas de branchages, qu’on nous dit être des tombes – et nous nous en doutions. Et pourtant combien de fois n’avons-nous pas entendu répéter que les indigènes de l’Afrique centrale n’ont aucun souci de leurs morts et les ensevelissent n’importe où. À tout le moins, ceux-ci font exception.
Arrivés quelque peu exténués à Abo Bougrima, je n’avais d’autre désir, après le tub et le thé, que de me replonger dans les Wahlverwandtschaften que, malgré l’absence (hélas !) de dictionnaire, je comprends beaucoup mieux que je n’osais espérer. Mais, à la tombée du soir, et tandis que Marc s’en allait avec Outhman tâcher de tuer quelques pintades, j’ai commencé de suivre, derrière la case des passagers, au hasard, un tout petit sentier, à demi caché par les hautes herbes. Il m’a mené presque aussitôt à un quartier de Bougrima que l’on a laissé tomber en ruines. Sur un grand dévalement, des espaces, entre les cases abandonnées et sans plus de toiture, formaient place. Les murs crevés des cases circulaires, assez distantes les unes des autres, laissaient paraître cette sorte de mur intérieur formant niche cintrée et dossier de banc bas, dont j’ai parlé plus haut. Je pus admirer à loisir et pleinement éclairées, encore que le jour fût près de s’éteindre, les belles décorations de ces parois. J’ai constaté l’emploi de trois couleurs – et non simplement du noir comme j’avais cru tout d’abord – mais encore du rouge brique et de l’ocre. Et tout cela si vernissé, si glacé, que les intempéries n’avaient pu que très peu le dégrader ou le ternir. De côté (et, m’a-t-il paru, toujours sur la droite) de très curieux commencements de piliers qui servent de supports à de grands vases superposés. Par suite de l’enlèvement des toitures, qu’on a dû brûler, ou dont on s’est resservi – ces ruines ont un aspect net, propre – sans aucun débris de paille ou de bois.
La végétation de la brousse avait envahi ces restes de village, et parfois une plante grimpante à larges et belles feuilles retombait et formait cadre ou feston à ces étranges parois en ruine, faisant valoir la richesse et la sonorité de leurs tons. On eût dit une sorte de Pompeï nègre ; et je me désolais que Marc ne fût point là et que l’heure fût trop tardive pour prendre quelques photographies. Solitude et silence. La nuit tombait. Peu de spectacles m’ont plus ému, depuis que je suis dans ce pays.
26 novembre.
Enfin un jour splendide. Le premier matin clair depuis longtemps – il me semble même que, depuis que je suis en A. E. F., nous n’avons jamais eu que des matins gris et brumeux. Oh ! le ciel n’était pas parfaitement pur, mais la lumière était chaude et plus abondante que jamais. Est-ce seulement à cause d’elle que le pays m’a paru beaucoup plus beau ? Je ne crois pas. Des affleurements de roche donnaient par instants un dessin plus marqué ; d’énormes boulders de granit. Les arbres, pas plus grands que ceux de nos pays, formaient dans la savane une sorte de forêt claire continue. Parfois quelques rôniers. Le ciel était d’un bleu profond et tendre. L’air était sec, léger. Je respirais avec délices et tout mon être s’exaltait à l’idée de cette longue marche, de cette traversée de l’immense pays qui s’étendait lointainement devant nous.
Rien à noter, du reste, que le repas au bord d’une rivière, puis, sous l’ardent soleil, plus tard, la traversée de la Mambéré, où nos tipoyeurs se baignent. Marc me retient d’en faire autant. Je me soumets en maugréant.
À une grande distance de Baboua, les nouveaux chefs viennent à notre rencontre. Ce sont les deux frères du chef reconnu par l’administration française, lequel s’est enfui tout dernièrement au Cameroun, avec les 700 francs que l’administrateur lui avait remis pour payer des nattes, travail des hommes de son village[61]. Ces deux nouveaux chefs sont à cheval et se dressent devant nous, la lance haute pointant vers nos tipoyes, et poussant des cris si farouches que je crois d’abord qu’ils veulent nous empêcher d’avancer. Un des chevaux rue, crève un tam-tam et bouscule le tipoye de Marc. Je mets pied à terre et m’avance en souriant. Explications, grand désordre – puis l’avant-garde que nous formons se remet en marche, précédée de cinq cavaliers, dont les deux chefs non reconnus, très beaux dans leurs vêtements arabes que le vent de leur course gonfle et fait flotter autour d’eux. Nous avons pris sur nos boys et nos porteurs une forte avance et tandis que j’écris ces notes, après nous être rasés, rafraîchis, avoir dégusté mandarines et bananes, nous les attendons encore.
Baboua, 27 novembre.
Adoum s’est amené, clopinant, hier soir, longtemps après les autres, souffrant d’une adénite très apparente. Je crains un phlegmon et ne sais que faire, sinon application de compresses humides. Je lui fais prendre au surplus quinine et rhofeïne ; il s’étend dans l’obscurité et s’endort. Il avait dû s’arrêter deux fois en cours de route, pris de vomissements. La chaleur était très éprouvante.
La maison du « commandant » (administrateur) et la case des passagers où nous sommes descendus, sont à quelques centaines de mètres du village – où nous nous rendons avant le coucher du soleil, accompagnés de l’interprète et des deux nouveaux chefs. Surprise de trouver le village complètement déserté. Le vrai chef en s’enfuyant a entraîné la désertion de tous ceux qui pensaient marquer ainsi leur attachement. Trente hommes (avec famille) l’ont, nous dit-on, accompagné sur la subdivision voisine, en territoire du Cameroun. Deux cents autres, environ, se sont répandus au loin dans la brousse, où ils vivent depuis quelques mois. Nous pénétrons dans la maison du chef, abandonnée. On y accède par un dédale de murs de terre et de cloisons de roseaux, fait pour faciliter l’embuscade et la défense. Derrière la maison, les cases de femmes, en hémicycle et ouvrant sur une sorte de cour, – tout est vide et désert.
Nuit splendide. Le soir, tam-tam, d’abord très distant, puis dont les sons se rapprochent. Après une bonne tranche des Affinités et ma leçon de lecture à Adoum, nous nous y rendons. Malgré la désertion du village, ils trouvent le moyen d’être encore une soixantaine, des deux sexes et de tous âges. On n’imagine rien de plus morne et de plus stupide que cette danse, d’un lyrisme que plus rien de spirituel ne soulève. Au son du tambour et de la même phrase musicale, reprise en chœur et inlassablement répétée, tous tournent en formant une vaste ronde, les uns derrière les autres, avec une extrême lenteur et un trémoussement rythmique de tout le corps, comme désossé, penché en avant, les bras ballants, la tête indépendante animée d’un mouvement de va et vient, comme celle des oiseaux de basse-cour. Telle est l’expression de leur ivresse, la manifestation de leur joie. Au clair de lune, cette obscure cérémonie semble la célébration d’on ne sait quel mystère infernal, que je contemple longuement, sur lequel je me penche comme sur un abîme, comme Antoine sur la bêtise du catoblépas : « Sa stupidité m’attire. »
Ce matin, le ciel le plus clair, le plus radieux que j’aie peut-être vu toute ma vie. L’air est léger ; la lumière profuse ; d’un bord à l’autre du ciel, s’étale un éblouissement. Je crois que Baboua est à près de 1 100 mètres d’altitude. Il a fait presque froid cette nuit. Labarbe est arrivé vers midi, si excédé qu’il n’a pu accepter notre invitation à déjeuner. Il ne mangera qu’après avoir liquidé certaines affaires pressantes et rendu la justice – et peut-être ne mangera pas du tout. Nous décidons de le retrouver vers trois heures et de lui amener Adoum qui souffre de plus en plus. Le malheureux garçon n’a pu dormir, ni même rester couché, a passé presque toute la nuit plié en deux sur un créquois. Labarbe a fait des études de médecine et j’attendais son conseil, son intervention peut-être, avec impatience. Il va devoir, nous dit-il, percer la poche qui s’est formée et introduire des mèches dans la plaie. Adoum s’est cependant traîné jusqu’à la demeure non lointaine du commandant, refusant les porteurs. Il semble extrêmement gêné lorsqu’on lui dit de se dévêtir. Je crois d’abord que c’est de la pudeur. Hélas ! la chute de la culotte découvre quantité de grosses pustules suppurantes au haut des cuisses. Dès le début des réticences, Labarbe avait compris ce qui en était, ce qui fait qu’il ricane et accable Adoum de ses sarcasmes. Ce n’est pas d’une adénite qu’il s’agit, mais d’un bubon vénérien qu’il importe de traiter différemment. Le bubon est du reste prêt à crever et Labarbe se contente d’abord d’une application de compresses d’eau chaude. Il interroge Adoum en blaguant. C’est en passant à Fort-Crampel que le pauvre garçon s’est fait poivrer, il y a précisément quarante jours, cette fameuse nuit d’orgie qui nous était demeurée mystérieuse. Douloureux spectacle de ce beau corps, aux lignes si pures, si jeune encore, tout abîmé, flétri, déshonoré par ces hideuses plaies. Labarbe cependant affirme que les indigènes connaissent certaines herbes capables de guérir, radicalement, définitivement, la vérole – qui, ajoute-t-il, n’a jamais chez eux la gravité qu’elle peut avoir chez nous. Il ne pense pas avoir vu un seul indigène qui en soit exempt – ni qui en soit mort.
Baboua, 28 novembre.
Toujours le même azur splendide. Nous ramenons Adoum à Labarbe. Le bubon a crevé cette nuit, d’où grand soulagement du malade qui a pu enfin s’endormir. Il s’étend sur la natte et je lui tiens les mains tandis que Labarbe presse sur la grosseur pour en faire sortir une invraisemblable quantité de pus. L’autre se tord de douleur, et bien plus encore lorsqu’on introduit une mèche chargée d’iode, profondément, dans le cratère du bubon.
Journée de repos et de lecture. Mon cerveau, je le sens frais et limpide comme le ciel. Vers quatre heures s’amène à cheval, escorté d’un autre cavalier, le fugitif Semba. Il sait que c’est l’incarcération qui l’attend ; mais il sait également que quatre mandats d’arrêt ont été lancés contre lui et qu’il ne peut plus échapper nulle part. Il porte une sorte de cotte de maille étincelante, formée de quantité de pièces de cinquante centimes percées et cousues à même une sorte de pourpoint noir. Très beau, très noble, et même un peu féroce, sur son cheval lancé au galop, il s’élance vers nous, la lance en avant ; puis met pied à terre lorsque paraît Labarbe qui, très digne, autoritaire et magistral, fait retomber sa main levée sur la poitrine de Semba et le livre aux deux gardes chargés de l’emmener en prison. Mais Semba, qui se soumet, s’en va vers la geôle, les précédant de quelques mètres. Il est accusé et reconnu coupable d’un tas de crimes, vente d’esclaves, meurtres et cruautés, détention d’armes non déclarées, de cartouches, etc. Le peuple présent le regarde s’éloigner, sans un murmure de protestation ni même d’étonnement. Tout ce qui a lieu était prévu. Cependant le village, où je retourne le soir (car la chaleur du jour est accablante) s’est à peu près repeuplé. Il est énorme, ce village, et l’on découvre toujours de nouveaux quartiers, de nouveaux groupements de dix, douze, quinze ou vingt cases – dans un repli de terrain, ou que d’abord cachaient les hautes graminées de la brousse. Le soleil se couche, globe écarlate, derrière un rideau de brumes violettes. Et tout aussitôt la pleine lune au haut du ciel commence à luire.
29 novembre.
Départ de Baboua à l’aube. Nouvelle équipe ; ce qui entraîne des hésitations et des discussions pour la répartition des charges. De plus il faut apprêter un hamac pour porter Adoum, incapable de marcher. Je laisse à Marc le soin de régler l’ordonnance du convoi et pars de l’avant. Je vais glorieusement bien, et fais à pied presque toute la route, en tête de colonne. Le temps est splendide. La route n’a pas été nettoyée, ni même les hautes herbes rabattues de côté, ainsi qu’elles étaient tout le long de la route précédente pour faciliter notre passage. Et je ne me doutais point de l’obstacle qu’elle peuvent présenter, car enfin la route est très large (de deux mètres cinquante à trois mètres), mais les herbes sont si hautes qu’elles la recouvrent complètement, repliées, s’opposant à notre marche ; elles sont encore couvertes de rosée, et, d’avoir à me frayer un chemin à travers elles, me voici bientôt tout trempé. C’est bien pis encore lorsqu’on approche d’un marigot ; la route disparaît alors sous l’abondance des plantes.
Après six heures de marche environ, nous atteignons un ruisseau qui traverse la route, non sous une galerie de hauts arbres ainsi que d’ordinaire, mais dans un espace découvert. Ce ruisseau n’est ni particulièrement clair, ni très profond, ni de cours très abondant ; mais il se brise et retombe entre des roches de granit si nettes, si lisses et, là-bas, un peu plus loin, si bien ombragées par un buisson, un arbre bas si prodigieusement embaumé, que je cède à l’invite de l’eau.
Depuis qu’apparaît la roche de temps à autre, le paysage se précise, s’accentue ; les mouvements du terrain semblent se dessiner mieux. Pays fort peu peuplé. Vers dix heures, village de Gambougo, assez misérable – chef complaisant – du reste pas d’arrêt. À une heure passée : Lokoti où nous déjeunons. Village qui veut se déplacer. Déjà l’on voit les squelettes des nouvelles huttes, toits non encore garnis, à quelque cent mètres de l’ancien village sur lequel on a jeté un sort. Impossible de passer la Nana de nuit, malgré notre désir de continuer au clair de lune ; force est de s’arrêter à Dibba ; misérable village, gîte d’étape plus misérable encore dont il faut bien se contenter ; on fait garnir de paille une partie des ouvertures ; et brûler un nid de fourmis, dont la horde était menaçante.
30 novembre.
Trois arbres, dont un énorme, sur cette vague place autour de laquelle se groupe le dispersement des huttes. Par un clair de lune parfait. Immense nuit tiède. Fraîcheur au premier matin ; rosée abondante comme une averse. Nous partons à l’heure où l’éclat de la pleine lune commence à pâlir devant l’approche de l’aube ; l’heure un peu fantastique où rentrent du sabbat les sorcières. La route descend jusqu’au bassin de la Nana ; un ciel couleur tourterelle, où le soleil fait une blessure cramoisie. Comme notre montée avait été toute insensible, l’on est surpris tout à coup de dominer de si haut une immense contrée, où les brumes attardés forment au loin de grands lacs, des rivières.
À pied jusqu’à la Nana. Très lente traversée des bagages dans une étroite pirogue. Si l’autre rive, fouillis d’arbres énormes ; là rive, en pente assez abrupte, les dispose de manière à les faire paraître plus hauts encore. Le ciel, que les brumes, en montant, avaient empli, s’éclaircit ; voici de nouveau le même temps radieux de ces derniers jours. C’est en voyant la pirogue se détacher de l’autre rive et sortir de l’ombre qui l’envoûte, poussée par l’effort du pagayeur arc-bouté sur la perche qui prend appui sur le fond de la rivière – c’est à la petitesse de l’homme, à la fragilité de l’esquif, que l’on juge l’énormité des arbres à l’entour.
Une demi-heure avant la Nana, un village où nous eussions pu passer la nuit si nous avions su. Tous ces villages, kagamas[62] de Baboua, sont à peu près déserts, tant à cause de la fuite de Semba et la crainte des sanctions et répressions qui peuvent s’ensuivre – que de la crainte (hélas ! trop aisément compréhensible) que les blancs que nous sommes, suivis immédiatement du commandant, ne parcourent le pays en vue de réquisitionner des hommes pour le chemin de fer, et de s’emparer d’eux par tous les moyens. Si grande que soit la gentillesse qu’on leur témoigne, ils se méfient, et pour cause.
Pourtant, passé la Nana, le village voisin nous fait fête. Ils étaient là, diposés pittoresquement, en escalier sur les marches naturelles que formaient les racines de je ne sais quel arbre géant, le chef, les tam-tams, la suite du chef, dont son fils, un enfant de treize ans, propre et beau, au visage bizarrement coupé de lignes noires, et le torse traversé en biais par une lanière de fourrure grise. Auprès de lui, trois êtres assez bizarrement beaux, de quatorze à seize ans, couverts de colliers et de ceintures de perles bleues et blanches ; bracelets de cuivre aux poignets, à l’avant-bras, au coude, aux chevilles et au haut du mollet. Je pose une main sur l’épaule de l’un d’eux, l’autre sur l’épaule du fils du chef et les entraîne avec moi, précédant l’escorte. Plus tard, ces enfants m’ont accompagné jusqu’au village, à une demi-heure de là, s’étant volontairement chargés de nos sacs. Entrés avec nous dans la case des étrangers où nous avions fait ouvrir nos chaises de bord, ils sont restés, d’abord assis à terre, à mes côtés ; puis le fils du chef, tandis que nous causions avec son père, s’est blotti entre mes genoux comme un petit animal familier.
Un paysage magnifique ; le mot est trop fort sans doute, car le site n’avait rien d’enchanteur – il pouvait même rappeler bien des paysages de France – mais tel était mon ravissement de sortir enfin de l’informe, de retrouver des collines distinctes, des pentes certaines, des bosquets d’arbres harmonieusement disposés… Enfin, depuis le matin le pays se développait, s’exposait devant nous ; car, depuis que nous avions quitté Bambio, à de rares exceptions près, nous cheminions dans un pays clos, forêt ou savane, enveloppés par une végétation si haute que l’on ne pouvait voir à plus de cinquante mètres – ou même souvent à plus de dix, devant soi. Quel ravissement, après que furent gravies ces hauteurs qui se dressent devant Déka et l’encerclent à demi, de voir enfin ces hautes graminées céder, faire place à une sorte de gazon ras, d’un vert tendre, au-dessus duquel la vue s’étendait au loin, et qui laissait leur pleine stature à ces arbres peu grands, clairsemés et qui jusqu’alors paraissaient noyés, étouffés par les hautes herbes. (J’ai dit qu’elles étaient si hautes qu’un homme à cheval ne les eût pu dominer ; on circulait au travers d’elles comme un chat dans un champ d’avoine.) Enfin je me sentais dans un état d’allégresse physique, propre à me faire trouver joie, noblesse et beauté, même au moins surprenant paysage. J’avais énormément marché ; mais, lorsque je me disposai à reprendre enfin mon tipoye, les cordes de soutien de celui-ci claquèrent aussitôt, me laissant brutalement tomber à terre ; et je dus marcher encore. C’était en plein soleil et durant une rude montée. Ces collines, qu’on n’appelle montagnes que parce que, dans tout le pays, on n’a pas mieux, ne doivent avoir guère plus de cinq cents mètres. Mais le pays, après qu’on est longtemps demeuré sur le plateau, s’affaisse extraordinairement, et il semble de nouveau que l’on domine de beaucoup plus haut que l’on n’était monté. Un accident ridicule, un peu plus tard, m’a forcé pourtant d’attendre que mon tipoye fût réparé. Après l’interminable montée au soleil, qui m’avait mis en nage (c’était durant les plus chaudes heures du jour) je souhaitais ardemment une rivière où pouvoir me baigner. On arrive à un marigot d’eaux quasi bourbeuses ; rien à faire – et je m’occupe à le franchir d’un bond – car il n’y a pas de passerelle ; mais le ruisseau est large ; aussi, posant un pied sur un soliveau, je prends un fort élan ; mon pied glisse et je m’étale tout de mon long dans le bourbier. J’en sors couvert d’une fange infecte, et cherche à me changer aussitôt, assis sur une roche brûlante. Je trouve du linge dans un sac, un pantalon dans une cantine, mais impossible de remettre la main sur des souliers. La paire de rechange a pris les devants avec les premiers porteurs. Je dois me contenter de pantoufles parfaitement impropres à la marche – avec lesquelles je trouve le moyen de faire encore quelques kilomètres, emporté par une sorte de lyrisme ambulatoire, une ivresse de santé, à quoi le paysage doit ce mot « magnifique » que j’employais tout à l’heure.
J’écris ces lignes après dîner – la lune toute pleine luit immensément sur le village de Dahi où nous passons la nuit ; on distingue vers l’est, à peine un peu voilées de brume bleue, les hauteurs de Bouar que demain nous devrons gravir. Pas un souffle sur terre ; pas un nuage dans tout le ciel, qui paraît non point noir, mais azuré comme la mer, tant la clarté de la lune est intense. Non loin de nous les feux de nos boys, des porteurs, et plus loin, des gens du village. Ceux-ci n’avaient point fui. Il y en avait bien une centaine, s’empressant à notre arrivée, à la nuit déjà close, avec des manifestations de cannibales, si serrés contre nous qu’on suffoquait.
Bouar, 2 décembre.
Depuis plusieurs jours ont commencé les feux de brousse. On entend de loin leur crépitement, et, de plus loin encore, la nuit, on en voit la lueur ; ils versent vers le ciel des torrents de fumée. Arrivés à Bouar, hier, vers une heure. Malgré la grande chaleur, l’air est vif. Il ne semble pas que l’on ait beaucoup monté, mais, à un peu moins de mille mètres d’altitude, le poste de Bouar, distant de l’important village, domine immensément la contrée ; vers l’ouest, l’étendue que nous avons parcourue en deux jours, et, bordant l’horizon, les hauteurs où nous couchions avant-hier. Plus au sud, vers Carnot, le regard dans le bassin de la Nana fuit plus loin encore.
Hier le soleil en se couchant emplissait l’espace de rayons pourprés. Ce matin, tandis que j’écris ceci, le ciel est ineffablement pur ; mais l’air, trop chargé de vapeur pour être parfaitement limpide, étale sur les verts sombres des forêts et les verts glauques des savanes, un glacis de nacre azurée. Devant la case, un premier plan de terrain aride, crevé de-ci de-là par de gros boulders de granit ; les dernières huttes du village des gardes, qui s’étend sur la droite, derrière le poste ; quelques arbres qui, en France, seraient des châtaigniers – puis, aussitôt après, l’immensité diaprée, car le dévalement trop brusque échappe aux regards. Rien entre ces arbres, à cinquante mètres et la plaine étonnamment distante.
Bouar, 3 décembre.
Visité l’ancien poste allemand, à un kilomètre de là ; à demi ruiné par une tornade ; d’où l’on domine admirablement le pays. Restes d’avenues de manguiers, et de cette sorte d’aloès, qui hébergent au haut de leur hampe, et parfois le long d’elle, la génération nouvelle ; de sorte que, lorsqu’on secoue cette hampe, ce ne sont pas des graines qui tombent, mais une pluie de petits aloès tout formés, avec des feuilles déjà fortes et des racines. Contre un des bâtiments du poste, quelques plants de tomates ; je reviens chargé de leurs fruits.
Ni le jasmin, ni le muguet, ni le lilas, ni la rose n’ont une odeur aussi forte et aussi exquise que les fleurs de cet arbuste auprès duquel je me suis baigné avant-hier. Corymbe de petites fleurs blanc rosé, quadrilobées autour d’une fine tubulure. Arbuste semblable, port, feuilles et fleurs, au laurier-tin. Parfum : une concentration de chèvrefeuille.
4 décembre.
Quitté Bouar ce matin assez tard, car nous attendons de nouveaux porteurs ; et Labarbe, arrivé hier soir, doit repartir avec nous ; mais lui pour Carnot, nous pour Bosoum. Nous avions réglé hier nos porteurs, pour leur permettre de repartir ; mais nous ne savions pas qu’ils avaient reçu un franc d’avance, de l’administration, pour leur nourriture. Nous n’aurions donc dû leur donner que trois francs et non quatre, et de plus nous n’avions pas, nous dit Labarbe, à payer leur manioc, pour lequel je comptais environ cinquante centimes par jour et par homme[63]. Labarbe affirme qu’ils ne dépensent quotidiennement pas plus de vingt-cinq centimes pour leur nourriture. Me voici bien loin du temps si proche où, à Port-Gentil, j’étais près de m’indigner que l’État n’accordât que sept sous par jour pour chaque prisonnier. Les porteurs sont payés un franc par jour par l’administration (et non un franc vingt-cinq, comme je croyais d’abord), cinquante centimes par jour lorsque immobilisés, et vingt-cinq centimes par jour de retour. En général moitié moins de temps compté pour le retour que pour l’aller.
Parfois ils portent une ceinture de cuir ou de corde, qui trace un simple trait sur la peau noire, suivant exactement le pli de l’aine ; un lambeau d’écorce brune ou rouge, ou de toile couvre étroitement le sexe, puis fuit entre les jambes et va rejoindre au-dessus du sacrum, la ceinture qui le tend. Cela est d’une netteté de dessin admirable. Parfois cette écorce, très belle de ton, s’épanouit par-derrière en corolle.
Tam-tam intime, hier soir, dans la nuit très obscure, car la lune n’est pas encore levée. Une douzaine de jeunes garçons réunis pour une petite danse sans conséquences. Feux en plein air, devant les cases, au camp des gardes. Prolongation de la soirée. Et, pendant que nous nous attardions près des foyers, Zézé et Adoum se laissaient rafler au jeu, par les gardes, tout l’argent de leur mois que nous venions de leur remettre. Même, Adoum perdait la paie du mois précédent, qu’il avait soigneusement réservée, qu’il croyait sincèrement (je le crois) pouvoir remettre bientôt à sa mère, à Abécher où il l’a laissée, voici quatre ans.
Ces gardes ont attendu, pour faire leur coup, le dernier soir, se doutant que, pressés par le départ, nous serions trop occupés ce matin pour enquêter sur cette affaire. Et de fait nous étions déjà loin de Bouar lorsque Adoum, que je voyais triste et que j’interrogeais, s’est confessé. J’ai tâché de le persuader qu’il s’était conduit comme un idiot, qu’il s’était fait rouler par des joueurs malhonnêtes, et que ces gardes étaient des tricheurs. Il s’amuse beaucoup de ce dernier mot, qu’il ne connaissait pas encore.
5 décembre.
Épais brouillard, ce matin ; on avance dans les hautes herbes trempées d’un chemin mal frayé. Ce n’est que passé dix heures que le soleil parvient à triompher des nuées et rétablit un ciel admirablement pur. Contrée sans grand intérêt. Hier les villages, une heure après Bouar, se sont succédé tous les deux kilomètres environ. C’est une région mal soumise, et nous nous attendions à beaucoup de mauvais vouloir. Il est vrai que certains villages sont à demi désertés. Devant notre venue (against) beaucoup d’indigènes craintifs se sont égaillés dans la brousse. Mais combien ceux qui restent sont faciles à ressaisir, dès qu’ils comprennent qu’on ne vient pas chez eux pour leur dam. Et, comme les nouvelles se transmettent vite, de village en village, les habitants se présentent toujours plus nombreux et leur accueil se fait plus chaud. Flatteuse impression de regagner ce peuple à la France.
C’est à l’espacement des arbres d’un verger, aux pommiers d’une cour de ferme normande, aux ormes, soutiens des vignes en Italie dans la région de Sienne, que j’aurais dû comparer le clairsemé des arbres dans la savane que nous traversons depuis tant de jours ; dont les hautes graminées noient les troncs. Et j’admire la constance de ces arbres, de résister aux incendies périodiques. Aujourd’hui l’espacement beaucoup plus grand des arbres fait la seule modification de ce paysage, d’une désespérante monotonie. Le village où nous nous arrêtons ce soir[64], seconde étape sur la route de Bosoum, est sans autre beauté que celle qu’y verse à flots la lumière. Comme de coutume je choisis, dans le cortège formé pour fêter notre entrée dans le village, un préféré sur lequel je m’appuie, ou qui marche à mon côté en me donnant la main. Il se trouve souvent que c’est le fils du chef, ce qui est d’un excellent effet. Celui-ci est particulièrement beau, svelte, élégant et fait penser à la Sisina de Baudelaire. Ce soir, avec deux compagnons, il me fait savoir que tous trois veulent nous accompagner jusqu’à Bosoum.
Quel bain délicieux j’ai pris à midi, et dans quelle limpide rivière ! Que la nuit est claire ce soir ! Je ne sais même pas le nom de ce village où nous gîtons. Cette route que nous suivons est des moins fréquentées (par les blancs, s’entend). Un immense inconnu nous enveloppe de toutes parts.
Tandis que je relis avec ravissement Romeo and July, Marc soigne des plaies, distribue des remèdes, puis « rend la justice », ce qui prend un temps infini.
6 décembre.
Arrêt à Batara. Aux abords de l’important village, où nous arrivons vers onze heures, de jeunes plantations de céaras nous annoncent que nous sommes rentrés sur le territoire de Lamblin – subdivision de Bosoum.
Après avoir circulé longtemps dans le sauvage, le larvaire, l’inexistant, joie de retrouver un village net, propre, d’apparence prospère ; un chef décent, en vêtements européens point ridicules, en casque blanchi à neuf, parlant correctement le français ; un drapeau hissé en notre honneur ; et tout cela m’émeut jusqu’à l’absurde, jusqu’au sanglot.
Tourmentés par l’idée que nous n’avons pas été généreux suffisamment envers le chef de village, à notre dernière étape. Nous lui faisons porter deux billets de cent sous dans une enveloppe, par un coureur de Batara. Son air consterné en recevant ce matin six francs de matabiche, m’était resté sur le cœur. L’absence de prix des denrées, l’impossibilité de savoir si l’on paye bien, ou trop, ou trop peu, les services rendus, est bien une des plus grandes gênes d’un voyage dans ce pays, où rien n’a de valeur établie, où la langue n’a pas de mot pour le merci, où, etc.
8 décembre.
Arrivés hier soir à Bosoum où nous retrouvons la route automobilisable. Là s’achève ce long chapitre de notre voyage. C’est ici que l’auto de Lamblin doit nous rejoindre, pour nous mener à Archambault. De Carnot, il y a trois semaines, nous avons écrit au Gouverneur, sur sa demande, pour l’aviser de la date de notre arrivée à Bosoum ; nous sommes en avance d’un jour. Nous devions faire ce dernier trajet en deux étapes ; mais, partis de Batara dès quatre heures du matin, nous arrivions dès une heure à Kuigoré, et décidions d’en repartir vers trois heures, ayant encore le temps de franchir avant la nuit les vingt kilomètres qui nous séparaient du but. Descendus de tipoye, nous avons fait une partie de cette route au demi-trot, emportés par l’impatience. Tout le matin, paysage d’une intense monotonie. Clématites en graine – renoncules ou adonides (avant floraison) et pivoines en bouton (comme auprès d’Andrinople). À partir de Kuigoré, très belles roches de granit, et même formant de grands soulèvements parfois analogues à ceux de la forêt de Fontainebleau. Chaque fois que le paysage se forme, se limite et tente de s’organiser un peu, il évoque en mon esprit quelque coin de France ; mais le paysage de France est toujours mieux construit, mieux dessiné et d’une plus particulière élégance. C’est ainsi que le passage d’une rivière, peu avant Kuigoré, puis la fuite de l’eau sous des grands arbres, les roches qui déchirent son cours, la route qui suit un instant le bord de l’eau, tout cela nous faisait dire avec ravissement, en riant : on se croirait en France !
L’arrivée à Bosoum est très belle. Yves Morel, le chef de la subdivision, nous attendait. N’écoutant pas ce qu’on lui dit, il répète six fois de suite les mêmes choses – mais pourtant point sot, d’un jugement souvent assez exact, me semble-t-il, et disant, encore qu’avec trop de lenteur, des choses fort intéressantes.
Dans une des Revues de Paris qu’il nous prête (avec force journaux de toutes couleurs) un article (1er août), où Souday, avec désinvolture, exécute Britannicus. Il ne consent à voir dans cette pièce admirable, « ni lyrisme, ni pensée » – un peu agaçant chez celui qui ne peut supporter à l’égard de Hugo, voire de Gautier, la moindre restriction[65].
CHAPITRE VI – De Bosoum à Fort-Archambault
Bosoum, 9 décembre.
L’absence d’individualité, d’individualisation, l’impossibilité d’arriver à une différenciation, qui m’assombrissaient tant au début de mon voyage, et dès Matadi devant le peuple d’enfants tous pareils, indifféremment agréables, etc.… et dans les premiers villages, devant ces cases toutes pareilles, contenant un bétail humain uniforme d’aspect, de goûts, de mœurs, de possibilités, etc.…, c’est ce dont on souffre également dans le paysage. À Bosoum, où l’on domine le pays, je me tiens sur cette esplanade de latérite rouge ocreux, contemplant l’admirable qualité de la lumière épandue. La contrée est mouvementée, larges plis de terrain, etc., – mais pourquoi chercherais-je à atteindre ce point plutôt que tout autre ? Tout est uniforme – pas un site, pas une prédilection possible. Je suis resté tout le jour d’hier sans aucun désir de bouger. D’un bout à l’autre de l’horizon, et où que mon regard puisse porter, il n’est pas un point particulier, et où je me sente désir d’aller. Mais que l’air est pur ! Que la lumière est belle ! Quelle tiédeur exquise enveloppe tout l’être et le pénètre de volupté ! Que l’on respire bien ! Qu’il fait bon vivre…
Cette notion de la différenciation, que j’acquiers ici, d’où dépend à la fois l’exquis et le rare, est si importante qu’elle me paraît le principal enseignement à remporter de ce pays.
Yves Morel s’étale, se déboutonne, – tout jeune encore, mais déjà très Père Karamazov. Une crise de rhumatismes par instants le tord et lui fait jeter de petits cris. Au demeurant, un excellent garçon. Nous parlons politique, morale, économique, etc., etc. Ses considérations sur les indigènes me paraissent d’autant plus justes qu’elles confirment le résultat de mes propres observations. Il croit, ainsi que moi, que l’on s’exagère grandement, d’ordinaire, et la salacité et la précocité sexuelle des noirs, et l’obscène signification de leurs danses.
Il me parle de l’hypersensibilité de la race noire à l’égard de tout ce qui comporte de la superstition, de sa crainte du mystère, etc.… – d’autant plus remarquables qu’il estime d’autre part le système nerveux de cette race beaucoup moins sensible que le nôtre – d’où résistance à la douleur, etc.… Dans la subdivision du Moyen-Congo où d’abord il était administrateur, la coutume voulait qu’un malade, à la suite de sa convalescence, changeât de nom, pour bien marquer sa guérison et que l’être malade était mort. Et lorsque Morel, non averti, revenait dans un village, après une assez longue absence, pour recenser la population – telle femme, à l’appel de son ancien nom, tombait comme morte, de terreur ou de saisissement, dans une crise nerveuse semi-cataleptique si profonde qu’il fallait parfois plusieurs heures pour la faire revenir à elle.
Recueilli sur la route un minuscule caméléon que je rapporte à la case, où je reste près d’une heure à l’observer. C’est bien un des plus étonnants animaux de la création. Près de moi, tandis que j’écris ces lignes, un gentil petit macaque qu’on est venu m’apporter ce matin, que l’aspect de mon visage blanc terrifie. Il bondit se réfugier dans les bras de n’importe quel indigène qui passe à sa portée.
Plaisir un peu néronien d’allumer un feu de brousse. Une seule allumette, et en quelques instants l’incendie prend des proportions effarantes. Des noirs accourent et se précipitent sur les grosses sauterelles que l’ardeur du foyer fait fuir. Je ramasse une très petite mante qui semble faite en feuilles mortes, plus extravagante encore que les longs insectes-fétus qui abondent. Yves Morel est malade. Suite de la crise de rhumatismes d’hier ; il n’a pas arrêté de vomir toute la nuit, et vers midi, quand nous nous rendons chez lui pour déjeuner, il vomit encore, étendu sur son lit, dans le noir, tandis que nous prenons notre repas dans la salle voisine. Nous lui faisons avaler de la magnésie et du bicarbonate, ce qui le soulage un peu. Il n’y a, au poste, absolument aucun remède autre que la quinine.
Rien ne dira la beauté de ces soirs, de ces nuits à Bosoum.
10 décembre.
Les vomissements de Morel continuent. Un instant nous avons pu nous demander si à son malaise ne se joignait pas celui de l’ivresse : la bouteille d’amer qu’on avait débouchée pour nous la veille et à quoi nous avions à peine touché, était à moitié vide, ainsi qu’une bouteille de whisky ; il nous semblait qu’il sentait la liqueur… bref, j’ai fini par lui poser une question directe ; devant sa protestation évidemment sincère il faut conclure que ce sont ses boys qui ont profité de la maladie du maître et de notre présence, espérant nous faire endosser leurs excès.
L’auto qu’a promis de nous envoyer Lamblin n’arrive pas[66].
11 décembre.
Admirables feux de brousse – dans la plaine, au près, au loin, de tous côtés de l’horizon, à la nuit tombante – et même ceux, là-bas, qu’on ne peut voir, mais qui derrière l’horizon, font une étrange rougeur, et comme une « une aube qui point ». Les hautes herbes, souvent encore pleines de sève, laissent le feu courir sous elles et ne se consument pas ; on voit alors la flamme à travers le réseau de leurs chaumes noirs.
Bosoum, 12 décembre.
Ciel ineffablement pur. Il me semble que jamais, nulle part, il n’a pu faire plus beau. Matin très frais. Lumière argentée ; on se croirait en Écosse. Une légère brume couvre les parties les plus basses de la plaine. L’air est suave, agité doucement ; sa fuite vous caresse. Je laisse Marc cinématographier un feu de brousse et reste tranquillement assis en compagnie de Gœthe.
13 décembre.
Toujours sans auto, sans nouvelles de Lamblin. Que faire ? Attendre. Le temps est splendide ; le ciel ne peut être plus pur, plus profond ; la lumière plus belle ; l’air plus tiède à la fois et plus vif… Achevé la première partie des Affinités, et parcouru quantité de Revues de Paris. Morel va mieux. Les vomissements ont enfin cédé à la piqûre de morphine que nous lui avons faite hier soir.
14 décembre.
Achevé la relecture complète des Fables de La Fontaine. Aucune littérature a-t-elle offert jamais rien de plus exquis, de plus sage, de plus parfait ?
16 décembre.
Toujours en panne à Bosoum. Ce n’est plus du repos ; c’est de l’énervement. Ne prenant plus d’exercice, le sommeil est beaucoup moins bon. Morel nous a persuadés qu’il était imprudent, à cause des panthères, de laisser portes et fenêtres ouvertes la nuit. Alors on ferme tout et l’on étouffe. Il est temps de repartir, fût-ce à pied.
Dans la collection de journaux que nous prête Morel (que vient de lui apporter le courrier) un réjouissant article de Clément Vautel, où je suis pris à partie en compagnie de « Rimbaud, Proust, Apollinaire, Suarès, Valéry et Cocteau » comme exemple de ces écrivains « abscons » dont la France ne veut « à aucun prix ». – Je lis dans Gœthe : « Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter als durch das, was sie lächerlich finden. »
Communication d’un radio du 19 novembre : Valéry est élu à l’Académie.
N’Ganamo. 17 décembre.
Il a bien fallu se décider à quitter Bosoum sans plus attendre les autos du gouvernement. Déjà nous regrettons de les avoir attendues si longtemps ; nous calculons le temps perdu ; nous pourrions être à Fort-Archambault… Une nouvelle équipe de 48 porteurs (dont 16 tipoyeurs) est réquisitionnée. C’est la septième. Rien de plus ingrat que cette route ; sous une chaleur accablante nous savourons sa parfaite monotonie, et ne quittons guère nos tipoyes. Trop secoué pour pouvoir lire. Mais sitôt arrivé à l’étape, je me plonge dans les Affinités. Soir splendide, comme tous ces derniers soirs. Le soleil encore assez haut au-dessus de l’horizon « fait la mandarine » comme disait Morel. Il perd à la fois chaleur et rayonnement ; c’est une masse rouge orangée que l’œil contemple sans éblouissement. Heure exquise où le casque devient inutile. Exactement au-dessus du point de l’horizon que le soleil mourant colore encore, le très fin croissant d’une lune naissante apparaît, comme un « noun » arabe. Je suis descendu jusqu’à une assez proche rivière dont un petit sentier dans la galerie forestière m’a permis de suivre le cours quelque temps. Quelle tranquillité ! Des appels d’oiseaux ; puis, sitôt que le soleil est couché, le concert des criquets commence. Au crépuscule, j’ai vu voler presque au-dessus de notre case un stupéfiant oiseau. Un peu plus gros qu’un merle ; deux plumes, extraordinairement prolongées, forment de chaque côté comme une sorte de balancier, sur lequel il semble prendre appui dans l’air pour des acrobaties d’aviateur.
Un peu plus tard, à la nuit close, j’accompagne Marc jusqu’au petit village d’où il revient ; très misérables huttes ; un groupement, derrière un amoncellement d’énormes blocs de grès, à la lueur des feux, prend un aspect préhistorique.
Bossa, 18 décembre.
Étape de 25 kilomètres (comme celle d’hier) mais, partis à 5 heures 1/2, nous n’y arrivons que vers une heure, par suite d’un arrêt prolongé sur la route. Depuis Bosoum les tipoyeurs ne chantent plus. Les arbres de la savane s’espacent ; et même cèdent complètement à de grands espaces découverts. Et ce ne sont plus alors des arbustes de la taille de nos arbres fruitiers, mais de beaux arbres aussi hauts que les plus hauts d’Europe, sans atteindre la taille des géants de la grande forêt. Je voudrais voir ces vastes prés au printemps, quand les herbes sont peu hautes et d’un vert tendre ; mais je doute si, peut-être, au-dessus de l’herbe nouvelle ne subsiste pas l’encombrement affreux des chaumes que n’a pu que noircir sans les consumer l’incendie. D’immenses espaces brûlés ; désolation plus atroce peut-être que celle d’aucun hiver. Les arbres ne sont pas dépouillés ; mais toutes les feuilles ont pris une monotone couleur bronzée qui forme avec le noir du sol, sous le soleil ardent, une implacable et morne harmonie. Il semble que sur ce sol calciné aucune vie ne pourra jamais reparaître, et le vert très tendre du gazon qui surgit entre les chaumes noirs, déjà trois jours après l’incendie, semble presque une fausse note. On dirait un confident indiscret qui compromet l’effet du drame en livrant trop vite un secret susceptible de rassurer le spectateur alarmé.
Ce qui nous a retardés, c’est la rencontre, une heure après le lever du soleil, d’une troupe de prisonniers emmenés par le capita d’un village voisin. Ils étaient onze, la corde au cou – une corde, qui n’était en vérité qu’une ficelle, qui les tenait tous reliés, leur aspect était si misérable que le cœur se serrait de pitié à les voir. Chacun d’eux portait une charge de manioc sur la tête, lourde assurément, mais non excessive pour un homme en bonne santé ; mais ils semblaient à peine en état de se porter eux-mêmes. Un seul d’entre eux ne portait rien ; un petit de dix à douze ans, affreusement maigre, excédé de misère, de jeûne et de fatigue ; par instants il tremblait de tous ses membres, et la peau de son ventre était agitée de frémissements spasmodiques. Le dessus de sa tête était comme râpé, le cuir chevelu remplacé, par zones, par cette sorte de peau qui se forme sur les blessures ou sur les surfaces du corps échaudées. Il semblait incapable à tout jamais de sourire. Et tous ses compagnons de misère, du reste, étaient si lamentables qu’à peine retrouvait-on une lueur d’intelligence en leurs yeux. Tout en interrogeant le capita, nous vidons dans les mains de l’enfant le contenu de notre musette, où ne se trouvent, par mauvaise chance, que trois morceaux de pain très sec. Dans la certitude d’arriver tôt à l’étape, nous avons laissé partir de l’avant nos porteurs, sans nous être munis de provisions de route. L’enfant dévore ces croûtons comme une bête, sans un mot, sans même un regard de reconnaissance. Ses compagnons, pour être moins faibles, ne semblent pas moins affamés que lui. D’après les interrogatoires que nous leur faisons subir, il semblerait qu’ils n’ont pas mangé depuis cinq jours. Ce sont, au dire du capita, des fuyards qui vivaient depuis trois mois dans la brousse, où je les imagine comme des animaux traqués. Mais les récits sont contradictoires et quand, ensuite, nous interrogeons Koté, le chef du village voisin qui donna l’ordre de s’emparer d’eux, puis, le soir, ceux du village d’où ils viennent et où nous campons pour la nuit, on doute s’ils étaient partis dans la brousse pour garder des chèvres qui, dans le village, tombaient malades, ou pour fuir le mauvais sort qui avait fait périr plusieurs de leurs enfants, ou pour « faire des sacs » à arachides, commandés par le chef, pour l’administration, ou tout simplement par insubordination et refus de travailler aux cultures. (À noter que celles-ci, dans le village voisin, sont importantes et comme nous n’en avions point vu depuis longtemps.) Nous entendons dire qu’ils s’étaient fixés depuis un an dans la brousse où ils avaient formé un village. D’après leur propre déposition, ils auraient été maltraités violemment par le chef Koté, et par les gens de son village, qui, après les avoir attachés à des pieux, les auraient couverts d’ordures. Qu’il est difficile de rien savoir, de rien comprendre. Et même, il faut bien l’avouer, la maigreur de ces gens, leur apparente détresse, ne nous paraissent pas très différentes de celles des habitants des villages que nous traversons. Rien de plus misérable que les cahutes où ils vivent, entassés pêle-mêle (telle hutte en contient onze et telle autre treize). Pas un sourire, pas un salut, lorsque l’on passe. Ah ! que nous sommes loin des entrées triomphales dans la région de Nola !… – Et j’aurais dû parler déjà, pour préparer cette rencontre, de l’« opération » conjuguée dont nous parlait Morel, qui commençait la veille de notre départ de Bosoum – pour laquelle Morel envoyait cinq miliciens, (chacun avec vingt-cinq cartouches, et ordre de ne tirer qu’en cas de besoin) lesquels devaient retrouver en un point nommé d’autre miliciens dirigés par trois administrateurs. Les quatre colonnes, en marchant l’une vers l’autre, ne pouvaient laisser échapper certains insoumis irréductibles qui, vivant aux confins de quatre subdivisions limitrophes, passaient de l’une dans l’autre chaque fois que l’administrateur de l’une les poursuivait – ceci depuis longtemps, et jusqu’à ce jour où le Gouverneur Lamblin avait décidé de mettre fin à cette résistance. Fallait-il voir dans le convoi de ce matin un résultat indirect des ordres donnés ?
19 décembre.
Nous partons comme toujours à l’aube. Hier soir, à travers les villages, un assez grand nombre de malades, affreusement maigres – maladie du sommeil ? Et seraient-ce alors des tsé-tsés, ces taons qui depuis deux jours couvrent nos tipoyes et n’attendent que notre inattention pour nous piquer ?
Le pays change d’aspect. Vastes prairies ; arbres plus clairsemés et plus grands. Un de nos porteurs nous signale un troupeau d’antilopes. À deux cents mètres de la route l’œil distingue, parmi les herbes, des taches blondes, une vingtaine… Outhman et un de nos porteurs s’emparent de la carabine et du Moser. Du haut d’un talus, je contemple la chasse. Au premier coup de feu, le troupeau prend la fuite ; toutes les antilopes que l’on voyait, et quantité d’autres que cachaient les trop hautes herbes. J’admire leurs bonds prodigieux. Puis brusquement toutes s’arrêtent, comme obéissant à un mot d’ordre. Mais elles sont déjà trop loin. Le temps manque pour les poursuivre.
Il fait chaud, mais l’air est si sec que nous marchons sans transpirer.
Enfin nous voici devant l’Ouham. Le pays n’a que bien peu changé ; qu’y a-t-il, ou qu’ai-je, qui fasse qu’il me paraît très beau. Une pente insensible mène au fleuve que borde une grande prairie. L’autre rive est un peu plus haute, et sur la gauche, non loin, des collines qu’on est tenté, dans un pays si plat, d’appeler des montagnes. L’Ouham est large comme la Marne ; comme la Seine peut-être… Il en est de ces dimensions comme de la hauteur des arbres… L’échelle est changée. Je gagne le bord du fleuve avec la prétention de pêcher ; mais les herbes du bord sont trop hautes et ma canne à pêche est trop courte ; c’est tout juste si mon poisson de métal peut atteindre l’eau. De très beaux rochers, en aval, rompent le courant. Le soleil se couche au-dessus de la prairie marécageuse qu’on vient d’incendier ; on voit partout des traces de gibier. L’Ouham, en amont des rapides, étend une grande nappe paisible… Décidément, il est aussi large que la Seine… au moins. Ses eaux sont limoneuses ; comme celles de toutes les rivières, depuis Bouar.
20 décembre.
Lever beaucoup trop tôt. Lecture à la lueur insuffisante du photophore en attendant l’aube. Il fait froid. On a l’onglée. Les porteurs avaient allumé de grands feux, qu’ils quittent à regret ; chacun emporte avec lui un tison qu’il tient devant lui, presque contre lui. Traversée de l’Ouham ; au-dessus du courant des eaux, un fleuve de vapeurs, au cours plus lent, se déroule et s’écoule en se déchirant ; le jour naissant faiblement les colore.
Quantité d’insignifiants petits villages – si l’on peut appeler ainsi des groupements de quelques cases très misérables dont les habitants, devant un maigre feu, ou sur le pas des portes, ne nous saluent pas, se détournent à peine pour nous regarder passer. Les huttes rappellent les abris précaires de nos charbonniers dans les bois. Un peu moins, ce serait la tanière. Et cette absence d’accueil, à notre arrivée, de sourires et de saluts à notre passage ne semble point marquer de l’hostilité, mais la plus profonde apathie, l’engourdissement de la bêtise. Quand on s’approche d’eux, ils ne bougent guère plus que les animaux des Galapagos ; quand on tend à quelque enfant un sou neuf, il s’effare et ne comprend pas ce qu’on lui veut. L’idée qu’on puisse lui donner quelque chose ne saurait l’atteindre, et si quelque aîné, ou l’un de nos porteurs cherche à lui expliquer notre bon vouloir, il prend un air surpris, puis tend les deux mains jointes en écuelle.
Le village où nous campons ne le cède en rien à ceux que nous avons traversés, en misère, en saleté, en dénuement de toute sorte, en sordidité. À l’intérieur des cases, une indicible puanteur. Je doute si les enfants ont jamais été lavés. L’eau sert sans doute aux besoins de la cuisine, après quoi il n’en reste plus pour la propreté. Elle vient d’un maigre marigot, qui sort d’un marécage à plus de deux cents mètres du village, puis se perd dans une fondrière.
Et pourtant, depuis ce matin, sur la route, d’assez importantes cultures : mil (qui tend à remplacer le manioc), sésame, et surtout des céaras, de véritables vergers de céaras. Encore trop jeunes pour être exploités. Quelques champs de coton.
Les récoltes de mil et de sésame sont enfermées dans de grands paniers oblongs suspendus aux branches des arbres, à l’entour du village.
21 décembre.
Partis à 6 h 1/2, nous arrivons à Bosangoa vers onze heures. Nombreuses équipes de travailleurs sur la route, qu’ils achèvent et sur laquelle nos autos devaient être les premières à passer. Importantes cultures (surtout du mil) ; mais villages et peuple encore plus désolants que la veille. Parfois, un peu en retrait de la route, quelques huttes sommaires bâties sans soin aucun ; des branches feuillues tiennent lieu de porte. Pas un salut, pas un sourire, à peine un regard quand on passe.
À Bosangoa, M. Martin, adjoint des services civils, qui remplace momentanément M. Marcilhasy, l’administrateur en tournée, nous accueille. Poste important ; avenues d’aloès. Quantité d’oiseaux, dont des compagnies de ce très bel échassier blanc, qu’on appelle « pique-bœuf » ; quelques phacochères[67] apprivoisés.
Après la sieste, chaleur accablante.
Bosangoa, 23 décembre.
Nuit très fraîche ; froide même vers le matin. Pas eu trop de deux couvertures et de deux sweaters, de deux pyjamas et d’un manteau, pour achever une nuit commencée sous un simple drap. Je m’étais couché sitôt après dîner, très fatigué par un fort rhume.
Marc cependant va rôder autour du camp, suivant son excellente habitude de chercher à voir ce qui ne se montre pas au grand jour. Il rentre tard et très ému par ce qu’il vient de surprendre : non loin de notre gîte d’étape, à l’abri du camp des gardes, un abondant troupeau d’enfants des deux sexes, de neuf à treize ans, parqués en pleine nuit froide auprès d’insuffisants feux d’herbes. Marc, qui veut interroger ces enfants, fait venir Adoum ; mais celui-ci ne comprend pas le baya. Un indigène se propose comme interprète, qui traduit en sango ce qu’Adoum retraduit en français : Les enfants auraient été emmenés de leurs villages, la corde au cou ; on les fait travailler depuis six jours sans salaire, et sans leur donner rien à manger. Leur village n’est pas si loin ; on compte sur les parents, les frères, les amis, pour apporter leur nourriture. Personne n’est venu ; tant pis.
La double transmission des questions et des réponses ne va pas sans quelque confusion ; mais le fait reste clair… Si clair que l’interprète bénévole, dès que Marc a le dos tourné, est appréhendé par un garde et jeté en prison… C’est ce qu’Adoum nous apprend à notre petit lever.
Et ce matin, lorsque Marc et moi cherchons à revoir les enfants, l’on nous dit qu’ils sont repartis dans leurs villages. Quant à l’interprète, après avoir passé la nuit en prison, il a été emmené par deux gardes, dès l’aube, pour travailler au loin, on ne peut ou ne veut nous dire sur quelle route.
Décidément il y a là quelque chose que l’on craint de nous laisser voir. Est-ce une partie de cache-cache qu’on nous propose ? Nous nous sentons aussitôt résolus à la jouer jusqu’au bout. Et d’abord il faut obtenir qu’on remette en liberté l’interprète ; il est inadmissible que, tout comme Samba N’Goto, il soit puni pour nous avoir parlé. Nous demandons son nom ; mais chacun se dérobe et prétend ne pas le savoir. Tout au plus consent-on à nous indiquer, à un ou deux kilomètres du poste, un groupe de cases où vit un indigène, qui connaîtrait l’homme en question. Sous un soleil de plomb nous nous rendons à ce petit village, où nous parvenons à apprendre, non point le nom de l’homme, mais ceux des deux plantons qui l’ont emmené ce matin. Et tandis que nous interrogeons, voici que s’amène, inquiet, soupçonneux, le premier garde, celui qui, hier soir, avait appréhendé l’interprète. Il tient à la main une feuille de papier ; c’est la liste de nos porteurs qu’il nous demande de signer, ce que nous aurions tout aussi bien pu faire plus tard ; grossier prétexte qu’il a trouvé pour nous rejoindre. Il veut savoir qui nous parle et ce qu’on nous dit. Mais nous coupons court à notre interrogatoire, craignant de compromettre d’autres gens ; et comme l’espion semble bien résolu à ne plus nous quitter, nous nous rendons avec lui chez M. Martin, à qui nous racontons toute l’histoire. Hélas ! lui aussi se dérobe ; il ne semble attacher aucune importance à notre récit. Pourtant, sur notre insistance, il se décide enfin à mener un semblant d’enquête et, lorsque nous le retrouvons un peu plus tard, nous annonce que tout va bien et que nous nous inquiétions à tort. Ce n’est point pour ce que nous croyions, mais bien pour un vol de cabris qu’on a coffré l’interprète, récidiviste qui ne mérite pas notre attention. Il nous affirme d’autre part que les enfants qui nous apitoyaient à tort sont tous fort bien nourris. On les a renvoyés dans leurs foyers tout simplement parce qu’ils avaient achevé leur travail, un très léger travail de désherbage. Il y a eu là une conjoncture purement accidentelle ; rien de suspect. Êtes-vous satisfaits ? – Pas encore.
23 décembre.
Notre persévérance aura-t-elle raison de cet embrouillement ? Nous le prenons de plus haut avec le garde « première classe », qui se trouble et, pressé de questions, se contredit, se coupe, finit par avouer que le voleur de cabris dont il parlait à Martin, n’est pas l’interprète, et qu’il a dit cela pour endormir Martin. L’interprète a été emprisonné sitôt après la conversation qu’il a eue avec Marc ; deux plantons l’ont emmené ce matin et, sur la route de Bosoum (celle que nous avions prise et où l’on pouvait être assuré que nous ne repasserions pas) l’ont remis entre les mains du garde Dono, chargé de le « faire travailler ». Le récit d’Adoum était donc exact.
Ceci m’encourage et l’assurance que je prends commence à en imposer aux indigènes. Quelques-uns se décident à parler. Nous avons envoyé chercher Dono, que nous interrogeons à part, malgré les protestations du « première classe ». On nous confirme que les enfants, ce matin, ont tous regagné leur village ainsi qu’un certain nombre de femmes racolées avec ces petits ; ils n’ont pas précisément pris la fuite, on la leur a fait prendre en hâte, car le « première classe » les faisait travailler en dépit de tous règlements. Le « première classe » ne leur donnait rien à manger. Une intelligente Soudanaise, (à qui nous allons rendre visite un peu plus tard) la femme du sergent qui accompagne Marcilhasy dans sa tournée, en avait pris quelques-uns sous sa protection particulière, par pitié, les avait fait venir dans l’enclos avoisinant sa case, les avait réchauffés et nourris. Le « première classe » aurait également laissé jeûner les travailleurs prestataires qu’il était chargé de nourrir et, de même, depuis six jours, les porteurs recrutés pour le transport du mil qui doit servir à l’alimentation des cheminots de Pointe-Noire. Ces porteurs n’avaient pour se nourrir que du je ne sais quoi, des herbes, des racines, ou que le produit de leurs vols[68].
Ces interrogatoires nous avaient menés jusqu’au soir. Nous devions partir le lendemain à la première heure et avions déjà pris congé de Martin. Mais nous ne pouvions le laisser ignorer tout ce qu’il aurait dû savoir et que nous venions d’apprendre. Prétextant une lettre à remettre à Marcilhasy, nous nous rendons au poste. Il est déjà neuf heures ; tout est éteint ; tant pis. Martin, déjà couché, se relève.
– Il y a ici quelqu’un qu’on cherche à mettre dedans, lui dis-je ; vous ou moi. Les renseignements que le garde vous a donnés sont en désaccord avec ceux que nous venons d’obtenir. Et comme il m’est désagréable de laisser derrière moi une affaire insuffisamment nettoyée, je décide de remettre notre départ de quelques heures ; c’est le temps qu’il faudra demain pour tirer tout cela au clair.
Et ce matin, nous faisons comparoir les deux plantons qui ont emmené l’interprète, introuvables hier soir. Mais j’avais exigé que le « première classe » nous les amenât. Du reste, pris de peur devant ma fermeté, ledit garde avait fait revenir l’interprète lui-même. À présent l’affaire est très claire, très nette. En l’absence du sergent, emmené depuis dix jours par l’administrateur, le garde de première classe a abusé de ses pouvoirs, fait des recrutements arbitraires, contraires aux règlements, et gardé par-devers lui la nourriture qu’il eût dû distribuer aux prestataires et aux porteurs. Au surplus, voici le sergent de retour ; c’est un islamisé du Soudan, qui parle fort passablement le français, et nous fait la meilleure impression. Nous le mettons au courant de l’affaire et lui confions le malheureux interprète, brimé pour nous avoir parlé, qu’il doit protéger contre le ressentiment du garde. Nous avons avisé de tout Martin, et de telle manière qu’il ne pût guère se dispenser d’intervenir. Il est inadmissible qu’il protège et favorise de tels abus, fût-ce simplement en fermant les yeux. S’il n’y eût eu là rien de répréhensible, le garde n’eût point pris de telles précautions pour le cacher.
Avant de quitter Bosangoa nous retournons au camp. Tout est rentré dans l’ordre : seuls des adultes sont là, groupés autour de feux non plus seulement d’herbes, mais de branches[69]. Ils sont du reste si craintifs, si terrorisés qu’ils feignent de ne comprendre point le sango, pour n’avoir pas à nous répondre (un peu plus tard on constate qu’ils le parlent parfaitement). Ils n’osent pas prendre les cigarettes que je leur tends, ou du moins qu’après un quart d’heure d’approche et de lent apprivoisement. On ne peut imaginer bétail humain plus misérable.
Vers deux heures nous quittons Bosangoa, après une visite à l’école d’agriculture, fondée récemment par Lamblin, fort intelligemment dirigée, nous semble-t-il, par le jeune M.
Passé l’Ouham, à cinq cents mètres du poste ; le peuple semble moins endormi ; quelques-uns saluent, sourient presque ; les huttes des nombreux villages traversés ont de nouveau des murs ; les habitants sont plus propres. Quelques femmes assez belles, et quelques hommes admirablement proportionnés. Quand nous nous arrêtons il est cinq heures. Le soleil, sans être précisément ardent, semble féroce. Puis, soudain, se colore et éteint ses feux. Grand beau village avant d’arriver au poste. Fort beau également, le village du poste, Yandakara, où nous nous arrêtons pour dîner, devant une immense esplanade. Près du gîte d’étape, à peine sorties du sol, de belles grandes dalles de granit gris.
24 décembre.
Repartis de Yandakara après souper. Beau clair de lune. Trop froid pour rester longtemps en tipoye, où pourtant j’arrive à m’assoupir. On parvient vers onze heures à un village dont, je ne sais le nom ; d’où nous repartons au petit matin, par un froid terrible. Il ne devait pas faire plus de 6°. Route assez monotone ; quelques cultures.
Brusquement, un miracle : l’auto que nous avions cessé d’espérer. Elle n’est pas passée par Bosoum. Elle vient à notre rencontre, car Lamblin a fort bien pensé que, vu le retard, nous nous serions mis en route sans plus attendre. La lettre de Carnot, où nous l’avisions de la date de notre arrivée à Bosoum, au lieu de l’expédier directement à Bangui, Chambaud, on ne sait pourquoi, l’a dirigée sur Mongoumba, où elle a dû attendre le passage du Largeau : d’où ce retard de quinze jours. En cas de maladie, d’appel à l’aide, cette maladresse eût pu être mortelle.
Un camion suit l’auto, chargé de trois caisses de sel pour Bosangoa. Ces caisses sont trop énormes pour être confiées à des porteurs ; nous décidons donc de garder les nôtres jusqu’au prochain gîte d’étape, où nous rejoindra le camion vide, au retour de Bosangoa.
Le gîte est à l’extrémité d’un petit village dont j’ignore le nom ; non loin coule une rivière, la Bobo, que va traverser notre route. Près du pont, elle fait un coude, forme un bassin profond, limpide, où des enfants se baignent ; puis cache ses abondantes eaux sous l’enveloppement penché des grands arbres.
Grâce à l’auto, l’étape a été peu fatigante. Renonçant à la sieste, nous regagnons la Bobo sitôt après le déjeuner. À peine distinct parmi les hautes herbes, un étroit sentier nous permet d’en remonter le cours. Les arbres ne s’arrêtent pas sur la rive. Ils se penchent, s’étalent au-dessus de l’eau, empiètent et, comme s’ils voulaient traverser, jettent vers l’autre bord des étais plongeants, un large réseau de racines aériennes, anastomose qui tend au ras de l’eau des passerelles. Puis un assez vaste espace s’étend, sous les branches puissantes, largement étalées : l’ombre y est religieuse ; quantité de petits tumulus, régulièrement espacés, soulèvent le sol noir ; on dirait des tombes. Serait-ce un cimetière ? Non. C’est un essai de plantation de café – raté, comme presque tous les autres de la région.
L’auto va nous permettre de gagner Bouca ce soir même. Nous congédions les porteurs, après règlement, et repartons vers deux heures. Un de nos boys monte dans notre auto. Zézé, l’autre boy et le marmiton qui nous suit depuis Carnot, s’entassent fort inconfortablement au-dessus de l’accumulation des bagages, dans le camion. Deux autres marmitons, qui nous suivent depuis Bouar, voudraient ne point nous lâcher ; ils s’attachent à nous comme Dindiki à son perchoir. Pas de place dans les autos ; n’importe ; ils iront à pied ; et en effet, nous les retrouverons le lendemain à Bouca, qu’ils atteignent après avoir marché toute la nuit – et ils avaient déjà marché presque tout le jour. Ils veulent nous suivre jusqu’à Archambault (nous y retrouver du moins). Tant de fidélité m’émeut, encore qu’il y faille voir surtout de la détresse et ce besoin de s’accrocher à n’importe quoi de substantiel, que l’on retrouve chez tous les parasites. Ces deux marmitons, au demeurant, sont affreux, ne savent pas un mot de français et c’est à peine si, depuis Bouar, je leur ai adressé deux fois la parole. Mais c’est déjà beaucoup qu’on ne soit pas brutal envers eux. J’avais donné à chacun un billet de cinq francs ; mais, à Bouca, le matin, devant leur désir persistant de gagner à pied Archambault, je redonne à chacun quelques pièces de cinquante centimes, sachant bien que, faute de menue monnaie, on peut crever de faim avec cinquante francs dans sa poche – car, dans aucun des villages que l’on traverse l’on ne trouve à « changer ». C’est là une des principales difficultés de ce voyage ; avertis, nous avons emporté de Brazzaville des sacs de sous, de pièces de cinquante centimes et de francs.
25 décembre.
Batangafo, où nous arrivons pour déjeuner. La route en auto, paraît paradoxalement plus longue. L’exigence est démesurée ; la monotonie devient plus sensible, car elle est moins dans le détail que dans l’ensemble ; la fuite trop rapide brouille les sensations, fait du gris.
Nous tenterons de gagner Archambault ce même soir, pour tenir la promesse faite à Coppet d’arriver pour la Noël.
Vertigineuse fuite dans la nuit ; le paysage lentement se dépouille et s’ennoblit ; réapparition des rôniers. Dans une clairière, une grande antilope-cheval, tout près de nous, qui ne fuit pas quand l’auto s’arrête ; très miracle de Saint-Hubert. Grands échassiers. Énormes villages saras, aperçus dans la nuit. Les murs en treillis bordent la route. Le camion ne suit plus. Il faut l’attendre. Nous nous arrêtons près d’un feu, sur le bord de la route. Les Saras qui s’y chauffaient s’enfuient ; puis reviennent un à un et acceptent nos cigarettes. Une peau de cabri ne leur couvre que les fesses ; mais, coinçant leur sexe entre les jambes, ils trouvent le moyen de sauvegarder leur pudeur.
Arrivés à Archambault peu après minuit. Nous réveillons Coppet, qui prépare un médianoche, et causons avec lui jusqu’au matin.
CHAPITRE VII – Fort-Archambault, Fort-Lamy
Éblouis dès le matin par la splendeur, l’intensité de la lumière. De l’autre côté de l’Enfer. Fort-Archambault, marche de l’Islam, où, par-delà la barbarie, on prend contact avec une autre civilisation, une autre culture. Culture bien rudimentaire encore sans doute, mais apportant déjà raffinement, le sentiment de la noblesse et de la hiérarchie, une spiritualité sans but, et le goût de l’immatériel.
Dans les régions que nous avons traversées ce n’étaient que races piétinées, non tant viles peut-être qu’avilies, esclavagées, n’aspirant qu’au plus grossier bien-être ; tristes troupeaux humains sans bergers. Ici nous retrouvons enfin de vraies demeures ; enfin des possessions individuelles ; enfin des spécialisations[70].
Fort-Archambault.
Ville indigène. Enceintes rectangulaires de claies de roseaux (seccos) formant enclos, où se groupent les huttes, où les Saras habitent par familles. Ces nattes sont juste assez hautes pour qu’un homme de taille moyenne ne puisse regarder par-dessus. En passant à cheval, on les domine et le regard plonge dans d’étranges intimités. Quintessence d’exotisme. Beauté des huttes au toit treillissé, liseré par une sorte de mosaïque de paille. On dirait un travail d’insectes. Dans ces enceintes, les quelques arbres, préservés des incendies annuels, deviennent très beaux. Le sol est une arène blanche. Quantité de petits greniers suspendus, à l’abri des chèvres, donnent à ces minuscules cités particulières l’aspect d’un village de Lilliput, sur pilotis. Les plantes grimpantes, sortes d’hipomées ou cucurbitacées flexueuses à larges feuilles, ajoutent au sentiment d’étalement des heures, de lenteur, de paresse et d’engourdissement voluptueux. Une indéfinissable atmosphère de paix, d’oubli, de bonheur. Ces gens sont tous souriants ; oui, même les infirmes, les malades. (Je me souviens de cet enfant épileptique, dans le premier village de la subdivision de Bosoum ; il était tombé dans le feu, et tout un côté de son beau visage était hideusement brûlé ; l’autre côté du visage souriait, d’un sourire angélique.)
Je n’inscris plus les dates. Les jours coulent, ici, tous pareils. Nous nous levons dès l’aube, et je cours jusqu’au bord du Chari voir le lever du soleil. Il fait frais. Quantité d’oiseaux au bord du fleuve ; peu craintifs, car jamais chassés ni poursuivis ; aigles-pêcheurs, charognards, milans (?), étincelants guêpiers vert émeraude, petites hirondelles à tête caroubier, et quantité de petits oiseaux gris et blanc semblables à ceux des bords du Congo. Sur l’autre rive, des troupeaux de grands échassiers. Je rentre pour le breakfast ; porridge, thé, fromage ou viande froide, ou œufs. Lecture. Visites. Déjeuner chez Marcel de Coppet. Sieste. Travail. Thé chez Coppet et révision de sa traduction du Old Wives Tale de Bennett. Promenade à cheval.
Curieux, chez ce peuple si sensible au rythme, la déformation caricaturale de nos sonneries militaires. Les notes y sont, mais le rythme en est changé au point de les rendre méconnaissables.
L’école de Fort-Archambault. Un maître indigène stupide, ignare et à peu près fou, fait répéter aux enfants : Il y a quatre points cardinaux : l’est, l’ahouest, le sud et le midi[71].
Le sou vaut ici huit perles bleues. Un enfant achète une poignée de cacahouètes. On lui rend quatre perles.
Les deux marmitons que nous avions laissés à Bouca, nous retrouvent ici, le soir du premier janvier.
Au contact de l’Islam, ce peuple s’exalte et se spiritualise. La religion chrétienne, dont ils ne prennent trop souvent que la peur de l’enfer et la superstition, en fait trop souvent des pleutres et des sournois[72].
Le chemin de fer Brazzaville-Océan est un effroyable consommateur de vies humaines. Voici Fort-Archambault tenu d’envoyer de nouveau mille Saras. Cette circonscription, l’une des plus vastes et des mieux peuplées de l’A. E. F., est particulièrement mise à contribution pour la main-d’œuvre indigène. Les premiers contingents envoyés par elle ont eu beaucoup à souffrir, tant durant le trajet, à cause du mauvais aménagement des bateaux qui les transportaient[73], que sur les chantiers mêmes, où les difficultés de logement et surtout de ravitaillement ne semblent pas avoir été préalablement étudiées de manière satisfaisante. La mortalité a dépassé les prévisions les plus pessimistes. À combien de décès nouveaux la colonie devra-t-elle son bien-être futur ? De toutes les obligations qui incombent à l’administrateur, celle du recrutement des « engagés volontaires » est assurément la plus pénible. Mais c’est ici que se manifeste la confiance que Marcel de Coppet a su inspirer à ce peuple noir, qui se sent aimé par lui. L’annonce des fêtes du 1er janvier avait provoqué une grande affluence. Or, c’est précisément le 31 décembre que les miliciens chargés du recrutement des travailleurs revinrent de leur tournée dans les villages de la circonscription, avec 1 500 hommes qui devaient passer la visite médicale, et sur lesquels le Docteur Muraz devait en retenir un millier. Ces hommes étaient cantonnés dans des locaux spéciaux aménagés dans le camp des gardes et étroitement surveillés par ceux-ci. Marcel de Coppet, conscient du regret de ces recrues de ne pouvoir se mêler à la fête, leva, pour deux jours, toutes les consignes, et permit à ces hommes de circuler librement : « j’ai confiance en vous, leur dit-il, et compte que, le troisième jour, vous vous présenterez tous à l’appel. »
Malgré le mauvais renom que le grand nombre de décès a valu aux travaux de la voie ferrée (car les indigènes de Fort-Archambault n’ignorent rien du triste sort de leurs « frères »), il n’y eut pas une seule désertion[74].
Voici qui est admirable sans doute. Mais que va-t-il advenir de ces malheureux ? Les précautions pour assurer leur subsistance ont-elles vraiment été mieux prises ? Ou sinon, cet abus de leur confiance est moralement inadmissible. Et sans doute Coppet le pense également. Mais que peut un administrateur ? Il doit obéir à son chef. Il l’avertit pourtant : « Ce recrutement encore a été possible… Je ne réponds plus du suivant. »
Fort-Archambault.
Visite aux deux principaux chefs : Bézo, et son cousin germain Belangar, de race sara-madjingaye. Chacun d’eux a envoyé son fils aîné à l’école de Fort-Lamy. Ces enfants viennent de rentrer à Fort-Archambault. Chose étrange, ils font un échange ; et quand nous demandons à Bézo :
– À présent chacun de vous deux va reprendre son fils ?
– Non, répond-il ; c’est moi qui prendrai le sien ; lui, le mien.
– Pourquoi ?
Il nous explique alors que chacun des deux pères craint de montrer pour son propre fils trop d’indulgence et de faiblesse[75].
Admirables bords du Chari, en aval. Longue promenade seul (très imprudent, dit Coppet). Îles ; longues étendues sableuses ; variétés d’oiseaux inconnus.
Ravissement à relire Cinna, dont je réapprends le début.
Quelle prodigieuse précipitation de notre littérature vers l’artificiel ! Je voudrais voir les lecteurs du Progrès Civique et M. Clément Vautel devant le monologue d’Émilie qui ouvre la pièce.
Impatients désirs d’une illustre vengeance
Dont la mort de mon père a formé la naissance,
Enfants impétueux de mon ressentiment,
Que ma douleur séduite embrasse aveuglément…
L’abstraction, la préciosité, la soufflure, l’anti-réalisme (pour ne point dire : le factice) ne sauraient être poussés plus loin. Et je ne connais pas de vers plus admirables. C’est le triomphe de l’art sur le naturel. Le plus abstrus sonnet de Mallarmé n’est pas plus difficile à comprendre que, pour le spectateur non prévenu, non apprivoisé par avance, l’enchevêtrement de cet amphigouri sublime.
Sitôt après je relis Iphigénie. Ce qu’il fallait que fût Corneille pour que l’on pût parler du « réalisme » de Racine !
Archambault, 10 janvier.
Marcel de Coppet, nommé Gouverneur intérimaire du Tchad, doit gagner Fort-Lamy dans cinq jours. Nous l’accompagnerons. Il fait très chaud depuis trois jours. Trop chaud. Un peu de fièvre vers le soir. Nuits assez mauvaises. Gêné par les chauves-souris qui pénètrent dans ma chambre malgré les nattes que je mets devant ma fenêtre, les journaux au-dessus des portes.
Sitôt après avoir achevé la relecture d’Iphigénie, je l’ai reprise. Je l’achève aujourd’hui, et voudrais la reprendre encore, dans un émerveillement grandissant. Il me paraît aujourd’hui que cette pièce est aussi parfaite qu’aucune autre et ne le cède en rien à ses sœurs ; mais sans doute n’en est-il point qu’il soit plus difficile de bien jouer. Aucun rôle n’en peut être laissé dans l’ombre et ne supporte d’être sacrifié. L’on pourrait même dire qu’il n’y a pas un premier rôle, et que tour à tour c’est Iphigénie, Agamemnon, Clytemnestre, Achille et Ériphile que l’on souhaite de voir le mieux interprété.
Caractère d’Agamemnon, admirablement vu par Racine. La réponse honteuse à Arcas, lorsque celui-ci craint qu’Achille ne proteste de voir Agamemnon abuser ainsi de son nom, et, somme toute, faire un faux :
… Achille était absent.
Et, jusque dans le détail, cette irrésolution, ces retours :
VA, dis-je, sauve-la de ma propre faiblesse
Mais surtout NE VA POINT… etc.
Et cette lâcheté,
… D’une mère en fureur épargne-moi les cris.
17 janvier.
Descente (j’allais dire : remontée) du Chari – cet étrange fleuve qui tourne le dos à la mer. Un peuple est assemblé sur la rive quand nous quittons Archambault.
Le d’Uzès flanqué de quatre baleinières. J’occupe, avec Marc, celles de tribord. Nous embarquons vers trois heures, par une température torride.
5 heures.
De grandes bandes d’un sable d’or, brûlante pureté, rapiécées de loin en loin par des étendues de prairies – pacages pour hippopotames et buffles.
18 janvier.
Le d’Uzès s’arrête non loin d’un extraordinaire soulèvement de grands boulders granitiques. C’est là qu’a succombé la mission Bretonnet. Bien que le soleil soit près de se coucher, je ne puis résister au désir de m’approcher de ces étranges roches (que d’abord je croyais de grès). J’entraîne mes compagnons dans une marche précipitée, traversant un terrain sablonneux très fatigant, puis des marécages. Je gravis une des hauteurs – mais mes compagnons m’attendent, et déjà la nuit tombe.
19 janvier.
Paysage « pour lions ». Petits palmiers doums ; brousse incendiée. Férocité admirable.
Chasse à l’antilope. Coppet en tue trois énormes.
Les belles zébrures des crocodiles.
Je n’ai le temps ni le désir de rien noter. Complètement absorbé par la contemplation.
20 janvier.
Le paysage, sans changer précisément d’aspect, s’élargit. Il tend vers une perfection désertique et se dépouille lentement. Pourtant beaucoup d’arbres encore, et qui ne sont pas des palmiers ; parfois ils s’approchent de la rive, lorsque le sol plus haut les met à l’abri de l’inondation périodique. Ce sont des arbres que je ne connais pas ; semblables à de grands mimosas, à des térébinthes.
Puis apparaissent les petits palmiers doums, au port de dracenas, et pendant quelques kilomètres il n’y en aura plus que pour eux.
Mais la faune, plus que la flore encore, fait l’intérêt constant du paysage. Par instants les bancs de sable sont tout fleuris d’échassiers, de sarcelles, de canards, d’un tas d’oiseaux si charmants, si divers que l’œil ne peut quitter les rives, où parfois un grand caïman, à notre passage, se réveille à demi pour se laisser choir dans l’azur.
Puis les rives s’écartent ; c’est l’envahissement de l’azur. Paysage spirituel. L’eau du fleuve s’étend comme une lame.
Je vais devoir jeter la boîte de coléoptères récoltés pour le muséum. J’avais cru bon de les faire sécher au soleil ; ils sont devenus si fragiles qu’il n’en est plus un seul qui ait gardé ses membres et ses antennes au complet.
Fréquents enlisements ; l’équipage descend, ayant de l’eau jusqu’à mi-corps, et pousse le navire comme il pousserait une auto. La délivrance occupe parfois plus d’une heure. Mais dans un paysage si vaste et si lent, on ne souhaite pas d’aller vite.
Un énorme crocodile, très près du navire. Deux balles. Il cabriole dans le fleuve. Nous stoppons. Puis retournons en baleinière sur les lieux. Impossible de le retrouver. Les animaux que l’on tue ainsi plongent aussitôt, et ne reparaissent à la surface que quelques heures plus tard.
Au crépuscule et déjà presque à la nuit nous voyons voler, au-dessus de la rive de sable, de nouveau cet étrange oiseau dont je parlais déjà (avant Bouca). Un coup de fusil de Coppet l’abat. Il tombe dans le fleuve, où Adoum va le repêcher. Deux énormes pennes non garnies et n’ayant que la tige centrale, partent de l’aileron, presque perpendiculairement au reste des plumes. À peu près deux fois de la longueur totale de l’oiseau, elles écartent de lui, paradoxalement, deux disques assez larges, à l’extrémité de ces tiges, que l’oiseau, semble-t-il, peut mouvoir et dresser à demi, indépendamment du mouvement des ailes. Coppet, qui me donne l’oiseau pour le muséum, l’appelle « l’oiseau aéroplane » et affirme que certains naturalistes en offrent six mille francs ; non qu’il soit extrêmement rare ; mais il ne se montre qu’à la tombée de la nuit et son vol fantasque le protège.
Boïngar.
Petit village. Quantité de métiers à tisser, occupés le plus souvent par des enfants. Marc cinématographie un de ceux-ci, tout jeune encore, d’une habileté prodigieuse. La bande qu’il tisse n’a que quelques centimètres de large et semble une bande pour pansements. Pour constituer une pièce d’étoffe, ces bandes sont reliées l’une à l’autre dans le sens de la largeur. (Il en faut jusqu’à 48, à hauteur de ceinture, pour un pantalon). Le métier est on ne peut plus simple : deux pédales croisent les fils de la trame ; un peigne suspendu en travers de la bande retombe sur la chaîne après chaque passage de navette. Les fils de la trame sont tendus au loin par un petit panier plat posé à terre et qu’alourdit ce qu’il faut de cailloux pour le coller au sol. L’enfant, à mesure qu’il travaille et que s’allonge la bande de « gabak » enroule celle-ci entre ses jambes et tire à lui le panier. Il chantonne en travaillant et son chant rythme l’élan de la navette.
Plus loin, dans un enclos de seccos, sept établis sont rangés côte à côte. Sans doute l’administration exige-t-elle du village une certaine quantité de gabak. Ce travail est confié souvent à des captifs, nous dit-on, le travail « noble » étant celui des cultures et de l’élevage.
Beauté de ce tissage et même de la matière première indigène que rien ne vient adultérer. On suit la fabrication depuis le début. Aucune intervention extérieure. On parle de réformer cela. Pourquoi ? Un peu de snobisme aidant, ce « home spun » ferait prime sur le marché.
Un aigle-pêcheur, au milieu du fleuve, captif de sa proie trop énorme, se débat et rame des ailes, anxieusement, vers le rivage.
Fort-Lamy. Sa laideur. Sa disgrâce.
À part ses quais assez bien plantés et sa position au sommet de cet angle que forment en se rejoignant le Chari et le Logone, – auprès d’Archambault, quel étriquement ! Au sortir de la ville, en amont, deux surprenantes tours d’égale hauteur ; énormes bâtisses de briques qu’on sent avoir été terriblement coûteuses et qui servent nul ne sait à quoi.
La ville indigène double la ville française, parallèlement au fleuve et s’étend en profondeur à chaque extrémité et forme proprement deux villes. Chacune également sordide, poussiéreuse, saharienne juste assez pour évoquer certaines oasis sud-algériennes – combien plus belles ! L’argile qui sert aux murs des maisons est de grain rude et de ton cendreux ; constamment mêlée de sable ou de paille. Les gens paraissent tous craintifs et sournois.
On apprend que la morne ville se dépeuple lamentablement. Fièvre récurrente et émigration. Les indigènes, qu’on ne laisse plus libres ni de se réunir pour un tam-tam, ni même de circuler dans leurs propres villages, une fois la nuit tombée, s’embêtent et fichent le camp. Les blancs retenus ici par leurs fonctions s’embêtent et rongent leur frein.
Je mène Adoum à l’hôpital de Fort-Lamy, et demande au Dr X… de bien vouloir procéder à un examen microscopique de son sang, car je m’inquiète de savoir si ce garçon, décidément, a la vérole, ainsi que Labarbe le prétendait.
L’examen ne donne qu’un résultat négatif. Mais alors, ces bubons, à Bouar ? – Simplement du crow-crow, dont nous avions souffert également, Marc et moi ; dans son cas, compliqué par une adénite. Adoum n’a rien. Il ne s’en montre nullement surpris.
– Je savais bien que je n’avais pas la vérole. Où l’aurais-je attrapée ?
– Mais, sans doute à Fort-Crampel, cette nuit où tu as été faire la noce. (Et Labarbe avait calculé qu’il s’était écoulé tout juste le temps nécessaire pour permettre réclusion des bubons.)
– Je n’ai pas fait la noce du tout. Je vous l’avais dit d’abord.
– Mais, ensuite, tu nous as dit toi-même que, cette nuit-là, tu avais été avec une femme.
– J’ai dit ça parce que vous aviez l’air d’y tenir. On me répétait que j’avais sûrement fait la noce. Je ne pouvais pas dire : non ! On ne m’aurait pas cru.
Cette petite histoire ne persuadera personne et ne servira qu’à m’enfoncer dans cette conviction : que l’on se blouse tout aussi souvent par excès de défiance que par excès de crédulité.
28 janvier.
Abandonnant Marcel de Coppet à ses nouvelles fonctions, nous décidons de descendre le Chari jusqu’au lac Tchad. En partant demain sur le d’Uzès, nous pourrons être de retour à Fort-Lamy dans quinze jours.
30 janvier.
Paysage sans grandeur. Je m’attendais à trouver des rives sablonneuses et déjà la désolation du désert. Mais non. Quantité d’arbres de taille moyenne agrémentent médiocrement les bords du fleuve, de leurs masses arrondies.
Après m’être étonné de ne pas voir plus de crocodiles, en voici tout à coup des quantités incroyables. J’en compte un groupe de 37 sur un petit banc de sable de cinquante mètres de long. Il y en a de toutes les tailles ; certains à peine longs comme une canne ; d’autres énormes, monstrueux. Certains sont zébrés, d’autres uniformément gris. La plupart, à l’approche du navire, se laissent choir dans l’eau lourdement, s’ils sont sur une arène en pente. S’ils sont un peu loin du fleuve, on les voit se dresser sur leurs pattes et courir. Leur entrée dans l’eau a quelque chose de voluptueux. Parfois, trop paresseux ou endormis, ils ne se déplacent même pas. Depuis une heure nous en avons vu certainement plus d’une centaine.
Arrivés trop tard à Goulfeï (Cameroun) ; mais peut-être, de plein jour, notre visite au sultan nous eût-elle laissé de moins extraordinaires souvenirs. La nuit est close quand nous franchissons la porte de la ville, entièrement ceinte de remparts. Devant nous, un long mur droit, présentant un unique trou noir par où, précédés de quelques chefs soumis au sultan, nous pénétrons dans de mystérieuses ténèbres. Puis, entre deux murs de terre assez hauts, une rue étroite comme un corridor, sinueuse et sans cesse brisée. On distingue parfois une ombre s’effacer dans une embrasure de porte ; elle porte la main à la tête et murmure une salutation. Un instant la rue s’élargit ; des claies de ramures couvrent une sorte de vestibule où des gens se tiennent assis. Qu’il doit y faire bon durant les chaudes heures du jour ! Plus loin les murs s’ouvrent ; c’est une place. Un grand arbre abrite l’entrée du palais.
Les présentations avaient eu lieu, indistinctement, dans la rue étroite. Nous pensions remettre à notre retour la visite, et déjà nous nous étions fait excuser d’arriver si tard. (J’ai le plus grand mal à ne pas être trop courtois, et même un peu plat, devant un chef musulman ; la noblesse de son allure, du moindre de ses gestes m’en impose plus que les titres les plus ronflants.) Mais le sultan insiste, et, la curiosité nous poussant, nous le suivons à travers une suite de petites salles et de couloirs ; tout cela dans l’obscurité. Enfin un serviteur apporte une lanterne. Nous pouvons voir que plusieurs des petites salles que nous traversons ont des murs glacés, comme enduits de stuc, et couverts de peintures, d’ornements, rudimentaires mais d’assez bel aspect. Nous parvenons dans une salle, à peine un peu plus grande que les autres, où sont quelques chaises. Le sultan nous invite à nous asseoir et s’assied lui-même. À ma gauche, près de l’entrée, s’accroupit un superbe enfant de quinze à seize ans ; c’est le fils du sultan. Le capitaine du Jacques d’Uzès nous sert d’interprète. Nous échangeons de vagues compliments à l’arabe, puis prenons congé de notre hôte, nous proposant de revenir dans le village, lorsque la lune se sera levée.
Que dire de cette promenade nocturne ? Rien de plus étrange, de plus mystérieux que cette ville. De-ci de-là, sur des places, au détour des rues, d’admirables arbres, vénérés sans doute, du moins préservés. Les murs d’enceinte présentent, à l’intérieur, un chemin de ronde, puis dévalent en pente rapide mais accessible. Une grande place, et un fort à demi ruiné. Tout cela fantastique, au clair de lune. Par-dessus les murs des habitations, on distingue des toits en coupoles. Nous abordons au pas d’une porte quatre adolescents ; ce sont d’autres fils du sultan. Ils nous accompagnent assez longtemps. Nous devons tourner, sans nous en douter, car après un quart d’heure de marche, nous nous retrouvons devant leur demeure, où nous les laissons.
31 janvier.
Un vent très froid. Ce matin quelques grosses tortues dressent leurs têtes hors du fleuve, dans le sillage du navire que, quelques instants, elles poursuivent. Les rives, beaucoup plus vertes, sont couvertes de petits buissons épineux.
Je n’ai pas dit qu’hier, durant un arrêt de quatre heures (on devait « faire du bois », car il n’y en avait pas de préparé) – nous sommes partis chasser dans la brousse. Quantité incroyable de pintades. Nous en rapportons sept et en perdons trois, blessées, mais que nous ne pouvons rattraper. Brousse peu boisée ; grands espaces à demi découverts, de terre nue semée de mimosas cassies. Troupeau de grandes antilopes.
Bizarre aspect des barques de pêche : grandes pirogues en maints morceaux de bois reliés entre eux avec des lianes et des ficelles, car le pays n’offre plus aucun arbre assez grand pour y creuser l’esquif. L’arrière de ces barques est fortement relevé, de manière à servir de point d’appui pour un grand filet tendu entre deux longues antennes ; un système de contrepoids permet de plonger le filet dans le fleuve et de le relever sans effort.
1er ou 2 février.
Arrêtés hier dès deux heures de l’après-midi près d’un village au bord du fleuve (rive droite). Un peuple d’enfants sur la rive ; mais tous s’enfuient dès qu’ils nous voient approcher. Village assez misérable. Beaucoup de teinturiers d’indigo (comme aux précédents).
Les femmes tapent avec un bâton sur les fruits du palmier doum afin d’amollir la pulpe ligneuse que l’on chique comme du bétel. La récolte de mil a été très insuffisante ; on pressent une grande disette.
La chaleur, la lumière surtout, est accablante. J’attends le soir pour m’avancer dans le pays. Marc étant parti avec Outhman pour photographier, Adoum étant parti à la chasse avec un garde, je vais seul, malgré les recommandations. Une admirable lueur orangée se répand obliquement sur le vaste verger naturel où je m’avance avec ravissement. Les sentiers suivis par les troupeaux de bœufs, richesse du pays, forment un réseau sur le sol. Quantité d’oiseaux, que le soir enivre. J’imagine ces buissons, à présent secs pour la plupart, verdissant au printemps, fleurissant, s’emplissant de nids, de vols d’abeilles, le sol se couvrant d’herbe fraîche et de papillons…
Nous sommes repartis dans la nuit – vers deux ou trois heures du matin, le capitaine souhaitant profiter du clair de lune. Nous dormions profondément à l’entrée du lac ; et, me fussé-je levé, par cette lumière insuffisante je n’eusse pu voir à mon gré le changement de la végétation. Mais le vent s’est mis à souffler et nous a forcés de nous arrêter, de sorte que bientôt nous avons perdu cette inutile avance – dont le seul effet a été d’escamoter ce que surtout je souhaitais voir. Le vent jetait contre nous de petites vagues précipitées, qui, coincées entre les baleinières et le bateau, jaillissaient en geyser et balayaient le pont. En un instant tout fut trempé. En hâte nous avons rassemblé tout l’épars, replié les lits. Le petit navire dansait si fort qu’une table cabriola les pieds en l’air ; désarroi des grands naufrages. Et ce, avec un mètre cinquante de fond. La danse des baleinières à nos côtés était presque terrifiante et la violence de leurs chocs contre la coque du d’Uzès. Nous nous sommes hâtés de chercher un abri provisoire entre deux vastes massifs de papyrus et d’une sorte de carex énorme[76].
C’est dans ce havre précaire que j’écris. Devant moi s’ouvre, sous un ciel uniformément bleu, une étendue d’eau illimitée, glauque comme une mer du Nord. À mes côtés, un bouquet de grands papyrus, surgis de l’eau, très beaux, encore qu’ils soient fanés pour la plupart – très « palmiers d’eau » ; et, derrière moi, le plus étrange mélange d’herbes et d’eau qui se puisse rêver ; de nouveau cette énormité, cette informité, cette indécision, cette absence de parti pris, de dessin, d’organisation qui m’affectait à l’excès dans la première partie de notre voyage et qui est bien la caractéristique majeure de ce pays. Mais ici cette perplexité de la nature, cette épousaille et pénétration des éléments, ce blending du glauque et du bleu, de l’herbe et de l’eau, est si étrange et rappelle si peu quoi que ce soit de nos pays (sinon peut-être certains étangs de la Camargue ou des environs d’Aigues-Mortes) que je n’en puis détacher mes regards.
En panne depuis le lever du soleil, nous devons attendre, jusqu’à près de midi, abrités entre des îlots de papyrus, que le vent soit un peu calmé. Le vent n’est du reste pas très fort – il paraîtrait à peine brise auprès du sirocco, du mistral. Les touffes de papyrus sont d’un admirable ton de vert-roux ; la mer du Tchad d’un glauque blondissant. On enlève les deux baleinières de nos côtés pour les attacher à notre remorque…
Après trois heures environ de traversée, voici les îles de l’autre bord. Les papyrus alternent avec des buissons à fleurs jaunes, à peine plus élevés que les papyrus (des papilonacées, semble-t-il ?) où grimpent parfois de grands liserons mauves – et des roseaux gigantesques, semblables à ceux que nous appelons « l’herbe des pampas », porteurs de grands panaches gris de chanvre, de la plus grande beauté.
J’admire l’effort de tant de végétaux des contrées équatoriales, vers une forme symétrique et comme cristalline, insoupçonnée dans nos pays du Nord où Baudelaire peut parler du « végétal irrégulier ».
Papyrus, palmiers, cactus, euphorbes-candélabres, se développent autour d’un axe et selon un rythme précis.
Nous avons jeté l’ancre devant une île inhabitée, la passe sur laquelle comptait le capitaine, pour gagner Bol, s’étant trouvée obstruée. Le soir tombait. Nous avons mis pied à terre, mais sans nous écarter beaucoup du point d’atterrissage, car en un instant nous eûmes les jambes pleines de petites graines très piquantes, qu’on ne peut même enlever sans risquer de s’enfoncer douloureusement leurs dards dans les doigts, où ils se brisent et déterminent des abcès[77]. Du reste le paysage n’offre aucun intérêt, sinon, dans cette vaste pelouse sèche que nous parcourons, un végétal bizarre, plante devenant arbuste, à feuilles très larges, d’un gris verdâtre très délicat, épaisses, tomenteuses (je veux dire couvertes d’une épaisse peluche). La fleur est d’un assez beau violet pourpre, mais très petite.
Nuit pas trop froide ; mais l’équipage va dormir auprès de grands feux, à cause des moustiques. Arrêt dans une île, peuplée de chèvres blanches. On ne comprend pas ce qu’elles peuvent trouver à manger, car le sol n’est qu’une arène aride, semée parcimonieusement de cette étrange plante-arbuste, que je décrivais tout à l’heure, dont le feuillage vert-de-gris fait avec la blancheur des chèvres une harmonie exquise. Quantité de chèvres sont attachées par une patte à un pieu fiché dans le sable. Ce sont celles, je crois, que l’on se propose de traire, qu’on ne veut point laisser téter par les chevreaux. Non loin, quelques cases, qui semblent plutôt des abris provisoires ; quelques indigènes d’aspect misérable et hargneux. Le capitaine du navire a grand-peine à obtenir de l’un d’eux qu’il nous accompagne pour nous piloter parmi les îles. Pourtant on nous apporte quatre œufs et une jatte de lait. Le capitaine prend un cabri ; on peut presque dire s’en empare de force ; pourtant il laisse cent sous en échange ; mais le vendeur réclame encore deux francs que le capitaine se résigne à donner. C’est la première fois que je vois un indigène défendre son prix, ou même « faire » son prix. On nous avait bien dit que les habitants de la région de Bol étaient « rétifs ». Ailleurs, quoi que ce soit et si peu qu’on leur donne, ils acceptent sans protestation. Avant-hier, un de nos tirailleurs, (le sergent) payait cinquante centimes un poulet, dans le petit village où nous nous étions arrêtés. Je lui ai dit que c’était un prix d’avant-guerre et que désormais il devrait payer le poulet un franc. Il se laisse convaincre, et retourne avec moi pour donner la piécette complémentaire. Comme il y met de la bonne grâce j’offre de couvrir ce débours ; mais il refuse les cinquante centimes que je lui tends et, comme j’insiste, en fait cadeau à un enfant qui passe. Il est assez naturel que les indigènes, dont on ne paie que cinquante centimes un poulet, voient débarquer les blancs avec terreur[78] et ne fassent rien pour augmenter un commerce si peu rémunérateur.
Nous rencontrons le Léon Blot, accosté près d’une petite île. À bord, nous voyons le vieux pilote qui jadis a guidé Gentil à travers le lac. Marc prend sa photo, et par enthousiasme, nous lui donnons un gros matabiche, qui lui fait venir le sourire aux lèvres et des larmes aux yeux.
Le vieux, que nous avons emmené de force comme pilote, ne s’attendait évidemment à rien recevoir, car, lorsque je lui glisse un matabiche dans la main, son visage, renfrogné jusqu’alors, se détend. Je le plaisante sur son air maussade : il se met à rire, prend une de mes mains dans les deux siennes et la presse à maintes reprises avec une effusion émouvante. Quels braves gens ! Comme on les conquerrait vite ! et quel art diabolique, quelle persévérance dans l’incompréhension, quelle politique de haine et de mauvais vouloir il a fallu pour obtenir de quoi justifier les brutalités, les exactions et les sévices[79].
Sitôt que le vent s’élève, de gros paquets d’eau lavent le pont. On ne sait où se tenir.
Je renonce à traduire Mark Rutherford. L’intérêt que j’y prends reste un peu trop particulier.
Je plonge dans le Second Faust avec le plaisir le plus vif. Il me faut avouer que je ne l’avais encore jamais lu tout entier dans le texte.
Les îles sont de plus en plus vastes et plus nettement hors de l’eau. Le sable paraît et s’élève faiblement en dune. En plus des papyrus, des roseaux et des faux baguenaudiers de la rive, on voit reparaître les mimosas et les palmiers doums. Mais, sur une île en particulier, pourquoi quantité de ceux-ci sont-ils morts ? Est-ce d’une mort naturelle ? et due à quoi ? Peut-être les indigènes les ont-ils incendiés à leur base, encombrée de vieilles feuilles qui rendaient inatteignables les fruits ?
La quantité d’arbres morts ou mourants m’étonne depuis le début du voyage.
Arrivée à Bol vers le milieu du jour.
Étrange aspect des petits murs d’enceinte du poste ; crénelés, aux angles amollis, émoussés – tout cela pas plus haut qu’un homme, de sorte qu’on pourrait, de l’extérieur, presque passer la tête entre les créneaux ; couleur galette de maïs. Une voûte de petit fortin à l’extrémité droite ; rien à gauche.
Le village est non loin sur la droite ; quelques cases misérables. Très peu d’habitants. À peu près tous, hommes et femmes, sont vêtus. Du sable, presque uniquement agrémenté par cette étrange plante gris-vert[80] dont enfin je puis voir le fruit : un beignet énorme, bivalve, tenant suspendu en son centre, au milieu d’une matière feutrée, filigranée, un paquet de graines. Celles-ci forment une cotte autour des duvets qui les coiffent et leur permettront de prendre l’essor. Rien de plus ingénieux et de plus bizarre. Les graines sont d’abord si étroitement juxtaposées, à la manière des tuiles d’un toit, que l’on ne soupçonne rien de ce duvet qu’elles protègent ; on ne voit d’abord qu’une carapace, une coque analogue d’aspect à celle des letchis. Dès qu’on presse cette coque, elle crève ; les graines se disjoignent, laissant paraître un trésor soyeux près duquel l’aigrette des pissenlits paraît terne, un émerveillement argenté qui tout aussitôt bouffe, foisonne, s’émancipe, et se prépare à se laisser emporter au premier souffle.
Le sergent Bournet (extrêmement sympathique) est seul à diriger la subdivision de Bol. Nous l’invitons à dîner à bord. Il est ici depuis sept mois ; débordé de travail ; et pourtant il s’embête à mort. Le travail qu’on lui fait faire, qu’on exige de lui, est, dit-il, au-dessus de ses forces. Il n’y peut suffire ; il n’est pas préparé pour cela. Le voici plongé dans des écritures et des comptabilités compliquées, lui qui sait à peine lire et écrire. « Ce qu’un plus instruit que moi ferait en vingt minutes, me prend toute une matinée, nous dit-il. Songez donc que je ne suis qu’un simple sergent. C’est un officier qu’il faudrait à Bol. Je n’en puis plus. » Et tout, dans ses moindres propos, respire la franchise et l’honnêteté. J’ai pris note par ailleurs des quelques renseignements qu’il nous donne sur la disette menaçante et le prix des denrées, du mil en particulier, dont les indigènes de Bol sont tenus de fournir dix tonnes[81] ; dont ils manquent, et qu’ils sont forcés d’aller chercher à trois jours de distance (et plus) et d’acheter aux Bournous trois et quatre francs le « tonnelet » de 20 kilos, que l’administration ne leur paiera qu’un franc cinquante.
Il nous parle également du recensement périmé, qui date de quatre ans ; d’après lequel sont taxés les villages, dont les habitants continuent à payer pour les morts (très nombreux par suite de la récurrente) et les fugitifs dont le nombre s’accroît chaque année, de sorte qu’il risque de ne rester bientôt plus que les vieux, les impotents et infirmes, les niais, qui devront supporter, de par le fait des morts et des désertions, triple et jusqu’à quadruple charge, à payer pour les morts et les absents. (De même pour le cheptel.)
« Si le recensement était refait, dit-il, si chaque village était taxé d’après le nombre réel et actuel de ses habitants, il serait on ne peut plus facile de faire rentrer l’impôt, qui n’a rien d’excessif et que chaque indigène consentirait volontiers à payer. Personne ne songerait plus à s’enfuir[82]. »
Ces énormes champs de papyrus sont flottants, sont mobiles. Vienne à souffler le vent, ils se déplacent, touffe après touffe, qu’on voit se détacher et partir à la dérive, puis reformer plus loin la prairie défaite. C’est ainsi que des passes du lac, en quelques heures, peuvent se trouver obstruées.
Yakoua.
Depuis Touggourt, je n’avais plus vu tant de mouches.
Pas de bois pour les pirogues. Avec un très épais paillasson de papyrus, on fabrique des sortes de plateaux flottants, de forme allongée, à l’avant recourbé en bec de gondole. On ne peut rien imaginer de plus étrange. Cela se pousse à travers l’eau, à l’aide de grandes perches, souvent amenées de fort loin. Au bord de l’eau croît toutefois cet arbuste à fleurs jaunes dont j’ai déjà parlé. Son bois est si poreux, si léger qu’il flotterait sur des nuages. On est tout surpris de voir un tout petit enfant en porter sur son épaule une solive énorme. Il s’en sert, l’enfourchant, pour traverser l’eau. Couché là-dessus à plat ventre, il rame des pieds et des mains, et, lorsque le vent l’aide, traverse en peu de temps des bahrs assez larges.
Il y a quantité de crocodiles dans cette partie du lac, nous dit-on[83] ; mais, chose étrange, ils ne s’attaquent jamais à l’homme[84] – peut-être surnourris par les poissons qui surabondent. Ils détruisent les filets que les indigènes tendent. Ceux-ci, gênés au surplus par les papyrus voyageurs, ont presque complètement renoncé à la pêche.
Le long de la rive, vers l’est, l’eau reste hors de vue et d’atteinte, derrière l’épais écran de papyrus et de roseaux. Ils dissimulent des fondrières, où l’on enfonce jusqu’au genou, jusqu’à la ceinture, où l’on peut disparaître en entier. Par instants ce rideau s’interrompt et permet accès aux pirogues, aux passeurs, au bétail qui vient s’abreuver. Je n’ai jamais vu bétail plus admirable. Ce fut d’abord, près d’un groupe de femmes, un bœuf couleur chamois, très différent de tous ceux que j’avais vus jusqu’alors ; semblable peut-être à quelque bas-relief égyptien. Ses cornes énormes étaient à peine incurvées, leur ligne extérieure continuait celle de l’os frontal et formait coiffure comme le pschent. On ne peut décrire une ligne ; mais je puis dire que la noblesse de cette courbe était telle que je songeai tout aussitôt au Bœuf Apis.
Un peu plus loin je fus arrêté par un troupeau d’une race très différente ; vaches et taureau de couleur gris très tendre, presque blanc ; les cornes énormes, monstrueuses, dépassaient non point seulement tout ce que j’avais vu, mais encore ce que je croyais possible ; extraordinairement arquées, au contraire de l’espèce que j’avais rencontrée précédemment, et formant au-dessus du front une menace si redoutable que, ne connaissant pas l’humeur de l’animal (c’était un taureau) je crus prudent de rétrograder. Je ne m’aperçus que plus tard, repassant avec Marc et Outhman, que ce terrible monstre était entravé.
Quantité d’oiseaux merveilleux. L’un, d’azur chatoyant, si charmant que je ne me décidais pas à le tuer, la curiosité, le désir de le voir de près l’a enfin emporté. Sa tête est brune. Les plumes du dos sont d’un tendre bleu de pastel ; tout le dessous du corps est bleu clair ; les ailes vont de ce même bleu tendre au bleu le plus sombre. La queue, bleu sombre, très longue, se termine en pointe aiguë. Un peu plus loin je vis jusqu’à sept oiseaux noirs et jaunes, gros comme des sansonnets, sur le dos d’un âne.
J’avance enveloppé d’un nuage, comme une divinité ; d’un nuage de mouches. Sur les mimosas, grande abondance d’un gui, assez voisin du nôtre ; très robuste ; très ramifié ; feuilles allongées, grisâtres ; grains rouge terne, allongés.
Nous avons suivi la rive tournante jusqu’à nous trouver sur le côté opposé de l’île : et nous la traversons pour rentrer. Amusement de retrouver, jaillie du sable, cette même orobanche que j’admirais dans les dunes, au sud de Biskra ; mais elle était alors d’un mauve tendre très délicat ; à présent ce ne sont plus que des torches sèches, presque noires.
Les indigènes qui passent continuellement d’une île à l’autre, emploient pour traverser les bahrs de lac, parfois larges de plus de cinq cents mètres, des soliveaux de ce bois extra-léger d’ambatch sur lesquels ils se couchent, qui maintiennent hors de l’eau, mais ruisselants, la tête et le dos du nageur ; très Arion sur le dauphin.
… février.
Nous avons été ce matin en baleinière jusqu’au village de Yakoua, sur une île voisine. Escale dans une première île. Admirable troupeau de bœufs, que Marc photographie. On les fait traverser un bahr, à la nage. Leur tête prend appui sur les énormes cornes creuses, qui flottent comme des bouées.
Indigènes extrêmement complaisants ; dignes ; il semble qu’ils s’affinent et se spiritualisent tandis qu’on remonte vers le nord. Un très vieux chef vient à notre rencontre à cheval ; il descend et offre sa monture ; mais il en a plus besoin que nous ; du reste le village n’est pas loin. Marche dans le sable très pénible. Courte réception du chef, qui a mis pied à terre ; échange de salutations sous une sorte de hangar. Très belle et noble expression de visage du vieux chef. Il a des mains de squelette ; peau tachée de blanc. Ses deux jeunes fils (ou petits-fils) nous accompagneront à travers le village à sa place, car il est à bout de souffle. Marc tâche de filmer des scènes « documentaires » ; cela ne donne rien de bien fameux. Il s’agit d’obtenir certains groupements de nageurs, et principalement de nageuses. Si triées qu’elles soient, celles-ci ne sont pas bien jolies. Impossible d’obtenir un mouvement d’ensemble. On nous fait comprendre qu’il n’est pas décent que femmes et hommes nagent en même temps. Ceux-ci doivent précéder de dix minutes celles-là. Et comme celles-là restent sur la rive, les hommes, pris d’une soudaine pudeur, se couvrent, se ceinturent et enfilent des pantalons. Marc m’explique qu’ils vont se dénuder en entrant dans l’eau ; il compte sur un certain effet de ces vêtements portés à l’abri de l’eau, sur la tête. Mais la pudeur est la plus forte ; les hommes préfèrent mouiller ces étoffes qui sécheront vite au soleil. Si l’on insiste pour les faire se dévêtir, ils lâchent la partie et s’en vont bouder sous un palmier doum. Marc s’énerve et il y a de quoi. Au bain des femmes. Elles non plus ne descendront dans l’eau que vêtues. N’empêche qu’elles exigent que les hommes, que tous les spectateurs, nous excepté, s’en aillent, se retirent au loin. Tout cela, grâce aux simagrées, donne un spectacle assez raté. Il est midi. Le soleil tape. Nous remontons en baleinière, mais nous avons le vent contre nous. Pas de rames ; rien que des perches pour pousser, mais ici, par miracle, l’eau est profonde et l’on est presque à bout de bras avant que la perche ne touche le fond.
Nous n’avançons pas. Enfin, prenant le parti de suivre la rive, nous faisons tant que d’atteindre Bol, (où, sur le d’Uzès, nous attend notre déjeuner) vers deux heures.
L’autre baleinière a été « faire du bois » dans une autre île. Elle n’est pas encore de retour. Nous ne pourrons repartir que demain.
Je suis sorti de nouveau hier, vers le soir, avec mon fusil sur l’épaule ; mais je n’ai rien tué. Les oiseaux sont si peu craintifs qu’on se fait scrupule de les tirer presque à bout portant. Glorieuse fin du jour. Si peu élevée que soit la dune, on domine un large bras de lac où la gloire du couchant doré se reflète. Sérénité majestueuse, indifférente et sans douceur.
Nous avons levé l’ancre à cinq heures du matin. Le ciel est d’une pureté saharienne. Il a fait de nouveau très froid cette nuit ; mais, par absence de vent, froid supportable.
Nous faisons escale vers sept heures, devant un assez important village, complètement déserté. Certaines des huttes, soigneusement closes, comme barricadées, marquent chez les habitants une idée de retour. On finit par découvrir, derrière une hutte, une vieille femme borgne, accroupie, vêtue de guenilles terreuses. Elle nous explique dans un grand flux de paroles qu’elle n’a pas suivi l’exode général, parce qu’elle est trop faible et à moitié paralysée. À ce moment on aperçoit, non loin, devant une autre case, une autre vieille, qu’elle nous dit être restée pour la soigner. Nous interrogeons tour à tour l’une et l’autre, mais leurs récits ne concordent pas, et Adoum transmet mal nos questions et leurs réponses. Quand on demande depuis combien de temps les autres habitants sont partis, on a comme réponse le nom du chef de village et le nombre de bras d’eau qu’il faut traverser pour gagner l’île où les autres se sont rendus. La loquacité de chacune de ces deux vieilles abandonnées est cauchemardante. Elles radotent éperdument. Si elles n’ont pas suivi les autres, c’est aussi qu’elles ne savent pas (ou ne peuvent plus) nager. Les autres sont partis depuis vingt et un jours. La plus infirme indique le nombre en faisant dans le sable vingt et un sillons avec l’index. Quoi que ce soit qu’on lui demande, elle se livre à une sorte de comptabilité maniaque en traçant du doigt des lignes qu’aussitôt ensuite elle efface du plat de la main. Les hommes sont partis pour trouver de quoi faire face à l’impôt, ou pour tenter de s’y soustraire ; on ne sait[85]. Ces gens n’auraient sans doute aucun mal à payer un impôt qui n’a rien d’excessif, si le recensement était tenu à jour, si chacun, d’après un recensement vieux de quatre ans, n’avait pas à payer parfois pour trois ou quatre disparus.
Escale vers midi, dans une grande île, d’un abord assez difficile, encombré de papyrus, de roseaux et de buissons d’ambatch. Je remarque dans l’eau plusieurs coléoptères nageurs, et une exquise petite plante flottante qui donne à la surface de l’eau un aspect rougeoyant. À la manière de nos lentilles d’eau, elle n’a qu’une feuille ; triangulaire et divisée comme une feuille de fougère. Nous mettons les deux baleinières bout à bout, mais il reste un espace marécageux que nous traversons à dos d’homme. Une demi-heure de marche vers l’intérieur de l’île (toujours la même monotone végétation : mimosas et principalement ce baguenaudier à jus blanc) et nous arrivons en vue d’un village ; on s’approche ; toutes les cases sont désertées. Pourtant nous distinguons devant une case un groupe de gens. Trois hommes, en nous voyant approcher, s’enfuient dans la brousse. À l’aide de deux interprètes – Adoum et un type de l’équipage, d’une musculature herculéenne, au visage très fin, qui a nom Idrissa et que nous appelons Sindbad – nous parlons à ceux qui sont restés – cinq femmes et trois garçons. Marc prend des photos et nous distribuons des piécettes de cinquante centimes dont on est obligé de leur expliquer la valeur qu’ils ignorent. Quelle distinction, quelle douceur et quelle noblesse dans le visage de l’aîné des garçons qui nous parle ! Marc fait demander s’il n’est pas le fils du chef ; mais non ; son père n’est qu’un simple cultivateur qui est parti avec tous les gens de ce village. Les trois garçons qui se montraient très craintifs d’abord, s’apprivoisent lentement. Ils nous disent que certains de leurs parents sont taxés à 30 et même 35 francs d’impôt – eux-mêmes sont taxés à sept francs, bien que les deux plus jeunes n’aient certainement pas plus de treize ans. Ils nous proposent du lait caillé dans des vases-bouteilles de jonc tressé, et se montrent extrêmement surpris, presque émus, lorsque je leur donne un pata (cinq francs) à chacun. Ils racontent que voici quatre jours, ils ont été de nouveau brimés par les gens du chef de canton Kayala Korami, qui se sont emparés de cabris, ont « amarré » un homme et l’ont roué de coups de chicotte.
(Ces 30 ou 35 francs d’impôt, retombant sur un seul, sont peut-être dus également au bétail qu’il possède – imposé à raison de un franc par bœuf.)
Pris quelques notes sur la question des frais de douane pour les bœufs vendus en Nigéria (obligation d’aller régler les droits de douane à Maho à vingt jours de marche environ) et la réquisition du bétail par l’administration qui ne peut le payer que le tiers ou le quart de sa valeur.
Nous continuons de naviguer entre les îles. Toutes pareilles. Je ne puis comprendre comment le capitaine s’y reconnaît. Comme, à présent, nous avons la libre disposition du bateau, déchargé de ses caisses (télégraphie sans fil, vin, farine et fournitures diverses à destination de Fada et de Faya) – non pressés par le temps, nous demandons que l’on nous mène vers les îles peuplées. De nouveau le d’Uzès s’arrête dans les papyrus et les buissons. Il est cinq heures. Nous nous dirigeons vers le centre de l’île. Quantité de crottes de cabris et de bœufs ; celles des bœufs ne sont pas très récentes. Après un quart d’heure de marche, un village assez important, mais complètement désert. Même pas une infirme abandonnée comme dans celui de ce matin. Mais au loin nous apercevons les taches blanches d’un troupeau de chèvres et nous marchons dans leur direction. La végétation change brusquement. C’est sur la lisière d’un bois de mimosas assez touffu que se tiennent les chèvres. Elles font des taches claires mouvantes dans l’entrelacs des branches, où pénètre l’oblique rayon du soleil couchant. Le troupeau est dispersé sur un grand espace, à demi enfoncé dans le bois. Il y a peut-être quatre ou cinq cents bêtes. Elles s’acheminent toutes dans la même direction, que nous prenons également, nous laissant guider par elles. Et voici bientôt en effet deux cases perdues en pleine brousse. Mon coup de fusil, qui vient de tuer une pintade, a fait surgir un vieil indigène ; il s’amène à notre rencontre, les mains levées. Avec lui un grand adolescent très décemment vêtu d’un boubou bleu, une femme et deux très jeunes enfants. Le type au boubou accepte de nous guider à travers les bahrs jusqu’à l’île où les indigènes des villages disséminés sont rassemblés momentanément autour du chef de canton (plus précisément : de son fils) venu pour recueillir l’impôt. Il est déjà tard. Le soleil se couche. Pas un souffle ; les étendues d’eau sont lisses. La nuit est close depuis longtemps déjà lorsque nous jetons l’ancre. Le village n’est pas loin et nous nous y rendons avec Adoum et Idrissa-Sindbad – précédés de notre pilote qui porte une lanterne-tempête. Voici venir le chef de canton (ou du moins son fils – celui-là même qu’on accuse de sévices et d’exactions). Il a une sale bobine ; le nez crochu, ce qui est particulièrement déplaisant pour un visage noir – l’œil égrillard et les lèvres pincées. Plus que poli ; presque obséquieux. Nous le quittons bientôt en promettant de revenir le lendemain. Cette reconnaissance nocturne n’a eu d’autre but que d’apprivoiser un peu les gens, les enfants en particulier, à qui nous distribuons quantité de piécettes. Ceux-ci n’ont plus, dans ces régions avoisinant le Tchad, le ventre énorme de ceux de l’Oubangui ; mais leurs mains et leurs pieds sont souvent hideusement déformés ; la paume des mains devient alors comme spongieuse, et le dos squameux.
De retour à bord, après le repas, nous nous apprêtions déjà pour la nuit, lorsque Adoum vint nous dire que cinq indigènes s’étaient présentés tout à l’heure, désireux de nous faire des « clamations » (réclamations), à qui le capitaine venait de dire de repasser demain matin. Nous souvenant de Samba N’Goto, et pensant que ces confidences nocturnes risqueraient d’être perdues pour toujours, nous envoyâmes en grande hâte Sindbad à la poursuite des plaignants, les invitant à revenir. Puis, dans l’attente, nous nous mîmes à lire, à l’insuffisante clarté du photophore (Mark Rutherford et le Second Faust). Un long temps passa et je me désolais de plus en plus, imaginant Sindbad forcé d’aller jusqu’au village, ne parvenant à retrouver les cinq hommes qu’en éventant leur démarche, qu’en les compromettant, qu’en les perdant. Au bout d’une demi-heure, Adoum nous annonce un nouveau plaignant. Celui-ci vient d’une île voisine ; a sauté dans sa pirogue sitôt qu’il a vu passer le vapeur, dans l’espoir d’y rencontrer un blanc à qui il puisse parler. Il se penche en avant et montre au-dessus de la nuque la cicatrice très apparente d’une large blessure récente ; écartant son boubou il montre une autre blessure entre les épaules. Ce sont les coups de chicotte d’un « partisan » (?) du chef de canton. Le partisan s’était d’abord emparé de trois des quatre chèvres laitières que cet homme gardait devant sa case pour subvenir à la nourriture de sa femme et de ses enfants ; et comme le partisan faisait mine de prendre encore la quatrième, l’autre avait protesté ; c’est alors que l’agent de Kayala Korami, le chef de canton, l’avait frappé.
Un peu plus tard (l’entretien avec ce premier plaignant venait à peine de finir) quatre autres indigènes sont venus. L’un se plaint que Kayala Korami se soit approprié le troupeau de huit vaches qui devaient lui revenir en héritage après la mort du frère de son père. Le second raconte qu’il a donné 250 francs à Kayala Korami pour être nommé chef de village. Celui-ci en réclame encore autant et, comme l’autre déclare qu’il n’est pas assez riche pour les donner, Korami menace de le tuer – et garde les 250 francs donnés d’abord. Les deux derniers, terrorisés par Kayala Korami, en sont réduits à vivre dans la brousse, dont ils ne sortent que la nuit pour aller retrouver, près du village, des parents ou des amis qui leur apportent à manger.
Ce que je ne puis peindre, c’est la beauté des regards de ces indigènes, l’intonation émue de leur voix, la réserve et la dignité de leur maintien, la noble élégance de leurs gestes. Auprès de ces noirs, combien de blancs ont l’air de goujats. Et quelle gravité triste et souriante dans leurs remerciements et leurs adieux, quelle reconnaissance désespérée envers celui qui veut bien, enfin, considérer leur plainte.
Ce matin, dès l’aube, de nouveaux plaignants sont là, attendant notre bon vouloir. Parmi eux un chef, que nous faisons passer d’abord. Tout ce que je disais des hommes d’hier soir est encore plus marqué chez celui-ci. Un de ses administrés l’accompagne qui, lorsque nous l’avons invité à s’asseoir, s’accroupit à terre, aux pieds du chef, blotti dans un pli de sa robe, comme un chien, et par instants pose sa tête sur ou contre le genou du chef, en signe de respect, presque de dévotion, mais aussi, dirait-on, de tendresse.
Le chef nous montre sur le dos de cet homme des cicatrices de blessures et des traces de coups. Il nous dit les exactions de Korami, les gens de son village terrorisés, désertant pour une circonscription voisine. Avant les nouvelles dispositions prises par l’administration française, alors que les chefs de villages n’étaient pas encore subordonnés à des chefs de cantons, tout allait bien… Non, non, ce n’est pas des autorités françaises qu’il a à se plaindre. Ah ! si seulement il y avait plus de blancs dans le pays ; ou si seulement les blancs étaient mieux renseignés ! Si seulement ils connaissaient, ces blancs qui gouvernent, le quart des méfaits de Korami, assurément ils y mettraient bon ordre. Mais c’est Korami lui-même qui les renseigne, ou des gens intimidés, terrorisés par Korami. Hélas ! la famille de Korami est nombreuse ; s’il venait à mourir, son fils lui succéderait, ou l’un de ses frères, et tout irait de mal en pis. Nous lui demandons s’il connaît, en dehors de la famille de Korami, quelque indigène capable de remplacer cet odieux chef de canton ; alors, très modestement en apparence et sans astuce, très naturellement, il se désigne. Marc relève son nom, comme il a relevé ceux des autres plaignants. Du reste lui n’a pas à se plaindre personnellement ; c’est au nom des habitants de son village qu’il parle. – Et tandis qu’il nous parle, voici que s’amène Korami lui-même, flanqué de ses partisans, de ses gardes, de toute sa suite. Korami vient nous présenter ses hommages, mais du même coup regarder si des plaignants ne viennent pas dénoncer ses méfaits. Nous demandons au chef s’il ne craint pas que Korami ne lui en veuille de ce qu’il soit venu nous parler. Il redresse la tête, a une sorte de haussement d’épaules et nous fait dire par l’interprète qu’il n’a pas peur.
Nous sommes fort embarrassés de savoir que faire pour ne pas compromettre les autres plaignants. En vain nous cherchons quelque moyen d’intimider Korami et d’empêcher qu’après notre départ il ne les brime. Nous nous décidons à le recevoir d’abord – et lui disons tout aussitôt que nous sommes pressés d’aller faire de la photographie dans son village. En quelques instants nous prenons notre breakfast, et partons escortés par tous ces gens. Cependant, en arrière de Korami, nous faisons dire aux plaignants qu’ils n’ont qu’à revenir vers midi.
Village dans le sable. Cases en roseaux, toutes distantes les unes des autres. Des chèvres partout, en troupeaux énormes, blanches pour la plupart. Celles qui nourrissent, attachées par la patte à des piquets, branches dépouillées d’écorce, fichées dans le sable.
Au sortir du village, nous avons pris congé de Korami, désireux qu’il ne vînt pas jusqu’au bateau où devaient nous retrouver les plaignants. Mais bientôt, la curiosité le poussant, il est venu nous retrouver tout de même. Nouveaux adieux. – Il part mais laisse derrière lui trois de ses gardes. Ceux-ci restent obstinément sur la rive, attendant le départ de notre bateau et manifestement chargés de désigner à Korami tous ceux qui seront venus nous parler (ces gardes sont ceux, précisément, qui ont frappé les indigènes) ; nous les faisons venir, leur demandons s’ils ont quelque chose à nous dire ; et, si rien, pourquoi restent-ils là ? Ils répondent que c’est la coutume, pour honorer un blanc de condition. Je leur montre que j’ai déjà relevé leurs noms, leur demande s’ils savent qu’il y a un nouveau gouverneur, leur dis que je viens tout exprès parce que je sais qu’il y a « des choses pas bien » qui se passent ici, mais que tous les méfaits seront punis, et qu’ils peuvent le redire à leur chef. Ils protestent alors fort habilement que leur chef et eux-mêmes n’agissent que d’après les ordres et indications des chefs blancs.
(Évidemment si le sergent de Bol était plus puissant, moins débordé, ce serait à lui de veiller à tout et d’empêcher les exactions.)
Encore un tas d’enfants, espions possibles, qu’il faut également renvoyer. Ils étaient bien, d’abord, une soixantaine de gens sur la rive. Elle se vide peu à peu. Nous remontons à bord avec quatre des plaignants de la veille et du matin. Ils me supplient de leur donner un papier de mon écriture, qui les mette à l’abri du ressentiment de Korami. Celui-ci ne leur pardonnera pas de m’avoir parlé ! Un papier de moi, croient-ils, peut empêcher qu’on ne les frappe. Je leur laisse enfin une lettre sous enveloppe à l’adresse de Coppet, qu’ils puissent envoyer à Fort-Lamy, si on les embête. Ils sont manifestement reconnaissants de ce peu que je fais pour eux. L’un d’eux, le plus âgé, prend mes mains et les serre fortement, longuement. Ses yeux sont pleins de larmes et ses lèvres tremblent. Cette émotion, qui ne peut s’exprimer en paroles, me bouleverse. Certainement il voit combien je suis ému moi-même et ses regards se chargent de reconnaissance, d’amour. Quelle tristesse, quelle noblesse dans ce pauvre être que je voudrais presser dans mes bras !… Nous partons.
C’en est fait. Nous avons atteint le point extrême de notre voyage. À présent c’est déjà le retour. Non sans regret, je dis un adieu, sans doute définitif, à tout l’au-delà du Tchad. (Occasion peut-être de dire ce qui m’attire tant dans le désert[86].) Jamais je ne me suis senti plus vaillant.
Sicherlich, es muss das Beste
Irgendwo zu finden sein.
Passé la nuit, blottis contre une île, entre les touffes de papyrus ; un peu à l’abri – ce qui n’a pas empêché le navire de chahuter toute la nuit, avec un vacarme de chaînes, de baleinières cognées, de portes claquantes – qui a complètement empêché le sommeil.
Levé l’ancre de très bonne heure – mais pour une série d’échouages successifs. L’eau balaie le pont de l’arrière ; nous ne savons où nous tenir et comment mettre à l’abri nos lits et nos affaires. Je crois que le brave capitaine s’est un peu perdu ; à moins qu’il n’ait d’abord essayé d’un des bras du Chari, bientôt reconnu impraticable… toujours est-il que, de nouveau, nous devons mettre cap au Nord.
Enfin nous revoici dans des eaux courantes. D’abord rien que touffes de grands roseaux, le terrain se relève lentement. Énormes termitières.
Nous avons longé la rive gauche (Cameroun) qui, presque soudain, s’est couverte d’une forêt point très haute, mais extraordinairement touffue. La voûte des arbres énormes et largement étalés était opaquement tapissée de lianes. Cela ne ressemblait à rien de ce que nous avions vu jusqu’à présent. J’aurais donné je ne sais quoi pour pénétrer sous ces mystérieux ombrages – et rien n’était plus simple que de dire au capitaine de s’arrêter, puisqu’il était convenu que nous disposions à notre gré du navire. Précisément l’on passa devant plusieurs points, dépouillés de roseaux, où l’atterrissage eût été des plus faciles. Qu’est-ce qui m’a retenu de donner ordre ? La crainte de déranger les plans ; la crainte de je ne sais quoi ; mais surtout l’extrême répugnance que j’ai de faire prévaloir mon désir, de faire acte d’autorité, de commander. J’ai laissé passer le bon moment, et lorsque enfin je consulte le capitaine, la forêt s’écarte et un grandissant matelas de roseaux la sépare du bord du fleuve. Le capitaine, qui du reste a besoin de faire du bois, parle d’une autre forêt prochaine. La voici déjà. Nous accostons. La berge argileuse forme falaise, mais pas si haute qu’à l’aide de quelques racines nous ne puissions l’escalader. Marc emporte le Holland and Holland, arme admirable qu’a bien voulu nous prêter Abel Chevalley, et moi, avec le fusil, abondance de cartouches de tous calibres. Adoum nous suit. La forêt, hélas ! est beaucoup moins épaisse et sombre que tantôt. Plus, ou presque plus de lianes ; les arbres sont moins vieux ; les sous-bois moins mystérieux. Et ce que nous voyons ici me fait regretter plus encore ce que nous avons manqué tout à l’heure. Quantité d’arbres inconnus ; certains énormes ; aucun d’eux n’est sensiblement plus haut que nos arbres d’Europe, mais quelles ramifications puissantes, et combien largement étalées ! Certains présentent un fouillis de racines aériennes entre lesquelles il faut se glisser. Quantité de ronces-lianes, aux dards, aux crocs cruels ; un taillis bizarre, souvent sec et dépouillé de feuilles, car c’est l’hiver. Ce qui permet de circuler pourtant dans ce maquis, c’est l’abondance incroyable des sentes qu’y a tracées le gibier. Quel gibier ? On consulte les traces ; on se penche sur les fumées. Celles-ci, blanches comme le kaolin, sont celles d’une hyène. En voici de chacal : en voici d’antilope-Robert ; d’autres de phacochères… Nous avançons comme des trappeurs, rampant presque, les nerfs et les muscles tendus. J’ouvre la route et me crois au temps de mes explorations d’enfant dans les bois de La Roque ; mes compagnons me suivent de près, car il n’est pas très prudent de nous aventurer ainsi avec un seul fusil à balles. Par moments, cela sent furieusement la ménagerie. Adoum, qui s’y connaît, nous montre sur une aire de sable des traces de lion, toutes fraîches ; on voit que le fauve s’est couché là ; ces demi-cercles ont été tracés par sa queue. Mais plus loin, ces autres traces sont certainement celles d’une panthère. Nous arrivons, au pied d’un tronc d’arbre mort, devant une excavation énorme, aboutissant à une bouche de terrier si vaste qu’Adoum s’y glisse jusqu’à mi-corps. Il ne le fait, il va sans dire, qu’avec prudence, car il commence par nous dire que c’est le gîte de la panthère ; et effectivement cela sent le fauve à plein nez. L’on voit tout auprès quantité de plumes de divers oiseaux que la panthère a dévorés. Je m’étonne pourtant que la panthère ait un terrier. Mais, tout à coup, Adoum se récrie : Non ! ce n’est pas une panthère ; c’est un animal dont il ne sait pas le nom. Il est extrêmement excité. Il cherche à terre, et nous montre enfin, triomphant, un grand piquant de porc-épic. Ce n’est pourtant pas un porc-épic qui a dévoré ces volailles… Un peu plus loin je fais lever une grande biche rousse, tachée de blanc. Puis quantité de pintades, que je rate ignominieusement. Je voudrais bien savoir ce qu’étaient ces oiseaux que j’ai poursuivis quelque temps, sous les branches. De la grosseur des perdrix, ils avaient leur allure ; mais le taillis était trop épais pour me permettre de tirer. Un gros singe gris vient étourdiment se balancer puis prendre peur à quelques mètres au-dessus de nos têtes. On entend et l’on voit de hautes branches s’agiter ; un bond, une fuite et, très loin déjà, retournée vers nous, une petite face grise avec deux yeux brillants. Par instants, les branches s’écartent ; il y a des clairières que bientôt le printemps emplira de son enchantement. Ah ! que je voudrais m’arrêter, m’asseoir, ici, sur le flanc de cette termitière monumentale, dans l’ombre obscure de cet énorme acacia, à épier les ébats de ces singes, à m’émerveiller longuement. L’idée de tuer, ce but à atteindre dans la chasse, étrécit mon plaisir. Assurément je ne serais pas immobile depuis quelques minutes, que se refermerait autour de moi la nature. Tout serait comme si je n’étais pas, et j’oublierais moi-même ma présence pour ne plus être que vision. Oh ravissement indicible ! Il est peu d’instants que j’aurais plus grand désir de revivre. Et tandis que j’avance dans ce frémissement inconnu, j’oublie l’ombre qui déjà me presse : tout ceci, tu le fais encore, mais sans doute pour la dernière fois.
Le bois s’éclaircit ; les sentes de gibier se font de plus en plus fréquentes, et bientôt nous retrouvons la savane semblable à celle que nous parcourions ces derniers jours avant le Tchad.
Nous rembarquons, n’ayant tué qu’une pintade.
Dans la falaise argileuse, devant le bateau, quantité de trous de guêpiers. On voit la trace du grattement de leurs deux pattes.
Arrêt, une heure avant le coucher du soleil, dans un très grand village (rive française) – Mani – où nous retrouvons les enfants que nous avions apprivoisés à l’aller. Le sultan, cet être arrogant et sans sourire, qui sans doute nous a jugés peu importants, d’après notre familiarité envers les inférieurs, ne daigne point paraître. Mais son jeune fils vient près de moi, s’assoit sur mes genoux, dans le fauteuil que j’ai fait porter à terre – et manifeste une tendresse qui compense les dédains du père.
Je ne sais plus les dates. Mettons : le jour suivant. Départ à l’aube. Ciel tout pur. Il fait froid. Tous ces matins, levé vers cinq heures et demie, je reste jusqu’à neuf heures et demie ou dix heures, emmitouflé de trois pantalons, dont deux de pyjamas – deux sweaters.
La pintade que nous avons tuée hier est succulente.
Je ne me lasse pas de regarder, sur les bancs de sable, ces énormes crocodiles qui se lèvent nonchalamment au passage du bateau et parfois glissent sur le sable, jusqu’à l’eau, parfois se dressent sur leurs quatre pattes, très antédiluviens et musée d’histoire naturelle.
Une petite pirogue, montée par deux hommes rejoint notre navire. Je ne l’ai pas vue s’approcher ; mais notre navire un instant a stoppé ; un indigène monte sur le pont, très digne encore que vêtu d’un boubou assez misérable. Il vient avec quatre poulets, de la part du sultan d’hier, et tout chargé de ses excuses. Il proteste qu’il a couru après nous hier soir, tandis que nous nous promenions dans le village. Le sultan a envoyé ces poulets hier soir déjà, mais si tard qu’Adoum (fort habilement) a refusé de nous réveiller. « Gouverneur il dort. » Tout cela n’était pas très décent de sa part, et je crois que le refus d’Adoum fort heureusement lui a fait honte, de sorte que tout aussitôt il a envoyé vers nous ce messager, ancien chef de village lui-même, qui a couru par voie de terre, coupant un coude du fleuve, pour rattraper le d’Uzès et réparer. Nous nous montrons dignes, sensibles et généreux ; et je me replonge dans le Second Faust.
On s’arrête vers dix heures pour « faire du bois ». Nous descendons à terre (rive Cameroun). Contrée très différente encore. Étrange alternance d’arbres, souvent admirables, et d’espaces découverts plantés d’herbes sèches. L’abondant gibier a tracé partout des sentiers sinueux que l’on suit sans peine. Le temps est splendide. Nous avons d’abord longé la rive, où j’ai pu tuer un canard et une pintade. Puis nous nous lançons comme la veille dans la brousse. Nous faisons lever un gros phacochère qui reposait sous un impénétrable abri de branches basses, penchées au-dessus de ce qui dût être un marécage, qui n’est plus qu’une croûte d’argile durcie. Nous le poursuivons quelque temps, sans parvenir à le revoir. Mais nous voici distraits par un petit troupeau d’am’raïs. Somme toute nous reviendrons bredouilles (n’étaient les volailles du début) – mais ravis. Je me souviendrai de ce double tronc d’arbre, une sorte d’acacia, aux branches basses, extraordinairement étendues, protégeant de son ombre noire un grand espace découvert et bordé d’une ronde d’autres acacias plus petits ; on eût dit un patriarche entouré de ses fils. C’est dans cet arbre énorme, plus puissant qu’aucun de nos chênes de France, que bondissait une troupe de singes, qui se sont enfuis à notre approche. L’arbre entier était couvert de cette bizarre plante grasse grimpante, qui semble un cactus, lance en tous sens des rameaux, tous exactement de même grosseur – qui semblent des serpents, rôdent à travers les branches, s’étalent en formant réseau sur le faîte, puis retombent de toutes parts, sur le pourtour de l’arbre, comme les franges d’un tapis.
Quantité incroyable de crocodiles sur les bancs de vase. Aplatis, collés au sol, couleur de fange et de punaise, immobiles, on les dirait directement produits par le limon. Un coup de fusil, et tous s’écoulent, comme fondus, et se confondent dans l’eau du fleuve.
Retour à Goulfeï. Nous y arrivons à la nuit close. Le sultan vient nous voir pourtant, mais nous lui disons que nous remettons au lendemain notre visite. Étrange malaise au début de la nuit. Il ne fait pas trop chaud ; presque frais ; et l’on étouffe. C’est une sorte d’angoisse dont ne pourra triompher le sommeil sans adjuvants. J’essaie, pour la première fois, du sonéryl (« talc et amidon », lit Marc sur le prospectus) dont l’effet ne tarde pas à se faire sentir. Mais la baleinière vient frotter la toile de tente contre la moustiquaire de mon lit, juste à hauteur de mon oreille. C’est un petit grattement continu, parfaitement insupportable. Je me relève trois fois et trimballe mon lit où je puisse ne plus l’entendre. Longtemps avant l’aube un tumulte d’oiseaux me réveille ; je distingue l’appel des pintades, le ricanement des canards. Ils sont tout près de nous. À la fin je n’y tiens plus ; je me rhabille à tâtons. Précisément Adoum, que ce vacarme réveille également, vient chercher fusil et cartouches. Nous sortons tous deux, furtivement. En trois coups nous tuons cinq canards. À ce dernier coup, tiré presque dans le noir, je suis tout surpris de voir avec un canard, trois petits oiseaux rester sur la place. Le second canard s’en va tomber un peu plus loin sur le fleuve ; d’autres s’envolent – et j’assiste à ce spectacle extraordinaire : un des fuyards revient auprès de son camarade tombé, se pose sur l’eau, d’abord un peu loin, craintivement, puis, en ramant, se rapproche, insoucieux du nouveau coup de fusil que je tire, et qui le manque. Ce n’est qu’au troisième coup qu’il s’enfuit ; comme à regret, car il revient encore voleter près de son camarade – et ce n’est, cette fois, que la pirogue qui s’en va chercher le défunt, qui, définitivement, le fait fuir. Marc nous a rejoints, à qui je passe le fusil. Il fait encore quatre victimes, avant que le soleil soit levé.
Rentrés pour le breakfast et la toilette ; mais voici déjà venir le sultan et sa cour. Nous baissons les toiles de tente pour changer de linge et nous faire beaux. Un blanc (fortement teinté, du reste, car c’est un Martiniquais) s’amène. C’est le sergent Jean-Baptiste, du secteur de prophylaxie du Logone. Il arrive à faire, nous dit-il, jusqu’à six cents piqûres par jour. Le pays est terriblement ravagé par la maladie du sommeil.
Nous rentrons dans cette ville, qui, la nuit, à l’aller nous avait paru si étrange. De jour elle ne l’est pas moins, et l’idée que nous nous en faisions n’était pas fausse. Goulfeï est parfaitement prodigieux. Le sultan nous mène jusqu’à sa demeure. Suite de salles très petites et basses, en terre durcie ; on y accède par un dédale de couloirs, de passages ; on traverse des cours ; tout cela très petit, mais trouvant le moyen d’avoir grand air, comme une demeure très primitive. Murs extraordinairement épais. Ce que cela rappelle le plus : les tombes étrusques d’Orvieto ou de Chiusi. Et tout le long de notre visite, au détour d’un couloir ou lorsque nous débouchons dans une cour, c’est, à l’autre bout, une fuite rapide de femmes et d’enfants qui courent se cacher dans d’autres retraits plus secrets. Très Salomé de Laforgue, et fuite, devant les ambassadeurs, de « l’arachnéen tissu jonquille à pois noirs ». Des escaliers aux marches énormes mènent aux terrasses. Marc y monte, la visite finie, pour tourner quelques films. Auparavant, le sultan nous avait laissés un instant dans une de ces nombreuses petites salles où l’on avait ouvert des chaises pliantes et allumé du feu pour nous recevoir ; et était allé revêtir ses robes d’apparat. Il revient resplendissant ; très simple du reste, amusé, et avec un sourire enfantin. Il nous avait laissés avec un oncle (le frère du sultan défunt) et son fils, un superbe adolescent, réservé et timide comme une jeune fille. Tous deux admirablement vêtus. Le fils particulièrement porte un vaste pantalon de soie grise brodée de bleu foncé (qu’on nous dit venir de Tripolitaine). Tous deux coiffés de petites chéchias de jonc tressé, brodées de laines multicolores. Courtoisie, gentillesse exquise.
Nous repartons à midi.
Arrêt vers trois heures à un nouveau village camerounien.
Grande débandade à notre approche. Petites filles et garçons se sauvent et se cachent comme du gibier. Les premiers que l’on ressaisit servent à apprivoiser les autres ; bientôt tout le village est conquis. Certains de ces enfants sont charmants, qui bientôt se pendent à notre bras, nous cajolent avec une sorte de tendresse lyrique ; mais qui nous disent vite adieu lorsque nous nous approchons du bateau, car ils gardent une certaine crainte qu’on ne les emmène.
Nous avons exprimé le désir de voir de plus près les crocodiles. On attache à la remorque du d’Uzès une pirogue où sont montés deux hommes de ce village. Arrêt vers quatre heures sur rive française. Vite nous prenons place dans la pirogue et traversons l’énorme Chari, gagnant, en face, un vaste banc de sable. Mais il est déjà trop tard pour les crocodiles. Alors nous nous enfonçons dans la brousse avec Adoum et les deux pagayeurs. Nous n’avons pas fait trois cents mètres que Marc tue une grande biche zébrée de blanc. Et cent mètres plus loin nous voici devant un énorme terrier. D’après la description que nous font les indigènes de l’animal qui l’habite, nous croyons comprendre qu’il s’agit d’un fourmilier[87]. Mais à présent le fourmilier a cédé la place à un autre gros animal dont on distingue le mufle, au fond du trou. De ma place je ne puis le voir, mais Marc, qui le voit, met en joue ; le coup ne part pas. Le phacochère, car c’en est un, bondit hors du trou, et à sa suite deux autres très gros et toute une portée de petits. Tout cela nous file dans les jambes ; je ne comprends pas comment aucun de nous n’a été bousculé. Un second coup de fusil abat l’un des trois gros. Adoum reste plié en deux de rire, parce qu’un de nos pagayeurs, pris de peur et voulant reculer, a buté contre une souche et roulé à terre. Encore qu’un des sangliers soit venu droit sur moi, jusqu’à n’être plus distant que de deux mètres, je n’ai pu croire un instant à quelque danger. Du moins veux-je dire qu’il me paraissait évident que l’animal cherchait à fuir et non pas à attaquer. Néanmoins je m’attendais à être renversé, car il était de belle taille, plus gros que celui que venait de tuer Marc ; mais au dernier moment, il a fait un bond de côté. Nous avons continué à battre la campagne, extrêmement excités, mais n’avons plus tué qu’une pintade. Entendu très distinctement le rugissement du lion ; les indigènes disent qu’il y en a un grand nombre. Celui-ci devait être assez près de nous. Le soleil s’était couché, et l’on commençait à ne plus y voir. À grand regret nous dûmes nous résigner à rentrer. La quantité de traces et de fumées sur le sol dépassait ce que l’on peut croire. Certaines paraissaient toutes fraîches, de phacochères, d’antilopes de toutes sortes et de toutes tailles, de fauves, de singes. Cependant nous ne voulions pas abandonner la victime, que nous avions laissée loin derrière nous avec un des hommes, chargé d’en écarter les hyènes ou les chacals. Le phacochère était terriblement lourd et les deux pagayeurs eurent beaucoup de mal à le porter jusqu’à la pirogue, les pattes liées deux par deux, par-dessus une longue branche. Adoum avait chargé la biche sur ses épaules. Elle était aussi lourde que lui. Quant au phacochère, il devait bien peser autant qu’un Béraud.
Retour en pirogue ; traversée dans la nuit, tout près de l’eau, tout contre l’eau. Équilibre douteux.
Retour à Lamy le 13. Notre voyage à Bol a duré onze jours.
Depuis qu’ils sont en brousse avec nous, nos boys ont de la viande tous les jours. Outhman déclare : « Nous heureux quand nous manger bien, parce que, quand manger bien, pas penser. » Et comme nous lui demandons : « penser à quoi ? » il se défile et parle de son camarade. « Adoum, quand pas manger bien, lui penser à Abécher, penser à sa mère. Plus penser du tout quand bien manger. »
Courrier de France ; mais pas de lettres.
Je relève dans Le Rire, cette légende admirable d’une caricature médiocre :
« Voyons, mon garçon, je vous l’ai déjà dit : si vous ne buviez pas, vous pourriez être caporal.
– C’est vrai, mon capitaine ; mais c’est que, quand j’ai bu, je me crois colonel. »
Dindiki se précipite sur les éphémères[88], les saisit à pleines petites mains, pour les croquer, comme avec rage.
Étudier l’éthique et l’esthétique de Dindiki. Sa façon particulière de se mouvoir, de se défendre, de se protéger. Chaque animal a su trouver sa manière, hors de laquelle il paraisse qu’il n’y ait pour lui point de salut.
Fort-Lamy, 16 février.
Hier Adoum dormait tranquillement dans une case indigène. Deux blancs arrivent : un sergent et un caporal. Ils veulent une femme, qu’ils pensent qu’on leur cache ou qu’on refuse de leur livrer. Adoum, qui s’était tu d’abord et faisait semblant de dormir, s’interpose quand il voit ces sous-offs allumer de la paille et mettre le feu à la case. – « De quoi se mêle ce sale noir ? Si tu dis un mot on va te foutre au bloc. – Oui, dit Adoum ; c’est vous qui foutez le feu à la case ; et c’est moi qui vais aller au bloc. » Sur ce, le sergent se saisit de lui et lui administre un violent coup de chicotte, dont il porte encore la marque en travers du dos, ce matin. L’incendie qui se déclare attire du monde, dont Zara la procureuse et Alfa, le boy de Coppet, qui conjure Adoum de ne pas protester.
J’apprends ce soir que l’affaire a des suites. Un long rapport est communiqué à Coppet, où l’administrateur-maire réclame énergiquement une sanction, auprès de l’autorité militaire.
Une commande d’appareils de T. S. F. faite en 1923 pour besoins de services en 1924, n’était pas encore arrivée, ni même annoncée à Fort-Lamy au moment de notre départ… Ces retards sont dus, nous explique-t-on, aux complications d’engrenages, les commandes administratives devant être d’abord centralisées au ministère des colonies, par un bureau spécial, où des agents spéciaux sont chargés de s’entremettre avec les fournisseurs. Ces agents, qui n’ont jamais mis les pieds aux colonies, modifient à leur gré et selon leur appréciation particulière, les commandes, ne tenant le plus souvent aucun compte des exigences spécifiées[89].
Longue visite à Pécaut, le vétérinaire, homme remarquable. Il m’apprend que le papillon rouge que j’ai laissé m’échapper plusieurs fois dans la forêt de Carnot, est particulièrement rare et demandé. Que de reproches je me fais ! Je crois bien que les papillons rouges que j’ai vus (5 ou 6 fois) étaient de deux espèces – ou du moins de deux variétés assez distinctes. Pas très grands ; d’un admirable rouge minium un peu sombre.
Nous partons dans deux jours.
Quatre-vingts porteurs sont commandés à Pouss, que nous gagnerons en baleinières de la compagnie Ouham et Nana.
Pour une meilleure répartition des charges, et l’examen des munitions, Marc ouvre toutes les caisses. Nous constatons que sur les douze touques de farine (10 kilos chacune) emportées de Brazzaville, il n’en est pas une seule qui n’ait été percée de trous par les clous de l’emballage. Ces touques de fer-blanc sont soigneusement soudées, mais, par ces trous, les charançons sont entrés ; et l’humidité a gâté une partie de la farine[90].
Le 20 février, au matin.
Nous quittons Fort-Lamy en trois baleinières. C’est le retour. Désormais chaque jour me rapproche de Cuverville.
APPENDICE AU CHAPITRE VII
Je dois à l’obligeance de Monsieur de Poyen-Bellisle la communication que voici.
I
Après la conquête du Tchad, les militaires ne perçurent, en supplément des vivres alloués par l’intendance, qu’une mensualité de 40 à 50 francs. Cette mesure permettait de supprimer les transferts d’argent très difficiles à cette époque, elle contraignait les militaires, qui touchaient à Brazzaville, au retour, un rappel de solde pour toute la durée de leur séjour au Tchad, à faire des économies, mais elle les obligeait aussi à ne pas payer aux indigènes la valeur réelle des produits du cru.
Au début, aucun cours de ces produits n’étant établi en argent, ni même établi du tout, l’inconvénient n’était pas grand ; l’abus commença seulement à partir du jour où les rentes commerciales devenues sûres, des produits importés furent mis en vente sur les marchés du Tchad, où la possibilité d’acquérir des produits venus de l’étranger ne fut plus limitée aux seuls Chefs. Même avant la guerre, avant la chute du franc, il n’y avait déjà plus de commune mesure entre les prix exigés du consommateur indigène obligé ou désireux d’acheter des marchandises d’importation et les prix de vente imposés au même indigène pour les produits de sa terre ou de son industrie. Il y eut donc abus. L’habitude de vivre à bon compte est une de celles auxquelles les Français tiennent le plus et ils s’y attachèrent d’autant plus qu’il était en leur pouvoir d’en faire une règle. Personne, de 1918, date à laquelle la valeur des produits importés s’éleva sans cesse, jusqu’à 1926, n’eut l’idée (ou s’il l’eut il l’écarta comme une pensée déplaisante) que les prix payés aux indigènes devaient être augmentés. Les prix des produits du cru étaient approximativement ceux-ci dans la région de Fort-Lamy, il y a une dizaine d’années : bœuf sur pied 25-50 frs, mouton 1.50-2.50 frs, viande au détail 0,20 à 0,25 frs le kg, œufs, un et même deux pour 0,05, poulet 0,25 à 0,50 frs, mil 0,05 le kg, lait 0,10 le litre, huile d’arachides et beurre 0,70 le litre. – À ce moment, si le coût de la vie était déjà manifestement trop faible pour les Européens, l’existence matérielle était facile pour les indigènes non producteurs, obligés de s’approvisionner dans les marchés. La comparaison ci-dessus se limite aux produits du cru. Mais tandis que la valeur du franc diminuait, l’injustice allait grandissant. À la fin de 1925 – je prends pour baser mon raisonnement l’article importé de vente la plus courante – un yard de calicot valait 10 frs, alors qu’il coûtait au plus 0,75 frs en 1918. Les autres produits importés avaient augmenté de valeur dans des proportions analogues.
De par la volonté des Européens intéressés à tenir très bas les cours des produits du cru, les indigènes pouvaient s’alimenter à bon compte, le mil, l’aliment essentiel, se payait 0,05 le kg, 4 frs l’hectolitre ; très au-dessous de sa valeur. Le producteur était lésé, mais le consommateur indigène bénéficiait des prix fixés, imposés arbitrairement par les Européens qui entendaient avant tout vivre économiquement et que cette volonté fermait à tout raisonnement comme à toute justice.
À la fin de 1925, un facteur nouveau vint compliquer la question : la récolte de mil fut déficitaire partout et manqua complètement dans de nombreuses régions. En décembre quelques tonnes de mil apportées sur le marché de Fort-Lamy ayant dû, sur l’ordre de l’Administration, être vendues au prix très inférieur aux prix pratiqués sur les marchés voisins du Cameroun, Fort-Lamy se vit privé de tout approvisionnement en mil. Le mil ne reparut à Fort-Lamy qu’à partir du jour où liberté absolue du commerce fut officiellement proclamée. À chaque marché, il en était mis en vente des quantités très suffisantes pour les besoins de la population, mais le prix s’éleva vite, pour se maintenir durant plusieurs mois à 1.50 frs le kg. L’indice du coût de la vie des indigènes passait subitement de 1 à 20, sinon davantage. Avant cette époque les produits destinés aux Européens avaient bien subi une légère augmentation à Fort-Lamy même ; dans la brousse ils étaient restés tels qu’en 1918. À Fort-Lamy, lorsque la hausse du mil se produisit, un poulet se payait de 0,75 à 1 frs, la viande de boucherie 1 frs le kg, un œuf 0,10. Le prix de la vie s’était élevé pour les Européens par rapport à 1918 de 150 % en moyenne, pour les indigènes, calculé en argent, il avait vingtuplé en ce qui concerne le mil et augmenté de 1500 % pour les produits importés. Pour dire autrement, il suffisait de trois poulets pour se procurer 20 kg de mil ou plus d’un yard de calicot en 1918 ; au début de 1926 il fallait vendre trois ou quatre poulets pour obtenir deux kg de mil et dix poulets pour acheter un yard de calicot. La démonstration pourrait être poussée très loin, les résultats seraient identiques et inattaquables.
L’arrivée du Gouverneur M. de Coppet empêcha même un désastre, car l’administration locale avait eu l’idée aussi simple qu’inapplicable de taxer le mil. À l’instant même, si cette mesure eût été prise, le mil disparaissait de tous les marchés et, s’il en avait existé des stocks dans les villages, il eût été nécessaire d’aller les réquisitionner à main armée. Mais comme il n’y avait pas de stocks, la mesure eût été inopérante en tant qu’elle visait des résultats pratiques, elle aurait présenté d’autre part l’inconvénient d’interdire aux intermédiaires indigènes d’aller s’approvisionner de mil au Cameroun et en Nigeria. Car la liberté laissée aux transactions suscita un grand nombre de vocations commerciales et il est permis de dire que c’est grâce à ces intermédiaires, que la famine n’a pas sévi dans la région de Fort-Lamy. Ils se procuraient du mil contre des pièces de 5 frs en argent et, compte tenu de la valeur locale, très variable, de l’argent (20 à 30 frs en billets pour une pièce), le mil leur était vendu 1 fr environ le kg, franc papier. En ajoutant à ce prix, les frais de transport par pirogue, par bœuf, à tête d’homme, les dépenses occasionnées par le déplacement, le prix de 1.50 fr le kg sur le marché de Fort-Lamy n’était pas excessif.
Une hausse des prix applicable aux Européens par les produits du cru s’imposait donc absolument, tout autre que M. de Coppet n’aurait pu s’y opposer sans manquer à la justice. Il convient de noter que les indigènes n’ont pas en général abusé de la liberté toute nouvelle qui leur était laissée. En décembre 1926 le kg de bœuf ou de mouton se vendait à Fort-Lamy 2 fr, un œuf 0,25, un poulet de 2.50 à 4 frs, le beurre et l’huile d’arachides 5-6 frs le litre, le lait à 0.50 le litre. L’augmentation générale moyenne peut être évaluée sur la base des prix de 1918, à 6 ou 700 %, augmentation normale si l’on tient compte de ce qu’en 1918, les prix étaient établis par l’Administration, sans que les producteurs eussent voix au chapitre, et qu’il y avait une différence appréciable entre les cours officiels et la valeur marchande des produits.
Une des causes du mécontentement pour ainsi dire général qu’a provoqué le renchérissement de la vie dû à la liberté du commerce, c’est que les traitements n’ont pas été augmentés dans les mêmes proportions. Le fait est exact, mais (exception faite pour les fonctionnaires que le Gouvernement a voulu avantager dans un but électoral, les instituteurs par exemple), la même inégalité se retrouve en France. Un Administrateur de 1re classe des Colonies, célibataire, touchait à Paris 8 000 frs d’appointement en 1917, il en touche aujourd’hui 24 600. – Tant que le régime paiera mal ses agents – et ce sera toujours, car ils sont trop nombreux – ceux-ci succomberont à la tentation, lorsqu’ils en auront le pouvoir, de ne pas payer généreusement les indigènes.
Ce qu’on peut dire encore en faveur de la liberté commerciale au Tchad, c’est que, dans toutes nos possessions, cette liberté a succédé à la liberté qu’avaient eue à l’origine les Européens d’imposer les prix qu’ils entendaient payer. Ailleurs on a procédé graduellement ; au Tchad, il a été nécessaire, les circonstances l’exigeaient – mauvaise récolte, nécessité de procurer aux indigènes des ressources leur permettant d’acheter du mil devenu cher – d’agir avec une certaine brutalité. C’était indispensable et c’est bien ; on s’accoutumera rapidement au nouveau système qu’on ne peut critiquer qu’avec des arguments d’intérêt personnel et dépourvus de la plus élémentaire équité.
Le seul point noir est que l’indigène, en dehors de son village, de son campement, des détails habituels de son existence quotidienne, manque de mesure et de jugement. Habitué à subir depuis toujours le despotisme de ses chefs, il risque d’être désaxé par la latitude qui lui est donnée de traiter d’égal à égal avec le blanc sur le terrain commercial. Peut-être eût-il été avantageux de protéger le producteur indigène en fixant, par des mercuriales révisables, des prix convenables – mais de lui imposer ces prix.
En pays noir, en pays islamisé surtout, l’autorité, même si elle côtoie la justice, est préférable à la meilleure des mesures qui apparaîtrait à nos sujets renfermer une part de faiblesse, un abandon de pouvoir. Et cela est d’autant plus indispensable que le prestige du blanc a singulièrement fléchi depuis quelques années au Tchad, dans le Bas Chari notamment notre domination n’est que nominale et si nous ne rétablissons bientôt une autorité dont le souvenir se perd chez les Chefs et chez leurs administrés, nous allons rapidement vers l’anarchie et des événements désagréables. Il faut certes s’intéresser aux indigènes, les aimer, mais s’ils sentent la faiblesse chez celui qui commande (et la bienveillance trop apparente sera toujours considérée par eux comme un manque d’énergie), le Chef cessera vite d’en être un à leurs yeux.
II
J’allais donner le « bon à tirer » de ce livre, lorsqu’on me communique un numéro de la Revue de Paris (1er Mai 1927) où M. Souday me fait l’honneur de protester contre les quelques lignes que l’on peut lire à la fin du chapitre V de cette relation de voyage.
Inutile de répondre. Mais comme le lecteur pourrait avoir oublié les phrases auxquelles je faisais allusion, M. Souday me permettra de les reproduire :
« … Raffolez-vous de Britannicus ? Certes, c’est très bien fait, très bien écrit, mais de ce style oratoire et académique que Taine a défini avec force. Et les sentiments sont élémentaires. La fameuse tirade tant vantée de Narcisse, qui retourne Néron, ressemble pour le fond à ce que la première petite-femme venue dirait à son mari pour l’exciter contre sa belle-mère : » “Elle se moque de toi derrière ton dos ! Elle se vante de te mener par le bout du nez !” etc.… Ce n’est pas sorcier… La « tragédie des connaisseurs » me semble bien inférieure aux tragédies historiques de Corneille, à Cinna, même à Nicomède. Racine est avant tout un grand peintre de l’amour : ses chefs-d’œuvre, ce sont Andromaque, Bajazet, Phèdre, et il avait en lui une veine de poésie qui s’est même développée par exception dans Athalie, sous l’action de la ferveur religieuse. Mais il n’y a dans Britannicus ni lyrisme, ni pensée. »
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse
du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Novembre 2009
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : JacquesC, Jean-Marc, MauriceC, PatriceC, Coolmicro et Fred.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.