
Paul Landormy
LA MUSIQUE FRANÇAISE TOME I
DE LA MARSEILLAISE À LA MORT DE BERLIOZ
(1943-1944)
CHAPITRE PREMIER
LA MUSIQUE SOUS LA RÉVOLUTION DE 1789
LA MARSEILLAISE – LE CHANT DU DÉPART
Le XIXe siècle commence en 1789. Un esprit nouveau, parti de France, souffle sur la vieille Europe. En musique, comme dans tous les autres domaines, et surtout en France, il fait sentir ses effets. La Révolution, en bouleversant l’ordre social et politique, atteint aussi les arts et principalement l’art musical. On ne fait plus seulement de la musique pour distraire les princes, les rois et les grands. On attribue à la musique un rôle plus large et plus élevé, qui est d’entretenir les sentiments patriotiques. Au delà de la patrie même, on vise l’humanité. Car tous les hommes sont frères, et cette fraternité on veut la faire régner sur la terre. C’est l’époque des chants nationaux et des chants humanitaires. La musique devient affaire d’État. Conception toute moderne, inspirée d’ailleurs à certains égards de l’antiquité. Comme dans la République de Platon, la musique fait partie et une des parties les plus importantes de l’éducation du citoyen. Dans son projet sur les exercices scolaires, Rabaut-Saint-Étienne écrit (21 décembre 1792) : « En chaque exercice, il sera chanté des hymnes à l’honneur de la patrie, à la liberté, à l’égalité, à la fraternité de tous les hommes ; des hymnes propres enfin à former les citoyens à toutes les vertus. »
Ils devront être approuvés par le Corps législatif. On crée des fêtes civiques où la musique joue un rôle capital : fêtes de la Nature, de l’Agriculture, de la Jeunesse, des Époux, de la Reconnaissance, de l’Être suprême. « Il est une sorte d’institution, dit Robespierre, qui doit être considérée comme une partie essentielle de l’éducation publique : je veux parler des fêtes nationales. »
Dès 1789 GOSSEC est nommé directeur de la musique de ces fêtes nationales, et lorsque SARRETTE eut obtenu la direction de l’Institut national de musique (1793), devenu bientôt après le Conservatoire (1795), c’est encore GOSSEC qui est choisi comme inspecteur, avec Cherubini et Lesueur.
GOSSEC, LESUEUR, MÉHUL, CHERUBINI, DALAYRAC, BERTON, CATEL collaborent successivement à l’organisation de toutes les fêtes révolutionnaires.
Quand on songe à l’appareil grandiose de ces cérémonies où des symphonies militaires étaient exécutées sur les places publiques par des orchestres monstres, où des chants patriotiques étaient entonnés par des milliers de choristes et repris par le peuple entier, on ne peut s’empêcher de penser, avec Julien Tiersot, que BERLIOZ, l’élève de Lesueur, l’auteur de la Symphonie funèbre et triomphale et du Requiem à cinq orchestres, sera l’héritier direct de tous ces musiciens de la Révolution qui ne faisaient qu’adapter à des circonstances nouvelles, avec des moyens infiniment plus puissants, l’art pittoresque, pathétique et un peu théâtral qu’ils employaient sous l’ancien régime, à composer leurs Te Deum et leurs Jugements derniers.
Car la musique de la Révolution se prépare déjà sous les premières années du règne de Louis XVI. Il faut noter dans le Te Deum, la Messe des morts, la Nativité de Gossec, l’intention descriptive, la recherche des effets de timbre, les effets de masse et le désir d’étonner. Gossec se plaît à « faire frissonner » ses auditeurs « par les plus pathétiques accords », à imiter « le bruit affreux du tonnerre joint à celui des flots irrités », « le bouleversement de la nature et l’écroulement de l’univers ». Il imagine « l’effet terrible » d’un groupe d’instruments à vent « cachés dans l’éloignement pour annoncer le Jugement dernier, pendant que l’orchestre exprimait la frayeur par un frémissement sourd de tous les instruments à cordes ».
Les mêmes moyens ou des moyens analogues, les effets de puissance obtenus par toutes sortes de bruits d’orchestre, et au besoin celui du canon, seront employés dans ces fêtes de la Révolution qui célèbrent l’écroulement de l’ancien monde et l’avènement d’une civilisation nouvelle.
Non seulement on use des mêmes moyens, mais le même personnel de chefs d’orchestre et d’exécutants se met immédiatement au service des autorités révolutionnaires. Remarquons ici l’extraordinaire souplesse des artistes musiciens à s’adapter aux régimes politiques les plus divers, les plus opposés, à changer de convictions comme d’un simple habit qui leur tient à peine au corps et pas du tout à l’âme. Remarquons cette prudente adresse, sans l’admirer.
Mais, il faut l’avouer, les révolutionnaires virent grand et firent grand. Ils surent organiser des spectacles magnifiques accompagnés d’extraordinaires musiques. Il y manquait certes le génie d’un Beethoven qui y aurait si heureusement et de si bon cœur trouvé son emploi. Le génie du moins ne manqua point à l’auteur de la Marseillaise et à celui du Chant du départ.
Spectacles merveilleux que ces fêtes révolutionnaires. Merveilleux de conception, de pittoresque et d’ordre, parfois d’évocation poétique.
Voici, par exemple, la fête du 14 juillet 1790, le premier anniversaire de la date mémorable. Un cortège brillant et grave traverse Paris : « En tête, à cheval, avec sa musique, ses timbales et ses trompettes, un détachement de la garde nationale parisienne nouvellement formée. Puis les citoyens de Paris nommés en avril 1789 par les États généraux. La garde nationale à pied précédée de sa musique. Les citoyens élus en août 1789 au nombre de 240. Les tambours de la ville. Les 120 commissaires élus par les 60 districts pour faire les honneurs de la fête, accompagnés des présidents de tous les districts, les administrateurs provisoires de Paris, le maire, la garde et la musique de Paris. Le Roi, avec, à sa droite, le président de l’Assemblée nationale. Ensuite, en hommage aux idées de J.-J. Rousseau, 100 nourrissons portés dans les bras de leurs mères. Maintenant un bataillon de 400 enfants âgés de huit à dix ans, musique en tête. Après eux, les députés de 42 départements de la France, les troupes de ligne de toutes armes, soldats et marins, y compris les représentants de la marine marchande. Les députés des 42 autres départements. Un bataillon composé de vétérans ou vieillards. Pour terminer, un détachement de gardes nationaux à cheval. Suivent 14.000 députés. On se rend au Champ de Mars où un colossal amphithéâtre donnant place à 200.000 personnes a été construit par des ouvriers volontaires de tout âge. Au centre, l’autel de la Patrie sur lequel le grand aumônier de France, assisté de 60 aumôniers de la garde nationale, célèbre une messe solennelle. Alors le général La Fayette vient, au nom de tous, prêter serment de fidélité à la Nation, à la Loi, au Roi, à la Constitution. » Les larmes inondent les visages. Les cris d’enthousiasme se font entendre. Un Te Deum de Gossec, d’allure un peu militaire, se fait entendre « pour remercier l’Être suprême de tous les biens dont il comblait la France depuis une année entière ». La messe avait d’ailleurs continuellement été accompagnée de musique, en partie empruntée à l’ancien répertoire des fêtes royales. Mais on ne pouvait improviser d’un seul coup tout un répertoire nouveau.
En annonçant la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, un journal du temps disait : « Jamais l’Univers n’aura offert un pareil spectacle. » Et L. David, en dressant le plan de la fête du 10 août 1793, écrivait : « Peuple français ! C’est toi que je vais offrir en spectacle aux yeux de l’Éternel. » À de telles fêtes, le peuple entier, la Nation participe. À ces fêtes, il faut donc une musique simple, claire, à larges lignes un peu sommaires. Ne nous en étonnons pas. Musique de plein air qui ne s’accommoderait d’aucun raffinement. Musique d’allure presque toujours un peu militaire et rappelant à la fois, par sa concision et le tonnerre de quelques-uns de ses effets, les commandements des chefs et la réponse des armes. En septembre 1791, lors de la proclamation de la Constitution, on éleva de nombreux orchestres aux Champs-Élysées. De grandioses exécutions auxquelles les chœurs de l’Opéra prirent part eurent lieu autour de l’autel de la Patrie, et quand le cortège, Bailly en tête, entra au Champ de Mars, « on fit, à cet instant, une décharge considérable de canons. On avait établi, sur le haut de Chaillot, une batterie répondant à celle qui était sur le bord de la rivière, composée de cent trente canons ».
Moyens un peu gros, sans doute, et au bruit desquels se perd un peu la musique.
Mais il n’y a pas que ce bruit des armes, ce « tonnerre » des canons. La musique, la vraie, a aussi sa part dans l’œuvre de la Révolution, quand ce ne seraient que ces chants nationaux qui atteignent au sublime : la Marseillaise et le Chant du départ, – nous y revenons.
La Marseillaise d’abord, – quoiqu’on puisse préférer le Chant du départ, pour plus de ligne, plus de profondeur et plus de dignité. Mais la Marseillaise procède d’un tel élan, et son accent est tellement entraînant ! Aucun chant patriotique, aucun hymne national dans aucun temps et dans aucun pays ne s’élève à cette hauteur d’enthousiasme. « Je fis les paroles et l’air de ce chant à Strasbourg, écrit Rouget de Lisle, dans la nuit qui suivit la proclamation de la guerre, fin avril 1792. » Cet hymne, improvisé par un jeune capitaine du génie et qui lui avait été demandé par le maire de Strasbourg, Diétrich, fut d’abord intitulé Chant de guerre pour l’armée du Rhin, dédié au maréchal Lukner. L’imprimerie Daunbach à Strasbourg le publia. Puis il fut transmis à Marseille par un journal constitutionnel et les volontaires marseillais le chantèrent le 30 juillet 1792 à leur entrée à Paris. D’où le nom qu’on lui donna dès lors et qui lui est resté de Marseillaise.
Le Chant du départ atteint au sublime par des moyens plus simples, moins violents. Il a plus de style. Son effet n’est pas moins irrésistible que celui de la Marseillaise. Il fut composé par Méhul sur des vers de M.-J. Chénier. Sans en être certain, on admet, d’après un récit d’Arnaut, qu’il fut exécuté pour la première fois à Fleurus le jour de la victoire de l’armée de Sambre-et-Meuse commandée par Kléber et Marceau (26 juin 1794) : « Jamais, a dit très justement Arnaut, on ne sera tout ensemble aussi noble et aussi populaire[1]. »
*
On pourrait croire que, parmi tant de graves et de terribles événements, la Révolution nuisit au succès des représentations théâtrales, qu’elle les fit même complètement disparaître. Il n’en est rien. Tout au contraire. Un décret de janvier 1791 proclame la liberté des spectacles : 60 salles de théâtre s’ouvrent à Paris, dont 16 ou 18 scènes musicales. On joue l’ancien répertoire Gluck et Sacchini, Méhul et Grétry. On joue des pièces de circonstance : le Siège de Lille (1792) de Rodolphe Kreutzer, le Réveil du peuple ou la Cause et les effets (1793) de Trial, l’Intérieur d’un ménage républicain (1794) de Fay, les Vrais Sans-Culottes (1794) de Lemoyne, Viala ou le Héros de la Durance, de Berton (1794), la Nourrice républicaine (1794). À l’Opéra, le 8 juillet 1794, on joue la Réunion du 10 Août ou Inauguration de la République française, sans-culottide en cinq actes, musique de Porta, paroles de Moline et Bouquier.
Musique souvent bâclée, quelquefois de pur vaudeville.
Représentations tumultueuses interrompues de temps à autre par des chansons patriotiques et politiques qu’entonne le public.
Société prodigieusement vivante, animée de passions exaltées au plus haut point dont les manifestations diverses, selon les partis en présence, s’entre-choquent furieusement.
Dominant tout ce flot singulièrement mêlé de musiques qui souvent n’en méritent pas le nom, se dressent quelques œuvres et quelques hommes. De ces hommes, il en est au moins un dont il faut mettre en pleine lumière la belle figure, car il a du génie : c’est MÉHUL, l’auteur du Chant du départ.
Figure charmante, d’une expression douce et tendre, avec de grands beaux yeux, profil délicat, mais aussi du drame et de la force derrière une apparence un peu frêle.
CHAPITRE II
LE ROMANTISME MUSICAL
Dans la musique de Méhul nous trouverons déjà bien des traces de romantisme, ou, si l’on aime mieux, des tendances assez marquées au romantisme. Ce grand artiste commence à faire la liaison entre les classiques du XVIIIe siècle et les romantiques du XIXe.
Nous savons ce qu’est le romantisme en littérature. Il conviendrait peut-être d’expliquer ce qu’il est en musique et comment il se forme.
Le romantisme musical se caractérise en premier lieu par le choix des sujets traités.
Et d’abord, tout ouvrage romantique en musique aura un sujet. Finie la musique pure, la musique qui se développe pour elle-même, sans autre signification que son contenu sonore. Il faut décrire, il faut peindre, même si l’on ne compose pas pour le théâtre et si l’on ne parle pas aux yeux en même temps qu’aux oreilles. L’imagination visuelle doit alors être mise en jeu par les suggestions appropriées. Il faut que le monde extérieur existe pour le musicien romantique, et il doit le prouver.
Parmi tous les sujets qui s’offrent, on préférera ceux qui prêtent le plus à la couleur. On décrira volontiers les pays ou les âges éloignés, le moyen âge et l’Orient, et aussi les domaines du fantastique, du surnaturel. On laissera de côté l’âge classique par excellence, l’antiquité grecque et romaine.
On choisira de préférence aussi les sujets qui donnent matière plus que d’autres au pathétique, à l’effusion sentimentale, et à cette effusion ne s’opposeront plus les bornes des convenances du style : elle aura tous les droits. Le sentiment, la passion s’étaleront en larges nappes. Dans la musique classique, il faut souvent chercher le sentiment. Il se laisse à peine deviner. On peut discuter de l’interprétation affective d’une mélodie de Haydn ou de Mozart. Qu’exprime-t-elle au juste ? Exprime-t-elle quelque émotion assignable ? En tout cas, l’interprète doit mettre en évidence une émotion d’un caractère si discret. Nulle hésitation de ce genre en présence d’une composition romantique dont le sens expressif se définit clairement par lui-même. Le classique dissimule, le romantique souligne et parfois écrase l’expression.
Ces dispositions du romantique par opposition à celles du classique se traduisent par des caractères techniques que nous pouvons maintenant tâcher de déterminer.
Dans la musique romantique, la ligne mélodique affecte une courbe moins simple, plus capricieuse, plus irrégulière. Elle procède par de plus grands élans.
La mélodie ne donne plus l’impression d’un tout aussi harmonieux composé, calculé, équilibré. Le musicien renoncera peu à peu à la carrure. – On appelle carrée toute mélodie qui se compose d’un certain nombre de fois 4 mesures. – La mélodie classique-type est faite de 8 ou de 16 mesures. Ajoutons que, dans le développement de ces 8 ou 16 mesures, il y a souvent des répétitions ou des imitations qui constituent des symétries aisément perceptibles et donc des facilités pour la mémoire de l’auditeur. Renoncer à ces symétries devient grave. Comment retenir l’air qu’on ne pourra plus « siffler » en sortant de la salle de concert ou de théâtre ? Or, c’est justement de cette chaîne obsédante que se délivre le romantique. Il veut construire son chant en toute liberté, et par exemple, la 1re phrase de la Sonate de Franck aura 27 mesures et celle du Quatuor de Lekeu 43. Rien dans de telles compositions de la régularité classique. Phrases trop longues aussi, pensera-t-on, pour être retenues aisément d’un bout à l’autre. Mais quel avantage en revanche pour l’expression !
Dans la musique classique, la mélodie constitue un tout bien déterminé. Elle a un commencement, un milieu et une fin. La fin notamment se trouve annoncée par une cadence, c’est-à-dire par une certaine formule harmonique qui ne prête à aucune ambiguïté. C’est un point au bout de la phrase. Un point, à la ligne. L’auditeur ne s’y trompera pas. Il saura que le thème est achevé et qu’on va passer à autre chose. Le musicien romantique renoncera un beau jour à ces cadences stéréotypées, il en abandonnera les formules, il laissera la mélodie s’achever sans cette ponctuation finale, ou ne pas s’achever du tout, se continuer par une autre mélodie dont elle se distinguera à peine. Ce sera la mélodie infinie, comme l’appellera Richard Wagner. Quelle porte ouverte à la rêverie, au vague de l’expression, à tout ce qui est le plus cher au romantique !
D’une façon générale, le souci de l’architecture passe au second plan, – sans pourtant être abandonné, mais pour faire place à des constructions plus savantes, plus complexes, moins aisément saisissables.
Il ne s’agit plus avant tout de se faire facilement comprendre, mais d’abord d’émouvoir ou de solliciter vivement l’imagination. Les vieux cadres tombent. Toutes les fantaisies sont admises.
Ce n’est pas seulement dans le découlement de la mélodie que ces libertés nouvelles trouveront place, mais aussi dans le choix et l’enchaînement des harmonies. Les accords qui, jusque-là, n’avaient servi que d’accompagnement, de soutien à la mélodie, aidaient à mieux percevoir le rapport de chaque note du chant avec la tonalité, prendront à leur tour un caractère expressif : ils signifient l’attente, le regret, l’espoir ; ils fortifieront le sentiment déjà traduit par la mélodie, ils lui donneront une pointe plus sensible. De leur valeur intellectuelle, ils passeront à une valeur affective, non seulement par leur constitution individuelle, mais par ce qu’ils annoncent, ce qu’ils préparent, mais par ce qui se produit ou ne se produit pas à leur suite, satisfaction ou déception qui émeut à son tour : l’enchaînement des harmonies devient un moyen expressif de la plus haute importance. Il ne s’agit plus seulement de l’accord de septième de dominante ou de septième diminuée, précieuses inventions du temps de Monteverdi, mais de toutes sortes d’autres agrégations sonores et de leurs suites dont le compositeur s’appliquera à augmenter la variété et l’imprévu.
Le romantisme en musique usera également de la recherche et de la nouveauté dans l’instrumentation. Nous avons vu Gluck en essayer les premiers effets dans son Orphée et se soucier fort de faire aboyer son orchestre ou d’en employer quelques instruments au rendu d’un écho naturel. Le coloris orchestral est l’objet de toutes sortes d’inventions déjà bien avant la fin du XVIIIe siècle.
Gluck n’est cependant pas un romantique, ni la plupart de ses contemporains. Non certes. C’est un des classiques les mieux caractérisés. Mais n’oublions pas que ni le classicisme ni le romantisme ne sont des absolus, mais seulement des degrés dans une échelle qui en comporte une infinité et de très divers. C’est ainsi qu’il est facile de découvrir du romantisme dans l’œuvre pourtant si classique de Mozart, ne fût-ce que dans ce Don Juan qui ne témoigne pas de son audace et de sa fantaisie seulement dans son livret, mais dans les moyens employés pour en traduire musicalement les effets.
Tout ouvrage musical est un mélange de classicisme et de romantisme.
Et d’abord, la musique tend par elle-même vers le romantisme plus qu’aucun autre art.
On remarquera, d’autre part, que, d’une façon générale, les Français sont beaucoup plus classiques et les Allemands beaucoup plus romantiques, ceux-ci notamment par une prédominance du sentiment dont se garde volontiers le Français, plus discret et plus soucieux de la ligne.
Il y a eu du romantisme en musique à toutes les époques et il y en aura toujours.
Quoi qu’il en soit, il y a une certaine musique qu’on appelle plus spécialement la musique romantique et qui se développe exactement à partir du premier tiers jusqu’à la fin du XIXe siècle. C’est cette musique-là dont nous suivons la naissance en ces premières années du siècle. Elle n’est pas encore bien nettement définie ; elle reste à bien des égards tout près du classicisme. Elle donne cependant des signes avant-coureurs d’une croissance ultérieure qui aboutira en France au phénomène extraordinairement curieux qu’est l’apparition de Berlioz, – Berlioz infiniment plus romantique à certains égards que Wagner, mais beaucoup moins au point de vue de la pure technique musicale, – Berlioz pénétré de littérature romantique mais n’exprimant ses inspirations que dans des formules classiques, ou peu s’en faut, et terminant son œuvre par un retour au classicisme presque pur, avec les Troyens.
Pour le moment, nous en sommes à considérer Méhul, qui ne marque qu’un premier pas sur la route du romantisme à la fois par sa fidélité aux idées de J.-J. Rousseau sur la nature et sur le sentiment et par son goût pour la couleur locale, Méhul qui subit ainsi grandement l’influence des idées et des états d’âme de la Révolution (eux-mêmes issus de l’action des philosophes du XVIIIe siècle), mais dont, techniquement, la musique reste encore toute proche de celle des classiques.
CHAPITRE III
MÉHUL, CHERUBINI, BOIELDIEU
Étienne-Nicolas Méhul naquit à Givet le 22 juin 1763. Il éprouva d’abord une sérieuse vocation religieuse, à laquelle il renonça faute de la santé suffisante. Vers 1778 ou 1779, on ne sait comment, il arrivait à Paris ne possédant « que ses seize ans, sa vielle et l’espérance ». Recommandé à Gluck, il le surprit au milieu des transports de l’inspiration, gesticulant, dansant, mimant des airs de ballet. Le grand musicien le reçut le plus aimablement du monde, et le fit assister à la répétition générale d’Iphigénie en Tauride. Souvenir qu’il conserva toute sa vie.
Méhul ne fut point l’élève de Gluck, mais en obtint de précieux conseils. Il travailla plus particulièrement avec un certain Edelmann qui lui apprit le rudiment de son art. Le 4 septembre 1790, il écrivait son premier opéra-comique : Euphrosine ou le Tyran corrigé. Terrible tyran qui à son caractère impérieux joignait un profond dédain de l’amour. La belle Euphrosine finit, après bien des traverses, par se faire aimer et elle épouse le farouche Coradin.
Euphrosine obtint un succès des plus vifs. Un certain « duo de la jalousie » excitait l’admiration de Grétry qui comparait Méhul au jeune Gluck, au Gluck de 33 ans. Plus tard, Berlioz n’hésitait pas à considérer Euphrosine comme le chef-d’œuvre de Méhul. Il en louait « la grâce, la finesse, l’éclat, le mouvement dramatique et des explosions de passion d’une violence et d’une vérité effrayantes ». Il ajoutait : « Le prodigieux duo : Gardez-vous de la jalousie est resté le plus terrible exemple de ce que peut l’art musical uni à l’action dramatique, pour exprimer la passion. Ce morceau étonnant est la digne paraphrase du discours d’Iago : « Gardez-vous de la jalousie, ce monstre aux yeux verts », dans l’Othello de Shakespeare ». S’il faut l’en croire, Berlioz n’aurait pu se retenir d’un « étrange scandale par un cri affreux » que lui fit jeter la conclusion du tragique duo. Ne laissons pas d’apporter quelque modération à de tels enthousiasmes. Nous savons de quels excès est capable dans ses démonstrations approbatives aussi bien que dans les autres, l’auteur de la Symphonie fantastique.
Il reste qu’Euphrosine est une fort belle partition. Le duo de la jalousie notamment est plein de mouvement et par des moyens très simples (un unisson des cordes au début, en ré mineur) atteint à un effet de sombre horreur.
À Euphrosine succéda un autre ouvrage de valeur, Stratonice, « comédie héroïque », représenté au théâtre Favart le 3 mai 1792 et fort bien accueilli, partition expressive mais composée sur un sujet un peu trop vague, un peu trop général peut-être pour inspirer profondément l’auteur. Il s’agit de Stratonice, jeune princesse grecque, qui va devenir l’épouse du roi de Syrie, Séleucus Nicator, en dépit de l’amour profond qui l’unit à Antiochus, fils du roi. Les deux amants sont résignés. Mais le prince Antiochus meurt littéralement d’amour pour Stratonice. Son père s’en aperçoit et se sacrifie pour lui. Les détails circonstanciés, individualisés, pittoresques, manquent malheureusement et la représentation doit être un peu traînante comme la musique qui ne se garde pas d’une certaine convention. Notons que le rôle d’un médecin, Érasistrate, qui intervient pour arranger les choses au profit d’Antiochus, renferme de bien jolies phrases dans la tessiture alors très à la mode du baryton Martin, avec des la naturels aigus très agréablement amenés.
Un autre opéra de Méhul, d’ailleurs moins remarquable, Mélidore et Phrosine, eut un sort assez curieux. Soumis à la censure, « il me fut rendu quelques jours après par le citoyen Baudrais », nous conte l’auteur. Il n’y avait trouvé rien que d’innocent. « Mais, ce n’est pas assez, ajouta-t-il, qu’il ne soit pas contre nous, il faut qu’il soit pour nous. L’esprit de votre opéra n’est pas républicain. Les mœurs de vos personnages ne sont pas républicaines. Le mot « liberté » n’y est pas prononcé une seule fois. Il faut mettre votre opéra en harmonie avec nos institutions. » Legouvé me tira d’embarras. À l’aide d’une douzaine de vers placés à propos, il amena dans mon drame le mot liberté assez souvent pour satisfaire aux exigences du citoyen Baudrais, et la représentation de Phrosine fut permise. » Mais on voulait davantage encore et l’on exigea sans doute de Méhul qu’il « payât une contribution patriotique en monnaie frappée au coin de la République », – ce qui nous valut un Horatius Coclès, enlevé en dix-sept jours et représenté à l’Opéra le 18 février 1794, – sans grand intérêt.
Le 9 décembre 1795, le Directoire nommait Méhul membre de la 3e classe de l’Institut (section de musique) et en même temps inspecteur des études au Conservatoire.
Le 1er mai 1797, le public sifflait le livret du Jeune Henry, mais applaudissait la musique et bissait l’ouverture (la Chasse du Roi Henry, avec sonneries de trompes imitatives), restée justement célèbre.
Il faut citer encore de Méhul Ariodant et l’Irato. L’Irato ou « l’Emporté » notamment témoigne d’une verve comique dont, jusque-là, on ne croyait pas Méhul capable. Il se sentait davantage porté vers les sujets dramatiques où la passion a sa part. L’Irato ne forme qu’un acte, mais charmant. Il est dû à la prédilection de Napoléon pour la musique italienne[2]. S’entretenant un jour avec Méhul, dont il estimait fort le talent : « Votre musique, lui dit-il, est peut-être plus savante et plus harmonieuse ; celle de Paisiello et de Cimarosa a pour moi plus de charmes. » Ce mot amena Méhul à imaginer une amusante mystification. Après avoir terminé la partition de l’Irato sur un livret de Marsollier, il fit annoncer, – on était en carnaval, – un opéra italien adapté à un poème français, dont la musique, était due al signor Fiorelli et qui devait être représenté au théâtre Favart le 17 février 1801. L’ouvrage fut fort applaudi, et encore davantage quand on nomma le véritable auteur. La partition était dédiée au premier Consul qui aurait dit à Méhul quand il la lui présenta : « Trompez-moi souvent ainsi. » Méhul y avait assez adroitement imité la manière italienne, mais sans trop y sacrifier de sa propre nature et de son style habituel. On l’accusa cependant d’entrer dans une voie nouvelle. Il fit, à ce sujet, une déclaration d’indépendance : « Je ne suis, écrivait-il, d’aucun parti, et ne veux m’enrégimenter dans aucun. Je ne connais en musique aucun genre ennemi de l’autre, si tous tendent en même temps à la rendre plus agréable et plus vraie. Je crois que cet art a un but plus noble que celui de chatouiller l’oreille et qu’il n’est pas condamné à n’être jamais qu’aimable. Le genre de la musique est toujours subordonné au genre du drame, et le choix des couleurs est commandé par le dessin qu’il faut colorier. Si la musique de l’Irato ne ressemble pas à celle que j’ai faite jusqu’à présent, c’est que l’Irato ne ressemble à aucun des ouvrages que j’ai traités. Je sais que le goût général semble se rapprocher de la musique purement gracieuse (entendez de la manière italienne), mais jamais le goût n’exigera que la vérité y soit sacrifiée aux grâces. » On sent dans ces lignes que, malgré tout, Méhul reste partisan de la musique française, de celle qui subordonne son développement et son expression aux termes de la poésie et qui se veut plutôt passionnée que seulement gracieuse et spirituelle.
Le 1er janvier 1804, trois musiciens, Gossec, Grétry et Méhul, étaient élevés au grade, alors si recherché, de chevalier de la Légion d’honneur.
En même temps, Bonaparte offrait à l’auteur du Chant du départ la place de maître de sa chapelle, devenue vacante par la démission de Paisiello qui retournait en Italie. Méhul se récusa. Il demanda que ces fonctions lui fussent attribuées conjointement avec son ami Cherubini. Mais vainement. Lesueur fut désigné seul. Toutefois pour le couronnement de Napoléon à Notre-Dame, le 2 décembre 1804, Méhul composa une Messe solennelle qui, d’ailleurs, n’y fut point exécutée.
À cette époque, on ossianisait considérablement à Paris et dans toute la France. Mme de Staël, Marie-Joseph Chénier, Baour-Lormian répandaient le culte des poésies d’Ossian, c’est-à-dire de ces vieilles légendes gaéliques ingénieusement présentées par l’Écossais Macpherson. Déjà, en 1804, Lesueur avait obtenu l’applaudissement du public et celui de l’Empereur avec son opéra Ossian ou les Bardes. Le 17 mai 1806, l’Opéra-Comique représentait un autre ouvrage ossianique, Uthal, celui-ci de Méhul, surtout remarquable par ses recherches de coloris instrumental. Notamment, les violons étaient supprimés de l’orchestre : des altos en tenaient la place.
Mais nous arrivons à l’œuvre capitale de Méhul, à celle qui doit nous arrêter quelque peu, à son Joseph.
En 1767, le Révérend Bitaubé, né à Kœnigsberg de réfugiés français et fixé à Paris depuis 1770, avait écrit un poème en prose assez médiocre sur l’histoire touchante de Joseph. Lorsque, sous l’Empire, la France recouvra la liberté religieuse, l’ouvrage du Révérend Bitaubé devint l’objet d’une faveur imprévue. Les théâtres s’emparèrent du sujet à la mode. Entre autres, Baour-Lormian fit représenter, en 1807, à la Comédie-Française un Omasis ou Joseph en Égypte, d’ailleurs sans succès. Dans des temps plus anciens, rappelons l’oratorio de Haendel (1745) et le Giuseppe riconosciuto de Métastase qui, de 1733 à 1748, fut mis trois fois en musique. Un bénédictin allemand avait aussi donné son Joseph. Mais celui de Méhul devait les surpasser tous[3].
Le hasard d’une conversation donna naissance au projet de cet ouvrage. Le librettiste Alexandre Duval causait avec Méhul : ils discutaient ensemble la valeur de la pièce de Baour-Lormian. Alexandre Duval prétendait que le sujet, « si intéressant dans la Bible, n’offrait que la reconnaissance des frères, et que tout ce que l’on pouvait se permettre, c’était de faire arriver Jacob en Égypte, et de le rendre témoin du pardon que Joseph accorde à ses frères ». Il blâmait Baour-Lormian d’avoir introduit dans son drame une intrigue amoureuse, à son goût tout à fait déplacée. Méhul approuvait ces réflexions si justes, mais n’en croyait pas moins le sujet de Joseph propre à faire la matière d’un opéra, et il engageait le poète à lui apporter en cette affaire sa précieuse collaboration. Duval y consentit, et, dans le besoin d’amener des « situations fortes et saisissantes », ne trouva « d’autre moyen d’y parvenir que de faire un réprouvé de Siméon et un aveugle de Jacob ». D’où certains contrastes et certaines méprises « dont l’invention rallia tous les suffrages des amis du librettiste ». En quinze jours, le poème était écrit. La musique ne demanda que deux mois de travail, au compositeur. Heureux temps où un chef-d’œuvre pouvait être improvisé aussi rapidement, chef-d’œuvre de simplicité certes, mais aussi de grandeur et d’émotion pénétrante !
La première représentation eut lieu le 17 février 1807 et s’acheva au milieu de l’enthousiasme général. Cependant, certaines maladresses du livret eurent vite fait de ralentir le succès initial, et après treize représentations Joseph quitta l’affiche. Repris en 1821, en 1826, en 1851, en 1862, la pièce rencontra toujours les mêmes difficultés à s’imposer. Les reprises ultérieures, de 1866 à 1882, réussirent mieux. En 1899, l’Opéra représenta Joseph avec le dialogue parlé remplacé par des récitatifs versifiés, par Armand Silvestre et mis en musique par Bourgault-Ducoudray. L’œuvre parut inopportunément alourdie, et ne se soutint pas dans cette nouvelle présentation[4]. Trois semaines plus tard, l’Opéra-Comique reprenait la version originale et l’a conservée à son répertoire, – au moins en principe, – car voici bien des années que nous ne la voyons plus paraître sur la scène. Faudra-t-il que nous rappelions l’admiration qu’avaient Weber et Richard Wagner pour notre Méhul et pour son Joseph et le souci que les Allemands ont toujours eu de maintenir au répertoire vivant de leurs théâtres un chef-d’œuvre incontestable ? Faudra-t-il que nous ayons toujours besoin de l’exemple de l’étranger pour honorer nos gloires nationales comme il convient ?
L’ouverture est d’une ligne simple et grande, presque nue.
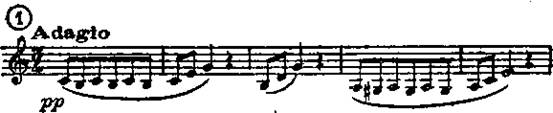
Elle se compose de trois parties : une sévère introduction, un chant choral, puis un Allegro passionné. Alors le rideau se lève sur le magnifique air de Joseph qui débute par un long récitatif : « Vainement, Pharaon, dans sa reconnaissance… », se continue par un délicieux Adagio d’une douceur nostalgique :

et se termine par un Allegro plein d’emportement : « Frères jaloux, troupe cruelle ! c’est vous dont la main criminelle, à son amour m’osa ravir », avec cet exquis mouvement d’affectueux pardon :

Déjà la fine sensibilité de Méhul se révèle. Elle s’affirme d’une autre manière, plus naïve, dans la fameuse Romance : « À peine au sortir de l’enfance. » Puis c’est la grande scène qui amène le final où tous les frères se rencontrent et qui donne lieu à un si bel ensemble.
L’« entr’acte » évoque l’idée d’une marche silencieuse à travers le désert. Le rideau se lève sur la scène vide et l’on entend, dans le lointain, la prière de Jacob « Dieu d’Israël » se perdant dans les espaces vides. Dans sa ligne si unie, ce chœur à l’unisson d’abord des voix de femmes, puis des voix d’hommes, enfin de toutes les voix réunies et harmonisées, donne l’impression de l’immensité, du calme, d’une Nature si propice à l’imagination du surnaturel et du mystérieux, en même temps que de l’union fervente des cœurs dans leurs croyances et de la force agissante qui résulte d’un tel lieu. Jamais effet si grandiose ne fut produit par des moyens si restreints. Nous atteignons là au sublime.
En contraste, la douce et tendre, la caressante Romance de Benjamin, puis un beau Trio entre Benjamin, Joseph et Jacob qui renferme la vibrante prière de Jacob :


avec l’éloquente insistance du vieillard à réclamer le bonheur pour ses enfants :

On reconnaît bien là ce langage si chaud et si parlant de la mélodie française dont la tradition se maintiendra, de Roland de Lassus et de Claude Le Jeune, par l’intermédiaire de Monsigny et de Grétry jusqu’à Gounod, Duparc et Bizet.
Le 3e acte s’ouvre par l’émouvant duo de Benjamin et de Jacob :

et il s’achève rapidement par une scène de réconciliation.
Dans la collection des opéras français, Joseph mérite une place de premier rang. Une œuvre de tendresse, de grandeur, de pureté qui, avec le Chant du départ, doit assurer la gloire immortelle de son auteur.
Méhul n’était âgé que de 53 ans, mais sa faible santé annonçait déjà qu’il ne vieillirait plus beaucoup.
De 1808 à 1810, il composa quatre symphonies dans la manière de Haydn avec une teinte plus douce, qui furent exécutées et fort applaudies aux concerts du Conservatoire.
Au théâtre, il fut moins heureux, et divers échecs lui furent assez amers. « Je suis meurtri, je suis écrasé, dégoûté, découragé, écrivait-il après l’un deux. Il faut du bonheur, le mien est usé. Je dois, je veux me retrancher dans mes goûts paisibles. Je veux vivre au milieu de mes fleurs, dans le silence de la retraite, loin du monde. » À Pantin, dans son « asile champêtre », il avait réuni une riche collection de tulipes.
Au début de 1817, les médecins conseillèrent à Méhul le séjour du Midi. Il se retire à Hyères. « Seul, au bout du monde », il ne se trouve pas bien. « Les jours où il arrive des voyageurs, le monsieur malade est oublié. » D’Hyères, il gagne Marseille, où l’on organise un festival en son honneur. Puis il revient à Pantin. Enfin, l’automne le ramène à Paris dans son logis de la rue Montholon, « occupé à tousser du matin au soir et souvent du soir au matin ». C’est là qu’il rendit le dernier soupir, le 18 octobre 1817, à 6 heures du matin.
Méhul tient de l’époque révolutionnaire quelque chose de sa simplicité et son cœur si sensible à toutes les émotions humaines, son cœur profondément affectueux. Il tient de Gluck quelque chose de son style, mais il l’a moins sévère, moins tendu, plus naïf. Par la couleur et par le sentiment, il prépare déjà le romantisme, et dans les premières œuvres de Franck nous trouvons un écho de celles de Méhul. Vincent d’Indy écrit à ce propos : « Les mélodies fraîches et ingénues [de Ruth] témoignent d’une évidente fréquentation avec les œuvres de Méhul. » Et, au sujet du duo de Ruth et de Booz, le même auteur parle « du dialogue très simple et assez apparenté avec les scènes entre Jacob et Benjamin du Joseph de Méhul ».
« J’aime la gloire avec fureur », écrivait Méhul en 1793. Qui aurait cru cette âme si tendre capable d’élans si furieux ? Le fait est que Méhul pouvait éprouver les plus fortes passions puisqu’il sut les exprimer si vivement. « Son âme, à la fois tendre et forte, a dit Arnault, était ouverte à toutes les passions et les combattait toutes, hors celle de la gloire. » Cessons d’oublier le grand homme qui fut l’auteur de Joseph et du Chant du départ et rendons-lui le tribut d’admiration qui lui est justement dû, et que nous négligeons un peu aujourd’hui de lui accorder, comme il l’a lui-même impérieusement réclamé.
*
Voici maintenant un musicien, qui ne vaut certes pas Méhul, mais qui mérite d’être appelé par Berlioz « un modèle sous tous les rapports », et par Beethoven (dans une lettre à L. Schlösser) « le meilleur compositeur de son temps ». Ce fut essentiellement le musicien officiel d’alors, un haut personnage très estimé de tous, chargé d’honneurs et des fonctions les plus délicates, solidement installé dans les situations les plus recherchées.
Né à Florence en 1760, il arrivait à Paris en 1788, au moment où l’opéra-bouffe ramené par Viotti s’y rétablissait sous le nom de Théâtre de Monsieur. Il écrivit pour la scène, pour l’Église, pour le concert, les œuvres les plus diverses dans un style très ferme qui réalisait une sorte de synthèse de l’art français et de l’art italien. Son art paraissait à ses contemporains un peu trop savant. On siffla son Anacréon (1803) : c’était, disait-on, de la « musique allemande ». On se plaignait « de n’avoir pas le temps de respirer et de jouir des airs ». Napoléon n’aimait pas Cherubini. Il préférait Paisiello et Zingarelli : « Vos accompagnements sont trop forts », disait-il à Cherubini. Napoléon avait une prédilection pour la musique italienne, la musique à l’italienne, avec ses légers flonflons « qui ne l’empêchent pas, disait Cherubini, de penser aux affaires de l’État ».
Les deux plus beaux succès de Cherubini au théâtre furent Lodoïska (1791) et le Porteur d’eau ou les Deux journées (1800).
En 1821, Cherubini devait être nommé, et pour de longues années, directeur du Conservatoire.
On considère, avec quelque étonnement, les éloges que les plus grands maîtres du temps, Haydn, Beethoven, Schumann (qui l’appelle « le magnifique »), Mendelssohn, Hans de Bülow, et plus tard, Hermann Kretzschmar, accordent à la musique de Cherubini. De la musique bien faite, c’est, à notre sens, tout ce qu’on en peut dire. De la musique de professeur de composition.
N’oublions pas que lorsque Beethoven écrivit à Cherubini pour lui demander son appui afin d’obtenir du roi de France une souscription à la Messe en ré, celui-ci ne répondit même pas. Voilà qui ne nous dispose pas à l’indulgence.
Combien je préfère à l’art appliqué de Cherubini, celui si libre de SPONTINI (1774-1851), de ce Spontini qui releva pour un moment le genre passé de mode de la tragédie musicale, de la tragédie gluckiste, en écrivant la Vestale (1807), œuvre très mélangée, au fond très italienne, dont le succès fut immense et qui renferme au moins une page mémorable, un air de soprano de toute beauté, que faisait valoir, il y a quelques années encore, la superbe voix de Mme Mary Mayrand !
Mais il ne va plus bientôt être question de tragédie musicale. Avec les Rossini, les Meyerbeer, les Halévy, les Auber, l’opéra historique allait lui succéder tandis qu’en Allemagne, Weber et Wagner préparaient l’avènement de l’opéra symphonique et romantique.
C’est bien la fin d’un genre, du genre de la tragédie musicale créée en Italie par les Florentins et Monteverdi, et réalisée sous sa forme la plus parfaite par le génie de Gluck.
*
Plus que l’opéra sérieux, que le « grand opéra », l’opéra-comique fut florissant sous la Révolution et sous l’Empire, et la tradition des Philidor, des Monsigny et des Grétry s’y continua glorieusement. Philidor mourut en 1795, mais Monsigny en 1817 seulement et Grétry en 1813. Ces deux derniers au moins purent donner à de plus jeunes leur vivant exemple. MARTINI faisait représenter, en 1800, Annette et Lubin. Martini, de son vrai nom Schwarzendorf, né à Freistadt, dans le Palatinat, l’auteur de la jolie romance Plaisir d’amour sur des paroles de Florian, restée populaire. DALAYRAC (1753-1809), donnait en 1799 Adolphe et Clara, en 1800, Maison à vendre.
Mais le plus fameux et le mieux doué de tous ces compositeurs de musique légère, c’est BOIELDIEU.
Il est né à Rouen, le 16 décembre 1775, et il devait y mourir le 8 octobre 1834. De son vivant, il posséda la gloire universelle. Il fut le rival de Rossini. Sa Dame blanche est un des gros succès du siècle.
Aujourd’hui, Boieldieu est bien oublié, ou du moins négligé. Dans mon enfance, autour de moi, je me le rappelle, on l’aimait encore. On le jouait au théâtre. Ma famille possédait toutes ses partitions qu’on feuilletait volontiers. Que de fois n’ai-je pas entendu fredonner les charmants airs du Nouveau Seigneur du Village, de la Fête au village voisin, de Ma Tante Aurore, des Voitures versées ! Et j’ai conservé une vive sympathie pour ces musiques un peu faciles, mais si mélodieuses, si spontanées, d’un attrait si ingénu, où tant de grâce s’allie à une sensibilité vraiment touchante. Il y a quelque chose du parfum de Mozart dans la mélodie de Boieldieu.
Vie heureuse, d’un bonheur rapide, aisé, trop tôt interrompu.
Tout enfant, Boieldieu fait partie de la maîtrise de la cathédrale. Il a pour maître le terrible M. Broche qui ne lui épargne pas les taloches. Maître dur, maître jovial aussi, ami de la bouteille et de la chanson. Un matin, nous conte Augé de Lassus, M. Broche s’oublie au cabaret du « Chaudron ». C’est jour de grande fête. Son orgue l’attend. Il n’arrive point. La cérémonie va commencer. Les souffleurs sont à leur poste. Toujours pas d’organiste. Le petit Boieldieu se risque, et, tout tremblant, pose ses mains sur le clavier. Il s’enhardit, suit l’office, improvise, et c’est un enchantement. Il a sauvé la partie. Son maître, survenant, l’embrasse à l’étouffer. Le bruit se répand dans la ville de son audace et de son triomphe : il a déjà une réputation.
Mais ce n’est pas à l’église et comme organiste qu’il compte faire sa carrière. Le Raoul Barbe-bleue de Sedaine et Grétry, au théâtre, l’a enthousiasmé. Lui aussi, il écrira pour la scène. Son père, indulgent, l’encourage, se fait son collaborateur : il lui fournit son premier livret. La Fille coupable, en 2 actes, représentée à Rouen le duodi de la 2e décade de brumaire an II, est acclamée. Et aussi, bientôt après, Rosalie et Mirza, signée encore une fois des deux noms du père et du fils.
Boieldieu atteint sa vingtième année. Il souffre de vivre dans cette province où ses parents le retiennent. Il ne songe qu’à Paris. Un beau jour, il s’enfuit. Il se blottit dans une charrette qui prend la route de la capitale. Mais le charretier le laisse en chemin. La nuit le surprend dans les champs. Un berger lui donne asile dans sa cabane. Après bien des difficultés, Boieldieu arrive au bout du voyage avec, pour tout bagage, un rouleau de musique et dix-huit francs dans sa poche. Mais, en franchissant la « barrière », il s’écrie : « Je serai quelque chose dans cette ville-là ! »
Les premiers moments sont pénibles, on le devine. Boieldieu en vient à se désespérer, quand un vieux serviteur de la famille envoyé à sa poursuite le rejoint, lui apportant une recommandation pour Mollien. Le voilà bientôt lancé. Il fréquente les Érard. Il compose des romances qu’il chante lui-même dans les salons. Il se fait peu à peu connaître. Pour gagner quelque argent, il accorde des pianos et donne des concerts. Le 5 septembre 1795, un premier succès de théâtre, la Dot de Suzette, suivi de plusieurs autres. Et, en 1800 (Boieldieu a 25 ans), le Calife de Bagdad, dont 700 représentations consécutives n’épuisent pas la fortune inespérée.
On vient de fonder le Conservatoire. Boieldieu compte parmi ses premiers professeurs. Il ne sait pas grand’chose. Qu’enseigner à ses élèves ? Il leur apprend la composition en chantant devant eux ses mélodies. Il est presque aussi jeune qu’eux et leur communique sa fièvre musicale. Ne le croyez pas négligent. Il s’applique. Il est sévère pour les autres et aussi pour lui-même. Ses manuscrits sont remplis de ratures, de « collettes ».
Tout en écrivant la délicieuse Tante Aurore (le quatuor initial est une merveille de légèreté, d’esprit, de vivacité), il s’éprend d’une femme du monde, bonne musicienne, charmante, un peu légère. Liaison romanesque qui dura peu et d’où naquit une fille que Boieldieu reconnut.
Après quoi, il se laisse épouser par Mlle Malfleury, danseuse à l’Opéra. Il s’aperçoit vite qu’il a fait une sottise et, pour éviter le désagrément d’une vie en commun que le divorce ne pouvait alors interrompre, il s’enfuit à l’autre bout de l’Europe, en Russie.
Son séjour à Saint-Pétersbourg sera de huit années. Il charme la cour et la ville par son joli bavardage musical, si parisien, si français. Il ne se soucie guère d’écouter les chants du peuple russe, ni de s’en inspirer, – ces chants dont Mme Vigée-Lebrun, venue elle aussi dans l’empire des tsars, disait quelques années plus tard : « La musique du peuple reste au peuple et cependant cette musique est d’une originalité un peu barbare, mais les chants en sont mélancoliques et mélodieux. »
Pendant que Boieldieu faisait représenter là-bas ses Voitures versées (avec leur fameux duo « Au clair de la lune »), l’empereur veut qu’on monte la Vestale de Spontini. Boieldieu déchiffre la partition. « Je n’y comprends rien, déclare-t-il. Mon chat n’écrirait pas de la musique comme cela. » Il s’effrayait de peu. Cependant, il s’amusait à composer de la musique pour les chœurs d’Athalie. Il employait aussi ses loisirs, un peu longs à son gré, à dessiner et à peindre, non sans talent. Il s’ennuyait fort en Russie. Il en revint comblé de splendides cadeaux, dont le moins précieux ne fut pas la montre que portait Napoléon à Austerlitz et qui lui fut donnée par Caulaincourt, duc de Vicence, ambassadeur à Saint-Pétersbourg.
Quelle joie de rentrer à Paris ! Il y trouve établi un rival dangereux, Nicolo, l’auteur des Rendez-vous bourgeois. Mais Boieldieu est incapable d’un mouvement de jalousie. D’ailleurs, qu’a-t-il à craindre ? Son Jean de Paris (1812), avec Martin et Elleviou dans les deux rôles principaux, va aux nues. On applaudit à tout rompre l’air du Sénéchal que Martin chante avec infiniment de gravité comique et d’esprit. L’année suivante, c’est cet exquis petit chef-d’œuvre : le Nouveau Seigneur du Village. Nicolo réplique par Joconde (1814), dont la romance « Dans un délire extrême, on veut fuir ce qu’on aime… Mais on revient toujours à ses premières amours », est sur toutes les lèvres. Mais voici la Fête du village voisin, dont, plus près de nous, le grand chanteur Faure « soupirait », paraît-il, délicieusement la ravissante cavatine : « Simple, innocente et joliette », d’une grâce et d’une tendresse pénétrantes.
En 1817, Méhul vient de mourir : Boieldieu se présente à l’Institut et l’emporte sur Nicolo.
Un nouveau rival arrive, d’une singulière importance : Rossini, et son Barbier de Séville. Loin d’en concevoir de l’aigreur, Boieldieu apporte la partition à sa classe, la joue devant ses élèves, s’extasie, s’exclame : « Ah ! mes enfants, ce n’est pas à celui-ci qu’on reprochera de manquer de mélodie ! »
Ce n’en est pas moins l’invasion de la musique étrangère qui commence et qui va continuer bientôt par celle de Meyerbeer et qui submergera presque la musique française.
Maintenant, Boieldieu a cinquante ans et déjà sa carrière est sur le point de s’achever. Son œuvre la plus populaire, la Dame blanche, est représentée pour la première fois le 10 décembre 1825. Le sujet – sujet tout à fait romantique – l’occupait depuis des années. Mais il n’en avait tiré que des esquisses. Or, voilà que Pixérécourt, directeur de l’Opéra-Comique, réclame immédiatement une nouvelle pièce pour son théâtre. En vingt-neuf jours, la partition est écrite, apprise, répétée et représentée. Tous les élèves de Boieldieu mettent la main à l’ouvrage pour les besognes subalternes sous la direction du maître.
Rossini et Boieldieu habitaient le même hôtel, l’un au premier, l’autre au deuxième étage. Après la « première » de la Dame blanche, Rossini félicitait Boieldieu : « Cette scène de la vente est un chef-d’œuvre. Je ne l’aurais certainement pas mieux traitée. Nous autres, Italiens, nous n’aurions su que dire et répéter : Felicità ! Felicità ! » – « Vous avez fait mieux, Maître, répondit modestement Boieldieu. Ce n’est qu’à l’instant où je monte me coucher que je suis au-dessus de vous. »
Les Rouennais réclamaient à leur tour la Dame blanche. Ils l’eurent le 9 février 1826, conduite par l’auteur. Ovations sur ovations. Pour finir, l’orchestre, dans un sentiment touchant, attaque le motif du chœur de Grétry, repris par tous les spectateurs : « Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille ? » La vieille cité de Rouen fêtait éperdument son enfant glorieux.
Mais ce n’est pas tout. L’orchestre au complet, violons, altos, violoncelles, contrebasses, flûtes, cors, clarinettes et bassons, vient sous les fenêtres de Boieldieu lui donner une aubade. Et cela n’en finit pas. Le tapage se prolonge fort avant dans la nuit. Un malencontreux commissaire de police intervient et verbalise. Le chef d’orchestre est, pour sa sérénade, condamné à 1 franc et 50 centimes d’amende, plus les frais.
Après la Dame blanche, plus rien, – plus rien qu’une pièce manquée, les Deux Nuits. Devenu veuf de sa danseuse, Boieldieu se remarie avec la sœur de la chanteuse Philis. Il est heureux, toujours. Il continue de professer au Conservatoire. Certains jours, en guise de leçon, il emmène sa classe se promener sur les boulevards, écouter quelque chansonnette ou s’amuser des pantomimes de Debureau. Ou bien toute la bande part pour Villeneuve-Saint-Georges, où Boieldieu possède une maison, et elle fait l’école buissonnière.
En 1832, une phtisie laryngée se déclare. Boieldieu ne compose plus du tout. Il n’a jamais pu composer qu’en chantant. Avec la voix, il perd l’inspiration.
Il s’éteint le 8 octobre 1834, dans sa propriété de Jouy.
On lui fait de pompeuses funérailles à la chapelle des Invalides.
La musique qui les accompagne est celle de Cherubini pour les obsèques de Louis XVIII. Le « petit Boiel » se trouvait un peu écrasé sous ce faste.
Le lieu de sa dernière demeure lui convient mieux : il repose dans un coin du Père-Lachaise, au milieu de ses confrères et de ses interprètes Bellini, Lesueur, Garat, Tamberlick, Hérold, Grétry, Panseron, Ponchard, Nicolo, Dugazon, Mme Gavaudan, tout le brillant théâtre musical de son temps.
Un des plus jolis musiciens que la France ait jamais produits, un de ceux dont les ouvrages approchent le plus de la perfection.
Est-elle de Boieldieu ou de Mozart, cette phrase au contour si pur, au charme si prenant ?

CHAPITRE IV
1828
LA MUETTE DE PORTICI
LES HUIT SCÈNES DE FAUST
L’année 1828 vit paraître deux œuvres remarquables, à des titres bien différents, la Muette de Portici d’Auber et les Huit scènes de Faust de Berlioz, deux œuvres qui, chacune dans son domaine, furent le commencement d’une suite très importante.
*
La Muette de Portici ouvre la voie à l’opéra historique.
Au XVIIe et au XVIIIe siècle, l’opéra s’était développé sous la forme d’une tragédie mythologique de grand apparat. Mais on en avait épuisé la matière. D’innombrables sujets avaient été traités et plusieurs fois traités. Le public se lassait de ses perpétuels emprunts aux fables antiques. Et puis la Révolution, en consacrant le triomphe de la bourgeoisie, amenait au théâtre des auditeurs peut-être un peu moins familiers avec les aventures des dieux, des déesses et des demi-dieux, avec leurs amours, leurs rivalités, leurs combats et leurs incursions dans les affaires humaines. Il fallait du nouveau. Il fallait redescendre de l’Olympe sur la terre et traiter uniquement de ces affaires humaines, mais sans tomber dans un vulgaire réalisme. Les spectacles de l’Opéra avaient toujours été somptueux, donnant lieu à des décorations splendides, à de riches cortèges, à des défilés, à des danses. Il fallait conserver à ces spectacles tout leur luxe traditionnel. Les grands sujets historiques offraient ce double avantage de fournir une matière plus proche de nous et de donner cependant lieu à un déploiement de mise en scène aussi brillant que celui de l’opéra mythologique, quoique d’un genre différent.
Quelques essais avaient déjà été tentés dans ce nouvel ordre d’idées. Mais le premier ouvrage qui atteignit pleinement le but souhaité et donna toute satisfaction au public, ce fut la Muette de Portici d’Auber.
*
AUBER est né à Caen le 29 janvier 1782, simple incident de route d’un voyage d’agrément qu’effectuaient ses parents. Le lendemain, le nouveau-né était baptisé à l’église Saint-Julien et recevait les prénoms de Daniel-François-Esprit, – Esprit le bien nommé.
Auber appartenait à une famille aisée. Son père, officier des chasses royales, demeurait à Paris, faubourg Saint-Denis, dans les bâtiments des « petites Écuries du Roi ». Ce père transmit à son fils son goût pour l’équitation et sa passion pour la musique.
La Révolution fit perdre sa situation à ce Jean-Baptiste-Daniel Auber qui avait quatre enfants à élever : trois fils et une fille. L’officier des chasses royales se fit éditeur d’estampes et réussit fort bien dans ses affaires. Il eut un salon fréquenté par toutes sortes d’artistes et put assurer au jeune Daniel une brillante éducation. À seize ans, celui-ci jouait remarquablement du piano et du violon et il chantait. Le célèbre baryton Martin, ami de la maison, lui avait donné des conseils. Il avait écrit déjà quelques mélodies. En 1799, le « petit Auber », comme on disait, compose deux quatuors à cordes. Il publie, en 1800, une « première Sonata » pour piano en ut.
Cependant, son père voulait qu’il reprît un jour la maison d’estampes. Et, pour l’initier aux affaires, il l’envoya faire un voyage en Angleterre. Ce fut la seule absence un peu longue que, dans toute sa vie, Auber, parisien dans l’âme, s’accorda hors de la capitale de France. Il resta seize mois à Londres. Sans doute les habitudes du peuple britannique lui plaisaient particulièrement. Car il en acquit les qualités extérieures et intimes qui le distinguent, le cant, la respectability, le soin de cacher tout ce qu’il est inutile de montrer, la discipline du corps et de l’esprit qui fait proportionner exactement l’effort au but à atteindre. Auber devint un véritable gentleman et le resta tout le long de sa longue existence. Une pointe de galanterie et de malice, qui lui était personnelle, achevait de le caractériser.
Jusque-là, Auber n’écrivait de la musique que par distraction. Il en écrivait même pour ses amis et qui paraissait sous leur nom, notamment trois concertos de violoncelle signés Lamara, qui doivent être restitués à Auber.
Une société d’amateurs lui demanda un jour une pièce de théâtre et il composa un petit acte (1805), l’Erreur d’un moment, dont Charles Malherbe retrouva naguère le manuscrit.
En 1806, un concerto pour violon en ré, joué par Mazas dans un exercice des élèves du Conservatoire, lui vaut un succès flatteur.
Il entrait dans sa vingt-cinquième année et il composait toujours. Son père se décida à consulter un artiste sur la valeur de ses dons. Cherubini répondit : « Votre fils ne manque pas d’imagination ; mais il lui faudrait commencer par oublier tout ce qu’il sait, en supposant qu’il sache quelque chose. » Il s’offrait d’ailleurs à devenir le professeur du débutant. Pendant trois ans, assis l’un en face de l’autre à une même petite table, Auber et Cherubini travaillèrent ensemble le contrepoint et la fugue. Auprès d’un tel maître, Auber apprit tout ce qu’on pouvait alors savoir de l’art musical. Il lui dut aussi de précieuses relations, notamment celle du comte de Caraman, futur prince de Chimay, mari de la fameuse Mme Tallien, grand amateur d’art et grand mécène. Auber ne tarda pas à devenir l’enfant gâté de la maison et le pourvoyeur attitré de ses divertissements.
Le Séjour militaire, pièce en 1 acte de Bouilly, fut le début d’Auber au théâtre Feydeau (27 février 1813). Début encourageant. Et cependant, Auber reste six ans et demi sans aborder de nouveau la scène. À quelqu’un qui lui demandait ce qu’il avait fait durant ce long silence : « J’ai fait, répondit-il, des visites aux auteurs en crédit, et même à ceux qui ne l’étaient point, toujours mieux accueilli des premiers que des seconds. »
Le 18 septembre 1819 parut le Testament et les Billets doux. Puis vinrent la Bergère châtelaine, Emma ou la Promesse imprudente.
À ce moment arrive à Paris Rossini, dont le prestige exerce sur la jeunesse musicale une incroyable séduction. Auber est présenté au maître par Carafa dans une soirée au cours de laquelle l’auteur du Barbier chante lui-même la cavatine de Figaro : Largo al fattotum della cità. « Je n’oublierai jamais, contait plus tard Auber, l’effet produit par cette exécution foudroyante. Rossini avait une fort belle voix de baryton, et il chantait sa musique avec un esprit et une verve dont n’approchèrent, dans ce rôle, ni Pellegrini, ni Galli, ni Lablache. Quant à son art d’accompagner, il était merveilleux : Ce n’était point sur un clavier, mais sur un orchestre que semblaient galoper les mains vertigineuses du pianiste. Quand il eut fini, je regardai machinalement les touches d’ivoire, il me semblait les voir fumer ! En entrant chez moi, j’avais grande envie de jeter mes partitions au feu : « Cela les réchauffera peut-être », me disais-je avec découragement. Et puis, à quoi bon faire de la musique, quand on n’en sait pas faire comme Rossini ? »
L’exemple du Maître lui fut très utile. Il assouplit son style. Sans rien perdre du fruit de l’enseignement sévère de Cherubini, Auber acquit alors infiniment plus de souplesse, de liberté, de fantaisie.
Autre rencontre utile et qui porta indéfiniment ses fruits : celle de Scribe. Les deux hommes de théâtre se virent, se connurent, se jugèrent indispensables l’un à l’autre et de cette première impression résulte une collaboration de quarante années que seule la mort put interrompre.
Voici quelle était la méthode de travail des deux amis. On établissait de concert le plan de l’ouvrage. Auber cherchait alors ses principaux motifs et Scribe se chargeait enfin de trouver les paroles qui devaient le mieux s’y adapter. La poésie, on le voit, n’était ici que la très humble servante de la musique.
La raison sociale Auber-Scribe eut bien vite acquis la meilleure réputation sur le marché musico-littéraire et les deux associés firent fortune.
Auber a écrit quarante-huit pièces pour le théâtre. C’est un chiffre. Il n’est pas question de les analyser toutes, ni même de les énumérer.
Arrêtons-nous seulement à quelques titres et à quelques œuvres.
*
D’abord la Muette de Portici, opéra en 5 actes, paroles de Scribe et Germain Delavigne, représenté dans la salle de la rue Le Peletier, le 29 février 1828 avec A. Nourrit dans le rôle de Masaniello et Mme Damoreau-Cinti dans celui d’Elvire. Le premier grand succès de l’opéra historique. Le sujet est emprunté à l’histoire de la Révolution de Naples (1647) provoquée par un pêcheur. De 1828 à 1882, la Muette a donné lieu à 505 représentations. Richard Wagner en admirait la belle construction, l’abondance mélodique, les ensembles puissants et le mouvement général. Ce fut un des modèles dont il s’inspira quand il écrivit Rienzi. L’ouverture est longtemps restée célèbre, ainsi que la barcarolle du 2e acte : « Amis, la matinée est belle », le duo « Amour sacré de la patrie », la pièce du 3e acte, l’air du Sarranil au 4e acte ; et la Barcarolle du 5e. Musique souvent trop facile, mais d’une allure entraînante et qui ne manque pas son effet sur les foules. Sait-on que la Muette de Portici fut le point de départ de la Révolution qui, en 1830, fonda l’indépendance de la Belgique en la séparant de la Hollande ? Un soir, en effet, à Bruxelles, le duo : Amour sacré de la patrie obtint un succès d’enthousiasme particulièrement vibrant. Les spectateurs sortirent du théâtre frémissants d’une véritable fièvre patriotique : ils se rendirent aux bureaux du journal le National, puis au palais de justice pour manifester violemment leurs sentiments. Le feu était mis aux poudres. La Révolution éclata.
Dans le succès initial de la Muette, les excellents interprètes eurent leur part, surtout Adolphe Nourrit et Mme Damoreau-Cinti. Le nom de Nourrit est resté fameux dans l’histoire de l’Opéra. Ce fut un chanteur tout à fait extraordinaire dont j’ai eu le privilège d’entendre parler dans ma famille par un témoin de ses succès. Mon père n’était plus jeune quand ma mère me donna le jour. Il était violoniste et avait eu pour professeur au Conservatoire le célèbre Habeneck qui l’avait pris, encore adolescent, dans son orchestre de l’Opéra. Mon père faillit même épouser la fille d’Habeneck : c’était du moins le vœu du père et, je crois, de la fille. Mais la pauvre enfant était fort laide et mon père était fort bel homme. Grand, bien fait, élégant, une jolie barbe blonde. Tous les auditeurs des concerts réputés du lycée Louis-le-Grand qu’il dirigeait après 1870, gardaient le souvenir de sa belle prestance et de sa distinction. Bref, le mariage souhaité par les Habeneck ne se fit pas. Mais les relations restèrent cordiales entre la famille de mon père et celle de Mlle Habeneck.
À l’Opéra où il tenait une partie de violon, mon père eut souvent l’occasion d’entendre Nourrit.
Nourrit était né à Paris en 1802. Il avait étudié le chant avec Garcia. Il débutait à Paris en 1821 dans le rôle de Pylade de l’Iphigénie en Tauride de Gluck. Il créa Masaniello dans la Muette de Portici d’Auber, Robert dans Robert le diable de Meyerbeer, Raoul dans les Huguenots de Meyerbeer, Arnold dans Guillaume Tell de Rossini, Eléazar dans la Juive d’Halévy. En 1837, il quittait l’Opéra de Paris. Il se donna la mort à Naples après une représentation de la Norma (1839). La légende veut que ce soit de dépit d’avoir été supplanté à Paris par Duprez. Le fait est qu’avec Duprez commence une nouvelle école de chant. Jusque-là les ténors ne donnaient leurs notes élevées qu’en voix de tête. Duprez inaugura l’ut de poitrine et l’on perdit l’habitude de chanter en voix de tête. Il nous est difficile de nous figurer l’impression que pouvait produire le rôle d’Arnold dans Guillaume Tell par exemple, chanté de cette façon. Il nous semble que tous les effets de puissance dans l’aigu devaient être manqués. Mon père justement prétendait qu’il n’en était rien. Il disait que Nourrit avait un médium de baryton et que la voix de tête qui faisait suite à ce beau médium le continuait sans décevoir par un subit amincissement de volume. C’était une voix de tête considérablement renforcée et qui dominait les ensembles de façon surprenante. Et puis, quel artiste que ce Nourrit ! Infiniment plus fin interprète que Duprez ! d’ailleurs admirablement doué sous tous les rapports. Littérairement cultivé, c’est lui qui composa les paroles de l’air de la Juive : « Rachel, quand du Seigneur la grâce tutélaire. » – « Nourrit, conte Halévy, nous donna d’excellents conseils. Il y avait au 4e acte un Finale : il nous demanda de le remplacer par un air. Je fis la musique de l’air sur la situation donnée. Nourrit demanda à M. Scribe de faire lui-même les paroles dont la musique était prête. Il voulait choisir les syllabes les plus sonores et les plus favorables à sa voix. M. Scribe, généreux parce qu’il est riche, se prêta de bonne grâce au désir du chanteur, et Nourrit nous apporta, peu de jours après, les paroles de l’air : « Rachel, quand du Seigneur… » Mais quelle singulière façon de concevoir la composition d’un opéra. »
Nourrit était aussi bien capable d’écrire avec talent de la musique. Il est l’auteur de plusieurs ballets qui furent donnés par la Taglioni et par Fanny Elssler : la Sylphide, la Tempête, le Diable boiteux, l’Île des Pirates, etc.
Je crois bien que pour l’ensemble de ses dons et pour la façon dont il les avait cultivés, mon père admirait beaucoup plus Nourrit que Duprez…
Quoi qu’il en soit, son triomphe dans la Muette de Portici fut complet. Et ce fut en même temps la première grande victoire d’Auber sur une scène lyrique.
Parmi ses autres ouvrages, citons au moins Fra diavolo (1830), le Philtre (1831), le Domino noir (1837), les Diamants de la Couronne (1841), Haydée (1847), tous du genre léger dans lequel excella leur auteur et dont la réputation s’est conservée jusqu’à nos jours, les plus remarquables chefs-d’œuvre de l’opéra-comique après Boieldieu.
Sans en avoir l’air, Auber fut un grand travailleur. Sans en avoir l’air, car il se mêlait joyeusement à l’agitation de la vie mondaine, montait à cheval, assistait aux courses, faisait des visites, figurait dans les fêtes officielles, allait au théâtre ou en soirée, rentrait chez lui pour souper à l’heure où les autres dorment et l’on se demandait à quel moment de la journée, il trouvait le temps de s’asseoir devant sa table ou devant son piano. Son secret c’est qu’il n’avait pas de sommeil. Il se couchait tard et se levait tôt et il se rattrapait le jour ou le soir dans quelque fauteuil, s’endormant où il voulait et comme il voulait quelques instants qui lui valaient un long repos. Il donnait ses audiences le matin chez lui à 6 heures. Il avait trouvé ce moyen d’éloigner les fâcheux. Ne comptant point avec son sommeil, il ne respectait pas celui des autres. Il lui arrivait de réveiller au beau milieu de la nuit Mme Damoreau-Cinti pour lui faire déchiffrer un air qu’il venait de composer. Voilà, par parenthèse, qui contredit la thèse de Fétis selon lequel Auber « professait pour son art et sa production une profonde indifférence ». – « Il avouait, déclare Fétis, il avouait à ses amis qu’il n’aimait pas l’art auquel il doit tout et que la raison seule triomphe de ses dégoûts lorsqu’il écrit. » – Cette prétendue indifférence, c’était encore une façon d’écarter les curieux et les indiscrets. On lui prête cette boutade : « J’ai aimé la musique jusqu’à 30 ans, – une véritable passion de jeune homme ! je l’ai aimée tant qu’elle a été ma maîtresse, mais depuis qu’elle est devenue ma femme… » Et puis il résistait mal au plaisir de faire un mot d’esprit. On cite encore cette parole qu’il opposa à Wagner, venant l’interroger sur ses goûts et ses intentions en musique : « Je n’aime que les femmes, les chevaux, les boulevards et le bois de Boulogne ! » Simple façon d’arrêter cet enragé bavard qu’était Wagner et ses interminables dissertations. Weckerlin qui assista Auber dans ses derniers moments, recueillit sur ces lèvres ces mots : « Musique !… Ah ! la musique…, que deviendra-t-elle ! »
Auber n’assistait jamais à l’exécution publique de ses œuvres. La pièce une fois répétée généralement, il l’avait vue pour la dernière fois et ne remettait plus les pieds au théâtre, les soirs où on la donnait.
Un original.
Élégant, petit mais de taille bien prise, le visage rasé, de courts favoris, des yeux noirs profondément enfoncés sous l’arcade sourcilière, d’une mise correcte et même recherchée, il était fait pour plaire et il plaisait. Il parlait peu mais avait la répartie vive. Au Bois, il aimait faire quotidiennement sa promenade à cheval. Quand il vieillit, la voiture remplaça le cheval. Il emmenait alors volontiers des dames qu’il plaçait dans le fond de la calèche, se réservant le siège de devant. Le soir venu, il endossait l’habit et se rendait à l’Opéra surtout quand on y dansait un ballet, ou à la Comédie-Française ou dans quelque petit théâtre du Boulevard. Après le spectacle, il regagnait son petit hôtel de la rue Saint-Georges, souvent appuyé au bras de quelque amie fidèle. Deux domestiques, qui vieillirent avec lui l’attendaient et avaient préparé le souper traditionnel.
Il travaillait un peu partout, à la promenade, en soirée, au théâtre, au milieu d’une conversation, toutes les fois qu’il paraissait un peu distrait ou somnolent. C’est qu’un « motif » s’esquissait, se cherchait, s’essayait dans sa tête en attendant qu’il en vérifiât la qualité en le tapant sur une vieille épinette reléguée au deuxième étage de son hôtel. Dès six heures du matin, il écrivait. À midi, sa journée était finie, à l’heure où d’autres la commencent.
En 1829, Auber succédait à Gossec à l’Institut.
En 1839, il était nommé directeur des concerts de la Cour.
En 1842, il prenait la direction du Conservatoire de musique, en remplacement de Cherubini, démissionnaire.
En 1852, il était chargé de la direction de la Chapelle impériale.
À 89 ans, Auber avouait à des amis : « Il ne faut d’exagération en rien : j’ai trop vécu. » Et pourtant, on pouvait dire, avec le vicomte Henri Delaborde, sans trop forcer les choses que « sa vieillesse même n’était à bien des égards qu’une jeunesse exceptionnellement prolongée ou tout au moins une riante arrière-saison à laquelle les roses d’Anacréon ne manquaient pas plus que les grâces et la fertilité poétiques ». Il continuait de donner audience à 6 heures du matin, de venir au Conservatoire après déjeuner, de se rendre en voiture au bois de Boulogne l’après-midi et d’aller au théâtre le soir.
L’année 1870 lui fut affreusement pénible. « Le siège de Paris lui porta un véritable coup. » Au mois de mai 1871, il prit le lit et ne le quitta plus. Il mourut le 12 mai.
Un gentil musicien qui s’est élevé, au moins une fois, à la grandeur.
*
La Muette de Portici, l’opéra historique, voilà déjà, d’une certaine façon, du romantisme. Les romantiques ont toujours cherché dans l’histoire un prétexte à couleur locale. C’est aussi du romantisme que l’exaltation du sentiment, l’enthousiasme populaire qui règnent dans de tels ouvrages. Mais la forme reste encore toute proche de la forme classique.
La même année que la Muette paraît une manifestation autrement caractéristique d’un nouvel idéal : les Huit Scènes de Faust de Berlioz. Étudions-la.
*
Le grand ouvrage en trois volumes d’Adolphe Boschot qu’il a consacré à la vie et à l’œuvre de Berlioz et qui est lui-même un chef-d’œuvre de patience, de perspicacité, d’intuition historique et poétique, débute par une description du pays où est né le musicien. J’en détache quelques lignes :
« Ici, au pays de Berlioz, tout est net… Tout est précis, tout est écrit, en quelque sorte. Cette infinité de détails juxtaposés, étalés, calligraphiés sur le coteau comme dans le paysage d’un primitif flamand, a vraiment quelque chose de narratif… D’ordonnance, d’eurythmie, de musique de lignes, il n’y en a pas. C’est un immense panorama où toutes les touches sont jolies. »
Décrire ainsi le pays de Berlioz, c’est déjà définir par avance sa musique. C’est déjà indiquer qu’un certain caractère du romantisme lui manquera : le vague, l’indécis, le mystère. Musique au dessin morcelé mais très arrêté. Les nuages enveloppants de Wagner, ou même ceux plus légers et plus transparents de Debussy lui feront défaut.
Mais elle a l’éclat des couleurs, la fureur des passions déchaînées, tous les traits brillants, étincelants, les éclairs d’une invention orageuse. Elle se moque de la ligne et du style, juxtapose dans un désordre inspiré les touches les plus vives. Le plus étonnant, c’est que de cette multiplicité d’impressions diverses se dégage paradoxalement le sentiment profond d’une certaine unité d’ailleurs indéfinissable.
*
Louis-Hector Berlioz est né, à la Côte Saint-André, dans l’Isère, le 11 décembre 1803. Comme il arrive parfois aux plus beaux génies musicaux, la musique n’est pas chez lui, un héritage familial. Ses parents ne sont pas musiciens. Autour de lui, en dehors des siens, pas de musique non plus. Dans la Côte Saint-André, pas un seul piano. Et cependant à 12 ans, Berlioz composait déjà des romances et des quintettes dont il utilisera les thèmes dans l’ouverture des Francs-Juges et dans la Symphonie fantastique. Sa famille s’oppose à sa vocation de musicien. On veut qu’il soit médecin et, à cet effet, il vient à Paris pour faire ses études. Mais il va au théâtre, il s’enthousiasme pour Gluck. La musique est la plus forte. Il entre en relations avec le compositeur Lesueur, se fait recevoir élève au Conservatoire, écrit les Francs-Juges (1827) et en 1828, les Huit Scènes de Faust, qui deviendront les pages les plus caractéristiques de la Damnation.
Berlioz avait déjà publié ses Romances. Mais les Huit Scènes de Faust portent l’indication op. 1.
Le 3 mars 1829, il écrivait au vicomte Sosthène de la Rochefoucault, surintendant des Beaux-Arts :
« Monsieur le Vicomte,
« Je publie en ce moment la partition des Huit Scènes de Faust de Gœthe, dont j’ai composé la musique : c’est le premier ouvrage que je livre à l’impression (voir plus haut). Veuillez, Monsieur le Vicomte, me faire l’honneur d’en accepter la dédicace.
« Je vous dois beaucoup et je serai bien heureux si vous daignez, etc.
« J’ai l’honneur, etc.
Hector Berlioz. »
Rue Richelieu, n° 96.
En réalité, si ces Huit Scènes sont dédiées au vicomte de la Rochefoucauld, elles ont été écrites (Berlioz en confie le secret à son ami Ferrand), F. H. S., c’est-à-dire for Harriett Smithson. Pour Harriett Smithson, pour cette actrice anglaise qui joue la Juliette de Shakespeare, et dont il s’est épris si ardemment d’une ardeur véritablement « volcanique ». Pour cette Harriett Smithson qui lui inspirera bientôt la Symphonie fantastique (1830).
Les Huit Scènes se présentent sous l’aspect d’une grande partition pour soli, chœur et orchestre. Elles comprennent : 1° Le Chant de la Fête de Pâques, introduit par une citation de Gœthe : « Voici, une liqueur que je dois boire pieusement ; je l’ai préparée, je l’ai choisie ; elle sera ma boisson dernière… – Christ vient de ressusciter. » Chœur d’anges. Un « chœur de disciples » lui répond. – Un détail qui montre quelle importance Berlioz donne tout de suite à l’instrumentation : nous lisons ce nota bene : « En France, on se sert des contrebasses à trois cordes. J’ai écrit ce fa grave néanmoins, parce qu’il est probable qu’on en viendra enfin à mettre en usage les contrebasses à quatre cordes comme on l’a fait depuis longtemps dans plusieurs villes d’Allemagne. »
Viennent ensuite : 2° Les Paysans sous les Tilleuls, précédés de cette citation : « Monsieur le Docteur, ils hurlent comme des possédés, et ils appellent cela de la joie et de la danse. » 3° Le Concert des Sylphes ; 4° La Chanson du rat, sous le titre d’Écot du joyeux compagnon ; 5° La Chanson de la Puce ; 6° Le Roi de Thulé ; 7° La Romance de Marguerite ; 8° La Sérénade de Méphistophélès, accompagnée d’une seule guitare.
« Pour le clairvoyant, pour le volcanique Hector, dit Adolphe Boschot, ces Huit Scènes, que ne contiennent-elles pas ? Lui, l’auteur, il y voit tout son Faust : il y revit toutes ses émotions à propos de Shakespeare, de Thomas Moore, de Walter Scott et d’Ophélia. Il retrouve quelque chose de ses rêves et de ses souffrances, de ses tempêtes amoureuses, jusque dans les épigraphes en sautoir qui bigarrent fantasquement le haut des pages. Cette musique, sa musique, comme elle doit être évocatrice pour lui-même ! « Je me consacre au tumulte, aux jouissances les plus douloureuses, à l’amour qui sent la haine, à la paix qui sent le désespoir !… » Est-ce là une épigraphe pour se mettre à la mode du jour, ou plutôt n’est-ce pas un aveu, un aveu sincère ? »
Dans ces Huit Scènes ne cherchons pas surtout Faust, ni Gœthe, cherchons surtout Berlioz. Nous l’y trouverons tout entier avec ses enthousiasmes, ses révoltes, ses délires d’amour, ses fureurs et ses désespoirs, tout cela de tête, d’imagination, de nerfs plus que de cœur, – au moins dans la plupart des cas.
Prenons pour exemple, la fameuse Chanson du roi de Thulé, un des chefs-d’œuvre de la partition. Elle est gothique à souhait. Elle ne nous émeut pas, mais nous donne une impression saisissante de couleur moyenâgeuse. Et par quel procédé ? Berlioz aurait pu user ici des vieux modes. Il n’en fait rien. Tout au contraire, il emploie un moyen fort moderne : le chromatisme. Le thème débute en effet ainsi :

Le si bécarre et le ré bémol nous feraient penser à une gamme ainsi construite :

où deux demi-tons se trouvent placés côte à côte. Cette gamme n’appartient pas au moyen âge. Mais elle est fort étrange et cela suffit à nous transporter dans un lointain imaginaire de temps et de pays indéterminés.
Il y a deux façons d’évoquer le passé : en copiant l’histoire ou en créant la légende. Il y a certainement plus de puissance dans le second procédé, et il est aussi plus personnel. C’est celui que préfère Berlioz.
Très habilement encore, Berlioz coupe la phrase de courts repos entre ses membres, imitant l’habitude des gens du peuple quand ils chantent de prendre librement leur respiration sans souci d’une rigoureuse mesure, toutes les fois qu’un arrêt relatif se produit dans le mouvement de la mélodie.
Enfin, tandis que les trois premiers membres de la phrase sont régulièrement formés de quatre mesures, les derniers se composent de l’assemblage imprévu de deux groupes de trois mesures, rompant ainsi la carrure et allongeant la période comme pour mieux attester la libre spontanéité de l’inspiration populaire.
Voilà du romantisme à la Berlioz, d’excellente venue.
Quel contraste avec la Romance de Marguerite, celle-ci sans aucun effet de couleur, toute en sentiment, si profondément émue et si émouvante !

Piètres paroles ! Mais quelle magnifique inspiration musicale ! Pour une fois, – car le cas n’est pas fréquent chez lui, – le cœur de Berlioz a parlé et le langage le plus prenant. Souveraine beauté de ligne en même temps que d’expression.
Le Concert des Sylphes, la Chanson du Rat, la Chanson de la Puce, la Sérénade de Méphistophélès compteront parmi les pages les plus originales et en même temps les plus heureuses de la Damnation. Quelle instrumentation merveilleuse dans toutes ces pages produisant un coloris romantique tout à fait extraordinaire !
Cet effet suprêmement original n’est pas dû qu’à l’instrumentation. La mélodie, par son dessin, y a sa part. Considérez seulement le thème de la Sérénade :

« Génie monodique, » a dit, peut-être avec quelque exagération, Jean Marnold, frappé de l’indigence du don harmonique chez Berlioz.
Toujours est-il qu’on ne soulignera jamais assez l’originalité de la mélodie dans la musique de Berlioz, l’imprévu de son contour et sa résistance essentielle bien souvent à l’harmonisation.
*
Ces Huit Scènes qu’en penserait l’auteur de Faust, Gœthe lui-même. Berlioz voulut le savoir. Il lui écrivit donc : « Monseigneur, – il avait d’abord écrit Monsieur, mais crut bon de montrer plus de déférence à un ancien ministre : il savait que les plus grands esprits restent accessibles à la flatterie, – Monseigneur, depuis quelques années, Faust est devenu ma lecture habituelle ;… des idées musicales se sont groupées dans ma tête autour de vos idées poétiques ;… la séduction a été si forte, le charme si violent, que la musique de plusieurs scènes s’est trouvée faite à mon insu… J’espère que vous pardonnerez à un jeune compositeur qui, le cœur gonflé et l’imagination enflammée par votre génie, n’a pu retenir un cri d’admiration. »
Gœthe avait alors quatre-vingts ans. La lettre, très adroite, fort bien écrite, le toucha. Du moins, Eckermann constata que la partition de Berlioz retint un bon moment l’attention de Gœthe. Il la lut ou essaya de la lire. Puis, incapable sans doute d’entendre ce que voyaient ses yeux, il envoya un des deux exemplaires reçus à son ami Zelter. Zelter ne répondit pas tout de suite. Alors, Gœthe insista : « Apaise à ta manière, lui écrivait-il, la curiosité que me donne la vue de ces figures de notes, elles paraissent si étranges et si merveilleuses… »
Zelter répondit (21 juin 1829) : « Certaines gens ne peuvent indiquer leur présence et marquer leur participation en toute circonstance que par des expectorations bruyantes, des éternuements, des croassements, des vomissements : M. Hector Berlioz paraît être de ces gens-là. L’odeur de soufre, qui se dégage autour de Méphisto, l’attire, le fait éternuer et souffler de telle sorte que tous les instruments s’agitent et font rage dans l’orchestre. – De Faust, aucun cheveu ne bouge. – Au surplus, merci pour l’envoi : l’occasion se trouvera bien d’utiliser un jour ou l’autre dans quelque leçon, cette excroissance, résidu d’avortement qui résulte d’un hideux inceste. »
Gœthe ne se soucia plus des Huit Scènes. Il ne répondit pas à Berlioz.
*
Cette attitude de Gœthe vis-à-vis de Berlioz n’est pas pour nous étonner. Gœthe a méconnu les trois plus grands musiciens allemands de son temps : Beethoven, Weber et Schubert.
C’est là un cas curieux à examiner. D’autant plus qu’on a voulu prêter à Gœthe l’oreille d’un musicien.
Et cependant !
Quand Bettina Brentano lui crie son enthousiasme pour l’auteur de l’Héroïque, Gœthe ne la croit pas. Beethoven représente pour lui le jeune romantisme allemand, c’est-à-dire le chaos, l’informe, le monstrueux, tout ce qui peut lui être le plus odieux. Il ne veut pas être submergé par ce flot d’incohérence, de laideur.
Lorsque, malade et rongé par les soucis d’argent, Beethoven tendra la main à Gœthe afin d’obtenir du duc de Weimar une souscription à l’édition de la Messe en ré, Gœthe ne répondra pas. Il ne répondit jamais.
À l’égard de Weber, même incompréhension et même dureté. En 1825, peu de temps avant sa mort, Weber, déjà malade, se présente à la maison de Gœthe. Il s’annonce. On le fait attendre. On feint d’ignorer son nom, alors célèbre dans toute l’Allemagne. Admis enfin, il trouve abord froid, visage glacé, banalités, vide politesse. Weber se sauve, ulcéré. Il reste deux jours à l’hôtel, alité, sans que personne s’informe de lui.
C’était une véritable haine et une sorte de dégoût que Gœthe éprouvait pour Weber. Tout l’irritait en lui : sa misère physique, son caractère (il lui reprochait de flatter les passions de la foule), son art (beaucoup de bruit pour rien), son manque de goût littéraire qui lui faisait accepter, jugeait-il, des poèmes stupides.
Quant au pauvre petit Schubert, Gœthe n’y prête guère attention. Son Roi des Aulnes le laisse indifférent en 1817. Il faut que l’admirable lied ait fait le tour de l’Allemagne et lui soit chanté par la grande cantatrice Wilhelmine Schrœder pour que le dédaigneux poète fasse mine de s’émouvoir.
Mais le jour où le jeune Mendelssohn lui fait parvenir un cahier de quatuors piano et cordes, au fils du riche banquier berlinois, Gœthe s’empressait de répondre une lettre de longs et chauds remerciements.
Beethoven, Weber, Schubert, Berlioz, quatre génies de cette envergure niés l’un après l’autre par Gœthe ! Nous ne pouvons nous empêcher d’en vouloir à l’illustre poète et de l’accuser de surdité musicale.
À cette opinion, Romain Rolland a résisté. Il a voulu nous imposer l’image d’un Gœthe musicien.
Il fait remarquer que Gœthe ne resta pas indéfiniment insensible à l’art de Beethoven. Mais il faut voir de quelle façon. Quand il rencontre Beethoven à Tœplitz, il est frappé de l’expression extraordinaire de son visage. Il écrit à sa femme : « Je n’ai jamais encore vu aucun artiste plus puissamment concentré, plus énergique, plus intérieur ! »
Mais c’est l’homme qu’il juge là plus que le musicien.
Quelques jours plus tard, Beethoven improvise devant lui ; et l’on sait comment Beethoven improvisait, de quel élan impétueux, enflammé, torrentiel, – Gœthe dit alors à Beethoven qu’il avait joué d’une façon charmante ; il le complimenta sur l’agilité de ses doigts et son jeu perlé.
Peu à peu, Gœthe consentit à admirer Beethoven, mais après tout le monde et quand la réputation du compositeur était à son comble.
À l’occasion de la mort de Beethoven, Hummel part pour Vienne. À son retour, Gœthe ne lui demande rien, ne s’informe de rien, fait le silence une fois de plus…, de peur de trop s’émouvoir.
Ce Beethoven, il a fini par l’admirer. Mais il ne l’aime pas. Il n’aime ni le démesuré (Beethoven lui paraît tel), ni la mélancolie romantique. Et puis : trop de bruit.
Il aime Palestrina, Bach, Haendel, Don Juan, le Barbier.
En Beethoven, il fuit ce qu’il ne veut pas être et ce qu’il est pourtant au fond de lui-même dans son moi le plus caché.
Écoutant un jour la Symphonie en ut mineur, que lui joue Mendelssohn, il grogne, il regimbe. « On aurait peur, murmure-t-il entre ses dents, que la maison s’écroule. » Il a été touché jusqu’au plus profond de lui-même. Mais il n’en veut pas convenir. Assis dans un coin obscur, « comme un Jupiter tonnant », il jette des éclairs avec ses vieux yeux. Et refoulant son trouble, maîtrisant l’émotion qui l’étreint : « Cela n’émeut en rien, s’écrie-t-il rageur, cela étonne seulement ! »
Mais cela tout à la fin de ses jours. Il avait mis toute sa vie pour entrer en ce contact rageur avec Beethoven.
… Et Weber lui reste définitivement étranger.
Pourtant il prétendait aimer la musique et il l’avait étudiée. Il a une oreille extrêmement sensible et que le moindre bruit choque. Il possède une fort belle voix de basse dont il aime à faire sonner le timbre. Dans sa jeunesse, il a chanté. Il a appris le piano et le violoncelle. Il ne joue pas mal du piano.
La musique lui sert d’excitant pour se mettre en train d’écrire. « Je puis toujours mieux travailler, dit-il, quand j’ai entendu de la musique. » La musique est pour lui « le véritable élément d’où toute poésie sort et où elle retourne. »
Il a travaillé la composition et il s’y est essayé.
Il s’est formé le goût en écrivant des opéras-comiques de Sedaine et de Favart, de Monsigny et de Grétry, les « Singspiele » de Hiller.
Gluck fut toujours pour lui un des « sommets de l’art ». Dans sa jeunesse, il fit proposer de ses vers au grand compositeur pour qu’il voulût bien les mettre en musique. Mais Gluck avait bien d’autres occupations. D’un ton bourru, il refusa de lire les poèmes. « J’ai mes auteurs, répondit-il, Marmontel, Sedaine ! »
Haendel est aussi un des compositeurs préférés de Gœthe, et, plus que tous les autres, Mozart. Son Don Juan lui paraît un modèle inimitable. J.-S. Bach le ravit, Palestrina l’enchante.
Mais quelle peine Gœthe vieillissant trouve à sortir de ses admirations premières ! Aller plus loin, quelle fatigue ! Sa pensée est inlassable ; mais son oreille ne se prête plus aux curiosités de son esprit. Son oreille ne peut s’adapter à tant d’imprévu.
Terrible épreuve pour le goût d’un critique, remarqua Romain Rolland, d’avoir entendu au début de sa vie, en 1763, le petit Mozart, et à la veille de sa mort, en 1831, la petite Clara Wieck. Quelle longue durée, au cours de laquelle tant de choses ont changé dans le domaine de l’art !
N’importe ! Nous constatons cette « infirmité » de Gœthe qui le condamnait à rester en dehors du mouvement musical de son temps. Nous constatons cette lenteur à suivre l’évolution dont il était témoin. Et, dans cette paresse d’oreille, il y a vraiment une limite fâcheuse.
Gœthe est avant tout un visuel, zum selen geboren, zum Schauen bestellt pour lequel l’oreille est un « sens muet ». – Il l’a dit.
Malgré son grand désir de ne rien laisser échapper de ce qui se passait d’intéressant autour de lui, il paraît bien qu’il n’a jugé la musique que de loin, sans suffisante pénétration, et, trop souvent, après coup, d’après l’opinion des autres.
Un dilettante, un « amateur » peu doué. Rien de plus.
*
Dans ses Entretiens avec Eckermann, le Souverain de l’intelligence reconnaît à la musique le privilège de dépasser l’intelligence, la raison, d’exprimer l’indicible.
Est-ce bien un avantage qu’il lui accorde ? N’est-ce pas plutôt, dans sa pensée, une condamnation ?
Ce qu’il admet surtout, c’est la musique comme soutien de la poésie, – rôle secondaire et subordonné. Alors il fait mettre ses vers en musique par cet infiniment médiocre Zelter, et il se montre pleinement satisfait de cette collaboration. Il écrit à Zelter, en 1820 : « Je sens immédiatement l’identité de tes compositions avec mes lieds ! » C’est presque l’incompétence de Voltaire.
Il sent la musique en littérateur. Il y met au besoin tout ce qui n’y est pas et n’y saisit pas ce qui en est l’essentiel : la pure saveur des combinaisons sonores. Il faut qu’il y trouve des idées et des images à tout prix, – idées et images dont se passe bien le musicien, qui le gênent plutôt.
Sur les rapports de la littérature et de la musique, il a des idées quelquefois fort curieuses d’ailleurs : telle sa conception de la comédie. Les anciens disaient saltare comœdiam, danser une comédie. Gœthe veut que toute comédie soit danse, soit jouée en sautant, en courant, en dansant : action sans repos et en cadence. Et aussi cette idée du drame-salvatio est proprement musicale.
Mais ce n’est pas la danse, la musique réalisée par le pas et le geste, c’est la musique dans la parole que Gœthe aime par-dessus tout. Il dresse ses comédiens dans ce sens. Il veut d’un « parler musical » même quand il s’agit de prose. « Il dirige une troupe d’acteurs comme on conduit un orchestre. » Il attend encore plus de la parole ainsi musicalisée que de la musique.
En fin de compte, la musique de la parole est supérieure pour lui à la musique elle-même. Voilà où il se montre exclusivement poète. Voilà qui le sépare définitivement des musiciens pour qui le monde des sons est une réalité irréductible qui comporte sa beauté en soi, incomparable.
*
Nous nous expliquons peut-être maintenant, et par différentes raisons, pourquoi Gœthe, ce romantique si désespérément accroché au fantôme d’un classicisme illusoire, jugeait si imparfaitement les artistes musiciens.
Mais tout particulièrement quel malheur qu’un homme comme lui n’ait pu comprendre qu’il avait trouvé en Berlioz le plus éminent des interprètes.
*
Dans la Revue musicale, Fétis écrit sur les Huit Scènes un article assez perspicace. « L’imagination de ce jeune compositeur, disait-il, est empreinte d’une couleur fantastique et bizarre. Faust était le sujet le plus favorable au développement de ses idées originales. » Fétis remarquait « les idées entièrement neuves de l’orchestration ». Il concluait : « Cette partition de Faust, originale jusqu’à la bizarrerie, est l’ouvrage d’un homme plein de talent et de facilité… Si M. Berlioz calme un peu cette fièvre de sauvagerie dont il est tourmenté, nous n’hésitons pas à lui prédire les plus grands succès. »
Aussitôt, Meyerbeer écrit de Baden, pour demander un exemplaire. Le riche Meyerbeer préparait ses succès futurs. Il tenait à se mettre bien avec un camarade journaliste, et journaliste de quelle plume acérée, mordante au besoin, qu’il fallait ménager, dont il fallait se concilier les bonnes grâces par tous les moyens.
Par ailleurs, personne en France, pas plus qu’en Allemagne, ne s’occupait des Huit Scènes. On avait bien d’autres soucis. À l’Opéra, on montait Guillaume Tell et voilà qui intéressait au suprême degré tous les musiciens et tous les critiques et qui faisait oublier Berlioz.
Guillaume Tell passe enfin et Guillaume Tell triomphe. « Pantin de Rossini ! » Berlioz écume de colère. « L’ouvrage a quelques beaux morceaux. » Il ne peut pas le nier. Sans quoi !… « Il n’est pas absurdement écrit. Il y a un peu moins de grosse caisse, et voilà tout. Du reste, point de véritable sentiment, toujours de l’art, de l’habitude, du savoir-faire, du maniement du public. Ça ne finit pas. Tout le monde bâille, l’administration force les billets… »
Voyons ce que nous devons en penser.
CHAPITRE V
ROSSINI ET L’INVASION DE LA MUSIQUE ITALIENNE
GUILLAUME TELL (1829)
La première moitié et même les deux premiers tiers du XIXe siècle sont l’époque d’une formidable invasion de musique étrangère sous laquelle la musique française faillit être complètement submergée.
Ce flot puissant se déchaîna dans toute sa violence à partir de l’arrivée de Rossini à Paris, en 1823.
Nous avons déjà vu que Napoléon Ier avait singulièrement favorisé le développement du théâtre italien à Paris. Mais il ne s’agissait jusqu’alors que d’opéras italiens écrits sur des paroles italiennes. Nous allons bientôt montrer comment Rossini appartient à l’histoire de l’opéra français.
Né le 29 février 1792, à Pesaro, Gioacchino Rossini était le fils d’un inspecteur des boucheries qui exerçait aussi les fonctions de trompette municipal. Le petit Gioacchino fut mis en apprentissage chez un charcutier puis chez un forgeron. Mais sa vocation musicale est telle qu’on lui fait apprendre le piano, le violon, le cor, qu’on le fait chanter à l’église, qu’il est admis à 15 ans, au lycée musical de Bologne, dans la classe de composition du père Mattei. En 1811, il écrit son premier opéra, l’Inganno felice. Dans l’espace de treize ans, – jusqu’en 1823 – il en compose trente-quatre, avec des succès divers, dont Tancrède et l’Italienne à Alger (1813), une tragédie musicale et un opéra-bouffe qui commencent de répandre sa réputation, dont aussi le Barbier de Séville (1816), le chef d’œuvre de l’opéra-bouffe italien.
Le Barbier de Séville eut d’abord une existence difficile. La première soirée fut presque un désastre. Le public, hanté par le souvenir de l’œuvre de Paisiello, sur le même sujet, ne songeait qu’à tourner en ridicule la pièce nouvelle. D’ailleurs, une foule d’incidents comiques semblaient s’accumuler pour empêcher le succès de la représentation. Le ténor Garcia fut sifflé pour avoir fait maladroitement résonner les cordes de sa guitare. Basile, à son entrée, buta et faillit se casser le nez. Un chat traversa la scène pendant le final du 2e acte et toute la salle miaula. Le lendemain, Rossini refusa de conduire la 2e représentation. Mais le second soir, tout alla pour le mieux et on vint chercher l’auteur chez lui pour le porter en triomphe.
Pourtant, dans les journaux les critiques faisaient encore bien des réserves.
Ne se voyant pas fêté en Italie, comme il l’eût souhaité, surtout après l’insuccès de Sémiramis à Vienne, en 1823, Rossini accepta les propositions de l’Angleterre. Il partit pour Londres. Sur sa route, il s’arrêta à Paris où on l’engagea de revenir en octobre. Il y revint en effet, et y trouva les théâtres de musique dans une situation très embarrassée. Il eut l’habileté de se faire choisir par le gouvernement comme directeur du Théâtre Italien aux appointements énormes pour l’époque de 40.000 francs par an, sans compter toutes sortes de revenus résultant pour lui de la composition d’œuvres nouvelles. Le voilà pourvu d’une situation officielle qui va lui permettre de régner avec une suffisante autorité sur la musique française. Il va écrire lui-même des opéras français. À cette fin, il commencera par tirer parti de ses ouvrages antérieurs en les transformant. En 1826, son Maometto secondo devint le Siège de Corinthe. L’accueil fut enthousiaste. En 1828, un opéra-comique, le Comte Ory utilisa des fragments de Matilda di Sabran et du Viaggio à Reims écrit en 1825, à l’occasion du sacre de Charles X.
Le Siège de Corinthe avait remporté un immense succès. Moïse, avec sa fameuse Prière, fit encore plus d’impression sur le public. Mais ce n’était qu’une traduction de l’italien. Rossini voulut payer de sa personne et composer un ouvrage entièrement original. Il écrivit Guillaume Tell (1829). Cette fois, il avait fait un grand effort : il avait travaillé six mois. Il avait composé un « grand opéra » à la française sur le modèle de la Muette de Portici d’Auber.
Avait-il réussi ? Beaucoup mieux qu’il ne l’espérait lui-même et que ne le disaient ses ennemis, dont, au premier rang, Berlioz. Mais il avait surtout des amis et on le fêta dignement.
Guillaume Tell, reconnaissons-le, est un noble ouvrage, qui fait honneur à la scène française et il convient que nous nous arrêtions un peu à le considérer.
*
D’abord l’Ouverture, qui est une merveille. Il faut l’entendre conduite par Toscanini. L’ouverture en quatre parties : 1° une page d’introduction confiée aux violoncelles divisés sur de belles et solides harmonies ; 2° un « orage » d’un sobre mais parlant réalisme, en même temps que d’une ligne très classique ; 3° un délicieux « ranz des vaches », confié au cor anglais et varié par la flûte ; 4° un final endiablé d’une vivacité fine et légère. L’ensemble de ces quatre pièces détachées s’unit en un tout parfaitement cohérent. Elles ne donnent à aucun degré l’impression de décousu, mais au contraire celle d’une liaison parfaite.
Un gracieux chœur dansé et la chanson amoureuse du ténor solo amènent la belle phrase de Guillaume Tell :

Il est à remarquer avec quelle aisance, quelle correction et quel accent naturellement pathétique, Rossini mène ce récit mélodique.
Nous arrivons bientôt à une des pièces capitales de l’œuvre, le duo de Guillaume et d’Arnold.

de fière allure patriotique, avec ces riches dessins d’orchestre soutenant le récit de Guillaume en attendant qu’Arnold réplique par sa cantilène enflammée :

et après le revirement d’Arnold, son nouvel appel à l’amour, mais cédant cette fois à la vertu :

Au 2e acte, nous rencontrons la romance de Mathilde, assez fade :

Mais on n’a pas assez remarqué qu’elle est précédée d’une superbe introduction d’orchestre, pleine d’un mouvement passionné :

Après cela, le duo de Mathilde et d’Arnold : « Oui, vous l’arrachez à mon âme, ce secret qu’ont trahi mes yeux… » n’est plus que de cette musique que Rossini écrit quand il veut au courant de la plume et qui n’a d’autre mérite que de couler de source, facile et claire.
Mais le 2e acte nous réserve de magnifiques surprises.
D’abord le trio entre Arnold, Guillaume et Walter, d’un bel élan, robuste et chaleureux :

avec le douloureux épisode d’Arnold pleurant la mort de son père :

toujours avec cette belle déclamation large et d’un accent bien français, – avec aussi une harmonie si simplement expressive, – déchirante, – sur ces paroles : « Mon père, tu m’as dû maudire. » et, à la fin de la phrase, ces quelques notes retombant ternes et comme mortes dans le silence :

Alors, dans un récit passionné, Guillaume annonce à Arnold la conjuration des quatre cantons et le trio s’achève dans un appel enflammé à la liberté écrit dans une souveraine entente des effets vocaux les plus vibrants.
La fin de l’acte est un tableau saisissant de la conjuration du Rütli, dans la belle forêt du Seelisberg. Des profondeurs du bois ou de la surface des eaux montent des bruits divers. Ce sont les représentants des quatre cantons qui arrivent par groupes. Tableau à la fois plein de couleur, de mystère et d’émotion. Et un puissant ensemble réunit toutes les voix dans un serment solennel de fidélité à la patrie et à l’idéal commun.
C’est là une page de toute beauté par la profondeur et la sincérité du sentiment comme par l’inspiration grandiose des moyens d’expression.
Le 3e acte renferme la fameuse scène de la pomme, d’où il n’y a pas une note à regretter depuis la phrase de Guillaume :

jusqu’au sublime récit :

souligné d’accords si simplement et si intimement expressifs, et à la phrase incomparable de Guillaume, encore à mi-chemin entre le récit et la mélodie, accompagné cette fois par les dessins touchants du violoncelle solo :


On ne saurait s’élever plus haut ni plus purement dans le pathétique.
Le 4e acte s’ouvre par l’air d’Arnold « Asile héréditaire », auquel je préfère d’autres pages. Mais il se termine sur une vision radieuse de la Suisse libérée et dans une atmosphère de reposante sérénité musicale obtenue par les moyens les plus simples : une succession d’accords parfaits arpégés harmonieusement enchaînés.
J’ai souvent entendu dans mon enfance et dans ma jeunesse l’un des meilleurs Guillaume Tell qu’ait connus l’Opéra : le baryton Lassalle. Il possédait une voix ample et claire, nullement forcée, d’un timbre et d’un volume essentiellement naturels et il avait une jolie prononciation fort nette. Sa prestance, son geste large, son visage énergique, toute sa personne contribuait à faire de lui l’homme du rôle.
Je me rappelle aussi avec plaisir deux charmantes Jemmy, Mlles Janvier et Édith Ploux.
Mais dans le rôle d’Arnold, je n’ai le souvenir que de ténors hurlant à tue-tête, sans art, une musique dont ils ne sentaient ni la beauté musicale ni la force dramatique. Nourrit y était, paraît-il, splendide mais avec son aigu en voix de tête, il n’avait pas besoin de crier pour invoquer l’amour de Mathilde. Il avait, m’a-t-on dit, des douceurs et des rondeurs charmantes, et même dans la force, jamais de rudesse.
*
Après Guillaume Tell, après un succès foudroyant, à 37 ans, Rossini, chose incroyable, renonce au théâtre. Il fut, dit-on, effarouché par la gloire naissante de Meyerbeer. Je crois plutôt et plus simplement qu’il fut pris par la paresse, par une effroyable paresse,… et par la gourmandise. Il passait son temps à bien vivre, à savourer une délicieuse cuisine.
Il s’en retourna en Italie. Mais il s’y déplut et revint se fixer à Paris. En 1820, il avait épousé une chanteuse, Mlle Colbran, de sept ans plus âgée que lui, mais possédant 20.000 francs de rentes et une villa en Sicile. Mlle Colbran étant morte en 1845, il épousa en deuxièmes noces Mme Olympe Pélissier. Il avait besoin d’une femme pour tenir sa maison et veiller à la confection des petits plats qu’il aimait.
Rossini mourut en 1868, sans avoir écrit autre chose d’important, depuis une quarantaine d’années, que son Stabat mater (1832-1842).
Il connaissait ses dons et son principal défaut : la mollesse au travail. On cite ce mot (1860) qu’il aurait dit à Wagner : « J’avais de la facilité, j’aurais pu arriver à quelque chose. »
Mais Wagner est trop sévère pour lui quand il écrit : « Ce fut un fabricant extraordinairement habile de fleurs artificielles qu’il faisait de velours et de soie et qu’il peignait de couleurs trompeuses. Si bien qu’elles ressemblaient presque aux fleurs naturelles. » Il s’est montré au moins une fois, dans Guillaume Tell, capable de vérité et de la plus naturelle émotion[5].
Toujours est-il, que même par ses autres ouvrages, il exerça sur tous les peuples et particulièrement sur les Français, une extraordinaire séduction.
Stendhal écrivait en 1823 : « Depuis la mort de Napoléon, il s’est trouvé un autre homme dont on parle tous les jours à Moscou comme à Naples, à Londres comme à Vienne, à Paris comme à Calcutta. La gloire de cet homme ne connaît d’autres bornes que celles de la civilisation ; et il n’a pas 32 ans ! »
Et le métaphysicien Hegel disait : « Tant que j’aurai de l’argent pour aller au théâtre italien, je resterai à Vienne. »
Le théâtre italien envahissait tous les pays, même la France et Paris.
À côté de Rossini, Vincenzo BELLINI, né à Catane, le 1er novembre 1802, l’auteur de la Norma (1831), qui fit fureur avec la Malibran dans le rôle principal, vint à Paris en 1833, et il y composa les Puritains pour le théâtre italien. La veine mélodique de Bellini est intarissable et ses thèmes sont le plus souvent remarquables de pureté, d’élégance, de charme. Parfois aussi, ils manquent de force, d’accent, de distinction. Les accompagnements sont d’une indigence extrême et l’art du développement reste tout à fait rudimentaire.
Gaetano DONIZETTI, né à Bergame, le 25 novembre 1797, mort dans la même ville le 8 avril 1848, rivalisait, sans atteindre au même succès, avec Bellini. Son œuvre la meilleure est la Lucia di Lammermoor, qui fut représentée à Naples. En 1839, la censure napolitaine ayant interdit son Poliuto (Polyeucte), il part pour Paris, indigné, et c’est alors qu’il écrit ses ouvrages français, la Fille du régiment et la Favorite, d’abord assez mal accueillis, mais qui devinrent vite populaires.
Donizetti manque parfois de goût et tombe dans la vulgarité.
On se souvient peut-être encore aujourd’hui de l’air d’Alphonse dans la Favorite : « Jardins de l’alcazar, délices des rois maures », air qui fut un des triomphes du grand chanteur Faure et qui présente cette particularité d’être précédé d’un récitatif où, sur 23 mesures lentes, le même ut est répété 20 fois, soutenu par différentes harmonies. La difficulté de conserver à cet ut sa plénitude et sa couleur, d’en varier légèrement l’intensité suivant les moments est une épreuve terrible pour un artiste. Mais la plupart des chanteurs se sont contentés de la proférer à pleine voix sans nuance et sans art, soucieux seulement d’arriver sans encombre et sans défaillance, sans manque de respiration surtout, au bout de l’interminable récitatif.
*
La musique italienne influa considérablement au début du XIXe siècle sur la musique française et faillit la corrompre en lui faisant perdre quelques-unes de ses qualités les plus précieuses, et la plus précieuse de toutes : le goût.
Heureusement, Berlioz était là, non pas certes pour balancer le succès des Italiens, mais au moins pour rappeler à l’ordre la France musicale par ses articles de presse, et par ses exemples. Un des plus retentissants fut, en 1830, la Symphonie fantastique.
CHAPITRE VI
1830
LA SYMPHONIE FANTASTIQUE
En 1827, une troupe d’acteurs anglais arrivait à Paris, jouer Shakespeare en anglais. Ils donnèrent leur premier spectacle, le 6 septembre. La presse fut bonne pour les acteurs et pour la « grande amoureuse », Harriett Smithson.
« C’était une Irlandaise. Grande, svelte, l’épaule un peu grasse et la poitrine épanouie, la taille souple, le visage d’une blancheur éblouissante, avec de grands yeux un peu à fleur de tête, doux et rêveurs, et parfois étincelants de passion. »
À la représentation du 11 septembre, les Anglais attirèrent beaucoup de jeunes artistes : Delacroix, Hugo, Gérard de Nerval, Janin, Vigny, Dumas… et Berlioz.
On jouait Hamlet, Hamlet, c’était Kemble, et Ophélie, Harriett Smithson.
Berlioz ne savait pas l’anglais. Mais le seul nom de Shakespeare exaltait son imagination, « le foudroyait ». Hamlet-Kemble est admirable. Mais Ophélie-Smithson fait sur Berlioz une bien autre impression qui le bouleverse. « La secousse est si forte », qu’après le spectacle, il ne peut plus rentrer chez lui. Il erre toute la nuit dans les rues de Paris et dans les plaines de la banlieue.
Le 15, Harriett Smithson joue Juliette. Nouveaux transports. Nouvelles courses à travers rues et champs.
Comment parvenir jusqu’à Elle ?
Du moins que le nom de Berlioz lui soit connu !
Pour attirer son attention, il écrit à la diable une Messe qu’il dirige à Saint-Eustache.
En aura-t-elle entendu parler ?
On annonçait dans les journaux : « Le 5 décembre, miss Smithson et M. Abbott joueront pour la dernière fois à Paris. Ils paraîtront dans les deux derniers actes de Roméo. »
À cette représentation, « il y aura de la musique ».
De la musique… De qui ?
De Berlioz, parbleu, naturellement… Une ouverture « qu’on bissera ». Suprême moyen de conquérir Harriett !
Or, voici, selon Berlioz, ce qui se passa :
« Une après-midi, pour répéter son ouverture, il vient à Feydeau… Il entre au théâtre. Il monte vers la scène, muet, morne… Tout à coup, à trois pas de lui, il voit miss Smithson, il voit Juliette, Juliette morte, que Roméo arrache au cercueil et emporte dans ses bras… Feux et tonnerres ! Il pousse un cri et fuit en se tordant les mains. Miss Smithson entend ce cri. Elle s’échappe des bras de l’acteur et regarde. Qui est-ce ? Elle n’avait pas encore vu Berlioz… Quels yeux ! Quels yeux égarés !… Elle prend peur : « Qu’on veille sur ce gentleman dont les yeux n’annoncent rien de bon ! » On lui apprend que c’est Berlioz.
… Les représentations des acteurs anglais qu’on avait annoncées à leur fin, reprenaient bientôt. Berlioz les suivait passionnément et tandis qu’Harriett Smithson était en scène, lui, au parterre, proclamait : « Elle sera ma femme ! »
Cette passion qui le dévore, elle va devenir l’aliment d’une œuvre musicale. De quelle œuvre ? D’un drame ? D’une symphonie ?
Or, au Conservatoire, sous la direction de Habeneck, venait de se fonder la Société des Concerts. On y jouait sans cesse du Beethoven, le grand homme alors à la mode : il venait de mourir. Durant l’audition de la Symphonie en ut mineur, la Malibran est prise de convulsions : on a dû l’emporter hors de la salle du Conservatoire. Berlioz du moins l’affirmait.
Sur Berlioz lui-même, après Harriett Smithson, nouveau coup de foudre : Beethoven… Beethoven et ses neuf symphonies.
Ne manquons pas de citer ici, d’après Ad. Boschot, un fragment d’article où le jeune romantique déchaîné qu’est alors Berlioz décrit ses impressions quand il écoute Beethoven : « Mes forces vitales semblent d’abord doublées ; je sens un plaisir délicieux où le raisonnement n’entre pour rien ; l’habitude de l’analyse vient ensuite d’elle-même faire naître l’admiration ; l’émotion, croissant en raison directe de l’énergie ou de la grandeur des idées de l’auteur, produit bientôt une agitation étrange dans la circulation du sang ; mes artères battent avec violence ; les larmes, qui d’ordinaire, annoncent la fin du paroxysme, n’en indiquent souvent qu’un état progressif, qui doit être de beaucoup dépassé. En ce cas, ce sont des contractions spasmodiques des muscles, un tremblement de tous les membres, un engourdissement total des pieds et des mains (en italiques dans le texte), une paralysie partielle des nerfs de la vision et de l’audition ; je n’y vois plus, j’entends à peine ; vertige… demi-évanouissement… » Une autre fois, il parlera très sérieusement de « mèches de cheveux arrachés, de rires stridents et de sanglots convulsifs. » Un jour, il voit, à la conclusion de la Symphonie en ut arriver de vieux militaires se lever et, faisant le salut, s’écrier : « l’Empereur ! »
Mais nous sommes à une époque où il se passe des choses bien étranges et où la musique produit sur le public des effets extraordinaires. Stendhal dans sa Vie de Rossini rapporte ceci : « À Brescia, je fis la connaissance de l’homme du pays qui était peut-être le plus sensible à la musique. Il était fort doux et fort poli ; mais quand il se trouvait à un concert et que la musique lui plaisait à un certain point, il ôtait ses souliers sans s’en apercevoir. Arrivait-on à un passage sublime, il ne manquait jamais de lancer ses souliers derrière lui et sur les spectateurs. »
Pour le moment, Berlioz est « foudroyé » par Beethoven. Il lit ou il écoute ses symphonies et ses quatuors et il songe à composer des ouvrages qui leur ressemblent et qui produiront sur le public les mêmes effets bouleversants.
De son amour pour Harriett Smithson (il lui a écrit pour lui demander sa main. Mais elle ne répond pas. Elle refuse de lire ses lettres), et de son admiration enthousiaste pour Beethoven, va naître l’œuvre nouvelle, une symphonie, une immense symphonie, la Fantastique.
Selon une méthode qu’il suivra désormais volontiers, il commence par rechercher dans ses papiers s’il ne se trouve pas quelque page oubliée à utiliser. Il en découvre une, excellente, une mélodie de prime jeunesse, sur des vers d’Estelle et Némorin, de Florian :
Je vais donc quitter pour jamais
Mon bon pays, ma douce amie !
Il fera servir cette page bienheureuse.
*
Ici, un entr’acte.
Un jour, en rentrant de courses à travers la ville, Berlioz trouve son Thomas Moore ouvert à cette page : « Quand celui qui t’adore n’aura laissé derrière lui que le souvenir de ses douleurs ;… tu fus l’idole de mes rêves d’amour ;… chaque pensée de ma raison t’appartenait ;… les jours de ta gloire ;… je meurs pour toi… »
Mais c’est son amour, son amour désespéré pour Harriett Smithson que Thomas Moore chante là. Pour un instant, il se détourne de la pensée de sa Symphonie. Il se précipite sur sa plume et, d’un trait, il écrit son Élégie en prose qu’il joindra à ses Mélodies irlandaises, avec cette dédicace : F. H. S. (For Harriett Smithson). « C’est la seule fois, déclare-t-il, qu’il me soit arrivé de pouvoir peindre un sentiment pareil en étant encore sous son influence active et immédiate. » Et il ajoute : « J’ai rarement pu atteindre à une aussi poignante vérité d’accents mélodiques, plongé dans un tel orage de sinistres harmonies… Ce morceau est immensément difficile à chanter et à accompagner. »
Et jamais, dans aucun concert, Berlioz ne le fera chanter !
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Peut-être ceci : À la bien considérer, et sans qu’il se l’avoue nettement, Berlioz s’aperçoit qu’il s’est fait illusion sur la valeur de cette mélodie et que d’écrire sous la dictée immédiate du sentiment n’est sans doute pas la meilleure manière de faire œuvre de beauté. Il vaut mieux laisser la passion se refroidir, l’émotion amoureuse, puisqu’il s’agit ici d’amour, se transmuer en émotion musicale, ce qui est bien différent, et prendre son contour, son dessin harmonieux.

*
Autre événement qui dut interrompre la composition de la Symphonie commencée. Mais on voudrait bien savoir quelle part prit Berlioz à la « bataille d’Hernani », ou même s’il y assista. Or, on ignore tout des rapports de Berlioz et du groupe de Hugo à cette époque. Il est bien probable cependant que si le 25 février 1830, Berlioz avait assisté à cette représentation mémorable, il en aurait parlé. Le bruit en dut tout au moins parvenir jusqu’à lui et remuer en lui bien des idées et des sentiments.
Ce qui est certain c’est que la littérature prenait alors en France le pas sur tous les autres arts. Victor Hugo vient de révolutionner le monde des artistes par sa préface de Cromwell (1827). Pour la jeunesse d’alors, ce sont « les tables de la Loi sur le Sinaï ». Un éclatant chef-d’œuvre, les Orientales, en janvier 1829, achève de porter Victor Hugo au rang de chef incontesté de la jeune école. Ce recueil de poésies dépasse en retentissement l’effet de ces toiles sensationnelles qu’avaient été en 1819, le Radeau de la Méduse, en 1822, la Barque de Dante, en 1824, le Massacre de Chio. C’est en 1827, qu’avait paru la traduction du Faust de Gœthe par Gérard de Nerval. « Quel temps merveilleux ! s’écriait plus tard Théophile Gautier. Walter Scott était alors dans toute sa fleur de succès… On découvrait Shakespeare sous la traduction un peu raccommodée de Letourneur. Et les poèmes de Lord Byron, le Corsaire, Lara, le Giaour, Manfred, Beppo, Don Juan nous arrivaient de l’Orient qui n’était pas banal encore. »
Hernani, achevé, allait être représenté. Les répétitions étaient commencées. D’avance, le tumulte s’organisait autour de la pièce. Les classiques et les romantiques allaient s’affronter. Il s’agissait pour Victor Hugo de remporter la victoire. Et habilement, il la préparait, il l’organisait. Il rassemblait ses troupes. Théophile Gautier fut un de ses principaux agents. Sa double qualité de peintre et de poète le recommandait à l’attention de Hugo qui lui fit remettre par Gérard de Nerval, sous promesse de n’amener que des hommes sûrs, six carrés de papier rouge marqués de la devise hierro.
Le grand jour vint (25 février 1830). Jeunes poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, tous les artistes, toute la « jeune France » était là. Ils étaient chevelus et triomphants. Parmi eux, un jeune rapin d’une beauté surprenante, le visage mat, vêtu d’un pourpoint en satin cerise (le fameux gilet rouge dont on a tant parlé) d’un pantalon vert d’eau très pâle, bordé d’une bande de velours noir, d’un habit noir à revers de velours largement renversés et d’un ample pardessus gris doublé de satin vert : c’était Théophile Gautier.
Sur le devant d’une loge, une admirable jeune fille, blonde, en robe blanche, avec une écharpe bleue, comme en extase « une Muse écoutant Apollon » : c’était Delphine Gay (Mme de Girardin).
Rude bataille, indécise le premier soir, qui se prolongea durant toutes les représentations suivantes, mêlées d’applaudissements, de sifflets, de cris, des vers repris et hués ou répétés avec enthousiasme, Théophile Gautier prit part quarante fois de suite à ces extraordinaires disputes.
Mais Berlioz ? Que faisait Berlioz ? Peut-être boudait-il. Il boudait la gloire d’un rival. Pourquoi fallait-il donc que la poésie prît ainsi le pas sur la musique ? Hugo avait-il donc plus de génie que lui, Berlioz ? On verrait bien ! On verrait comment serait accueillie la Symphonie fantastique et si elle ne provoquerait pas, en musique, une révolution analogue à celle que marquait en poésie la première d’Hernani !
« Et Hugo avait été joué à la Comédie-Française !… Être joué sur un théâtre !… Pourquoi Berlioz ne serait-il pas joué à l’Opéra ? » Aussitôt, il tente des démarches. Mais en vain. « Il me faut de l’argent, répond le directeur… Rien ne fait plus d’argent qu’Auber et Rossini. »
Alors Berlioz revient au projet de l’« immense symphonie » dont il avait été un instant détourné. Cette symphonie, elle sera romantique. L’auteur n’y parlera que de lui, de ses propres émotions. Elle sera plus romantique qu’il n’en a jamais été écrit. Berlioz se mettra en scène, y contera sa vie, ses rêves, ses amours. Il se mettra en scène plus que Beethoven lui-même dans ses derniers ouvrages. La Symphonie fantastique aura pour sujet la romanesque passion de Berlioz pour Harriett Smithson !
Et voilà que Berlioz apprend justement l’imprévue déchéance de sa bien-aimée. Harriett Smithson est engagée à l’Opéra-Comique, – non pas pour y chanter – mais pour jouer des rôles muets. Eh quoi ! La divine Ophélie, l’exquise Juliette devenue deuxième figurante, simple « marcheuse », qu’est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que les Parisiens s’étaient naïvement entichés d’une actrice fort belle à la vérité, mais sans talent, engagée au dernier moment dans la troupe anglaise pour la compléter au petit bonheur. Et puis, l’illusion était tombée et Harriett ne trouvait plus d’engagement à Paris ni ailleurs, dans les rôles shakespeariens. Il y avait aussi des racontars, Berlioz écrit à son ami Ferrand : « D’affreuses vérités découvertes à n’en pouvoir douter… Elle (Harriett) n’est qu’une courtisane ! » Est-ce bien vrai ? Berlioz ne s’attarde pas à discuter les on-dit. Le fait est que maintenant la matière est belle pour l’« immense symphonie ». La pure, l’idéale jeune fille tombant tout d’un coup au rang d’une vulgaire courtisane. Quel drame émouvant ! Les tortures de la jalousie lui dévorent le cœur, à lui, l’auteur ! Quel magnifique motif d’inspiration ! Si la Smithson n’était pas en réalité devenue courtisane, il faudrait inventer cette histoire, pour terminer la symphonie. C’était la seule fin possible. Elle était trouvée.
Et pour mieux faire comprendre ses intentions, Berlioz rédige un long « programme » dont voici l’essentiel :
I. – RÊVERIES, PASSIONS.
Un jeune musicien, d’une sensibilité maladive et d’une imagination ardente, se trouve dans cet état d’âme que Chateaubriand a si admirablement peint dans René. Rêveries vagues ; mélancolies et joies sans causes précises ; troubles délicieux d’un sentimental adolescent. – Soudain, il voit une femme : la femme idéale, telle qu’il la rêvait, idéal de beauté et de charme que son cœur appelait depuis longtemps. – Aussitôt, amour volcanique, délirantes angoisses, fureur, jalousie ; puis retour de tendresse, larmes, et enfin consolations religieuses.
II. – UN BAL.
L’artiste se trouve dans les circonstances de la vie les plus diverses. Le voici au milieu d’un bal, dans un tumulte joyeux… L’image chérie vient se présenter à lui et jeter le trouble dans son âme.
III. – SCÈNE AUX CHAMPS.
Au loin (c’est le soir), deux pâtres dialoguent un ranz des vaches. L’artiste rêve… L’idée fixe, l’image de la bien-aimée reparaît. Pressentiments lugubres : « Elle me trompe ! » Mugissement de l’orchestre… Tout s’apaise. Sérénité du soir… Un des pâtres reprend le ranz des vaches. L’autre ne répond plus… Absence, oubli, isolement douloureux… Faible écho d’un tonnerre lointain… Solitude… Silence…
IV. – MARCHE AU SUPPLICE.
L’artiste rêve qu’il a tué celle qu’il aimait. Il est condamné à mort et mené au supplice : l’idée fixe reparaît : c’est la clarinette qui rappelle la douce mélodie ; mais elle est interrompue par un accord de tout l’orchestre : c’est le coup de hache du bourreau qui a fait rouler à terre la tête du condamné.
V. – SONGE D’UNE NUIT DE SABBAT.
L’artiste se voit (en songe), aux enfers. Des spectres, des monstres, des larves, des lémures, des sorciers et des diables viennent danser autour de lui. C’est le sabbat… La bien-aimée apparaît, mais déformée, ricanante, sautillante, vulgaire, triviale, grotesque… C’est une courtisane !… Voici les cloches ! la ronde s’arrête et se prosterne. Dies iræ. Puis parodie du Dies iræ. La ronde du sabbat reprend et se mêle au Dies iræ dans un furieux tourbillon d’épouvante.
Ce thème littéraire, ce programme était-il bien nécessaire ? Mais oui, Berlioz le répandra dans la salle où l’on jouera sa symphonie. Attirer ainsi l’attention des auditeurs sur un épisode de sa vie fort connu du public, c’était donner à son œuvre un intérêt d’actualité tout puissant. C’était en somme le succès.
Ce programme, il était nécessaire d’une autre manière. Car l’œuvre qu’avait construite Berlioz était faite de pièces et de morceaux empruntés à des œuvres ou à des projets antérieurs. Il fallait lui donner une unité, fût-elle quelque peu factice. Cette unité, elle serait constituée par la personne même de Berlioz, dont on nous conte l’histoire. La musique ne serait que le commentaire de cette histoire, ne s’expliquerait que par elle. Voilà la liaison établie du même coup entre des parties fort hétérogènes.
Mais voyons cette musique.
Tâche ingrate au suprême degré. J’avoue que toutes les fois que je tente d’analyser la musique de Berlioz, elle me paraît s’effriter et tomber en poussière sous mon regard. J’avoue même que longtemps je fus rebelle à toute admiration pour cette sorte d’art qui me restait totalement étranger, précisément sans doute parce que je cherchais trop à l’analyser. J’ai fini par écouter sans essayer de comprendre et alors je fus ému par une beauté qui se forge, on ne sait comment, en dehors de toutes les prévisions et par les moyens en apparence les plus artificiels. Une unité secrète vient lier les éléments qui ne semblaient d’abord que se juxtaposer dans un désordre irrémédiable et que le don de génie avait pour effet d’assembler en un tout cohérent, – mais cohérent pour la seule oreille et sans que la raison y démêle rien de clairement enchaîné.
I. – RÊVERIES, PASSIONS.
La symphonie s’ouvre, ex abrupto, après deux mesures seulement d’introduction n’ayant d’autre sens que de marquer la tonalité d’ut mineur, mais où du moins sonnent les bois délicieusement, par l’exposé du thème de la rêverie d’adolescent que Berlioz emprunte à un de ses premiers essais. C’est la mélodie, dédiée à son amie d’enfance Estelle Dubœuf, et composée jadis sur les paroles de Florian, tirées d’Estelle et Némorin :
Je vais donc quitter pour jamais
Mon bon pays, ma douce amie,
Loin d’eux, je vais passer ma vie
Dans les pleurs et dans les regrets.
Berlioz songe à ce passé lointain. Il en est tout ému et d’une émotion fort triste. Sur sa partition, il marque cette indication : Lugubre. Il exagère un peu sans doute et il a beau assombrir le sentiment par le choix des harmonies, il ne va pas jusqu’à en rendre l’expression tragique. Je ne serai cependant pas tout à fait de l’avis d’Adolphe Boschot qui qualifie la mélodie d’Estelle de « jolie romance florianesque ». Je lui découvre infiniment plus d’accent qu’à la poésie de Florian. Au surplus, en voici le texte tel que l’exécutent les violons avec sourdines :

Si nous lisons ce thème jusqu’au bout, nous sommes frappés d’un procédé, fréquent chez Berlioz, dont il use vers la fin de son exposé. La partie chantante et ses harmonies, se trouvent tout d’un coup soulignées de croches pizzicato et pianissimo des contrebasses qui ne se justifient par aucune raison d’ordre musical. Il faut y voir un effet purement impressionniste. Berlioz est ému du souvenir de cet amour lointain, si ému qu’il en ressent tout d’un coup des palpitations et ce sont ces palpitations d’un cœur nerveux que traduisent à leur manière ces pizzicati imprévus.

L’énoncé de ce premier thème forme l’introduction du premier mouvement. Car, si révolutionnaire qu’il soit, Berlioz tient à donner à sa symphonie au moins l’apparence d’une forme classique. Elle aura cinq mouvements, un de plus même que n’en comporte d’ordinaire la symphonie classique. L’Allegro initial sera précédé d’une introduction lente, comme si souvent chez Beethoven ; ici, le largo de la mélodie d’Estelle. Un Allegro agitato e appasionnato assai s’enchaînera à ce Largo. Puis vient, en guise de Scherzo, le Bal, suivi du mouvement lent, la Scène aux Champs. Ici, on attendrait le Finale. Mais nous avons d’abord une marche, la Marche au supplice exigée par le « programme ». Et Beethoven s’était déjà permis ces sortes d’exceptions au plan consacré de la symphonie. Enfin, le Songe d’une nuit de Sabbat constitue une péroraison des plus brillantes.
Mais si la symphonie peut se définir essentiellement un ordre de mouvements, elle a de plus dans la composition de chaque mouvement ses lois propres. C’est là qu’il est le plus difficile de se conformer à ses exigences.
Et surtout la Symphonie repose principalement sur l’art du développement. Qu’est-ce donc qu’un développement musical ? Un développement consiste en musique à tirer d’un thème tout ce qu’il contient en puissance. Un thème se compose d’un certain nombre de notes que l’on peut prendre dans leur ordre direct ou dans l’ordre inverse, qu’on peut presser ou ralentir, accompagner d’harmonies diverses, lui conférant ainsi des expressions inattendues, présenter dans des tonalités différentes, unir à divers contrepoints, briser en fragments qu’on peut rejoindre ensuite en des enchaînements nouveaux, etc. Tout cela, c’est développer. Sans compter qu’un fragment du thème, ou son rythme sans sa mélodie, ou seulement son harmonie sans l’un ni l’autre, peuvent être les points de départ d’inventions imprévues. Pour se rendre compte de la richesse de créations que porte en soi virtuellement un motif donné, il suffit de considérer les trente-trois variations de Beethoven sur un thème de Diabelli.
Or, Berlioz ignore à peu près tout de l’art du développement, cet art qu’un Haydn, qu’un Mozart, qu’un Beethoven avaient déjà porté à leur point de perfection. Il ne sait que présenter, les uns après les autres, divers motifs et les répéter au besoin intégralement sans aucune modification, traitant chacun d’eux comme un bloc indivisible, inaltérable. Mais juxtaposer des thèmes divers n’est pas à proprement composer. Composer c’est extraire d’un ou deux thèmes toutes leurs conséquences musicales en un tout profondément unifié. Ce qui manquera aux ouvrages de Berlioz, c’est cette unité de synthèse.
L’unité ne leur fera pas cependant complètement défaut. Et c’est ici qu’est le miracle. Ne cherchons pas à l’expliquer par une analyse qui ne donnerait aucun résultat. Il s’agit ici, nous l’avons dit, d’une unité de sentiment où se découvrent les affinités secrètes d’éléments musicaux que ne rejoint aucune composition, accessibles à la seule sensibilité et non point à l’intelligence. Et ainsi, il apparaît qu’une mosaïque musicale comme celle que crée Berlioz peut éviter l’inconvénient majeur de toute discontinuité.
Fermons cette vaste parenthèse utile à notre dessein et revenons à notre Symphonie et à son premier Allegro, qui correspond au terme du « programme » : Passions.
Après quelques accords affirmant la tonalité d’ut majeur, commence l’exposé de ce que Berlioz appelle l’idée fixe et qui n’est autre que l’image musicale, le « reflet mélodique » de la bien-aimée, de Harriett Smithson.

Ce thème appelle bien des réflexions.
D’abord, dans son début au moins, il est présenté sans accompagnement, dans une absolue nudité. Voilà qui justifierait la qualification de « génie monodique » attribuée par Marnold à Berlioz. Mais quelle vertu expressive ne faut-il pas à un thème pour valoir ainsi par lui-même, sans être relevé de la saveur d’aucune harmonie ! Une comparaison se présente immédiatement à l’esprit. On songe au motif de la Cène par quoi débute le Prélude de Parsifal :
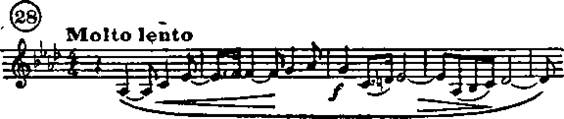
Ce thème, lui aussi, est présenté d’abord à nu, sans accompagnement. Mais de quelle intensité expressive n’est-il pas doué et quelle émotion ne recèle-t-il pas en son contenu purement monodique ! Je voudrais qu’il en fût de même du motif de Berlioz que nous considérons. Or, j’ai toujours fait mes efforts pour en saisir le caractère expressif et, je l’avoue, je n’ai jamais réussi à en être touché. Il m’a toujours paru extraordinairement plat, dans sa tonalité d’ut majeur, composé comme il est des notes de l’accord parfait suivies d’une montée sur le 7e de dominante destinée sans aucun doute à traduire une émotion qui m’échappe totalement. Je n’hésiterai pas à déclarer que pour mon oreille, sans doute mal accordée avec la sensibilité de Berlioz, cette mélodie n’a aucune signification émotive. Je souhaite de faire, à cet égard, exception à la perception commune. Mais je sais, hélas, d’autres auditeurs que moi qui partagent sur ce point mon sentiment.
Le cas est d’autant plus regrettable que ce motif joue un rôle singulièrement important dans la Symphonie. Il est, comme dit Berlioz, l’idée fixe, le thème obsédant qui reviendra sans cesse aux moments les plus doux, évoquer l’image de la bien-aimée, et la passion dévorante qui poursuit l’auteur.
Inutile d’insister sur cette remarque souvent présentée et développée par bien des commentateurs que l’idée fixe de Berlioz n’est pas le leit-motiv de Wagner. Le leit-motiv devient dans le drame wagnérien un élément important du développement auquel il fait corps, lui apportant ainsi un point de départ et une matière malléable. L’idée fixe de Berlioz n’entre comme élément dans aucun développement. Elle est plaquée, ici ou là, interrompant au contraire le développement ou ce qui en tient lieu. L’idée fixe de Berlioz n’est que le rappel du motif dont, avant lui, il a été déjà fait usage par J.-S. Bach, par Mozart et par bien d’autres. Mais ce rappel de motif joue dans la Symphonie fantastique, amalgame un peu artificiel de tant de matériaux divers, un rôle particulièrement utile, en donnant l’illusion d’une unité absente, ou si cette unité se trouve réellement créée par les liens mystérieux du génie berliozien, en nous aidant à en prendre plus clairement conscience.
Nous disions tout à l’heure que l’idée fixe de la Symphonie fantastique débute sans accompagnement. Il en est ainsi, en effet, durant les six premières mesures. Par la suite, apparaît au-dessous du thème, je ne dirai pas un accompagnement à proprement parler, mais une sorte de contre-coup rythmique. C’est le cœur de Berlioz qui s’émeut et dont les soubresauts se trouvent marqués ainsi dans le grave :

avec des interruptions, des silences complets entre certaines de ces fiévreuses pulsations. Procédé essentiellement impressionniste dont nous avons déjà noté que l’usage serait fréquent chez Berlioz.
*
Toute considération abstraite et générale comporte une certaine part d’inexactitude. Nous en avons la preuve si nous réfléchissons de nouveau à ce que nous venons d’indiquer comme essentiel à l’art de Berlioz. Nous avons parlé de son impuissance à développer. C’est une affirmation à nuancer maintenant. En réalité, Berlioz ne développe guère. Il n’en connaît pas ou n’en pratique pas les moyens, – pas souvent du moins. Raison de plus pour souligner les cas qui font exception. En voici un par exemple : Avant les deux barres de reprise, quand l’exposition est terminée, nous trouvons quelques lignes inspirées de l’idée fixe ainsi altérée, transformée :

Ce ré dièse change tout. Il est singulièrement expressif, singulièrement passionné. Rapide indication, certes, et qui ne se prolonge pas, mais dont l’effet n’en est pas moins considérable.
Et après les deux barres de reprise, quand commence la partie de la symphonie qu’on appelle le divertissement, c’est-à-dire la recherche de toutes sortes de combinaisons entre les thèmes (partie « savante » de la symphonie), là encore, Berlioz présente à la basse son idée fixe modifiée d’une autre manière. Il développe :

*
L’Allegro initial de la Symphonie fantastique ne renferme qu’un thème, qui est celui dont nous venons de préciser la signification et le rôle. Mais, en général, le 1er mouvement de la Symphonie classique comprend deux thèmes. Chez Beethoven, un des thèmes est habituellement masculin (rythmique), l’autre féminin (mélodique). Songez, par exemple, au début de la Symphonie en ut mineur avec les coups du destin « qui frappe à la porte » :

suivis de la douce prière de sa victime suppliante,

De l’opposition et de la lutte de ces deux thèmes résulte tout l’intérêt dramatique de ce premier Allegro.
Berlioz s’est privé de ce moyen puissant d’émotion. Dans le 1er mouvement de la Fantastique, il n’y a pas de second thème. On peut tout au plus relever un certain nombre de courts motifs rythmiques ou harmoniques qui viennent se placer entre les énoncés successifs du thème, je ne dirai pas principal, mais unique. Ces brefs motifs ne méritent ni par leur importance restreinte, ni par leur valeur mélodique quasi-nulle, la dénomination de « thèmes ». C’est, par exemple, une suite de sixtes montant, puis descendant par degrés chromatiques :

Procédé harmoniquement pauvre, mais d’un effet assez imprévu de passion ardente et comme rageuse par le moyen des attaques d’un Staccato strident que Berlioz exige de ses violons.
Il y a peut-être un motif qu’on pourrait à la rigueur considérer comme second thème, c’est ce motif rythmique que nous avons déjà cité qui marque sous l’idée fixe les soubresauts du cœur de Berlioz. Il reparaît, après le divertissement, au début de la réexposition, aux parties hautes et enveloppe d’une sorte de galop frénétique tout le thème de la bien-aimée. Ce serait alors le second thème qui serait rythmique et le premier qui serait mélodique, contrairement à l’ordre suivi d’ordinaire par Beethoven. Nous aurions ainsi un premier thème féminin, reflet mélodique de la bien-aimée et un second thème masculin traduisant les réactions de Berlioz à son amour pour Harriett Smithson. Et ce second thème offrirait au musicien l’occasion d’une sorte de développement.
De cet art de développer, si rudimentaire chez Berlioz, on pourrait reconnaître encore la trace dans la façon dont le compositeur amène la conclusion de son 1er mouvement.
Par la répétition modulée d’un fragment du thème de la bien-aimée, Berlioz amène un dernier énoncé de ce thème lui-même :

Et il conclut, par une « cadence plagale », trois fois répétée avec l’indication Religiosamente. C’est le seul commentaire de ces termes du « programme » : Consolations religieuses. Commentaire un peu bref. Non pas, il est vrai, au point de vue strictement musical et c’est l’important. Nous nous moquons, en effet, que les consolations religieuses ne tiennent pas une grande place dans le cœur de Berlioz.
II. – UN BAL.
Cette 2e partie, c’est une valse, précédée de ces papillotements, de ces scintillements d’orchestre, effets de pure instrumentation auxquels excelle Berlioz. C’est une valse, sans doute composée antérieurement et recueillie précieusement parmi les éléments qui serviront à constituer la Symphonie, peut-être une valse inspirée naguère, suppose Adolphe Boschot, « inspirée au disciple du chevalier Lesueur par une passionnette commençante pour les filles de son Maître, pour ces demoiselles qu’Hector accompagnait au bal, et, de préférence, pour la mélancolique Eugénie, qui aimait tant la musique désespérée ?… » Musique de danse sans aucun rapport avec celle du 1er mouvement mais dont la présence ici sera justifiée par les exigences du programme de plus en plus indispensable à l’unité de l’œuvre. Il suffira, pour mettre en évidence le lien léger qui en rattache les unes aux autres les différentes parties d’une brève « citation ». L’idée fixe, le « reflet mélodique » de la bien-aimée apparaîtra tout d’un coup vers la fin de la valse. Apparition extrêmement brève. Citation tronquée. L’auteur ne se donnera même pas la peine d’exprimer l’émotion que l’image chérie doit produire en son cœur. Il va au plus pressé et conclut dans un tourbillonnement éperdu de la danse.
Il faut avouer d’ailleurs que le thème de cette valse est singulièrement original et de l’effet le plus heureux. On n’avait pas encore songé à traduire le mouvement de la valse en musique par un trait aussi long, d’un contour aussi souplement serpentin, surtout une ardeur aussi fougueuse. Même quand il commence dans la douceur. On est entraîné irrésistiblement. Ce n’est pas tant de la grâce, de la tendresse qu’une coulée de feu.
III. – SCÈNE AUX CHAMPS.
Au loin (c’est le soir), « deux pâtres dialoguent un ranz des vaches ».
Je ne connais pas de musique plus poétique.
Le cor anglais[6] dit le thème, que le hautbois reprend en écho :

Notons le curieux rythme syncopé et l’absence d’accompagnement. Toujours la mélodie dans sa nudité. Rappelons de nouveau le mot de Marnold : « Berlioz, génie monodique ». Cette fois, la mélodie non harmonisée présente par elle-même un caractère intensément expressif de mélancolie.
Les voix de la Nature, sous forme d’à peine perceptibles trémolos des cordes, se mêlent au chant agreste du cor anglais et du hautbois. Bruissements confus, doux frissonnement des feuilles sous la tendre caresse d’une légère brise d’été.
Les deux pâtres cessent de se répondre.
Une mélodie chantée par les violons et la flûte unis dit toute la plénitude de vie d’un cœur amoureux :

Mélodie une fois de plus sans accompagnement.
Mais la musique s’agite. L’idée fixe apparaît et en même temps se font entendre d’affreux mugissements aux basses. « Elle me trompe », dit le programme et la colère, une colère « vraiment byronienne » d’un cœur dévasté éclate à l’orchestre.
Les mauvaises pensées s’effacent. Un délicieux chant d’apaisement s’épanouit sereinement à la clarinette, entremêlé d’un exquis contrepoint.

Nouvelle angoisse de jalousie. Nouveau sursaut des basses.
Puis tout se calme encore une fois et cette fois l’idée fixe reparaît dans sa pureté originelle.
L’artiste, qui de ses passions diverses avait animé le paysage, s’éloigne, quitte la scène. La peinture d’un beau soir d’été reprend avec le mélancolique chant du cor anglais. Mais cette fois, le hautbois ne répond plus. Le pâtre a perdu la présence de son compagnon. Faible écho d’un tonnerre lointain… Solitude… Silence. Toute cette fin est prodigieusement évocatrice, symbolique, émouvante.
IV. – MARCHE AU SUPPLICE.
Le héros de la Symphonie rêve qu’il a tué celle qu’il aimait et que, condamné à mort pour son crime, il marche au supplice.
Dans ses Mémoires, Berlioz nous conte que cette marche fut écrite « en une nuit ». Ce serait évidemment possible. Mais ce n’est pas vrai. Cette marche existait depuis longtemps. Elle est extraite d’une œuvre antérieure : les Francs-Juges. Le manuscrit en subsiste et l’on y peut constater, de façon fort instructive en ce qui concerne l’art de Berlioz, comment s’en fit l’appropriation au programme de la Symphonie. Elle se fit à l’aide d’une simple collette qui contient les quelques notes ajoutées au texte primitif et qui constituent un rappel de l’idée fixe. En soulevant la collette, on voit l’ancien texte des Francs-Juges. « Ce que Berlioz a écrit en une nuit, c’est la collette. Ce fut le seul changement qu’il fit à la musique de son ancienne Marche des Gardes, dit Adolphe Boschot. Il arrêta le dernier fortissimo sur la dominante, intercala avant les accords du ton, quatre mesures de l’idée fixe (clarinette), et les pizzicati du quatuor. »
Mais il faut reconnaître que par une heureuse rencontre, cette Marche au supplice convient admirablement à la situation qu’elle doit commenter. Elle est lugubre à souhait, d’un rythme pesant, d’un sentiment féroce. Rien n’y manque de ce qu’il s’agit d’exprimer :

et les motifs s’enchaînent les uns aux autres dans une parfaite liaison, sans la moindre discontinuité, sans un heurt. Quand l’idée fixe apparaît, c’est à peine si elle trouve le temps de s’émouvoir en ses premières notes. Elle est brutalement interrompue par un accord sec de tout l’orchestre : c’est le coup de hache du bourreau qui a fait rouler à terre la tête du condamné. Il n’y a plus qu’à conclure par quelques accords majeurs (après tout ce mineur) et par un roulement de tambour. L’effet est saisissant. Tout le morceau d’ailleurs est d’une grande beauté tragique.
V. – RONDE DU SABBAT.
Une symphonie romantique, une Symphonie fantastique ne pouvait mieux se conclure que par une Ronde du Sabbat. Nulle part ailleurs les effets d’orchestration si savoureux dont Berlioz avait le secret n’étaient mieux à leur place. C’est ainsi que le morceau commence par un trémolo des violons divisés en six : grande nouveauté que cette sonorité à la fois frêle et scintillante, grésillante, nouveauté qui surprendra ses premiers auditeurs, combien de fois imitée depuis, ne fût-ce que par Wagner ! Mais ce n’est pas seulement pour ses effets d’orchestre, si attachants qu’ils soient, que je veux admirer ici Berlioz. C’est aussi pour l’effort de composition qu’il a tenté et qu’il a merveilleusement réussi.
Après un prélude d’une couleur on ne peut plus diaboliquement fantastique se présente le thème de la bien-aimée déformé. Elle nous apparaît sautillante, ricanante, triviale, grotesque. « C’est une courtisane. » Le thème originairement à 4 temps, change ici de rythme : il devient un 6/8 vulgaire surchargé des crapuleuses agaceries de petites notes « aguichantes comme des clins d’yeux prometteurs » :

Après une adroite transition au travers de laquelle s’infiltre déjà l’amorce du thème de la Ronde finale :

Voici le Dies iræ burlesque qui débute par le texte authentique du chant liturgique et se termine par une ronde frétillante sur le même thème rythmé à 6/8.

Voici enfin la Ronde du Sabbat qui débute en fugato :

se poursuit par un développement nourri et s’achève par une dernière affirmation du Dies iræ contrepointé par le thème de la Ronde du Sabbat. Berlioz n’avait pas encore construit une pièce d’orchestre aussi solidement échafaudée.
Et, à 26 ans, Berlioz avait écrit un de ses premiers chefs-d’œuvre. Chef-d’œuvre longtemps contesté. Chef-d’œuvre cependant et dont il faut retenir ce qu’en disait Schumann.
Après avoir traité Berlioz d’« aventurier de la musique », et, faisant allusion à ses années d’études de médecine, après avoir ajouté : « Jamais Berlioz n’a disséqué la tête d’un assassin avec plus de répugnance que je n’en ai éprouvé en anatomisant la Ire partie de sa symphonie », Schumann n’hésitait pas à déclarer : « Avec quelle hardiesse tout cela est enlevé ! On ne pourrait absolument rien ajouter ou supprimer sans ôter à l’idée sa tranchante énergie, sans nuire à sa force. » Il entrait alors dans le détail et notait mesure par mesure les harmonies contestables « selon les anciennes règles », ou les harmonies « vagues et indéterminées, qui sonnent mal, qui sont tourmentées, cherchées » et alors il s’écriait : « Puisse l’époque où l’on considérera de tels passages comme des beautés être loin de nous !… Et pourtant, chez Berlioz, tout cela prend un certain air. Qu’on essaie donc de le corriger ou seulement d’y faire une modification quelconque (pour un harmoniste exercé, ce sera un jeu) et l’on verra combien cela deviendra terne. »
Ce que Schumann n’admettait pas, c’était le « programme » de la Symphonie : « On laissera volontiers, disait-il, ce programme à Berlioz ; ces sortes de prospectus ont toujours quelque chose de peu digne. Cela sent trop le charlatan… Les titres eussent amplement suffi. » C’est ce que pensera Liszt et il se contentera des titres pour ses Poèmes symphoniques.
Mais Berlioz ne se fait pas faute d’user de moyens « peu dignes » pour attirer et tâcher de retenir l’attention du public. C’est ainsi qu’il profite d’une occasion, qui lui paraît excellente, de lancer son œuvre nouvelle. Le 5 décembre 1830, l’Opéra doit donner, à 7 heures, une représentation extraordinaire au bénéfice de Harriett Smithson. Le même 5 décembre, au Conservatoire, Berlioz fera entendre, à 2 heures, sa Symphonie fantastique où paraît Harriett d’abord en Ophélie puis en « fille Smithson ». « Tout le monde sait mon histoire », ajouta-t-il.
Donc, le 5 décembre, au Conservatoire, une centaine de musiciens se réunissaient pour exécuter, à titre gracieux, la Symphonie du jeune « Prix de Rome » (Berlioz venait d’obtenir en août 1830, la récompense tellement souhaitée). Au programme, l’ouverture des Francs-Juges, Hymne et Chœur guerrier (des Mélodies irlandaises), Grande scène de Sardanapale et la Symphonie fantastique. En intermède, un solo par Chrétien Uhran, le violoniste mystique. Chef-d’orchestre : Habeneck. Le programme de la Symphonie imprimé sur des feuilles roses ou jaunes, bien voyantes, était distribué dans la salle.
Et quelle salle pour cette première de la Fantastique !
Laissons Adolphe Boschot nous la décrire :
« Les Jeune France, les merveilleux, chevelus, avec la barbe en collier, ou avec les côtelettes (comme Berlioz), ou avec la moustache et l’impériale, tandis que les académiques étaient, comme il convient, chauves et glabres !
« Les Jeune France portaient la redingote de drap vert ou ponceau avec collet de velours sanglée à la taille et laissant flotter d’amples basques. De la cravate noire (bouillonnant comme une turgescence de ténèbres) sortaient les deux pointes du col, aiguës, blanches ; et par l’échancrure de la redingote, dont les larges revers faisaient schall, brillaient des boutons d’or, sur le gilet de poil de chèvre. Le pantalon, tiré par les sous-pieds, était brun, gris ou bleu. D’autres Jeune France portaient l’habit, non pas noir, mais couleur cendre, couleur puce ou « poussière de ruines » ; cet habit, boutonné à la ceinture ; et par-dessus, d’une couleur tranchante ou tout blanc, dépassait le gilet dont on voyait la largeur de deux ou trois boutons…
« Les femmes avaient d’immenses chapeaux. Plus de capotes comme sous la Restauration dévote. Ou, tout au moins, les capotes dégageaient le visage, toutes grandes, relevées, verticales, d’où retombait, flottant, un long voile de blonde. On aimait aussi les grands bérets de gaze, jetés de travers comme une vaste auréole biaise, et qui dardaient une longue aigrette courbe, tandis qu’une vaste plume, à la castillane, caressait, de son duvetis écumeux, la nacre de la nuque toute nue…
« Toutes les formes du corsage développaient, amplifiaient, magnifiaient la ligne retombante des épaules. La mode était d’être mince, élancée, « sylphidique », fluide, – mais dans une grande somptuosité de fanfreluches… »
Devant ce public la Fantastique eut un succès « furieux, effroyable, épouvantable ».
Berlioz avait su se ménager toutes sortes de sympathies et d’admirations. Le « programme » plut.
Le Figaro écrivait : « Cette Symphonie fantastique est la bizarrerie la plus monstrueuse qu’on puisse imaginer… Cinq ou six salves d’applaudissements et de trépignements d’admiration ont dédommagé M. Berlioz des obstacles sans nombre dont la routine a hérissé les premiers pas de sa carrière. »
Et le sage Fétis, dans la Revue musicale, se laissait entraîner quelque peu par l’opinion commune : « Le concert de M. Berlioz, disait-il, avait attiré grand nombre d’amateurs, d’artistes et de curieux. Ce jeune musicien, poussé par son instinct vers une route nouvelle, a de nombreux partisans parmi la jeunesse, toujours avide de nouveautés… C’est une composition fort extraordinaire que cette Symphonie fantastique. Le génie des effets neufs s’y manifeste de la manière la plus évidente, et deux parties (le Bal, la Marche au supplice), annoncent une imagination vaste ; enfin, on y trouve une physionomie individuelle prononcée, en dehors des formes ordinaires de l’art ; mais, en général, cette musique excite plutôt l’étonnement que le plaisir… »
Liszt, présent à cette première audition, était dans l’enthousiasme et en conserva une impression profonde. De force, le célèbre pianiste emmena Berlioz dîner avec lui.
La Fantastique fut vraiment pour Liszt une révélation. Il en écrivit un admirable arrangement pour piano seul. Il s’éprit des idées de Berlioz, à tel point qu’il devint le partisan le plus acharné de la musique poétique et descriptive, de la musique à programme. On sait quels admirables Poèmes symphoniques il devait composer un jour : il en dut la première conception à Berlioz.
1830 ! Grande date dans l’histoire du romantisme français. 1830 ! date de naissance de deux chefs-d’œuvre, Hernani et la Symphonie fantastique. Le premier d’un éclat plus brillant peut-être, le second d’un retentissement plus profond et où l’âme de Berlioz s’est déjà complètement exprimée.
CHAPITRE VII
1831
« ROBERT LE DIABLE » – « ZAMPA »
CHOPIN À PARIS
« Il paraît impossible, écrivait Richard Wagner, en 1842, que dans la direction que Meyerbeer a suivie jusqu’à son sommet suprême, on veuille encore s’avancer plus loin. Nous devons nous attacher à cette opinion que cette dernière époque de la musique dramatique s’est close avec Meyerbeer, qu’après lui, aussi bien qu’après Haendel, Gluck, Mozart, Beethoven, l’idéal, – tel qu’il a été atteint dans chacune de ces périodes à son tour, – doit être regardé comme réalisé et désormais indépassable. »
Meyerbeer mis sur le même rang que Haendel, Gluck, Mozart et Beethoven, et par un artiste comme Wagner, voilà qui a de quoi nous étonner. Il n’en est pas moins vrai que l’apparition des ouvrages de Meyerbeer sur la scène de l’Opéra de Paris fut un événement extrêmement considérable et qui parut à ses contemporains rejoindre en valeur artistique les plus grandes dates de l’histoire de la musique.
À côté de la Symphonie fantastique cependant combien peu compte pour nous Robert le Diable !
Mais tâchons d’expliquer cette extraordinaire illusion !
*
Jacob Beer naquit à Berlin, le 23 septembre 1791. Pour les besoins de sa carrière, il italianisa son prénom qui devint Giacomo et il joignit à son nom l’un des noms de son grand-père maternel Wulf. Il s’appela désormais Giacomo Meyerbeer.
Son père, Jacob Herg Beer, banquier passionné pour les lettres et les sciences, avait un salon très fréquenté. Sa mère, Amalée Wulf, présidait ce salon avec infiniment d’esprit et de distinction. Elle avait, dit-on, un caractère sérieux, d’une sérénité biblique et possédait une sûreté de jugement remarquable.
Giacomo Meyerbeer fut un enfant prodige. À 9 ans, il exécutait en public le Concerto en ré mineur de Mozart. Et déjà, il composait d’instinct.
Il fallut lui trouver un maître. Zelter, l’ami de Gœthe, et Bernard Anselme Weber furent ses premiers professeurs. Mais celui qui lui apprit véritablement son métier fut l’abbé Vogler, alors réputé pour son savoir.
L’abbé Vogler était organiste à Darmstadt. Il exigea que le jeune Meyerbeer prît pension chez lui. « Vous serez reçu chez moi comme mon fils », écrivait-il. Parti assez grave à prendre. Les parents hésitaient. Cependant, le jeune homme avait terminé ses études littéraires, appris cinq ou six langues et « profondément établi ses convictions religieuses ». Sa mère, qui s’était particulièrement attachée à son éducation, fut d’avis de le laisser partir. Il partit donc. Il avait 18 ans.
Auprès de l’abbé Vogler, Meyerbeer eut pour condisciple Weber, le futur auteur du Freischütz, avec lequel il se lia d’une amitié solide et auprès duquel il trouva toujours un soutien précieux.
Meyerbeer fit ses débuts en public comme compositeur avec un oratorio Dieu et la Nature qui obtint un vrai succès à Berlin (8 mai 1811) et fut repris dans différentes villes d’Allemagne.
Un opéra biblique en 3 actes, le Vœu de Jephté, eut une fortune beaucoup moins heureuse.
Après divers essais qui eurent des destins divers, il aborda la carrière de pianiste où il remporta de véritables triomphes.
Mais il songeait toujours à la composition et surtout au théâtre où il n’avait pas réussi à son gré jusque-là. Salieri lui donna le conseil d’aller respirer l’air de l’Italie.
L’Italie l’enchanta et tout particulièrement la musique de Rossini. Ce brillant, cette facilité, cette mélodie coulante et dominatrice, tout cela le changeait de la lourde polyphonie dans laquelle il avait vécu jusque-là empêtré.
Il conçut tout de suite le moyen de concilier la sévérité de l’art allemand avec l’agrément et la légèreté de l’art italien et de faire de ce mélange son invention propre.
Mais il prit son temps. Ce n’est qu’au bout de deux ans de séjour sur la terre italienne qu’il fit représenter son premier opéra italien Romilda e Costanza (1818). Tout de suite, grand succès. Même accueil l’année suivante pour Semiramide riconoscinta. Mais en 1820, le public se montre encore plus favorable pour Emma di Resburgo, à Venise, et pour Margherita d’Angiù, à la Scala de Milan. Les deux opéras ont la vogue non seulement en Italie, mais, par des traductions, en France et en Allemagne.
Seul l’ami Weber n’était pas content. Il aurait voulu que Meyerbeer consacrât tout son talent à faire briller l’art de son pays. Comment, disait-il, « un artiste allemand, doué d’une force créatrice aussi énorme, pouvait-il gagner le misérable succès de la foule, se ravaler au rang d’imitateur ? Était-il donc si difficile, sinon de repousser le succès immédiat, du moins de ne pas le regarder comme l’idéal suprême ? » Et pour compenser le triomphe d’Emma di Resburgo, à Dresde, en 1820, il obtenait que, sur la même scène, on reprît une œuvre allemande de Meyerbeer créée à Prague en 1815, Abimelek, sous le titre nouveau de Hôte et convive. Et à ce propos, il écrivait un long article qui se terminait ainsi : L’auteur des deux ouvrages « nous a donc démontré là que son talent a beaucoup de faces et qu’il peut être original, puisqu’il réussit ce qu’il « veut ». Mais si le rédacteur de cet article pouvait formuler un souhait, ce serait que M. Meyerbeer, à présent qu’il a étudié l’art dans ses manifestations variées et selon le goût des nations auxquelles elles sont destinées, à présent qu’il a fait l’épreuve de sa force comme de la souplesse de son talent, revienne se fixer dans la Patrie allemande, et qu’il s’emploie à son tour, parmi quelques vrais fidèles de l’art, à poursuivre l’établissement définitif de cet opéra national allemand, qui veut bien prendre des leçons à l’étranger, mais à condition de rendre ce qu’il a appris transformé « en vérité et en individualité ». Ce n’est qu’ainsi que sera affermi enfin, parmi les nations d’art, ce rang dont Mozart a placé l’inébranlable fondement dans l’opéra allemand. »
Weber avait mis le doigt sur la plaie : l’amour du succès devait éloigner de plus en plus le jeune Meyerbeer de l’idéal qui était celui de son ami et que celui-ci avait déjà si merveilleusement contribué à réaliser.
Meyerbeer, malgré les avis de Weber, continue sa carrière italienne avec l’Esule di Granata (1822) et Almanzer destiné à Rome. Mais subitement, le jeune compositeur est obligé de quitter l’Italie. Les atteintes d’un mal dont il souffrit toute sa vie le forcent à prendre les eaux de Spa, puis de passer à Berlin tout l’hiver de 1822-23. Ce séjour dans son pays l’incite à écrire un opéra allemand : la Porte de Brandebourg, qui ne fut d’ailleurs pas représenté.
Mais il songeait déjà à une nouvelle expérience. Non content de ce qu’il avait appris des maîtres allemands puis des exemples italiens, il voulait s’instruire maintenant auprès des Français et faire dans ses œuvres la synthèse des trois styles, fondant ainsi une méthode musicale nouvelle : l’éclectisme.
Le 5 juillet 1823, il écrivait, de Milan, à Levasseur, la célèbre basse, son interprète, à Paris, dans Marguerite d’Anjou[7] : « … J’ai été bien flatté du passage de votre lettre dans lequel vous me parlez de la bonne opinion que M. le Directeur de l’Opéra français veut bien avoir de mes faibles talents. Vous me demandez s’il serait sans attrait pour moi de travailler pour la scène française, je vous assure que je serais bien plus glorieux de pouvoir avoir l’honneur d’écrire pour l’Opéra français que pour tous les théâtres italiens (sur les principaux desquels, d’ailleurs, j’ai déjà donné de mes ouvrages).
« Où trouver ailleurs qu’à Paris les moyens immenses qu’offre l’Opéra français à un artiste qui désire écrire de la musique vraiment dramatique ? Ici (en Italie), nous manquons absolument de bons poèmes d’opéras, et le public ne goûte qu’un seul genre de musique. À Paris, il y a d’excellents poèmes et je sais que votre public accueille indistinctement tous les genres de musique, s’ils sont traités avec génie. Il y a donc un champ bien plus vaste pour le compositeur qu’en Italie. Vous me demanderez peut-être pourquoi, avec cette manière de voir, je n’ai pas tâché d’écrire pour Paris. C’est parce qu’on nous représente ici l’opéra français comme un champ hérissé de difficultés, où il faut ordinairement attendre de longues années avant de se faire représenter, et cela fait peur. Je vous avoue aussi que j’ai été gâté peut-être sur ce point en Italie, où l’on a bien voulu jusqu’à présent me rechercher, quoique je confesse que c’est plutôt par l’excessive indulgence du public envers moi, que pour mon très faible mérite… »
Donc, dès 1823, Meyerbeer pensait essayer de se faire jouer à Paris. Paris était alors la capitale du monde musical. C’est là qu’on obtenait les succès les plus décisifs. C’est, là qu’il fallait se faire connaître.
Quoi que Meyerbeer en pût dire, la place était libre. La tragédie lyrique se mourait. Auber n’avait pas encore ouvert la voie à l’opéra historique ou légendaire avec la Muette de Portici. L’école française n’était guère représentée que par des auteurs d’opéras-comiques, notamment Boieldieu, Paër, Hérold.
En attendant, Meyerbeer écrit pour Venise et y fait représenter, le 26 décembre 1824, il Crociato in Egitto (le Croisé), dont l’immense succès sur toutes, les scènes d’Italie se continua à Londres, à Paris, en Russie, en Amérique et jusqu’au Brésil, sans compter (dans une traduction allemande) en Allemagne. C’est la première partition de Meyerbeer qui compte vraiment et qu’il compte lui-même. Il laisse tomber, en effet, le souvenir de ses ouvrages italiens, sans se défendre pourtant d’y puiser l’occasion des motifs. Weber lui-même « accepta » il Crociato.
L’œuvre restait cependant encore italienne à certains égards, ne fût-ce que pour son abus de la mélodie recherchée pour elle-même indépendamment de la vérité des caractères et des situations. Le rôle principal était dévolu à un sopraniste, c’est-à-dire qu’il exigeait dans les autres pays un travesti-femme bien hors de propos. Certains passages, les récitatifs, notamment, appartenaient bien à Meyerbeer.
Les années 1825 et 1826 apportèrent à Meyerbeer deux deuils cruels, la mort de son père d’abord, en 1825, celle de Weber, si prématurément emporté, à Londres, en juin 1826, après le triomphe d’Obéron. Meyerbeer en conçut un profond chagrin. En 1827, il se maria avec sa cousine germaine, Mina Mosson. Ses deux premiers enfants moururent coup sur coup. Ces nouveaux deuils affectèrent profondément Meyerbeer très sensible à tout ce qui intéressait la vie de famille. Sa veine musicale en fut pour un moment tarie.
Cependant, il avait paru, à Paris, en 1826 et 1827. Il y revint en 1829 ou 1830, entrant en relation avec les artistes célèbres, fréquentant les concerts, les théâtres, les bibliothèques où il consultait les partitions des anciens opéras français depuis Lully. Il rêvait d’un opéra-comique pour cette scène française où ce genre de spectacle se trouvait si vivement apprécié du public. On lit dans le Journal des Débats du 1er mai 1827. « Il y a quelques jours, le comité de lecture du théâtre Feydeau a reçu à l’unanimité un opéra-comique en 3 actes dont le titre est Robert le Diable, sur lequel l’administration fonde les plus grandes espérances. Les paroles sont attribuées à deux auteurs dont l’association a été constamment heureuse, MM. Scribe et Germain Delavigne. La musique en est confiée à un compositeur, M. Meyerbeer, qui, après s’être acquis en Allemagne et en Italie une réputation éclatante, l’a étendue dans notre patrie, où plusieurs de ses ouvrages ont déjà été représentés avec un succès soutenu (en italien). »
Donc Robert le Diable était d’abord un opéra-comique. Cela nous explique le caractère mélangé de l’œuvre définitive.
Les librettistes ne se résolurent pas facilement aux modifications réclamées par Meyerbeer.
Après bien des hésitations et des retouches successives, ils arrivèrent à satisfaire le compositeur et à faire de leur ouvrage un opéra en 5 actes.
La Révolution de Juillet vint interrompre les pourparlers avec le directeur de l’Opéra qui fut mis à pied et remplacé par le docteur Véron.
« Jamais, non jamais, déclare Charles de Boigne dans ses Petits Mémoires de l’Opéra, on ne saura ce que les répétitions ont coûté d’insomnies, de terreurs, de défiances, de travail, de désespoir même à Meyerbeer. Il avait l’œil à tout, il pensait à tout, il surveillait tout : poème, musique, mise en scène, décoration, costumes, chant et danse. »
Le docteur Véron ne lésinait pas sur les frais qui devaient contribuer à l’éclat du spectacle. Mais les dépenses supplémentaires afférentes à la réalisation de la musique lui paraissaient toujours superflues : C’est ainsi que Meyerbeer dut payer de ses deniers la location d’un orgue qui lui semblait nécessaire au dernier acte.
La 1ère représentation eut enfin lieu le 21 novembre 1831.
Le succès fut « complet, énorme, exceptionnel ».
Le public était grisé. Il sentait une ère nouvelle s’ouvrir pour le théâtre musical. C’était du moins ce qu’on pensait alors, et en un sens on ne se trompait pas, car, pour de longues années, Meyerbeer allait régner sur l’Opéra de Paris, s’imposant à tous avec une force étrange.
Ce qui plaisait au public, c’était d’abord le livret, qui nous paraît aujourd’hui ridicule, mais dont l’immodérée couleur romantique séduisait tous les esprits, malgré ses invraisemblances inouïes, quand ce ne serait que la naissance de ce duc de Normandie, Robert, le personnage principal du drame, exilé en Sicile, fils de l’union du diable Bertram, favori de Satan et de la princesse Berthe, – quand ce ne serait que l’inconvenante invention de ces Nonnes qui sortent de leur tombeau pour danser un ballet.
Mais parcourons rapidement cette action et tâchons d’en débrouiller la présentation vraiment bien confuse.
Au début du 1er acte, nous voyons paraître le personnage accessoire de Rimbaud qui arrive de Normandie chargé d’un message pieux pour Robert. Il commence par chanter une sorte de ballade qui conte l’origine et les aventures de Robert le Diable.
Robert est donc le fils d’un démon et il a, dès sa jeunesse, agi en Normandie comme un chenapan, volant, pillant, troussant les filles. C’est sa conduite abominable qui lui a valu son exil.
Or, Robert est là, qui écoute son vassal, sans que celui-ci s’en doute, et, pour le punir de son insolence, il le condamne à être pendu.
Mais Rimbaud a amené en Sicile une jeune fille, Alice, à laquelle il est fiancé. Dans cette Alice, Robert reconnaît sa sœur de lait. Par son intervention, elle obtiendra la grâce de son fiancé Rimbaud.
Alice apporte à Robert une triste nouvelle : celle de la mort de sa mère, qui l’a chargée d’être auprès de lui « son bon ange » et de lui remettre, le moment venu, c’est-à-dire quand il s’en montrera digne, un certain papier d’où dépend son salut. Robert reconnaît qu’il n’a pas encore l’âme assez pure pour recevoir ce message maternel.
Nous apprenons alors qu’un certain chevalier Bertram, dans un rude combat, a sauvé la vie de Robert. Bertram est resté depuis lors le meilleur ami de Robert. Or Bertram n’est autre que son père, le favori de Satan.
Robert aime la princesse de Sicile, Isabelle, et il en est aimé. Mais la princesse est promise par ses parents au prince de Grenade qu’elle doit épouser dans quelques jours. Or voici qu’Isabelle se lamente parce qu’elle est abandonnée de Robert, et c’est le début du 2e acte.
Survient Alice, qui justement apporte à Isabelle une lettre de Robert l’assurant de sa fidélité et lui demandant à la revoir. Isabelle y consent. Robert sollicite son pardon. Maintenant, il est prêt à provoquer son rival, le prince de Grenade, et à le vaincre.
Mais le prince de Grenade provoque, de son côté, Robert en un tournoi. Robert, égaré par Bertram, attend son rival dans la forêt pour un combat à mort. Il ne se présente donc pas au tournoi. Il est déshonoré.
Rimbaud, rencontre Bertram auquel il confie son désir d’épouser au plus tôt Alice.
Avec mépris, Bertram jette, en cadeau de noce, une bourse à Rimbaud. « Ah ! l’honnête homme ! » s’écrie celui-ci. Mais la nature diabolique de Bertram se manifeste aussitôt. « Avec cette bourse, dit-il, tu pourrais gagner le cœur de bien des femmes et vivre joyeusement. » Voici Rimbaud du même coup retourné, ne songeant plus à épouser Alice, ne pensant plus qu’au plaisir et se félicitant encore une fois d’avoir rencontré Bertram : « Ah ! l’honnête homme ! » – Duo bouffe.
Encore un de gagné pour l’enfer ! Bertram se réjouit. Mais Robert, son fils ? L’a-t-il, lui aussi, définitivement gagné ? Il ne sait ! Robert hésite toujours entre le bien et le mal. Il faut que ce fils lui appartienne enfin tout entier, que ce fils se donne pour jamais à l’enfer. C’est le vœu le plus cher d’un père profondément aimant… Facile romantisme… Et Bertram disparaît. Il s’abîme dans le mystère affreux d’une caverne d’où jaillissent des flammes.
Alice paraît tout éplorée. Elle est délaissée par Rimbaud.
Bertram sort de la caverne. Il nous confie qu’il vient d’entendre prononcer cet arrêt redoutable : « Si, à minuit, tu n’as pas définitivement gagné le cœur de ton fils, tu le perds pour jamais ! » Alice entend ces mots. Bertram, furieux d’être surpris, menace Alice des pires malheurs si jamais elle dévoile le secret qui vient de lui échapper. Elle périra elle-même, et, avec elle, « son amant et son vieux père ». Ainsi « tu n’as rien vu, rien entendu ». – « Rien », répond Alice.
À ce moment, Robert descend de la montagne, ce qui donne lieu au fameux trio sans accompagnement entre Alice, Robert et Bertram.
Resté seul avec Bertram, Robert confiera qu’il est désespéré d’avoir manqué le tournoi auquel il était assigné, et de s’être ainsi déshonoré. Et Bertram lui déclare :
On te tendit un piège,
On trompa ta valeur.
C’est par un sacrilège
Que ton rival a détruit nos projets :
Des esprits infernaux, il employa les charmes.
Que faire ? – Le vaincre par ses armes. – Et Bertram incite Robert à se rendre à l’antique abbaye que le courroux du Ciel abandonne aux enfers. Au milieu des cloîtres déserts s’élève le tombeau de sainte Rosalie. – « Hélas ! funeste souvenir ! s’écrie Robert. C’était le nom de ma mère chérie. » – (Au 1er acte, on nous disait que cette mère s’appelait Berthe. Il faut croire qu’elle portait deux noms, sans quoi ce serait à n’y plus rien comprendre.) Sur ce tombeau, pousse un rameau toujours vert qui donne à celui qui a l’audace sacrilège de le cueillir une puissance mystérieuse et tous les biens de ce monde. Robert devra cueillir ce rameau vert qui lui donnera sur son rival une facile vengeance. En aura-t-il le courage ?
Il répond :
« Des chevaliers de ma patrie, l’honneur toujours fut le soutien, » phrase musicale célèbre.
Changement de tableau. Nous voici dans le monastère. Bertram évoque les Nonnes qui organisent une procession, puis dansent. Elles indiquent à Robert le rameau qu’il doit cueillir. Il le cueille enfin. La foudre éclate. Les nonnes se changent en spectres, les démons sortent des profondeurs de la terre. Robert se fraye un passage à travers ces apparitions fantastiques. Chœur des réprouvés : « Il est à nous. » Fin du 3e acte.
Au début du 4e acte, Alice, se souvenant des paroles de Bertram au sortir de la caverne, vient prévenir Isabelle à mots couverts qu’un grand danger menace Robert. Isabelle est entourée de ses femmes et de courtisans, tous fort joyeux. Ils se réjouissent du futur mariage de la princesse avec le prince de Grenade.
Robert paraît au fond de la scène portant son rameau vert. Tous portent la main au front comme frappés d’un coup invisible, puis peu à peu s’endorment. Pour Isabelle seule, Robert rompt le charme magique. Elle s’éveille. Robert jette sur celle qu’il aime toujours et qu’il veut enlever des regards enflammés qui l’effraient. Isabelle voulait que sa main fût le prix d’une victoire gagnée avec honneur dans un tournoi. Elle refuse de céder maintenant à la violence. Robert s’emporte. Isabelle lui demande grâce. « Tu ne veux plus de mon amour, s’écrie Robert. Alors, cruelle, prends donc ma vie. Plutôt mourir… Plutôt la mort sous leurs coups. » Et il rompt le rameau vert. Alors toute la cour endormie peu à peu s’éveille. On se saisit de Robert, et l’on menace du trépas ce « guerrier téméraire ».
Au 5e acte, la scène représente un lieu saint qui sert d’asile aux malheureux et aux repentants. Un chœur de moines invite les fidèles à prier. Robert s’est réfugié là. Bertram l’y accompagne. Robert a cherché à retrouver son rival. Il a eu avec lui un combat dans lequel il a été vaincu. Il cherche un moyen de reconquérir Isabelle. Bertram lui en fournit un. C’est de signer un pacte avec l’enfer. Robert accepte de signer « l’écrit redoutable » que lui tend Bertram. Mais au moment où il va s’engager, retentit à l’orgue un doux chant de piété qu’autrefois chantait sa mère. Il est ému. Il hésite. Il voudrait pouvoir prier.
Mais d’un mot, Bertram ranime sa rage contre son rival, contre son ennemi, contre le prince de Grenade. Et pour emporter définitivement un triomphe encore douteux, Bertram avoue à Robert qu’il est son père, qu’il fut l’amant, l’époux de Berthe-Rosalie ; le récit de Rimbaud que Robert avait cru menteur n’était que trop vrai.
Et maintenant Bertram laisse Robert libre de décider de son sort. Il restera à son père ou l’abandonnera pour jamais.
Mais Alice apporte une nouvelle imprévue. « Le prince de Grenade et son brillant cortège n’ont pu franchir le seuil du lieu saint. Et la noble princesse, à votre amour ravie, vous attend à l’autel ! » Tout cela est bien peu clair. Mais passons.
Voici le grand trio final. Bertram présente à Robert l’« écrit redoutable » par lequel, s’il le signait, il se damnerait éternellement. Alice lui lit un autre écrit qui contient les dernières volontés de sa mère. Elle lui ordonne de fuir « les conseils audacieux du séducteur qui l’a perdue ». Robert, toujours indécis, ne sait qui entendre. Mais minuit sonne. Robert n’a pas signé « l’écrit redoutable » que lui tend en vain Bertram. Il est sauvé.
Le théâtre est couvert de nuages. Le tonnerre gronde.
Les nuages se lèvent et l’on voit l’intérieur de la cathédrale de Palerme, remplie de fidèles : la princesse Isabelle entraîne Robert vers l’autel.
Gloire à Dieu ! Chœur final.
Nous avons tenu à exposer tout au long cet interminable livret, surchargé de détails inutiles, obscurs, invraisemblables. Il fallait montrer de quoi se contentaient les auditeurs de 1831. Ils ne se contentaient pas seulement de pareilles fadaises. Ils en étaient enthousiastes et Scribe passait à leurs yeux pour un grand homme. Une intrigue si vainement compliquée suffisait à leur goût du merveilleux, du surnaturel, du fantastique, goût bien peu exigeant, goût bien « bourgeois », au plus mauvais sens du mot. Nulle trace de sentiment artistique dans ces inventions saugrenues. Pas une situation clairement établie, pas un caractère nettement dessiné. Ce Bertram et ce Robert ne sont que des fantoches dont on ne sait même pas ce qu’ils pensent ou ce qu’ils sentent au juste. Mais des grands mots, exprimant de prétendues grandes passions, donnent lieu à des scènes mouvementées. Des imaginations bizarres prêtant à des décors et à une mise en scène d’un éclat étrange et frappant. C’est tout ce que Meyerbeer réclamait de son librettiste.
Et la musique ?
La musique a son mérite indéniable. Elle a de la force et du mouvement. Elle est brillante et colorée, d’une instrumentation recherchée. Mais elle reste constamment superficielle. Jamais elle n’atteint les profondeurs du sentiment. Elle n’obtient l’effet que par des moyens qui sont gros et quelquefois grossiers.
La partition s’ouvre par un chœur d’une banalité outrageante : « Le vin, le jeu, le vin, le jeu, les belles, voilà nos seules amours ! » La ballade de Rimbaud, qui suit, est d’une rare platitude. La romance d’Alice ne vaut guère mieux. Et tout ce début serait vraiment par trop décourageant si la Sicilienne que chante Robert ne venait pas relever un peu le ton de cette musique négligée :

L’air d’Isabelle au 2e acte paraît bien ordinaire, et l’acte entier ne présente guère plus d’intérêt.
C’est au 3e acte seulement que l’on commence à rencontrer les morceaux de quelque valeur : d’abord le duo bouffe, un peu lourd d’ailleurs, entre Rimbaud et Bertram, puis la valse infernale avec les répliques passionnées de Bertram : ces pages ont de l’élan, de la couleur, de la vie : on est emporté malgré soi.
Ensuite, les couplets d’Alice : « Quand je quittai la Normandie », ne manquent pas d’une certaine grâce.
Vient le duo d’Alice et de Bertram qui est assez réussi :

On remarquera que le thème de ce duo ressemblerait assez à celui d’une sonate ou d’une symphonie de Haydn ou de Mozart. C’est un cas assez fréquent chez Meyerbeer. Les souvenirs des classiques abondent chez lui et il construit volontiers des pièces de chant sur des motifs symphoniques. Ce duo se termine par une longue cadence en vocalises du soprano et de la basse. Tout du long de la partition, on rencontre ces effets de virtuosité hérités de l’école italienne et qui supposent de la part des interprètes d’alors une technique très développée, absolument inconnue à la plupart de nos chanteurs et de nos chanteuses d’aujourd’hui.
Le Trio sans accompagnement qui suit, entre Alice, Robert et Bertram, est d’une remarquable écriture. La mélodie médiane sonne très joliment, avec grâce et douceur :

La phrase de Robert :

a de l’allure. Jadis, c’est là qu’on attendait le ténor. Il devait montrer, dans ce début de thème, de quoi il était capable, et, s’il en avait la force et l’adresse, il ne manquait pas de soulever la salle.
La scène de l’évocation des Nonnes est d’une grandeur un peu vide. Mais la procession des Nonnes est un des meilleurs morceaux de la partition.

Le duo des bassons, dans le milieu du morceau, sonne d’un timbre ironiquement funèbre, bien en situation.
En revanche, la Bacchanale ne vaut rien. Mais je ne déteste point la phrase des violoncelles, vraiment mélodieuse (3e air du ballet, séduction par l’amour).
À l’acte suivant, le duo de Robert et d’Isabelle est assez dramatique. Il se termine par cette phrase d’une fougue tout italienne :

Meyerbeer ne craint pas le mélange des styles.
Le 5e acte, assez court, renferme l’important trio entre Alice, Robert et Bertram, construit sur trois motifs bien assis qui, par leurs caractères divers, se font mutuellement valoir : On notera le grand effet de crescendo dans l’unisson sur le 3e motif, qui annonce le crescendo des Huguenots dans la Bénédiction des Poignards, avec des moyens d’ailleurs infiniment plus restreints :

Nous n’imaginons pas aujourd’hui ce que put être le succès de Robert le Diable, et non seulement à Paris, mais sur toutes les scènes des deux mondes. Cet opéra fut traduit et joué dans une dizaine de langues. À Paris, il eut pour interprètes, Mlle Dorus (Alice), Nourrit (Robert), et Levasseur (Bertram). Trois grands artistes. Ajoutons que la Taglioni dansait l’abbesse damnée.
Aujourd’hui, Robert le Diable est presque absolument oublié. On ne le joue plus nulle part. Je n’ai pu le voir représenté qu’une fois à l’Opéra de Paris. Mais dans mon enfance, tous les amateurs de musique en connaissaient par cœur les principaux motifs. Dans ma famille, j’en entendais continuellement chanter les scènes les plus saisissantes. Je retrouvais le souvenir de ces auditions intimes en feuilletant, il y a quelques jours, la partition, et c’est tout juste si je n’étais pas près du même enthousiasme que dans mes jeunes années. Je devais lutter contre la force renaissante des impressions passées pour conserver la liberté de mon jugement et mon sens critique.
Ce qui est certain, c’est que Robert le Diable marque le point de maturité du talent de Meyerbeer. Il possède désormais tous les moyens, si l’on peut dire, de son art. Si Robert le Diable ne garde pas dans la mémoire des hommes la même réputation que les Huguenots ou que l’Africaine, c’est à la faiblesse de son livret qu’il le doit.
Henri de Curzon éprouve une prédilection pour cette partition dans laquelle, si l’on ne tient pas compte de l’inconsistance du livret, Meyerbeer « a trouvé, selon lui, la plus haute expression de son style dramatique ». Mais comment éliminer la considération de la qualité du livret ? Comment parler de l’« accent sincère », – plus sincère que partout ailleurs, semble dire notre auteur, – en présence de situations et de caractères absolument faux ? Comment être sincère en traduisant les invraisemblables sentiments d’un Bertram ou d’un Robert ? Meyerbeer se montre éloquent, certes, mais d’une éloquence qui n’a pas d’objet, qui s’exerce à vide, qui n’est que le procédé d’une toute puissante rhétorique. Cela ne nous suffit pas.
En tout cas, Meyerbeer pouvait être satisfait. Il était déjà compté comme l’égal des plus grands maîtres de l’art musical. De retour à Berlin, il recevait de son souverain le titre de Kappelmeister de la Cour. À Paris, la Croix de la Légion d’honneur, et, un peu plus tard, la place de membre étranger de l’Académie des Beaux-Arts lui témoignaient « l’estime où le tenaient et la cour et la ville ».
*
L’année 1831 vit naître à l’Opéra-Comique une œuvre qui, sans égaler le triomphe de Robert le Diable, eut un assez grand retentissement, Zampa de Ferdinand Hérold.
Zampa n’est pas un chef-d’œuvre : il s’en faut, mais c’est la première manifestation d’importance de l’auteur du Pré-aux-Clercs et témoigne tout de même d’un certain génie.
Louis-Joseph-Ferdinand Hérold était né à Paris, en 1791. Son grand-père était organiste à Seltz, en Alsace. Son père, dont l’éducation musicale s’était faite en Allemagne auprès de Charles-Philippe-Emmanuel Bach, enseignait le piano à Paris depuis 1781. Ferdinand Hérold fit ses études au Conservatoire où il fut l’élève de Méhul, obtint en 1812 le Prix de Rome et partit pour l’Italie où il connut Paisiello et Zingarelli. Au printemps de 1815, il quitta l’Italie et se mit en route pour Vienne. Mais il était si pénétré de musique italienne qu’il ne sut tirer aucun parti de son séjour dans la capitale de l’Autriche. C’est ainsi qu’il ne rendit pas même visite à Beethoven pour lequel il avait une lettre d’introduction. Et voici les jugements étranges qu’il portait sur Mozart : « J’ai entendu la musique de Mozart à Paris, à Naples, à Vienne, et, plus je l’entends, plus je me convaincs qu’elle fait mieux au piano qu’au théâtre. » À Naples, la musique de Figaro « lui avait paru un peu cuivrée ». Il avoue qu’à Vienne elle lui « a paru seulement très harmonieuse ». Tout de même, la Flûte enchantée le convertit : « Je viens d’entendre la Flûte enchantée et elle m’a moi-même enchanté. La musique est vraiment délicieuse. »
Son goût reste d’ailleurs très indécis. Il écrit : « Ce n’est pas que le séjour de Vienne m’ennuie ; mais il n’est pas très utile d’y rester longtemps. Autant je suis satisfait d’avoir pu étudier le goût allemand, en quittant l’Italie, autant je reconnais qu’il serait dangereux peut-être d’entendre exclusivement cette musique serrée qui parle toujours aux oreilles et à l’entendement et jamais à l’âme. Les opéras modernes qui me font le plus de plaisir sont ceux de Girowetz. Les ouvrages de Weigl sont des chefs-d’œuvre de contrepoint ; mais je n’y trouve point ce que je cherche actuellement dans la musique. Les morceaux d’ensemble en sont d’une facture excellente ; mais où est l’esprit de la musique italienne ? Ah ! j’ai dit autrefois bien du mal de la musique italienne ; je reconnais mes torts tous les jours davantage. Certes, l’orchestre italien est quelquefois bien pauvre dans notre manière de parler. Mais en quoi consiste la richesse d’une musique ? Est-ce dans la manière de traiter les idées, ou dans les idées elles-mêmes ? » Cette dernière réflexion n’est point, après tout, si sotte et témoignait du désir de mieux comprendre son art.
À son retour à Paris en août 1815, il continuait à chercher sa voie et semblait plus près de la trouver. Il écrivait en effet : « De toutes les musiques, celles qui me touchent le plus, c’est la musique de Mozart et celle de Grétry, les deux contraires. Ce sont là mes deux hommes (peut-être après Salieri). Je ne parle pas de Gluck. J’ai été élevé avec sa musique et je ne puis m’en rapporter à l’impression qu’elle produit en moi. Alceste m’a beaucoup ennuyé dernièrement. »
Nous lisons d’autre part, sur un petit calepin daté de Vienne 1815, et intitulé : Cahier rempli de sottises plus ou moins grandes, rassemblées en forme de principes par moi, des notes comme celle-ci : « Tâcher de prendre un juste milieu entre la musique vague de Sacchini et la vigueur de Gluck. – Penser souvent à Mozart, à ses beaux airs de mouvement.
« Quand les paroles ne disent rien ou peu de chose, ce qui arrive souvent, il faut faire un joli chant dans l’orchestre avec les violons, à l’italienne, le répéter dans plusieurs tons, bien moduler, et entrecouper de plusieurs phrases à l’unisson. Ceci fait beaucoup d’effet, surtout dans les morceaux d’ensemble.
« Trouver des chants naïfs. »
Plus tard, Hérold dessinera le plan d’un grand opéra tel qu’il le rêve et, par avance, ce sera celui de l’opéra tel que le concevra Meyerbeer :
« Pour un grand opéra en 5 actes, je voudrais :
« 1er Acte. – Court, sans grande emphase : peu ou point de divertissement, mais un intérêt de curiosité. Des occasions de joli chant et un bon finale.
« 2e Acte. – Déjà plus de grandiose. Un peu de danse, d’une autre couleur que le 1er acte. Un morceau de chant brillant : un finale de grand caractère. L’acte court.
« 3e Acte. – Dès le commencement, une immense décoration. Ici la plus grande pompe ; de grands divertissements ; des pas de 12, de 20, de un, de deux. Une revue ; des chevaux. Une musique de régiment sur le théâtre, nouveau moyen, peu usé. Pour le chant, c’est égal : comme on voudra. L’acte long et amusant.
« 4e Acte. – Très court, 3 scènes. – Du pathétique, de la vigueur : oppositions de masse et de couleur : fin originale.
« 5e Acte. – Court aussi, mais à deux décorations, ou du moins avec un tableau final de grand effet. Quelques chants faciles et agréables. Fin dans les mains du peintre, du machiniste et du directeur. »
Exposé net, judicieux et prophétique des exigences du grand opéra tel qu’on allait bientôt le concevoir.
Mais Hérold songeait bien plus à l’opéra-comique qu’à l’opéra, et dans ce genre qui lui convenait mieux, il écrivit de nombreux ouvrages qui avec des fortunes diverses ne réussirent jamais à placer Hérold à son véritable rang. Zampa tint enfin tout ce que promettait son talent. Zampa, quoique représenté sur la scène de l’Opéra-Comique, n’est pas une œuvre de joie et de gaîté, c’est un opéra romantique, dont l’élément fantastique va presque jusqu’au tragique.
Chef de pirates, Zampa est une sorte de don Juan au petit pied, fier sacripant d’ailleurs comme le héros de Tirso de Molina. Il a obligé une jeune fille, fiancée à un homme qu’elle aime, à l’épouser lui-même pour sauver la vie de son père qu’il a fait prisonnier. Au cours d’une orgie, Zampa a la fantaisie de passer son anneau de fiançailles au doigt de la statue d’une jeune vierge. Lorsqu’il veut reprendre l’anneau, la statue ferme la main. Zampa, un instant troublé, n’en poursuit pas moins les apprêts de son mariage avec la belle Camille ; et bientôt ont lieu les noces. Mais le soir venu, lorsque Zampa revendique ses droits d’époux, Camille échappe à son étreinte et s’enfuit. Il la poursuit, mais au lieu de l’atteindre, il rencontre la statue vengeresse qui le saisit dans ses bras et l’entraîne avec elle dans les profondeurs de la terre. Quelques épisodes bouffons, dus à la présence d’un couple comique, traversent cette action dramatique.
La musique traite ce sujet étrange dans le style de l’époque qui peut nous paraître suranné, mais qui renferme cependant de bonnes parties. L’ouverture d’abord, longtemps restée au répertoire des musiques militaires, est un véritable chef-d’œuvre. Elle est bâtie sur trois thèmes d’excellente venue tous trois, le premier d’un entrain trépidant,

le second, sur le ton d’une prière fervente :

le troisième, gracieux et léger :

La partition elle-même renferme notamment une page saisissante, quoique d’une composition très simple, le quatuor de l’entrée de Zampa et d’autre part, une charmante mélodie, longtemps célèbre :

C’est le 3 mai 1831 qu’eut lieu la première représentation de Zampa interprétée par Chollet (Zampa), et Mme Casimir (Camille). Chollet avait à peu près la même étendue de voix que le baryton Martin, mais non pas le même timbre. Martin en effet, était un baryton ténorisant (il donnait jusqu’au contre-ut, en voix de tête bien entendu), tandis que Chollet était un ténor barytonnant. C’était d’ailleurs un excellent chanteur en même temps qu’un parfait comédien. Le rôle de Zampa fut tenu, après Chollet, à l’Opéra-Comique tantôt par des ténors tels que Masset, Barbot, Montaubry, tantôt par des barytons tels que Soulacroix, Melchissédec, Maurel, etc., tantôt par des artistes comme Lhérie dont la voix tenait à la fois du ténor et du baryton. J’ai entendu pour ma part, dans ce rôle, Soulacroix qui s’y montrait tout à fait remarquable. Soulacroix était une sorte de baryton Martin, au timbre délicieux, mais à la voix toujours appuyée, ce qui le distinguait de son devancier.
Zampa ne s’est pas maintenu au répertoire de l’Opéra-Comique. Et il faut bien avouer que, malgré d’heureux moments, l’œuvre ne vaut pas le Pré-aux-Clercs du même auteur, dont nous aurons à nous occuper bientôt. Mais elle marque le goût d’une époque et c’est pourquoi nous lui avons fait une place dans ce chapitre.
*
Lorsqu’à la fin de 1831, Chopin arrivait à Paris, il y trouvait établis en pleine gloire, Auber et Rossini. Meyerbeer venait d’y donner son Robert le Diable, Hérold son Zampa[8].
Chopin était un musicien d’une autre trempe, un des plus grands qu’on ait jamais connus, quoiqu’il n’ait usé que de moyens restreints et n’ait presque rien écrit que pour le piano. Mais quelle merveilleuse inspiration, tour à tour douce, caressante, forte et prenante, toujours profonde ! La musique coule en lui, coule de lui, comme d’une source abondante et inépuisable, et se répand en un flot tout-puissant.
Chopin n’est pas Français, mais nous verrons bientôt les raisons diverses pour lesquelles il appartient un peu à la France, quand ce ne serait que parce qu’il choisit notre pays pour y vivre la plus grande partie de sa vie et y cultiver son art.
Frédéric Chopin était né le 22 février 1810 à Zelazowa-Wola, près de Varsovie. Son père, d’origine lorraine (il était venu de Nancy en Pologne), et peut-être fils naturel d’un gentilhomme polonais (mais ce n’est pas sûr), était précepteur du fils unique de la comtesse Skarbek. Sa mère, Justine Krzyzanovska, était polonaise.
Les plus lointains souvenirs de Frédéric Chopin étaient ceux de la maison natale et aussi ceux du petit village de Szafarnia où il passait ses vacances, errant souvent, rêveur, dans la campagne, s’arrêtant à la porte des auberges pour écouter un violoneux raclant quelque mélodie populaire ou la chanson d’un paysan, ou bien il regardait les paysans danser…
Plus tard, Nicolas Chopin, son père, se transporte à Varsovie, où il enseigne le français au Lycée et à l’École militaire préparatoire.
À 8 ans, Frédéric Chopin se faisait applaudir comme pianiste dans un concert de bienfaisance.
En 1827, il commençait des tournées à travers l’Europe. Celle de 1829 fut particulièrement brillante et fructueuse.
Le 1er novembre 1830, il quittait Varsovie pour n’y point revenir quelques jours avant l’insurrection polonaise qui éclatait le 29 novembre, d’abord triomphante, brisée quelques mois plus tard dans le sang.
Chopin, qui avait le pressentiment de ne plus jamais revoir sa patrie, emportait avec lui un souvenir du pays natal qui ne le quitta jamais : une poignée de terre dans une coupe d’argent offerte par des amis.
Derrière lui, il laissait un premier roman d’amour. La cantatrice Constance Gladkowska, de l’Opéra de Varsovie, lui avait inspiré une violente passion qu’il exprima dans le Larghetto du 1er Concerto pour piano en fa mineur. Dans une lettre datée de Noël 1830, il écrivait à son intime ami Johann Matuszynski : « Dis-lui que tant que battra mon cœur, je ne cesserai de l’adorer. Dis-lui qu’après ma mort, mes cendres devront être jetées sous ses pas. Mais ce n’est pas assez : tu peux de moi lui dire bien davantage ! »
Il arrive à Paris.
Les premiers mois furent très maussades. Il habitait 27, boulevard Poissonnière, un petit logement au quatrième étage. De sa fenêtre, il suivait les évolutions de la foule. Il s’amusa d’abord de tout ce mouvement, des appels des camelots, des cris des vendeurs de journaux, des gestes gouailleurs et des réparties goguenardes des gamins.
Mais ce spectacle eut bien vite fait de le lasser. Et puis, cette gaîté était un peu faubourienne ; elle manquait de ce raffinement, de cette distinction si nécessaires à Chopin.
Il était loin de sa famille, de ses amis, de Constance Gladkowska !
Chopin cherchait à se faire connaître. Mais, malgré toutes sortes de lettres de recommandation, c’était long, bien long !
On ne venait pas à lui. Il restait ignoré.
Enfin, son premier concert eut lieu le 26 février 1832, à la salle Pleyel. Ce fut le très grand succès. Il fut acclamé. D’emblée, on reconnaissait en lui le grand artiste.
Mais sa situation, au point de vue financier, restait déplorable. Le temps passait. La gêne persistait. Il songeait à quitter Paris pour Londres ou pour l’Amérique.
Le hasard d’une rencontre le tira d’embarras.
Le prince Valentin Radziwill le conduisit en soirée chez le baron James de Rothschild. Ce fut une ovation délirante dans ce salon où son jeu, comme sa personne, furent hautement appréciés. Le lendemain, les demandes de leçons pleuvaient.
Voici Chopin le virtuose préféré des salons et le professeur à la mode.
Dans les milieux aristocratiques on appréciait au plus haut point l’extraordinaire virtuose, le délicieux compositeur, le séduisant Polonais né pour toutes les grâces, tous les artifices, tous les raffinements étudiés d’une des sociétés les plus polies du monde.
Il avait les yeux bruns, le regard spirituel, le sourire doux et fin, les cheveux bruns aussi, très soyeux, le teint transparent. Le nez long et presque crochu déparait seul un charmant visage. Les membres étaient frêles, les gestes gracieux, la voix un peu assourdie et presque étouffée. Toutes ses manières avaient une particulière distinction et Liszt termine par cette jolie phrase un portrait qui peint admirablement l’homme : « Toute son apparence faisait penser à celle des convolvulus, balançant sur des tiges d’une incroyable finesse leurs coupes divinement colorées, mais d’un si vaporeux tissu que le moindre contact les déchire. »
Chopin devint bientôt à Paris un des hommes à la mode, toujours ganté de blanc, vêtu de façon recherchée, soucieux des moindres minuties de la parure masculine, depuis le choix des bijoux jusqu’à l’assortiment des cravates ou des cannes.
Cet homme, si répandu, ne se confia jamais complètement à personne. « Les Slaves se prêtent volontiers, mais ne se donnent jamais. » Il gardait en lui quelque chose de secret et de mystérieux qu’il ne livra jamais, sinon par sa musique.
Chopin avait alors 22 ans. Il avait déjà beaucoup composé, notamment les douze premières Études qui datent de sa 19e année.
De 1832 à 1837, Chopin fut parfaitement heureux.
Il avait loué un appartement, 5, chaussée d’Antin. Dans la matinée, il donnait quatre ou cinq leçons qu’il faisait payer vingt francs, un gros prix pour l’époque. Une partie de l’après-midi il travaillait. Puis c’était le tour de l’homme du monde. Il faisait des visites, allait dîner sur les boulevards, et passait la soirée dans un salon ou au théâtre.
Il dépensait tout ce qu’il gagnait, sans compter. Il avait un cabriolet à lui, un cocher à gages. Il invitait fréquemment ses amis au restaurant. Il obligea aussi bien souvent des compatriotes malheureux.
Pendant l’été de 1835, Chopin voyagea en Allemagne. À Dresde, il rencontra Marie Wodzinska, la sœur de ses amis Wodzinski. Il l’avait connue tout enfant. Chopin avait un cœur qui s’enflammait facilement. D’après George Sand, ce n’était pas une, mais cinq, six passions qui le tenaient à la fois. Souvent, dans une même soirée, il s’éprenait de deux ou trois femmes successivement, et, à leur grand désappointement, il les oubliait aussitôt.
Donc Chopin s’éprend de son amie d’enfance Marie Wodzinska. Le voici gai, joyeux, triomphant. C’est une charmante idylle. Il prétend épouser bientôt sa bien-aimée. Il demande sa main. La mère se montre favorable à l’idée de ce mariage pourtant tout à fait disproportionné au point de vue de la fortune. Les Wodzinski possédaient une des plus grosses fortunes de Pologne. Chopin n’avait que son talent. Le père s’opposa net au projet de cette union.
Ce fut un coup terrible pour Chopin.
Il tomba gravement malade.
Il revint à Paris brisé, physiquement et moralement. Il se traînait, lamentable, sans goût de vivre.
Et tout d’un coup voici qu’une simple présentation le remet sur pied. Son imagination travaille, son cœur s’émeut. Un troisième roman s’ébauche dans cette âme mobile. Une passion violente l’attire vers George Sand.
Mais, si vous le voulez bien, attendons que l’heure en soit sonnée. Nous ne sommes qu’en 1831, l’année de Robert le Diable. D’ici là, bien des événements se succéderont dans le monde de la musique, dont il nous faut parler d’abord.
CHAPITRE VIII
DE 1832 À 1835
LE PRÉ-AUX-CLERCS – LE CHALET. – LA JUIVE
L’année 1832 fut celle du choléra. Ce fléau épouvantable s’abattit au mois de mars sur Paris, dont il bouleversa la vie. Coup fatal pour les théâtres. On se demanda si l’existence de l’Opéra-Comique n’allait pas être mise en question. L’émeute des 5 et 6 juin porta le coup de grâce au malheureux théâtre, dont la situation financière était depuis longtemps ébranlée. L’Opéra-Comique dut fermer ses portes. Les artistes montrèrent du courage dans l’adversité. Ils se mirent en société et s’installèrent dans la salle des Nouveautés, place de la Bourse. En septembre, ils ouvraient leurs portes, avec le concours de leur ancien camarade le baryton Martin, qui, retiré depuis quelques années de la scène, n’hésitait pas à leur apporter l’appui de sa renommée.
Mais il leur fallait de l’inédit à offrir au public. On savait qu’Hérold achevait une partition, celle du Pré-aux-Clercs. Mais elle n’était point encore terminée et il fallait la mettre en scène. Tout cela demandait du temps. Hérold tira d’affaire ses futurs interprètes en improvisant au courant de la plume un petit acte, la Médecine sans médecin, sur un livret de Scribe et Bayard, qui fut écrit, répété et représenté en moins de trois semaines. Le 15 octobre 1832, l’acte improvisé recevait du public le meilleur accueil.
Deux mois plus tard, jour pour jour, le 15 décembre 1832, le Pré-aux-Clercs soulevait les acclamations d’une foule enthousiaste. À longs cris, Hérold était réclamé par les assistants. On voulait à toute force qu’il se présentât sur la scène pour le couvrir d’applaudissements.
Hélas ! le pauvre Hérold était hors d’état de répondre à l’appel de ses admirateurs. Pris d’une crise violente d’un mal qu’il avait hérité de son père, il était tombé sans connaissance dans les bras de ceux qui l’entouraient, crachant le sang en abondance. On dut le ramener précipitamment en son logis et le coucher dans le lit qu’il ne devait presque plus quitter.
Le sujet du Pré-aux-Clercs était emprunté par le librettiste Planard aux Chroniques du temps de Charles IX, de Mérimée. La scène se passe tantôt au Louvre où Marguerite de Valois, femme du roi de Navarre, est retenue prisonnière par son frère Charles IX, tantôt au Pré-aux-Clercs. Marguerite a auprès d’elle une noble fille du Béarn, Isabelle dont est amoureux un jeune huguenot béarnais, le baron de Mergy, envoyé par son roi à la cour de France. Mergy a pour rival auprès d’Isabelle le comte de Comminges, duelliste acharné et protégé de Charles IX. Les deux hommes se devinent et se haïssent. Une querelle inévitable surgit entre eux. Rendez-vous est pris au Pré-aux-Clercs. Comminges, qui d’ordinaire ne manque jamais son homme, est tué par Mergy à la première passe. Mergy épousera Isabelle, dont il est aimé. Chacun se réjouit.
La musique du Pré-aux-Clercs est pleine de mouvement, de couleur, délicate et fine, pathétique au besoin. C’est une partition heureuse. Les pages capitales sont l’Ouverture d’abord, très bien menée, puis le duo de Nicette et Girot :

d’un contour mélodique si agréable et d’une harmonie si plaisante. J’aime moins la seconde partie avec le chant redoublé en syncopes à l’orchestre. Je citerai encore le grand air d’Isabelle avec répliques de violon solo :
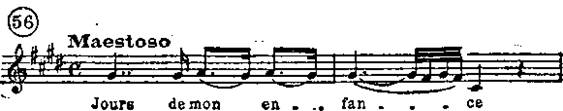
et surtout le trio exquis, – véritable chef-d’œuvre de gaîté, de tendresse et d’esprit, – entre la Reine, Isabelle et Cantarelli (le rôle comique de la pièce) :

Le succès du Pré-aux-Clercs se soutint pendant de longues années. Le 11 octobre 1871, on célébrait la 1.000e représentation.
Il est vraiment dommage que depuis 1898, un ouvrage d’un mérite si réel ait quitté le répertoire courant de l’Opéra-Comique[9].
Le 19 janvier 1833, cinq semaines exactement après l’apparition du Pré-aux-Clercs, Ferdinand Hérold rendait le dernier soupir. Il n’avait pas encore 42 ans.
*
Adolphe ADAM était de famille alsacienne comme Hérold. Il naquit à Paris, en 1803, entra au Conservatoire en 1817 et, si on l’en croit, il méprisait alors souverainement la musique mélodique. « Je n’estimais, écrit-il dans ses Souvenirs, que les combinaisons les plus arides et les plus recherchées. » Je n’imagine pas que ces combinaisons aient eu rien d’effroyablement compliqué. On s’effarait de peu à cette époque où régnait l’école de la parfaite sagesse : tonalité bien accusée, « motif » net et facile à retenir, modulation rare. Dans la classe de Boieldieu, Adam apprit à écrire de la musique claire, vive et gracieuse. Ses meilleurs ouvrages furent : le Chalet (1834), le Postillon de Longjumeau (1836), le Toréador (1849), Giralda (1850), la Poupée de Nuremberg, Si j’étais roi (1852), le Sourd ou l’Auberge pleine (1853), œuvres d’un agrément sans profondeur, où l’on peut trouver un plaisir honnête, sans plus.
Le livret du Chalet fut tiré par Scribe d’une pastorale de Gœthe, Jery und Bœtely qui, de 1790 à 1873, a été mise en musique par une quinzaine de compositeurs. Adam écrivit sa partition en deux semaines. Il raconte lui-même comment : « Pendant trois jours, je ne pus accoucher de la plus misérable idée. Le soir du troisième jour, je me couchai, pleurant comme un enfant, persuadé que c’en était fait de ma carrière de compositeur, et que j’avais dépensé toute la somme d’idées que le Ciel m’avait départie… Mes regards tombèrent alors sur le manuscrit de mon ballet de Faust. Une danse de démons pouvait convenir à un chœur d’orgie. J’essayai d’adapter la musique aux paroles ; elles n’allaient pas. J’en fis d’autres, et je composai ces deux vers ridiculement célèbres qu’on a tant reprochés à Scribe : Du vin, du rhum et puis du rac, ça fait du bien à l’estomac. Je trouvai dans une scène d’Ariane les fragments de mon introduction. À partir de ce moment, tout alla comme par enchantement. Je fis dans la même journée les couplets : Dans le service de l’Autriche… et terminai le grand morceau dans la soirée. Le lendemain, grâce au souvenir de quelques airs nationaux que j’avais rapportés de Suisse, j’écrivis l’introduction de l’ouverture et les couplets : Dans ce modeste et simple asile. Mon imagination s’était échauffée ; je n’eus plus besoin d’aller chercher dans mes œuvres passées, oubliées ou inconnues ; le quinzième jour, ma partition était trouvée, instrumentée et remise à la copie. » On peut sourire de tant de hâte, de tant de précipitation, d’une telle fièvre d’improvisation, et se demander avec défiance ce que pouvaient valoir des ouvrages aussi rapidement bâclés. N’empêche qu’il fallait une singulière facilité, une spontanéité peu commune d’invention pour mettre sur pied vaille que vaille une œuvre qui a tout de même son prix, en si peu de temps.
Le 25 septembre 1834, la première représentation avait lieu avec le plus vif succès. Boieldieu qui y assistait, s’écriait : « Je voudrais que cette musique fût de moi. »
Mais la vogue du Postillon de Longjumeau (1836) eut plus de retentissement encore, notamment en Allemagne où la pièce n’a pas cessé de se jouer.
Adam, le musicien chéri de la bourgeoisie louis-philipparde, s’est admirablement caractérisé dans ces lignes qu’il a écrites sur lui-même[10]. « Je n’ai guère d’autre ambition, dans une musique de théâtre, que de la faire claire, facile à comprendre et amusante pour le public. Je ne puis faire que de petite musique, c’est convenu ; je me contente donc de faire comme je puis, comme je sais, et j’attends que le public se lasse de moi pour cesser d’écrire. » Et il dit encore, à propos de ses ballets (il en a écrit beaucoup) : « J’écris les idées qui me viennent, et elles viennent toujours, les aimables filles ! Et pour se presser si fort, au risque de chiffonner leur toilette, elles ne me sourient pas moins ; et il m’arrive, tout harcelé que je sois par le maître de ballet, de les trouver fraîches et jolies… On ne travaille plus, on s’amuse. »
Un gentil musicien !
N’oublions pas qu’il est l’auteur d’un célèbre ballet, Giselle (1841), qui se danse encore aujourd’hui à l’Opéra.
*
Et voici le grand événement de 1835, la première de la Juive de Jacques-Fromental-Élie Halévy (1799-1862). Les autres ouvrages de cet auteur sont complètement oubliés. Halévy reste uniquement l’auteur de la Juive, ce qui n’est pas encore beaucoup dire. La Juive, en effet, est un opéra bâti selon la formule alors à la mode de l’opéra historique où l’on se donne l’apparence d’un penseur parce que l’on remue les grandes passions politiques et religieuses, mais d’un style qui sonne terriblement le creux.
En dehors de la Juive, qui donc connaît Guido e Ginevra ou la Peste à Florence (1838), la Reine de Chypre (1841), Charles VI (1843). Dans ma jeunesse, les vieux amateurs chantaient encore un air de Charles VI, que j’aimais assez. Voilà pour les opéras. Et pour les opéras-comiques, qui donc a retenu seulement les titres de l’Éclair (1835), des Mousquetaires de la Reine (1846) et du Val d’Andorre (1848). Pour ma part, je me rappelle avoir entendu bien des fois, étant enfant, les Mousquetaires de la Reine au théâtre de Brest. Je passais alors mes vacances dans cette ville. Or, à la fin de septembre, c’étaient les débuts de la troupe d’opéra-comique qui se faisaient généralement par la représentation de cet ouvrage : car il offrait l’occasion d’entendre à peu près tous les chefs d’emplois, sauf le baryton ; première chanteuse légère, dugazon, premier et second ténor, première basse. À l’entr’acte, les abonnés allaient déposer leur bulletin de vote dans l’urne installée au foyer, décidant en souverains du sort des malheureux artistes. Cette formalité, qui s’accomplissait sous mes yeux, m’était pénible : j’avais le cœur serré, car je devinais ce que pouvait être l’existence de ces misérables chantres de province. Mes souvenirs de ces représentations sont très précis et je conserve l’impression que Halévy réussissait beaucoup mieux dans le genre de l’opéra-comique que dans celui de l’opéra. Je me rappelle un excellent duo entre la basse et le ténor et aussi un air assez bien tourné de la basse : « C’est au bon temps du roi Henri, Messieurs, que se passait ceci. »
Mais je n’ai jamais pu supporter une seule note de la Juive. Tout enfant, cette musique me paraissait d’une horrible platitude. Les grands airs du Cardinal dont on se plaisait à vanter la noblesse me donnaient l’impression de la pure sottise en musique, depuis :
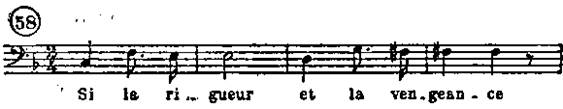
jusqu’à :

Et comment admettre surtout ce tissu d’absurdités musicales dont je n’indique ici que le début :

avec, pour finir, des vocalises sans éclat, sans brillant et sans aucune signification expressive. Tout cela me répugnait. Et c’était pourtant l’époque où j’admirais encore Meyerbeer. Mais n’insistons pas sur le caractère infiniment prosaïque de cette déclamation bourgeoise.
Laissons, sans la remuer, la poussière s’amasser sur ces ruines.
CHAPITRE IX
LISZT ET LA COMTESSE D’AGOULT
Pour écouter cette musique de pacotille, et même quelquefois peut-être, pour en subir l’illusoire attrait, il n’y avait pas que des bourgeois sans goût. Une société très éclairée, un milieu très artiste assistait aux spectacles de l’Opéra. Si ces spectateurs d’élite sentaient l’inanité de la Juive, ils ne méprisaient pas tout à fait un Guillaume Tell, ni même un Robert le Diable. Au centre de cette société, il y avait deux grands musiciens, Liszt et Chopin et deux écrivains de talent, George Sand et la comtesse d’Agoult (Daniel Stern).
*
Le 22 octobre 1811, naissait à Raiding, en Hongrie, Franz LISZT[11]. Son père, Adam Liszt, était comptable du prince Esterhazy : il jouait bien du piano. Franz, dès sa petite enfance, fut nourri de la musique des tziganes et de celle de Beethoven. À 9 ans, déjà remarquable virtuose du piano, il faisait sa première apparition en public. De 10 à 12 ans, il fut l’élève de Czerny, l’ami et l’interprète de Beethoven, pour le piano et de Salieri pour la composition.
Lorsqu’il donna son deuxième concert à Vienne, Beethoven, qui était dans l’assistance, fut tellement enthousiasmé de son jeu, qu’il sauta sur l’estrade pour embrasser le jeune artiste.
À 12 ans, Liszt arrive à Paris où il passera une grande partie de sa vie, jusqu’en 1847.
Érard l’accueille à bras ouverts.
Mais Cherubini lui ferme les portes du Conservatoire.
Il travaille la composition avec Paër.
Il se mêle à la vie littéraire, artistique et mondaine et subit toutes sortes d’influences diverses qui retentiront dans son œuvre. Son esprit sera pénétré par l’action du romantisme français. Il est nourri de sentiments français, d’idées françaises. La langue française sera sa langue quasi-maternelle.
À 12 ans et demi, il fait représenter à l’Opéra un acte, Don Sanche. Puis il commence ses tournées à travers l’Europe, émerveillant ses auditeurs par son éblouissante technique en même temps que par la puissance et la profondeur de ses interprétations.
À 15 ans (1826), il écrit Douze études pour le piano qui deviendront plus tard, en 1838, les Douze études d’exécution transcendante et dont la quatrième devait prendre la forme d’un poème symphonique : Mazeppa.
Il étudie le contrepoint avec Reicha.
Mais voici qu’il a des crises de mysticisme et qu’il songe à se faire prêtre. Son père s’y oppose et lui dit qu’il n’a pas le droit d’abandonner la musique, qu’il faut obéir à la volonté de Dieu en cultivant les dons qu’il en a reçus. Franz se soumet, mais, toujours très pieux, se livre à des pratiques d’ascétisme qui l’épuisent.
Sur ces entrefaites, son père meurt d’une fièvre maligne et sa mère, qui était retournée en Hongrie, vient le rejoindre à Paris.
Ici, se place dans la vie de Liszt, un premier épisode sentimental. Il s’éprend de son élève, mademoiselle Caroline de Saint-Cricq, qui avait 17 ans. Va-t-il l’épouser ? « S’ils s’aiment, laissez-les être heureux, » dit la mère mourante. Le père les sépare. Caroline, désespérée, veut se faire religieuse et finit par épouser M. d’Artigaux. Mais elle n’oublia jamais Franz et ne fut jamais oubliée de lui. Souvenir très pur.
Fort troublé par cette cruelle déception, Liszt tombe malade. On annonce sa mort.
Son mysticisme s’exalte. Il ne supportait plus près de lui que la séraphique présence de ce Christian Urhan, premier violon de l’Opéra et altiste renommé « qui aimait Dieu autant et plus que Mozart et Gluck. »
Cet Urhan jeûnait tous les jours jusqu’à 6 heures, dînait au Café anglais, et, selon une permission spéciale de l’archevêque de Paris, tenait chaque soir sa partie de violon à l’Opéra, en tournant le dos à la scène, afin que ses regards fussent soustraits au Malin.
Peu à peu, Liszt se remet de la grande secousse qu’il a ressentie et maintenant, il a une crise de lecture. Il se passionne pour René, le René de Chateaubriand, pour Montaigne et Ballanche, Lamennais et Voltaire, Lamartine et Sainte-Beuve.
Il éprouve une ardente soif de s’instruire, de se cultiver.
Il rencontre Mignet : « Monsieur Mignet, s’écrie-t-il, apprenez-moi toute la littérature française ! » – « Une grande confusion semble régner dans la tête de ce jeune homme, » note Mignet.
Mais nous arrivons à 1830. Le canon de Juillet tonne. « Le canon l’a guéri, » dit sa mère. Finie la crise de mysticisme. Il se réveille démocrate, socialiste. Son besoin d’idéal se satisfait à de nouvelles sources. Il aime alors tous les révolutionnaires : en politique, Saint-Simon et Lamennais, en musique Berlioz et Paganini. Il arrange pour piano la Fantastique de Berlioz et il écrit six Études sur les Caprices de Paganini. Il connaît la musique de Chopin et en sent toute la profondeur. Il en joue divinement les Études. La Fantastique surtout devient pour Liszt une révélation. Voilà la voie ouverte à ses futurs poèmes symphoniques.
*
Cette idée du poème symphonique qu’il a empruntée aux Français, Liszt va la réaliser à l’allemande et dans le sens beethovénien[12].
N’importe ! Il la doit, cette idée, à Berlioz et donc à la France. Non seulement à Berlioz, mais encore au milieu de littérateurs et d’artistes de toutes sortes qu’il fréquente.
Le romantisme n’avait-il pas d’ailleurs pour principe essentiel que les arts sont frères et qu’ils ne doivent pas rester étrangers l’un à l’autre, que dans un certain sens, ils doivent s’interpénétrer ? Liszt empruntera à la littérature et à la peinture des motifs d’inspiration. Il ne croit pas que la musique gagne à se suffire à elle-même. Dans son langage particulier, elle doit exprimer ce que tout autre art peut traduire à sa manière.
C’est là une brusque rupture avec la méthode de la musique classique, qui, tout au moins sous la forme de la sonate ou de la symphonie, ne se préoccupe essentiellement ni de la littérature ni de la peinture, qui n’a point l’intention d’être un langage, d’exprimer autre chose qu’elle-même. C’est seulement au théâtre que la musique classique s’associe à un poème et cherche à trouver dans ses propres ressources l’équivalent des mots ou des images. La distinction des genres reste encore observée et l’on n’a point encore songé à faire parler aux seuls instruments une langue autre qu’exclusivement musicale. Le développement d’une sonate ou d’une symphonie suit un ordre dicté par une logique purement musicale et non par le dessein de suivre un programme littéraire ou pittoresque.
Ce sont là du moins des généralités qui souffrent des exceptions, et l’on pourra citer l’exemple de la Symphonie pastorale et de la Symphonie héroïque, mais on aperçoit aisément à quel point de tels ouvrages sont encore loin de mériter le nom de poèmes symphoniques.
Cependant remarquons bien, – il faut le dire et le répéter, – que la musique à programme n’est pas née avec Berlioz et Liszt. De tout temps, il s’est trouvé des musiciens qui ont voulu donner à leurs compositions un intérêt descriptif ou imitatif. Pour ne pas remonter plus loin dans la série des âges, la Bataille de Marignan de Janequin est assez célèbre pour que chacun puisse constater qu’au XVIe siècle on savait, par le moyen des seules voix humaines, réussir admirablement des descriptions musicales ; et le Chant des oiseaux, l’Alouette, le Rossignol du même auteur, sont des preuves aussi convaincantes de la perfection de son talent dans ce même genre.
Au XVIIIe siècle, le même souci de l’imitation de la Nature extérieure se donna libre cours dans les œuvres des clavecinistes : Songez au Moucheron de Couperin, à la Poule de Rameau. Ne parlons pas de J.-S. Bach dont le cas est trop complexe et réclamerait trop de commentaires. Rappelons seulement le Caprice sur le départ de son frère chéri. Plus tard, nous pourrions citer des pages nettement descriptives dans la Création ou dans les Saisons de Haydn, notamment la magnifique introduction de l’Hiver dans cette dernière partition.
Mais nous remarquerons que dans les cas que nous venons d’énumérer la description, l’imitation d’un objet ou d’un phénomène extérieur est souvent comme une « citation » extérieure au texte purement musical, une illustration d’un caractère étranger à la musique même et qui ne fait point corps avec elle.
C’est que la musique n’est peut-être vraiment faite que pour traduire les états intérieurs, les sentiments, les passions et non les réalités du dehors.
C’est ce que comprend admirablement Liszt et il en résulte de sa part une conception très particulière de la musique à programme, une conception très différente de celle de Berlioz.
Berlioz, en effet, dans la Symphonie fantastique, dans Roméo et Juliette, a l’intention de raconter une histoire, d’évoquer des tableaux ou des situations dramatiques. Il veut faire voir, il veut peindre. Il s’attache au fait, à l’anecdote autant et plus parfois qu’au sentiment, et c’est en quoi une symphonie de sa composition n’a presque plus aucun rapport avec une symphonie de Haydn, de Mozart ou de Beethoven. Le développement musical est conduit par la succession des éléments du programme littéraire dont il s’attache à reproduire le caractère, fût-ce au mépris des lois de l’architecture musicale et des nécessités de la vie intérieure des thèmes et de leur évolution.
Il en va tout autrement chez Liszt. S’il prétend traiter musicalement un sujet emprunté à la littérature, le Tasse, Orphée, Prométhée, Mazeppa, c’est en prenant soin de laisser tomber toutes les miettes de l’histoire ou de la légende qu’évoquent ces titres. En les lisant par avance, ces titres, nous pourrons faire revivre dans notre imagination toutes les circonstances du mythe d’Orphée ou de l’extraordinaire aventure de Mazeppa. Mais sitôt que la musique parle, c’est pour nous dire tout autre chose, c’est pour exprimer en ses traits dominants le caractère du héros, sa physionomie morale, c’est pour parler le langage du sentiment, ou, s’il y a lieu de nous présenter une grande image, comme celle de la course effroyable de Mazeppa, c’est en se bornant à cette seule vision et à celle du triomphe qui la suit au moyen de motifs dont le développement, au delà de leur initial pouvoir évocateur, reste purement musical et n’est point du tout régi par le souci d’un programme.
De telle sorte que, tout en empruntant à la littérature les sujets de ses poèmes symphoniques, Liszt ne sort point, quoi qu’il en semble, du domaine de la logique purement musicale qui canalisait les inspirations d’un Haydn, d’un Mozart ou d’un Beethoven. En ce sens, il s’éloigne considérablement de la conception de la musique imitative d’un Janequin. Sa position dans l’histoire de l’art musical n’est explicable, n’est intelligible que comme une conséquence directe de l’art des classiques dans ce qu’il a de plus fidèle à sa propre définition, qui est celle même de la « musique pure ». À ce point de vue, Liszt reprend et continue Beethoven.
On comprendra mieux cette attitude de Liszt, si l’on considère d’un peu près sa Faust-Symphonie, un de ses plus beaux ouvrages, peut-être son chef-d’œuvre, et celui où il se montre, parmi les musiciens, le meilleur interprète de Gœthe.
Ici, pas de pittoresque extérieur, pas de procédé décoratif. Liszt ne songe pas un instant à nous conter, détail par détail, l’histoire des amours de Marguerite et de Faust, l’intervention de Méphisto, de Siebel, de dame Marthe, de Valentin, des voisines. Il néglige tout le côté anecdotique du poème. Il ne retient de la pensée de Gœthe que trois aspects essentiels. Il essaye de caractériser successivement chacun des trois personnages principaux : Faust, Gretchen et Méphisto, en consacrant à chacun d’eux une des trois parties de son œuvre qui constituent comme les trois mouvements d’une symphonie classique, un Andante entre deux mouvements vifs.
Chacun de ces trois caractères est analysé en ses éléments et exprimé par des thèmes vraiment parlants.
Pour ce qui est de Faust, un premier motif traduira sa disposition à la rêverie, à la méditation philosophique, un second motif son besoin de tendresse, un troisième son impatience de savoir et de vivre et enfin un quatrième sa résolution d’agir. Dans tout cela, pas un fait extérieur, rien que des états d’âme essentiellement musicables.
De Marguerite, il traduira d’abord l’innocence, la pureté par un délicieux chant de hautbois accompagné par l’alto, puis le rêve amoureux. Alors éclate le drame avec l’entrée d’un thème de Faust, celui du désir, présenté avec une tragique violence. Ici, en quelques notes (exquises d’ailleurs), la seule évocation d’un fait, d’une image précise, Gretchen effeuillant la marguerite. Enfin, pour terminer, voici que le thème de l’action, de l’ambition dominatrice de Faust se présente prodigieusement atténué devant l’amour de Marguerite et se résout en une tendre caresse.
Maintenant la troisième partie.
Ce qu’il y a d’admirable c’est que Méphisto, l’esprit de la Négation, ne s’exprime par aucun thème qui lui soit propre. Il n’existe, en effet, que par ses négations. Les thèmes de Méphisto, ce sont les thèmes de Faust, travestis, tournés en ridicule.
Ce qu’il y a de remarquable aussi, c’est que le thème de Marguerite apparaissant un instant ne sera ni dénaturé ni persiflé. Il résiste à la négation du démon. Une seconde fois, il interviendra pour arrêter les railleries du diable. Il deviendra alors solennel, se transfigurera et proclamera la vertu rédemptrice de l’Éternel féminin par les voix du ténor solo et du chœur. Et dans cette contemplation se dissoudront l’activité et l’esprit même de Faust.
Tout cela est prodigieux de richesse et de profondeur et, j’y insiste encore, tout cela est purement psychologique. Rien de l’imagerie musicale.
Mais, pour différent que l’art de Liszt soit de celui de Berlioz, il n’en a pas moins sa source première dans cette Fantastique que Liszt a tant aimée et admirée. Ainsi, c’est en France qu’il a cueilli la première idée de ses Poèmes symphoniques, idée si féconde puisqu’elle devait, se transformant d’une autre manière encore, donner naissance au Prélude à l’après-midi d’un Faune, aux Nocturnes et à tant d’autres chefs-d’œuvre de Claude Debussy.
*
On le voit, Liszt ne perdait point son temps à Paris. Il y préparait, sur les assises les plus solides, son magnifique avenir de compositeur.
Reprenant certaines idées exposées par Fétis en 1832, et leur apportant un considérable développement, il soutiendra que la tonalité moderne doit se constituer par l’abolition des anciennes coutumes qui renfermaient la mélodie dans des bornes trop étroites. Il en élargira indéfiniment le concept jusqu’à soutenir qu’aucun accord ne puisse être considéré comme absolument étranger à une tonalité donnée, si éloigné qu’il en puisse paraître au premier abord.
Cependant, Liszt continue de vivre ardemment la vie mondaine. Il est très répandu dans les salons. Il a les plus brillantes relations. Sa personne est des plus séduisantes : il est grand, mince, porte une longue chevelure. Son visage est candide. D’une apparence frêle et pourtant robuste, il fracasse les pianos et tombe évanoui.
En 1833, commence la liaison de Liszt avec la comtesse d’Agoult (qui devait plus tard se faire connaître comme écrivain sous le pseudonyme de Daniel Stern). La maladie et la mort d’un enfant veillé en commun en fut l’occasion. La comtesse ne voulut pas du mystère illusoire de relations secrètes avec celui qu’elle aimait. Elle rompit ouvertement avec sa famille, avec la société, et, le front haut, alla s’installer avec Liszt à Genève. De cette union passablement tourmentée, pleine d’orages, naquirent trois enfants : Daniel, mort à 20 ans ; Blandine, la future Mme Émile Ollivier ; et Cosima, qui devait épouser Hans de Bülow, puis Richard Wagner.
Liszt eut la délicatesse, tant qu’il vécut avec Mme d’Agoult, de vouloir subvenir à lui seul entièrement aux besoins du ménage. C’est pourquoi, il entreprenait de continuelles tournées qui l’éloignaient de la comtesse. À cette circonstance, nous devons de posséder une abondante correspondance entre les deux amants.
*
La correspondance de Liszt et de la comtesse d’Agoult (1833-1864), a été publiée par les soins de leur petit-fils, M. Daniel Ollivier.
Lecture un peu pénible par moments : on éprouve quelque honte à violer ainsi le secret le plus intime de deux âmes délicates. Après tout, ce secret ne nous échappe-t-il pas ? Qu’y a-t-il de plus menteur qu’une lettre, surtout entre deux amants ? Rarement, ils s’y montrent au naturel. Le jeu des passions brouille tout. Il faut en deviner les dessous et démasquer les hypocrisies spontanées ou volontaires : ce n’est pas toujours facile et la part de l’hypothèse reste considérable.
Mais le jeu est, en un sens, très attrayant et on s’y livre bien volontiers.
La correspondance dont il s’agit est éditée en deux volumes qui ont paru à quelques mois de distance. J’avais donc lu le premier volume d’abord, tout seul, et, d’après cette lecture, je m’étais fait une première idée des rapports de Liszt et de Mme d’Agoult qui s’est quelque peu modifiée par la suite. Mais il y a peut-être intérêt à rapporter mes impressions dans l’ordre même où elles se sont succédé.
*
On représente d’ordinaire Mme d’Agoult comme violente, colère, grondeuse. D’après ses premières lettres, elle m’apparut, en fin de compte, beaucoup plus sympathique que Liszt avec toutes ses petites finesses, ses habiletés, ses roueries pour cacher ses infidélités et sauvegarder son indépendance, avec son impérieux égoïsme, mêlé de grands traits de générosité, certes, mais où la vanité a sa part.
Vanité débordante. Il faut voir comme il raconte ses succès et comment il insiste sur les détails les plus mesquins, comme il se montre jaloux de ses rivaux, surtout de Thalberg. Sa supériorité écrasante ne lui suffit pas : il voudrait empêcher Thalberg d’exister. Cette férocité d’amour-propre ne se comprend guère d’un homme qui sut si noblement plus tard se sacrifier à Wagner.
Il était encore bien jeune, il est vrai : 22 ans quand il connut la comtesse ; elle, 28. Et son immense orgueil s’alimentait sans cesse de flatteries démesurées. Il avait sa cour comme un souverain. Dès son lever, sa chambre était encombrée de visiteurs. « Le matin, ma chambre ne désemplit pas… Tout le monde veut me voir et m’avoir… Je suis l’homme à la mode… Vous ne me faites pas l’injure de penser que cela me fasse la moindre impression, n’est-ce pas ? » Nous lui faisons cette injure. Sinon, pourquoi conterait-il ces choses ?… « Au moment où je vous écris, il y a quatre personnes qui se promènent dans ma chambre… » De Leipzig : « Mendelssohn, Hiller et Schumann ne quittent pas ma chambre. Mendelssohn m’apporte des sirops, des confitures… Schumann est venu me chercher à Dresde. » Et il déclare lui-même : « L’intérêt, l’amour-propre dominent, de fait, toute la vie d’un homme. »
Par contre, n’y a-t-il pas quelque grandeur, fût-elle calculée, dans cette lettre de Mme d’Agoult du 25 juin 1838 : « Je vous aime immensément et pour vous. Je crois que vous pouvez et que, par conséquent, vous devez encore aimer. Il y a une partie de votre cœur qui reste en souffrance avec moi. Mon amour vous dessèche… Voilà cinq ans que cela dure et c’est peut-être assez. Laissez-moi aller au loin. Quand vous m’appellerez, je reviendrai. Il ne faut point arrêter tout ce qui amène un plus entier développement de vos facultés. Si je ne vous aimais pas religieusement et ne vous plaçais pas si haut, je ne pourrais vous parler ainsi, mais j’ai un profond respect pour votre liberté. »
Cœur plein d’amertume et sans illusion et par suite incompris de la plupart des hommes et des femmes, – qui veulent être trompés. – Mme d’Agoult n’a certes point le génie de Liszt, mais quelle beauté morale dans ce caractère !
Elle est vouée à la solitude.
À Liszt, il faut le monde, le mouvement, l’agitation. Il a sans cesse la fièvre. Il s’en plaint. Il passe la moitié de son temps à souffrir, à gémir, à se soigner, et l’autre à se surmener en d’interminables fêtes et parades.
Au milieu de tout, il faut qu’il travaille son piano. Mais quelle facilité ! Il apprend le Concerto en ut mineur de Beethoven en vingt-quatre heures. Il le joue « avec point d’orgue improvisé », et obtient « le plus inouï succès ». Mais que ne ferait-il pas pour gagner les bravos d’un public en délire ?
Nulle part, il ne souleva les enthousiasmes exubérants, il ne provoqua les cris, le tumulte, les ovations, comme en Hongrie. C’est à Pesth que lui fut remis ce fameux « sabre d’honneur » dont on devait bientôt faire tant de gorges chaudes à Paris. Lui n’en sent pas le ridicule. Très sérieusement, il écrit : « Festetics tenait un magnifique sabre (d’une valeur de 80 ou 100 louis), orné de turquoises, de rubis, etc., à la main. Il m’adresse une petite allocution en hongrois devant tout le public qui applaudit avec frénésie, et me ceint le sabre au nom de la Nation. » Il ajoute naïvement : « Ce sabre vous plaira extrêmement. » Et il l’envoie à Mme d’Agoult qui sourit et lui répond : « Votre sabre est arrivé. Ferrez-vous à glace sur toutes les plaisanteries qu’on vous fera là-dessus. » Entre temps, lui s’inquiète : « Le comte Traun a-t-il remis le sabre à ma mère ? » Chez Liszt, et dans sa musique même, (songez à la fin des Préludes), il y aura toujours un petit coin pour le sabre d’honneur.
Malgré ses formidables succès, Liszt ne plaisait pas à tous. Il avait ses ennemis. Il signale à Prague « une espèce d’opposition classique » qui s’était formée contre lui. On le trouvait trop capricieux, trop fantaisiste, trop fougueux, trop libre.
Mme d’Agoult, ne l’oublions pas, malgré ses admirations pour les romantiques, est une classique. D’où, en partie, le drame de ces deux âmes si étrangères l’une à l’autre.
Liszt montre parfois une singulière désinvolture pour conter ses infidélités. Il écrit à sa maîtresse : « Je veux vous parler aussi d’une espèce de passion à laquelle je me suis laissé aller quarante-huit heures. Ne soyez point jalouse. » Il irrite à dessein.
Mme d’Agoult ferme l’oreille à de tels propos et elle s’ingénie à préparer à Liszt un retour digne de lui dans ce Paris qu’elle juge à merveille, dont elle sait le peu de goût pour la vraie musique, le dilettantisme si superficiel. Après avoir noté une triste soirée aux Italiens, avec la Persiani, « admirable gosier », Rubini et Tamburini, étonnants virtuoses, elle conclut : « C’est en somme un pauvre résultat que celui obtenu par l’élite des chanteurs devant l’élite des nations. Le temps n’est pas à la musique… »
Mais fièrement, Liszt répliquait : « Quelque apathie musicale que vous y remarquiez, je ne désespère pas de remuer ce public-là. » Et, insouciant, ce grand enfant ajoutait : « J’ai acheté des pipes magnifiques que mon domestique, ancien hussard décoré de deux croix[13], tient dans un ordre admirable. C’est à peu près mon seul plaisir de les regarder matin et soir. »
*
Entre ce grand enfant volage, et cette sévère maîtresse, il ne pouvait y avoir que des malentendus.
De quel côté sont les torts ? J’ai montré comment la lecture du premier volume de la correspondance entre Liszt et Mme d’Agoult m’avait donné le sentiment que presque toujours la comtesse avait raison contre son trop jeune amant.
J’avoue que le deuxième volume me laisse une impression quelque peu différente. Les années donnent tout de même plus de sérieux à Liszt, de fermeté et de sincérité à son caractère. Mme d’Agoult devient parfois bien pointilleuse et bien sèche. Comment n’a-t-elle pas lassé plus tôt Liszt ?
Elle a surtout le grand tort de n’avoir pas senti suffisamment son génie. Elle n’a pas compris le beau rôle qu’elle pouvait jouer à côté de lui. Elle n’a rien eu du dévouement dont plus tard sa fille Cosima fera preuve à l’égard de Wagner. Cosima tenait sans doute davantage de son père. Mme d’Agoult était trop occupée de sa personne, de ses droits, de son orgueil, de son bonheur. Et, en somme, c’est elle qui a rompu. Elle méprisait sans doute un peu en Liszt le « pianiste », le « saltimbanque », comme il disait lui-même, ou le « chien savant ». Sa vanité souffrait de s’être liée à une sorte de « cabotin ». Elle lui reproche à tout propos ses succès de virtuose. Elle n’a pas deviné, prévu quelle place il tiendrait un jour dans le monde comme compositeur. Elle avait pour elle-même trop d’admiration et croyait trop en son propre génie.
Liszt a de petits côtés, surtout dans sa première jeunesse. Nous avons conté tout à l’heure l’histoire du « sabre d’honneur ». Cette histoire a sa suite dans le deuxième volume de la correspondance. Nous y trouvons la citation d’un article de la Revue des Deux Mondes, du 15 octobre 1840 qui se termine par ces mots : « Nous laisserions encore Beethoven et Weber mourir de faim pour donner un sabre d’honneur à M. Liszt. » Le trait était dur et blessant. Liszt s’en montra vivement affecté. Il prépare une réponse. Il demande à Mme d’Agoult de la mettre au point. Il lui en indique les grandes lignes dans une lettre, ma foi fort noble, où il montre le grand rôle de l’interprète, sans lequel les œuvres n’existeraient pas, ne seraient pas comprises, de l’interprète qui se dévoue à faire connaître et admirer les pages les plus grandioses ou les plus profondes des maîtres. Cette conception du rôle de l’exécutant est toute nouvelle. Liszt lui fait dans le monde artistique une place qu’il n’avait jamais occupée jusqu’alors tout près des créateurs. Sa protestation est une date (octobre 1840). Malheureusement elle se termine par des considérations sur le « sabre d’honneur » qu’il veut à tout prix justifier et dont certainement Mme d’Agoult aura souri encore une fois.
*
Liszt a connu la comtesse d’Agoult trop jeune. Il ne pouvait satisfaire les exigences si hautainement ambitieuses et si diverses d’un amour où la tête jouait un rôle peut-être plus important que le cœur. Et cependant il s’était donné tout entier. Malgré ses infidélités, Liszt paraît avoir été le plus épris des deux. Il veut toujours oublier tous les malentendus et revient indéfiniment à son amour profond. « Vivons, appuyez votre bras sur le mien ; laissez-moi m’endormir paisiblement sur votre cœur dont les battements sont pour moi le rythme mystérieux de l’idéale beauté, de l’éternel amour. »
Liszt est presque toujours absent. Il part en de continuelles tournées pour gagner les sommes nécessaires à faire vivre largement Mme d’Agoult et ses enfants. Là-dessus, il est intraitable : seul, il veut pourvoir à tout. Mais l’absence refroidit l’amour, aiguise les querelles, donne lieu aux caprices du grand artiste, caprices d’un moment, d’une heure bien souvent, mais qui exaspèrent Mme d’Agoult, toujours bien informée, souvent par Liszt lui-même qui a fait vœu de sincérité et tient sa promesse. Les rares instants que les deux amants passent ensemble sont toujours l’occasion d’un rapide raccommodement qui ne laisse parfois qu’une trace peu durable chez Mme d’Agoult.
Du moins, au lendemain d’une séparation, elle écrit (le 21 octobre 1840) : « Je me suis retrouvée tout entière à l’émotion profonde, religieuse de cette soirée qui change ma vie. J’avais jusqu’ici été à vous douloureusement, avec trouble, inquiétude, avec efforts d’enthousiasme, espoir toujours décroissant, alternatives d’exaltation passionnée et d’amère ironie. Aujourd’hui, la paix est descendue dans mon cœur à votre voix ; un sentiment jamais éprouvé de certitude, d’harmonie, d’unité me fait bénir votre amour et ma destinée. » La paix redescend dans ce cœur. Mais quelle âme tourmentée !
Mme d’Agoult ajoute : « Quelle puissance bienfaisante nous a transformés ou plutôt nous a révélés l’un à l’autre ? Oh ! c’est vous seul qui avez tout changé par la force de votre amour ! » Elle le reconnaît. « C’est à vous que je rends grâce, car c’est vous qui avez écrasé le serpent et qui, pour la seconde fois, m’enlevez sur vos ailes dans la région idéale vers laquelle je soupirais. Soyez-en fier et surtout soyez un peu plus heureux… » Quelques jours plus tard, elle signe : « Marie, redevenue votre Marie avec plus d’abandon et de sincérité que jamais. »
Liszt présent a un grand pouvoir sur Mme d’Agoult. Cette fois, l’impression dure plus que de coutume. Un aveu de Liszt à propos d’une faiblesse passagère la confirme : « Votre preuve de confiance, lui écrit la comtesse, me fait un plaisir extrême et désarme en moi toutes les jalousies. »
*
Mais c’est au tour de Mme d’Agoult de faire la coquette, de s’entourer d’hommes, de provoquer les hommages à sa beauté, de raconter ses succès à Liszt afin de le piquer au vif. C’est ainsi qu’Émile de Girardin devient un de ses adorateurs. « Aimez-moi et faites ce que vous voudrez, » écrit d’abord Liszt.
« Je vois Émile tous les jours, répond Mme d’Agoult, – une heure avant les autres. »
Liszt devient inquiet. « Un dernier mot à propos d’Émile. Puisque vous m’avez donné ce droit sur vous… eh ! bien non, je ne veux point que vous fassiez un pas de plus. »
Et Mme d’Agoult s’incline : « Si cela vous cause l’ombre d’un déplaisir, je ne reverrai de ma vie M. de Girardin. »
Mais Liszt n’en demande pas tant. Il ne veut pas d’une rupture brutale. Il sait peut-être au fond que Mme d’Agoult ne fait que s’amuser. Il lui suffit d’interrompre son jeu, sans dénouer complètement des relations utiles.
Si l’on en croit Mme d’Agoult, Émile de Girardin aurait éprouvé pour elle un bien vif élan de passion. Elle eut avec lui une explication décisive qui lui enlevait tout espoir d’être jamais aimé. « De grosses larmes tombaient une à une de ses yeux. Il me quitta sans presque avoir parlé. » Il lui écrivait le lendemain : « Vous devez savoir que mon âme est brisée et que le sacrifice est consommé. » Émile de Girardin resta l’ami de la comtesse et son conseiller littéraire.
Mme de Girardin aurait, paraît-il, dit ce mot : « Mon mari est en coquetterie avec Mme d’Agoult, mais cela ne m’inquiète pas. Avec les femmes d’esprit, cela n’est pas dangereux ; ce n’est qu’avec les bêtes qu’on va très loin, faute de savoir quoi dire. »
Sainte-Beuve, lui aussi, fait sa cour à Mme d’Agoult. Soupirant peu redoutable. Il s’y prend timidement et de la façon la plus maladroite. « Il me fait une cour très sotte, toute en madrigal et en bel esprit Rambouillet… Je ne puis concevoir qu’un homme si fin se mette dans une situation si bête. »
La comtesse en est bien vite excédée. « Il est d’une soumission, d’une humilité singulières. Il attendra indéfiniment en silence, il se contentera… de rien, car il ne veut pas d’amitié. Enfin vous avez raison de dire : quelle diable d’idée il lui a pris là ! J’espère m’en bien tirer. Il ne s’agit que de ne pas froisser son amour-propre, car je suis très convaincue qu’il ne m’aime pas le moins du monde. » Elle réussit à ne point se brouiller avec lui et à le conserver dans son cercle. Elle tenait beaucoup à lui. Il venait tous les soirs. Il l’aidait à corriger ses épreuves. « De temps en temps, comme pour ne pas être trop inconséquent ou trop impoli, il jette un mot de galanterie dans le discours. C’est comme un grain de sel ajouté à une salade parfaitement assaisonnée. Il y est de trop, mais on s’en aperçoit à peine… »
Girardin et Sainte-Beuve sont devenus indispensables à la comtesse, car elle commence à songer très sérieusement à son « avenir littéraire », que Mme de Girardin lui prédit « magnifique ».
Son premier essai, Hervé, ravit Liszt. « J’ai fondu en larmes dès la première page, » écrit-il. Mais dès la seconde « nouvelle, » Julien, Liszt fait des critiques. C’est trop court et trop concentré. Il voudrait un vrai roman. « Faites-le bientôt et qu’il soit long, touffu, abondant et haut. » Plus tard, pour Nélida, il se montrera plus sévère encore et à ses éloges se mêlent bien des réserves : « Charme et aristocratie dans le style. Par-ci, par-là un peu de manière dans la pose des personnages… Manque d’ampleur et de simplicité dans le déroulement de la période… Mais grâce et distinction parfaites dans la tournure, même dans ce quelque chose de contracté dont vous avez eu toujours de la peine à vous débarrasser… » Liszt se montra terriblement clairvoyant.
Reconnaissons que Mme d’Agoult a le mérite de ne se point fâcher d’une critique aussi libre. Elle répond, avec une conscience nette de ses limites : « Vous savez que je ne suis pas un génie spontané et surabondant. Mon talent est tout de réflexion et les qualités de mon style se perdraient par une trop grande hâte… »
Nélida, c’est un peu l’histoire des amours de Liszt et de la comtesse, et cette confession témoignerait, selon Gâchons de Molènes (Journal des Débats du 19 mai 1846), de la « satisfaction immense et constante » qu’éprouverait l’héroïne à considérer sa propre personne. « Ainsi, tandis qu’elle fait chaque jour une fâcheuse découverte dans l’intelligence de Guermann, chaque jour elle fait dans son propre esprit des découvertes qui l’enchantent. Elle finit par prendre de ses idées un plaisir tel qu’il la console des souffrances de son cœur… »
*
En parlant des ouvrages de la comtesse et de Nélida en particulier, nous avons anticipé sur les événements de sa vie et n’avons point conté d’abord, comme il aurait fallu, sa rupture avec Liszt. Nous n’avons pas besoin d’ajouter que ces événements occupaient beaucoup le milieu musical, littéraire, artistique et mondain où vivaient les deux amants.
Cette rupture, elle se préparait de longue date. Union sans cesse mêlée de demi-brouilles et de raccommodements. Tout s’arrange quand les amants se retrouvent ensemble, de loin en loin : « J’embrasserai vos incomparables petits pieds…, » s’écrie Liszt dans la joie du retour proche. Mais enfin, Mme d’Agoult ne peut plus supporter la constante séparation, les éternelles tournées de Liszt et son renom un peu tapageur, ni surtout ce qu’elle appelle ses « orgies ». La liaison très brève, mais assez voyante, de Liszt avec la danseuse Lola Montés fut le prétexte que prit la comtesse pour quitter définitivement son amant. Elle écrit en avril 1844 : « Si je n’avais pas la conviction, mon cher Franz, que je ne suis et ne puis être dans votre vie qu’une douleur et un déchirement importuns, croyez bien que je ne prendrais pas le parti que je prends dans la plus profonde douleur de mon âme. Vous avez beaucoup de force, de jeunesse, de génie. Beaucoup de choses repousseront encore pour vous sur la tombe où va dormir notre amour et notre amitié… »
Après tout, étant donné le caractère de la comtesse, – et son âge, – cette décision ne fut-elle pas en un sens la sagesse même ? À quoi bon vieillir pour les retours espacés de ce jeune impétueux toujours absent ?… Mais faut-il d’autre part se montrer si raisonnable en amour ?
La correspondance n’est pas, pour cela, absolument interrompue. Liszt et Mme d’Agoult continuent de s’écrire de loin en loin, et, ce qu’il y a de remarquable, c’est que longtemps encore Liszt témoigne de son amour profond et persistant pour la comtesse. Évoquant le passé, il écrit le 15 mars 1845 : « Les entraînements et les fautes qu’on pourrait y trouver n’ont jamais eu ni durée ni gravité quelconques. La main que vous me promettez de me tendre un jour d’oubli, je serai heureux de la saisir et de la tenir embrassée à toujours, mais je ne puis pas, non je ne pourrai jamais me dire que cette main a dû me quitter un seul instant. » En avril 1846, il parle de son cœur « brisé » : « Vous y retrouveriez le reflet encore brûlant de vos rayons et de vos jeunes amours. » Le 10 août 1848, de retour à Weimar, il écrit : « Votre portrait de Lehmann y était resté depuis 1843 : il est là suspendu devant mon bureau. »
Hélas ! à tout cela, Mme d’Agoult ne sait guère répondre que par des ironies et des pointes.
Et nous finissons par comprendre Liszt de s’être enfin complètement détourné d’elle pour se lier par un nouvel et durable attachement à la princesse de Wittgenstein.
*
Dans cette correspondance on trouvera mille autres choses que les amours si curieusement mouvementés de Liszt et de la comtesse. On aura le sentiment de vivre dans l’intimité de ces grands romantiques si magnifiquement inspirés : Lamartine, Hugo, Lamennais que Mme d’Agoult recevait continuellement. On rencontrera des indications fort imprévues sur Bettina Brentano, la célèbre amie de Gœthe et de Beethoven, alors âgée de 57 ans et dont Liszt fut presque amoureux. Il y a là des textes de la dernière importance. Liszt écrit : « Votre point de vue de génie musical pour Mme d’Arnim (Bettina Brentano), me paraît on ne peut plus ingénieux, voire même vrai… Comme musicienne pratique, je ne fais pas grand cas de Bettina, mais elle a certainement une divination profonde et comme cabalistique de l’art. Ces Lieder qu’elle vient de publier et de dédier à Spontini ne valent pas grand’chose, mais il y a un tourment d’expression, une sorte de grossesse de sentiment qui ne laisse pas d’avoir un certain intérêt. » Liszt ajoute : « Vous me demandez comment il se fait que Bettina n’ait rien créé avec un sentiment aussi profond de la nature et un sens si intelligent de la forme. Peut-être suis-je plus autorisé que d’autres à répondre qu’une trop grande intimité de sentiment n’est pas favorable à la production, que les impressions trop vives, trop multipliées, détruisent le repos nécessaire à la conception des caractères et ne permettent pas de poursuivre, avec la ténacité de logique et la simplicité de l’observation telle quelle, le développement dramatique… Bettina a fait comme moi. Elle a dépensé sa faculté de créer (qui n’était pas disproportionnée peut-être) à comprendre, à sentir, à vivre et à se pénétrer de tout cela. Elle s’en est grisée, et puis elle s’est trouvée musicienne, sorte d’êtres parfaitement inaptes dans la région positive de l’intelligence. Vous avez parfaitement touché le point juste. C’est une musicienne. » Réflexions pénétrantes où s’accuse seulement une trop grande modestie de la part de Liszt.
Mme d’Agoult en profite pour reprocher à Liszt (comme à Bettina), « dieses beständige moralisch besoffen sein (cette constante saoûlerie morale) qui ne peut produire autre chose que le Katzenjammer (le mal aux cheveux) de l’âme, c’est-à-dire le dégoût de toutes les affections naturelles. » Du moins « Bettina a eu dix ou quinze ans d’un mariage parfaitement sensé, fidèle au devoir ; elle a eu de ses enfants tous les soins physiques imaginables… »
Il est à noter que bien qu’ayant rompu avec lui, la comtesse se soucie toujours de la conduite de son amant et de sa tenue morale. Elle veut qu’il lui fasse honneur. Elle lui demande d’avoir du « goût », et tâcher de lui « épargner les publicités grossières ». Elle lui envoie durement ses « vérités ».
*
Et puis, quelle découverte ! Voici que Liszt fut l’un des adorateurs de la « Dame aux Camélias », de cette pauvre Mariette Duplessis dont Alexandre Dumas a fait l’héroïne de son célèbre drame. Liszt pleure sa mort, et il ajoute : « Elle me disait, il y a quinze mois : « Je ne vivrai pas ; je suis une singulière fille et je ne pourrai y tenir, à cette vie que je ne sais pas ne pas mener et que je ne sais pas non plus supporter. Prends-moi, emmène-moi où tu voudras : je ne te gênerai pas, je dors toute la journée ; le soir tu me laisseras aller au spectacle, et la nuit, tu feras de moi ce que tu voudras ! » Liszt dit encore (mai 1847) : « L’habitude de ce qu’on nomme (et de ce qui est peut-être) corrupteur, ne l’atteignit jamais au cœur… Croiriez-vous que je m’étais pris pour elle d’un attachement sombre et élégiaque, lequel, bien à mon insu, m’avait remis en veine de poésie et de musique. C’est la dernière et seule secousse que j’aie éprouvée depuis des années. » Ainsi Mariette Duplessis avait pu attirer et retenir un grand artiste, le charmer, l’émouvoir ; et il est touchant de penser qu’elle put être, un instant, l’inspiratrice de Liszt.
*
Il y a tant de choses dans ce deuxième volume que je feuillette, – après l’avoir lu très attentivement, – même des pensées qu’il ne serait pas vain de méditer. Par exemple, ce mot de l’auteur des Contemplations : « Victor Hugo, à propos du Requiem, a dit que la musique était le dernier des arts, parce qu’elle vieillissait. « La musique prend des rides », a-t-il dit. » Négligeons l’exemple du Requiem de Mozart qui n’est certes point une de ses meilleures œuvres et dont il n’est, d’ailleurs, qu’en partie l’auteur. Il est certain que rien ne va vite comme le renouvellement des éléments du langage musical, de sa morphologie et de sa syntaxe. La musique de Lully et de Rameau est déjà presque une langue morte que le vulgaire ne saisit plus, tandis que la langue de Molière reste toujours vivante.
Il y a surtout une page tout à fait remarquable où Liszt s’explique de la façon la plus nette et la plus pénétrante sur « la musique à programme. » C’est à propos de sa Dante-Symphonie et de sa Faust-Symphonie. « S’il advient que (ces œuvres) soient exécutées à Paris, écrit-il à Mme d’Agoult, je vous demanderais de les entendre et de prendre votre plaisir en patience. » (L’expression est jolie.) « En attendant, je souscris entièrement et sans réserve aucune à la règle que vous voulez bien me rappeler, que les œuvres musicales « en suivant d’une manière générale un programme, doivent avoir prise sur l’imagination et sur le sentiment indépendamment de tout programme. » C’était fort bien dit de la part de Mme d’Agoult. Liszt ajoute pour son propre compte : « En d’autres termes : toute belle musique doit premièrement et toujours satisfaire aux conditions absolues, inviolables et imprescriptibles de la musique. Proportion, ordonnance, harmonie et eurythmie y sont aussi indispensables qu’invention, fantaisie, mélodie, sentiment où passion. » Et, cherchant à cette règle une application, il en vient à cet exemple tout à fait significatif : « Le reproche souvent fait à M. Wagner (et qui vous paraît encore assez plausible) de sacrifier à un programme poétique les exigences de l’art musical est non seulement très injuste, mais nul de fait. » Ces lignes étaient écrites en 1864, alors que plus de la moitié de la Tétralogie était composée et Tristan terminé. Liszt observe que Wagner a écrit de la musique dramatique et non de la musique à programme, ce qui est tout différent, et que, d’ailleurs, les ouvertures du Vaisseau fantôme et du Tannhäuser ou les préludes de Lohengrin et de Tristan, qui peuvent être considérés comme de la musique à programme, satisfont tout aussi bien aux lois de la musique pure que les ouvertures d’Iphigénie en Aulide, de Don Juan, du Freischütz ou d’Obéron.
Pour Berlioz, Liszt se montre un peu plus embarrassé. Il s’esquive : « Quant aux œuvres symphoniques de M. Berlioz, que vous croyez passibles d’un reproche analogue à celui qu’encourt si innocemment M. Wagner, elles touchent à d’autres questions qui, pour être sérieusement examinées, exigent plus de développement. » La Symphonie fantastique, en effet, pourrait-elle « avoir prise sur l’imagination et le sentiment » indépendamment de la connaissance du programme qui a inspiré l’œuvre ?
Nous savions déjà (mais nous en trouvons dans cette correspondance de nouvelles preuves), que Liszt n’était pas seulement un musicien de génie mais une grande intelligence.
Un grand cœur aussi, et je n’énumère point ici tous les traits de sa générosité.
Un cœur fier, enfin, et que le sentiment justifié de son incomparable valeur d’artiste soutenait dans son attitude si digne vis-à-vis d’une société encore peu disposée à admettre l’égalité du talent et de la naissance ou de la fortune. C’est après je ne sais quelle sotte histoire d’une grande dame que Liszt prononça ce mot : « Personne au monde, les têtes couronnées exceptées, n’a le droit de me faire chercher comme on fait chercher un valet de place. »
Ce que je ne comprends point, c’est le mot cruel que prononça Liszt lorsqu’on 1876 il apprit par les journaux la mort de « Daniel Stern » (pseudonyme littéraire de la comtesse d’Agoult). Il écrivit alors à la princesse de Wittgenstein, à propos de celle qu’il avait aimée d’un amour si profond durant plus de onze années (de 1833 à 1844) : « À moins d’hypocrisie, je ne saurais la pleurer davantage après son décès que de son vivant… Mme d’Agoult avait éminemment le goût et la passion du faux, excepté à certains moments d’extase dont elle n’a pu supporter le souvenir. »
Parole énigmatique que ne suffit pas à expliquer le dessein de complaire à la princesse.
*
Nous allons quitter, bien à regret, cet incomparable Liszt. Mais pas avant d’avoir cité le saisissant portrait que traçait de lui, à 23 ans, une vieille amie de Mme d’Agoult : « La porte s’ouvrit et une merveilleuse apparition s’offrit à ma vue. Je dis apparition parce que je ne trouve pas d’autre mot pour rendre le sentiment extraordinaire qui me remua à la vue de l’homme le plus prodigieux que j’aie jamais vu. Une haute stature et de la plus extrême minceur, un visage pâle avec de grands yeux d’un vert de mer profond qui lançaient des éclairs éblouissants, une expression de souffrance et pourtant de puissance sur le visage, une démarche qui planait et semblait bien plus glisser sur le sol qu’y poser solidement, un air de préoccupation et d’inquiétude, comme celui d’un spectre pour lequel sonne la cloche qui le rappelle dans les ténèbres… »
Que son image maintenant rentre dans les ténèbres du Passé.
Mais parlons un peu de ses enfants.
Quand Liszt rompit sa liaison avec la comtesse d’Agoult, il confia ses enfants à sa mère. Mme d’Agoult les voyait souvent.
La nouvelle amie du grand musicien, la princesse de Wittgenstein, voulut soustraire Blandine, Cosima et Daniel à une influence dont elle était jalouse. Elle leur imposa comme éducatrice – on se demande de quel droit, – une terrible femme, Mme Patersi, naguère sa propre institutrice, qui se dépeint au vif par ce seul trait : on l’appela de Saint-Pétersbourg en la priant de se rendre directement par Weimar à Paris. Habituée aux calèches de poste de la Russie, elle trouva inconvenant de s’étendre sur les coussins d’un wagon, si bien qu’elle accomplit, assise toute droite, raide comme un piquet, le long trajet de Pétersbourg à Weimar. Là, elle fut obligée de s’arrêter, malade de son effort. Elle repartit bientôt.
Les enfants furent d’abord effrayés à l’arrivée de cette sévère personne qui les enlevait à l’affectueuse tutelle de Mme Liszt. « J’ai eu une grande peine à quitter grand’mère », écrit Cosima. Mme Patersi ne peut empêcher, bien à regret, que Blandine et Cosima fassent de temps en temps visite à leur mère. Il en résulte toutes sortes d’histoires contre la niaiserie desquelles proteste Cosima. Elle s’en explique à son père avec une belle franchise, qui nous plaît : « Nous ne nous habituerons jamais, écrit-elle, à l’idée que le retour de notre mère vers nous soit une source de cachotteries, d’intrigues et de choses pires encore et plus stupides. »
Alors, sous l’inspiration de la princesse de Wittgenstein, Liszt enlève ses enfants de Paris et les envoie à Berlin auprès de la mère de son élève préféré, Hans de Bülow.
Nouveau déchirement pour les jeunes filles et leur frère. Si loin de leur grand’mère et de leur mère ! Mais elles acceptent avec une entière soumission les volontés de ce père pour lequel elles ont un culte : elles sentent la grandeur de son génie, et aussi sa profonde bonté, masquée quelquefois par ses faiblesses à l’égard de la redoutable princesse.
Hans devient leur maître de musique et, naturellement, il s’éprend de ses élèves. Cosima surtout le séduit. Il écrit au père : « Elle n’a pas seulement du talent, mais du génie… J’ai été saisi et profondément touché en reconnaissant, dans le jeu de Mlle Cosima, Liszt en personne. »
Il écrit encore à Liszt : « Tes filles sont tristes que tu ne t’occupes pas du tout d’elles, mais tristes avec une résignation toute chrétienne. » Liszt, en effet, restait parfois des mois, sinon des années, sans voir ses filles. « Elles attendaient en vain depuis une semaine des nouvelles de Paris et se plaignaient de leur déception. Je leur demandai avec la sympathie la plus discrète possible pourquoi elles ne se plaignaient pas directement à toi de ce manque de nouvelles. Mlle Cosima m’a répondu : « Je ne me plains jamais de ce qui m’afflige le plus. »
Dure enfance que celle-là, loin de ceux qu’on aime. Mais cet abandon, cette sorte de solitude morale trempe un caractère. Admirable préparation à la future « mission » de Cosima.
On sait comment Cosima épousa Hans de Bülow qu’elle quitta pour se dévouer à Richard Wagner et à son œuvre.
Au cours de cette suprême et sublime aventure, Cosima emportait dans les milieux allemands un peu de l’esprit français et de son influence, – ne l’oublions pas, – dont il serait juste de tenir compte.
N’oublions pas que Wagner, vieilli, dans ses jours de gaîté, se divertira de son travail en lisant la Dame blanche de Boieldieu ou Cendrillon de Nicolo Isouard, – quand ce ne sera pas, le fait est amusant, en jouant à quatre mains, avec sa femme, les Symphonies de Haydn.
CHAPITRE X
CHOPIN ET GEORGE SAND
Liszt et Mme d’Agoult avaient pour amis intimes Chopin et George Sand.
Nous avions abandonné Chopin au moment où il allait justement s’éprendre de George Sand.
Comment la rencontre eut-elle lieu ?
Pendant une soirée, donnée chez la marquise de Custine, alors que Chopin était lancé à corps perdu dans une improvisation sur un thème polonais, les Adieux du lancier, il aurait aperçu devant lui, tout près du piano, recueillie, extasiée, une femme brune, grande et pâle qui lui rappela Marie Wodzinska : c’était George Sand.
Le charme aurait été irrésistible.
C’est du moins ce que raconte le comte Wodzinski dans son livre : les Trois Romans de Chopin.
Le comte a embelli la réalité, qui est beaucoup plus prosaïque.
Tout simplement, George Sand se fit présenter à Chopin par Liszt qui la connaissait par Mme d’Agoult. Elle alla le voir chez lui.
Mme Sand s’imposa et sut faire naître dans l’âme de Chopin l’amour qu’elle souhaitait.
Chopin s’enflamma d’une passion tout de suite très vive et qui dura.
Liaison singulière d’ailleurs entre deux êtres si différents, si peu faits pour se comprendre et même pour s’aimer, liaison pendant laquelle chacun des deux artistes ne pénétra rien de ce qui faisait la véritable originalité de l’autre, liaison qui cependant se prolongea une dizaine d’années.
Tout de suite, George Sand emmène Chopin aux Baléares, où elle conduisait son fils âgé de 15 ans, dont la santé l’inquiétait. Chopin lui-même, après un sursaut de vitalité, était retombé. Le mal dont il devait mourir, la phtisie, le faisait déjà cruellement souffrir et le tourmentait de sombres pressentiments. Aux « pays du soleil », Mme Sand espérait guérir Chopin, en même temps que son fils.
Ce fut une désastreuse aventure.
Logés d’abord dans trois pièces blanchies à la chaux, à Palma, chez un sieur Gomez, ils se trouvèrent au milieu d’une population hostile qui redoutait la contagion d’un mal trop facile à soupçonner chez notre musicien. George Sand et Chopin durent fuir. Ils s’installèrent dans une grande chartreuse aux trois quarts abandonnée. Dans sa cellule, le pauvre Chopin mourait d’ennui.
Le climat était doux. Mais il y eut six semaines de grosses pluies et de grande humidité.
Chopin se portait mal. Il toussait beaucoup. Il se voyait perdu. Le « thème de la mort » le poursuivait. Il était hanté par des apparitions terrifiantes, par d’affreux cauchemars.
Cette vie était insupportable.
On quitta enfin les Baléares.
De retour en France, George Sand et Chopin vécurent tantôt à Paris et tantôt à Nohant dans ce milieu d’artistes, d’hommes politiques, dont la femme-écrivain aimait à s’entourer : Pierre Leroux, Balzac, Louis Blanc, Edgar Quinet, Étienne Arago, Henri Martin, l’acteur Bocage, le chanteur Lablache, la grande cantatrice Mme Pauline Viardot, le peintre Eugène Delacroix, le violoncelliste Franchomme.
Chopin s’isolait volontiers. Il ne subissait aucunement l’influence des littérateurs, des peintres, des historiens, des hommes politiques auxquels il se trouvait mêlé. Il s’intéressait peu à leurs idées et à leurs œuvres. Enfermé en lui-même, il se suffisait et son génie n’avait pas besoin d’aliment étranger.
Ce n’était d’ailleurs ni un penseur, ni même un curieux.
Son imagination se bornait à développer les thèmes que lui fournissait sa très vive sensibilité, – sensibilité où la sensation, l’émotion, tous les états immédiats sans élaboration complexe tenaient la plus grande place.
Chopin continuait de vivre auprès de Mme Sand, mais toujours un peu « dans son coin ». L’agitation de cette femme ardente et toujours en mouvement le fatiguait.
Une brouille survenue, en 1847, pour un motif insignifiant entre George Sand et Chopin détermina bientôt une rupture définitive qui se préparait de longue date.
George Sand n’avait plus le même attachement pour celui qu’elle appelait autrefois « son cher malade ». Son rôle de « sœur de charité », accepté d’abord avec enthousiasme, finissait par la lasser.
Si, d’un côté, l’affection n’avait fait que croître, de l’autre, il n’y avait eu qu’un engouement passager, évanoui depuis longtemps.
Abandonné à lui-même, Chopin ne fait plus que traîner lamentablement les restes d’une pitoyable vie.
Il donne un concert salle Pleyel au bout duquel il s’évanouit.
Il part pour l’Angleterre.
Il revient en France en janvier 1849 dans un état désespéré. La maladie avait fait des progrès terribles. Ce n’est plus désormais qu’une lente agonie.
La phtisie laryngée qui le minait l’emporte enfin le 17 octobre 1849, à 4 heures du matin.
Les funérailles n’eurent lieu que le 30 octobre. Tout Paris suivait le cercueil. Chopin fut enseveli au Père-Lachaise, à côté de Bellini, mort jeune et du même mal, qu’il avait connu et aimé.
« Une main amie, dit le comte Wodzinski, jeta sur la bière un peu de cette terre natale qu’il avait emportée avec lui, il y avait de cela près de vingt ans, en souvenir de la patrie absente, – et l’on rendit à la patrie le cœur d’un fils qui l’avait aimée d’un si ardent et si tenace amour. »
*
Il y a quelque vingt ans, j’écrivais : « Chopin n’a pas eu de précurseurs, et il n’a pas eu davantage de disciples. Il n’est point un chaînon dans une longue évolution. Beethoven, si grand qu’il soit, continue Haydn et prépare Wagner. De l’un de ces trois artistes à l’autre, le progrès est continu : ils parlent la même langue et quelquefois avec le même accent, du même ton. Chopin n’est que Chopin. Ce qu’on a pu lui emprunter lui est tout à fait extérieur, n’est que son procédé. À personne il n’a livré quelque chose du secret de sa voix intérieure et lui seul il a pu parler son langage.
« Ce n’est pas à dire que son influence ait été nulle. Au contraire, elle fut considérable, mais très indirecte, et, pour en retrouver les traces, il faut lire au-dessous des apparences qui les contredisent des rapports cachés, souvent presque inexprimables. Qui dira, par exemple, la lointaine parenté des Préludes de Claude Debussy avec les Préludes de Chopin ? »
*
Chopin avait appris le piano à peu près seul.
Son premier professeur, Zywny, était violoniste. Le second, Elsner, ne lui fit travailler que l’harmonie et la composition.
Et il fut un admirable pianiste, au jeu fin, délicat, nuancé, d’un charme extraordinaire. La puissance lui manquait. Sa sonorité, un peu faible, était faite pour l’intimité.
Dans les vastes salles de concert, devant les nombreux auditoires, il n’avait pas l’action irrésistible de Liszt, qu’à cet égard il enviait.
Chopin n’a écrit, ou peu s’en faut, que pour le piano et en écrivant pour le piano, il ne songe pas, comme parfois Beethoven ou Liszt, à des effets d’orchestre ou comme Schumann au quatuor à cordes. Il ne songe qu’au piano, ne recherche que des effets de piano.
Chopin a composé deux Sonates, mais en général, il écrit des DANSES : valses, mazurkas, polonaises, ou bien des morceaux de pure fantaisie : préludes, impromptus, ballades, nocturnes, – ou enfin des études.
Danses passionnées, danses romantiques.
Toutes les émotions humaines s’y expriment : joie, souffrance, résignation, tendresse, mélancolie, amour, orgueil, colère, et jusqu’aux plus héroïques accents du patriotisme outragé.
La mélodie de Chopin a un parfum polonais très prononcé, mais elle a souvent une forme italienne. On dirait d’une mélodie vocale, avec toutes sortes de tours et de retours et comme un regret de s’achever. N’oublions pas que Chopin pleurait d’attendrissement en écoutant les airs de la Norma et des Puritains.
Mélodie très ornée, et d’ornements très étendus à l’opposé de la mélodie classique fort courte, et faite d’éléments étroitement serrés autour de la note à orner.
Mélodie accompagnée d’harmonies savoureuses inconnues des classiques et d’un intérêt expressif dont jamais jusqu’à Chopin on n’eût cru que l’harmonie réduite à elle-même fût capable.
Harmonies réalisées rarement en accords plaqués mais le plus souvent en arpèges et en toutes sortes de dessins variés.
« C’est à Chopin, disait si justement son ami le peintre Delacroix, c’est à lui que nous devons cette extension des accords, soit plaqués, soit en arpèges, soit en batteries, ces sinuosités chromatiques et enharmoniques dont ses Études offrent de si frappants exemples ; ces petits groupes de notes surajoutées tombant par-dessus la figure mélodique pour la diaprer comme une rosée et dont on n’avait encore pris le modèle que dans les fioritures de l’ancienne grande école de chant italien. Reculant les bornes dont on n’était pas sorti jusqu’à lui, il donna à ce genre de parure l’imprévu et la variété que ne comportait pas la voix humaine. »
Les rythmes de Chopin, toujours très accusés et quelquefois très puissants, restent en même temps infiniment souples et libres.
Le rubato prend dans cette musique une importance qu’il ne faut pas exagérer, mais qu’il serait cependant absurde de nier.
« Que votre main gauche, disait Chopin, soit votre maître de chapelle, et garde toujours la mesure. »
Autres recommandations :
« Toujours facilement ! »
et surtout :
« Pas de bruit ! »
*
Chopin est un romantique, mais sans esprit de système, sans idées préconçues comme c’est le cas pour Berlioz ou pour Liszt. Il n’a pas une philosophie de l’art. Il est toute spontanéité, tout instinct.
Du romantique, il a l’exaltation qui s’enchante d’elle-même. Il ne compose que d’inspiration et quand il est inspiré, il semble redouter de voir cesser le miracle et finir l’extase. Il y a en lui une sorte de tension vers l’infini de la jouissance artistique.
Je lui reprochais naguère un peu d’affectation, un peu de boursouflure. Je l’en excusais d’ailleurs, tant ce défaut me paraissait se traduire chez lui avec naïveté.
Je renonce aujourd’hui à ce reproche. Plus j’y pense et plus Chopin me semble suivre toujours sa nature et n’aller jamais au delà de sa sincérité. Il a, pour cela, trop de goût et ne saurait dépasser la mesure. Il est trop français. Et pourquoi ne ferait-on pas tout de même l’hypothèse qu’il coule en ses veines quelques gouttes de sang français ?
Pourquoi ajouter foi à ce racontar selon lequel la naissance de son père serait illégitime ? Quelle sotte histoire que celle où l’on fait intervenir ce grand seigneur polonais ! Légende destinée à embellir la réalité et qui la fausse. N’est-il pas plus simple et plus beau de supposer que Chopin est fils d’un Lorrain et que de sa double origine, à la fois française et polonaise, il a reçu deux sangs mêlés qui ont fait l’originalité de son caractère d’artiste, à la fois si enflammé et si harmonieux. Son œuvre, en effet, révèle un souci d’ordre et d’équilibre qu’elle doit bien certainement à la France, soit par la naissance de l’auteur, soit par son long contact avec le milieu parisien.
*
On a souvent considéré la musique de Chopin comme évocatrice d’une foule d’images et l’on a donné des titres à ses pièces de piano : la Goutte d’eau, le Jugement dernier, Finis Poloniæ. Ce serait une sorte de « musique à programme ».
Parmi les commentateurs de Chopin, l’un des plus récents, L. Binental, s’élève vivement contre cette façon de voir. Il ne veut pas que, dans la musique de Chopin, on considère autre chose que cette musique elle-même. Il n’a pas assez de railleries pour ces critiques qui y découvrent « le fracas des canons, les troupes de hussards galopant à perdre haleine, les gouttes de pluie tombant en cadence, ou les rafales qui balayent un cimetière ».
Voilà donc un Alfred Cortot en fort mauvaise posture, si l’on en croit notre auteur. Car vous n’ignorez pas que ce grand interprète a usé plus que quiconque de ces commentaires littéraires et pittoresques.
À l’appui de son sentiment, L. Binental cite une lettre de Chopin se moquant d’un Allemand enthousiaste, lequel, à l’occasion des Variations sur le motif de Don Juan : « La ci darem la mano » s’était livré à un débordement d’interprétations littéraires, considérant l’œuvre comme une série de « tableaux fantastiques ».
« Il dit de la seconde variation, écrit Chopin, que don Juan y court avec Leporello, de la troisième qu’il prend Zerline dans ses bras, tandis qu’à la main gauche Mazetto s’en fâche, de la 5e mesure de l’Adagio que don Juan embrasse Zerline sur le ré bémol majeur ! Plater m’a demandé hier où était le ré bémol majeur de Zerline… »
Pour Chopin, c’est là le comble du ridicule.
Dans une autre lettre, il se plaint des « titres stupides » que l’éditeur Wessel avait inscrits en tête de quelques-uns de ses ouvrages. Et, cette fois, il se met en colère. Il écrit à son ami Fontana : « Quant à Wessel, c’est un imbécile et un escroc… Si je m’écoutais, après cette histoire de titres, je ne lui enverrais plus rien. Dis-lui son fait aussi énergiquement que tu pourras… »
Voilà qui surprendra bien des fervents du Maître.
Le romantique Chopin interdisant l’accès de son œuvre à la littérature ! C’est à n’y pas croire.
Et L. Binental nous invitant à considérer les Nocturnes, les Préludes, les Ballades, les Polonaises comme de la « musique pure » !
On ne peut aller plus délibérément contre l’opinion commune qui tend à inscrire un « programme » presque sous chaque page de Chopin.
Pour ma part, je m’accorderais volontiers avec ce critique audacieux. J’admets sans difficulté, d’ailleurs, que toute musique n’a de véritable signification qu’elle-même, le compositeur eût-il trouvé l’occasion de sa première inspiration dans tel événement extérieur, telle aventure d’âme, telle lecture. La musique une fois composée, l’occasion d’où elle est née importe peu. Elle n’est plus que musique. Toute sa beauté consiste dans les secrets rapports des sons dont elle est faite et dans le mouvement qui en entraîne le développement.
Les vrais musiciens, en écoutant une œuvre, ne pensent à rien au delà de leurs sensations et de leur émotion, sans donner même aucun nom à cette émotion ni la rapporter à aucun objet extérieur. Et il n’est pas besoin de rien savoir de l’histoire de Chopin et des circonstances qui ont accompagné l’éclosion de tel Prélude ou de telle Ballade pour en saisir la signification essentielle, tout entière enfermée en son contenu sonore, pour en être profondément troublé.
Je comprends l’indignation de Chopin : « Écoutez ma musique ! Ne pensez pas à autre chose qui vous en distraira ! »
Tout de même je ne me montrerais pas aussi sévère que L. Binental, – et que Chopin, – et je laisserais chacun faire à sa guise et prendre son plaisir à sa façon.
Comment empêcher, en effet, certaines imaginations d’être excitées par cette musique si troublante, et certains auditeurs de lier leur émotion à des pensées diverses que la personne, la vie, la nationalité, les aventures de Chopin leur suggèrent ? Cela prouve peut-être que le plaisir proprement musical n’est pas en eux suffisamment intense, ne remplit pas entièrement leur âme et qu’il y faut un complément pour les satisfaire pleinement. Ces images, superflues pour les uns, ne le sont point pour les autres. Elles aident des sensibilités trop peu ouvertes à la musique à y trouver une joie entière. Elles contribuent à orienter et à développer l’impression sonore chez les amateurs insuffisamment doués : il ne faut pas en faire fi.
Et puis, n’oublions pas que même de grands musiciens – témoin Alfred Cortot – se repaissent de ces imaginations étrangères à l’œuvre. C’est qu’ils ne sont pas seulement musiciens. Ils éprouvent des besoins autres que celui du plaisir d’un sens. Ils ont une âme plus vaste et des facultés plus diverses que bien d’autres. Ils ne sont pas qu’un cœur et une oreille. Envions-leur peut-être la richesse des impressions simultanées dont ils sont capables.
Enfin, toutes les musiques ne prêtent pas également à ces efflorescences imaginatives, et l’on ne voit guère comment elles prendraient naissance autour de certains textes de Mozart, par exemple.
Pourquoi les compositions de Chopin et de la plupart des romantiques y donnent-elles lieu plus aisément ?
C’est là un mystère difficile à éclaircir, celui de la parenté des sons, des couleurs et des lignes.
Ou plutôt non, la question est ailleurs.
Les sons n’évoquent point directement tels objets dans l’espace ; mais les émotions qu’ils éveillent en nous se sont trouvées déjà associées à tels ou tels objets dont le souvenir reparaît alors.
Il faut croire que les romantiques sont sujets à s’émouvoir précisément plus que les autres des objets ou des événements extérieurs, et à ne point vivre pour ainsi dire d’une vie purement musicale, c’est-à-dire enfermée en soi, comme un Mozart.
Seulement la plupart des romantiques ont manifesté l’intention d’exprimer par leur musique toute leur existence passionnée dans un monde qui les touche si vivement. Il est fort curieux que Chopin ait repoussé si violemment toute interprétation littéraire, romanesque, poétique de ses œuvres. L. Binental a fort bien fait de le noter.
*
Chopin ne voudrait pas qu’on fît de la littérature autour de sa musique. Il n’en fait pas autour de lui-même et la lecture de ses lettres serait particulièrement décevante pour quiconque y chercherait la manifestation exaltée de ses joies, de ses souffrances, de ses passions.
Chopin écrit fort simplement, tout uniment, et semble éviter à tout prix de transformer ses états d’âme en thèmes littéraires.
Pour dire le vrai, Chopin n’est pas du tout un écrivain.
Sa correspondance n’offre d’autre intérêt que de nous donner quelques renseignements sur sa vie et de nous dévoiler, bien malgré lui, quelques traits de son caractère.
Les premières lettres, celles qu’il écrivait enfant, sont illisibles. À partir de la quinzième année, il a quelque chose à dire. Il compose déjà. Il devient l’organiste en titre du lycée où il fait ses études. Il confie la nouvelle à Jean Bialoblocki : « Ah ! monseigneur ! quel personnage suis-je devenu ! La première personne du lycée, après M. le Curé ! »
Ce Jean Bialoblocki est un ami qu’il aime tendrement, bien tendrement, d’une tendresse un peu particulière. Il l’appelle : « ma chère âme ». En parlant de valses d’un auteur à la mode qu’il lui envoie : « Tu verras, dit-il, qu’elles sont dignes de toi, c’est-à-dire aussi jolies que toi. » Et il termine une lettre par ces mots : « Maintenant, tends tes lèvres à ton ami fidèle. » Passages un peu gênants (j’en pourrais citer d’autres), qui marquent le côté féminin de la nature de Chopin.
Parfois des bouffonneries un peu dans le genre de celles de Mozart enfant : « Lorsqu’on est lié par une amitié de onze ans, que l’on a compté ensemble 132 mois, commencé ensemble 468 semaines, 3.960 jours, 94.040 heures, 5.702.400 minutes, etc. »
Dès qu’il voyage, Chopin a plus de choses à conter. De Berlin, il conserve le souvenir d’une ville démesurée : « Une population double y tiendrait sans doute à l’aise. » Il ne s’y plaît guère.
À Vienne, il commence à se faire entendre en public. « Je me suis décidé. Blahetka prétend que je ferai fureur, que je suis un virtuose de premier ordre et que l’on doit me ranger à côté de Moscheles, Herz et Kalkbrenner. »
Dès son premier concert, ce fut le grand, l’immense succès.
Et dire que ce merveilleux virtuose fut un autodidacte !
De retour à Varsovie, Chopin donne un concert, où Constance Gladkowska viendra. Elle est assise au premier rang. Elle lui sourit. Chopin est heureux.
Mais cet amour n’est pas assez fort pour le retenir dans sa patrie. Il sent que son destin est ailleurs et qu’il ne le réalisera dans sa plénitude que s’il se transporte sur une scène plus vaste.
Il hésite cependant : « J’ai des accès de rage, écrit-il. Je ne bouge toujours pas. Je n’ai pas assez de force pour fixer le jour de mon départ. »
Quitter Constance et quitter son foyer lui paraît si douloureux : « J’ai le pressentiment que, si je quitte Varsovie, je ne reverrai plus jamais ma maison. »
Un jour, en sortant de l’église, il aperçoit Constance : « Mes yeux ont surpris son regard. Alors, je m’élançai dans la rue et il me fallut un quart d’heure pour revenir à moi… »
Enfin, il se décide à s’éloigner de Constance : « De samedi en huit, je partirai, quoi qu’il arrive. Je mettrai ma musique dans une valise, son ruban dans mon âme, mon âme sous mon bras, et en avant dans la diligence. »
Il donne un dernier concert où Constance chante l’air de la Dame du Lac de Rossini : « O quante lagrime per te versai… » et le 1er novembre 1830, le voilà sur la route de Vienne.
Constance ne devait plus le revoir. Deux ans plus tard, elle épousait un gentilhomme campagnard. Puis ses beaux yeux bleus, que Chopin avait tant aimés, se fermèrent à la lumière : elle devint aveugle. Quelquefois elle se mettait au piano et chantait la belle cantilène : « Quante lagrime per te versai » et de ses grands yeux, restés limpides malgré la cécité, tombaient doucement des pleurs.
Arrivé à Paris, Chopin est ravi de tout ce qu’il y trouve de satisfactions diverses : « Ici seulement, écrit-il, on peut apprendre ce qu’est le chant. À l’exception de Pasta, je crois qu’il n’y a pas de plus grande cantatrice en Europe que Malibran-Garcia. »
Paris lui plaît aussi pour la liberté dont on y jouit : « Paris est tout ce que tu voudrais qu’il fût. Tu peux t’y divertir, t’y ennuyer, y rire, y pleurer, y faire ce que bon te semble sans que personne te gratifie d’un regard. »
En hiver, Chopin ne compose pas. Il est trop pris par ses leçons et par la vie mondaine. Et puis, le froid l’engourdit. L’inspiration lui revient à la belle saison, chez George Sand, à Nohant.
Un jour, à Paris, il écoute le jeune fils du grand violoncelliste Franchomme, violoncelliste lui-même, étonnamment doué comme son père. On avait juché le gamin sur le couvercle d’un piano à queue, son violoncelle entre les jambes, pour jouer quelque morceau de haute virtuosité. Chopin, tout en l’écoutant, admirait la bonne santé de ce gros garçon « rose, frais, chaud, écrit-il, et jambes nues… Moi, j’étais jaune, fané, froid, et trois flanelles sous le pantalon ! »
Pauvre Chopin !
Ce qu’il faut lire, ce sont les lettres d’Angleterre et d’Écosse.
Malgré sa rupture avec George Sand, qui lui a brisé le cœur, Chopin demeure sans amertume. Il a des paroles d’indulgence pour celle qu’il aima tant.
Ce qu’il faut admirer dans ces dernières lettres, c’est sa mansuétude, sa bonté au milieu des pires souffrances, sa crainte d’ennuyer ses correspondants en leur contant ses maux. Il y fait à peine allusion. Il ne se plaint pas, il n’a pas un mot de révolte, ni d’envie. Il s’enquiert de la santé des autres, songe à leur bonheur… Une âme des plus hautes, des plus pures, des plus généreuses.
Une âme de douceur, de tendresse, d’abandon alangui.
Certes oui. Mais pas toujours.
Il y a un Chopin violent, impétueux, auquel il faut aussi songer. Certaines de ses compositions le révèlent.
Son élève Georges Mathias parle de ses leçons tumultueuses : « Il a cassé, dit-il, une chaise devant moi. » Un jour, il flanque à la porte un jeune pianiste qui l’avait impatienté. George Sand a écrit : « Chopin fâché était effrayant. »
Et, pour finir, je cite Guy de Pourtalès à qui il faut toujours en revenir :
« À l’une de ses élèves il joua une fois par cœur quatorze Préludes et Fugues de Bach. Et comme la jeune fille exprimait son admiration pour ce tour de force : « Cela ne s’oublie jamais, dit-il en souriant. Depuis un an, je n’ai pas étudié un quart d’heure de suite. Je n’ai pas de force, pas d’énergie. J’attends toujours un peu de santé pour reprendre tout cela… »
« La dernière chose, disait-il, c’est la simplicité. »
Dédié à tant de prétentieux interprètes.
Et quelle conscience, quel souci de la perfection ! « Il s’enfermait dans sa chambre des journées entières, conte George Sand, pleurant, marchant, brisant ses plumes, répétant ou changeant cent fois une mesure, l’écrivant et l’effaçant autant de fois et recommençant le lendemain avec une persévérance minutieuse et désespérée. Il passait six semaines sur une page pour en revenir à récrire telle qu’il l’avait tracée du premier jet. »
*
George Sand était-elle assez musicienne pour sentir la grandeur du génie de Chopin ? Elle ne savait rien de la technique musicale, mais elle possédait un instinct assez vif des choses de la musique. Le fait est qu’elle en parle avec exaltation dans beaucoup de ses romans.
N’oublions pas que George Sand descendait d’une chanteuse de l’Opéra. Sa grand-mère, qui l’éleva, ayant épousé Dupin de Francueil, le familier de J.-J. Rousseau, avait en sa jeunesse joué le Devin du village, chantait Pergolèse, Hasse, Léo, Porpora, avait connu Gluck et s’accompagnait au clavecin. Son père jouait du violon et chantait l’opéra-comique.
George Sand écrit parfois à tort et à travers de la musique, en confondant les idées et les termes, mais toujours avec élan, avec amour. On se rend compte que la musique la touche profondément.
Et elle a eu le grand mérite, avec quelques autres romantiques, Chateaubriand, Gérard de Nerval par exemple, de s’intéresser pour la première fois à la chanson populaire. Jusque-là on méprisait fort ces chants du peuple. Ni les littérateurs ni les musiciens ne s’en occupaient. On peut dire que c’est le romantisme, la génération de 1830 qui a découvert la chanson du peuple et qui a songé à en recueillir les textes, – les littérateurs plus que les musiciens.
Ne risquons point cependant d’affirmations trop absolues. Rappelons-nous qu’avant les romantiques, – bien avant eux, même, – Montaigne a parlé avec admiration des villanelles de Gascogne dont il comparait « les naïvetés et grâces à la principale beauté de la poésie parfaite selon l’art ». La Fontaine, Molière, J. J. Rousseau ont fait allusion à des chansons populaires dont ils avaient su apprécier l’agrément et la vitalité.
Mais ce n’étaient là que des indications exceptionnelles, tandis que Chateaubriand, Gérard de Nerval, George Sand s’intéressent d’une façon continue à la chanson populaire. Chateaubriand, Gérard de Nerval ne signalent que leurs textes littéraires. George Sand la première, et la seule à cette époque, souligne leur valeur musicale. Elle voudrait qu’on les recueillît, qu’on ne laissât point se perdre ces sources pures de beauté.
La curiosité pour le Volkslied s’était manifestée plus tôt en Allemagne avec les Herder, les Gœthe, les Bürger et l’on crut même quelque temps que les seuls pays germaniques possédaient un si riche fonds de chansons populaires. Il fallut vite reconnaître plus tard que le fonds français était plus riche encore et plus varié.
Il est important de savoir que George Sand fut une des premières à ouvrir la voie du trésor.
Le principal initiateur en cette affaire c’est le musicologue Julien Tiersot, né à Bourg-en Bresse, en 1857, à qui nous devons une capitale Histoire de la Chanson populaire en France et aussi tout particulièrement un précieux livre intitulé la Chanson populaire en France et les écrivains romantiques (avec 96 notations musicales) où nous apprenons tout ce que nous devons en ce domaine à George Sand.
Quelques mots, en passant, sur ce Julien Tiersot que j’ai beaucoup connu. Un homme de haute stature. Les yeux un peu bridés, les pommettes saillantes, une longue barbe en pointe. Un rude travailleur et un critique de goût, un bon musicien, ce qui n’est pas si fréquent chez les musicologues. Une tête bien faite, un jugement bien équilibré, une vue nette des hommes et des choses qui lui permettait d’écrire, en 1917, ce solide aperçu du renouveau de l’art musical en France depuis 1870 qui s’intitule Un demi-siècle de musique française. Un fervent de l’art populaire et en même temps un adepte de toutes les nouveautés qui se produisirent en France entre César Franck et Debussy, un des premiers pèlerins de Bayreuth, un ami de Vincent d’Indy, de Bordes et de la Schola, sachant apprécier aussi bien la finesse et la complexité de l’art fauréen ou de l’art debussyste. Un ardent apôtre de l’éducation musicale du peuple, donnant lui-même l’exemple par des auditions et des conférences. Il avait une voix de ténor un peu aigrelette dont il usait avec adresse et infiniment de verve. Sa parole était chaude, claire, persuasive. Il avait beaucoup d’action sur ses auditeurs et il a fait beaucoup, ainsi que son ami Maurice Bouchor, pour répandre en France la pratique du chant choral.
Pour en revenir à George Sand, Julien Tiersot cite quelques passages de ses ouvrages relatifs à la chanson populaire :
« Les arbres étaient en fleurs ; les rossignols chantaient et j’entendais au loin la classique et solennelle cantilène des laboureurs, qui résume et caractérise toute la poésie claire et tranquille du Berri (Histoire de ma vie, IV, III).
« Aux époques de l’année où il n’y a pas d’autre travail et d’autre mouvement dans la campagne que celui du labourage, ce chant si doux et si puissant monte comme une voix de la brise, à laquelle sa tonalité particulière donne une certaine ressemblance… Le charme en est indicible, et, quand on s’est habitué à l’entendre, on ne conçoit pas qu’un autre chant pût s’élever à cette heure et dans ces lieux-là, sans en déranger l’harmonie » (La Mare au diable, II).
Julien Tiersot cite encore des pages très significatives du Meunier d’Angibault, de Jeanne, des Maîtres sonneurs, des Noces de campagne, etc.
Quant elle avait pour hôte à Nohant quelque musicien illustre, Chopin, Liszt, Meyerbeer, George Sand ne manquait pas d’attirer son attention sur la beauté, sur le charme profond de la chanson populaire du Berri.
« J’ai vu Chopin, écrit-elle, un des plus grands musiciens de notre époque, et Mme Pauline Viardot, la plus grande musicienne qui existe, passer des heures à transcrire quelques phrases mélodiques de nos chanteuses et de nos sonneurs de cornemuse. »
Que sont devenues ces notations de Chopin. On ne sait.
Mais pour celles de Mme Viardot, elles ne sont pas perdues. Julien Tiersot nous dit : « Mme Viardot, très intéressée par les premières auditions de chansons populaires que je donnai à Paris en 1885, et qui se sont renouvelées et multipliées par la suite des années, voulut bien me confier ses manuscrits. » Utilisant ces documents, les combinant avec ses recherches personnelles dans le Berri et avec les données fournies par les ouvrages de George Sand, Tiersot parvint à reconstituer dans leur intégrité (paroles et musique) un nombre important de chansons berrichonnes qu’il publia au cours de son livre sur la Chanson populaire et les romantiques. J’en signale au moins une assez curieuse par son mélange de 3/8 et de 2/4 et par l’intervention d’un si bécarre et d’un do dièse en sol mineur. Au demeurant, elle est charmante :

George Sand s’effarait parfois des bizarreries, des « harmonies barbares » de quelques-unes de ces chansons populaires. À ce sujet, Tiersot présente d’intéressantes observations que nous reproduisons d’autant plus volontiers qu’elles viennent appuyer quelques-unes des réflexions que nous inspiraient dans un autre volume[14] les « audaces » du groupe des Six.
« La plupart des airs qu’on vient de lire, dit Julien Tiersot, étaient en majeur ; et en effet, la pièce de l’instrument (la cornemuse) est disposée de façon à faire entendre les notes de cette gamme, et l’absence de clef rend difficile l’altération des degrés par le demi-ton (cela peut s’obtenir en bouchant un trou à demi, mais le moyen est peu praticable, surtout si l’altération est fréquente). Lors donc qu’il s’agit de jouer en mineur, les cornemuseux ont recours au moyen antique des échelles de transposition, prenant pour tonique la note la. Mais en même temps, les bourdons continuent à faire entendre les notes fondamentales du ton d’ut ; de sorte que tandis que le chant est exécuté en la mineur, l’harmonie reste celle d’ut majeur. Telle est l’explication des anomalies que George Sand a constatées… « L’instrument est incomplet, disait-elle, et pourtant le sonneur sonne en majeur et en mineur sans s’embarrasser des impossibilités que lui présenterait la loi. » Il est vrai. Mais il faut avouer que ces agrégations dont « l’étrangeté » lui paraissait « atroce » ne semble pas telle aux musiciens populaires, chez qui le sens harmonique est moins affiné ; le fait est qu’ils n’y prêtent aucune attention. Ils ne se préoccupent pas qu’une mélodie en la mineur soit accompagnée par les notes fondamentales de la gamme d’ut. Au reste, ces notes entrent presque toujours dans l’harmonie naturelle de la fondamentale, l’ut étant médiante de la tonique en la mineur. Aux cadences seulement, cette tonique la se trouve en contact de seconde avec le sol, dominante du ton majeur. Et qui sait, si l’on voulait pousser à fond ces investigations dans le sens de l’harmonie primitive, si nous ne trouverions pas dans cette superposition de deux tons un premier exemple de ce polytonalisme qui préoccupe les techniciens de nos jours ? Assurément, les ménétriers qui le pratiquent dans le Berri, comme dans les autres provinces de France et d’ailleurs, n’ont aucunement conscience de cette anomalie : ils font, eux aussi, du polytonalisme sans le savoir ! Mais le fait qu’ils en usent sans s’en douter pourrait être jusqu’à un certain point une justification pour une pratique qui donne lieu à tant de discussions « ex professo ».
On voit que Julien Tiersot a l’esprit large.
Voici le début du Chant des livrées (version instrumentale) tel qu’il se joue au Berri en la mineur avec accompagnement des bourdons ut, sol :

Au début de la Mare au diable, George Sand décrit le chant du laboureur. C’est une page fort belle. Elle insiste sur ce qu’on appelle le briolage, c’est-à-dire une série de cris plutôt qu’un chant, pour exciter les bœufs : c’est tout à fait curieux et Julien Tiersot en a noté des exemples fort intéressants :

Parmi les chants de laboureur, il en est un qu’il faut particulièrement signaler :

On y reconnaîtra textuellement, note pour note, le thème de la Symphonie pastorale de Beethoven. Comment expliquer cette étonnante rencontre ? « Que l’on n’aille pas imaginer, indique fort à propos Tiersot, des contacts dont l’impossibilité est évidente. Pas plus que le laboureur auvergnat n’a entendu la symphonie, pas plus Beethoven n’a connu la mélopée dont les indigènes du Plateau central ont, par aventure, gardé le secret dans leur tradition rustique. La vérité est que ces mélodies n’ont pas plus de patrie qu’elles n’ont d’âge. Comme elles sont de tous les lieux, elles sont aussi de tous les temps… Si l’on osait faire ici une application des plus transcendantes doctrines de la philosophie, on chercherait à expliquer le cas en faisant appel à Platon lui-même. De même, qu’il a rassemblé les Idées en quelque région mystérieuse, par delà les sphères, attendant que les initiés viennent puiser à leur source, de même nous pourrions croire qu’il est certaines essences musicales dont la révélation peut être obtenue par l’homme lorsqu’il sait s’élever vers elles : Beethoven et notre chanteur auvergnat ont été les élus. Ils ont, chacun pour sa part, emprunté une parcelle de la substance incréée ! Ainsi la même forme musicale apparaît-elle à la fois retrouvée et contenue dans la symphonie de l’artiste sublime et dans le chant fruste du montagnard. »
Ne nous éloignons pas davantage de Chopin. Nous avons suffisamment constaté qu’auprès de George Sand et dans la campagne de Nohant, il vivait dans un milieu favorable à la musique.
Plus généralement, il nous apparaît de plus en plus combien la musique sous tous ses aspects, depuis les plus rudimentaires jusqu’aux plus raffinés, était goûtée des romantiques de France et tout ce qu’elle dut dans son développement progressif aux littérateurs de 1830.
CHAPITRE XI
1836
LES HUGUENOTS
La plus célèbre partition de Meyerbeer.
Et pourtant sur aucune scène du monde on ne représente plus les Huguenots[15]. Cette sorte d’art, ou plutôt d’artifice, n’a plus aucune prise sur la foule, qu’il a tant émue autrefois. Cette musique est morte et l’on s’étonne aujourd’hui qu’elle ait pu vivre d’une vie si intense et faire illusion même à de bons juges. C’est que Richard Wagner s’est chargé d’apporter la satisfaction qu’ils réclamaient aux amateurs de grandeur, d’héroïsme, d’éloquence, par des moyens où la poésie authentique et la vérité prennent la place de la convention et de l’artifice. Le même public qui applaudissait autrefois les Huguenots s’empresse aujourd’hui aux représentations de Lohengrin et de la Walkyrie. Dans un juste combat, Wagner a définitivement tué Meyerbeer.
Les Huguenots ont été critiqués au lendemain même de Robert le Diable. Meyerbeer, emportant à Berlin le livret de Scribe, se mit immédiatement au travail. Et pourtant la première représentation n’eut lieu que le 26 février 1836. Cette longue attente fut due à des circonstances diverses. Mme Meyerbeer tomba malade. Pour sa guérison, un séjour en Italie fut jugé nécessaire. Meyerbeer conduisit lui-même sa femme à Milan et déclara que les répétitions de son œuvre à l’Opéra ne commenceraient qu’à son retour. Véron, directeur de l’Opéra, se fâcha et réclama aussitôt les 30.000 francs de dédit prévus par contrat en cas de retard dans la livraison du manuscrit de l’opéra nouveau ou dans la mise en train des études. Véron croyait tenir Meyerbeer. Mais c’est lui qui se trouva pris.
Quel ne fut pas son étonnement quand il reçut immédiatement les 30.000 francs de dédit (pour retard dans la mise en train des études) contre remise de la partition (déjà antérieurement livrée). Cette partition il aurait bien voulu la ravoir. Mais comment faire ? Impossible d’accepter les 30.000 francs et de retenir la partition, ou même de la récupérer. Il insista vainement. Meyerbeer ne voulait plus rien entendre. Il ne voulait plus avoir affaire à Véron. Il songeait à porter son ouvrage à l’Opéra-Comique. Singulière idée ! Mais enfin, Duponchel, succédant à Véron, dans la direction de l’Opéra, finit par obtenir que l’œuvre lui fût réservée.
Les répétitions furent longues et minutieuses. Meyerbeer exigeait la perfection dans le plus petit détail de l’exécution, et, au besoin, il se corrigeait lui-même. C’est ainsi qu’il écrivit de bout en bout en dernière heure, le fameux duo du 4e acte, et cela sur les indications de Nourrit, toujours d’excellent conseil.
Scribe se refusa à rien changer à cette partie de son livret. Il fallut qu’Émile Deschamps s’en mêlât et qu’il établît le texte de la nouvelle scène dont Nourrit avait suggéré l’idée. Meyerbeer ne fut pas un ingrat et à ce providentiel Deschamps il réserva une part d’auteur sur ses propres droits.
On fit par ailleurs de nombreuses coupures. Meyerbeer avait en effet l’habitude de composer de la musique surabondante, quitte à supprimer les passages reconnus superflus, à l’épreuve, des répétitions. Le personnage de Catherine de Médicis, qui devait présider à la bénédiction des poignards, fut complètement supprimé.
Le livret, rempli de gaucheries et d’invraisemblances, valait tout de même mieux que celui de Robert le Diable. Et puis Meyerbeer, avec tous ses défauts, avait tout au moins le talent de dessiner, à traits un peu gros, par sa musique, des types. Les figures musicales de Marcel, de Valentine, de Raoul, de Saint-Bris ne s’effacent pas de la mémoire. L’orchestre offre des effets d’instrumentation parfois heureux et qu’admirait Berlioz, qu’il donnait en exemple dans son Traité d’instrumentation.
Les deux premiers actes sont assez vides, et pleins de banalités. On y fête « les beaux jours de la jeunesse », le doux climat de la Touraine, le « bonheur de la table ». Quelle musique digne de ce nom inscrire sur ces tristes lieux communs qui s’expriment d’ailleurs en langage si vulgaire ? L’effet de contraste avec les horreurs de la Saint-Barthélemy dont il va être question est vraiment trop prolongé. Nous y apprenons qu’un jeune seigneur protestant, Raoul de Nangis, aime une jeune fille catholique, Valentine, fille du comte de Saint-Bris et dame d’honneur de Marguerite de Valois, reine de Navarre, ce qui donne lieu à la fade romance de Raoul, accompagnée par l’alto solo :

Marcel, soldat huguenot fanatique, domestique de Raoul, trouble « l’orgie » des amis catholiques de Raoul en proclamant sa foi de luthérien fidèle qu’il traduit en chantant le choral : « Seigneur, rempart et seul soutien du faible qui t’implore », dont le thème a déjà paru dans l’ouverture. Et à ce chant pieux, il enchaîne sa « chanson huguenote » : « Pif, paf, pif, paf » d’un effet curieux mais en somme peu réussi avec les notes trop graves du chant qui ne « sortent » pas et cet accompagnement bizarre de contrebasse et de petite flûte, instruments situés à l’extrême grave et à l’extrême aigu de l’orchestre et dont la grande distance laisse entre eux un vide pitoyablement béant.
Et jusqu’à la fin du 1er acte, nous ne trouvons plus, sauf la cavatine assez gracieuse du page, que des ensembles sans grand intérêt.
Sauf l’air du début : « Ô beau pays de la Touraine » assez joli, après tout, le 2e acte ne renferme guère de page digne d’être citée.
C’est seulement avec le 3e acte que le drame se noue et que Meyerbeer peut user des vertus agissantes de son lourd pathétique. Le duo entre Marcel et Valentine : « Ô terreur, je tressaille au seul bruit de mes pas… » est un des meilleurs moments de la partition[16].
Ce duo débute par un double motif :
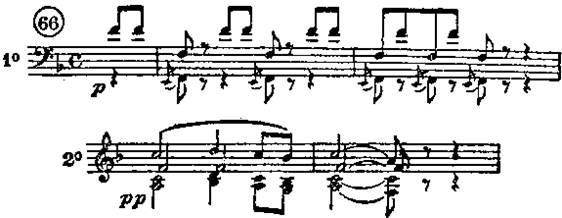
Évidemment ces deux motifs font allusion aux deux personnages en scène. Mais de quelle façon ? Le premier traduit l’allure lourde et en même temps l’esprit un peu gros de Marcel. L’autre exprime la tendre supplication de Valentine faisant des vœux pour le salut de celui qu’elle aime. C’est sur ces deux motifs que sera construite toute la Ire partie du duo. Il s’y ajoute un troisième élément de pur accompagnement qui paraîtra à la basse après la ritournelle :

et qui traduit le trouble, l’agitation de Valentine.
Le développement des deux thèmes se trouve interrompu par cette phrase :

d’une venue farouche, pleine de rondeur et d’entrain, un peu rude. On peut se demander pourquoi elle est accompagnée à l’unisson de la voix par les instruments les plus graves et les plus aigus (la petite flûte) ce qui donne un effet un peu pauvre et un peu creux. Notons l’analogie avec l’air de Marcel déjà mentionné : « Pif, paf, pif, paf… » Même accompagnement. Il y a là une instrumentation qui est donc caractéristique du personnage de Marcel, qui ne s’applique qu’à lui. De quelle façon le représente-t-elle ? Peut-être (je propose à tout hasard cette hypothèse), parce qu’elle fait allusion à l’orchestration très rudimentaire de certaines marches militaires où tous les instruments, y compris les fifres, jouent à l’unisson ou à l’octave. Marcel est un vieux soldat dont l’âme militaire se trouve symbolisée par une imitation de ces marches.
Après ce début très mouvementé, vient un Arioso à l’italienne :

Mais, à la différence des Italiens, Meyerbeer, présente sa phrase dans une écriture autrement soignée. Elle est écrite à trois parties également mélodiques, également chantantes, d’un effet extrêmement harmonieux. On reconnaît l’Allemand et l’élève de l’abbé Vogler.
Plus loin, il faut insister sur le caractère trépidant de cette basse :

qui souligne si bien le chant suffoqué de Valentine :

et l’on doit reconnaître l’importance expressive de la modulation de fa mineur en sol bémol majeur au milieu de la phrase.

Ces modulations aux tons éloignés sont chères à Meyerbeer et nouvelles de son temps. Ici, la modulation éclaire tout d’un coup la phrase d’une lumière douce et chaude.
Après les paroles et le chant tourmenté de Valentine, la phrase de Marcel en fa majeur sur des harmonies très simples et très claires produit une impression de contraste saisissante :

Ce duo est vraiment une des pièces maîtresses de la partition. Je ne me refuse nullement à en reconnaître la beauté sui generis, beauté aux formes un peu massives mais qui s’impose, si l’on veut bien se défaire de tout parti pris défavorable à l’œuvre.
Le Septuor du duel : « En mon bon droit j’ai confiance » me séduit beaucoup moins. Les combattants y « plastronnent » avec une naïveté vraiment un peu trop étalée.
Quant aux ensembles de la fin de l’acte, ils font surtout du bruit.
Le 4e acte s’ouvre par quelques mesures d’orchestre d’une allure tout à fait classique, puis vient la romance de Valentine, bientôt suivie de la Bénédiction des poignards. Il faut avouer que ce vaste morceau d’ensemble est construit de main de maître.
D’abord, ce trait expressif qui indique la résolution bien prise :

puis le récit de Saint-Bris, et enfin la phrase principale :

qui marque d’un accent si net la volonté tendue, avec le contraste d’un second membre plus mélodique témoignant d’un ardent enthousiasme :

Voilà les éléments essentiels du premier développement. Ensuite un nouveau thème paraît, solennel et puissant :

Il fait place, pour la bénédiction des armes, à de belles harmonies, singulièrement hardies pour l’époque :

Troisième développement sur ce rythme rapide :

Pour finir, retour du thème initial en toute force, dans un ensemble vocal impressionnant sur les batteries largement rythmées du plein orchestre. On ne peut se défendre d’un sentiment de réelle grandeur.
Dans la version primitive, le rideau tombait au 4e acte, après la Bénédiction des poignards. Au cours des répétitions, Nourrit, nous l’avons dit, suggéra l’idée d’une scène finale indispensable, à son gré, entre Valentine et Raoul. Nous avons dit aussi que Scribe refusa d’écrire les paroles de ce duo supplémentaire et que ce fut Émile Deschamps qui se chargea de la tâche. Meyerbeer, ne sachant encore que penser de cette addition peut-être intempestive, partait sur ces entrefaites pour Berlin, emportant le manuscrit. Huit jours après, il écrivait à Nourrit : « J’ai essayé d’écrire la musique de votre duo et j’avoue que je n’en suis pas trop mécontent. » Quand il fut rentré à Paris, on mit le nouveau duo à l’étude, mais, avant de convoquer au théâtre le compositeur, on attendit que la mise en scène fût réglée, tant on avait peur que Meyerbeer, toujours disposé aux remaniements, ne changeât encore une fois d’opinion.
En fait, ce duo du 4e acte est une des meilleures pages de la partition.
Voici la situation : Raoul, qui n’ignore pas le sort dont ils sont menacés, veut aller « secourir ses frères ». Valentine craignant qu’il ne soit massacré lui-même, veut le retenir. Dans l’âme de Raoul se livre un long et cruel débat entre le devoir et l’amour.
Il n’entend tout d’abord que la voix du devoir. Cette première partie du « grand duo » se déroule sur un motif d’accompagnement dont la signification est tout à fait parlante :

Il veut dire la résolution ferme prise par Raoul, mais qui lui coûte et qui lui fait la parole haletante (croches séparées par des demi-soupirs). Le long trait en triples croches exprime le grand effort, l’effort pénible d’énergie, de volonté qui soulève tout un monde de sentiments contraires.
Raoul supplie Valentine de le laisser partir :

Remarquons ici une fois pour toutes comme il faut de tout nécessité, selon les habitudes du « grand opéra », que les paroles les plus étroitement liées à l’action s’adaptent à la coupe régulière d’une phrase mélodique, même quand la situation requerrait une souplesse dans le chant qui le libérerait d’une rigueur aussi ordonnée.
Suprême argument, Valentine avoue son amour : « Si tu meurs, je meurs aussi… Reste… Je t’aime… »
Alors, voici paraître le thème le plus spontané, le plus expressif, le plus heureux de la partition :

Ce thème, une orchestration des plus mystérieusement enveloppées, nimbée d’une sorte de scintillement nocturne, la fait singulièrement valoir. Cette phrase caressante, elle demande à être murmurée, comme elle l’était par Adolphe Nourrit, grâce à l’usage admirable que ce grand artiste savait faire de sa voix de fausset dans le registre aigu. Depuis Duprez, nos forts ténors ont pris l’habitude de « hurler » cet ut bémol et c’est positivement horrible. Il n’y a pas lieu d’ailleurs d’espérer un retour à une première tradition définitivement abandonnée.
Après l’effet funèbre habilement produit par le coup de tocsin sonnant au lointain beffroi :

vient la stretta finale :

d’un fougueux emportement ; Raoul s’élance du balcon et disparaît. Valentine s’évanouit. Toute cette fin d’acte est d’un beau mouvement.
Le 5e acte renferme encore une page digne d’être retenue. C’est, après le choral de Luther, le trio de Marcel, Raoul et Valentine, accompagné par la seule clarinette basse, nouvelle recherche d’instrumentation inédite. Le trio est d’une écriture très pure et très émouvante. Marcel, debout entre les deux amants agenouillés, joint leurs mains et il bénit leurs « noces funèbres ». Le drame se clôt par leur mort à tous trois sous les coups des conjurés.
Meyerbeer avait su réunir pour l’interprétation de son œuvre des artistes d’élite : Nourrit (Raoul), Levasseur (Marcel), Lafont (Raimbaud), Dérivis (Nevers), Mlle Falcon (Valentine), Mlle Flécheux (le page). Le mystique Urhan accompagnait à la viole d’amour, puis à l’alto la romance « Plus blanche que la blanche hermine ».
La « première » des Huguenots fut un triomphe sans précédent. Meyerbeer fut définitivement sacré « l’un des plus grands génies de l’histoire. »
On l’égalait à Michel-Ange et à Beethoven.
Berlioz lui-même se joignait au chœur des admirateurs de l’incomparable chef-d’œuvre. Il parle de la dissonance brutale des trompettes à travers les cris de mort de la scène finale qui « resplendit comme une épée nue », et il ajoute : « Ce n’est pas une des moindres inventions d’une œuvre où, à côté de tant de beautés d’expression, les combinaisons nouvelles brillent en si grand nombre. »
Rossini, peu soucieux de se mesurer avec un rival aussi redoutable, lui adressait un flot de congratulations. Les deux compositeurs se disaient les meilleurs amis du monde. En réalité, ils se détestaient cordialement. « Qu’attendez-vous, disait-on à l’auteur de Guillaume Tell, pour donner une suite à votre chef-d’œuvre ? – J’attends, répondait-il, que les Juifs aient fini leur sabbat. » De son côté, Meyerbeer, contait-on, se vengeait en payant des spectateurs pour dormir ostensiblement aux opéras de son confrère Rossini.
Meyerbeer régnait et pour longtemps sur la scène française[17].
CHAPITRE XII
HAROLD EN ITALIE (1834) – REQUIEM (1837) BENVENUTO CELLINI (1838)
Après avoir affreusement calomnié Harriett Smithson par l’image qu’il offrait d’elle au public dans sa Symphonie fantastique, après mille et mille sautes d’esprit et de cœur, après s’être rapproché d’Harriett, après de multiples ruptures et raccommodements successifs, cet étrange Berlioz décida d’épouser l’actrice anglaise déjà vieillie et fort endettée. L’aime-t-il encore ? En a-t-il pitié ? Toujours est-il que le 30 octobre 1833, le mariage a lieu à l’ambassade britannique.
Le 21 novembre, concert organisé au bénéfice d’Harriett Smithson. Lamentable échec. La séance, annoncée pour 7 heures, ne commença qu’à 8, au milieu des protestations de l’auditoire indigné de ce retard excessif et traduisant sa colère par de terribles hurlements. À 1 heure du matin, elle n’était pas terminée. Les musiciens de l’orchestre s’esquivaient. Le public réclamait la Marche au supplice. Berlioz s’excusa et, s’avançant au bord de la scène : « Messieurs, implora-t-il, ayez pitié de moi ! »
Le bénéfice avait tout de même été de 7.000 francs, aussitôt engloutis dans le gouffre des dettes de Mme Berlioz.
Un nouveau concert mieux préparé réussit bien. Il comprenait au programme la Symphonie fantastique, unanimement applaudie. Et voici comment, selon Berlioz, la soirée s’acheva : « Pour comble de bonheur, quand le public fut sorti, un homme à longue chevelure, à l’œil perçant, à la figure étrange et ravagée, un possédé de génie, un colosse parmi les géants, que je n’avais jamais vu, et dont le premier aspect me troubla profondément, m’attendit seul dans la salle, m’arrêta au passage pour me serrer la main, m’accabla d’éloges brûlants qui m’incendièrent la tête et le cœur : c’était Paganini ! ! ! (22 décembre 1833). » Singulière rencontre de ces deux extravagants. Eut-elle réellement lieu ? Avec Berlioz, on peut toujours se poser de telles questions. Paganini aurait demandé à Berlioz de composer pour lui une œuvre. Et c’est ainsi que serait née dans l’esprit du compositeur l’idée de confier à un alto solo (Paganini) le personnage imaginaire d’Harold dans sa 2e symphonie : Harold en Italie. « J’imaginai, dit-il, d’écrire pour l’orchestre une suite de scènes, auxquelles l’alto solo se trouverait mêlé comme un personnage plus ou moins actif conservant toujours son caractère propre ; je voulus faire de l’alto, en le plaçant au milieu des poétiques souvenirs que m’avaient laissés les pérégrinations dans les Abruzzes, une sorte de rêveur mélancolique, dans le genre de Childe-Harold de Byron. De là, le titre de la symphonie Harold en Italie. »
Cette symphonie compte 4 parties : 1° Harold aux Montagnes ; 2° Marche des pèlerins chantant la prière du soir ; 3° Sérénade d’un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse ; 4° Orgie de brigands. Tous ces tableaux, fort pittoresques, Berlioz les a inventés de toutes pièces : il ne les a pas vus. L’Italie qu’il nous peint n’est pas celle que nous connaissons. Elle n’a rien de sa lumière, de son atmosphère, de sa vie, de sa joie. C’est une Italie sans sa pureté, ni sa sérénité, ni même sa sévérité à l’occasion. Les paysages et les personnages sont nés entièrement de l’âme inquiète et tourmentée de l’auteur qui n’exprime dans son œuvre que lui-même. C’est quelque chose. C’est tout. Et Harold, sans être le meilleur ouvrage de Berlioz, reste un témoignage tellement personnel, qu’on ne saurait l’oublier. La Marche des pèlerins surtout est remarquable. Mais l’idée n’était peut-être pas très heureuse de confier à l’alto le rôle d’instrument soliste, et le personnage principal. L’alto possède un très beau timbre mais qui sonne à la longue de façon terne et monotone. Au cas tout à fait invraisemblable où Paganini, habitué à « se servir » lui-même, aurait désiré jouer une composition de Berlioz, il n’aurait jamais accepté cette partie si peu brillante dans la 2e symphonie, partie à tel point effacée par endroits qu’on se demande si l’auteur n’a pas complètement oublié son alto solo. Le fait est que dans le final, Harold ne fait guère que « compter des pauses » et s’éclipse longtemps avant la conclusion. D’ailleurs, ce ne fut pas Paganini, ce fut tout simplement « le mystique Urhan » qui tint l’alto lors de la première audition d’Harold.
Cette première audition fut un événement.
Dans la salle du Conservatoire où Berlioz avait réuni une centaine de musiciens, on remarquait le duc d’Orléans, fils du Roi. « On se montrait la femme du jeune maëstro, la décorative tragédienne ; lui-même, l’auteur, svelte, d’un impeccable parisianisme, bien pris dans sa longue redingote à taille, petit, mais relevant avec fierté sa crinière rousse et son visage pâle » ; on se montrait Jules Janin, d’Ortigue, Eugène Sue, Legouvé, les Bertin, Victor Hugo, Sainte-Beuve, Lamennais, Castil-Blaze, Lesueur, Henri Heine, Alexandre Dumas…
On bissa la Marche des pèlerins.
Aux Débats, article enthousiaste de Jules Janin.
Succès factice, succès d’amis. Berlioz s’en rend compte et se désespère.
Une deuxième audition tombe devant un public insensible.
Maintenant, Berlioz essayait de se pousser à l’Opéra. Il mobilisait tous ses camarades journalistes pour une campagne de presse en sa faveur, qui excédait le directeur, Véron.
*
Cependant, grâce à la protection du duc d’Orléans, le compositeur incompris entrait comme chroniqueur musical aux Débats. Son premier article parut le 25 janvier 1835. Berlioz touchait cent francs par article. C’était beaucoup pour l’époque : un prix de faveur.
Alors, à propos des concerts du Conservatoire, Berlioz débute par des chroniques sur Haydn, Mozart, Weber, Gluck et surtout Beethoven. Critique singulièrement fantaisiste, d’un lyrisme débridé, d’un romantisme à tous crins, beaucoup plus littéraire que musicale, à grands mots et à grandes images. La Symphonie en ut mineur, par exemple, nous offre, selon Berlioz, le spectacle des fureurs d’Othello : « C’est tantôt un délire frénétique qui éclate en cris effrayants ; tantôt un abattement excessif qui se prend en pitié lui-même ; tantôt un débordement d’imprécations, une rage inouïe qui va jusqu’aux convulsions, à l’évanouissement… » Berlioz improvise au hasard, au petit bonheur. Et il faut bien avouer que tels commentaires n’ont aucun rapport avec le texte qu’ils prétendent illustrer. Littérature pour littérature, « le destin qui frappe à la porte » a tout de même plus de sens.
*
Berlioz songe toujours à l’Opéra. Il entreprend Benvenuto. Il fait annoncer « qu’il l’achève ». Le succès des Huguenots ne pouvait qu’enflammer son ardeur à triompher à son tour sur notre première scène lyrique… Ces Huguenots dont Schumann dira : « Après le Crociato, j’ai encore compté Meyerbeer au rang des musiciens ; après Robert le Diable, j’ai hésité ; mais, à partir des Huguenots, je le range sans façon parmi les écuyers de Franconi ! » Vraiment exagéré.
Berlioz, lui, ménage le tout-puissant confrère, et flatte le nouveau directeur Duponchel. Il ne ménage ni à l’un les témoignages de son admiration, ni à l’autre ses plus vives félicitations.
Mais comment travailler ? Berlioz était toujours à court d’argent, Harriett était une déplorable ménagère. Misère qui dessèche l’inspiration.
Pour que Berlioz puisse travailler à son Benvenuto, Legouvé lui prête deux mille francs.
Une bonne aubaine : on allait commencer à l’Opéra les répétitions de la Esmeralda, de Mlle Bertin. Berlioz se charge de surveiller les répétitions. Voilà qui lui enlève du temps pour avancer son Benvenuto, mais qui d’autre part le met en relations quotidiennes avec Duponchel. Il va pouvoir faire accepter son opéra.
Tout d’un coup, une autre affaire se présente : un Requiem avec 500 ou 600 exécutants dont il reçoit la commande. Un Requiem pour les victimes de Fieschi : « Faveur d’autant plus flatteuse, dit Berlioz, qu’elle ne fut pas sollicitée. » En réalité, depuis des mois, il assiégeait les bureaux du ministère afin de l’obtenir.
*
Le Requiem de Berlioz ne serait certainement pas celui de tout le monde. Il songeait à peindre une vaste fresque, une vision fantastique, « un colossal poème de la prière et de l’épouvante ». « Le texte de la Messe des Morts, dit Adolphe Boschot, devient un scénario, un programme pour une romantique et pittoresque symphonie mêlée de chœurs. » Mais Adolphe Boschot lui-même reconnaît que jamais Berlioz n’avait réussi à construire d’aussi classiques développements, à utiliser des thèmes pour des combinaisons aussi variées et aussi ingénieuses. Pittoresque et musical, les deux termes ne s’excluent pas pour un artiste doué comme l’est Berlioz. Au moins dans quelques-unes des meilleures pages du Requiem, le compositeur satisfait autant notre oreille que notre imagination visuelle.
Le Requiem de Berlioz diffère de toutes façons de tous les autres ouvrages connus sous le même titre et pour la même destination.
Il y a cinq Requiem particulièrement célèbres : celui de Mozart, celui de Berlioz, celui de Brahms, celui de Verdi, celui de Fauré[18].
Celui de Mozart, malgré son universelle réputation, n’est pas le plus remarquable de tous, il s’en faut. D’une belle écriture, sans doute. Et encore, au point de vue du style, il y a des pages de Mozart dans ses quatuors, ses sonates et ses symphonies, comme dans ses opéras, qui comptent bien davantage. Mais surtout ce Requiem de Mozart (et qui n’est pas entièrement de Mozart) est froid et terne. Quoi qu’on en dise, je n’ai jamais pu accorder une place privilégiée dans mes admirations aux œuvres religieuses de Mozart. Sa profonde piété, attestée par tant de passages de sa correspondance, n’arrive pas à s’exprimer dans sa musique : c’est un fait, à mon sens, contre lequel tous les raisonnements du monde ne vaudront pas, – et malgré l’autorité des appréciations de Henri Ghéon. Mais il fallait bien découvrir une valeur chrétienne à la musique de Mozart. Et la mode s’en est mêlée.
On ne peut pas dire que le Requiem de Berlioz procède d’une inspiration essentiellement religieuse. Mais les terrifiantes images de la mort et le mystère de l’Au-delà avec les troublantes hypothèses qu’il suggère ont vivement frappé l’imagination trépidante de l’auteur et il s’efforce à traduire ses visions effroyables avec une grandeur saisissante, quand il ne se laisse pas aller parfois à des impressions plus douces et qui pénètrent.
Le Requiem allemand de Brahms ne mérite guère l’attention qu’on lui accorde d’ordinaire. C’est une œuvre académique où tous les modèles imposés par la tradition se trouvent adroitement imités, de Bach et de Hændel à Mendelssohn, dans un style où l’on ne reconnaît même plus la mélodie habituellement si personnelle de Brahms. À qui en ignorerait l’auteur, on ne ferait jamais deviner qui a composé cette musique sans couleur et sans caractère.
Le Requiem de Verdi, plein de véhémence et violemment dramatique, exprime avec une grande beauté la tragédie de la mort et de la résurrection. Italien, il l’est profondément, je dis bien avec toute cette profondeur dont sont capables les grands Italiens quand ils ne s’en tiennent pas à la superficialité du chant mélodieux, savamment arrondi, et de la vocalise brillante. Et le miracle, c’est que le drame ne perd rien de sa force à se traduire dans un langage tout de même extrêmement brillant. La passion domine tout. Passion religieuse à sa façon, méridionale, toute en dehors, en grands élans, en grands éclats, en grands gestes, – mais inspirés.
Le Requiem de Fauré ne comporte aucun drame que tout à fait intérieur, intime. J’ai entendu chanter le Libera avec les accents déclamatoires d’une rhétorique enflammée. Fausse interprétation. Ce Libera est bien une supplication mais contenue, recueillie, telle qu’un Fauré seul peut la prononcer, soutenu par ce sentiment latent de confiance et d’espoir qui illumine d’un bout à l’autre la délicieuse partition. Pas de sombres images dans ce Requiem consolant qui est toute douceur, et, jusque dans la douleur et la souffrance, encore une caresse.
De toute façon, le Requiem de Berlioz n’appartient qu’à lui.
Déjà son début (Requiem et Kyrie) est extrêmement original. Il se construit sur une gamme qui s’essaye par trois fois à monter et s’arrête trois fois, un peu plus haut chaque fois, brisée par un silence :

Cette gamme, il la retournera, la fragmentera, utilisera d’une nouvelle manière chaque fragment, enfin emploiera comme il n’avait jamais fait encore les procédés des classiques. Et cela restera pourtant par l’instrumentation, par la couleur, dans une atmosphère unique, essentiellement berliozienne. Et toujours l’imprévu, l’imprévu d’un ordre qui ne se règle pas exclusivement sur la logique musicale, mais sur le texte littéraire. Berlioz commente souvent le mot et sa musique change ainsi d’aspect presque à chaque tournant de la phrase littéraire. Beethoven avait déjà donné par endroits dans sa Messe en ré l’exemple de cette façon de faire, de cette soumission éventuelle de la musique au texte littéraire, et par suite, disons-le, de ce décousu musical. Le seul Wagner a, plus tard, su concilier les deux exigences, poétique et musicale, qu’il s’était imposé de respecter sans rien sacrifier de l’une à l’autre. Son dessein de peindre, d’éveiller des images visuelles et de suggérer l’idée des gestes ou des actions ne nuit en rien à la logique de son discours sonore. À point nommé le développement d’un thème vient éveiller dans l’esprit la représentation sensible de la pensée exprimée par les mots. C’est un tour de force qu’il a été le premier à réussir à ce point de perfection, donnant ainsi un exemple que, par les moyens les plus personnels, suivront à leur tour les d’Indy, les Fauré, les Debussy. Mais enfin, à sa manière, Berlioz a composé un Introït vraiment puissant, évocateur, émouvant. Ne lui en demandons pas davantage.
La 2e partie du Requiem de Berlioz (Dies iræ et Tuba mirum) n’est pas celle que je préfère. Après une entrée en matière trop volontairement et trop facilement scolastique, elle se perd dans les effets tonitruants de masses cuivrées où la musique n’a plus grande part. Quatre fanfares de cuivres se donnent la réplique. Ce sont les trompettes de la Résurrection et du Jugement dernier. Elles se font entendre des quatre points cardinaux, et se répondent du Nord au Midi, de l’Orient à l’Occident, pour se réunir enfin dans un ensemble fracassant.
À ces quatre orchestres de cuivres, se joignent 70 voix de basses à l’unisson qui déclament la même terrible prose.
Mais ce n’est pas assez. Il faudrait « doubler ou tripler toutes ces masses », note Berlioz. Il faudrait réunir « un chœur immense de 700 ou 800 voix ! »
Il se laisse entraîner ici par son amour du colossal, du pyramidal, du babylonien, du ninivite. Et tout ce bruit qu’il fait sonne le creux. Il oublie la musique. Avec des moyens dix fois moins intenses, dans le final de Don Juan, Mozart produit infiniment plus d’effet.
Un ami de Berlioz écrivait, – sous sa dictée – en 1837 : « Une des propriétés les moins contestables de la musique de M. Berlioz est d’agir instantanément sur les organes physiques, d’ébranler les nerfs par des secousses répétées et de s’emparer soudainement de l’imagination par des effets inattendus. » Mais l’ébranlement physique n’est pas nécessairement suivi de celui de l’imagination, qui réclame des sollicitations d’un ordre choisi.
Que je préfère à toutes ces clameurs du Tuba mirum les huit dernières mesures pianissimo : « salva me, fons pietatis » d’une harmonie si touchante !
C’est l’ingénieuse transition à une troisième pièce de petite dimension et de caractère intime, le Quid sum miser, tout à fait charmant, fait de petits fragments très courts de thèmes du précédent morceau sans cesse interrompus par des silences et dont la misérable énonciation constamment brisée laisse une impression de pauvreté, d’humilité, de timidité extraordinaires ; tout à fait expressive et en rapport avec le texte à commenter. Invention géniale dans sa simplicité, sa nudité, et la succession de ses minuscules et, à dessein, indigentes répliques.

Le Rex tremendæ est à son tour d’un intérêt mêlé. La 1ère partie « Rex tremendæ majestatis » est d’une sonorité éclatante mais pompeux, théâtral, vide. Avec la 2e partie : « Qui salvandos salvas gratis » commence la douceur, et après de nouveaux et importuns éclats, le morceau finit délicieusement et pianissimo ; sur des harmonies choisies :

Maintenant le Quærens me, un morceau tout de douceur et de tranquillité, en contraste avec les fougues du Rex tremendæ, une pièce à trois voix sans accompagnement. Berlioz emploie, il est vrai, six portées et veut faire croire à une complication plus grande de contrepoint. Complication illusoire. Il n’y a pas six voix réelles, mais trois seulement, sauf quelques petits détails insignifiants. Il aime jeter ainsi de la poudre aux yeux. Mais la pièce est charmante et elle plaît au milieu de tout ce fracas pour sa caresse. On n’est pas fâché non plus d’écouter les voix seules et que les instruments si bruyants jusque-là se taisent. Effet savamment calculé.
Avec le Lacrymosa nous revenons au bruit de tonnerre, aux effets de masses, aux masses divisées, à tout un arsenal d’artillerie musicale un peu vaine.
Nouvelle opposition. Après les tempêtes du Lacrymosa, un Offertoire (chœur des âmes du purgatoire) tout en demi-teinte. Il débute à l’orchestre par une belle monodie des violons :

avec, pour finir, un majeur de lumière et d’espoir.
Hostias et preces : court morceau, où Berlioz s’essaye à tenter des sonorités nouvelles : celles de trois flûtes assemblées en accords sur une basse de huit trombones, les trombones eux-mêmes invités à descendre dans le grave jusqu’à des profondeurs encore inexplorées. « Ces notes pédales, écrit-il sur sa partition, sont peu connues même des exécutants ; elles existent cependant, et sortent même assez aisément lorsqu’elles sont ainsi amenées. »
Sanctus. Nouvelles recherches d’effets d’orchestre : quatre violons soli dans l’aigu, les altos divisés en trémolo « serré », flûte, sonorité irréelle. Puis une fugue avec cette indication répétée à chaque entrée de voix : « Chantez sans violence, en tenant bien les notes au lieu de les accentuer isolément. » Indication à méditer dont les chœurs devraient faire leur profit pour l’exécution de n’importe quelle fugue. Mais non ! Au lieu de cela on a la coutume de marquer chaque entrée par un sf, puis de laisser éteindre immédiatement le son : procédé du plus détestable effet.
Agnus Dei. Il fallait en finir avec ce Requiem. Et Berlioz, sans doute pressé, se borne à recopier ici, une partie de son premier morceau et l’Hostias tout entier. Mais il ajoute un début neuf et une conclusion nouvelle. Et l’ensemble est fort beau. Le Requiem se termine sur une impression profonde et pénétrante.
Il devait être exécuté le 28 juillet 1837 aux Invalides.
Dix jours avant, on le décommande.
Quelle affaire ! « C’est infâme ! » s’écrie Berlioz.
Mais il se remet vite. « L’ouvrage existe, c’est toujours ça. » On trouvera certainement une occasion de le produire !
Il est tout de même furieux : « J’appelle une telle conduite du gouvernement tout bonnement un vol ! On me vole mon présent et mon avenir… C’est un vol manifeste… C’est un abus de confiance, un abus de pouvoir, une saleté, un tour de gobelet, un vol… »
Le 23 octobre, à 2 heures, on apprend la prise de Constantine et la mort du commandant en chef. Le 25 on chante un Te Deum à Notre-Dame. Mais Berlioz réclame une place pour son Requiem (en l’honneur du commandant en chef). Il obtient enfin (19 novembre), du ministre de l’Intérieur, l’autorisation d’en annoncer l’exécution aux Invalides. Le 4 décembre, répétition générale qui est déjà une « solennité fashionable ». Alfred de Vigny, qui y assistait, note dans son Journal : « Musique belle et bizarre, sauvage, convulsive et douloureuse… Effets imprévus, mais calculés exprès. » Le 5, exécution publique.
« Impression foudroyante, écrit Berlioz à ses parents. Au moment du Jugement dernier, l’épouvante produite par les cinq orchestres et les huit paires de timbales accompagnant le Tuba mirum ne peut se peindre ; une des choristes a pris une attaque de nerfs. » Croyons-le, si nous voulons.
En réalité, aux Invalides, solennité officielle, d’où le vrai public était absent. Et très judicieusement Adolphe Boschot remarque : « De fait, pour la majorité du public, le Requiem avait passé presque inaperçu. » Mais autour de l’événement, dans le petit monde des musiciens, Berlioz faisait « un tapage d’enfer. C’était là le danger. Il ne triomphait sur personne, puisqu’il n’avait pas de public venu pour lui. Mais il triomphait aux yeux de ses concurrents, de ses envieux. Et déjà on lui en voulait d’être trop ouvertement protégé par les Bertin, par les Débats, par les ministres et par le duc d’Orléans. Le succès du Requiem, stimulant les protecteurs de Berlioz, poussait Benvenuto à l’Opéra, – sans doute pour une chute ».
*
C’est Berlioz lui-même qui avait fourni à ses librettistes, Auguste Barbier, Léon de Wailly les éléments du livret de Benvenuto. Il les avait empruntés aux Mémoires de Benvenuto Cellini et à un Conte fantastique d’Hoffmann. La scène se passe à Rome, au XVIe siècle, sous le pontificat de Clément VII, les lundi, mardi gras et mercredi des Cendres. C’est le carnaval. Benvenuto parcourt la ville avec une bande de mauvais sujets, lançant des confetti aux vieux barbons, et des fleurs aux jolies filles. Il entre chez Messer Giacomo Balducci, trésorier du pape. Il y trouve, seule, Térésa, la fille de Balducci, à qui il fait une cour pressante : celle-ci se laisse enjôler. Le médiocre ciseleur, Fieramosca, fournisseur du pape, surprend les amoureux sans laisser deviner sa présence. Balducci rentre chez lui. Benvenuto s’esquive et voyant dans les mains de Fieramosca un bouquet, se figure que c’est lui l’amoureux de sa fille. Il appelle servantes, voisines et toutes les commères du quartier et livre à leurs coups ce benêt de Fieramosca, qui va subir une rude bastonnade. La toile tombe sur un ensemble très mouvementé, dont plus tard, en 1844, Berlioz utilisera les motifs pour l’ouverture dite du Carnaval romain.
Deuxième tableau : Mardi gras, la place Colonna. Une fontaine. Au fond la colonne de Marc-Aurèle. À droite un théâtre de pasquinades. À gauche, une taverne. Cellini, seul, chante son amour et son espoir de revoir et d’enlever sa belle maîtresse. Les ciseleurs arrivent en foule pour célébrer leur métier et boire. Le cabaretier réclame son dû. Fort à propos, le pape envoie à Benvenuto une bourse pleine d’or que lui apporte Ascanio l’accompagnant d’un sermon ridiculement solennel. Mais Benvenuto n’a qu’une pensée : enlever Térésa. Pour l’aider dans son entreprise il envoie ses élèves se cacher et se grimer dans le théâtre de pasquinades. Fieramosca, toujours présent quand il ne faudrait pas, a écouté le complot. Accompagné du spadassin Pompeo, il complote à son tour d’enlever Térésa. Sur la place Colonna, la foule des masques s’amasse. Les comédiens du théâtre de pasquinades annoncent leur spectacle. Entrent Balducci et sa fille d’une part, Cellini et Ascanio d’autre part déguisés l’un en pénitent blanc, l’autre en moine brun. Sur la place grand tohu-bohu, grand brouhaha. Sur le petit théâtre la pantomime commence. Délicieuse ariette d’Arlequin. Grotesque cavatine de Polichinelle. Le roi Midas, sur la scène, s’est fait la tête de Balducci, enjolivée de superbes oreilles d’âne. Balducci se précipite, furieux, vers les bateleurs. Il s’éloigne ainsi de sa fille et laisse le champ libre aux amoureux. Et justement voici deux « pénitents blancs » aux côtés de Térésa : Cellini et Fieramosca. La jeune fille est incapable de reconnaître lequel est Cellini. Benvenuto perdant patience dégaine et tue Pompeo. On l’arrête. Il est perdu. Mais le canon du fort Saint-Ange tonne. Toutes les lumières s’éteignent. C’est la fin du carnaval. Dans une grande confusion, à la faveur de l’obscurité, les amis de Cellini rossent le guet et délivrent Cellini qui se sauve tandis qu’Ascanio entraîne Térésa. Merveilleux final.
Troisième tableau : Mercredi des Cendres. L’atelier de Benvenuto à l’aube. Au premier plan, le Persée que Cellini doit fondre pour le pape. Chœur des fondeurs. Térésa entre, amenée par Ascanio. Mais où est Cellini ? On ne l’a pas revu. Au dehors on entend un chant mélancolique. Ascanio chante à son tour une barcarolle. Puis ce sont les chœurs d’un cortège religieux qui passe. Térésa s’agenouille se signe, et prie avec Ascanio pour Cellini. Mais voici Cellini lui-même. Survient Balducci, puis Fieramosca. Dispute. Benvenuto veut les pourfendre. Entre le pape. Le pape attend avec impatience son Persée. Si Cellini arrive à le fondre le soir même, il épousera Térésa : sinon il sera pendu.
Quatrième tableau : La fonderie de Benvenuto, au Colisée. Cellini travaille. Mais le métal manque. « Je suis perdu », s’écrie Cellini. Il jette tout ce qu’il trouve dans le brasier, statuettes, aiguières, plats d’argent. Et c’est la victoire… et le mariage promis.
« Honneur aux maîtres ciseleurs. »
Sur ce livret étincelant de vie, de joie, de passions diverses, aussi peu semblable que possible aux textes des grands opéras de Meyerbeer, Berlioz écrit une partition toute brillante des plus vives flammes de son génie, tour à tour douce et tendre, recueillie, insinuante, exubérante, brûlant de mille feux, éclatant en mille saillies inattendues, resplendissante, éblouissante de mille couleurs diverses.
Mais qu’importent tous ces mérites ? Le public n’est pas prêt pour cette musique-là. Le 1er septembre 1838 la répétition générale reçoit un accueil douteux. Le rhume du ténor fait remettre la première au 10. Le 10 la salle est houleuse. L’ouverture cependant est acclamée. Mais le livret est condamné, surtout pour quelques expressions familières. On rit, on siffle, on n’écoute pas la musique. D’avance les auditeurs avaient leur siège fait. Berlioz était un symphoniste, – s’il était quelque chose, – et non un homme de théâtre.
Quel effondrement pour Berlioz !
Que lui importent les articles favorables des confrères ?
C’est le public qu’il voulait conquérir. Or, à la 2e, à la 3e représentation, le public ne vient pas. Personne. Recettes lamentables.
Berlioz, épuisé de fatigue et de chagrin, prend le lit. Il désespère d’être écouté à l’Opéra. Il va s’orienter de nouveau vers la symphonie[19].
CHAPITRE XIII
ROMÉO ET JULIETTE DE BERLIOZ (1839)
SYMPHONIE FUNÈBRE ET TRIOMPHALE (1840)
WAGNER À PARIS
Pour se consoler de son échec à l’Opéra, Berlioz donne des concerts. Dans la petite salle du Conservatoire, devant son public, il obtient des succès d’enthousiasme. À la fin d’une de ces séances, Paganini, cette fois bien réellement présent, s’agenouille devant lui aux acclamations de l’auditoire électrisé.
Le surlendemain il reçoit cette lettre (en italien dans l’original) :
Mon cher Ami,
Beethoven mort, il n’y avait que Berlioz qui pût le faire revivre ; et moi, qui ai goûté vos divines compositions, dignes d’un génie tel que le vôtre, je crois de mon devoir de vous prier d’accepter en hommage vingt mille francs qui vous seront remis par M. le baron de Rothschild, sur la présentation du billet ci-joint.
Croyez-moi toujours
Votre affectueux ami.
Nicolo PAGANINI.
Paris, le 18 décembre 1838.
Les plus méchants bruits circulèrent sur les motifs qui avaient inspiré au célèbre virtuose cette générosité. On le disait avare, incapable d’un tel don. On disait que, sur le conseil de Jules Janin, Paganini, qui venait de refuser de jouer dans un concert de charité, aurait fait ce cadeau pour se concilier la faveur du public. Que ne disait-on pas ? L’illustre violoniste, mourant à Nice le 27 mai 1840, ne devait plus être là pour protester contre de tels mauvais propos. Le fait est que Paganini avait réellement donné les 20.000 francs et qu’à tous les points de vue ç’avait été un grand réconfort pour Berlioz, malade et dans la détresse. Tenons-nous-en à cette constatation. Et cette affirmation d’un grand artiste, plaçant Berlioz à la suite de Beethoven et sur le même plan, rendait au vaincu de Benvenuto le courage perdu.
Dès le 20 janvier 1839, Berlioz « ruminait » le projet d’une symphonie dramatique sur le Roméo de Shakespeare.
Le 9 septembre, après sept mois de travail heureux, il pouvait écrire dans une lettre, à propos de son nouvel ouvrage : « Fini, très fini, ce qui s’appelle fini. Plus une note à écrire. Amen, amen, amenissimen ! ! ! »
ROMÉO ET JULIETTE, symphonie dramatique, avec chœurs, solos de chant et Prologue en récitatif harmonique, composée d’après la tragédie de Shakespeare. Tel est le titre complet de l’œuvre.
Émile Deschamps avait mis en vers le scénario établi par Berlioz lui-même.
Ce scénario, il est presque tracé d’avance dans ces lignes que Berlioz adressait de la villa Médicis à la Revue européenne : « Le Roméo de Shakespeare ! Dieu quel sujet ! Comme tout y est dessiné pour la musique !… Le bal éblouissant dans la maison des Capulet ;… ces combats furieux dans les rues de Vérone ;… cette inexprimable scène de nuit au balcon de Juliette, où les deux amants murmurent un concert d’amour tendre, doux et pur comme les rayons de l’astre des nuits ;… les piquantes bouffonneries de l’insouciant Mercutio ;… puis l’affreuse catastrophe… de voluptueux soupirs changés en râle de mort ; et enfin, le serment solennel des deux familles ennemies jurant, trop tard, sur le cadavre de leurs malheureux enfants, d’éteindre la haine qui fit verser tant de sang et de larmes. – Les miennes coulaient en y songeant. »
Le livret de Roméo débute par un Prologue : combats, tumulte dans la rue. Le Prince intervient : les combattants se dispersent. Puis, en un « récitatif choral ou harmonique » le chœur fait entendre comme une sorte de psalmodie qui expose le sujet du drame. Les thèmes représentatifs de chaque situation sont brièvement indiqués à l’orchestre. Le chœur s’interrompt. Une voix seule, une voix de contralto chante les jours heureux de l’amour. Puis c’est un scherzetto qui décrit par la voix d’un ténor les fantaisies et les tours de la Reine Mab. Le chœur reprend pour annoncer la mort de Juliette et de Roméo.
Après ce Prologue destiné à préparer l’auditeur à l’action qu’il va suivre et à la musique qu’il va écouter, la symphonie dramatique proprement dite commence. Elle se divise en six parties :
I. – Roméo seul. – Tristesse. – Bruits lointains de concert et de bal. Grande fête chez Capulet.
II. – Scène d’amour. – Nuit sereine. – Le jardin de Capulet, silencieux et désert.
III. – La reine Mab ou la Fée des songes (Scherzo pour l’orchestre seul).
IV. – Convoi funèbre de Juliette.
V. – Roméo au tombeau des Capulets.
Note ironique de Berlioz : « Le public n’a point d’imagination. Les morceaux qui s’adressent seulement à l’imagination n’ont donc point de public. La scène instrumentale suivante est dans ce cas, et je pense qu’il faut la supprimer toutes les fois que cette symphonie n’est pas exécutée devant un auditoire d’élite auquel le 5e acte de la tragédie de Shakespeare avec le dénouement de Garrick est extrêmement familier, et dont le sentiment poétique est très élevé. C’est dire assez qu’elle doit être retranchée 99 fois sur 100. »
Garrick, lorsqu’il joua le rôle de Roméo, imagina une tirade supplémentaire qu’il déclamait devant le corps de Juliette endormie. Juliette revenait à elle. « Joie délirante des deux amants. » Mais le poison opère. Roméo meurt et Juliette se poignarde. Voilà la double agonie que Berlioz décrira musicalement et qu’il demande à ses auditeurs de se représenter par l’imagination en écoutant la musique.
Il faut avouer qu’il est besoin ici d’une musique singulièrement suggestive pour évoquer un tel spectacle sans le secours des voix. Mais, si la musique est belle, l’auditeur ne se passera-t-il pas volontiers du tableau qu’elle prétend suggérer et ne lui suffira-t-il pas d’une émotion purement musicale ?
VI. – Final. La foule accourt au cimetière. Capulets et Montaigus forment un double chœur qui prête un serment solennel de réconciliation sur les paroles mêmes prononcées par le père Laurence.
Final brillant mais pompeux, un peu, nous le regrettons, dans la manière de Meyerbeer.
*
Ce qu’il y a d’extraordinaire dans cet ouvrage, c’est qu’un sujet dramatique y est traité sous forme symphonique et que si, cependant, l’auteur emploie parfois les voix, les deux personnages principaux, Roméo et Juliette, sont les seuls à n’être jamais présentés vocalement. Jamais ils ne chantent. Tous leurs sentiments, toutes leurs passions ne sont traduits que par les instruments. « À pareil défi au sens commun, il ne pouvait y avoir qu’une excuse, écrit judicieusement Camille Saint-Saëns : faire un chef-d’œuvre ; et Berlioz n’y a pas manqué. Tout y est neuf, personnel, de cette originalité profonde qui décourage l’imitation. Le fameux Scherzo de la Reine Mab vaut encore mieux que sa réputation : c’est le miracle du fantastique léger et gracieux. Auprès de telles délicatesses, de telles transparences, les finesses de Mendelssohn, dans le Songe d’une nuit d’été, semblent épaisses. »
Tout n’est cependant pas à admirer dans la partition de Roméo, mais ce qui s’y trouve d’admirable l’est au suprême degré, surtout la Tristesse de Roméo qui est une des pages capitales de Berlioz, et, dans un tout autre genre, le Scherzo de la Reine Mab. Mais l’œuvre est inégale et on ne saurait, pour la continuité de l’inspiration, la mettre sur le même plan que la Damnation, qui est vraiment, avec la Symphonie fantastique, le chef-d’œuvre de son auteur.
N’empêche que la Tristesse de Roméo constitue une merveille incomparable et peut-être bien que Berlioz ne s’est élevé si haut nulle part ailleurs dans l’ensemble de ses ouvrages. Et encore une fois son moyen d’émotion se trouve être le plus simple du monde, celui qui lui est cher par-dessus tout : la monodie :

Monodie qui semble se mouvoir hors de toute tonalité et n’appeler aucune espèce d’harmonie.
Voilà l’une des plus intimes caractéristiques du génie de Berlioz. Ce n’est pas dans le domaine de l’harmonie que ce romantique innovera, il en laissera le soin à Liszt auquel Wagner empruntera à son tour le plus clair de son système harmonique. C’est dans le cadre plus étroit de la mélodie que Berlioz trouvera du nouveau, dans ce cadre où l’invention était infiniment plus difficile que partout ailleurs et où l’originalité avait infiniment plus de prix.
Là Berlioz est inimitable et n’a pas encore aujourd’hui été dépassé ni même égalé. Il possède, à cet égard, sur nos contemporains même une avance qui n’a pas été rattrapée.
Tirer une telle force d’expression de la seule monodie, voilà qui suffit à mesurer la puissance du génie de Berlioz.
*
Dans la salle du Conservatoire, le 24 novembre 1839, première audition de Roméo et Juliette de Berlioz avec 200 exécutants sous la direction de l’auteur, Dupont, Alizard et Mme Stoltz pour les soli. Le prologue plaît peu. La Tristesse de Roméo et la Fête chez Capulet déchaînent des applaudissements interminables. La Scène d’amour laisse une impression indécise. Avec la Reine Mab, de nouveau l’enthousiasme. Le Convoi funèbre de Juliette et la Scène dans le caveau des Capulets laissent le public très froid. Grâce au Finale, l’audition se termine en triomphe.
Ces alternatives dans le succès correspondent assez imparfaitement aux inégalités véritables de la partition, mais en révèlent quelques-unes cependant.
À une deuxième audition (1er décembre 1839), le succès fut plus décidé, plus continu. Stephen Heller, présent, écrivait à Schumann : « C’est un grand bonheur pour les amis de l’art de voir ce progrès de l’opinion publique, et surtout l’homme de génie se frayant avec courage un chemin glorieux hors des voies prosaïques et vulgaires de la routine et de la spéculation[20]. »
*
Berlioz, toujours malade, souffrant d’un terrible épuisement nerveux, se débat dans l’espoir toujours renaissant d’une bonne chance imprévue.
Pour les fêtes de juillet 1840, il voudrait « caser » une Symphonie funèbre et triomphante.
Il en obtient la commande.
Une « grande machine » en trois parties d’un style un peu déclamatoire, mais dont il escompte le gros effet populaire.
Encore une déception. Cette musique, malgré tous les moyens instrumentaux et même vocaux dont disposait Berlioz et dont il usait largement, on ne l’entend pas, on ne l’écoute point, elle se perd au milieu des clameurs soulevées par les passions politiques.
Pourtant, Berlioz a ce jour-là un auditeur de choix : Richard Wagner, et qui applaudissait l’œuvre et son auteur : « Cette Symphonie funèbre, écrit-il, est grande de la première à la dernière note. » C’était peut-être beaucoup dire. Enfin, recueillons le jugement.
*
Depuis septembre 1839, Wagner, chassé de Riga par les intrigues d’un rival, habitait Paris. Il y était venu chercher fortune. Il apportait avec lui l’esquisse de son Rienzi qu’il espérait bien faire jouer à l’Opéra.
Il était arrivé sans argent, avec sa femme Minna et un magnifique terre-neuve. Il s’était présenté à Meyerbeer qui avait fait mine de le patronner.
Il composait pour les salons des romances auxquelles on ne comprenait rien.
Il voulut faire jouer une œuvre de lui, Défense d’aimer, à la Renaissance.
Et justement la Renaissance fait faillite (1840).
Il se propose pour écrire la musique d’un vaudeville de Dumanoir, la Descente de la Courtille.
Mais on ne consent même pas à lui confier ce travail de manœuvre.
Il présente au directeur de l’Opéra le scénario du Hollandais volant.
Le directeur, enthousiasmé pour le sujet, lui achète 500 francs le droit de le faire mettre en musique par un autre.
C’est la misère noire.
Pour vivre, Wagner accepte les pires besognes. Il arrange les opéras à la mode pour flûte, pour clarinette, pour cornet à pistons. Il corrige des épreuves de musique. Il se charge pour les revues musicales françaises et étrangères des collaborations les plus ingrates.
Il est bien vite dégoûté de Paris et de son dilettantisme.
Sa seule consolation est d’écouter au Conservatoire les Symphonies de Beethoven, et, notamment, la Neuvième, dirigées par Habeneck, comme il ne les avait jamais entendues en Allemagne.
Et il remuait des projets dans sa tête : « Si je composais un opéra suivant mon sentiment, écrivait-il, il mettrait en fuite le public, car il ne renfermerait ni airs, ni duos, ni trios, ni aucun de ces morceaux qu’on coud aujourd’hui tant bien que mal pour faire un opéra. Ce que je ferais, il n’y aurait ni chanteur pour le chanter, ni public pour le comprendre. » Et il se remettait à composer. Durant l’hiver 1839-40, il écrit l’ouverture de Faust. Puis il terminait Rienzi et envoyait la partition à Dresde, dans l’espoir de la faire exécuter.
Ce Rienzi est une sorte de tribun héroïque et pur qui veut délivrer le peuple romain du joug de la noblesse et que le peuple finit par abandonner lâchement. Quand il avait commencé son Rienzi, Wagner était encore sous l’influence de l’opéra historique qui triomphait à Paris avec Guillaume Tell, la Muette de Portici, Robert le Diable, la Juive, les Huguenots. Il voyait son sujet « à travers les lunettes du Grand Opéra », c’est-à-dire comme un brillant spectacle en 5 actes, avec des ensembles considérables, des hymnes, des cortèges, des scènes militaires, des ballets, de grands airs, de grands duos écrits dans un style constamment pompeux et oratoire. Wagner ne voulut pas laisser inachevé un ouvrage où il avait tout de même mis beaucoup de lui-même, de sa pensée profonde et de son cœur. Mais aussitôt Rienzi terminé, il se retire à Meudon pour écrire une œuvre selon son sentiment et en sept semaines il mettait sur pied l’esquisse musicale de son Vaisseau fantôme.
Un seul compositeur l’intéressait à Paris, et c’était Berlioz. Il sentait en lui une force, du génie, une conception de l’art analogue à la sienne et un désintéressement méritoire. « Malgré son caractère déplaisant, malgré ses adorateurs délirants et qui lui tournent la tête », Berlioz, en 1840, attire le jeune Wagner. Mais peut-être Wagner soupçonne-t-il aussi dans cet extraordinaire Berlioz un rival dangereux et ne se défend-il pas tout à fait d’une certaine jalousie.
Les deux héros se retrouveront, face à face.
Mais voici que Wagner reçoit une bonne nouvelle : son Rienzi va être joué à Dresde. Il quitte Paris le 7 avril 1842, ce Paris qu’il ne peut s’empêcher tout à fait d’aimer et d’admirer malgré les jours malheureux qu’il y a déjà vécus, et pour les joies artistiques qu’il a pu tout de même y goûter.
Le 25 juin 1842, Wagner terminait une lettre à l’éditeur Schlesinger par ces mots : « Paris nous est, du reste, inoubliable, et, quoique nous y ayons cruellement souffert, le souvenir de la grandeur de la vie de là-bas l’emporte malgré tout. »
*
Il nous est impossible de ne pas citer ici quelques-unes des appréciations de Wagner sur Berlioz.
Le 5 mai 1841, Wagner envoyait à l’Europa de Lewald une Correspondance parisienne dont nous détachons ces lignes :
« Je vois bien qu’il me faut enfin parler de Berlioz à tout prix, car je me rends compte que l’occasion favorable ne se présentera pas si tôt. » Et il ajoute, parlant de ce musicien génial : « Berlioz n’est nullement un compositeur d’occasion, c’est même la raison pour laquelle je n’ai pas eu à m’occuper de lui occasionnellement. Il n’entretient pas de relations, il n’a rien à faire avec ces établissements artistiques de Paris, fastueux et exclusifs, l’Opéra et le Conservatoire, qui, dès le premier abord, se sont empressés de lui fermer leurs portes en s’étonnant de son audace. On a forcé Berlioz à être et à rester une exception bien tranchée, à la grande, à l’éternelle règle, et c’est cela qu’il est et qu’il reste, aussi bien au fond qu’en apparence.
« … On entend les compositions de Berlioz uniquement dans un ou deux concerts qu’il organise lui-même chaque année. Ces concerts restent son domaine exclusif : c’est là qu’il fait exécuter ses œuvres par un orchestre qu’il a formé à son usage tout particulier devant un public dont il a fait la conquête pendant une campagne de dix ans. Quant à entendre ailleurs du Berlioz, il faut y renoncer, à moins que ce ne soit dans la rue ou à l’église, où le gouvernement l’appelle de temps en temps à une action politico-musicale.
« Cet isolement de Berlioz ne s’étend pas seulement à sa situation extérieure ; c’est avant tout cet isolement qui est le principe de son évolution intellectuelle : si Français qu’il soit, si réelles que soient les sympathies qui unissent son essence, sa tendance à celle de ses concitoyens…, il n’en reste pas moins seul. Il ne voit personne devant lui sur qui s’étayer, à ses côtés personne sur qui s’appuyer.
« Du fond de notre Allemagne, l’esprit de Beethoven a soufflé sur lui, et certainement il est des heures où Berlioz désirait être un Allemand ; c’est en de telles heures que son génie le poussait à écrire à l’imitation du grand maître, à exprimer cela même qu’il sentait exprimé dans ses œuvres. Mais, dès qu’il saisissait la plume, le bouillonnement naturel de ce sang qui frémissait dans les veines d’Auber, lorsqu’il écrivit le volcanique dernier acte de sa Muette… Heureux Auber, qui ne connaissait pas les symphonies de Beethoven ! – Berlioz, lui, les connaissait ; bien plus, il les comprenait, elles l’avaient transporté, elles avaient enivré son âme… et néanmoins, c’est par là qu’il lui fut rappelé qu’un sang français coulait dans ses veines. C’est alors qu’il se reconnut incapable de faire un Beethoven, c’est alors aussi qu’il se sentit incapable d’écrire comme Auber.
« Il fut Berlioz, il écrivit sa Symphonie fantastique, œuvre dont Beethoven eût souri. » Est-ce bien sûr ? « tout comme en sourit Auber, mais qui était capable de plonger Paganini dans la plus fiévreuse extase, et de gagner à son auteur un parti qui ne veut plus entendre au monde que la Symphonie fantastique de Berlioz ».
Et, alors, ce jugement cassant :
« Celui qui entend cette symphonie ici, à Paris, doit vraiment croire qu’il entend une chose étrange, inouïe. – Une riche, une monstrueuse imagination, une fantaisie d’une énergie épique, vomissant, comme d’un cratère, un torrent bourbeux de passions ; ce qu’on distingue, ce sont des nuages de fumée de proportions colossales, traversés seulement par des éclairs, zébrés par des bandes de feu et façonnés en fantômes changeants. Tout est excessif, audacieux, mais extrêmement désagréable. Là, il ne faut chercher nulle part la beauté de la forme, nulle part le courant majestueusement paisible, à la sûre ondulation duquel on aimerait à confier son espoir.
« Après la Symphonie fantastique, le premier morceau de la Symphonie en ut mineur de Beethoven eût été pour moi une jouissance bienfaisante et pure. »
Lisez aussi ces lignes instructives, peut-être sévères, excessives, injustes, mais qui n’en renferment pas moins leur part de vérité :
« Le Français pense avant tout à une chose, divertir, amuser ; même quand il cherche à perfectionner son art par l’ennoblissement, par l’idéalisation de cet amusement. » On pourrait songer ici à un Debussy, par exemple, qui définit le but de son art : « faire plaisir ». Mais il faut se dire que le plaisir n’est en ce cas que l’enveloppe d’une matière esthétique infiniment riche, remplie d’humanité, d’émotion et qu’il n’est pas de musique plus profonde que celle de Debussy, non, pas même celle de Wagner.
Continuons notre citation : « Aussi, écrit Wagner, l’effet, l’impression d’un moment sont et demeurent pour le Français l’objet principal. » Encore une fois, le nom de Debussy se présente à l’esprit de Debussy, l’impressionniste, qui réduit tout son art à des notations pour ainsi dire instantanées. Mais un seul mot, une seule note peut parfois traduire le tragique d’une situation avec autant d’intensité que l’interminable déroulement des plus sublimes flots d’éloquence : nous l’avons dit et nous le redirons, le « Je t’aime » de Pelléas sur une harmonie choisie vaut les longs aveux de Tristan à Iseult, comme le cri déchirant de don José : « Ma Carmen adorée ! » à la fin de la partition vaut, en son ardente brièveté, les plus passionnés développements symphoniques d’un Richard Wagner.
Et puis, il n’y a pas en France que des musiciens tels que Debussy et Bizet. Le Français ne songe pas toujours qu’à son plaisir même idéalisé ni à l’impression du moment. Il y a, en France, des artistes qu’on chercherait en vain à traiter d’amuseurs même de noble espèce, ou d’impressionnistes : un Vincent d’Indy, un Henri Duparc, un Paul Dukas, compositeurs en général plutôt sévères et qui enferment leurs pensées musicales dans de vastes constructions largement développées où l’éloquence s’étale et se donne tous les droits.
Je reprends le texte de Wagner : « L’effet, l’impression d’un moment sont et demeurent pour le Français l’objet principal ; s’il est totalement dépourvu du sens intuitif, il lui suffit d’avoir tout simplement atteint ce but…, mais s’il est doué d’une véritable faculté créatrice, cela ne l’empêche pas de se servir de cet effet ; seulement, ce n’est plus alors que le premier et le plus important moyen pour faire comprendre à tous sa pensée intime. »
C’est justement d’un Vincent d’Indy, d’un Henri Duparc qu’on ne saurait dire que de tels artistes enveloppent leur pensée intime d’un appareil amusant, divertissant, pour attirer le public. Et ce n’est pas non plus d’un Berlioz, qui, à tout prendre, éloignerait plutôt ses auditeurs par ses audaces et ses bizarreries qui n’« amusent » que des raffinés et qui, d’ailleurs, font corps avec sa pensée même, sa pensée la plus intime et ne peuvent s’en détacher. Ce que Wagner aurait pu dire inexactement d’un Debussy s’il l’avait connu, il ne saurait vraiment l’appliquer en toute rigueur à Berlioz. Il reste que Wagner a défini quelques-uns des caractères éventuels de l’art français.
Wagner ne parle pas que de la musique de Berlioz, en général, il donne son opinion sur certaines œuvres de ce compositeur. C’est ainsi qu’il déclare que sa symphonie Roméo et Juliette lui « a fait éprouver les plus vifs regrets ». Il continue : « Dans cette composition, à côté des trouvailles les plus géniales, il s’amoncelle une telle quantité de fautes contre le goût et la bonne économie artistique que je ne pus me défendre de faire ce souhait : c’est que Berlioz, avant l’exécution de cette œuvre, l’eût soumise à un homme tel que Cherubini. » Il va bien loin.
Par contre, à propos de la Symphonie funèbre et triomphale, il dit :
« Il est un talent qu’on ne saurait contester à Berlioz : c’est précisément son entente à fournir des compositions parfaitement populaires ; je dis populaires au sens le plus idéal du mot… Je n’aurais vraiment nulle répugnance à donner le pas à cette composition sur les autres œuvres de Berlioz… Un sublime enthousiasme patriotique, qui s’élève du ton de la déploration aux plus hauts sommets de l’apothéose garde cette œuvre de toute exaltation malsaine. » C’est aller bien loin encore, – dans un autre sens.
Wagner conclut : « Si j’étais Beethoven, je dirais : « Si je n’étais Beethoven, et si j’étais Français, je voudrais être Berlioz. » Parlerais-je ainsi dans l’espoir d’être plus heureux ? Je ne le sais au juste, mais je le dirais cependant. – Chez ce Berlioz flambe la jeunesse d’un grand homme. Ses symphonies sont les batailles et les victoires de Bonaparte en Italie. Il vient d’être fait consul, – il va devenir empereur, – il va conquérir l’Allemagne et le monde. »
Ces appréciations diverses de Wagner sur Berlioz et sur ses œuvres ne se tiennent peut-être pas très bien. Il n’en résulte pas moins l’impression que le futur auteur de la Tétralogie a une très grande idée de l’auteur de la Symphonie fantastique, et s’il exagère peut-être parfois ses défauts, c’est sans doute pour diminuer un peu l’importance d’un rival redoutable.
De loin en loin, Wagner dira du mal de la France et des Français, mais nous voyons aussi qu’il en pensait du bien et, pour en finir, citons cette dernière phrase caractéristique, tirée des Mémoires, au sujet de son départ de Paris le 7 avril 1842 : « La diligence roula d’abord sur les boulevards. Puis nous passâmes les barrières et nous ne vîmes plus rien, car nos yeux étaient obscurcis par des flots de larmes. »
CHAPITRE XIV
1844
LE DÉSERT DE FÉLICIEN DAVID
Et maintenant un Berlioz au petit pied, qui, pour ses contemporains, fut aussi grand que Berlioz lui-même, mais un Berlioz sans véritable originalité, sans caractère profond, qui ne possédait que les dehors du romantique et dont l’œuvre ne survécut pas à ses premiers succès : Félicien David. On cite cependant toujours son Désert comme une date dans l’histoire de la musique à programme.
Félicien-César DAVID naquit à Cadenet (Vaucluse), le 13 mai 1810. Le 16 juillet 1818, il était admis à la maîtrise de Saint-Sauveur, à Aix-en-Provence. Il y eut pour maîtres, d’abord l’abbé Michel, puis un certain Marius Roux qui tous deux l’initièrent très sérieusement au solfège, à l’harmonie et à la composition. De très bonne heure, le petit Félicien se mettait à écrire des motets, des hymnes, même un quatuor à cordes. Âgé de 15 ans, il continua ses études, surtout musicales, au collège de Saint-Louis, dirigé par les pères Jésuites. Il était devenu assez bon violoniste.
En 1828, l’arrêté gouvernemental qui ordonnait la fermeture des établissements de la Société de Jésus, le mit sur le pavé et l’obligea à trouver un gagne-pain. Il s’engagea comme second chef d’orchestre au théâtre d’Aix, puis après bien des déboires, comme petit clerc chez Maître Pellegrin, avoué, enfin comme chef de la maîtrise de Saint-Sauveur, poste devenu vacant.
Frappé de ses dons, un oncle lui promit alors de lui fournir une pension de 50 francs par mois pour lui permettre d’aller vivre à Paris. Il ne tint du reste sa parole que pendant trois mois.
Le jeune Félicien arrivait dans la capitale au printemps de 1830. Présenté au directeur du Conservatoire, l’irascible signor Cherubini, il ne reçut qu’un accueil fort peu amical : « Qué vous né savez rien ! » lui hurla le maestro. « Qué vous né faites qué des fautes ! Qué cé n’est pas de la mousique ! Qué votre maître est oun âne bâté ! »
Cherubini le confiait cependant aux soins d’un certain M. Millaud, répétiteur de contrepoint et de fugue.
Mais tout d’un coup, voici le Conservatoire et la musique bien loin. Un peintre nommé Justin, dont Félicien David venait de faire la rencontre, le dissuade de continuer ses études musicales et le presse de se joindre au groupe alors grandissant des saint-simoniens.
Fondé en 1823, par le comte Claude-Henri de Saint-Simon, dont la mort survenait dès 1825, le saint-simonisme devenait bientôt une sorte de secte religieuse à laquelle se ralliaient Auguste Comte, Augustin Thierry, Michel Chevalier, Olinde Rodrigues, Bayard et Enfantin. L’hérésie se mit de la partie. Bayard, puis Olinde Rodrigues se séparèrent du « père Enfantin ». Au printemps de 1832, « le Père », suivi de ses plus dévoués disciples, se retira dans sa maison de Ménilmontant pour se livrer à toutes sortes d’études économiques et industrielles, et pour élaborer tout un plan d’apostolat.
Séduit par les doctrines saint-simoniennes, Félicien David adhéra au groupe et y apporta, pour les cérémonies prévues du culte, sa collaboration de musicien. Il avait sous sa direction 40 choristes, qui presque tous ignoraient le solfège.
On sait que les saint-simoniens portaient un costume étrange : tunique bleue (couleur de la foi), ouverte sur la poitrine, serrée à la taille, tuyautée sur les hanches ; gilet rouge (couleur du travail), se boutonnant dans le dos en symbole de la fraternité humaine, nul ne pouvant la revêtir sans le secours d’une main fraternelle ; plastron blanc (couleur de l’amour), etc.
Le saint-simonisme intéressait beaucoup les Parisiens à des titres divers et surtout pour le condamner. La maison commune de Ménilmontant fut enfin fermée et la famille dispersée.
Félicien David quitte Paris avec la communauté. Il veut aller avec elle porter la bonne parole bien loin, en Égypte, dans l’espoir de rendre la prospérité à la terre des Pharaons. Chemin faisant, il dirige les études du quatuor vocal.
Après une ovation à Marseille, la petite troupe des saint-simoniens s’était embarquée, le 22 mars 1833, sur le brick Clorinde vers Constantinople.
Elle y fut assez mal reçue par le Sultan et invitée à se rendre en d’autres lieux.
Le séjour à Jérusalem fut plus heureux.
Départ alors pour Jaffa, puis pour le Caire.
Mais, en 1835, la peste force Félicien David à s’engager dans le désert avec l’intention de gagner la Syrie. Il finit par atteindre Beyrouth, d’où il s’embarque de nouveau pour Marseille où il atterrit le 19 juin 1835 : il en était parti vingt-sept mois auparavant.
Il avait visité une grande partie de l’Orient.
Cette longue randonnée n’était pas du temps perdu. Félicien David rentrait en France l’âme pénétrée de sonorités, de mouvements, de parfums et de lumières qui allaient faire de lui le musicien orientaliste par excellence, ou du moins celui que l’on considéra de son temps comme tel. Onze ans après son retour allait naître son œuvre la plus caractéristique : le Désert.
*
Les Français étaient tout prêts à se passionner pour cet ouvrage.
L’Orient était à la mode grâce à Chateaubriand, à Victor Hugo, à Lamartine, dont en 1835, on venait de publier le Voyage en Orient, sans compter lord Byron, et aussi Delacroix et Decamps.
Dans le domaine de la musique on ne pouvait accorder d’importance significative aux quelques « turqueries » que l’on rencontre avant Félicien David, dès le XVIIIe siècle, dans l’Enlèvement au sérail de Mozart, les Deux Avares et la Caravane du Caire de Grétry.
Plus tard, le Calife de Bagdad de Boieldieu, les Ruines d’Athènes de Beethoven, l’Obéron de Weber mettaient peut-être davantage la musique sur la voie de l’orientalisme, quoique d’une façon bien lointaine encore.
Ici, Félicien David paraît être vraiment l’initiateur.
*
Félicien David écrivit sa partition du Désert en trois mois, d’avril à juillet 1844. Il s’occupa alors de la faire exécuter. Il découvrit fort heureusement pour chanter l’appel du Muezzin qui devait constituer une des attractions de son Concert, un certain Béford dont la voix rappelait à s’y méprendre celle des eunuques du vice-roi d’Égypte. Un grand nombre d’instrumentistes et de choristes de bonne volonté se joignirent au groupe des professionnels rétribués. Un acteur de l’Odéon, Thibeaudeau-Milon, tint le rôle de récitant.
Le grand jour arriva, – 8 décembre 1844. Le Concert commença par deux chœurs : le Chant du soir et le Sommeil de Paris, deux mélodies : le Chibouck et les Hirondelles et le Scherzo de la Symphonie en mi bémol. Jusque-là succès modéré. Après l’entr’acte, Tilmant, qui dirigeait l’orchestre, leva sa baguette sur le Désert. Dès les premières mesures une sorte d’envoûtement se produisit sur l’assistance et ne cessa d’accroître ses effets. Ce fut bientôt un enthousiasme indescriptible. L’auteur, caché parmi les seconds ténors, dut se montrer, descendre en scène pour s’entendre acclamer. La séance terminée, il était entouré, félicité, embrassé par ses amis. Il put à grand’peine rentrer chez lui.
La presse confirmait bientôt l’accueil du public.
Berlioz écrivait aux Débats : « Un grand compositeur vient d’apparaître, un chef-d’œuvre vient d’être dévoilé ! Le compositeur se nomme Félicien David, le chef-d’œuvre a pour titre le Désert… Nous avons été frappés d’admiration, touchés, entraînés, écrasés… » Il prononçait le mot de « génie » et, entrant dans l’analyse de la partition, il déclarait notamment : « Le Simoun est quelque chose de prodigieux. C’est aussi beau que l’orage de la Pastorale de Beethoven… L’Hymne à la Nuit est délicieux… Les airs de danse sont des perles de l’Orient enchâssées dans l’orchestre le plus savant, le plus gracieusement original qui se puisse entendre… »
N’était-ce pas vraiment situer Félicien David bien haut ?
*
Jusqu’à présent, en écrivant ce chapitre, je ne m’en rapportais qu’à mes souvenirs, – souvenirs bien lointains, souvenirs de jeunesse, souvenirs du temps où l’on jouait encore le Désert en France, surtout dans les Concerts de province. Il me semblait alors que la musique de Félicien David était une musique agréable, sans plus d’ailleurs. Et je n’allais pas jusqu’aux extrêmes exagérations de Berlioz. Mais enfin je lui accordais un certain mérite.
Or, je viens d’ouvrir la partition du Désert pour vérifier mes impressions d’autrefois. Cruelle déception ! Avec la meilleure volonté, j’y découvre moins encore que ce que j’espérais y trouver.
D’abord, la symphonie s’ouvre par un ut indéfiniment prolongé aux violons et aux altos. Une note, une seule, symbolisant l’immensité, l’immensité stérile du désert, une seule note sous laquelle bientôt passent aux basses les autres notes de la tonalité d’ut majeur, sauf le si, cela reste immobile et ne conduit à rien.
Mais le désert n’est pas le vide, ni le néant. Le désert est vivant, il a ses merveilleux jeux de lumière, ses parfums, le mouvement de ses sables, ses tempêtes. Et s’il fallait ne voir en lui tout d’abord que vide et qu’immobilité, encore y avait-il moyen d’en exprimer le caractère avec plus d’intensité et de grandeur.

Le chœur « Allah, à toi je rends hommage » ne relève en rien ce début insignifiant avec ses pauvres harmonies.
La Marche de la Caravane prend enfin un peu d’accent.

Plus loin, le contrepoint de hautbois est assez heureux.
Mais la tempête est faite d’assez lamentables banalités : trémolos et gammes chromatiques sans trêve ni arrêt, sans nuances, Sempre fortissimo.
La Nuit manque de mystère et d’ombre :

La Fantaisie arabe n’a guère d’arabe que le nom.
La Danse des almées aurait peut-être un peu plus de caractère, mais si peu.
Je préfère de beaucoup la Rêverie du soir :

Le Lever du Soleil use assez pauvrement d’un effet trop connu de trémolo des violons dans l’aigu.
Enfin, reconnaissons que le Chant du Muezzin, noté sur place, apporte, pour terminer, une note savoureuse dans cette suite d’impressions orientales en général infiniment pâles :

Que reste-t-il, en somme, de cette inégale partition ? Bien peu de chose.
Berlioz lui-même, d’ailleurs, en a singulièrement rabattu plus tard de ses éloges d’abord immodérés.
Dans une lettre du 16 octobre 1855, il écrit : « David a donné deux concerts qui lui ont fait perdre 1.800 francs. On trouve maintenant cette musique enfantine… Le temps est un grand maître ; je ne sais comment on pourra lutter contre les enseignements de ce maître-là…
« Et de David éteint rallumer le flambeau. »
*
Le Désert était peut-être un sujet qui dépassait les forces de cet aimable compositeur. Il faut le chercher ailleurs, non pas certainement dans Moïse au Sinaï, oratorio en 2 parties (1846), ni dans Christophe Colomb ou la découverte du Nouveau Monde, ode-symphonie en 4 parties (1846) ou dans l’Éden, mystère en 2 parties (1848) ; j’aimerais déjà mieux la Perle du Brésil, opéra en 3 actes (1851) ou Herculanum, opéra en 4 actes (1859). Mais ce qui me plaît mieux encore, c’est une œuvre légère, un opéra-comique en 2 actes, Lalla-Roukh, sur un livret d’Hippolyte Lucas et Michel Carré inspiré de Thomas Moore. La donnée en est fort simple. La fille d’un sultan des Indes se rend auprès d’un prince qu’elle doit épouser ; au cours du voyage, elle éprouve un charme singulier à écouter chanter une sorte d’aède qui l’accompagne ; elle finit par reconnaître en lui son propre fiancé qui, voulant être aimé pour lui-même, avait pris ce déguisement. La partition contient quelques bonnes pages. C’est ainsi qu’on peut louer la cantilène de Noureddin : « Ma maîtresse a quitté la tente », l’air de Lalla-Roukh : « Ô nuit d’amour » et tout particulièrement les couplets comiques de Baskir : « Ah ! funeste ambassade ! » d’une excellente venue.
*
Après la mort de Berlioz en 1869, Félicien David recueillit la succession de son fauteuil à l’Académie des Beaux-Arts à l’unanimité des suffrages de 32 votants. Il hérita également de ses fonctions de bibliothécaire du Conservatoire de musique. Fonction qu’il ne remplit pas plus sérieusement que son prédécesseur. Tous deux considéraient ce poste si modestement rétribué comme une sinécure et laissaient au commis Leroy toute la charge de la bibliothèque. Enfin, Leroy obtint de David qu’il visitât au moins une fois les locaux et leur aménagement. « Cette idée ne me serait pas venue, répondit naïvement David, mais je n’ai rien à vous refuser et je vous promets ma visite. » Il ne la renouvela jamais.
Félicien David mourut le 29 août 1876. Depuis quelque temps il sentait ses forces progressivement diminuer. Son agonie fut brève et peu douloureuse.
Saint-Saëns a écrit de lui : « Chaque artiste a une qualité maîtresse qui donne à ses œuvres leur principal caractère. David possédait la plus rare de toutes : la naïveté. C’est à cette qualité qu’il doit le succès d’étonnement qu’il a rencontré avec Lalla-Roukh et le Désert. Le public ne s’attend pas à cela ; il est préparé à tout, aux grands effets, aux petits effets, aux mélodies piquantes, aux grandes phrases passionnées, aux orchestrations bruyantes, aux harmonies fines et distinguées ; mais il est sans défense contre une âme qui s’ouvre et dit simplement ce qu’elle a à dire… »
Sans doute. Mais de cette naïveté de Félicien David on se lasse vite : elle est monotone et parfois il dit les choses vraiment trop simplement et l’on se demande d’ailleurs si ce qu’il avait à dire valait toujours la peine d’être dit.
Petit musicien, mais qui tient sa place dans l’histoire comme inventeur de l’orientalisme en musique, plus d’ailleurs par ce qu’il a voulu faire que par ce qu’il a vraiment réalisé.
CHAPITRE XV
1846
LA DAMNATION DE FAUST
Et nous voici de nouveau avec Berlioz, – Berlioz toujours à la recherche d’un public et d’un succès.
En mars 1841, l’Opéra annonce le Freischütz de Weber. « M. Berlioz dirigera les répétitions. » On lui confie un travail : Pour l’Opéra des récitatifs sont nécessaires, indispensables, au lieu du parlé de l’œuvre originale. C’est Berlioz qui les composera. Il composera même ou il arrangera des ballets. Il les empruntera à Preciosa, à Obéron. Il orchestrera l’Invitation à la Valse. Merveilleuse instrumentation qui, sans toucher le moins du monde à sa signification musicale, apporte au chef-d’œuvre de Weber un lustre, une couleur, une intensité expressive incomparables.
Le Freischütz passe, le 5 et le 7 juin 1841 (répétition générale et première). Demi-succès. Presse médiocre. Cependant on donne l’œuvre six fois en juin et avec de bonnes recettes, presque celles des Huguenots, c’est tout dire, ces Huguenots qui « faisaient » trois fois plus que Don Juan.
Mais la presse, mauvaise, chagrinait Berlioz.
Il avait d’autres ennuis.
Son ménage n’allait pas. Harriett Smithson était jalouse d’une rivale dont elle soupçonnait l’existence. Berlioz s’était en effet épris d’une chanteuse espagnole Maria Recio, de joli visage, mais sans aucun talent, qui le couvrait de ridicule en l’obligeant à lui chercher des engagements et à lui faire donner des rôles. Il la jugeait à sa valeur, mais il l’aimait : c’était encore une sorte de bonheur. Par contre il avait bien vite fait de s’apercevoir qu’Harriett Smithson ne répondait en rien à l’image de sa fantaisie qu’il adorait. Il finit par l’abandonner.
Et toujours la gêne, la misère, la détresse. À un certain moment il se sent si désemparé qu’il demande à être nommé inspecteur de la musique dans les écoles primaires. Le poste souhaité lui échappe… heureusement !
Il revient à la musique. Il reprend ses Huit scènes de Faust pour les développer (1845).
Dès sa première jeunesse, Berlioz s’était enthousiasmé pour le Faust de Gœthe, nouvellement traduit en français par Gérard de Nerval (1828). « Le merveilleux livre me fascina de prime abord : je ne le quittais plus ; je le lisais sans cesse, à table, au théâtre, dans les rues, partout. » Dès 1828 il met en musique la Ballade du Roi de Thulé. En février 1829, il a terminé les Huit scènes. Il s’agit maintenant de donner à ce premier essai des dimensions plus considérables.
Berlioz fait alors appel à la collaboration d’un obscur journaliste, un certain Almire Gandonnière, auquel il demande de composer quelques vers sur le canevas qu’il lui apporte. Mais Gandonnière ne va pas jusqu’au bout de sa tâche et Berlioz la continue lui-même. À partir de la 2e scène de la 3e partie, tous les vers sont de lui, sauf les strophes empruntées à la traduction de Gérard de Nerval. Alors, muni de son livret, qu’il achève en route, Berlioz part pour un long voyage à travers l’Autriche, la Hongrie, la Bohême et la Silésie.
Il n’est point si mauvais poète. Témoin la fameuse Invocation à la Nature d’une éloquence si émue :
Nature immense, impénétrable et fière,
Toi seule donnes trêve à mon ennui sans fin !
Il écrit son poème et il compose sa musique partout où il se trouve : « en voiture, en chemin de fer, sur les bateaux à vapeur et même dans les villes, malgré les soucis divers, ajoute-t-il, auxquels m’obligeaient les concerts que j’avais à y donner. »
Il termine la première ébauche de son œuvre à Paris, « mais toujours à l’improviste, chez moi, au café, au jardin des Tuileries, et jusque sur un banc du boulevard du Temple. » Ensuite il « retravaille le tout, en polit les diverses parties, les unit, les fond ensemble », et il met au point l’instrumentation « qui n’était qu’indiquée ça et là. »
Berlioz n’a pas conçu la Damnation pour le théâtre. C’est une « symphonie dramatique avec chœurs » ou un « opéra de concert » une suite de tableaux disjoints qui se prêtent mieux aux jeux de l’imagination qu’à une représentation véritable.
Même Berlioz évite tout ce qui est particulièrement dramatique ou plutôt scénique. On ne trouvera dans la Damnation ni la scène de l’église, ni celle de la prison, ni les personnages de Valentin, de dame Martha, de Wagner. Les amours de Faust et de Marguerite n’occupent qu’une scène, tout à fait différente d’ailleurs de celle du Faust allemand ou de celles de l’opéra de Gounod.
Dans le poème immense de Gœthe qui est à la fois presque une épopée, à coup sûr un drame, une comédie, et aussi une satire, un conte philosophique, politique, social, par moments aussi une sorte de livret d’opéra, Berlioz n’a pas isolé, comme Gounod, l’épisode touchant de Marguerite. Il a choisi ce qui donnait lieu aux effets les plus pittoresques, les plus moyenâgeux, les plus romantiques ; et s’il a trouvé le moyen d’exprimer une âme, n’en doutons point, c’est seulement la sienne propre.
L’œuvre fut exécutée pour la première fois à Paris, le 6 décembre 1846. Ce fut un désastre. La salle était d’ailleurs à moitié vide. Dans les couloirs on citait le joli mot de Rossini : « Quel bonheur que ce garçon-là ne sache pas la musique ! Il en ferait de bien mauvaise ! » Dans la presse, les amis firent des articles dithyrambiques mais qui ne donnaient le change ni au public, ni à l’auteur.
La Damnation ne commença d’être connue et admirée en France qu’après la mort de Berlioz grâce principalement au zèle d’Édouard Colonne. Le 11 décembre 1898 elle atteignait sa 100e audition aux concerts dirigés par ce remarquable artiste. Dès lors le chef-d’œuvre de Berlioz, devenu populaire, n’a pas cessé de figurer aux programmes des Sociétés symphoniques du monde entier. Il fut même porté au théâtre – pour lequel il n’était pas fait, – et obtint, sous cette forme, un nouveau genre de succès. La première « représentation » de la Damnation eut lieu en février 1893 sur la scène du théâtre de Monte-Carlo.
Le théâtre national de l’Opéra de Paris a inscrit depuis l’ouvrage de Berlioz à son répertoire courant.
*
PREMIÈRE PARTIE
La Damnation s’ouvre par un tableau situé par l’auteur dans les plaines de Hongrie. Notons que Berlioz n’a jamais trouvé pareille indication dans le poème de Gœthe et l’on pourrait croire à un pur caprice de sa part. Mais on découvre bientôt son intention, c’est qu’il veut avoir l’occasion de faire entendre sa Marche hongroise, une des pages les plus superbement romantiques qu’il ait jamais écrites et dont il a déjà éprouvé l’effet sur le public. Pourquoi pas ? Pourquoi Faust, parmi ses innombrables aventures, ne compterait-il pas celle d’un voyage en Hongrie ? Et puis, nous ne l’ignorons pas, Faust n’est que le prête-nom de Berlioz dont nous sommes ravis de recueillir les impressions les plus diverses. Ce début date et situe l’inspiration initiale de l’ouvrage.
Donc, au milieu de la plaine de Hongrie, Faust se promène seul dans les champs, à l’heure du lever du soleil.
« Le vieil hiver a fait place au printemps. » Le cœur du vieux chercheur désabusé s’épanouit un instant au spectacle du renouveau.
Aux violons paraît d’abord un motif doux et tranquille d’une extrême simplicité, sans accompagnement (toujours le « génie monodique »).

Ce motif devient le sujet d’un développement qui n’est pas, à proprement parler, fugué, mais prend plutôt la forme canonique, les « entrées » se faisant non point à la quarte ou à la quinte, mais à la tierce. C’est sur ce « fond » orchestral profondément expressif que se pose le chant de Faust dont la joie, en présence du réveil de la Nature, se teinte encore de mélancolie.
De gaies chansons de paysans se font entendre dans le lointain. Cette « Ronde » est un des morceaux que Berlioz avait écrits pour les Huit Scènes de Faust. On en remarquera la ligne sinueuse, le contour un peu « grimaçant » et souvent modulant. Il y a là peut-être quelque ironie et, pour la comprendre, il faut relire ce texte de Gœthe, pris dans le rôle de Wagner (le domestique et l’élève du vieux savant), texte que Berlioz avait inscrit en haut de la page sur sa partition : « Monsieur le Docteur, il est honorable et avantageux de se promener avec vous ; cependant je ne voudrais pas me confondre dans ce monde-là, car je suis ennemi de tout ce qui est grossier – leurs violons, leurs cris, leurs amusements bruyants, je hais tout cela à la mort. Ils hurlent comme des possédés, et appellent cela de la joie et de la danse. »
Mais voici que, dans une autre partie de la plaine, une armée s’avance. Le cœur de Faust « frémit à son chant de victoire ».
« J’avais écrit cette marche, raconte Berlioz, dans la nuit qui précéda mon départ pour la Hongrie. Un amateur de Vienne, bien au courant des mœurs du pays que j’allais visiter, était venu me trouver avec un volume de vieux airs quelques jours auparavant : « Si vous voulez plaire aux Hongrois, me dit-il, écrivez un morceau sur un de leurs thèmes nationaux ; ils seront ravis, et vous me donnerez, au retour, des nouvelles de leurs applaudissements. En voici une collection dans laquelle vous n’avez qu’à choisir. » Je suivis le conseil et choisis le thème de Rakoczy. »
Selon Adolphe Boschot, le récit de Berlioz serait quelque peu fantaisiste. Ce serait à Paris même, avant son voyage en Hongrie, qu’il aurait très probablement écrit la Marche hongroise.
Un appel de trompette annonce l’épisode guerrier. Les petites flûtes, accompagnées des pizzicati des cordes, en exposent le 1er thème et les violons la seconde phrase plus mélodique. Mais Berlioz ne se contente pas d’orchestrer brillamment cet air populaire. Il le développe et, utilisant ses éléments divers, il brosse rapidement le tableau d’une bataille éloignée d’abord, puis qui se rapproche. Un Crescendo formidable annonce la victoire. Soulevé par l’enthousiasme, l’orchestre tout entier reprend à pleine force « les rythmes fougueux du thème hongrois ».
J’ai entendu souvent cette marche conduite par Édouard Colonne. Il lui donnait un relief, un accent, un « panache » magnifiques. Son procédé était fort simple : il « retenait » le mouvement comme celui d’un coursier trop ardent dont un habile cavalier sait dompter l’emportement. Il obtenait ainsi l’effet d’une force, d’une intensité d’énergie extraordinaires. Je me rappelle aussi qu’il ralentissait un peu (à peine) le 2e thème et le donnait plus piano que le premier, avec une certaine langueur. Toutes ces finesses sont inconnues de nos chefs d’aujourd’hui qui ne savent que mener la marche le plus vite possible et lui font perdre ainsi, sans s’en douter, tout son dynamisme.
DEUXIÈME PARTIE
Revenu dans le Nord de l’Allemagne, Faust, seul, dans son cabinet de travail, médite :
Sans regret j’ai quitté les riantes campagnes
Où m’a suivi l’ennui.
Sans plaisir, je revois nos altières montagnes…
Il souffre d’une existence qui ne lui a donné que déceptions. Il veut en finir avec la vie. Il saisit une coupe empoisonnée… À ce moment, éclate au dehors le chant de la fête de Pâques :
Christ vient de ressusciter…
Sa beauté simple, sa tranquillité sereine s’opposent au caractère inquiet, tourmenté du monologue de Faust chanté sur un développement d’orchestre en style fugué. Ce chant de Pâques émeut profondément le vieux philosophe. Il réveille en lui de doux souvenirs. Il se rappelle son « heureuse enfance », « la douceur de prier… »
Le Faust de Gœthe s’écrie alors : « La terre m’a reconquis ! » Le Faust de Berlioz – notez la différence – conclut : « Mes larmes ont coulé, le ciel m’a reconquis. » Il a retrouvé l’élan de sa foi première.
L’intervention subite de Méphistophélès aura bientôt fait de détourner le docteur de ses pensées pieuses. Quels voyages merveilleux, quels plaisirs infiniment variés lui propose le démon !
Faust se laisse séduire.
Pour commencer, Méphisto emmène Faust à travers les airs et le conduit dans la Taverne d’Auerbach, à Leipzig.
Gœthe, dans sa « tragédie », nous offre là un tableau réaliste, haut en couleur, des joies grossières de l’étudiant. Il fait visiblement appel à ses souvenirs de jeunesse.
Berlioz s’en inspire pour écrire une page du romantisme le plus rutilant.
Après un chœur de buveurs où les voix avinées se répondent lourdement, Brander chante la Chanson du Rat. « Attention ! annonçait Berlioz lui-même, par une épigraphe sur la partition des Huit Scènes, une chanson de la nouvelle facture ! » Rien de goguenard, de drolatique, de bizarrement comique comme la ligne mélodique et l’orchestration inventées par Berlioz pour conter cette histoire grotesque des aventures d’un rat consumé par l’amour dans le fourneau d’une cuisine.

La mort du rat est saluée d’un ironique « Requiescat in pace ». Et Brander propose, pour l’« Amen », une fugue ! « Improvisons, dit-il, un morceau magistral ! » Alors Méphisto, s’adressant à Faust : « Écoute ceci ! Nous allons voir, docteur, la bestialité dans toute sa candeur ! »
Il faut savoir, pour comprendre l’intention de Berlioz, que les fugues sur le mot « Amen », si fréquentes dans la musique d’église, sont, selon lui, « le plus abominable et le plus indécent des contresens, un impardonnable outrage à l’expression musicale. » Il veut donc nous offrir ici, en caricature, une de ces « hideuses pasquinades harmoniques, excellentes pour peindre une orgie de sauvages ». Il se propose d’écrire une de ces « fugues monstrueuses qui, par leur ressemblance avec les vociférations d’une troupe d’ivrognes, paraissent n’être qu’une parodie impie du texte et du style sacrés. »
Voici, en effet, les buveurs « reprenant, – c’est encore Berlioz qui parle, – dans un mouvement plus large le thème de la Chanson du Rat et faisant une vraie fugue scolastico-classique, où le chœur tantôt vocalise sur a, a, a, a, tantôt répète rapidement le mot tout entier, amen, amen, amen, avec accompagnement de tubas, d’ophicléides, de bassons et de contrebasses ».
Le malheur, – si l’on peut ainsi s’exprimer, – c’est que Berlioz croyant écrire une fugue caricaturale, a, malgré lui, composé une fugue classique de la plus grande beauté, une fugue admirable, d’un mouvement, d’une animation et d’une pureté de lignes incomparables. « Réellement, reconnaissait après coup Berlioz, elle n’est pas assez désagréable ; il y a là une sonorité d’orgue et une harmonie vibrante qui gâtent tout. » Le public, loin de protester ou de rire, applaudissait à tout rompre. Berlioz s’en montrait chagriné et comparait ce succès à celui du sonnet d’Oronte lors de la première représentation du Misanthrope.
Maintenant Méphisto propose à son tour une chanson : ce sera celle de la Puce, fidèle adaptation du texte de Gœthe, chef-d’œuvre d’esprit et de la couleur.

Mais Faust et son compagnon en ont assez. Ils fuient ces lieux « où la parole est vile, la joie ignoble et le geste brutal ».
Les deux voyageurs se trouvent transportés soudain dans les bosquets et les prairies du bord de l’Elbe. Au milieu de ce charmant paysage, Faust s’endort, calme et paisible. Méphistophélès veille sur son sommeil qu’il peuple de rêves délicieux : « Voici des roses, de cette nuit écloses… » Les trombones accompagnent, pianissimo, le chant caressant de Méphisto de leur sonorité creuse si particulière dans la douceur, – les trombones, instruments « sataniques », par excellence.
Un chœur de Gnomes et de Sylphes se joint à Méphisto pour bercer le sommeil de Faust. Le thème de l’« air des roses », repris dans un rythme nouveau et avec un accompagnement tout à fait « aérien » prend une suavité incomparable. Parmi ses rêves, Faust voit apparaître l’image de Marguerite « pure comme l’étoile du matin ».
Encore le thème de l’« air des roses », légèrement déformé, et présenté cette fois sous la forme d’une sorte de valse lente, voici la Danse des Sylphes, telle que l’a conçue déjà Berlioz lorsqu’il composa les Huit Scènes. « Des Sylphes se balancent en silence dans les airs autour de Faust endormi. » Le chant des violons en sourdine, l’accompagnement argentin de la harpe, le ré grave des violoncelles tenu en sourdine d’un bout à l’autre de cette page unique en font une merveille de charme, de grâce et de volupté.
Depuis qu’il a rêvé de Marguerite, Faust ne peut détacher sa pensée de sa céleste image. Avec Méphisto, quittant les prairies de l’Elbe, il arrive près de la maison de Marguerite.
À ce moment un chœur de soldats, puis un chœur d’étudiants passent devant sa porte.
Figurons-nous une rue sombre, étroite, entre de hauts toits, de lourds pignons, des tourelles pointues ; au fond, une place sombre et le porche éclairé d’une église, comme dans un tableau célèbre de Delacroix. Imaginons que par cette rue dévalent des bandes d’étudiants et de reîtres qui chantent à plein gosier. D’abord les soldats : ils font sonner leur bottes sur le rude pavé et scandent de leurs accents vigoureux leur marche lourdement cadencée. Puis les étudiants, clamant sur des paroles latines leur insouciance et leur soif de plaisirs :
Jam nox stellata velamina pandit ;
Nunc bibendum et amandum est ;
Vita brevis fugaxque voluptas ;
Gaudeatnus igitur.
« Déjà la nuit étend ses voiles. Maintenant il faut boire et il faut aimer. La vie est brève et la volupté passe vite. Réjouissons-nous donc ! »
Les deux chansons, d’abord présentées séparément, se superposent ensuite en un ensemble plein de vie, d’une sonorité éclatante.
On peut rappeler à ce propos qu’en 1843, Berlioz entendit le Déserteur de Monsigny et qu’il en fut enthousiasmé. Il signale, dans sa chronique d’alors, un finale où se mêlent deux chansons, celle d’un jeune niais et celle d’un vieux militaire qui aime à boire. « Cette double chanson, écrivait-il, j’avoue que je la regarde comme un trait de génie, ni plus ni moins. » Berlioz prit là, sans doute, la première idée de son double chœur.
Ce double chœur de Berlioz, lui aussi, est un trait de génie. Il termine admirablement, dans un mouvement et un éclat incomparables la 2e partie de la Damnation.
TROISIÈME PARTIE
Sur le seuil de la demeure de Marguerite, Faust éprouve comme la caresse d’un air plus pur. C’est une sensation presque physique qui l’émeut. « Je sens à mon front glisser comme un beau rêve, comme le frais baiser d’un matin qui se lève. » Le compositeur s’enchante de ces images poétiques et les souligne de charmantes inventions harmoniques. « C’est de l’amour ! C’est de l’amour ! J’espère. »
Dans cet espoir d’aimer, les sens, les nerfs, l’imagination, la volonté d’être ou de paraître passionné jouent le rôle prédominant. Cet appel inquiet de Faust nous découvre une fois de plus le secret douloureux de l’âme de Berlioz.
Il n’est pas sans intérêt de comparer cet air de Faust de Berlioz à la cavatine que, dans la même situation, au seuil de la demeure de Marguerite, chante le Faust de Gounod. J’avoue que je préfère infiniment ici l’inspiration de Gounod. Seulement il faut oublier toutes les détestables interprétations de nos ténors français qui ont fait de ce « Salut, demeure chaste et pure » la plus fade romance et la plus dépourvue de toute signification poétique. Il faut l’imaginer chanté avec toute la chaleur intime et contenue qui doit l’animer. Alors elle resplendit dans sa pure beauté. Le Faust de Berlioz est trop occupé de lui-même. Nous serions heureux de le sentir, par une sympathie plus profonde, entrer par avance en communion avec cette âme virginale dont il espère qu’elle rafraîchira la sienne. Sa « curiosité passionnée » manque de cette simplicité du cœur sans laquelle il est impossible de comprendre les simples, et, après tout, elle n’est point si passionnée que le voudrait l’auteur.
L’inspiration de Gounod, bien qu’elle soit enfermée dans cette forme vieillie et un peu conventionnelle de la cavatine, bien qu’elle s’attache un peu trop scrupuleusement à respecter les symétries traditionnelles, me paraît ici très supérieure à celle de Berlioz par la qualité musicale, l’intensité expressive et la continuité.
Suit l’Air du Roi de Thulé (chanson gothique).
L’auteur de la Damnation se trouve ici dans son domaine préféré : il s’agit d’obtenir un effet de couleur, de frapper l’imagination plus encore que le cœur. Berlioz y réussit admirablement. Sa Chanson du Roi de Thulé est gothique à souhait. Elle nous invite merveilleusement à la rêverie romantique, c’est un des chefs-d’œuvre de la partition.
Nous l’avons analysée en parlant des Huit Scènes.
Berlioz aime les contrastes. À la douceur triste de la romance de Marguerite il fait succéder la scène étincelante, éblouissante des follets.
Cette scène, il ne la trouvait point dans le poème de Gœthe, mais différents passages de la « tragédie » de Faust pouvaient néanmoins lui en donner l’idée. Aussi, c’est un feu follet qui guide la course du docteur et de Méphisto à travers les gorges sauvages du Brocken : « Va droit, au nom du Diable, s’écrie Méphisto s’adressant au follet, ou j’éteins d’un souffle l’étincelle de ta vie. » Et Berlioz fait apostropher en ces termes ses follets danseurs par le compagnon de Faust :
Au nom du diable, en danse,
Ménétriers du diable, ou je vous éteins tous !
En quelques brèves paroles soulignées par les étranges sonorités d’un orchestre autrement « satanique » que celui de Gounod, – le diable de Gounod n’est qu’un diable pour rire, – Méphisto appelle les follets. Ils accourent au plus vite et leur vive apparition est traduite par les traits fulgurants de trois petites flûtes aux notes suraiguës.
Menuet des follets. Un menuet, quelle ironie ! Les follets vont danser un menuet ! S’agit-il vraiment de cette danse tranquille, compassée, presque majestueuse dont s’enchantaient les salons et les cours du XVIIIe siècle ? Non certes. C’est une parodie de menuet, une danse bouffonne et pittoresque à la fois, d’un fantastique très particulier. Quelque chose de très aérien et de goguenard en même temps dans son allure zigzaguante. Toujours les petites flûtes et de ronronnants bassons. Les follets vont, viennent, sautent de place en place, font une révérence narquoise et s’esquivent dans une pirouette. Une foule de détails curieux d’orchestration. Par exemple celui-ci : « Une cymbale, suspendue par une courroie et frappée par une baguette à tête d’éponge » rend un son irréel.
Un Presto subit. Le thème de la Sérénade de Méphisto apparaît par avance, déformé de rythme (2 temps au lieu de 3), dans une agitation toute menue, comme chanté par les maigres voix d’êtres minuscules. Fausse reprise du menuet. Un trille piano à découvert. Et la bande des follets cesse sa danse.
Voici maintenant la Sérénade. Méphisto fait mine de jouer de la vielle et son geste est traduit à l’orchestre par des quintes répétées six fois dans le grave des violoncelles.
Et la Sérénade commence, telle qu’elle avait été écrite pour les Huit Scènes, avec quelques différences cependant. Elle n’était accompagnée que d’une guitare. Maintenant elle s’enrichit de toutes sortes d’ingéniosités orchestrales. Rythme cinglé, fouetté, enragé, de valse diabolique, avec ces accents sarcastiques placés sur le temps le plus faible de la mesure à trois temps, le second.
À la fin du premier couplet, un éclat de rire sec et strident lancé par toutes les voix, et l’orchestre clôt la phrase comme par un énorme coup de poing.
Au second couplet, le chœur des follets (voix d’hommes) accompagne en sourdine le chant de Méphisto. Et voici que, pendant que Méphisto respire, le chœur reprend seul le thème ; mais le démon lui coupe la parole et impose sa voix dominante. Cette fausse rentrée est d’un effet admirable, à la fois de naturel et d’esprit.
« Chut ! disparaissez ! » et, sur un trait qui court de l’aigu des violons aux profondeurs les plus graves des contrebasses, la troupe des follets s’évanouit.
Dans la Damnation, nous ne trouvons pas de « scène du jardin ». Le grand duo d’amour de Faust et de Marguerite se passe dans la chambre de la jeune fille.
Berlioz a pris une autre liberté avec le texte de Gœthe dont il s’inspirait. Il a supprimé la courte scène où, dans la rue, devant l’église, Faust aborde Marguerite et lui offre le bras qu’elle refuse. Leur première rencontre a lieu dans la chambre de la jeune fille.
Mais il faut justifier l’accueil que, dès le premier instant, Marguerite va faire à Faust. Il faut expliquer comment son premier mouvement n’est pas d’essayer de fuir devant cet étranger qui s’est subrepticement introduit chez elle. Berlioz a imaginé, à cet effet, un moyen de théâtre, à vrai dire un peu usé. Mais qu’importe ? Il suppose que Marguerite a vu d’avance, en rêve, l’image de Faust et qu’elle en conserve un souvenir ému. L’apparition soudaine de celui qu’un invincible pressentiment lui faisait attendre l’emplit d’un trouble délicieux. Et c’est ainsi que se trouve amené le duo : « Ange adoré dont la céleste image… »
QUATRIÈME PARTIE
On connaît le fameux « air du Rouet » de Gounod et le célèbre lied de Schubert, Marguerite au rouet. C’est dans un tout autre style que Berlioz a conçu la Romance qu’il prête à Marguerite au début de la 4e partie de la Damnation : « D’amour, l’ardente flamme… » Ce morceau n’a pas l’allure d’une « fileuse ». La mélodie n’en est pas conduite par le mouvement monotone du rouet. C’est une méditation passionnée qui se poursuit très librement avec la plus grande variété de rythmes. Elle est d’un sentiment plus grave, plus désolé, plus inconsolable que les pages de Schubert et de Gounod auxquelles nous sommes amenés tout naturellement à la comparer.
Une des plus belles inspirations de Berlioz, et des plus émouvantes, une de celles où parle le plus directement son cœur. On ne résiste point à des accents aussi intensément douloureux, aussi poignants.

La romance de Marguerite s’achève. Au loin, la retraite sonne ; des voix se mêlent aux instruments. Ces chants, ces bruits du soir sont familiers à Marguerite et lui rappellent de doux souvenirs… « Il ne vient pas… Il ne vient pas… Hélas ! »
Suit l’Invocation à la Nature.
Berlioz a pu trouver dans le Faust de Gœthe la première idée de cette page mémorable. Il y pouvait rencontrer des passages comme celui-ci : « Esprit sublime… tu m’accordes de lire dans le sein profond de la Nature comme dans le cœur d’un ami… » Et encore : « Déjà je sens mes forces grandir, déjà j’éprouve en moi comme l’ivresse du vin nouveau. Je me sens le courage de m’aventurer à travers le monde, de porter toute la douleur et tout le bonheur terrestre, de lutter avec les tempêtes et de ne point défaillir parmi les craquements du naufrage… »
Mais Berlioz s’est inspiré de Gœthe très librement et l’on peut dire que c’est sa propre pensée qu’il a surtout traduite dans cette Invocation, d’un sentiment beaucoup moins confiant que celui de son modèle, et dont la conclusion laisse percer l’amertume d’un cœur profondément ulcéré.
Le Faust de Gœthe cherche péniblement la vérité. Il a ses moments de doute. Mais il finit par conquérir la foi dans la vie, dans l’action. Le Faust de Berlioz, en définitive, n’attend rien du monde, ni des choses, et renonce à conquérir un bonheur impossible. C’est bien l’âme du compositeur lui-même, âme lasse, fatiguée, retombant sur elle-même dans l’impuissance et le vide, qui s’exprime ici en des vers de vrai poète :
Nature immense, impénétrable et fière,
Toi seule donnes trêve à mon ennui sans fin ;
Sur ton sein tout-puissant je sens moins ma misère…
Je retrouve ma force et je crois vivre enfin.
Oui, soufflez, ouragans ! Criez, forêts profondes !
Croulez, rochers ! Torrents, précipitez vos ondes !
À vos bruits souverains ma voix aime à s’unir.
Forêts, rochers, torrents, je vous adore ! Mondes
Qui scintillez, vers vous s’élance le désir
D’un cœur trop vaste et d’une âme altérée
D’un bonheur qui la fuit.
Au point de vue musical, Berlioz n’a jamais rien écrit de plus audacieux, de plus libre, de plus affranchi des règles traditionnelles de l’harmonie. La phrase module constamment et de la façon la plus imprévue et contrairement à toutes les lois jusque-là reconnues. Si bien qu’on se demande jusqu’aux dernières mesures quelle peut être la tonalité de cette page si étrangement construite. Après les dernières notes du chant où s’affirme la tonalité d’ut dièse mineur, nous nous croyons enfin revenus sur le terrain solide de l’harmonie classique, mais au bout de six mesures, l’orchestre, comme pour augmenter le désarroi de nos impressions, et peut-être pour mieux exprimer celui des pensées de Faust, conclut par une cadence vacillante dans le mode hypodorien.
Page d’apparence décousue, mais où le génie du compositeur établit de secrètes liaisons et une si forte unité !
Morceau puissant, majestueux et profondément émouvant. Jamais Berlioz ne s’est livré, n’a consenti à l’entier aveu de ses tourments de façon plus tragique.
La Course à l’abîme. – Dans un mouvement furieux, Faust et Méphisto galopent sur deux chevaux noirs. Rythme persistant d’une croche et de deux doubles croches à l’orchestre.
Faust est poursuivi par le souvenir de Marguerite : « Dans mon cœur retentit sa voix désespérée… Ô pauvre abandonnée ! »
Les deux cavaliers traversent plaines et montagnes. Le paysage fuit devant eux interminablement.
Ils rencontrent un groupe de paysans agenouillés devant une croix et psalmodiant : « Sancta Maria, ora pro nobis. Sancta Magdalena, ora pro nobis… » – « Prends garde à ces enfants, s’écrie Faust, à ces femmes qui prient au pied de cette croix ! » – « Eh ! qu’importe, répond Méphisto. En avant ! » – « Sancta Margarita ! » reprennent les voix. Un éclair frappe la croix qui tombe renversée. Femmes et enfants s’enfuient, pleins d’épouvante. Les cavaliers sont déjà loin.
Des visions de l’enfer hantent l’imagination de Faust : « Dieux ! Un monstre hideux, en hurlant, nous poursuit !… » – « Tu rêves. » – « Quel essaim de grands oiseaux de nuit !… Quels cris affreux !… Ils me frappent de l’aile ! » – « As-tu peur ? ricane Méphisto. Retournons ! » Ils ralentissent le pas de leur chevaux… Le glas des trépassés sonne… Ils s’arrêtent. Faust croit entendre la voix de Marguerite. « Courons ! » Les chevaux repartent plus vite encore. « Hop ! hop ! » crie le démon. – « Regarde autour de nous, reprend Faust, cette ligne infinie de squelettes dansants, avec quel rire horrible, ils saluent en passant ! » – « Hop ! Pense à sauver ta vie et ris-toi des morts ! Hop ! Hop ! »
Les chevaux frémissent. Leurs crins se hérissent. Ils brisent leurs mors. Le tonnerre gronde avec des roulements affreux. « Hop ! Hop ! » Il pleut du sang ! Méphisto triomphe et il appelle à lui le peuple des démons : « Sonnez vos trompes ! Il est à nous ! »
Faust et son compagnon s’abîment dans les enfers.
On entend un chœur chanter dans une langue diabolique : « Irimiru Karabras. »
Ainsi s’achève, – ou presque, – dans un tourbillon de désespoir cette œuvre magnifique où s’exprime en traits de feu la grande âme tourmentée de Berlioz.
Ce n’est pas tout à fait la fin cependant. Car une dernière, page s’ajoute à la partition : le Ciel et Apothéose de Marguerite, dont on a pu se demander si elle était bien sincère[21].
CHAPITRE XVI
LE PROPHÈTE (1849) – L’ÉTOILE DU NORD (1854)
LE PARDON DE PLOËRMEL (1859)
L’AFRICAINE (1865)
Le temps passait depuis les Huguenots (1836) et on attendait toujours à Paris une nouvelle partition de Meyerbeer. Mais Meyerbeer ne se hâtait point. Il était soucieux de la plus minutieuse préparation possible d’un nouveau succès. Et il travaillait. On annonçait deux ouvrages de lui : l’Africaine et le Prophète. Lequel passerait le premier ? C’était Meyerbeer lui-même qui avait apporté le sujet de l’Africaine à Scribe. Mais Scribe faisait des difficultés pour en mettre sur pied le livret de la manière que l’entendait Meyerbeer. Scribe, à son tour, avait proposé un autre sujet, celui du Prophète, et Meyerbeer, sans enthousiasme, l’avait accepté. Dès que son collaborateur lui en avait fourni les éléments, il s’était mis à la tâche. Dès 1843, on disait la partition terminée. Le directeur de l’Opéra s’impatientait. Le public aussi. Mais Meyerbeer attendait que l’Opéra eût engagé les artistes indispensables selon lui à la bonne interprétation de son œuvre. Il voulait Levasseur. Il voulait Mme Pauline Viardot et, pour éviter Duprez, se contentait de Roger. Le rôle de Bertha, écrit pour Jenny Lind, fut en définitive distribué à l’insuffisante Mlle Castillon. Enfin, tout s’arrangeait peu à peu. En ce qui concerne la mise en scène, on songeait à des attractions de première importance : le ballet des patineurs (organisé par l’inventeur du patin à roulettes à qui l’on confia une classe de patinage à l’Opéra), le brouillard et le lever du soleil sur la plaine de Münster, le couronnement dans la cathédrale, l’incendie final.
Le 11 avril 1849, le Prophète obtenait un succès décisif.
Il y a de belles pages dans le rôle de Jean de Leyde et surtout dans celui de Fidès, sa mère. Mais la partition est assez inégale. Et l’on n’imagine pas, si l’on n’a pas vu représenter l’ouvrage, à quel point les trois anabaptistes peuvent être ennuyeux !
Meyerbeer emploie avec assez de bonheur le procédé du rappel des motifs. Le thème de la prière de Fidès pour son fils, celui de l’amour de Jean pour Bertha, et surtout celui de la marche du Roi-prophète donnent lieu à de discrètes réapparitions de l’effet le plus juste.
Toujours cette déclamation un peu lourde, cette éloquence un peu trop appuyée, ce style « grand opéra » qui nous est devenu odieux et qui rendrait probablement insupportable aujourd’hui la reprise d’un tel ouvrage.
Mais on avait alors le goût de ces choses et, dès la saison d’été de 1849, le Prophète commençait une tournée triomphale de représentations à travers le monde, d’abord à Londres avec Mme Viardot et Mario ; puis à Berlin avec Mme Viardot encore et le remarquable ténor Tischatchek.
Mais déjà Meyerbeer songeait à composer une autre œuvre, cette fois-ci un opéra-comique ou quelque chose d’approchant. Ce fut l’Étoile du Nord.
Il y travaillait malgré un état de santé de plus en plus médiocre. On ne le voyait plus. Il vivait dans la solitude. Les médecins – c’était la mode alors – l’envoyaient tantôt au bord de la mer, tantôt dans une ville d’eaux. Il passait de Dieppe ou de Nice à Ems ou à Swalbach. Il séjournait surtout à Spa.
La maladie ne l’empêchait point d’écrire, d’écrire de la musique et de correspondre avec ses librettistes et avec son directeur.
L’Étoile du Nord eut sa première représentation le 16 février 1854 à l’Opéra-Comique de la salle Feydeau. Ce fut un succès éclatant. Pierre le Grand de Russie, sous les habits d’un simple charpentier et la future Catherine au temps où elle le connut, alors cantinière des ouvrières de son village, en étaient les principaux personnages.
Je viens de relire avec plaisir la douce cantilène de Pierre :

J’ai goûté particulièrement l’art ingénieux avec lequel Meyerbeer amène ce motif en mi bémol par un récitatif en sol majeur : « Pour fuir son souvenir… »
La joie que put éprouver Meyerbeer du succès de l’Étoile du Nord fut malheureusement compensée par la grande tristesse, l’affliction profonde que lui causa la mort de sa mère (24 juin 1854), pour laquelle il avait la plus tendre affection en même temps que la plus vive et respectueuse admiration.
Meyerbeer aimait écrire des marches solennelles. Il y trouvait l’occasion de manifester son goût pour le pompeux. À l’occasion du mariage du prince Frédéric-Guillaume de Prusse avec la princesse d’Angleterre, à Londres, le 25 janvier 1858, il composa sa quatrième Marche aux flambeaux.
À la fin de la même année, il revenait à Paris pour diriger les études d’un nouvel opéra-comique : le Pardon de Ploërmel, qu’on désigne à l’étranger sous le titre de Dinorah, opéra-comique copieusement mêlé d’éléments pittoresques et fantastiques. Cette fois Meyerbeer abandonna Scribe et confia à Michel Carré et Barbier le soin de lui fournir son livret. La première représentation eut lieu le 4 avril 1859. Le public se montra hésitant devant une œuvre qui ne rentrait pas dans les cadres traditionnels. Opéra-comique, si l’on veut, mais plutôt opéra légendaire et fantastique en même temps que charmante pastorale. Les légères et joyeuses arabesques du rôle de Dinorah, la gravité passionnée des airs du chercheur d’or Hoël, la fantaisie spirituelle du rôle de Corentin, le joueur de biniou, finirent par triompher des premières résistances des auditeurs parisiens. En dehors de Paris, 70 villes avaient représenté en moins d’un an le nouvel ouvrage de Meyerbeer.
J’aimais autrefois et j’aime encore l’ouverture, d’un beau développement symphonique avec intervention des chœurs du « pardon », le trio de la clochette, la valse : « Ombre légère qui suis mes pas… » et le paysage musical du 3e acte qui fait un si joli hors-d’œuvre avec les airs successifs du chasseur, du faucheur, des 2 pâtres dont les voix diverses finissent par s’unir en un hymne matinal au Créateur.
Meyerbeer avait toujours plusieurs projets dans la tête et il commençait souvent de les réaliser pour les laisser bientôt de côté. De ces projets il en est un assez curieux qu’il est intéressant de signaler. En 1860 il avait entrepris un intermède scénique pour une pièce de Henry Blaze de Bury, reçue à l’Odéon : La Jeunesse de Gœthe. Il s’agissait d’une vision du poète relative à son Faust. La scène de l’église, le chœur des étudiants, l’hosanna séraphique qui termine le second Faust devaient y trouver place, ainsi que le lied de Mignon, le chant des Parques d’Iphigénie en Tauride, et toute la scène du Roi des Aulnes pour laquelle Meyerbeer se proposait d’orchestrer le lied de Schubert et d’en confier le chant à différentes voix et à un chœur. Une lettre de 1861 donne des indications à cet égard. Mais on ne voit pas bien comment ces éléments disparates auraient été combinés. Meyerbeer avait, paraît-il, établi complètement sa partition. Elle n’a pas été retrouvée.
Mais le projet qui restait le plus cher à l’auteur des Huguenots sur la fin de ses jours, c’était celui de l’Africaine. Dès la fin de 1839 probablement il en avait mis sur pied la partition complète, plus que complète, débordante, luxuriante, d’une étendue double de celle qu’on exécute maintenant. Il se réservait de supprimer au cours des répétitions les parties qui lui sembleraient le moins bien venues ou le moins opportunes dans le développement de l’action. Il attendait toujours la distribution la plus favorable. Il aurait désiré Jenny Lind, Pauline Viardot, Sophie Cravalli. Du moins il eut Faure, le créateur d’Hoël du Pardon de Ploërmel. Il ne pouvait espérer mieux pour le personnage de Nélusko. Marie Sass et Naudin étaient d’autre part des interprètes fort honorables.
Naturellement, et comme toujours, il eût voulu mettre l’œuvre en scène lui-même. À cet effet il s’installa à Paris durant l’automne de 1863. Mais il était déjà bien malade. Soudain son état s’aggrava et, dans la matinée du 2 mai 1864, il rendit le dernier soupir.
On lui fit des obsèques magnifiques. De la rue Montaigne à la gare du Nord par les boulevards, un imposant cortège se déploya au travers d’une foule dense, respectueuse et émue. La mort d’un grand homme ne laisse jamais un peuple indifférent, pourvu qu’il ait senti le rayonnement de sa gloire.
Le soir, l’Opéra donnait les Huguenots, avec Faure dans le rôle de Nevers dont il avait réalisé une interprétation inoubliable.
Fétis avait été chargé, en l’absence du compositeur, de diriger les études de l’Africaine. Il fut amené à laisser tomber une vingtaine de numéros de l’énorme partition, de la partition démesurément étendue. On a recueilli toute cette musique inutile. Il n’y a aucune perte à regretter.
Le 28 avril 1865 avait lieu la première de l’Africaine. Le triomphe en prit « des proportions sans précédent et qu’on n’a point revues ». La centième était donnée dix mois plus tard, le 9 mars 1870.
*
De toutes les partitions de Meyerbeer l’Africaine est celle que je préfère. C’est la moins inégale. C’est celle aussi où se manifestent le plus heureusement deux caractères assez rares dans sa musique : le charme et la tendresse.
Le Prélude instrumental d’abord est admirablement réussi, fin, délicat, d’une jolie orchestration et très harmonieusement construit sur deux motifs de l’opéra : Celui de l’air d’Inès : « Adieu, mon doux rivage… » et la phrase de la même Inès au 2e acte : « Eh bien, sois libre par l’amour… »

Sur des paroles parfois d’une navrante platitude, Meyerbeer a inscrit souvent d’heureuses inspirations musicales :
Au 1er acte la phrase d’Inès se déroule avec une ampleur aisée :

L’unisson des basses : « Dieu que le monde révère » a une certaine majesté.
La scène de Nélusko et de Sélika devant le Conseil a du pittoresque et de l’éloquence ; Nélusko se montre rude à souhait.
J’aime le mouvement et la fière allure de la phrase de Vasco de Gama reprise par les chœurs.

Ne vous montrez pas difficile sur le rapport de la musique et du poème… (quel poème !) L’essentiel c’est que ce soit de la musique. C’en est.
Le 2e acte débute par l’air du Sommeil que chante Sélika éventant Vasco. Le motif est assez agréable.
Le grand air de Nélusko : « Fille des rois… » est solidement bâti et il se termine par une très belle phrase :

Le duo qui suit entre Vasco et Sélika se laisse écouter. Plus loin, nous retrouvons avec plaisir dans le septuor, la phrase d’Inès « Eh bien, sois libre par l’amour » déjà citée dans le Prélude.
Dans l’acte du Navire, ce qu’il y a de meilleur c’est la Ballade de Nélusko : « Adamastor, roi des vagues profondes… » Le reste est de mince valeur.
À l’acte suivant le grand air de Vasco débute sur un motif délicieux, joliment accompagné par les batteries des bois dans l’aigu :

On aime moins la fin de l’air.
Il y a beaucoup d’émotion dans la Cavatine de Nélusko : « L’avoir tant adorée… »
Le duo de Sélika et de Vasco renferme au moins une phrase charmante :
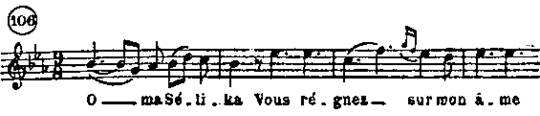
La grande scène finale du Mancenillier débute par le fameux unisson des cordes :

dont j’avoue que je n’ai jamais apprécié la valeur tant vantée et tant applaudie. La phrase, tellement déclamatoire, sonne terriblement le creux.
Et les dernières pages de la partition ne renferment rien de bien remarquable.
Dans mon enfance et ma première jeunesse on jouait sans cesse l’Africaine à l’Opéra et je l’ai vu représenter maintes et maintes fois avec une distribution hors de pair : Gabrielle Krauss et Lassalle dans les rôles de Sélika et de Nélusko, Villaret dans celui de Vasco. J’étais enthousiasmé et j’ai conservé pour la partition une sorte d’affection reconnaissante qui expliquera et fera excuser ce qu’il y a peut-être d’un peu partial dans le jugement que je porte sur l’ensemble de l’œuvre. Mais cependant je ne crois pas me laisser trop égarer par mes impressions lointaines du jeune âge et je possède assez de sens critique, il me semble, pour remettre les choses à leur plan véritable.
De toute façon, il faut bien le reconnaître, l’Africaine appartient à un genre périmé, est d’un style passé de mode et il ne faut point songer à rendre à cet ouvrage quelque chose de son ancien succès.
*
Meyerbeer a été jugé bien diversement : suivant les uns il aurait eu tous les défauts du Juif et on lui reproche alors tout particulièrement d’avoir dépensé des sommes considérables pour assurer la réussite de ses ouvrages.
Il était riche : c’était son droit.
Mais, à le bien considérer, Meyerbeer paraît avoir été un homme fort estimable. C’était un esprit profondément religieux. Il pratiquait sa religion avec une sincère piété. On signale de lui maints traits de générosité. Il se montrait volontiers bienfaisant envers ceux de ses compatriotes qu’il savait dans la détresse. En 1847, il tira de la misère une descendante de Gluck qu’il découvrit à Vienne. Dans son testament il inscrivit la fondation d’une sorte de « prix de Rome » pour les Allemands qui devait permettre aux lauréats de passer six mois en Italie, six à Paris, six à Munich, Vienne et Dresde.
Très correct, très affable, il détestait le monde et ne vivait que pour la musique, pour sa musique.
La musique ? L’aimait-il d’un amour sincère, profond ? Ne l’aimait-il que pour les gains et surtout pour la gloire qu’elle lui rapportait ? Cette gloire l’a-t-il recherchée à tout prix, et au besoin par des moyens de mauvais aloi ?
Je crois que Meyerbeer fut un musicien sincère et probe, et si sa musique a des défauts, elle les doit aux défaillances de son goût, mais non au désir de flatter le public.
Il n’en est pas moins vrai que les opéras de Meyerbeer ne « restent » pas. Malgré son incontestable habileté technique, malgré le coloris un peu voyant de son orchestration et une certaine fantaisie pittoresque un peu lourde, malgré la vigueur de certains effets dramatiques, cet art manque d’élévation et de poésie. Fait pour plaire à une époque, il disparaît avec elle.
CHAPITRE XVII
1858
ORPHÉE AUX ENFERS
Orphée aux enfers (1858) révéla pour la première fois au monde entier la réalité du génie bouffon d’Offenbach.
De son vrai nom, Offenbach s’appelait Lévy. Il prit le nom d’Offenbach du nom de la petite ville d’Offenbach-sur-le-Main, non loin de Cologne, où il était né le 21 juin 1819.
Il montra de bonne heure de telles dispositions musicales que son père résolut de l’emmener à Paris, dans le centre de la vie musicale universelle. Jacques Offenbach avait alors 14 ans. Il craignait de ne pouvoir entrer au Conservatoire. Cherubini appliquait très rigoureusement le règlement qui en interdisait l’accès aux étrangers. Il y fut admis tout de même et aussi en même temps dans l’orchestre de l’Opéra-Comique comme violoncelliste. Bientôt il se faisait connaître dans les salons et dans les concerts, non seulement comme violoncelliste, mais comme joueur de mirliton. Et c’était bien moins son talent sur le violoncelle que toutes les calembredaines, toutes les bouffonneries dont il accompagnait ses exécutions qui lui valurent immédiatement un succès considérable.
Il entreprend alors des tournées en Allemagne. Partout il est fort bien accueilli.
Il compose. Il met en musique les fables de La Fontaine.
Il donne des concerts à Londres, non seulement pour le grand public, mais à la Cour pour la reine Victoria.
Il épouse Mlle Herminie de Alcain, d’une famille de réfugiés carlistes qui a 20 ans comme lui. À cette occasion, il se convertit à la religion catholique. Le jeune ménage s’installe dans un modeste logis du passage Saulnier qui devient bientôt un des salons les plus à la mode du Paris artistique.
Cependant il ne cesse de composer, notamment de petits opéras-comiques qu’il place difficilement et qui n’obtiennent qu’un succès médiocre, et puis aussi des Mélodies, et une Fantaisie sur Robert le Diable pour sept violoncelles.
Arsène Houssaye, devenant administrateur de la Comédie-Française, l’appelle à la direction de l’orchestre de ce théâtre.
Mais ce poste, cette fonction ne lui plaisait guère. Composer la musique du Bonhomme jadis pour la pièce de Murger ou la Chanson de Fortunio pour le Chandelier de Musset, c’était trop peu de chose pour son besoin d’activité fiévreuse.
À propos du Chandelier on conte l’anecdote suivante : c’était le comédien Delaunay, célèbre pour le timbre charmeur de sa voix parlée dans les rôles d’amoureux, qui jouait le personnage de Fortunio. Or il se trouva que lorsqu’il voulut lui faire chanter la Chanson qu’il avait composée pour lui, Offenbach fut obligé de constater avec chagrin d’abord que Delaunay n’était pas du tout musicien, et que lorsqu’il cessait de parler et qu’il essayait de chanter, il révélait une affreuse voix de basse caverneuse et rude qu’on ne lui soupçonnait pas. Le comédien dut renoncer au chant et se contenter de dire les jolis vers de Musset.
Mais Offenbach ne se contente pas des menues occupations que lui donne la Comédie-Française. Il entreprend d’autres travaux. Il fait passer aux Variétés un « acte espagnol » Pepito qui reçoit le meilleur accueil. Puis il écrit pour les Folies-Nouvelles Oyayaye ou la Reine des Îles (1855) « anthropophagie musicale » en 1 acte. Le voici enfin dans son véritable domaine, la bouffonnerie débridée. Dans cette pièce extravagante, il s’agit d’un contrebassiste, Racle-à-mort, qui, embarqué pour une longue traversée, fait naufrage et aborde en Océanie. Prisonnier d’anthropophages qui lui laissent pour tous vêtements un chapeau, un faux-col, une cravate et des bottes, il a l’ordre de distraire Oyayaye, la reine du pays. Racle-à-mort n’est pas pris au dépourvu. Il met en musique, avec variations à l’italienne, la note de la blanchisseuse de la Reine, et la lui fait chanter. Mais voici qu’Oyayaye a faim et elle jette de tels regards sur l’infortuné Racle-à-mort que celui-ci comprend que la Reine veut le dévorer. Il lui joue alors de la contrebasse. Elle est ravie, mais elle a toujours faim. Il lui joue du mirliton. Mêmes extases, puis mêmes regards avides de nourriture. Racle-à-mort ne voit plus son salut que dans la fuite. De sa contrebasse il fait un canot, de son mouchoir une voile et il prend la mer en faisant un pied de nez à la reine des anthropophages.
Cette pochade burlesque eut un immense succès.
Alors Offenbach tenta la chance en prenant la direction d’un théâtre, d’un minuscule théâtre construit aux Champs-Élysées par le prestidigitateur Lacaze et qui devenait vacant. Il obtint de l’administration des Beaux-Arts l’autorisation d’y jouer des pièces en 1 acte avec musique, sous condition qu’il n’emploie jamais plus de trois personnages.
C’était pendant l’Exposition de 1855. Offenbach eut l’adresse de réunir quelques excellents acteurs : Darcier, Berthelier, Pradeau, Mlle Montrouge et la danseuse Mariquita. Il afficha un premier spectacle composé de : 1° un prologue intitulé Entrez, messieurs, mesdames sur un texte de Méry et Jules Servières (pseudonyme de Ludovic Halévy) ; 2° une petite opérette Nuit blanche ; 3° une pantomime Arlequin barbier ; 4° pour finir, les deux Aveugles.
Il avait appelé son théâtre les Bouffes-Parisiens. Tout de suite, il encaissa des recettes formidables de 1.200 francs, formidables pour la valeur de l’argent à cette époque et pour l’exiguïté du local.
Puis vinrent : le Violoneux, où débuta Hortense Schneider, et Madame Papillon.
L’hiver venu, le succès continuait, si bien qu’Offenbach donna sa démission de chef d’orchestre de la Comédie-Française.
La salle du passage Choiseul devenant libre, Offenbach la loua et obtint l’autorisation d’y représenter des pièces à quatre personnages, et, le 29 décembre 1855, il y transportait son théâtre toujours sous le titre de Bouffes-Parisiens. L’été, il émigrait à Marigny.
Nous n’énumérerons pas la multitude de partitions qu’Offenbach écrivit alors, toujours à la diable, mais avec un sens aigu du comique musical. Une d’entre elles, Croquefer ou le dernier des Paladins, alla aux nues. Elle donna lieu à un incident amusant.
La veille de la « première », Croquefer fut interdit La censure y avait-elle trouvé quelque chose à redire ? Pas le moins du monde. Mais Croquefer comportait un personnage de plus que les personnages autorisés. Offenbach, souvent invité à la Cour, protégé de l’impératrice, avait pensé qu’on ne lui ferait pas un crime de ce manquement au règlement. Mais les bureaux se montraient intransigeants. Le ministre refusa de créer un « précédent ». Alors les auteurs eurent une idée. Le 5e personnage Mousse-à-mort était indispensable à l’action. On imagina qu’il avait eu la langue coupée dans un combat contre les Sarrasins. Et les paroles qu’il aurait dû prononcer on les inscrivit sur des banderolles déroulées à point nommé. Subterfuge renouvelé de nos anciens entrepreneurs de spectacles du XVIIe siècle. Et comme il y avait un quintette où Mousse-à-mort devait tenir sa partie, on remplaça le texte par des onomatopées ou des aboiements. Le tour était joué. Le public s’amusa énormément et le ministre fut le premier à rire de cette heureuse trouvaille. Bientôt après, les bureaux de l’administration des Beaux-Arts recevaient l’ordre de ne plus limiter le nombre des personnages autorisés à jouer un rôle dans les pièces des Bouffes.
Le Mariage aux lanternes inaugura le nouveau régime. Cette même année 1856, Offenbach organisait un concours d’opérette pour faciliter la carrière des jeunes auteurs. Le jury couronna ex æquo les deux partitions de Georges Bizet et de Charles Lecocq, et le Docteur Miracle fut joué 22 fois avec la musique de Bizet et celle de Lecocq alternativement.
Avec Orphée aux enfers (1858) commence la série des grandes opérettes d’Offenbach, des opérettes-parodies qui travestissent l’antiquité et en même temps tournent en dérision les procédés du grand opéra. Orphée aux enfers fut le premier succès européen d’Offenbach.
Le livret était signé du seul Hector Crémieux. Mais Ludovic Halévy y avait collaboré. La vieille fable d’Orphée se trouve singulièrement transformée. Orphée se rend dans les royaumes infernaux pour rechercher sa femme, mais non plus par amour. S’il la réclame, c’est uniquement pour faire taire les clameurs de l’Opinion publique, un personnage en chair et en os qui raconte partout qu’Orphée est un mari trompé. Au 2e acte nous assistons au retour des dieux de leurs équipées nocturnes et aux scènes que Junon fait à son volage époux Jupiter. Puis c’est l’arrivée d’Orphée, remorqué par l’Opinion publique, la visite de Pluton à Jupiter, occasions de toutes sortes d’inventions plaisantes.
La première version de la pièce était en 2 actes et 4 tableaux. Orphée aux enfers, agrandi plus tard en 4 actes et 12 tableaux devint une véritable féerie. La mise en scène y prenait alors peut-être trop d’importance et faisait un peu oublier l’intérêt du texte et de la musique.
La partition d’Orphée aux enfers, prélude magnifiquement à la série des chefs-d’œuvre d’Offenbach. Il n’est pas exagéré de parler ici de chefs-d’œuvre. La musique bouffe peut avoir son genre de beauté, son genre de grandeur même. Le comique, la bouffonnerie d’Offenbach a des proportions immenses, et en même temps elle a toujours des proportions heureuses : c’est de la vraie musique, et parfois de la grande musique. Ses ensembles, à la fin des actes, sont construits avec un souci merveilleux de la ligne architecturale : c’est la perfection dans cette sorte de style. L’ouverture d’Orphée, les couplets d’Eurydice, la chanson pastorale d’Aristée, les couplets de l’Opinion publique, le chœur du Sommeil, la valse de Vénus, autant de pages mémorables et il faudrait en citer bien d’autres.
Orphée aux enfers eut 228 représentations consécutives. La 228e fut une représentation de gala. L’Empereur, prenant la tête du mouvement d’universelle approbation qui se dessinait dans le public, demanda que cette dernière eût lieu aux Italiens. Le spectacle se composa de la Joie fait peur, en lever de rideau, jouée par la Comédie-Française, le Violoneux, chanté par Mme Cico, Orphée avec les chœurs et l’orchestre des Italiens, puis un pas de la Sylphide, donné par la Livry et Mérante, enfin une saynète intitulée le Musicien de l’Avenir qui persiflait Wagner. Là les auteurs Eugène Grangé et Philippe Gilles et le compositeur Offenbach auraient mieux fait de se tenir tranquilles. Wagner traînait alors à Paris une existence misérable, dont nous reparlerons plus loin. Il avait jusque-là entretenu de bonnes relations avec Offenbach qu’il avait rencontré chez des amis communs. Il avait toujours émis des jugements favorables sur sa musique. Il l’appelait plaisamment « le petit Mozart des Champs-Élysées ». Il ne pardonna pas à Offenbach d’avoir amusé le public à ses dépens. Il écrira plus tard dans l’Allgemeine Musik Zeitung : « Offenbach possède, la chaleur qui manque à Auber ; mais c’est la chaleur du fumier : tous les cochons d’Europe ont pu s’y vautrer. » Répartie également injuste, qui dépasse le but.
*
Offenbach a écrit plus de cent pièces de théâtre. Nous ne les citerons naturellement pas toutes. Nous voudrions seulement indiquer celles qui firent le plus pour sa réputation.
Le 5 janvier 1861, la Chanson de Fortunio eut un tel succès devant le public de la première représentation qu’elle fut entièrement jouée deux fois de suite.
Mais voici maintenant des œuvres plus importantes :
La Belle Hélène, d’abord, dont Meilhac et Halévy avaient fourni le texte délicieux.
Meilhac et Halévy étaient deux camarades du lycée Louis-le-Grand qui s’étaient presque ignorés durant le temps de leurs études. Meilhac avait deux ans de plus qu’Halévy. C’était un « grand ». Mais ils prenaient leurs récréations dans la même cour. Après le lycée, ils s’étaient rencontrés sur le boulevard, reconnus, et liés d’amitié. Ils adoraient tous deux le théâtre et ils en vinrent assez vite à cette collaboration fructueuse, où Meilhac apportait son esprit, Halévy sa sensibilité, son goût et son style.
Les deux amis, accompagnés d’Offenbach, un beau matin de 1864, sonnèrent à la porte d’Hortense Schneider pour lui offrir le rôle principal de la Belle Hélène. On pense s’ils furent bien reçus. Les répétitions commencèrent. Elles furent très houleuses. Offenbach n’était pas très content de son orchestre (26 musiciens) ni de ses chœurs. Il se montrait très nerveux. Un jour, il crut entendre du bruit dans une baignoire. Or, il ne supportait la présence d’aucun étranger aux répétitions. Il fit taire l’orchestre et les chanteurs et lançant un regard fulminant vers la salle :
« Quelqu’un est là ! s’écria-t-il. Je ne veux personne.
– Personne ? lui réplique Meilhac. Pas même le comte de Morny ?
– Ah ! si le comte de Morny est là, c’est une autre affaire. Lui et le chef de claque, je veux bien, mais ceux-là seuls. »
Et puis Hortense Schneider faisait la mauvaise tête. On se disputait les répliques amusantes. « Ménélas est mon mari dans la pièce, disait la Schneider. C’est donc à moi que revient la réplique « la pipe à Ménélas. »
L’excellent José Dupuis réclamait un autre air pour ses couplets :
Au mont Ida, trois déesses
Se querellaient dans un bois.
Quelle est, disaient ces princesses,
La plus belle de nous trois ?
Offenbach improvisa devant Dupuis trois autres airs différents pour les mêmes paroles. Dupuis, après avoir écouté les trois airs, se trouvait aussi embarrassé dans son choix que Pâris en présence des trois déesses. La dernière version finit cependant par lui plaire davantage. Offenbach la griffonna à la hâte. Pâris l’emporta à Nogent où il habitait, l’apprit en une nuit : il était bon musicien, ancien premier prix de violoncelle au Conservatoire de Liège. Et le lendemain, il chantait cet air à la répétition, cet air qui, par lui choisi, devait faire bientôt le tour du monde.
Je n’ai jamais entendu Hortense Schneider. Elle ne chantait plus lorsque j’aurais été d’âge à l’écouter. C’est Jeanne Granier qui, dans ma jeunesse, jouait délicieusement le rôle d’Hélène. Mais j’ai eu la bonne fortune d’applaudir José Dupuis. Quel merveilleux artiste ! Doué d’une très jolie voix de ténor, il chantait de façon exquise. Et puis, remarquable comédien, il avait surtout une simplicité, une naïveté, une ingénuité de diction vraiment admirables. D’ailleurs de haute taille et de belle allure.
Je ne sais si je ne mets pas la partition de la Belle Hélène au-dessus de toutes les autres du même compositeur ! Elle persifle les procédés du « grand opéra » de Meyerbeer et de Rossini avec un esprit extraordinaire et par des moyens qui ne cessent de nous séduire par leur propre musicalité. Le Trio du 3e acte est, à cet égard, un pur chef-d’œuvre.
La Belle Hélène a presque une portée philosophique et sociale avec son leit-motiv de la Fatalité. Louis Schneider, le très distingué historien de l’opérette française, a pu dire assez justement : « La Belle Hélène, c’est en somme, le « Crépuscule des Rois » médité et écrit par un Wagner gai. »
La partition de la Belle Hélène, consultée par Louis Schneider, appartenait à Paul Gallimard, le collectionneur bien connu, qui la tenait « en souvenir de gratitude reconnaissante » d’Hermine Offenbach, la veuve du compositeur. C’est un assez gros registre de format oblong 26 X 34, d’écriture svelte et nette, de 200 pages non numérotées.
Ludovic Halévy nous a laissé un curieux témoignage sur la façon dont Offenbach composait : « Je ne puis regarder, disait-il, cette partition de la Belle Hélène sans revoir Offenbach en train d’orchestrer devant le petit bureau de son cabinet, rue Laffitte. Il écrivait, écrivait, écrivait, – avec quelle rapidité ! – puis de temps en temps, pour chercher une harmonie, plaquait, de la main gauche, quelques accords sur le piano, pendant que la main droite courait toujours sur le papier. Ses enfants allaient et venaient autour de lui, criant, jouant, riant et chantant. Des amis, des collaborateurs arrivaient… Avec une entière liberté d’esprit, Offenbach causait, bavardait, plaisantait… et la main droite allait toujours, toujours, toujours… Et voilà comment il a écrit cette longue suite d’admirables et délicieux petits chefs-d’œuvre. »
Menée avec succès par ces deux protagonistes hors de pair, Hortense Schneider et José Dupuis, la Belle Hélène alla aux nues.
Voici maintenant Barbe-Bleue, la parodie du moyen âge comme la Belle Hélène avait été la parodie de l’antiquité, de ses héros et de ses dieux.
*
Barbe-bleue passa le 5 février 1866 aux Variétés.
Le Barbe-bleue de Meilhac et Halévy n’égorge pas lui-même ses femmes. C’est un joyeux compère qui éprouve de temps en temps le besoin de changer de sultane ; et alors il charge son chimiste attitré, Popolani, de les empoisonner. Mais Popolani se garde bien d’exécuter à la lettre les ordres de son maître. Il n’offre pas à toutes ces délaissées le fatal verre d’eau sucrée, ou bien à l’eau sucrée il n’ajoute aucun poison. Il les laisse vivre et se peuple ainsi à peu de frais un agréable sérail.
Naturellement Barbe-bleue finit par découvrir qu’il a été joué. Sept femmes bien vivantes sont là, devant lui. Qu’en faire maintenant ? Il ne songe plus à les tuer et il trouve la solution élégante et douce : marier ces sept femmes à sept galants chevaliers. Et tout se termine par des chansons.
Barbe-bleue obtint un grand succès devant son premier public, mais ne le retrouva pas aussi plein, aussi incontesté par la suite. La verve en est moins drue que celle de la Belle Hélène.
*
Avec la Vie parisienne, Offenbach retrouva un triomphe éclatant et durable. Il s’agissait de tenir une pièce toute prête pour les grands jours de l’Exposition de 1867. Le titre et le sujet de cette Vie parisienne ne pouvait mieux convenir.
La Vie parisienne se joue au Palais-Royal.
Aux Variétés, ce sera la Grande-Duchesse de Gérolstein qui sera la pièce de l’Exposition, avec, encore une fois, Hortense Schneider et José Dupuis pour mener le train.
À ce propos, une petite histoire :
Le grand-duc Vladimir, fils du tsar, vient à Paris pour visiter l’Exposition. En quittant la Russie, il envoie à l’ambassadeur de son pays en France un télégramme ainsi conçu : « Voudrais voir Schneider dès premier soir. » L’ambassadeur, tout à fait protocolaire, lui présente à son arrivée Henri Schneider, président du Corps législatif.
Le 6 octobre 1868, c’était la Périchole.
Puis vint le tour des Brigands (1869).
Et l’époque des grandes opérettes, des chefs-d’œuvre est terminée.
Citons, après cela, quelques titres encore : Pomme d’api, Madame l’archiduc où Fugère se faisait déjà remarquer dans le petit rôle du comte, Madame Favart, la Fille du Tambour-major.
*
Mais la santé du compositeur laissait beaucoup à désirer. Perclus de douleurs, pouvant à peine se traîner aux répétitions de ses pièces, il avait loué une voiture à la journée dans laquelle il avait fait installer un siège spécial sur lequel des porteurs le hissaient, et un pupitre pour travailler durant les parcours. C’était toute une affaire de le tirer de là une fois qu’on l’y avait fait entrer à grand’peine.
Il eut le courage de faire le voyage d’Amérique à l’occasion de l’Exposition de Philadelphie où il reçut un accueil enthousiaste.
À son retour, il se sentait de plus en plus souffrant. Mais il travaillait toujours avec un courage surhumain. Il terminait ces Contes d’Hoffmann par lesquels il voulait prouver à ses détracteurs qu’il était capable d’aborder la scène de l’Opéra-Comique. Il mourut, avant d’en avoir connu le succès, le 3 octobre 1880.
Le 10 février 1881, les Contes d’Hoffmann furent donnés salle Favart, avec Talazac, Taskin, Isaac et Marguerite Ugalde. Offenbach avait réussi à écrire non seulement de la musique charmante, pittoresque à souhait, mais de la musique tragique qui faisait frissonner. Offenbach triomphait d’une manière bien inattendue.
*
Offenbach était avant tout un homme de famille qui adorait les siens et qui ne se plaisait qu’au milieu d’eux.
Nous l’avons vu, il ne s’isolait pas pour travailler… Il lui fallait autour de lui, du mouvement, de la vie. Que l’on fît mine de causer à voix basse pour respecter son travail, il se fâchait : « Il y a donc un mort ici ? » s’écriait-il.
Il était très bon et secourut souvent des artistes dans le besoin.
Dans son comique, dans sa moquerie, dans son rire, il n’y a jamais d’amertume. Il amuse sans blesser, ou du moins il n’a pas l’intention de blesser. Il fait rire d’une joie saine qui réconforte. Le rire, le rire franc et sincère ! Le rire en musique, la chose la plus rare du monde, et dont il posséda le don, comme personne. En son domaine, à son rang, non point un petit musicien, mais un grand artiste : un génie !
*
À son plan, un peu en arrière d’Offenbach, il faut citer, dans le même domaine de l’opéra-bouffe, le compositeur HERVÉ, de son vrai nom, Florimond Ronger qui naquit à Houdain (Pas-de-Calais) le 30 juin 1825. Son père était brigadier de gendarmerie. Sa mère était Espagnole. Le père mourut en 1835. La mère emmena le fils à Paris et, comme il avait une jolie voix, elle le fit entrer dans la maîtrise de l’église Saint-Roch. Elwart, professeur d’harmonie au Conservatoire, s’intéressa à lui et le fit travailler. En 1839, Florimond quittait ses fonctions d’enfant de chœur. Il fallait trouver tout de suite une occupation un peu rémunératrice. Il se fit engager comme organiste de l’église de Bicêtre, aux appointements de 150 francs par an, mais logé, nourri, chauffé et blanchi. Et en même temps, le curé assurait un emploi à la mère, dans la buanderie.
Un beau jour, Hervé se mit en tête de donner un concert aux aliénés de l’hospice. L’effet fut excellent.
Il alla plus loin et entreprit de leur faire jouer la comédie. Même réussite.
C’était un garçon plein d’idées et adroit à les réaliser.
En 1845 le petit organiste de Bicêtre, qui avait déjà fait parler de lui, se présentait au concours pour la place d’organiste de l’église Saint-Eustache à Paris, et de haute lutte, obtenait l’attribution de ce poste envié.
Mais il voulait, en même temps, pouvoir faire du théâtre, comme auteur et comme acteur. Il fallait que ce fût sous un autre nom, sans quoi il aurait perdu sa place. Il confia son embarras à son élève, le jeune marquis d’Hervé. « Qu’à cela ne tienne, lui dit celui-ci. Prenez mon nom. Vous serez Ronger à Saint-Eustache et à Bicêtre ; et vous serez Hervé au théâtre. » Situation amusante qui fut plus tard exploitée par Meilhac et Albert Milhaud dans le livret de Mam’zelle Nitouche sur lequel Hervé composa une de ses plus jolies partitions.
En 1847, Hervé voit arriver chez lui un de ses camarades nommé Désiré.
Désiré jouait au théâtre Montmartre.
Il venait demander à Hervé de composer une saynète musicale pour une soirée à bénéfice qu’on donnait en son honneur.
Désiré, qui s’appelait de son vrai nom Courtecuisse (il créera plus tard Jupiter, aux Bouffes, dans Orphée aux enfers), était gros et court. Hervé était grand et mince.
Voilà le sujet de la piécette tout trouvé. Ce sera Don Quichotte et Sancho Pança. Hervé y accumule toutes les cocasseries possibles et imaginables et adapte à ses paroles une musique extrêmement comique.
Cette pochade fait grand bruit dans le monde des théâtres. Adolphe Adam qui vient l’écouter, comble l’auteur-compositeur-acteur de compliments et lui promet de faire jouer son ouvrage sur une scène plus importante. (Le théâtre de Montmartre était alors théâtre de banlieue.) Le 5 mars 1858, Don Quichotte et Sancho Pança était représenté à l’Opéra national avec un gros succès.
Mais la vraie première avait eu lieu en 1848 et Louis Schneider, expert en la matière, affirme que cette date doit être retenue comme celle de la naissance de l’opérette, quoique le mot n’ait paru sur une affiche que le 1er mars 1856, à l’occasion de la présentation d’un acte de Jules Viard et Jules Bovery, Madame Mascarille, d’ailleurs sans grand intérêt.
Voici maintenant Hervé, chef d’orchestre au Palais-Royal, où, le 6 mai 1850, il fait représenter une petite pièce intitulée Passiflor et Cactus, d’une fantaisie échevelée, d’une incohérence désopilante. Hervé commençait à devenir un auteur, – et un acteur – à la mode.
C’était un grand bel homme à la moustache blonde, aux yeux bleus, très élégant à la ville, mais méconnaissable à la scène par son habileté à se grimer et à se costumer. Il avait une jolie voix de ténor. Mais il excellait à débiter les plus effarantes calembredaines, avec un flegme imperturbable, « une froideur hyperboréenne ».
Cependant, Hervé gravissait rapidement les échelons de la renommée.
Le 1er mars 1853, aux Tuileries, devant l’Empereur et l’Impératrice, entourés de la famille impériale et de la Cour, les artistes du Palais-Royal jouaient pour la première fois les Folies dramatiques, pièce nouvelle en 5 actes de Dumanoir et Clairville pour les paroles, et de Hervé pour la musique.
Dès le début de la soirée, le 1er acte de la pièce, Caracalla, « tragédie presque en vers », avait mis l’assemblée en gaîté. C’est dans cet extraordinaire Caracalla qu’on trouve cet affreux calembour, devenu classique :
Non, je ne suis pas mort.
Et je sors du tombeau comme un vieillard en sort.
Le second acte était intitulé Gargouillarda « opéra séria ». Et se développait burlesquement dans un étrange charabia à moitié italien à moitié français.
Et les cocasseries continuaient de s’enchaîner sans interruption jusqu’à la fin de la pièce.
Dans un entr’acte, le comte de Morny, vint apporter au musicien ses félicitations et lui offrit en même temps un poste de principal secrétaire. Hervé ne fit point comme Daudet et Halévy : Il déclina l’honneur, mais demanda le privilège d’un théâtre à lui. Ce privilège ne lui fut pas, à vrai dire, accordé. Mais on l’autorisa à ouvrir un spectacle-concert.
C’est 41, boulevard du Temple, dans une petite salle sur l’emplacement de laquelle on bâtit plus tard le théâtre Déjazet, que Hervé ouvrit son concert : les Folies-Concertantes. Le prix des places variait entre 50 centimes et 3 francs. Bientôt l’établissement prenait un nouveau nom : les Folies Nouvelles, dont une rampe à gaz faisait flamboyer les lettres sur la façade. Un prologue de Théodore de Banville, musique d’Hervé, en célébrait l’ouverture. Et la danse des inventions bouffonnes qu’engendrait à perte de vue l’imagination débridée de Hervé commença. Citons au moins celle-ci :
L’administration avait interdit à Hervé l’emploi de plus de trois personnages. Hervé voulut se jouer de la prescription et montrer à l’administration un tour de sa façon. Voici :
Agamemnon est en scène. Il regarde sa montre pour vérifier heure d’arrivée d’un chameau accompagné de son cornac.
Donc trois personnages : Agamemnon, le cornac et le chameau.
Mais le chameau (en carton) est mis en mouvement par deux acteurs, l’un dissimulé dans les jambes de devant, l’autre dans les jambes de derrière.
À un moment donné, les pieds de devant se séparent de ceux de derrière et la partie antérieure du corps entame avec la postérieure une lutte homérique.
Quatre acteurs en scène.
Mais trois personnages seulement.
Rien à dire. La censure est moquée.
Et Agamemnon, s’avançant sur le bord de la scène, déclame :
Je suis Agamemnon, je règne sans partage ;
Je me nourris de pain, de beurre et de fromage –
Potage comme rime eût été plus heureux,
Mais je suis maître ici et fais ce que je veux !
Et mille absurdités de ce genre…
Un jour, Jacques Offenbach vint demander à Hervé de créer un rôle dans Oyayaye ou la Reine des Îles (déjà citée). Ce fut celui d’Oyayaye elle-même (26 juin 1855).
En 1859, Hervé prit le bâton de chef d’orchestre aux Délassements-Comiques.
Ici, se place une entrevue, mieux encore un dîner au cours duquel Hervé fut présenté à Richard Wagner. Cela se passait chez un Allemand nommé Albert Beckmann, bibliothécaire du prince Louis-Napoléon. Wagner et Hervé étaient voisins de table. La maîtresse de la maison l’avait voulu ainsi. Ils entrèrent tout de suite en conversation cordiale. Comment résister à l’amabilité, à l’entrain endiablé d’Hervé ? Wagner, toujours un peu hargneux depuis les mauvaises soirées de Tannhäuser, eut vite fait de s’apprivoiser : « J’écris mes livrets moi-même, disait-il, car je ne trouve personne qui comprenne mon esthétique. » – « Et moi aussi, répliquait Hervé. Je fais comme vous. J’écris mes livrets moi-même et pour un motif analogue. Personne n’imagine le degré d’insanité auquel doit atteindre un livret d’opérette, surtout quand il faut qu’il se prête à ma musique… » À la fin du dîner, Wagner et Hervé étaient les meilleurs amis du monde.
Au moment du café, on continua d’épiloguer sur l’art, on fuma, on but. Hervé se mit au piano et fit entendre à Wagner quelques-unes de ses musiques les plus abracadabrantes extraites du Hussard persécuté, de la Fine Fleur de l’Andalousie, peut-être quelques esquisses de l’Œil crevé, Richard Wagner s’amusait énormément, riait à gorge déployée.
Lorsque, rentré dans son pays, on interrogea Wagner sur ce qu’il pensait de la musique française, il répondit : « Un musicien français m’a étonné, charmé, subjugué. Ce musicien, c’est Hervé. »
*
En 1864, Hervé composa un acte, pour lequel il dérogea à ses habitudes : car il en demanda les paroles à Jules Moinaux. Ce fut le Joueur de flûte. Grand succès qui donna lieu à plusieurs centaines de représentations.
Cependant, le directeur de l’Eldorado lui offrait le bâton de chef d’orchestre de son établissement avec des appointements égaux à ceux que touchait à l’Opéra son célèbre collègue Georges Hainl. Hervé se laissa séduire : il accepta et se mit à écrire pour le music-hall des centaines de chansons.
Mais il eut une idée à laquelle on ne s’attendait point. Il persuada à son directeur d’organiser des concerts classiques à l’Eldorado. Et l’entreprise réussit ! Hervé dirigeait les Symphonies de Beethoven. Mais ce n’était pas assez. Il les commentait, et ses causeries, d’un ton très libre, plaisaient infiniment.
Il revenait bientôt à l’opérette.
Et il ne consentit pas indéfiniment à obtenir de grands succès sur de petites œuvres. Il voulut bâtir enfin de grands ouvrages, dignes d’assurer à son nom une réputation durable.
Hervé a écrit au moins trois « grandes opérettes » : l’Œil crevé, Chilpéric et le Petit Faust.
L’Œil crevé était représenté pour la première fois le 12 octobre 1867, la pièce allait aux nues. L’acteur Milher, dans le gendarme Géromé, campait une figure inoubliable. Pour l’applaudir, on remarquait dans la salle le duc de Morny, le marquis de Massa, Meilhac, Halévy, Rochefort, Albert Wolff, Aurélien Scholl, Francisque Sarcey, le prince Murat, le prince et la princesse de Metternich, Francis Magnard, Édouard Lockroy, Paul de Cassagnac, Hortense Schneider, Cora Pearl et les plus jolies femmes de Paris. Succès très parisien en vérité et pièce du genre d’esprit qu’on aimait alors. Elle n’est point racontable. Mais voici un échantillon du texte qu’avait à débiter Géromé : « À la bataille de Mont-en-Suif, je m’étais engagé dans le régiment des patineurs irlandais ; je force la porte d’une maison déserte ; un laboureur me demande le chemin de Versailles ; je lui fends la tête du revers de ma botte, et, du même coup, j’abats trois arbres qui se trouvaient derrière lui. Le lendemain, j’étais nommé inspecteur du gaz dans une famille péruvienne. »
Le triomphe du coq-à-l’âne !
Là-dessus une musique extravagante, elle aussi, et à l’entrain endiablé de laquelle on ne résistait pas :
Ronflez, tambours, en avant la pastourelle !
Latorilla ! latorilla ! Good morning, sir !
Presse excellente.
Dans le Figaro, alors hebdomadaire, on pouvait lire, sous la signature d’Edmond Tarbé : « Comme Hector Berlioz et comme Wagner, avec lesquels il a du reste une autre ressemblance, celle de ne pas être compris de tout le monde, Hervé est un artiste à deux fins et d’un tempérament très absolu (?). » Un autre critique, Jules Prével, dans le même Figaro déclarait la musique d’Hervé « distinguée, spirituelle, joyeuse, bien bouffe, bien parisienne… et savante. L’orchestration, notait-il, est pleine de détails délicieux. » Enfin, dans le Temps, Francisque Sarcey s’exprimait ainsi : « Les charges de Meilhac, Halévy et Offenbach sont de la raison pure et de la gravité en comparaison des Folies-Nouvelles, dont Hervé était l’inventeur avant l’auteur d’Orphée aux enfers, et qui sont en train de se domicilier présentement aux Folies-Dramatiques. La pièce de l’Œil crevé semble une parodie du Freischütz. Son succès est immense[22]. » Il y eut en effet plus de 300 représentations consécutives.
La « première » de Chilpéric se donna le 24 octobre 1868 avec Hervé lui-même en tête de distribution dans le rôle de Chilpéric et avec Blanche d’Antigny dans celui de Frédégonde.
Nouveau triomphe.
On demande la pièce à Londres.
« J’y consens, répond Hervé, mais à une condition : c’est que je jouerai le rôle de Chilpéric.
– Comment voulez-vous que cela se fasse ? lui réplique l’impresario. Vous ne pouvez pas jouer en français à côté d’acteurs jouant en anglais.
– Qu’à cela ne tienne ! réplique à son tour Hervé. J’apprendrai l’anglais. Revenez dans trois mois. »
Et il congédia son interlocuteur ahuri par cette audacieuse promesse.
Trois mois plus tard, Hervé, qui avait travaillé l’anglais, le prononçait de la façon la plus originale du monde et partait pour Londres.
Avec un aplomb imperturbable, Hervé parut au Lyceum devant toute l’aristocratie anglaise, présidée par le prince de Galles. Quand l’anglais lui faisait défaut, Hervé appelait à son aide le français, ou bien il opérait un mélange des deux langues, qui paraissait voulu. Enthousiasme général. Le prince de Galles alla féliciter Hervé dans sa loge et lui offrit un fort beau diamant. Puis il exprima le désir d’entendre une seconde fois la chanson du Jambon que Chilpéric chantait à cheval au 1er acte. Hervé lui promit de la chanter de nouveau au tableau suivant.
« Mais vous promettez à Son Altesse une chose impossible ! interrompit le directeur Mansell. Le décor représente la chambre à coucher de Frédégonde.
– Raison de plus, reprit Hervé. Prince, vous réentendrez la chanson. »
Et, en effet, lorsque le rideau se leva, Chilpéric entra en scène à cheval, dans la chambre de Frédégonde pour chanter la chanson du Jambon. La salle trépigna. Ce fut du délire. À cor et à cri on redemanda encore la chanson du Jambon…
Ces détails peuvent paraître bien oiseux. Il ne nous a pas semblé inutile de les donner. Ils caractérisent l’esprit d’une époque.
*
Mais voici peut-être le plus original des ouvrages de Hervé. Et c’est le Petit Faust, parodie de l’opéra de Gounod, sur un livret, cette fois, non d’Hervé, mais de Hector Crémieux et Adolphe Jaime.
La première eut lieu aux Folies-Dramatiques le 23 avril 1869. L’ouverture déjà eut un succès triomphal, surtout après la reprise de la valse initiale en tutti pianissimo. Hervé écoutait derrière le rideau. Ce fut une des plus grandes joies de sa carrière d’artiste. Il avait de la peine à dissimuler ses larmes. Avant d’entrer en scène, il dut, avec un peu de poudre de riz, en effacer la trace. La partition fourmille de délicieuses inspirations. C’est la valse des Marguerites, les trois chœurs des vieillards, des jeunes gens et des jeunes filles d’abord successifs puis contrepointés en un ensemble unique avec une grâce incomparable, le rondeau des Quatre Saisons chanté par Méphisto, l’ensemble du duel, la Tyrolienne du Vaterland chantée par Marguerite, l’air de Valentin.
Théodore de Banville écrivait le lendemain dans l’Éclipse : « Nous ne consentirons plus à prendre M. Hervé pour le burlesque que vous savez… C’est un faux pitre… Il a rivé lui-même la chaîne qui l’attache à la poésie. Cette chaîne a une perle pour boulet. » Il fait allusion au Rondeau des Quatre Saisons. « J’applaudis sans restriction le Petit Faust, j’en applaudis surtout la musique. Elle est vive, élégante, originale, ailée d’un bout à l’autre… »
Le Petit Faust donna lieu à une longue, très longue suite de représentations.
Il fut souvent repris, notamment le 15 février 1882 à la Porte Saint-Martin, puis en 1890 au même théâtre avec Cooper, Jeanne Granier, Cassive ; en 1897 aux Variétés avec Guy, Brasseur, Méaly, Lavallière ; en 1907 aux Folies-Dramatiques avec Jeanne Saulier, Cooper, Sulbac.
N’oublions pas les vaudevilles-opérettes de Hervé, la série des pièces écrites pour Judic : la Femme à papa, la Roussotte, Lili, Mam’zelle Nitouche.
Après un assez long séjour à Londres où l’appela un brillant engagement, Hervé reparut à Paris en 1892. Il souffrait depuis longtemps d’un asthme dont il mourut le 3 novembre de la même année.
Il laissait derrière lui plus de cent ouvrages dont deux ou trois sont presque des chefs-d’œuvre.
Et lui-même fut presque un grand musicien.
En tout cas, après Offenbach et Hervé, l’opérette française ne retrouvera pas, en France, des compositeurs de cette envergure, de cette puissance de bouffonnerie, de cette largeur d’inspiration.
Elle en trouva de plus fins.
CHAPITRE XVIII
1859
LE FAUST DE GOUNOD[23]
Si nous voulons aujourd’hui désigner une musique claire, facile, mélodieuse, populaire, l’exemple qui nous vient tout de suite à l’esprit, c’est celui du Faust de Gounod. Il n’en est point d’un succès plus universel. Il n’en est point qui semble enfermer moins de secrets, qui touche des cœurs plus simples, qui s’adresse à des oreilles moins averties.
C’est du moins l’apparence.
Or le fait est là. Le Faust de Gounod a commencé par être très discuté et a mis du temps à s’imposer. Bien plus ! On reprocha d’abord à cet ouvrage d’être sans mélodie. Musique savante musique incompréhensible, allaient jusqu’à prétendre certains critiques.
La « première » de Faust eut lieu le 19 mars 1859 devant un public qui comprenait toutes les notoriétés littéraires, musicales, artistiques d’alors.
Or, lisez ce qu’écrivait Léon Escudier dans la France musicale. Il accusait Gounod de « porter au théâtre ce qu’il fallait laisser au concert ». Et il s’expliquait ainsi : « Il y a là un sentiment de l’art admirable, un goût parfait, une merveilleuse adresse dans le maniement des instruments, une science, en un mot, au-dessus de tout éloge ; mais tout cela ne constitue pas la musique dramatique… Hormis deux chœurs pleins d’originalité et fort beaux (dont le chœur des soldats, évidemment) et une magnifique scène dans les jardins entre Faust et Marguerite, tout ce qui se chante est morne, incolore, sans feu ; tout ce que joue l’orchestre est gracieusement poétique, riche de couleurs. Et c’est là, selon nous, l’erreur de Gounod ; ce n’est pas dans les voix qu’il a mis l’effet, c’est dans les instruments. »
« À son apparition, dit d’autre part Carvalho, Faust fut extraordinairement combattu. Beaucoup en trouvaient la musique inintelligible. »
Et Barbot, le créateur du rôle de Faust, de son côté : « Le public n’applaudissait guère que l’air de Marguerite et le chœur des soldats… J’ai entendu des gens de goût, des artistes, des compositeurs se demander ce que Gounod avait voulu faire. Ce n’était pas là de la musique, mais de l’aberration musicale, une œuvre incompréhensible. »
Voilà qui peut nous surprendre, mais il est certain que dans sa jeunesse Gounod fut considéré par ses contemporains comme un auteur sévère, comme un musicien quelquefois plus savant qu’inspiré.
Mais il ne suffit pas de constater le fait. Il faut tâcher de l’expliquer. Qu’est-ce donc qui pouvait, dans la musique de Gounod, donner à ses premiers auditeurs cette impression d’obscurité ?
Nous ne nous en rendons pas compte aujourd’hui. Mais Gounod apportait au public quelque chose de tout nouveau et qui ne pouvait que l’étonner : sa mélodie. Voilà qui dérangeait toutes ses habitudes d’oreille et lui rendait difficile la perception d’une beauté trop inattendue. On était accoutumé aux lignes si nettes, si arrêtées, de la mélodie rossinienne ou aux violents accents de la déclamation meyerbeerienne. Les délicates sinuosités d’un art plus ondoyant échappaient à la plus grande partie du public. Berlioz l’a fort bien senti et voici ce qu’il écrivait à propos de la Cavatine de Faust : « L’air de Faust : « Salut demeure chaste et pure », m’a beaucoup touché. C’est d’un beau sentiment très vrai et très profond. On l’a applaudi, mais pas assez. Il méritait de l’être vingt fois davantage. Je ne connais rien de plus décourageant que cette tiédeur du public français pour les beautés musicales de cette nature. Il les écoute à peine. La mélodie en est insaisissable pour lui : le mouvement est trop lent, le coloris trop doux, l’accent trop intime. »
Mais il n’y a pas que cela. Il faut remarquer aussi comment les phrases mélodiques de Gounod sont composées. De son temps on aimait surtout rencontrer dans un chant toutes sortes de symétries très apparentes et, par exemple, les deux premières mesures se répétant textuellement une seconde fois ou donnant lieu du moins à une « imitation » facilement reconnaissable. Souvent une mélodie était véritablement « construite » avec un premier élément donné dès le début et repris ensuite, plus ou moins déformé, à divers degrés de l’échelle musicale. C’est le procédé qu’emploie Gounod lui-même, par exemple dans la Cavatine de Faust déjà citée (mais qui offre des obscurités d’une autre sorte pour le public d’alors).
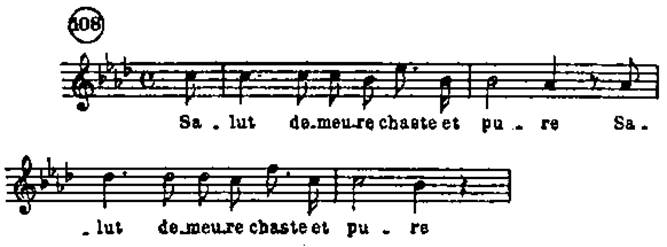
Il n’y a pas que les paroles qui se répètent ici, la musique elle aussi se redit presque textuellement. Et comme il est aisé pour la mémoire de retenir de pareilles phrases ! C’est un avantage auquel le grand public attache une importance capitale.
Gounod n’en use pas toujours ainsi. Et le plus bel exemple que nous en puissions présenter est emprunté, non pas à la partition de Faust, il est vrai, mais à une délicieuse mélodie qui s’intitule l’Absent :

Les deux premières mesures ne sont pas répétées deux fois. La deuxième mesure n’imite même pas le dessin de la première. Vous pouvez suivre tout du long la phrase de Gounod, c’est une invention perpétuelle, constamment renouvelée, et non le développement d’un premier motif élémentaire. Et dès la deuxième mesure, la mélodie module. Voilà de quoi déconcerter des oreilles habituées à plus d’uniformité.
Mais il y a autre chose encore. Et, cette fois, nous revenons à Faust. Le public de 1859 était accoutumé à n’entendre que des phrases solidement assises sur leurs 8 ou 16 mesures, des phrases carrées, comme on disait, se composant d’un nombre entier de fois 4 mesures, rythme simple fournissant d’utiles points de repère pour la mémoire. Or, Gounod se permet, dans Faust, au moins un manquement à la règle de la carrure et des plus importants. À la fin du 3e acte, quand Marguerite se met à sa fenêtre pour confier à la Nuit son rêve de tendresse, sa passion amoureuse, une phrase se dessine à l’orchestre, qui semble ne vouloir point s’achever et dont les fragments répétés aux divers instruments puis à la voix constituent un singulier mélange qui devait paraître bien étrange aux auditeurs de la « première ». Comment se retrouver dans cette suite de commencements mélodiques qui ne se terminent point par la cadence prévue, désirée, qui d’ordinaire marquait la fin de chaque thème comme un point à la ligne ? C’était à s’y perdre ! Ne dirait-on pas déjà quelque chose comme la mélodie infinie de Wagner ?

Nous commençons à nous rendre compte des raisons de l’étonnement des premiers auditeurs de Faust devant de telles nouveautés.
Et ce n’est pas tout. Ces mélodies, si surprenantes, sont accompagnées souvent de dessins d’orchestre qui se développent dans le style contrepointé du quatuor à cordes. Voilà qui est bien savant et qui surprend des auditeurs habitués aux sempiternelles « batteries » de la méthode italienne.
De toute manière Gounod apportait dans l’opéra des procédés tout neufs et s’il ne fut pas tout d’abord compris, il n’y a rien là qui doive nous paraître si singulier. C’est le cas de tous les novateurs.
Gounod un « novateur » ! Eh ! oui, il faut se faire à cette idée si éloignée de l’opinion commune et si véritable pourtant. Il le fut en son temps et, comme tel, jugé sévèrement par certains.
De fait, le Faust de Gounod est une date dans l’histoire de la musique française. Cette musique simple, facile, familière et en même temps si poétique réapprenait aux gens de France le langage qu’ils avaient depuis longtemps oublié de chanter et qu’ils ne savaient plus écouter. Ce langage convenait parfaitement au dessein de Gounod de créer l’opéra de demi-caractère, également éloigné des excès du tragique et de ceux de la bouffonnerie. Et par des œuvres comme le Médecin malgré lui, Philémon et Baucis, Mireille, Roméo et Juliette, Gounod allait jouer un peu le rôle de notre Mozart français.
Qui s’en doute aujourd’hui ? Bien peu de connaisseurs.
Il faut dire, à la décharge de la majorité du public, que l’on ne fait rien en France pour nous faire connaître le grand artiste qu’est Gounod. On nous le présente presque toujours sous des apparences trompeuses, celles de la banalité, pour ne pas dire de la vulgarité. On ne sait plus, chez nous, ni jouer ni chanter Gounod. Il y faut tellement de discrétion et en même temps de ferveur, d’émotion intérieure. On appuie sur les effets. On marque les « temps » avec une fâcheuse insistance. On presse les mouvements comme si l’on redoutait de ne pas avoir fini assez tôt. Il m’a fallu le hasard de la rencontre imprévue d’une émission lyrique sur mon poste de radio pour que j’entendisse enfin le duo du 3e acte chanté comme il doit l’être. Cette émission venait d’Allemagne, d’une ville de province sans doute, car les chanteurs n’étaient pas exceptionnellement doués pour la qualité de la voix. Mais quel sentiment juste du sens de cette musique, quelle émotion, quel style ! J’étais un peu honteux pour notre pays de constater qu’il fallait recourir à des artistes allemands pour obtenir une bonne interprétation d’un chef-d’œuvre français. Et je notais particulièrement le soin et la ferveur avec lesquels fut dite la conclusion orchestrale de l’acte, d’une beauté si pure et si touchante, conclusion que, dans nos théâtres, on a coutume d’expédier à toute vitesse, sans goût et sans expression. Cette fois on prenait le temps voulu et l’on ralentissait même un peu, comme il est nécessaire, les dernières mesures.
Quelle leçon !
*
Victor MASSÉ, agréable mélodiste, que l’on peut, pour ainsi parler, rattacher à l’« école » de Gounod, partagea avec l’auteur de Faust l’honneur d’être considéré par ses contemporains comme un musicien fâcheusement « avancé ». « Il me souvient, écrit Saint-Saëns, des lances que j’ai rompues pour Galathée (1852) notamment avec les musiciens de l’orchestre. Et comme je cherchais à connaître les causes de leur hostilité, je finis par découvrir cette chose affreuse : l’auteur, à maintes pages de sa partition, avait divisé les altos ! »
Né à Lorient en 1822, mort en 1884, Victor Massé travailla la composition avec Halévy et il obtint le prix de Rome en 1844. Il débuta au théâtre en 1852 par un opéra-comique, la Chanteuse voilée qui met en scène le peintre Velazquez dont la servante va tous les soirs chanter sous un voile qui dérobe ses traits aux regards indiscrets des curieux, sur la grande place de Séville, pour rapporter quelque argent à son maître criblé de dettes. Velazquez finit par épouser cette servante dévouée. À signaler parmi les œuvres de Victor Massé la Reine Topaze (1856), Paul et Virginie (1870), la Nuit de Cléopâtre (1885). Il y a quelques bonnes pages dans Paul et Virginie. Mais la meilleure partition de Massé est sans contredit les Noces de Jeannette, établie sur un joyeux livret de Jules Barbier et Michel Carré. La musique en est d’une saine et franche gaîté avec quelques coins de grâce et de tendresse. La pièce fut créée par Couderc et Mlle Miolan, la future Mme Carvalho. Ce n’est qu’un acte : mais il est charmant et il est resté au répertoire de l’Opéra-Comique. Ouverture bien troussée. Air de Jean plein de verve : « Enfin, me voilà seul ! Et me voilà chez moi ! » Joli duo : « Halte-là, s’il vous plaît », qui débute par une sorte de récit des deux voix sur cet heureux motif d’orchestre :

Couplets pleins d’entrain de Jean : « Ah ! vous ne savez pas, ma chère, tout ce qui vous attend chez nous. »
La Romance de l’aiguille : « Cours, mon aiguille, dans la laine », est, je l’avoue, un peu fade et l’air des meubles manque de grâce ; je préfère l’air du Rossignol, bien qu’il ne soit pas exempt de quelque gaucherie.
Mais le duo final : « Allons, je veux qu’on s’assoie » est bien réussi.
Un ouvrage populaire, sans trivialité.
*
Notons ce fait important, c’est que, progressivement, depuis la Révolution, l’art musical, autrefois l’apanage des salons et des cours, s’est mis au service du peuple, s’est fait populaire, – ou, du moins, il a prétendu plaire à des classes de moins en moins élevées de la société. Il n’y est point parvenu sans quelques dommages, sans quelques concessions. Mais, au point où nous en sommes, à l’époque de Gounod, nous constatons un singulier effort des compositeurs pour relever le ton de leurs œuvres, pour amener à eux le peuple et renoncer à subir, pour lui plaire, ses exigences. Cet effort, il est très sensible chez Gounod. Il s’accentuera plus tard avec l’école franckiste, puis avec Fauré et Debussy[24]. Un Bizet s’y associera, malgré lui, car il serait par caractère disposé à toutes les capitulations, mais son génie s’y refuse.
Cette remarque était nécessaire au moment où nous abordons l’étude d’un compositeur comme Ambroise THOMAS, aujourd’hui généralement méprisé des connaisseurs et qui ne mérite cependant pas tant de dédain. Il a, pour sa part, contribué à relever le goût du grand public, du populaire, et s’il n’a pas été jusqu’au bout de la tâche, il faut lui tenir compte des conditions dans lesquelles il écrivait et du milieu artistique où il vivait.
Toujours est-il que, s’il n’a pas été comme Gounod et comme Massé considéré par ses contemporains comme un musicien « avancé », il a du moins observé dans son art une certaine tenue dont il faut lui savoir gré.
Ambroise Thomas naquit à Metz en 1811. En 1832 il obtint le prix de Rome. Ses « envois » furent accueillis avec bienveillance par l’Institut, qui approuvait dans ses premiers essais « une mélodie neuve sans bizarrerie et expressive sans exagération, une harmonie toujours correcte, une instrumentation écrite avec élégance et pureté ».
Dans un petit acte, la Double Échelle, par lequel il débutait à l’Opéra-Comique le 27 août 1837, Berlioz reconnaissait « de la grâce, du feu, une certaine finesse d’intentions dramatiques peu commune et beaucoup de tact dans l’emploi des masses instrumentales ».
En 1849 venait le Caïd, dont Bizet écrivait : « Votre Caïd vient de me ravir. C’est toujours jeune et spirituel… ; et quelle main ! » Ce fut un gros succès.
Après cela, Ambroise Thomas s’enhardit à de grands sujets : le Songe d’une Nuit d’été (1850), Hamlet (1867), Françoise de Rimini (1882), la Tempête (1889). Pour Hamlet il fit un sérieux effort, et certaines scènes, comme celle de l’Esplanade ou l’air « Être ou ne pas être » ne sont pas mal réussies. Mais dans l’ensemble de l’œuvre le style de la romance, indigne du sujet, prend vraiment trop de place. Le rôle d’Hamlet, écrit primitivement pour ténor, fut transposé par l’auteur pour la voix de baryton, afin que l’illustre Faure pût le chanter. Cet éminent artiste y trouva l’occasion d’une de ses plus brillantes créations.
Mais que penser de phrases musicales comme celle du duo : « Doute de la lumière », ou celle de la romance d’Hamlet : « Comme une pâle fleur… » ?
Pour le grand public Ambroise Thomas est surtout l’auteur de Mignon, qui depuis le jour de sa création, le 17 novembre 1866, n’a pas quitté l’affiche de l’Opéra-Comique.
Mignon ! Admirable sujet d’opéra, pour qui eût su rester fidèle à la pensée de Gœthe. Mais que dire des librettistes Michel Carré et Jules Barbier qui prêtent à Wilhelm Meister ces pitoyables paroles :
Oui, je veux par le monde
Promener librement
Mon humeur vagabonde ;
Au gré de mes désirs.
Je veux courir gaîment.
Ont-ils songé un seul instant que Wilhelm Meister, c’était Gœthe lui-même avec le monde de ses pensées et de ses rêves ? Et qu’ont-ils fait de Lothario et de Mignon ? Un simple « sujet de pendule ».
Malgré tout, ils n’ont pu complètement effacer de leur piètre livret toute la poésie des créations de Gœthe. De ce merveilleux sujet il reste quelque chose de très attachant, ne fût-ce que, du moins pour ceux qui l’ont lu, le souvenir de l’ouvrage du poète allemand.
Je me rappelle être allé, un soir, par curiosité, écouter Mignon à l’Opéra-Comique avec mon ami Alain, l’auteur des fameux Propos, que je savais homme de goût, très sensible à la bonne musique. Je voulais vérifier mes impressions antérieures sur la valeur de l’œuvre d’Ambroise Thomas. Je fus très étonné de constater qu’Alain était profondément troublé, que ses yeux se remplissaient de larmes. Évidemment il ne voyait les acteurs en scène qu’à travers l’image émouvante qu’il avait conservée dans son esprit du véritable Wilhelm Meister, de la Mignon de Gœthe et du harpiste.
Je viens de relire la partition de Mignon, avec l’intention de trouver quelque mérite à la romance trop célèbre : « Connais-tu le pays, où fleurit l’oranger. » Oui, ce n’est pas trop mal, mais ce n’est qu’une romance, là où nous attendions infiniment mieux, une romance qui ne demande qu’à devenir très vite une rengaine.
Du reste le texte de Gœthe : « Kennst du das Land wo die Citronen blüh’n » n’a guère été favorable aux musiciens qui ont eu l’idée de s’en inspirer, à commencer par Beethoven. Je n’en connais qu’un qui ait profondément senti l’émotion de la pauvre exilée telle que la traduit Gœthe : et ce musicien c’est Gounod. Il existe une mélodie de lui intitulée Mignon, sur des paroles de Louis Gallet, dédiée à Mme Miolan Carvalho, qui est une merveille. Elle se trouve dans le 3e Recueil édité par Choudens. Elle est d’un sentiment intense. Il est vrai que je l’ai entendu chanter autrefois par la sœur de ma femme qui possédait une voix de mezzo par elle-même, par son timbre, extraordinairement émouvante. Et c’est son oncle Pol Plançon qui lui avait appris le secret d’un art simple et grand, art, dont pour sa part, elle a réservé tout le profit à ses parents et à ses amis… Mais non ! Isolée de ce cher souvenir, la page reste infiniment belle. Lisez-la…
… Et comment Ambroise Thomas n’a-t-il pas compris tout ce qu’il y avait à tirer de ce personnage mystérieux du harpiste ? N’avait-il pas lu les poésies de Gœthe : « Wer sich der Einsamkeit ergiebt… », « An die Thüren Will ich schleichen… » et surtout : « Wer nie sein Brot mit Thränen ass… » dans leur texte original ? ni les sublimes traductions musicales qu’en a données Schubert en attendant celles de Hugo Wolf, celles-ci naguère interprétées par Mme Alice Motte-Lacroix de façon si troublante.
Ambroise Thomas a encore aujourd’hui ses partisans et pour tenir la balance autant que possible égale, je citerai ces lignes d’un juge difficile, Louis Laloy : « Chacun des personnages, l’enfant triste comme le héros généreux, la courtisane insensible comme le vieux Lothario ou l’élégant Laërte, remplit exactement son rôle et reçoit la musique qui lui convient. Le style souple d’Ambroise Thomas se plie à ces attitudes variées… Les couplets de Philine (« Je suis Titania la blonde ») sont parfaits en leur trivialité voulue. Le madrigal de Laërte est juste assez spirituel pour le personnage ; l’air d’adieu de Wilhelm est d’une jolie nuance de scepticisme mélancolique… La scène de la reconnaissance est presque (!) émouvante, avec le cantique enfantin que Mignon retrouve au fond de sa mémoire. Et l’entrée de Mignon, au 1er acte, est bien délicatement traitée. » Tout de même on sent, au ton de ce panégyrique, que Louis Laloy a son parti pris d’indulgence.
Tenons-nous-en à ces hésitations en présence d’un musicien qui n’a pas absolument fini de compter et qui comptera peut-être encore quelque temps.
*
Ambroise Thomas succédait à Adam à l’Institut en 1856, et en 1871 à Auber dans la direction du Conservatoire national de musique.
Il mourait en 1896.
CHAPITRE XIX
1859-1861
WAGNER À PARIS
Au milieu du XIXe siècle, l’attraction exercée par Paris comme centre musical était universelle. Aucun compositeur, dans aucun pays, n’avait de plus haute ambition que d’être joué sur la scène de notre grand Opéra.
Malgré la terrible misère dont il avait souffert durant son premier séjour en France et l’insuccès complet de ses démarches pour se faire connaître chez nous, Richard Wagner ne songeait qu’à renouveler sa tentative.
En juin 1849, il n’y tient plus : il tente de nouveau la fortune. Le voici qui débarque dans notre capitale. Il écrit à Liszt : « Je cherche un jeune poète français ayant le cœur assez chaud pour se dévouer à mon idée… Mon affaire, c’est d’écrire un opéra pour Paris ; je suis impropre à toute autre besogne… » Et Liszt répond que ce séjour à Paris « s’impose ». Il ajoute : « Tâche d’arriver à faire jouer dans le courant de l’hiver prochain ton Rienzi (avec quelques modifications indispensables pour le public parisien). Fais un peu ta cour à Roger et à Mme Viardot… Ne néglige pas non plus Janin… »
Mais Wagner n’arrive à rien de ce qu’il espérait. Il retourne à Zurich.
Il n’est cependant pas découragé. Le 14 octobre 1849 il écrit de nouveau à Liszt : « J’attends prochainement une invitation de Belloni (secrétaire de Liszt) à venir à Paris, surtout pour faire exécuter l’ouverture du Tannhäuser au Conservatoire. »
En février 1850 nouveau voyage en France. Nouvelle déception.
C’est ici que se place la peu reluisante aventure de Wagner avec Mme Jessie Laussot.
Momentanément désorienté, Wagner prétend renoncer à se faire un nom, à poursuivre la gloire : « Le caractère monumental de notre art disparaîtra ; nous secouerons l’attachement servile au passé, le souci égoïste de la durée et de l’immortalité ; nous négligerons le passé et l’avenir pour ne vivre et ne créer que dans le présent, le seul présent… Je renonce à la gloire, je renonce surtout à l’absurde fantôme de la gloire posthume… Faire plaisir à mes amis… : dès que j’ai contenté ce désir, je suis heureux et complètement satisfait. »
Cependant « la musique à faire pour son Siegfried chante déjà dans tout son être ».
Une bonne nouvelle, transmise par Liszt : « Seghers », le directeur de l’Union musicale, un chef ardent et qui va de l’avant : « Seghers me prévient qu’on exécutera votre ouverture de Tannhäuser au premier concert de la Société, le 24 novembre prochain (1850). »
À remarquer : Liszt écrit à Wagner presque toujours en français et s’excuse, quand il fait autrement, de son mauvais style allemand. Nouvelle preuve que Liszt tient par toutes sortes d’attaches profondes à la France. Il écrit à Wagner : « La Germanie est ton domaine, et tu es sa gloire… Je ne me sens aucune vocation et je manque totalement de la patience nécessaire pour me débattre contre les difficultés qu’on rencontre sur la scène allemande. » S’il réussit avec un opéra italien ou français à Paris ou à Londres, il restera « chez les welches ».
Wagner ne rêve que d’être entendu à Paris. Il cherche les moyens d’y atteindre. Il pense que Meyerbeer pourrait peut-être lui être utile. Mais Meyerbeer lui plaît de moins en moins. « Mes rapports avec Meyerbeer, écrit-il, ont un caractère tout particulier : je ne le déteste pas, mais il m’est antipathique au delà de toute expression. Cet homme éternellement aimable et complaisant me rappelle, à l’époque où il se donnait encore l’air de me protéger, la période la plus obscure, je dirais presque la plus immorale de ma vie : c’était la période des hautes relations et des escaliers dérobés, celle où nous sommes bernés par des protecteurs pour lesquels nous n’avons pas le moindre attachement. Ce sont là des rapports absolument immoraux. Nulle sincérité ni d’un côté ni de l’autre. L’un comme l’autre se couvrent du masque de l’affection, et tous deux ne s’exploitent qu’aussi longtemps qu’ils y trouvent leur avantage. » Voilà des déclarations qui m’enchantent. J’aime Richard Wagner pour sa parfaite franchise. Cet homme dit tout ce qu’il pense. Il a une certaine fierté, une certaine dignité, à sa manière, dont je lui sais gré. Avec ses rudes façons à la Beethoven, il me paraît très supérieur, comme caractère, à ce Gœthe, si diplomate, si humble devant les grands, si soucieux des intérêts de son esprit et de son œuvre, de sa tranquillité aussi et disposé à tout leur sacrifier.
Allemand dans le fond de son cœur, Wagner n’en reconnaît pas moins les mérites de la France et de l’art français. À son ami Liszt qui lui demande de lui donner des idées pour constituer un répertoire d’opéras au théâtre de Weimar, il répond : « La confusion, le pêle-mêle de tous les genres et de tous les styles, voilà ce qu’il y a de terrible, voilà ce qui empêche nos artistes d’avoir à aucun degré le sentiment de l’art… Ce qu’il y a de plus pratique, ce sont des ouvrages de l’Ancienne école française, parce que c’est là qu’on peut le mieux saisir une intention dramatique naturelle. » Et il suggère des titres : le Porteur d’eau de Cherubini, le Joseph de Méhul, etc. (22 mai 1851).
S’il vient à Paris, on voit que ce n’est pas dans l’intention de se moquer de ce qui s’y fait, de mépriser tout ce qui s’y joue. Il sait reconnaître le mérite de la véritable école française, – dont il exclut d’ailleurs Meyerbeer.
En 1853, nouveau voyage à Paris, en compagnie de Liszt et de la princesse de Wittgenstein. Tous ensemble ils allèrent à l’Opéra entendre du Meyerbeer et ils assistèrent à une séance du quatuor Maurin-Chevillard, exécutant des quatuors de Beethoven. Wagner eut également plaisir à se trouver dans une réunion de famille : Liszt au milieu de ses enfants. C’est là qu’il vit pour la première fois Cosima.
En 1855, Wagner est engagé à Londres pour diriger une saison de concerts. Il y rencontre Berlioz. Et c’est alors que Berlioz écrit à Liszt : « Nous avons beaucoup parlé de toi avec Wagner, tu peux penser avec quelle affection, car, ma parole d’honneur, je crois qu’il t’aime autant que je t’aime moi-même. Il est superbe d’ardeur, de chaleur de cœur, et j’avoue que ses violences mêmes me transportent. »
De son côté, après son retour à Zurich, Wagner disait à Liszt : « Je rapporte de Londres un vrai bénéfice : c’est une cordiale et profonde amitié que j’ai conçue pour Berlioz et qui est partagée. »
Heureux moment de sympathie commune, qui fait date dans l’histoire tourmentée des rapports de Berlioz et de Wagner, – deux génies à la fois trop grands et trop divers pour s’entendre longtemps et intimement.
Au commencement de janvier 1858, Richard Wagner va essayer encore une fois de faire admettre une de ses œuvres par un directeur de théâtre parisien : « La direction du grand Opéra ne donne pas encore signe de vie. Par contre, M. Carvalho (Théâtre lyrique) semble avoir des vues sur moi. Si nous arrivons à nous entendre, je suis décidé à lui livrer le Rienzi… premièrement, parce que c’est un ouvrage qui ne me donne plus de vrais soucis et qu’il m’est indifférent qu’il soit un peu massacré ; ensuite, parce que ce genre de sujet et de musique est, à mes yeux, bien plus accessible aux Parisiens que mes autres ouvrages. » C’est à cette occasion que Wagner fit la connaissance, éminemment utile pour lui, d’Émile Ollivier qui venait d’épouser Blandine Liszt.
*
Le 7 février, Wagner était rentré à Zurich, où l’attendaient de graves événements.
Depuis quelques années déjà Wagner et Mme Wesendonck vivaient dans une intimité qui se faisait de plus en plus tendre. Ils s’aperçurent enfin qu’un amour affreusement passionné les entraînait l’un vers l’autre. Reculèrent-ils devant ce qui leur apparaissait comme une lâcheté et une vilenie ? Toujours est-il que la séparation fut décidée. Wagner partit pour Venise après avoir rompu avec sa première femme Minna. Rupture seulement provisoire.
De cette rapide tragédie un magnifique témoignage nous reste : Tristan et Iseult.
*
Tristan avait guéri Wagner.
Cette fois, il prend le grand parti de conquérir décidément Paris. Il entreprend une campagne qu’il jure de ne point abandonner avant la victoire.
Il choisit d’ailleurs très mal l’époque de son arrivée. Le 15 septembre 1859, il n’y avait personne dans la ville : tout le monde était en vacances.
Il commence par faire des dépenses. Il loue, avenue Matignon, une maison « dont le prix de location n’est pas modique, » avoue-t-il lui-même. Sa première visite est pour Mme de Charnacé, fille de la comtesse d’Agoult, née avant sa liaison avec Liszt. Bon accueil, mais surtout d’aimable politesse.
Une connaissance plus utile fut celle d’Agénor de Gasperini, ancien médecin de la marine, amateur éclairé, devenu critique et qui devait être un des principaux soutiens de Wagner à Paris.
Ce Gasperini met Wagner en relation avec un certain Léon Leroy qui deviendra un des fidèles admirateurs du Maître.
Un autre enthousiaste serviteur de la gloire du grand homme fut un modeste douanier, Edmond Roche, que nous verrons collaborer à la traduction française du Tannhäuser.
Mais voici, au bout d’un mois, Wagner obligé de déménager. Il s’installe cette fois, 16, rue Newton, dans le voisinage de l’Arc de Triomphe de l’Étoile, presque dans la campagne, tout au moins au milieu de terrains vagues. Il écrit à Wesendonck : « L’appartement est enfin loué pour trois ans (!) – il a fallu en passer par là, – avec les deux derniers termes payés d’avance. »
Et tout de suite, il organise des réceptions, le mercredi soir, que préside sa femme Minna. On y voit Émile Ollivier et sa femme Blandine, Jules Ferry qui éprouvait pour celle-ci une admiration passionnée, Challemel-Lacour, alors jeune homme de lettres, Gasperini, Frédéric Villot, conservateur du Louvre, Saint-Saëns, Baudelaire, Champfleury, des étrangers et étrangères, Mme Eugénie Fétis, Malwida de Meysenburg : et une certaine Mme Schwabe qui, pour se faire admettre en une si importante assemblée, n’hésita point à offrir de payer le déficit des concerts qu’allait donner Wagner.
« Il demeure dans un pays perdu, écrit Challemel-Lacour, au fond des steppes boueuses qui s’étendent entre la barrière de l’Étoile et Passy. »
Mme Eugénie Fétis, à son tour : « Nous avons été reçus de la manière la plus gracieuse par M. Wagner. Il nous a promenés dans son petit palais. C’est ravissant, arrangé avec un goût exquis, toute une maison à eux entre deux jardinets. Mais je trouve le loyer un peu cher pour l’éloignement : 4.000 francs. Domestiques mâle et femelle. » Wagner n’hésitait pas devant les frais.
Quelques mois plus tard, par suite d’une expropriation qui atteint leur propriétaire, les Wagner ont abandonné leur petit hôtel des Champs-Élysées. Ils habitent maintenant rue d’Aumale, n° 3. Ils en sont à présent à la bonne à tout faire.
Ayant appris que Carvalho était un homme entreprenant, Wagner eut l’idée de l’inviter à venir écouter chez lui son Tannhäuser. La séance fut désastreuse. Voici comment Carvalho lui-même la conte : « Je vois encore Wagner affublé d’un veston bleu à brandebourgs rouges, coiffé d’un bonnet grec jaune ouvragé de torsades vertes. Il m’attendait dans son salon où deux pianos à queue avaient été disposés pour l’exécution de son œuvre. Avec une flamme, avec un entrain que je ne puis oublier, il me fit d’abord entendre la première partie de Tannhäuser. Puis, ruisselant de sueur, il disparut pour revenir coiffé, cette fois, d’un bonnet rouge orné de tresses jaunes. Son veston bleu était remplacé par un veston jaune agrémenté de torsades bleues. Dans cette nouvelle tenue, il me chanta la seconde partie de son opéra… Il hurlait, il se démenait, il tapait à tort et à travers, et, par-dessus le marché, il chantait en allemand !… Et des yeux ! Je n’osais pas le contrarier… Il me faisait peur ! »
La partition achevée, Carvalho balbutia quelques paroles de politesse et s’esquiva.
Malgré des déconvenues de ce genre, Wagner rêvait de représentations allemandes de ses œuvres, notamment de Tristan au Théâtre Ventadour, il rêvait d’une sorte de Bayreuth parisien, vingt-sept ans avant le vrai Bayreuth.
Il s’en tint, pour commencer, à trois concerts, qui eurent lieu au Théâtre Italien (Ventadour), le 25 janvier, le 1er et le 8 février 1860. Première manifestation du wagnérisme en France qui gagna quelques artistes et littérateurs à la cause de Wagner. Mais il y avait à régler un déficit de 11.000 francs. On vint au secours du compositeur imprudent de plusieurs côtés. Notamment Mme Kalergis se montra très généreuse.
Mme Kalergis, née Nesselrode, plus tard Mme Moukhanoff, beauté internationale, Allemande de naissance, Polonaise par sa mère, Russe par éducation, Grecque par son premier mariage, élève de Chopin et de Liszt, avait autrefois rencontré Wagner auprès de Liszt. Elle s’était enthousiasmée pour son art. Voyant Wagner dans une situation difficile, elle intervient pour le tirer d’affaire. En guise de remerciement, Wagner organisa pour elle, avec le concours de Mme Viardot, une audition intime du 2e acte de Tristan, qui eut lieu chez Mme Viardot, rue de Douai. Mme Viardot chantait Iseult, Wagner lui-même Tristan. Au piano, un excellent disciple de Liszt, Klindworth. Comme auditeurs, seuls Mme Kalergis et Berlioz.
Après les concerts de la salle Ventadour, Challemel-Lacour écrit au poète Georges Herwegh, resté en Suisse : « Nous sommes allés hier au soir au dernier concert de Wagner. Salle à peu près pleine, mais évidemment beaucoup de billets donnés. Il est, je pense, hors de contestation qu’il y a en lui de l’étoffe, de la puissance, une horreur absolue du convenu, peut-être du génie. Cela sera contesté pourtant, car la vénalité, l’ignorance, l’esprit de routine, pour tout dire, l’infamie de tout ce qui noircit du papier pour les journaux – les Débats exceptés – n’ont point de bornes. J’ai aperçu Berlioz qui m’a paru applaudir de grand cœur. Pour le succès au théâtre, c’est autre chose. Le public parisien n’est ni musicien, ni religieux, ni artiste. Il veut être amusé, voilà tout. Wagner n’est pas descendu, et, je le souhaite pour lui, ne descendra jamais au degré qu’il faut pour être le pourvoyeur de nos plaisirs. » On le voit, Challemel-Lacour jugeait sévèrement le public parisien de 1860. Il avait raison.
Il continue : « Autre malheur : Wagner a un système, ce qui ne serait qu’un inconvénient pour son talent s’il ne le montrait que dans ses œuvres, mais il s’en est fait le théoricien. Rien ne fait peur à un public timide, soumis au succès et à la tradition, comme la pensée qu’on veut lui imposer un système. Wagner aura beau faire de la belle, de la superbe musique, comme l’ouverture de Tristan et Iseult, les imbéciles, c’est-à-dire le public, auront toujours peur d’entendre un plaidoyer plutôt que d’entendre un opéra. » Réflexions fort sensées.
On peut parcourir aussi l’article que Berlioz publia dans les Débats du 9 février 1860, article dont Wagner a dit : « Cet article causa un véritable scandale. Il commençait par des phrases entortillées et finalement m’attaquait par de perfides insinuations. » C’est tout à fait inexact. Berlioz se montre juste envers Wagner et même perspicace. Il juge le prélude de Lohengrin « admirable en tout point… Pour moi, c’est un chef-d’œuvre, » déclare-t-il. L’introduction du 3e acte (marche en sol) lui paraît être « une idée formidable, irrésistible ». Il est vrai qu’il trouve le chœur d’épithalame mesquin et qu’il constate sa ressemblance trop évidente avec un air de Boieldieu, dans les Deux Nuits. Il n’a pas tort. Il loue la marche du Tannhäuser pour son éclat pompeux, son allure fière et chevaleresque. Il reconnaît qu’il y a beaucoup de force et de grandeur dans l’ouverture, mais il regrette le dessin obstiné, « acharné » des violons répété 118 fois sur le chant du choral. Et là encore on lui donne volontiers raison. Ses critiques les plus sévères vont contre l’ouverture du Vaisseau fantôme où il blâme l’abus du trémolo et des gammes chromatiques. Quant au prélude de Tristan, il n’y a rien compris. Et il ne faut pas nous en étonner. Le style en était tellement neuf.
Mais Wagner était habitué aux adulations de Weimar. L’article de Berlioz lui semble empoisonné.
En revanche, il fut infiniment touché de la lettre que lui écrivit Baudelaire. Cette lettre mériterait d’être citée intégralement. En voici du moins les plus importants passages : « Avant tout, je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance musicale que j’aie jamais éprouvée… Par vous, j’ai été vaincu tout de suite. Ce que j’ai éprouvé est indescriptible, et, si vous daignez ne pas rire, j’essaierai de vous le traduire. D’abord il m’a semblé que je connaissais cette musique, et plus tard, en y réfléchissant, j’ai compris d’où venait ce mirage ; il me semblait que cette musique était la mienne et je la reconnaissais comme tout homme reconnaît les choses qu’il est destiné à aimer. Pour tout autre que pour un homme d’esprit, cette phrase serait immensément ridicule, surtout écrite par quelqu’un qui, comme moi, ne sait pas la musique, et dont toute l’éducation se borne à avoir entendu (avec grand plaisir, il est vrai), quelques beaux morceaux de Weber et du Beethoven.
« Ensuite le caractère qui m’a principalement frappé, ç’a été la grandeur. Cela représente le grand, et cela pousse au grand. J’ai retrouvé partout dans vos ouvrages la solennité des grands bruits, des grands aspects de la Nature et la solennité des grandes passions de l’homme. On se sent tout de suite enlevé et subjugué. L’un des morceaux les plus étranges et qui m’ont apporté une sensation musicale nouvelle est celui qui est destiné à peindre une extase religieuse. » Évidemment le prélude de Lohengrin. « L’effet produit par l’Introduction des invités et par la Fête nuptiale est immense. » Il s’agit ici sans doute de la marche de Tannhäuser et de l’introduction du 3e acte de Lohengrin. « J’ai senti toute la majesté d’une vie plus large que la nôtre… Il y a partout quelque chose d’enlevé et d’enlevant, quelque chose aspirant à monter plus haut, quelque chose d’excessif et de superlatif. Par exemple, pour me servir de comparaisons empruntées à la peinture, je suppose devant mes yeux une vaste étendue d’un rouge sombre. Si ce rouge représente la passion, je le vois arriver graduellement, par toutes les transitions de rouge et de rose, à l’incandescence de la fournaise. Il semblerait difficile, impossible même, d’arriver à quelque chose de plus ardent ; et cependant une dernière fusée vient tracer un sillon plus blanc sur le blanc qui lui sert de fond. Ce sera, si vous voulez, le cri de l’âme montée à son paroxysme. » On se demande si Baudelaire ne fait pas ici allusion au prélude de Tristan, en général si peu compris à cette première audition. Il concluait : « En somme, vous avez dû être satisfait du public dont l’instinct a été bien supérieur à la mauvaise science des journalistes. »
Ainsi, par ses trois concerts, Wagner avait conquis quelques admirateurs enthousiastes.
Cependant l’Empereur avait donné l’ordre de représenter Tannhäuser à l’Opéra. C’était l’ambassadrice d’Autriche, princesse de Metternich, qui avait obtenu cette faveur de Napoléon III. De hautes personnalités étrangères avaient joint leurs efforts aux siens, notamment le comte de Hazfeld, secrétaire de l’ambassade de Prusse, et l’ambassadeur lui-même, comte de Pourtalès. Hans de Bülow, dans toute cette affaire, avait mis au service de Wagner son concours dévoué et son habile diplomatie.
Malheureusement, Fould, ministre d’État, faisait à Wagner une opposition tenace et cherchait toutes les occasions de susciter des difficultés à l’exécution de ses projets.
Alors, Mme de Metternich intervenait et l’affaire était tout de suite réglée par ordre impérial. Mais cette lutte sourde n’en était pas moins irritante pour les nerfs toujours à vif de Wagner.
La question particulièrement délicate était celle de la traduction du poème de Tannhäuser en français. Wagner avait d’abord songé pour cette tâche à un M. de Charnal dont il eut vite fait de constater l’incapacité absolue. On lui avait parlé du ténor Roger, artiste très cultivé. Il alla lui rendre visite à la campagne et Roger sembla faire d’abord très bon accueil à la proposition. Il se mit à l’ouvrage et convoqua Wagner dans son château aux environs de Paris, pour juger d’un premier essai : « Dans son premier feu, écrit Wagner à Wesendonck, Roger avait déjà traduit la scène du commencement. Préparé comme toujours à tous les mécomptes, j’ai été cette fois agréablement surpris. Il a chanté la scène lui-même et très bien. En tout cas, le texte français était très vocal, l’accentuation juste et la phrase n’est pas sensiblement altérée. » Mais Roger était un homme léger. Son beau zèle se calma. Il abandonna le travail. Il en fut de même de Gasperini qui commença par accepter de se charger de la traduction et renonça bien vite à une entreprise qui lui paraissait bien ardue.
Alors Wagner s’adressa à cet Edmond Roche dont nous avons déjà prononcé le nom. Singulière figure. Cet employé de la douane qui avait facilité à Wagner certaines formalités administratives avait une nature d’artiste. Il jouait du violon. Il avait travaillé dans la classe d’Habeneck. Mais il n’était pas arrivé à grand’chose : il tenait une partie de violon au théâtre de la Porte Saint-Martin, où, dans les mélodrames, il exécutait le « trémolo à l’orchestre ». Il avait fait de la critique musicale. Il était poète même à ses heures, – ou il croyait l’être. Mais Edmond Roche ne savait pas l’allemand. Grave lacune pour le traducteur du Tannhäuser.
Alors entre en scène un Allemand, fixé depuis peu à Paris, Lindan, qui se met à collaborer avec Edmond Roche.
Leur traduction fut soumise au directeur de l’Opéra que leur travail ne satisfit point et qui chargea Charles Nuitter (anagramme de Truinet, son vrai nom), homme du métier, de mettre au point l’ouvrage.
Ces divers traducteurs voulaient figurer sur l’affiche. Il y eut procès. Le jugement fut rendu le 6 mars 1861, juste une semaine avant la première de l’œuvre qui fut représentée, affichée et éditée sous le seul nom de Wagner. Émile Ollivier avait plaidé la cause et obtenu du tribunal cette sentence favorable aux intérêts du compositeur.
Cette difficile traduction avait tout de même fini par se faire.
D’autre part, musicalement, Wagner avait beaucoup travaillé, ajoutant à sa composition primitive l’important tableau symphonique du Venusberg, si magnifiquement inspiré, mais qui faisait un peu disparate avec le reste de la partition, d’un style moins évolué.
Wagner est toujours en rapport avec Berlioz dont il espère pour son Tannhäuser un article élogieux. À propos de Berlioz justement, il écrit à Liszt, le 22 mai 1860 : « J’ai reconnu… que l’homme richement doué ne peut trouver que dans un homme supérieur un ami qui le comprenne, et je suis arrivé à cette conclusion qu’aujourd’hui nous formons une triade exclusive de tout autre élément, parce que nous sommes tous les trois pareils ; cette triade se compose de toi, de lui et de moi. » Grande vérité que jamais Wagner n’a énoncée si clairement parce qu’elle fut trop souvent obscurcie dans son esprit par la passion.
Le pauvre Berlioz ! Il n’a plus l’ardeur, la jeunesse, l’enthousiasme de Wagner. Il répond à une lettre de Wagner : « Je ne sais si vous avez encore des illusions ; quant à moi, je vois depuis bien des années les choses telles qu’elles sont… Vous êtes au moins plein d’ardeur, prêt à la lutte ; je ne suis, moi, prêt qu’à dormir et à mourir. »
Au cours de l’été 1860, un événement important se produisit dans la vie de Wagner. Il reçut la promesse que, s’il venait assister en Allemagne à la représentation de ses ouvrages, il ne serait pas inquiété. Il y avait onze ans, depuis les événements de Dresde, qu’il était banni de son pays. Il en profita pour aller passer une semaine d’août de l’autre côté du Rhin. Ce court séjour dans sa patrie ne lui causa qu’une mince satisfaction. Il écrivit à Liszt : « Il me prend des frissons d’épouvante quand je pense à l’Allemagne et à l’avenir réservé à ce que je rêve d’entreprendre là-bas. Dieu me pardonne, je n’y vois que petitesse et mesquinerie, faux mérite et suffisance, absence totale de réelle valeur. Tout est en façade, la médiocrité est à l’ordre du jour, si bien qu’à tout prendre j’aime encore mieux voir jouer le Pardon de Ploërmel à Paris que chez nous, à l’ombre du célèbre et glorieux chêne allemand ! Aussi je t’avouerai qu’en mettant le pied sur le sol germanique je n’ai pas éprouvé la moindre émotion, à part la surprise que m’a causée le langage stupide et grossier que j’ai entendu autour de moi. Crois-moi, nous n’avons point de patrie ! Et si je suis Allemand, je porte certainement mon Allemagne en moi-même. »
Wagner était certes bien plus Allemand qu’il ne pensait. Mais tout son esprit était alors tendu vers Paris et le succès qu’il y escomptait avec son Tannhäuser.
Il s’occupait activement de soigner sa publicité. Pour cela, il se faisait présenter à Bertin qui le mettait en relation avec Neffzer, en train de fonder le Temps.
Mais, à l’Opéra, durant les répétitions, il a le talent de se rendre insupportable. Il a des exigences qui paraissent invraisemblables au directeur. C’est ainsi qu’il lui remet la petite note suivante contenant l’énumération des instruments supplémentaires dont il a besoin :
1er acte. – 12 cors ; les cors doivent être doublés quand les sonneurs apparaissent en scène, tout à la fin de l’acte. Comme il n’y aura pas assez de cors à Paris, M. Sax devrait être prié d’en faire remplacer une partie par des instruments du même timbre de son invention, peut-être par des saxophones.
Comment Wagner peut-il imaginer que des saxophones auront le même timbre que des cors ?
2e acte. – 12 trompettes, n’apparaissant pas sur la scène.
3e acte. – Orchestre distribué au-dessous de la scène, composé de : 2 petites flûtes, 4 grandes flûtes, 4 hautbois, 2 clarinettes en ré, 2 clarinettes ordinaires, 4 cors à pistons, 4 bassons, 1 tambour de basque, 1 paire de cymbales, 1 triangle, 4 tambours. »
Il y avait là vraiment de quoi effrayer un directeur pourtant déjà accoutumé aux formidables dépenses de supplémentaires réclamées d’ordinaire par Meyerbeer.
Les études musicales du Tannhäuser avaient commencé le 24 septembre 1860. Il y eut 73 répétitions au piano, 45 répétitions des chœurs, 27 répétitions d’ensemble sur scène, 4 pour les décors, 14 avec l’orchestre.
Wagner assista à toutes ces répétitions, sauf du 10 octobre au 20 novembre, semaines durant lesquelles il fut malade.
Wagner se loua beaucoup du zèle et de la compétence des deux chefs de chant Vauthrot et Croharé. Mais il eut à souffrir de l’incapacité du chef d’orchestre Dietsch, qui ne comprenait absolument rien à sa musique et prenait les mouvements tout de travers. Wagner se proposa pour le remplacer. Mais son offre ne fut pas acceptée.
La plus grande difficulté, – et qui eut les conséquences les plus graves – fut soulevée par la question du ballet. Le directeur de l’Opéra en demandait un pour le 2e acte, afin de ne pas contrecarrer les habitudes des abonnés. Wagner se refusa absolument à donner satisfaction sur ce point au directeur. L’intransigeance de Wagner ici paraît tout à fait déplacée. Et je ne puis que citer à ce propos les réflexions si pertinentes de Julien Tiersot dans sa publication des Lettres françaises de Wagner.
« Au fait, pourquoi Wagner se refusait-il avec tant d’entêtement à placer un ballet au second acte de Tannhäuser ? Considérons les choses comme elles sont : on peut avouer que des danses eussent été ici très bien placées ! Après tout, Tannhäuser, c’était un vieil ouvrage, dont la conception était tout autre que celle du moderne drame musical. Tannhäuser, quoi qu’on en puisse penser, n’est qu’un opéra. Le premier acte avait fait entendre un septuor ; le second commençait par un air qui semble calqué sur l’Euryanthe de Weber ; puis venait un duo et ensuite cette fameuse marche qui n’est aussi qu’un morceau d’opéra : elle l’est musicalement comme scéniquement. Qu’est-ce donc, sinon de l’opéra, que cette succession d’entrées des invités, parmi les fanfares ? Ils viennent prendre leurs places sur des gradins disposés pour l’exécution d’un chœur, puis, la première reprise orchestrale terminée, mêlent leurs voix au dessin des instruments et concluent avec eux en des sonorités somptueuses, mais dont les équivalents n’ont jamais retenti sous les voûtes d’aucun château du XIIe siècle ! La fête commence : la danse n’y a-t-elle pas sa place marquée ? On avait proposé pour l’Opéra l’engagement de danseuses étrangères, une Polonaise notamment : c’eût été l’occasion d’écrire une partition de danses de caractère. Après quoi serait venue la musique : le tournoi des chanteurs d’amour. Rien ne s’arrangeait mieux. »
Et ainsi, Wagner eût peut-être évité le désastre. Car on sait que les abonnés, notamment les membres du Jockey-Club, furieux d’être privés du traditionnel ballet, jurèrent de faire tomber l’œuvre de Wagner ou même d’en entraver l’exécution.
La première représentation eut lieu le 13 mars 1861. Salle au début assez calme. Bientôt, au changement de tableau du 1er acte, on rit. On rit de la célèbre ritournelle du hautbois, on rit du chœur des pèlerins. On rit à tout propos et hors de propos. « Appuyée au balcon de sa loge, la princesse de Metternich brise son éventail dans un geste de colère. » Mais une partie du public est favorable à Wagner. « On faillit se battre. »
Il fallait du courage pour risquer une seconde représentation. On la risqua, le lundi 18 mars. Le premier acte fut très applaudi, surtout le septuor. Mais au 2e acte une bordée de sifflets éclata. C’était le Jockey-Club qui partait en guerre. La séance fut alors constamment interrompue par des rafales de protestations qui duraient jusqu’à dix minutes de suite. Niwarm qui tenait le rôle de Tannhäuser jeta son chapeau de pèlerin par-dessus l’orchestre vers les fauteuils, comme on jette son gant en guise de défi.
La 3e représentation fut digne des deux premières.
Mais Gounod s’écria : « Que Dieu me donne une pareille chute ! » Jules Janin, Erlanger, Catulle Mendès, le prince Edmond de Polignac se déclarèrent pour Wagner. Le prince de Polignac fut élu, à cette occasion, membre du Comité d’un cercle rival du Jockey-Club.
Vis-à-vis du directeur de l’Opéra, voulant faire bonne figure, Wagner lui écrivit une lettre de remerciements dont j’extrais ces lignes : « J’ai joui de la grande satisfaction de voir mon œuvre parfaitement bien rendue par les artistes et chaudement accueillie par le public, qui, malgré les efforts d’une opposition acharnée » a couvert bien des fois ma musique de ses applaudissements unanimes. » Mais il retira son œuvre après la 3e représentation, ne voulant pas supporter une fois de plus le supplice et le scandale de ces rires et de ces sifflets.
Cependant, Wagner craignait que la nouvelle du retentissant échec de son Tannhäuser à Paris ne se répandît rapidement en Allemagne et n’y produisît le plus mauvais effet. Afin de parer à cet inconvénient, il écrivit une lettre d’explication aux journaux allemands. Il parlait de l’obstruction acharnée de ces messieurs du Jockey-Club et insistait sur la bonne tenue d’une grande partie du public : « Je persiste, concluait-il, à reconnaître au public parisien des qualités fort agréables, notamment une compréhension très vive et un sentiment de la justice vraiment généreux. »
Au fond, il était profondément attristé. Mais il ne voulait pas le paraître.
Il avouait pourtant parfois sa déception et son inquiétude. Il écrivait à Victor Cochinat, journaliste nègre, né à la Martinique, assez estimé de ses contemporains : « Je suis persuadé que je suis à jamais exclu des théâtres français. Car ce qui s’est passé le jour de ma première se répéterait éternellement et partout en France. Est-ce que les badauds du boulevard ne chantent pas ma chute, est-ce que les crieurs des rues ne vendent pas des « sifflets Wagner » ?
Mais il tâchait de se réconforter par quelques bonnes impressions : « Je vais faire un voyage, mais je ne quitte pas Paris sans gratitude ; un sentiment de grande reconnaissance me guide. Car j’ai reçu des lettres encourageantes de gens de lettres, notamment d’un jeune homme, dont vous avez peut-être entendu parler, car il a fondé une revue, la Revue fantastique ou fantaisiste et m’a invité à collaborer. Quoiqu’il n’ait que 16 ou 17 ans, il montre infiniment la grâce et l’esprit parisiens et je crois que M. Mendès pourra devenir un critique juste et généreux. »
Ce pauvre Wagner, dans son malheur, ne se doutait pas que le 13 mars 1861 devait rester une des dates les plus importantes de l’histoire de la musique en France. Il ne se doutait pas qu’elle marquait le point de départ du wagnérisme dans notre pays et que le wagnérisme devait envahir successivement tous les milieux artistiques et toutes les classes de la société, si bien que, vers la fin du XIXe siècle, une réaction devenait nécessaire et se produisit en effet sous les formes du fauréisme et du debussysme qui sauvèrent notre musique menacée de noyer son originalité dans la vaine imitation des formes musicales d’outre-Rhin. Il ne se doutait pas que les meilleures recettes de l’Opéra seraient un jour assurées par Tannhäuser, Lohengrin et la Walkyrie, alternant avec le Faust de Gounod.
Mais Paris, malgré sa cruelle aventure, n’en restait pas moins et pour longtemps le centre d’attraction des plus hautes ambitions de Wagner.
Après un voyage de quelques semaines en Allemagne, en Suisse et jusqu’à Vienne, il revint à Paris où, sa femme étant retournée en Allemagne, il reçut l’hospitalité de l’ambassade de Prusse, puis alla se loger à l’hôtel Voltaire, sur le quai en face des Tuileries. Il y travailla aux Maîtres chanteurs, ne voyant plus que quelques amis : Nuitter, Champfleury, Gasperini.
Le 28 mars 1862, Wagner, enfin amnistié, se retira en Allemagne. Il revint quelquefois en France, mais jamais plus à Paris.
En 1864 c’est l’appel inespéré du roi de Bavière. Voici les relations de Wagner et de Cosima Liszt-de Bülow qui commencent de devenir intimes.
Tous deux partent pour le midi de la France où ils songent sérieusement à s’installer définitivement, pour l’achèvement de la Tétralogie et des Maîtres chanteurs. Le 1er janvier 1866, Wagner écrit à un destinataire inconnu : « Je pense fort sérieusement à la France du Midi, et ce que je cherche est une belle campagne – avec un petit château – depuis Avignon et Arles jusqu’à Perpignan et les Pyrénées, – pourtant, où que cela soit, pourvu que cela ne soit pas ni Marseille, ni Nîmes, plutôt une de ces villes hors du commerce, délaissées, où l’on trouve cette vie si bon marché, si vantée de la France méridionale.
N’ayant pas trouvé en France l’installation qu’ils cherchaient, Wagner et Cosima se retirent en Suisse sur le lac des Quatre Cantons dans ce coin délicieux de Triebschen où ils passent plusieurs années heureuses.
Mais Wagner n’oubliait ni la France ni Paris. Et le 18 mars 1870 il écrivait à Champfleury : « J’applaudis de tout mon cœur à la fondation du journal dont le programme me paraît un point de départ vers la réalisation de mes espérances favorites, la fusion de l’esprit français et de l’esprit germanique. Vous savez que j’ai toujours eu l’idée de l’érection à Paris d’un théâtre international où seraient données, dans leurs langues, les grandes œuvres des diverses nations. Seule, la France, et Paris en particulier, saurait relier en un faisceau des productions hétérogènes en apparence, dont la connaissance exacte est, selon moi, indispensable au développement intellectuel et moral d’un peuple. Parmi les œuvres françaises qui devraient être données sur cette scène exceptionnelle, très indépendantes des intérêts du jour, celles de Méhul tiendraient une première place, et je vous félicite d’avoir songé à ce grand artiste, que je compte au nombre de mes précepteurs et dont la vie et les compositions sont beaucoup trop peu connues en France. »
Déjà, en 1868, Wagner parlait à un ami de représentations modèles allemandes à Paris, sous la direction de Pasdeloup.
Le 6 avril 1869 Rienzi fut donné au Théâtre-Lyrique.
Pour la fête du Maître, en 1869, Cosima lui fit la surprise d’inviter à Triebschen le quatuor Maurin-Chevillard pour exécuter devant lui les derniers quatuors de Beethoven et elle accompagnait cette invitation de cette remarque : « Peut-être les artistes du quatuor comprendraient-ils plus aisément la proposition qui leur est faite si on leur faisait savoir que le Maître n’a jamais voulu entendre les quatuors de Beethoven en Allemagne depuis qu’il les a entendus exécuter par le quatuor Maurin, dont il nous a dit qu’il lui avait facilité la compréhension de ces œuvres merveilleuses. »
On voit que Richard Wagner savait apprécier à toute leur valeur l’art et les artistes français.
Malheureusement, après tant de tergiversations et de contradictions de toutes sortes, Wagner allait bientôt, en publiant un livre intitulé Art allemand et politique allemande, renier une partie de ses convictions passées et s’enfermer politiquement dans un germanisme étroit.
*
La marche pour la réception des invités à la Wartburg fut naturellement une des pages de la partition les mieux accueillies. Elle est d’un grand effet, d’une superbe allure, même d’une « émotion » singulière lorsqu’elle est bien exécutée.
Il est à croire que Wagner avait pu obtenir qu’elle fût dite dans son vrai mouvement.
Je tiens à indiquer ici que, depuis ma première jeunesse, je ne l’ai jamais entendue jouer en France au tempo désirable. On la prend toujours trop lentement. Elle traîne lamentablement, avec une solennité ridicule. Elle perd ainsi tout caractère et, surtout dans son second thème, devient déplorablement commune.
Il faut aller en Allemagne pour sentir à quel degré d’intensité cette marche peut atteindre dans le chevaleresque et l’héroïque. C’est une question d’interprétation.
La première fois que je l’écoutai au Prinzregententheater de Munich, j’en éprouvai un véritable saisissement. Le second thème notamment m’apparut dans sa beauté resplendissante, avec son accent si fier, brillant d’entrain, de courage et de foi.
Mais le mouvement doit être extrêmement serré.
Il fallait voir de quel pas entraient en scène à Munich les « invités » de la Wartburg, – du pas si vif, si décidé, de nos chasseurs à pied.
Alors cette musique nous révèle des âmes d’une force impétueuse, d’une ardeur irrésistible.
Ce n’est pas du tout cela que nous entendons d’ordinaire à Paris.
Et je me demande pourquoi nos chefs d’orchestre ne songent pas à s’informer du tempo authentique de cette pièce admirable. Un témoignage irrécusable se trouve cependant à leur portée. La firme Pathé-Marconi a publié un magnifique enregistrement de la partition entière du Tannhäuser telle qu’on l’exécute, selon une indiscutable tradition, au théâtre de Bayreuth. J’ai vu un jour une de mes parentes éclater en sanglots, quand je faisais tourner pour elle précisément le disque de la marche, lors de la reprise tellement émouvante du chœur.
CHAPITRE XX
L’ENFANCE DU CHRIST (1854)
BÉATRICE ET BÉNÉDICT (1862)
LES TROYENS (1863)
Et Berlioz vivait toujours avec le double souci de la misérable Harriett et de l’acariâtre Maria Recio. Celle-ci le tenait serré, ne le lâchait pas, s’accrochait furieusement à lui. Parfois Berlioz s’enfuyait, montait vers Montmartre, vers son Ophélie. Affreux spectacle : la malheureuse, paralysée depuis cinq ans, sans mouvement ni parole, attendait désespérément la mort qui ne venait pas. Elle vivait, si l’on peut dire, dans une petite maison, au milieu des jardins, du côté de la Butte qui regarde Saint-Denis, ruelle Saint-Vincent, près du cimetière. Berlioz la regardait, navré, attendri, impuissant. Et il retournait à sa Recio, à ses démarches, à son travail, à ses feuilletons des Débats, à l’odieuse galère du journalisme. Tous ses chagrins, tous ses soucis ne l’empêchaient pas d’écrire des articles pleins de verve, joliment troussés qui ravissaient le public. Les concerts de virtuoses abondaient. Des pièces nouvelles à l’Opéra-Comique. Il fallait bien rendre compte de tout cela. « Les virtuoses de toutes nations, comme des plaideurs d’une nouvelle espèce, se ruent sur le pauvre public, le prenant violemment à partie, et paieraient même volontiers des auditeurs, pour les avoir d’abord, et ensuite pour les enlever à leurs rivaux. Comme les témoins, les auditeurs sont chers et n’en a pas qui veut… »[25].
Ce feuilleton dont nous citons quelques lignes se terminait par cette joyeuse invitation : « Tout le monde va à Bade pour le 11 août. Allons à Bade. »
Et Berlioz part pour Bade, le Monte-Carlo d’alors. Il était l’invité d’Édouard Bénazet, le fils d’un croupier fameux, devenu lui-même « le roi de Bade ».
À Baden-Baden, Édouard Bénazet était fermier de la roulette, et par la roulette il tenait tout Bade et toute l’Europe.
S’il invitait Berlioz, le brillant chroniqueur des Débats, c’est qu’il avait besoin de lui pour sa publicité, pour classer les succès, les triomphes de toutes les entreprises théâtrales, musicales, artistiques qui se faisaient à Bade. Jamais d’échec. Toujours la réussite, l’extraordinaire réussite.
Berlioz était appelé pour diriger la moitié de la Damnation, et après un intermède de virtuoses, le Carnaval romain.
Bade va devenir un lieu d’élection pour les manifestations musicales de Berlioz.
De retour à Paris, il se rend auprès d’Harriett. Est-elle encore là ? Mais oui, la pauvre, hélas !
Il la quitte. Il descend vers Paris. On court après lui… Elle n’est plus.
Le cœur brisé, Berlioz se met aux tristes préparatifs de l’enterrement. Il se résout à la vente du mobilier. Il ne garde que quelques menus objets pour son fils Louis, actuellement embarqué comme aspirant volontaire sur l’aviso le Corse.
Il compose. La partition de l’Enfance du Christ est en train. Il va l’achever.
*
On peut s’étonner que Berlioz, l’homme des constructions immenses, babyloniennes, ninivites, ait eu l’idée de cette petite « trilogie sacrée » de proportions si restreintes. C’est peut-être qu’il en voyait le placement plus facile.
Berlioz avait écrit lui-même le texte poétique, dans un style par endroits archaïque qui accusait le caractère naïf de cette pastorale, de cette « bergerie biblique ».
La musique il l’écrivit avec amour, y mit tout son art et toute sa tendresse, disposant avec habileté çà et là des effets de couleur, d’orientalisme dosés avec discrétion, usant de mélodies populaires, de vieux noëls français, pour mieux faire penser à quelque ouvrage de « primitif ».
PREMIÈRE PARTIE. – Le Songe d’Hérode.
Un récitant explique l’une après l’autre les scènes :

Admirable récitatif, d’une grâce un peu raide, d’un parfum archaïque obtenu par des moyens si simples, sans appel aux vieux modes désuets, par le choix des harmonies et le tracé imprévu de la ligne mélodique.
Marche nocturne.
« Une rue de Jérusalem donnant sur une des portes de la ville. À gauche un corps de garde. Soldats romains faisant une ronde de nuit. »
À l’orchestre des bruits de pas, d’abord indistincts, puis se précisant peu à peu. Bientôt s’élève une mélodie lente et triste sur la cadence persistante des pas monotones :

Voilà qui dépeint à merveille le morne ennui de la petite troupe en marche.
« Une 2e patrouille, venant du lointain, passe en scène, réveille le soldat assis à la porte du corps de garde et sort.
La 1re patrouille reparaît.
Le soldat de garde se lève, s’étire, et d’un pas las, va vers le centurion en scrutant l’obscurité et indique par un geste qu’il voit arriver son chef.
Les deux patrouilles reviennent en scène par les côtés opposés ayant à leur tête Polydorus et le centurion. »
Telles sont les indications de l’intelligente adaptation à la scène de Maurice Kufferath.
Les deux officiers se rencontrent.
« Qui vient ?
– Rome.
– Avancez. »
Ils se reconnaissent, échangent quelques propos (récitatif sans accompagnement) et se séparent. Les deux patrouilles se remettent en marche et s’éloignent. La marche nocturne reprend, à l’envers : le decrescendo succède au crescendo, avec des variétés intéressantes dans l’orchestration, et un même pouvoir d’évocation.
Air d’Hérode.
Deuxième tableau musical « à l’intérieur du palais d’Hérode ». « Toujours ce rêve ! s’écrie Hérode. Encore cet enfant qui doit me détrôner ! » Et plein de terreur, il chante cet air sombre :

où l’on remarquera le la bémol et le fa naturel dans la tonalité de sol mineur. « J’ai essayé quelques tournures nouvelles, écrivait Berlioz à Hans de Bülow. Cette gamme, désignée sous je ne sais quel nom grec dans le plain-chant, amène des harmonies très sombres et des cadences d’un caractère particulier, qui m’ont paru convenables à la situation. » Il s’agit en réalité de l’antique dorien :

devenu dans la liturgie catholique le 3e mode (2e mode authentique) :

transposé ici en sol :

Les Devins et Derviches entrent en jeu. Hérode les interroge. Ils consultent les Esprits et procèdent à toutes sortes d’évolutions incantatoires. Devins et Derviches « tournent » sur un rythme complexe 3/4 + 4/4 = 7/4. Ici Adolphe Boschot émet l’hypothèse très vraisemblable que voici : « Dans Virgile, que Berlioz commençait alors de relire avec passion, il pouvait remarquer la formule incantatoire terque quaterque, qui spécifiait, sans oser le nommer, le fatal nombre sept. » Il ajoute fort justement : « Musicalement, cette alternance de trois et de quatre temps a quelque chose de trouble, d’oblique et de sournois : on y sent rôder l’esprit du Malin. »
Après consultation des Esprits, les Devins déclarent au souverain terrifié :
Un enfant vient de naître
Qui fera disparaître
Ton trône et ton pouvoir.
Sur quoi Hérode ordonne qu’on fasse périr tous les nouveau-nés. Ici, nouvel air du Roi, celui-ci assez médiocre, il faut bien l’avouer, grand air repris en chœur à la manière d’un final d’opéra, d’un effet vraiment un peu gros et qui rappelle (si peu que ce soit, c’est déjà trop) les mauvaises pages de Meyerbeer.
L’étable de Bethléem.
Mais nous arrivons aux pièces les plus charmantes de la partition. D’abord le joli, tendre, caressant duo de sainte Marie et de saint Joseph :

Puis le chœur des anges qui ordonnent à la Vierge et à saint Joseph de fuir le soir même vers l’Égypte.
DEUXIÈME PARTIE. – La Fuite en Égypte.
Cette deuxième partie débute par une Ouverture qui est un admirable chef-d’œuvre. « Les bergers se rassemblent devant l’étable de Bethléem. » Et pour décrire ce mystérieux rassemblement, Berlioz écrit un fugato d’une grâce, d’une fraîcheur, d’une pureté incomparables.
Berlioz a toujours aimé le fugato et l’a pratiqué avec bonheur, malgré ses diatribes contre la fugue. Il est à remarquer que les musiciens qui brillent le moins par leur savoir technique, sont ceux qui marquent une prédilection pour le style fugué. Ils veulent sans doute se prouver à eux-mêmes qu’ils ne sont pas si maladroits qu’on pourrait le croire. Et certes il y a de la gaucherie dans cette Ouverture de la Fuite en Égypte, mais il semble que cette gaucherie soit voulue et elle donne l’impression d’une habileté de plus. En tout cas elle répand dans tout le morceau un parfum de naïveté délicieux.
Le thème est exquis :

Du développement très divers, j’extrais ce passage qui me plaît tout particulièrement :

J’aime ce la dièse, qui va bientôt se bécarriser, et les modulations qui s’ensuivent.
L’Ouverture est suivie d’un chœur : l’Adieu des Bergers à la Sainte Famille, d’un sentiment pénétrant, malgré – ou à cause de (je ne sais) – la liaison parfois tellement inattendue des harmonies et leur déroulement si peu conforme à la coutumière logique musicale. Comme exemple de cet apparent décousu, ne citons que ces quelques mesures :

La brusquerie de cette modulation a son charme[26].
Et maintenant la page maîtresse de la partition, le Repos de la Sainte Famille que rien ne dépasse en fraîcheur, en pureté et en naïveté :

récit précédé et enveloppé d’une symphonie adorable et se terminant dans la plus extrême et la plus touchante simplicité sur l’Alléluia du chœur des anges.
On n’imagine pas plus de douceur, plus de tendresse, ni plus d’apaisement à la fois dans la couleur et dans le sentiment.
Page célèbre pour l’interprétation de laquelle un interprète de choix est requis. Il y faut une voix fine, une voix mince, claire et facile, une voix transparente, une diction sans apprêt, une émotion discrète et tout intérieure. Les plus excellents artistes que j’entendis chanter ce Repos de la Sainte Famille furent autrefois, Warmbrodt, puis Plamondon, Planel, enfin le ténor nègre Hayes dont l’Alléluia (suppléant à celui du chœur absent) valait à lui seul, pour l’intensité de sa ferveur religieuse, qu’on prît place au concert pour en subir le touchant émoi.
TROISIÈME PARTIE. – L’arrivée à Saïs.
Depuis trois jours malgré l’ardeur du vent
Ils cheminaient dans le sable mouvant.
Le récitant nous dit les épreuves subies par la Sainte Famille qui fuit encore. Il est accompagné par un fugato d’orchestre (encore un !) construit sur un thème qui n’est que l’écho de celui de l’Ouverture de la Fuite en Égypte, présenté dans un autre rythme et un autre mouvement :

Les saints voyageurs arrivent enfin à Saïs. « Quelle rumeur… J’ai peur… » dit la Vierge. – « Ouvrez, secourez-nous », implore Joseph. Un Ismaélite (le Père de famille) les accueille.
Le Père de famille appelle enfants et serviteurs et il ordonne :
Que de leurs pieds meurtris on lave les blessures.
Les serviteurs entrent par groupes. Excellente occasion pour un nouveau fugato, vocal, cette fois-ci, avec accompagnement d’orchestre.
Le Père de famille demande à ses hôtes leur nom, leur patrie, leur état. « Charpentier », répond Joseph. – « C’est mon métier, vous êtes mon compère, reprend l’Ismaélite. Nous travaillerons ensemble. Près de nous, Jésus grandira. »
Et pour fêter l’arrivée des voyageurs, le Père de famille invite ses enfants à improviser un petit concert. Ce qui justifie l’introduction en cette place d’un trio pour deux flûtes et harpe.

Jolie pièce d’un effet assuré.
Il ne reste plus aux voyageurs qu’à reprendre un repos bien gagné. Le Père de famille les conduit à la chambre où ils pourront dormir.
Le Récitant conclut :
Ô mon âme, pour toi que reste-t-il à faire ?
Qu’à briser ton orgueil devant un tel mystère.
Toute cette fin languit un peu.
Mais par ailleurs, que de grâce, que de délicatesse, que de perfection dans certaines pages de cette partition ! Berlioz y reste un romantique par son goût de la couleur, mais un romantique assagi, sans volcanisme, sans fièvre, sans passions effrénées.
*
Le 28 juillet 1854, Berlioz avait terminé l’Enfance du Christ.
Le lendemain, il apprend qu’Halévy vient d’être nommé secrétaire perpétuel, en remplacement de Raoul Rochette, et que son fauteuil, – un fauteuil de musicien, – devient par là même disponible.
Aussitôt, Berlioz entre en campagne. Démarches sur démarches. Il n’épargne point sa peine. Tout cela pour apprendre quelques jours après que Clapisson est élu.
Alors il se remet à écrire, à terminer ses Mémoires, les fantastiques Mémoires, remplis d’inexactitudes, d’erreurs volontaires ou non, d’illusions et de confidences passionnées. Les dernières lignes en sont un cri de rage qui s’adresse à tous ceux qui l’ont fait souffrir, confrères, directeurs, critiques, public même :
« Maniaques, dogues et taureaux stupides, vous, mes Guildenstern, vous Rosencranz, mes Iago, serpents et insectes de toute espèce, adieu, mes amis, farewell, my friends ; je vous méprise ! »
Et il date : « Paris, 18 octobre 1854. »
Le lendemain, il épousait Maria Recio.
Il écrivait, à ce sujet, à son fils : « Ma position, plus régulière, est plus convenable ainsi. Je ne doute pas, si tu as conservé quelques souvenirs pénibles et quelques dispositions peu bienveillantes pour Mlle Recio, que tu ne les caches au plus profond de ton âme par amour pour moi… Si tu m’écris à ce sujet, ne m’écris rien que je ne puisse montrer à ma femme… »
Louis Berlioz, bouleversé par cette nouvelle, accourt à Paris, voit le nouveau ménage, va pleurer sur la tombe de sa mère… et repart pour se battre en Crimée.
Cependant Berlioz prépare la première audition de l’Enfance du Christ pour laquelle il a obtenu le concours de cinq des meilleurs artistes de l’Opéra.
Le dimanche 10 décembre, la petite salle Herz regorge d’élégances. Les couloirs mêmes sont bondés. Dès l’abord on est étonné, de la part de Berlioz, d’un orchestre si peu nombreux. Le concert débute par un trio de Mendelssohn pour piano, violon et violoncelle, doucereux. Puis Berlioz paraît au pupitre avec « son air moribond ». On écoute, étonné, sans enthousiasme, on applaudit discrètement. Le Repos de la Sainte Famille, bissé, déchaîne le succès. La séance se termine par une longue ovation à Berlioz. La presse est excellente, sauf la Revue des Deux Mondes où Scudo parle de « ce chaos de l’impuissance ».
La veille de Noël, nouvelle audition de l’Enfance du Christ : nouveau triomphe.
Berlioz ne se réjouit pas longtemps des applaudissements qu’il a recueillis. Il juge que le succès de cette petite composition est « offensant, révoltant pour les aînées », pour la Damnation, Benvenuto, le Requiem.
*
Le 30 janvier 1855, Berlioz et sa femme partent pour Hanovre où l’Enfance du Christ recueille l’approbation du Roi et de sa cour.
Mais voici qui a plus d’importance : Berlioz se rend à Weimar où il va trouver enfin un milieu digne de le comprendre, et d’abord ce merveilleux Liszt, serviteur des génies, ses confrères, génie lui-même, et la princesse Caroline Sayn-Wittgenstein. Non seulement sa dernière partition est jugée à son mérite, mais on le met en demeure de composer une œuvre de vastes proportions qui pût faire valoir toutes les ressources de son génie dramatique : « On me pousse, écrit-il à Fiorentino, on me talonne, on me taonne, pour écrire une grande machine théâtrale… Mais, pour un pareil travail, combien d’impossibilités matérielles, causées par les coutumes de l’Opéra de Paris[27]. » Berlioz est tout heureux de se sentir ainsi soutenu dans la voie où le portait, si peu confiant en lui-même, son destin.
Et Liszt a organisé à Weimar une double semaine-Berlioz durant laquelle on joue Roméo, la Captive, le Chœur des Ciseleurs, les Sylphes de la Damnation, la Fantastique, Lélio ou le Retour à la vie. Une quinzaine de parfait bonheur pour le pauvre compositeur.
Une « grande machine » pour l’Opéra ! Mais sur quel sujet ?
Berlioz, de moins en moins romantique, ne songe plus à Shakespeare. Le voici tourné vers l’antiquité. Depuis quatre ou cinq ans, il lit et relit son cher Virgile. Les amours de Didon et d’Énée, quelle magnifique tragédie ! Cela s’appellerait l’Énéide ou les Troyens.
L’œuvre qu’il rêve d’écrire, Berlioz voudrait qu’elle prît place non dans les représentations ordinaires de l’Opéra, mais dans « de grandioses solennités musicales, attendues et préparées comme les fêtes rituelles d’une religion… Car la musique n’est pas destinée à prendre place parmi les jouissances quotidiennes de la vie, comme le boire, le manger et le dormir… Je ne connais rien d’odieux comme ces établissements où bouillotte invariablement chaque soir le pot-au-feu musical : ce sont eux qui ruinent notre art, qui le vulgarisent, le rendent plat, niais, stupide… Un Panthéon lyrique et non le bazar de l’Opéra ! »
*
Après Weimar, Bruxelles. Berlioz y rencontre Edgar Quinet, proscrit par Napoléon III. Celui-ci écrit, à ce propos, à l’un de ses amis : « J’ai eu, l’autre jour, la grande joie de recevoir la visite de Berlioz que je ne connaissais pas et que j’ai toujours admiré à la barbe des impies. J’aime et j’admire cet artiste qui suit sa Muse, sans s’occuper de flatter le public. J’aime ce combat à outrance, désintéressé, contre les succès faciles. Berlioz m’intéresse autant que sa musique : sa volonté, son énergie, sa fierté sont elles-mêmes, à mon gré, la plus belle de ses symphonies. Il avait mon admiration, il emporte mon amitié. Quelle belle œuvre que la vie d’un véritable artiste !… J’ai entendu deux fois, à grand orchestre, son oratorio l’Enfance du Christ. Il y a là des chants comme en eût trouvé Raphaël » (4 avril 1855).
*
Berlioz revient à Paris et, à l’occasion de l’Exposition universelle, fait exécuter à l’église Saint-Eustache le Te Deum, qu’il avait composé en 1849. Neuf cents exécutants. Formidable entreprise, dont, à force de publicité, il arrive à couvrir les frais.
Et aussitôt, il écrit à Liszt : « C’était colossal, babylonien, ninivite. » Expressions trop fréquentes sous la plume de leur auteur pour que nous nous laissions prendre à leur illusoire magie. Pour une fois peut-être, Berlioz disait vrai. Mais il faut toujours vérifier ses dires. C’est à quoi n’a pas songé Arthur Honegger qui, sur la simple lecture des Lettres intimes de notre compositeur, a soutenu dans un brillant article de Comœdia (samedi 11 septembre 1943) que Berlioz n’avait pas été si malheureux qu’on voulait bien le dire, qu’il s’était créé une légende autour de sa personne, du fait de ses trop romantiques commentateurs, légende du perpétuel insuccès et de l’art incompris, qu’en réalité l’auteur de la Damnation avait été aussi souvent joué et aussi chaleureusement applaudi que pouvait le souhaiter un auteur de symphonies. Le seul cas de ses Troyens serait à citer comme un insuccès notoire. Mais il s’agirait là d’une œuvre de théâtre, non plus d’une symphonie, et d’ailleurs d’une œuvre mal conçue pour la scène. Arthur Honegger admet sur parole toutes les déclarations de Berlioz. Il ne doute pas un seul instant de la véracité des retentissants bulletins de victoire dont il inonde ses correspondants après chaque bataille. Il a tort. Qu’il consulte, à ce sujet, Adolphe Boschot qui dans l’ouvrage monumental qu’il a consacré à Berlioz examine sa vie et son œuvre à la loupe, jour par jour, page par page, dans un esprit dénué non de profonde sympathie ni d’enthousiaste admiration quand il le faut, mais de toute illusion déformante de la réalité des faits ou des sentiments. Une méthode critique implacable remet au point ce qu’il y a si souvent, pour ne pas dire presque toujours, d’extraordinairement fantaisiste dans les récits de Berlioz et dans ses indications, sur l’exécution de ses œuvres et sur l’accueil qui leur était fait. Oui, Berlioz a été assez habile pour se donner à lui-même et pour donner à ses contemporains l’illusion de succès triomphaux dont il avait construit de toutes pièces la trompeuse apparence. Mais il ne restait pas longtemps lui-même dupe de son mirage et il retombait vite chaque fois dans le désespoir de n’avoir pas été compris.
*
En février 1856, nouveau séjour de Berlioz à Weimar. C’est alors que Berlioz prend le ferme parti d’entreprendre la composition des Troyens. Cette importante décision, l’honneur en revient à la princesse Caroline Sayn-Wittgenstein. « Écoutez, dit-elle à Berlioz, si vous reculez, si vous ne bravez pas tout pour Didon et Cassandre, je ne veux plus vous voir. » Et elle lui donnait l’exemple de Wagner, malade, travaillant d’arrache-pied à cette immense Tétralogie qu’il n’avait aucun espoir de faire jamais représenter. Elle le pique au vif. Berlioz n’hésite plus. De retour à Paris, il entre en correspondance avec la princesse, qu’il traite en inspiratrice. Mais il n’a plus l’ardeur de la jeunesse. Il a peine à se mettre au travail. Il relit l’Énéide. Il parle de son projet à ses amis, à Fiorentino, à Legouvé. Il relit Shakespeare. Ce n’est pourtant plus dans l’esprit des œuvres telles que Roméo, Hamlet ou Othello qu’il veut écrire les Troyens. Berlioz a presque cessé d’être romantique. Un nouveau Berlioz se dégage des liens du passé. Ce n’est plus le volcanique auteur de la Fantastique. Il a cessé, ou presque, d’être romantique et apparaîtra bientôt pur classique.
En avril 1856, Berlioz écrit à Liszt. « J’ai commencé à dégrossir le plan de la grande machine dramatique à laquelle la Princesse veut bien s’intéresser. Cela commence à s’éclaircir ; mais c’est énorme et par conséquent, c’est dangereux… Je rumine, je me ramasse, comme font les chats quand ils veulent faire un bond désespéré. »
Il a des moments de découragement… « À quoi bon ? »…
« Je me décourage le soir, mais je reviens à la charge le matin, aux heures de la jeunesse du jour. »
*
Mort du compositeur Adam (3 mai 1856). Un siège vacant à l’Institut. Berlioz pose sa candidature. Quatre concurrents dont Gounod. « Trente-neuf immortels à solliciter. »
Et les Troyens ? Il ne cesse d’y penser au cours de ses randonnées à travers Paris.
« Tous les matins, je monte en voiture, mon album à la main, et tout le long de ma pérégrination je songe, non à ce que je vais dire à l’immortel à qui je rends visite, mais à ce que je ferai dire à mes personnages… »
Le 11 juin, il écrivait de nouveau : « Je suis dans une fièvre de composition… Je viens de finir le 3e acte de mon poème et de plus j’ai achevé d’écrire hier les paroles et la musique du grand duo du 4e acte, une scène volée à Shakespeare et virgilanisée, qui me met dans des états ridicules… On fait aujourd’hui la liste des candidats à la section de musique. On dit que je serai présenté le premier. »
Il fallut tout de même quatre tours de scrutin pour que Berlioz fût enfin élu de l’Institut.
Il est dans la joie : « Me voilà donc devenu un homme respectable ; je ne suis plus ni truand, ni bohème ! Arrière, la Cour des Miracles !… Quelle comédie !… Dans trois semaines, j’aurai achevé de gratter mon libretto. Je me mettrai à la partition pour ne plus en démordre… »
Et encore : « Cela fait à Paris grande sensation. C’est une révolution en faveur de la jeune musique…
« C’est un coup d’État dans l’empire des arts. De là, une joie incroyable parmi toute la jeune génération des artistes, et parmi les vieux artistes qui ont des idées jeunes. Horace Vernet, qui m’a si énergiquement secondé, est triomphant. La section de musique (Auber, Halévy, Thomas, Reber, Clapisson) s’est montrée d’une cordialité parfaite. Caraffa, seul, s’est couvert de ridicule par son opposition haineuse et couronnée d’insuccès…
« … Il me vient des lettres de félicitations de partout…
« … J’étais assis sur une baïonnette, me voilà dans un fauteuil… »
*
À la fin de juillet, il put envoyer son poème à la princesse Sayn-Wittgenstein.
Les Troyens restent sa grande affaire. Son poème lui revient de Weimar accompagné des réflexions de la princesse. Il le lit à des camarades. Il demande à chacun son appréciation. Il discute. Il corrige…
Mais c’est la musique qui l’inquiète. « La tâche sera rude. » Et quel public l’écoutera ?
Malade, les nerfs brisés, il travaille.
Alternatives de confiance et de découragement.
Enfin, la dernière page du manuscrit est datée du 7 avril 1858.
*
Et nous voici en face de cette partition immense, dont l’étendue même et une certaine uniformité peuvent rebuter. On en a dit bien du mal. On a surtout reproché à Berlioz de n’avoir pas su renouveler cette forme périmée du « grand opéra », d’une convention que nous n’acceptons plus et qui nous fatigue. On lui en a voulu de ses récitatifs ou de ses airs à la Gluck, de ses cantilènes à la Piccini ou à la Bellini, de certains de ses ensembles pompeux à la Meyerbeer. Et malgré tout, à qui veut l’écouter sans parti pris, l’œuvre fait une très grande impression. Il y a des pages admirables, d’une perfection en son genre inégalable. Citons seulement l’Apparition d’Hector, la Chasse, le Nocturne qui précède le duo de Didon et d’Énée, toute la scène du Départ des Troyens. Ce sont des évocations, les unes d’un charme indicible, ou d’une souveraine majesté, les autres d’une vie et d’une couleur intenses. Un souffle puissant d’héroïsme traverse l’œuvre. On est ému, on est profondément troublé. Quand il atteint ces sommets, Berlioz est tout près de nous. Sa musique n’est pas d’hier, elle est d’aujourd’hui et de toujours.
Une grave lacune cependant : nul amour dans cette œuvre. La passion de Didon ne se traduit qu’en romances. Son désespoir n’a pas un seul accent qui vous déchire et nous restons indifférents devant sa mort. Cette musique qui a tant de flamme n’a pas de cœur.
Mais regardons-y de plus près.
ACTE PREMIER
Le camp abandonné des Grecs.
Les Troyens se croient sauvés et se livrent à la joie sans arrière-pensée.
Au fond de la scène sur un tertre funéraire (le tombeau d’Achille), trois bergers chantent une mélodie plaintive. Contraste saisissant avec l’allégresse tumultueuse des Troyens.
Ici la terrible et inutile prophétie de Cassandre qui prévoit tous les malheurs prochains. Phrase célèbre d’une puissance dramatique en même temps que d’une pureté de ligne incomparable.

Chorèbe, le fiancé de Cassandre, intervient : « Cesse de craindre en cessant de prévoir », supplie-t-il, et il entoure de caressantes tendresses sa bien-aimée.
Mais imperturbable, Cassandre reprend la parole pour annoncer la chute de Troie et la mort de Chorèbe.
Le décor change. Maintenant on est au centre de la ville devant la citadelle. Une fête se prépare, une fête religieuse pour « recevoir le cortège religieux qui escorte le fatal cheval et le fait pénétrer jusqu’au Palladium ».
Paraissent les héros homériques : Priam, Hélénus, Hécube, Panthée, Chorèbe.
Puis un combat de ceste.
Voici maintenant Andromaque, veuve d’Hector, qui passe accompagnée de son fils Astyanax. La foule s’écarte avec respect.
Énée accourt et raconte l’horrible mort de Laocoon étouffé par deux monstrueux serpents pour avoir lancé un javelot contre le cheval de bois.
Cassandre renouvelle ses sombres avertissements.
Ce tableau riche en couleur et en contrastes est traduit musicalement de la façon la plus heureuse et s’achève par les éclats farouches de la fameuse Marche troyenne.

On voit tout de suite, par ce début même, quel va être l’inconvénient du livret imaginé par Berlioz. Il suppose, de la part du public, la connaissance exacte, minutieuse, intime de l’Iliade et de l’Énéide, non seulement la connaissance des vieilles légendes rapportées par Homère et Virgile, mais le sentiment de la beauté des poèmes qu’elles leur ont inspirés et le contact étroit avec la vie antique. Voilà ce qui manquera à la plupart des auditeurs de l’opéra des Troyens. Ils ne s’intéresseront pas à cette évocation de personnages qui ne sont pour eux que des noms : ils n’en seront pas touchés.
ACTE II
Dans le palais d’Énée, une chambre à peine éclairée par la faible lueur d’une lampe. Énée repose, tout armé.
L’ombre d’Hector paraît.

s’écrie Énée.
Alors, d’une voix morte, lentement et solennellement, l’ombre d’Hector annonce la chute de Troie et ordonne à Énée de « sauver les Images des dieux et de fonder un nouvel empire ».

La scène est fort belle. Elle a de la grandeur et tout le mystère qui convient.
Le décor change.
Près d’un autel de Vesta, des Troyennes prient.
Cassandre accourt : « Tous ne périront pas. Énée et quelques compagnons ont sauvé les dieux de la patrie et gagnent la mer. Chorèbe est mort et tant d’autres Troyens. Bientôt les Grecs vont profaner le temple. Ils nous prendront comme esclaves : femmes troyennes, mourons avant cette honte. » Le dernier cri, encore prophétique, de Cassandre est : Italie ! Italie ! »

ACTE III
Les Troyens à Carthage.
Un prélude d’orchestre, un Lamento, évoque la longue ondulation des flots qui portent Énée et ses compagnons vers Carthage.
Au lever du rideau, la scène représente les jardins de Didon.
Chœur de Carthaginois chantant les bienfaits de la paix.
Bientôt paraît Didon, acclamée par son peuple (Berlioz souhaite ici un chœur supplémentaire de deux ou trois cents voix).
Didon rappelle à son peuple tout ce qu’il doit à sa prudence, à sa sagesse, à son constant souci de l’intérêt commun.
Chers Tyriens, tant de nobles travaux
Ont enivré mon cœur d’un orgueil légitime.
Berlioz use ici de la forme classique des grands airs avec son récit initial, son thème principal et ses reprises, puis son final vif et brillant. Il en use avec le souvenir très présent des plus belles pages de Gluck. Il en use avec une réelle grandeur, mais il n’évite pas de produire l’impression de raideur, de tension et d’effort trop prolongé qui résulte de l’emploi de ces cadres conventionnels et surannés.
Je préfère le duo mélancolique et rêveur, qui suit, des deux sœurs, Didon et Anna.
Mais les Troyens naufragés demandent l’hospitalité. Didon accueille favorablement leur supplique.
Au même moment, on annonce que les Numides marchent sur Carthage. Énée s’offre à les combattre.
Final guerrier sans grand intérêt.
Intermède symphonique. – Chasse royale. Orage.
Énée est revenu : Ici se place le fatal épisode préparé par Junon et Vénus, la chasse et l’orage, où Berlioz suit fidèlement le texte de son cher Virgile.
Réveil de la forêt. Lever du jour. Les Naïades bondissent dans les roseaux. Des chasseurs traversent la forêt puis se dispersent :
Diffugient comites et nocte tegentur opaca.
Le vent se lève. La pluie tombe goutte à goutte. L’orage gronde sourdement dans le lointain.
Énée et Didon se réfugient dans la grotte fatale.
Des Fauves bondissent, poursuivant des Nymphes.
La foudre tombe, mettant le feu dans le tronc d’un chêne. À sa lueur Sylvains et Satyres dansent.
Des voix mystérieuses font entendre, du fond de la forêt, le cri de rappel prophétique : Italie !… Italie !…
L’orage se calme. De nouveau les Naïades sortent d’entre les roseaux.
Une dernière fanfare de chasse retentit.
Merveilleux tableau symphonique où triomphe le génie de Berlioz et tel qu’aucune réalisation scénique n’en saurait traduire la pénétrante poésie.
Je n’oublierai jamais l’audition qu’en 1935 nous donnait à Londres, de cette page mémorable, l’orchestre de la Royal Philharmonie Society sous la direction de Sir Hamilton Harty, avec une perfection de nuances et un sens évocateur extraordinaires. Page décidément sublime sur laquelle plane une sainte inquiétude dont de frémissants violons rendaient subtilement perceptible la sourde angoisse. Après quoi, éclata superbement sauvage la Marche troyenne.
ACTE IV
Anna et un chef carthaginois nous apprennent qu’Énée, vainqueur des Numides est aimé de Didon.
Énée et Didon paraissent.
Jeux et danses.
Mais le divertissement lasse la Reine.
Assez, ma sœur, je ne souffre qu’à peine
Cette fête importune.
Alors vont commencer les charmes souverainement enchanteurs de ce long nocturne par quoi se développe et s’achève ce merveilleux IVe acte. Les voix de Didon et d’Énée, mêlées aux voix de leur suite, forment un ensemble incomparablement enveloppant (Septuor) auquel répond l’écho d’un chœur lointain.
Didon et Énée, restés seuls, chantent :

Didon, appuyée sur l’épaule d’Énée, s’éloigne lentement.
Mercure paraît subitement dans un rayon de la lune, non loin d’une colonne tronquée où sont suspendues les armes d’Énée. S’approchant de la colonne, il frappe de son caducée deux coups, sur le bouclier qui rend un son lugubre et prolongé. Puis le dieu répète d’une voix grave : Italie !… Italie !… et disparaît.
ACTE V – La flotte troyenne au port.
Le théâtre représente le bord de la mer couvert de tentes troyennes. On voit les vaisseaux troyens dans le port. Il fait nuit. Un jeune matelot chante en se balançant au haut du mât d’un navire.
Et c’est l’exquise chanson d’Hylas :

N’oublions pas que le fils de Berlioz était marin :
« Je pensais à toi, dit-il, cher Louis, en l’écrivant… ; c’est un morceau de caractère destiné à contraster avec le style épique et passionné du reste… »
Le jeune matelot s’endort sans achever sa chanson.
Quelques chefs troyens paraissent et manifestent leur inquiétude : il faudrait partir :
Chaque jour voit grandir la colère des dieux.
Deux sentinelles montent la garde devant les tentes. Ces lourds soldats se confient leurs pensées très prosaïques. Ils ne songent guère à leur mission ni à l’Italie. Repus de l’hospitalité carthaginoise, ils n’ont guère hâte de quitter cette terre d’Afrique qui leur apporte toutes les joies qu’ils réclament.
Une des rares traces de romantisme à la Shakespeare qui subsiste dans cette partition des Troyens toute classique.
« Le Duo des soldats, d’une familiarité un peu grossière, inscrit Berlioz sur son manuscrit, produit un contraste tranché avec le chant mélancolique du matelot qui le précède et l’air passionné d’Énée qui le suit. On a trouvé en France que le mélange du genre tragique et du genre comique était dangereux et même insupportable au théâtre, comme si l’opéra de Don Giovanni n’était pas un admirable exemple du bon effet produit par ce mélange, comme si une foule de drames journellement représentés à Paris n’offrait pas aussi d’excellentes applications de ce système, comme si enfin Shakespeare n’était pas là. Il est vrai que, pour la plupart des Français, Shakespeare n’est pas même autant que le soleil pour les taupes. Car les taupes peuvent au moins ressentir la chaleur du soleil. »
Énée accourt. « Je dois quitter Carthage… Didon le sait. »
Il hésite cependant encore.
Les spectres de Cassandre, d’Hector et de Chorèbe, de Priam interviennent pour le décider.
« J’obéis, spectres inexorables !… Debout, Troyens ! »
En vain Didon arrive et cherche à retenir Énée. Les vaisseaux sont prêts. Le cri unanime : « Italie !… Italie !… » retentit parmi les matelots. La flotte s’ébranle et dans le jour qui se lève, majestueusement elle gagne la haute mer.
Il y a là un tableau d’un mouvement et d’une émotion extraordinaires. Gagné par l’enthousiasme des siens, Énée a fini par s’écrier lui aussi : Italie ! Et l’on sent toute la force, toute la violence de l’instinct profond qui pousse les derniers débris du peuple troyen vers leur nouveau destin. Émotion héroïque, sociale et politique qui bouleverse les cœurs ! Le point culminant du drame.
Deuxième tableau.
Un appartement du palais de Didon.
Adolphe Boschot déclare sublimes les dernières scènes de l’opéra, les scènes qui préparent et amènent la mort de Didon. Il a peut-être raison. Je dois avouer cependant que je ne suis pas de son avis. Pourquoi ? Je crois en comprendre le motif secret. La dernière scène du tableau précédent, la scène du départ des Troyens m’a trop vivement troublé. Je suis avec Énée, je suis pour ce petit peuple qui se cherche un royaume.
Didon et sa mort me sont indifférentes maintenant.
Et puis cette Didon, la Didon de Berlioz, – non celle de Virgile – n’a pas su me toucher par des accents qui traduisent avec assez d’intensité la profondeur de son amour. Ses chants furent éloquents, mais d’une éloquence théâtrale qui ne trahit pas le véritable secret de sa passion véhémente. S’il y a du charme dans le duo de l’acte IV, il exprime bien plus les délices d’un paysage nocturne, la féerie d’un paysage lunaire, que la tendresse d’une rêverie amoureuse. Enfin la Didon de Berlioz n’a pas su atteindre en moi les régions les plus intimes de ma sensibilité, comme l’a fait par exemple la Didon du vieux Purcell auquel je suis incapable de résister quand elle exhale son ultime plainte et sa suprême prière :

Et pourtant sur quel piètre texte poétique cette musique de Purcell est chantée ! Mais la musique emporte tout…
Dans cette page si souvent citée :

je trouve plus de rhétorique que de sincérité. Que dis-je ! Elle me semble désespérément froide et uniquement soucieuse d’un effet de style qu’elle n’atteint même pas. Car le style ne vaut que par la pensée ou le sentiment qu’il recouvre.
Du reste jamais, – sauf une fois, – Berlioz ne s’est montré le chanteur inspiré de l’amour. Rappelons-nous combien, par exemple, l’air de Faust devant la demeure de Marguerite est peu passionné, et combien d’autres fois Berlioz en des cas analogues, a manqué le but ou frappé à côté, substituant à l’émotion absente les effets descriptifs ou impressionnistes. Une seule fois, dis-je, une seule fois, mais avec quel rare bonheur, il a exprimé l’amour dans toute sa plénitude et sa profondeur, c’est quand il écrivit la phrase sublime – n’hésitons pas ici à user de la terrible épithète – la phrase sublime de Marguerite : « D’amour l’ardente flamme… »
Dans l’ensemble, – Adolphe Boschot lui-même le reconnaît, – la partition des Troyens n’a ni la perfection, ni l’attrait de certains autres ouvrages de Berlioz. Elle a des faiblesses. Mais quand il touche le but, Berlioz atteint ici, comme ailleurs, à un ordre de grandeur insurpassable.
*
Maintenant, il s’agit de faire jouer les Troyens !
Personne n’en voudra.
Il faudra patienter, attendre des jours, des mois, des années.
La vie recommence, monotone, toujours cruelle, physiquement et moralement.
En 1860, durant un séjour à Bade, un nouveau projet prend consistance. Bénazet, le roi de la roulette, propose à Berlioz de monter un ouvrage nouveau de lui. Berlioz pense tout de suite que, pour le public très spécial de Bade, un opéra de demi-caractère sera de mise. Il retrouve un libretto qu’il avait esquissé en 1833 sur la comédie Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare. Il va le reprendre, le remanier. Cela s’appellera Béatrice et Bénédict. Entente conclue avec Bénazet.
Il se met au travail avec entrain. Il le poursuit, au milieu des tracas, des soucis. Il l’achève dans la tristesse.
Son fils a rompu avec lui et lui écrit une lettre cruelle, affreusement blessante.
Mais contons l’aventure de Béatrice et Bénédict telle que Berlioz l’a conçue.
PREMIER ACTE.
Au lever du rideau, on voit un parc sous un ciel d’azur, « dans le goût des jardins italiens de la Renaissance ». À droite un palais. Dans le lointain Messine. Chœur joyeux :
Le More est en fuite. Victoire !
Don Pedro s’est couvert de gloire !
« Assez, assez ! quelles rimes ! s’écrie malicieusement Béatrice, quelles rimes ! Voilà les suites de la guerre ! »
Elle se moque aussi de Bénédict, qui n’est pas encore là ; mais auquel il lui est assez agréable de penser.
Le peuple danse une Sicilienne.
Bénédict paraît. Assaut de plaisanteries, d’agaceries, de bons mots, de préciosités. Querelle de surface d’une grâce souriante.
Bénédict, resté seul, jure qu’il ne songe point à se marier. C’est ce qu’il déclare à ses amis don Pedro et Claudio dans un aimable terzetto. Claudio, lui, va le soir même s’unir à la belle Héro.
Les musiciens arrivent pour répéter l’épithalame. « Messieurs, proclame le maëstro, le morceau que vous allez avoir l’honneur d’exécuter est un chef-d’œuvre. » Morceau grotesque en fugato. « Le mot fugue veut dire fuite ; et j’ai fait une fugue à deux sujets, à deux thèmes, parce que les deux époux songent à la fuite du temps… »
Don Pedro et Claudio se confient à voix basse que Béatrice aime Bénédict.
« Elle m’aime !… Mais moi aussi je l’aime ! » s’écrie Bénédict qui les a entendus et qui reste seul. Et sur cet aveu il chante un subtil rondo, puis se sauve tout heureux.
Héro, avec sa suivante, entre en scène, et dans un exquis duo, la perle de la partition, chante « le premier émoi de l’amour et la douceur de la nuit paisible et sereine ». Décidément, les nocturnes sont favorables à notre compositeur.
On pourrait croire que Berlioz a conçu cette page délicieuse per amica silentia lunæ. Mais non ! Ce serait durant une séance de l’Institut, prétend-il. Croyons-le, si nous voulons. Mais ne serait-ce pas là qu’une ironie sans vérité ?
DEUXIÈME ACTE.
Comme prélude la Sicilienne brillamment orchestrée.
La toile se lève.
« Du vin ! Du vin ! » réclament les soldats dans la coulisse.
Le grotesque maëstro Somarone, fortement éméché, improvise des couplets bachiques avec accompagnement de guitares, de tambourins et de trompettes.
Tous se sauvent dans les jardins et Béatrice chante un air à l’italienne avec récitatif, andante, cabalette et vocalises. Béatrice déjà fort amoureuse, mais se refusant par vanité à l’amour.
Héro survient et dit toute la tendresse dont déborde son cœur.
Béatrice, instruite par l’exemple du cortège nuptial qui se forme, se demande avec angoisse ce qu’elle va décider. L’orgueil va-t-il l’emporter sur l’amour ?
Bénédict se présente alors et entre les deux amants toutes les anciennes railleries, toutes les disputes renaissent.
Le cortège nuptial paraît. Entraînés par l’allégresse générale, Béatrice et Bénédict cèdent enfin à l’amour. Ils vont se laisser marier, comme leurs amis.
Court livret, légère fantaisie, convenant parfaitement au génie de Berlioz, génie auquel on sent qu’il manque parfois l’ardeur des jeunes années, génie « affaibli, diminué ou hésitant ».
Retenons de cette ultime partition, la page merveilleuse, que nous citions tout à l’heure, le duo des deux femmes à la fin du 1er acte :

*
Nouvelle tristesse : Le 13 juin 1862 Berlioz perd sa femme, Maria Recio. Elle meurt subitement d’une crise cardiaque.
L’isolement et l’ennui.
Du moins Berlioz continue d’habiter avec sa belle-mère, qui le soigne.
La publication de Salammbô en décembre 1862 secoue sa lassitude. Dans les Débats, il interrompt sa chronique musicale du 21 pour s’écrier : « Avez-vous lu Salammbô ?… Quant à moi je ne l’ai encore lue que deux fois, mais je vais me mettre à l’étudier. Déjà, j’en rêve la nuit, je sens mon cœur s’éprendre pour cette mystérieuse fille d’Hamilcar… Et ces paysans carthaginois qui s’amusent à crucifier des lions ! Ce style, calme dans sa force immense, est si coloré qu’il donne au lecteur des éblouissements… »
*
Un dimanche, au Conservatoire, on applaudit le duo nocturne de Béatrice et Bénédict !
Alors Berlioz : « Ce public hargneux, hostile aux vivants, s’oublie jusqu’à crier bis… On me découvre !… Ah ! si je pouvais vivre encore un peu !… »
Béatrice et Bénédict, traduit par Richard Pohl, est bien accueilli (8 avril 1863) par la cour grand-ducale de Bade.
Leurs Altesses font appeler Berlioz dans leur loge et le félicitent. Le lendemain il écrit : « Mon cher Fiorentino, voilà la chose. Grandissime succès. » Naturellement. « Malgré l’étiquette, la salle frémissait, du haut en bas, d’applaudissements rentrés… On me promet pour demain, l’interdiction étant levée, un dégel et une débâcle d’applaudissements… Si vous trouvez le joint, soyez assez bon pour dire… » Et en avant, la publicité dans les journaux de Paris. Mais que pensaient, au vrai, les Badois ?
*
Berlioz avait fini par faire accepter ses Troyens au Théâtre-Lyrique. Carvalho venait d’y faire représenter, sans succès, les Pêcheurs de perles de Bizet. Il risquait la grande aventure des Troyens. Mais, acculé par la ruine imminente de son entreprise, il rognait sur toutes les dépenses. Berlioz demandait des instrumentistes supplémentaires. On les lui refusait, ou il fallait qu’il les payât de ses deniers ou bien encore qu’il modifiât son instrumentation. Et puis Carvalho exigeait des coupures, et encore des coupures.
Il précipite les répétitions. Il faut jouer à tout prix. À la répétition générale (2 novembre 1863) même les amis constatent que « rien n’est d’aplomb. » La première (4 novembre) paraît interminable. Un entr’acte dura 55 minutes à cause de la lenteur des machinistes à planter le décor. Dans les couloirs, on daubait tant qu’on pouvait sur l’auteur et sur la pièce. « Ce poème, c’est un pensum de quatrième. – Pourquoi les Troyens portent-ils des costumes grecs ? – Carvalho n’est pas un « pêcheur de perles… » Les amis répondent en vantant le style de l’œuvre, sa beauté frémissante, sa parenté avec les ouvrages de Gluck et de Spontini. Par moments, la musique s’impose. À grands cris, on redemande le Septuor. On applaudit le duo nocturne, mais on n’écoute pas la Chasse royale : c’est de la symphonie. Et pourtant, à la fin du spectacle, le nom de Berlioz est acclamé. Le public se reprend. Il sent vaguement la grandeur du génie à la hauteur duquel il n’a pas eu le courage de s’élever et prétend lui manifester son regret et même son enthousiasme pour des beautés qui lui échappent en partie, mais non complètement.
Adolphe Boschot résume ainsi la situation :
« Au Théâtre-Lyrique les recettes étaient presque satisfaisantes. Pour les dix premières représentations (jusqu’au 25 novembre et la première exceptée), un peu plus de 30.000 francs ; soit en moyenne 3.400 francs pour chacune de ces neuf soirées (exactement 3.373 francs). Or, durant ce même automne, la recette moyenne des Pêcheurs de perles n’atteignait pas 1.000 francs (985 francs), celle d’Obéron se tenait à 1.500 ; mais les Noces de Figaro (qui s’étaient relevées) produisaient en moyenne 4.000 (3.950 francs), ce qui n’était pas encore la bonne moyenne du Théâtre-Lyrique (4.500 et 5.000). Les Troyens avaient donc d’honorables demi-salles. Certes l’élite du monde musical s’y intéressait. Tous les compositeurs français qui comptaient déjà, tous ceux qui compteront plus tard, suivaient ces représentations, bien qu’elles fussent défectueuses et mutilées… Et même, presque chaque soir on remarquait Meyerbeer, attentif, les yeux sur le livret, et comme à l’affût des accents dramatiques de l’orchestre. »
Carvalho n’avait représenté que la 2e partie de l’œuvre les Troyens à Carthage, détachée de la 1re, la prise de Troie.
En 1892 ces mêmes Troyens à Carthage furent l’occasion pour Mlle Delna d’un débuts triomphal à l’Opéra-Comique dans le rôle de Didon.
En 1899, la 1re partie des Troyens, sous le titre de la Prise de Troie, était représentée sur la scène de l’Opéra avec Mlle Delna, également magnifique dans le rôle de Cassandre.
L’œuvre entière dépasse les limites d’une seule représentation normale. En 1921, l’Opéra voulut cependant en donner une idée assez complète, malgré d’importantes coupures. L’exécution commencée à 7 heures 3/4, s’achevait avant minuit. L’orchestre sous la direction de Philippe Gaubert fut admirable de précision nuancée et d’ardeur frémissante. Franz était un superbe Énée d’une vaillance vocale peu commune et dans ses adieux à Carthage il mit un emportement chaleureux qui souleva les acclamations de l’auditoire.
CHAPITRE XXI
LA MORT DE BERLIOZ
Tout de suite après ces représentations des Troyens, qui avaient tellement attiré l’attention des artistes, des connaisseurs – si elles avaient laissé le grand public assez indifférent – Berlioz déclare sa carrière terminée. Il a dit son dernier mot. Sans cesse, il répète le vers de son maître bien aimé, de Virgile :
Vixi et quem dederat cursum fortuna, peregi.
Il lui reste quelques années à vivre, années vides, années creuses, qu’il essaye parfois de remplir tant bien que mal.
Il les remplit de souvenirs amers. Il écrit ses Mémoires. Il revit son passé. Mais il ne compose plus.
Il eut un moment l’idée de prendre la direction de l’orchestre de la Société des concerts du Conservatoire. Mais on ne songeait guère à lui. Le 21 décembre 1863, la Société vote et choisit Georges Hainl.
Au vrai, Berlioz ne vit plus. Il végète. Il sommeille. Presque toujours au lit, il attend la mort, tourmenté sans répit par ses pauvres nerfs.
« Ma tête est comme une vieille noix creuse, » dit-il.
Il donne sa démission de critique musicale des Débats, où le remplace son fidèle d’Ortigue.
Avec les 6.000 francs de rente de l’héritage paternel, les 1.500 francs de l’Institut, les 1.200 francs de la Bibliothèque du Conservatoire et quelques autres petits revenus, il a de quoi vivre tranquille : neuf ou dix mille francs par an.
Tranquille ! Est-il jamais capable d’être tranquille ?
Toujours des tracas, des soucis, réels ou fictifs. Et le plus grand de tous, celui de la mort, de la mort qu’il redoute et qu’il appelle pourtant de tous ses vœux.
Des soucis, des chagrins. Voici que, du vieux cimetière Saint-Vincent, les restes de sa première femme, Harriett Smithson, se trouvent expulsés. La concession de dix ans est périmée. Macabre cérémonie que celle du transfert de la pauvre Ophélia de cette demeure provisoire dans le caveau qu’il avait fait construire pour sa deuxième femme, morte en 1862. Spectacle abominablement pénible qui le bouleverse. Voici les deux femmes dormant à présent l’une près de l’autre. À quand son tour, à lui, Berlioz ? Sa place est réservée.
Parfois une bonne nouvelle, une courte, très courte joie. En mars 1864, au Concert spirituel du Théâtre-Lyrique, on exécute le Septuor des Troyens. En avril de la même année, on donne au Conservatoire la Fuite en Égypte. Mornes aumônes.
Berlioz retombe dans ses tristes pensées.
Le 2 mai 1864, gros événement : la mort de Meyerbeer. Funérailles pompeuses. Sapeurs, tambours, clairons, un bataillon de la garde nationale, les musiques du 1er grenadiers et de la gendarmerie de la garde impériale, précédant le char à six chevaux, conduisent le corps du maëstro à la gare du Nord. Le soir, représentation de gala à l’Opéra. En fera-t-on jamais autant pour lui, Berlioz ? Hélas !…
Un chroniqueur déclare : « Rossini a abdiqué, Halévy a succombé, Meyerbeer est mort sans laisser de successeur. L’art musical est sans maître. Il y a interrègne. »
Interrègne ! Et Berlioz, et Wagner, sont encore en vie !
Le fils de Berlioz, toujours marin, revient du Mexique, passe quelques jours auprès de lui. Joie d’un moment. Avec Stephen Heller, ils vont tous les trois se promener à la campagne, à Asnières. Ils reviennent par Neuilly. À la tombée du jour, le crépuscule attendrit Berlioz. De grosses larmes coulent sur ses joues.
Autre bonne surprise. La fête de l’Empereur (15 août 1864) apporte à Berlioz la croix d’Officier de la Légion d’honneur. Il se réjouit comme un enfant de cette distinction, – qu’il a du reste bien vite oubliée.
Son fils se rembarque.
De nouveau la solitude et les idées noires.
« Ma promenade favorite, écrit-il, est le cimetière Montmartre. J’y vais souvent. J’y ai beaucoup de relations… Avant-hier, j’y ai passé deux heures. J’y avais trouvé un siège très commode sur une tombe somptueuse, et je m’y suis endormi. »
Et puis, le voilà pris d’un désir irrésistible. Il veut revoir son pays, Grenoble, Vienne, l’Isère « et quelqu’un encore », son Estelle… celle que tout jeune, presque enfant, il a aimée d’un amour si frais, et déjà si profond, Estelle, son Estelle, sa Stella montis[28].
Il l’avait rencontrée pour la première fois, en 1816, dans des réunions de famille, à Meylan, – il y avait quarante-huit ans.
Il voulait revivre ce passé lointain.
À Vienne, chez son beau-frère Suat, notaire, il retrouve d’abord le cher souvenir de sa sœur qui avait laissé deux filles.
À Estressin, près de Vienne, dans la campagne du notaire, il passe une quinzaine de jours reposante. Mais il pense toujours à Estelle. Il parle d’elle à son beau-frère. Qu’est-elle devenue ? Où habite-t-elle ? Mme Estelle Fornier est-elle restée veuve ou s’est-elle remariée ?
Hector Berlioz a 61 ans. Mme Fornier va en avoir 70. Singulier regain d’amour, pense Suat, et il fait mille objections à Berlioz au sujet de la rencontre souhaitée.
Enfin, on apprend l’adresse de Mme Fornier. Elle habite Lyon, avenue des Brotteaux.
Berlioz court à Lyon, dans un état d’exaltation indescriptible. Il ose à peine se présenter chez Mme Fornier. Il s’enhardit. Il paraît devant elle : « Je ne respire plus (écrira-t-il), je ne puis parler. » Elle, avec douceur : « Nous sommes de bien vieilles connaissances, monsieur Berlioz… (Silence.) Nous étions deux enfants… (Silence.) » – « Veuillez lire ma lettre, madame. » Il lui tend un papier. Elle lit, puis répond : « Ma vie a été bien simple et bien triste. J’ai perdu plusieurs de mes enfants. J’ai élevé les autres. Mon mari est mort quand ils étaient encore en bas âge. J’ai rempli de mon mieux mon rôle de mère de famille… (Silence.) Je suis bien touchée et bien reconnaissante, monsieur Berlioz, des sentiments que vous m’avez gardés. » – « Donnez-moi votre main, madame. »
« Elle me la tendit aussitôt. Je la portai à mes lèvres et je crus sentir mon cœur se fondre et mes os frissonner. »
Mais ce n’est pas tout de même ce qu’il attendait. Il attendait plus de romanesque, des regrets, des attendrissements, du rêve. Il ne trouve que de la dignité, de la claire et froide raison. De la politesse.
Il se sauve.
De loin, il écrit : « Songez que je vous aime depuis quarante-neuf ans, que je vous ai toujours aimée malgré les orages qui ont ravagé ma vie… » Il demande la permission d’écrire, de revenir peut-être. Il devient plus pressant.
Nouvelle réponse, par lettre cette fois, de Mme Fornier :
« Je ne suis plus qu’une vieille et bien vieille femme (car, monsieur, j’ai six ans de plus que vous), au cœur flétri par des jours passés dans les angoisses, les douleurs physiques et morales de tout genre, qui ne m’ont laissé sur les joies et les sentiments de ce monde aucune illusion. Depuis vingt ans que j’ai perdu mon meilleur ami, je n’en ai pas cherché d’autre.
« Depuis le jour fatal où je suis devenue veuve, j’ai rompu toutes mes relations, j’ai dit adieu aux plaisirs, aux distractions, pour me consacrer tout entière à mon intérieur, à mes enfants. C’est donc là ma vie depuis vingt ans. C’est une habitude pour moi dont rien maintenant ne peut rompre le charme, car c’est dans cette intimité du cœur que je puis trouver le seul repos des jours qu’il me reste à passer dans ce monde. Tout ce qui viendrait en troubler l’uniformité me serait pénible et à charge…
« Je crois devoir vous dire qu’il est des illusions, des rêves, qu’il faut savoir abandonner quand les cheveux blancs sont arrivés, et, avec eux, le désenchantement de tous les sentiments nouveaux, même ceux de l’amitié, qui ne peuvent avoir du charme que lorsqu’ils sont nés de relations suivies et dans les heureux jours de la jeunesse…
« Vous êtes encore bien jeune par le cœur. Pour moi, il n’en est pas ainsi. Je suis vieille tout de bon. »
Triste leçon que Berlioz reçoit péniblement. Il ne sent dans la réponse de Mme Fornier que de l’étonnement, de la crainte, peut-être de la pitié, et rien des souvenirs émus qu’il espérait.
N’importe ! Il s’accroche en désespéré à son impossible rêve : recommencer un instant exquis de sa jeunesse, reprendre où il l’avait laissée la suite d’une idylle d’enfance. Cela l’aide à ne pas mourir. Il est moins sombre. Il a presque des instants de gaîté.
Liszt passe à Paris. Il dîne deux fois avec lui, tout à la joie de retrouver ce vieux camarade.
Il ne s’enferme plus tant chez lui. Il sort un peu. Il se rend aux soirées intimes des Damcke, des Massart où il se rencontre avec d’Ortigue et Stephen Heller. On lui fait lire à haute voix Hamlet ou Othello. Il se passionne pour ces lectures, s’abandonne à tous les sentiments violents qu’elles provoquent en lui et qui vont jusqu’aux larmes.
Durant une fête donnée en son honneur chez le docteur Blanche, Gounod se met au piano, et de sa jolie voix chante la chanson d’Hylas et, avec une partenaire de bonne volonté, le duo Nuit d’ivresse des Troyens.
Il passe des soirées incomparables à écouter Joachim interpréter les trios et les quatuors de Beethoven.
Mais les mauvais jours, les mauvaises nuits surtout, revenaient souvent.
Les Mémoires sont terminés et imprimés. Il veut en porter un exemplaire à Mme Fornier. Il part pour Genève, où elle se trouve. Cruelle rencontre où il s’entend redire les atroces vérités de sagesse et de raison qu’il redoutait.
Il revint à Paris. Malgré le choléra qui sévit, on n’y parle que de Meyerbeer, de sa gloire, de son génie et de son dernier « chef-d’œuvre », l’Africaine. À l’Institut, Berclé prononce son éloge. Il le met au-dessus de Chateaubriand et de Byron. Il proclame que « l’éclectisme est le trait dominant du XIXe siècle ». Mais il rappelle. « l’immense fortune » du célèbre compositeur, ses « sacrifices calculés, la critique désarmée, ses ennemis convertis en adulateurs », en protestant contre de tels propos injurieux… Berlioz, qui sait les nécessités de l’éloge académique, sourit.
Meyerbeer et Offenbach, voilà les dieux du jour.
De lui-même, Berlioz, de sa musique, que restera-t-il après lui ? Il se le demande avec angoisse. Trop originale, trop personnelle, il a peur qu’elle ne disparaisse avec la génération de 1830.
Il a perdu, – s’il l’a jamais possédée, – la foi dans son art.
Il croit ses partitions définitivement ensevelies dans la poussière des bibliothèques.
C’est à ces tristes pensées qu’il se laisse aller, désespéré, dans ce lit de souffrances où il reste couché, seize à dix-huit heures sur vingt-quatre.
Or, voici qui le remet pour quelque temps sur pied. Carvalho lui demande de « présider aux études » d’Armide pour le Théâtre-Lyrique. Mme Charton-Demeur, la Didon des Troyens, vient répéter rue de Calais. Saint-Saëns l’accompagne.
« Saint-Saëns, un grand pianiste, un grand musicien qui connaît son Gluck presque comme moi, écrit Berlioz. C’est quelque chose de curieux de voir cette pauvre femme patauger dans le sublime et son intelligence s’éclairer peu à peu. Ce matin, à l’acte de la Haine, Saint-Saëns et moi, nous nous sommes serré la main. Nous étouffions… Et dire que l’on blasphème partout ce chef-d’œuvre. On l’éventre, on l’embourbe, on le vilipende, on l’insulte partout : les chanteurs, les directeurs, les chefs d’orchestre, les éditeurs, tous !…
« … Depuis qu’on m’a ainsi replongé dans la musique, mes douleurs ont à peu près disparu. Je me lève maintenant chaque jour, comme tout le monde. »
Et puis une vraie joie : un dimanche, Pasdeloup affiche le Septuor des Troyens, et en même temps la marche nuptiale de Lohengrin et la marche de Tannhäuser. Berlioz se dissimule parmi les auditeurs. Le septuor est acclamé. On le bisse. Et on reconnaît Berlioz sur un gradin. On le force à se lever. « Vive Berlioz !… Levez-vous ! On veut vous voir ! Levez-vous ! » On l’entoure, on lui prend les mains. Il sanglote. À la sortie, sur le boulevard, on lui fait cortège. Le lendemain un flot de lettres, des articles de presse…
Pauvre grand homme ! Il en est bouleversé. Mais son bonheur ne dure pas. Gloire presque posthume. « Et le reste de mon œuvre ? Que deviendra-t-il ? »
Cependant on fête Liszt et sa Messe de Gran. 50.000 francs de recette à Saint-Eustache. Formidable succès : un crève-cœur pour Berlioz.
Maintenant l’Opéra demande à Berlioz de surveiller les études d’Alceste : « Que c’est beau ! s’écrie-t-il… Nous pleurons tous comme des cerfs aux abois… Quelle hauteur monumentale d’inspiration ! » Berlioz se sent tout réconforté. À l’Opéra, il rencontre Ingres qui partage son exaltation.
En Autriche, à Vienne, on annonce l’audition intégrale de la Damnation. Les Amis de la Musique l’invitent.
Malgré sa mauvaise santé, malgré la rigueur du froid de décembre (1866), Berlioz part. Ce voyage le fatigue horriblement. Il arrive brisé.
Mais le contact de son œuvre le ranime. Il veut la diriger. Il la dirige avec une fougue, un entrain, une jeunesse extraordinaires. Le 16 décembre, dans la salle de la Redoute, on a réuni plus de 300 exécutants. Le « vieillard légendaire » paraît. Accueil sans précédent : « On m’a rappelé plus de dix fois, écrit-il. Applaudissements interminables. Succès à perdre la tête… C’est le plus grand succès de ma vie… » Grand banquet. Toasts en plusieurs langues. Le chef ordinaire, Herbeck, conclut ainsi : « Salut à l’homme qui a frayé de nouveaux chemins dans l’art, qui, au lendemain de la mort de Beethoven avant 1830, assomme les musiciens bourgeois à l’œil terne… et qui lutte depuis et se débat parmi les infortunes et les misères de la vie. Je bois au génie d’Hector Berlioz ! »
Lui s’écrie : « Une de mes partitions est sauvée ! »
Mais en Autriche, les « éreintements » de la critique commencent contre Berlioz et contre la musique de l’avenir, contre le trio Berlioz, Liszt, Wagner. Le fameux Hanslick est à la tête du mouvement.
Retour à Paris. Nouveau projet ; livrer bataille à Cologne, cette fois. Tâcher de gagner du terrain. Ne pas se laisser oublier.
Il fait un froid abominable. On traverse la Seine à pied : elle est gelée. Berlioz part tout de même pour Cologne. On joue Harold en entier. On chante le duo de Béatrice et Bénédict (26 février 1867). Gros applaudissements.
À son retour à Paris, le succès de Roméo de Gounod le fait souffrir.
Et voilà qu’il apprend la mort de son fils, emporté par la fièvre jaune, à la Havane, à 33 ans. Il l’apprend le jour même où le pianiste Ritter préparait une petite fête intime en son honneur. Berlioz s’effondre. Plus de sommeil. Et tout de même, dans la somnolence, des cauchemars.
Les médecins l’envoient à Néris. Le traitement le rend plus malade.
Il signe cependant un contrat avec la grande duchesse Hélène de Russie qui l’engage pour cinq concerts classiques et un concert de ses œuvres. Il part pour Saint-Pétersbourg.
« Le voyage d’un agonisant. »
Exécution « foudroyante » de la Fantastique. « Je suis malade, avoue-t-il, malade comme dix-huit chevaux, je tousse comme six ânes morveux. » Malgré tout, il parle avec enthousiasme de ses concerts.
À Paris, revient un cadavre.
Et maintenant, c’est l’agonie, l’agonie qui dure des mois.
Le 8 mars 1869 à midi et demi finit enfin cet interminable supplice, et cette lutte acharnée contre l’oubli, – l’oubli de soi et de son œuvre.
Reyer veille ses restes.
Funérailles décentes.
Un incident : « On approchait du cimetière. Tout à coup les chevaux s’emportent, bousculent les musiciens qui les précèdent. Et le corbillard se précipite vers l’enclos des tombes, comme si le héros romantique voulait entrer seul dans la cité souterraine où tant de voix l’appellent depuis longtemps. »
Sur la tombe, discours usuels, banals, odieux.
*
La vie du pauvre Berlioz, cette vie infiniment pénible et malheureuse est close. Elle se termine sans qu’il ait jamais connu la gloire, la gloire véritable, celle qui s’attache à vous, qui vous suit, vous entoure et ne vous quitte plus, qui n’a point d’intermittence ni de manque et vous laisse espérer une réelle immortalité. Personne de ses contemporains n’a senti l’immense valeur de ses chefs-d’œuvre. Personne n’en a prévu l’avenir. Il était pourtant en France le plus grand homme, le plus grand musicien, du moins, de cette époque qui s’achève à la veille de 1870. On ne s’en doutait pas. Il a fallu qu’il fût disparu pour que tout d’un coup son nom devînt l’égal des plus renommés, pour que ses ouvrages fussent sans cesse réclamés, non seulement par les connaisseurs, mais par la foule, dans tous les concerts, pour que la Damnation devînt un des spectacles les plus suivis de notre Opéra.
Berlioz n’a en rien joui de ses créations. Mais il préparait l’éclosion et l’épanouissement de cette magnifique école française de musique symphonique qui se produisirent à partir de 1871, au sein de la Société nationale de Musique.
Il semblait du moins les avoir préparées.
Là, pourtant, il fallait qu’on se montrât encore injuste envers lui. Car, des grands artistes que vit naître et se développer la Société nationale, aucun ne se réclama de lui, – sauf Saint-Saëns. Tous les autres furent des ingrats, qui ne s’aperçurent en rien de la leçon qu’ils avaient reçue de l’auteur de la Fantastique. Ou plutôt, ils cherchèrent leur leçon, leur enseignement ailleurs, auprès des Franck et des Wagner, jusqu’au jour où un Fauré, un Debussy les libérèrent. Et alors, ils s’aperçurent peut-être que Berlioz aurait eu quelque chose à leur dire. À moins qu’ils n’aient tout de suite reconnu que l’originalité de ce Maître allait jusqu’à tel point qu’elle ne pouvait en rien servir d’exemple.
Qu’il reste donc isolé, ce pauvre grand génie incomparable, d’une espèce, d’une sorte que ne connut jamais aucun autre peuple et dont la lumière éclatante, mais insolite, ne pouvait resplendir que sur la terre de France.
Paul LANDORMY.
Cernoy-en-Berry, le 7 septembre 1943.
LISTE PAR DATES DE NAISSANCE DES COMPOSITEURS ET DES INSTITUTIONS ARTISTIQUES CITÉS DANS CE LIVRE.
1668. François Couperin
1683. Jean-Philippe Rameau
1685. Jean-Sébastien Bach
1711. Armand Trial
1714. Christophe Gluck
1726. François Philidor
1729. Pierre Monsigny
1732. François-Joseph Haydn
1733. François-Joseph Gossec
1734. Antonio Sacchini
1741. André Grétry – J.-P. Schwarzendorf dit Martini – Giovanni Paisiello
1751. Jean-Baptiste Lemoyne
1752. Nicolas Zingarelli
1753. Dalayrac
1756. Wolfgang Mozart
1758. Bernardo Porta
1760. Salvador Cherubini
1763. Jean-François Lesueur
1763. Étienne-Nicolas Méhul
1765. Bernard Sarrette
1766. Rodolphe Kreutzer
1767. Pierre Berton
1770. Louis Beethoven – Étienne Fay – Guillaume Lekeu
1773. Charles-Simon Catel
1774. Gasparo Spontini
1775. François-Adrien Boieldieu
1782. Daniel-François-Esprit Auber
1784. Nicolo Paganini
1786. Charles-Marie Weber
1789. Franz Liszt
1791. Louis-Joseph Hérold – Giacomo Meyerbeer
1792. Gioacchino Rossini
1793. Institut national de Musique
1795. Conservatoire
1797. Gaetano Donizetti – Franz Schubert
1799. Jacques-Fromental Halévy
1802. Vincenzo Bellini
1803. Adolphe Adam – Hector Berlioz
1809. Félix Mendelssohn
1810. Frédéric Chopin – Félicien-César David – Robert Schumann
1811. Franz Liszt – Ambroise Thomas
1813. Richard Wagner
1814. Stephen Heller
1818. Charles Gounod
1819. Jacques Offenbach
1822. César Franck – Victor Massé
1825. Florimond Ronger, dit Hervé
1830. Hans Guido de Bülow
1832. Charles Lecocq
1838. Georges Bizet
1845. Gabriel Fauré
1857. Julien Tiersot
1860. Hugo Wolf
1862. Claude Debussy
1864. Richard Strauss
1871. Société nationale de Musique
TABLE ALPHABÉTIQUE DES COMPOSITEURS ET DES INSTITUTIONS MUSICALES CITÉS DANS CE LIVRE.
Adam (Adolphe)
Auber (Daniel-François-Esprit)
Bach (Jean-Sébastien)
Beethoven (Louis)
Bellini (Vincenzo)
Berlioz (Hector)
Berton (Pierre)
Bizet (Georges)
Boieldieu (François-Adrien)
Catel (Charles-Simon)
Cherubini (Salvador)
Chopin (Frédéric)
Conservatoire
Couperin (François)
Dalayrac (Nicolas)
David (Félicien-César)
Debussy (Claude)
Donizetti (Gaetano)
Fauré (Gabriel)
Fay (Étienne)
Franck (César)
Gluck (Christophe)
Gossec (François-Joseph)
Gounod (Charles)
Grétry (André)
Halévy (Jacques-Fromental-Élie)
Hans de Bülow (Guido)
Haydn (François-Joseph)
Heller (Stephen)
Hérold (Louis-Joseph-Ferdinand)
Hervé (Florimond Ronger dit)
Institut national de Musique
Kretzschmar (Hermann)
Kreutzer (Rodolphe)
Lecocq (Charles)
Lekeu (Guillaume)
Lemoyne (Jean-Baptiste)
Lesueur (Jean-François)
Liszt (Franz)
Martini (J. -P. Schwarzendorf dit)
Massé (Victor)
Méhul (Étienne-Nicolas)
Mendelssohn (Félix)
Meyerbeer (Giacomo)
Monsigny (Pierre)
Mozart (Wolfgang)
Offenbach (Jacques)
Paganini (Nicolo)
Paisiello (Giovanni)
Philidor (François)
Porta (Bernardo)
Rameau (Jean-Baptiste)
Rossini (Gioacchino)
Sacchini (Antonio)
Sarrette (Bernard)
Schubert (Franz)
Schumann (Robert)
Société nationale de Musique
Spontini (Gasparo)
Strauss (Richard)
Thomas (Ambroise)
Tiersot (Julien)
Trial (Armand)
Wagner (Richard)
Weber (Charles-Marie)
Wolf (Hugo)
Zingarelli (Nicolas)
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Décembre 2013
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : BrussLimat, YvetteT, Jean-Marc, Jean-LucT, PatriceC, Coolmicro.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.