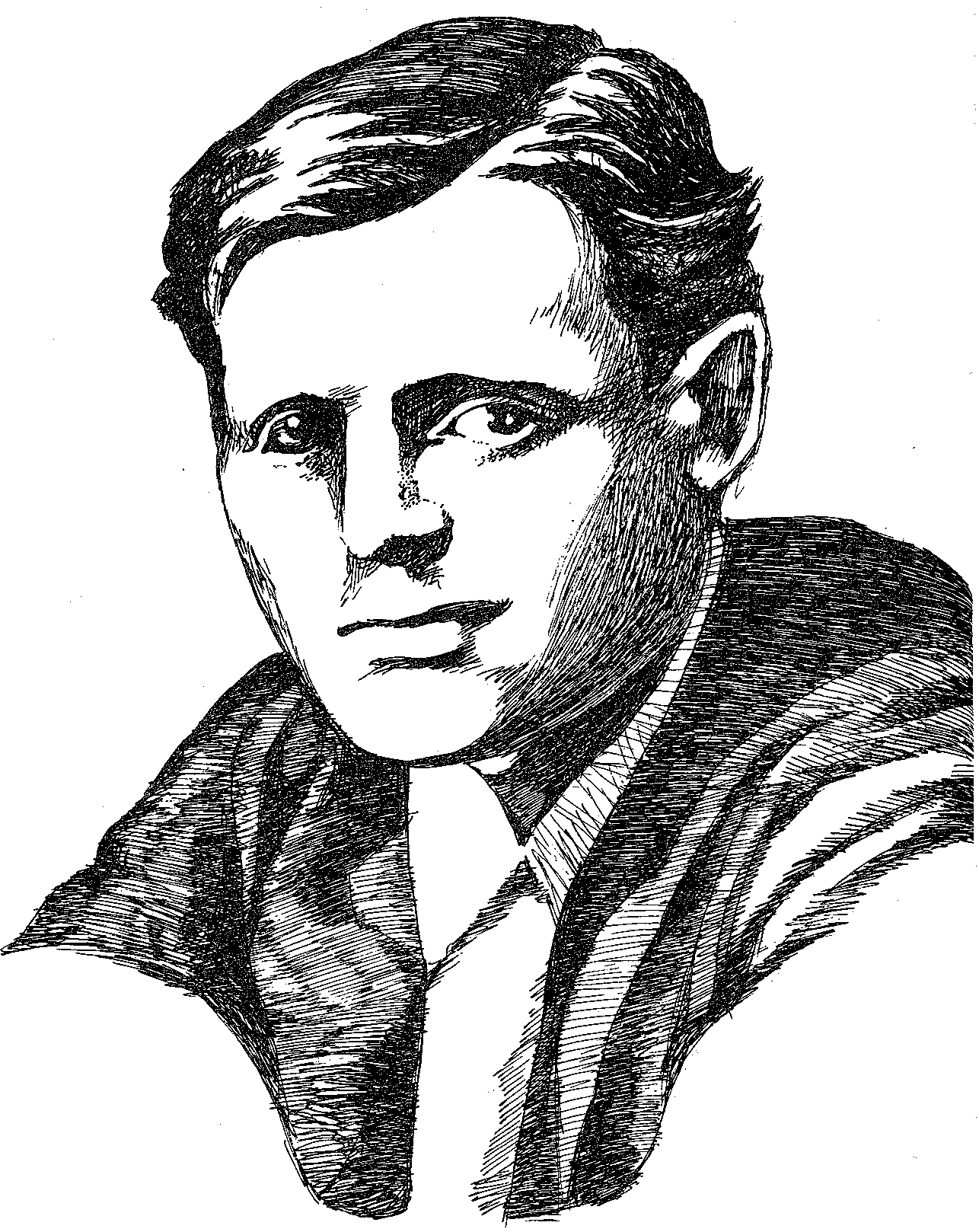
Jack London
MARTIN EDEN
(1909)
Traduction de Claude Cendrée
Table des matières
À propos de cette édition électronique
1
Arthur ouvrit la porte avec son passe-partout et entra, suivi d’un jeune homme qui se découvrit d’un geste gauche. Il portait de grossiers vêtements de marin qui détonnaient singulièrement dans ce hall grandiose. Sa casquette l’embarrassant beaucoup, il allait la glisser dans sa poche, quand Arthur la lui enleva des mains. Ce geste fut si naturel, que le jeune homme intimidé en apprécia l’intention. « Il comprend !… se dit-il, il va m’aider à m’en tirer ! »
Il marchait sur les talons de l’autre, en roulant des épaules et ses jambes s’arc-boutaient malgré lui sur le parquet, comme pour résister à un roulis imaginaire. Les grands appartements semblaient trop étroits pour sa démarche et il mourait de peur que ses larges épaules n’entrent en collision avec l’encadrement des portes ou avec les bibelots des étagères. Il s’écartait brusquement d’un objet pour en fuir un autre et s’exagérait les périls qui en réalité n’existaient que dans son imagination. Entre le piano à queue et la grande table centrale sur laquelle d’innombrables livres s’empilaient, une demi-douzaine de personnes auraient pu marcher de front ; cependant, il ne s’y risqua qu’avec angoisse. Il ne savait que faire de ses mains, ni de ses bras qui pendaient lourdement à ses côtés et, quand son esprit terrifié lui suggéra la possibilité de frôler du coude les livres de la table, il fit un brusque écart qui faillit lui faire renverser le tabouret du piano. L’allure aisée d’Arthur le frappa et, pour la première fois, il se rendit compte que la sienne différait de celle des autres hommes. Une petite honte le mordit au cœur – il s’arrêta pour éponger son front où la sueur perlait.
– Un instant, Arthur, mon vieux ! dit-il, en essayant de masquer son angoisse. Vrai ! c’est trop à la fois pour moi !… Donnez-moi le temps de me remettre. Vous savez que je ne voulais pas venir… et je suppose que votre famille ne mourait pas d’envie de me voir !…
– Ça va bien ! répondit Arthur d’une voix rassurante. N’ayez pas peur : nous sommes de braves gens tout simples… Tiens ! une lettre pour moi.
Arthur vint à la table, déchira l’enveloppe et se mit à lire, donnant ainsi à l’étranger le temps de se ressaisir. Et l’étranger comprit et lui en sut gré. Cette compréhensive sympathie le mit à l’aise. Il épongea de nouveau son front moite et lança de furtifs regards autour de lui ; son visage avait repris son calme, mais ses yeux avaient l’expression des animaux sauvages pris au piège. Il était environné de mystère, plein d’appréhension de l’inconnu, sans savoir ce qu’il devait faire ; conscient de sa gaucherie, il craignait que tout en lui ne soit également déplaisant. Il était sensitif à l’excès, toujours sur ses gardes, et les coups d’œil amusés que l’autre lui lançait furtivement par-dessus la lettre, le piquaient comme autant de coups d’épingles ; mais il ne bronchait pas, car, parmi les choses qu’il avait apprises, il y avait la discipline de soi. Puis, ces coups d’épingles atteignirent son orgueil : tout en maudissant l’idée qu’il avait eue de venir, il résolut de supporter l’épreuve, coûte que coûte. Les traits de son visage durcirent et dans ses yeux s’alluma une lueur combative. Il regarda autour de lui plus librement, observant tout avec acuité et chaque détail du bel intérieur se grava dans son esprit. Rien n’échappa au champ visuel de ses yeux largement ouverts ; devant tant de beauté, leur éclat combatif s’éteignit et fut remplacé par une chaude lueur : car il était sensible à la beauté.
Un tableau accrocha son regard et le retint. Il représentait un rocher assailli par une mer en furie, des nuages de tempête couvraient le ciel bas ; par-delà la barre, toute mâture serrée et donnant tellement de la bande que chaque détail du pont apparaissait – un schooner se détachait sur un coucher de soleil dramatique. C’était une belle chose et elle l’attira irrésistiblement. Il oublia sa démarche maladroite, s’approcha davantage du tableau… et toute beauté disparut de la toile. Ahuri, il observa ce qui lui semblait à présent un barbouillage quelconque, puis recula. Et la magique splendeur reparut. « C’est un trompe-l’œil », se dit-il – et il n’y pensa plus. Pourtant, il ressentit un peu d’indignation ; en effet, comment tant de beauté pouvait-elle être sacrifiée à un trompe-l’œil ? Il n’y connaissait pas grand-chose en peinture. Son éducation artistique s’était faite sur des chromos ou des lithographies, dont les contours – nets et définis – étaient les mêmes vus de près ou de loin.
Il est vrai qu’il avait vu des peintures à l’huile à la devanture des boutiques, mais les glaces l’avaient empêché d’approcher d’assez près.
Il lança un regard vers son ami qui lisait toujours sa lettre et vit les livres sur la table. Dans ses yeux s’alluma une convoitise ardente, semblable à celle d’un homme mourant de faim, à la vue d’un morceau de pain. Une enjambée l’amena à la table, où il se mit à manipuler les livres. D’un regard caressant, il passa en revue les titres et les noms des auteurs. Par-ci par-là il lut certains passages et soudain reconnut un livre qu’il avait lu autrefois. Puis, il tomba sur un volume de Swinburne qu’il se mit à lire attentivement, sans plus penser à l’endroit où il se trouvait. Son visage rayonnait. À deux reprises il retourna le volume pour voir le nom de l’auteur… « Swinburne ». Il n’oublierait pas ce nom-là. Cet homme savait voir : quel sentiment de la couleur ! Quelle lumière !… Mais qui était ce Swinburne ? Était-il mort depuis des siècles, comme tant de poètes ? ou bien vivait-il, écrivait-il encore ?… Il retourna au titre : oui, il avait écrit d’autres livres. Eh bien ! dès le lendemain matin, à la bibliothèque gratuite, il tâcherait de mettre la main sur un ouvrage de ce type-là. Puis il se replongea dans le texte et s’y oublia, si bien qu’il ne remarqua pas qu’une jeune femme était entrée. Il ne le sut qu’en entendant la voix d’Arthur qui disait :
– Ruth, voilà M. Eden.
Son doigt marquait encore la page du livre refermé et, avant même de se retourner, il tressaillit – moins peut-être à l’apparition de la jeune fille, qu’aux paroles prononcées par son frère. Ce corps d’athlète cachait une sensibilité extraordinairement développée. Au moindre choc, ses pensées, ses sympathies, ses émotions s’élançaient, bondissantes comme des flammes vives. Étonnamment réceptif, il avait son imagination toujours en éveil qui travaillait sans cesse à établir les rapports entre les causes et les effets. « M. Eden » – ces mots l’avaient frappé – lui que toute sa vie on avait appelé « Eden » ou « Martin Eden », ou « Martin » tout court. « Monsieur » !… quelle chose incongrue ! – Dans son cerveau changé en une vaste chambre noire, défilèrent d’innombrables tableaux de sa vie – chambres de chauffe et gaillards d’avant, campements et rivages, prisons et tavernes, hôpitaux et ruelles sordides – dont l’association se faisait lorsqu’il songeait à la façon dont son nom avait été prononcé dans ces divers endroits.
Puis, il se retourna et vit la jeune fille ; les fantasmagories de son cerveau disparurent. C’était une créature éthérée, pâle, auréolée de cheveux d’or, aux grands yeux bleus immatériels. Il ne vit pas comment elle était vêtue : il vit seulement que sa robe était aussi merveilleuse qu’elle. Et il la compara à une fleur d’or pâle sur une tige fragile. Non ! c’était un esprit, une divinité, une idole !… Une aussi sublime beauté n’appartenait pas à la terre. Ou bien les livres avaient raison et il y en avait beaucoup comme elle, dans les sphères supérieures de la vie. Swinburne aurait pu la chanter. Peut-être pensait-il à un être semblable quand il écrivit son Yseult. Une surabondance de visions, de sentiments, de pensées l’assaillit à la fois. Il la vit tendre le bras et elle le regarda droit dans les yeux en lui donnant une franche poignée de main, comme un homme. Les femmes qu’il avait connues ne donnaient pas la main ainsi : par le fait la plupart ne la donnaient pas du tout. Un flot de souvenirs l’envahit – mais il les chassa au loin et la regarda. Jamais il n’avait vu de femme semblable ! Quand il songeait à toutes celles qu’il avait connues !… Pendant une seconde qui lui parut éternelle, il se figura être transporté au milieu d’une galerie de portraits. Au centre trônait l’image de Ruth, et toutes devaient subir l’épreuve de la comparaison. Il vit les chlorotiques visages des ouvrières d’usines et les filles niaises et bruyantes de South Market, les gardiennes de bétail des « ranches » et les femmes basanées du vieux Mexico qui fumaient leur éternelle cigarette. Les Japonaises les remplacèrent – de vraies poupées trottinant sur leurs socques de bois ; puis les Eurasiennes, aux traits délicats et dégénérés ; et les filles des mers du Sud couronnées de fleurs aux beaux corps bruns.
Puis tout cela fut effacé par un fourmillement de cauchemar grotesque et terrible – et ce furent les abjectes créatures du trottoir de Whitechapel, traînant leurs savates, les mégères bouffies de gin des mauvais lieux et la foule diabolique de ces harpies à la parole ordurière, qui jouent le rôle de femelles auprès des matelots – proies faciles – et qui sont la raclure des ports et la lie de la plus basse humanité.
– Vous ne voulez pas vous asseoir, monsieur Eden ? dit la jeune fille. Je désirais vous voir depuis qu’Arthur nous a tant parlé de vous. Comme vous avez été courageux !
Il fit un geste de dénégation et murmura qu’il n’avait rien fait du tout et que n’importe qui aurait agi de même. Elle remarqua que ses deux mains étaient couvertes d’abrasions non guéries encore, qu’une cicatrice barrait sa joue ; une autre sur le front, se perdait dans les cheveux, une troisième disparaissait à demi sous le col empesé. Elle réprima un sourire à la vue de la raie rouge produite par le frottement du col contre le cou bronzé : évidemment, il n’avait pas l’habitude de porter des cols durs. Son œil féminin enregistra également les vêtements bon marché, mal coupés, les faux plis du veston et ceux des manches, qui cachaient mal les biceps saillants.
Tout en protestant qu’il n’avait rien fait du tout, il obéissait à son invitation et se dirigea gauchement vers une chaise en face d’elle. Avec quelle aisance elle s’asseyait !… Ce lui était une impression nouvelle. De toute son existence, il ne s’était jamais demandé s’il était désinvolte ou gauche.
Il s’assit soigneusement sur le bord de sa chaise, très embarrassé de ses mains. Partout où il les mettait, elles étaient gênantes. Arthur quitta la pièce et Martin Eden le suivit d’un regard d’envie. Il se sentait perdu, tout seul, dans ce salon, avec cette femme-esprit. Il n’y avait, hélas ! pas le moindre barman à qui demander des boissons, pas de petit groom à envoyer au coin de la rue acheter une bouteille de bière, afin d’établir d’emblée un courant de sympathie.
– Quelle cicatrice vous avez au cou, monsieur Eden ! dit la jeune fille. Comment ça vous est-il arrivé ? Dans une aventure, j’en suis sûre !
– Un Mexicain, avec son couteau, mademoiselle ! répondit-il. (Il passa sa langue sur ses lèvres sèches et toussa pour s’éclaircir la voix.) Dans une bagarre. Quand je lui ai enlevé son couteau, il a essayé de m’arracher le nez avec ses dents.
C’était mal dit. Mais devant ses yeux passa la vision somptueuse de cette chaude nuit étoilée, à Salina Cruz : la longue plage blanche, les lumières des steamers chargés de sucre, amarrés au port, les voix des matelots ivres dans le lointain, la bousculade des « stevadores », la lueur féline des yeux des Mexicains, et soudain, la morsure de l’acier à son cou, le ruissellement du sang, la foule et les cris. Les deux corps – le sien et celui du Mexicain – enlacés, roulant dans le sable qui volait et – venant d’on ne savait où – le mélodieux tintement d’une guitare. Tel était le tableau – et il vibra en évoquant ce souvenir. L’artiste qui avait peint le schooner, là-bas sur le mur, saurait-il aussi peindre ça ?… Il pensa que la plage blanche, les étoiles, les lumières des steamers seraient superbes et aussi, sur le sable, le groupe sombre entourant les combattants. Le couteau également ferait bien, il brillerait dans un éclair, sous la lumière des étoiles ! Mais de tout cela, rien ne transparut dans ses paroles.
– Il a essayé de m’arracher le nez avec ses dents, conclut-il.
– Oh ! fit la jeune fille d’une voix faible. (Il remarqua la contraction de ses traits délicats.)
Lui-même ressentit un choc ; une rougeur d’embarras envahit ses joues hâlées, son visage brûla comme s’il avait été exposé à la fournaise de la chaufferie. Évidemment, des rixes au couteau n’étaient pas des sujets de conversation pour une dame ; c’était trop sordide.
Dans ce monde-là, les gens dont parlent les livres n’abordent pas de sujets semblables – peut-être même les ignorent-ils.
La conversation qu’ils s’efforçaient de faire démarrer, subit un petit arrêt. Puis elle le questionna sur la cicatrice de sa joue. Il se rendit compte qu’elle faisait un effort pour se mettre à son niveau. « Je veux me mettre au sien ! » décida-t-il en pensée.
– Ce n’est qu’un accident, dit-il en désignant sa joue. Une nuit, par grosse mer, le bout-dehors du grand mât a été arraché et aussi le palan. Le bout-dehors était en fil d’acier et il se tortillait en l’air comme un serpent. Tous les hommes de garde tâchaient de l’attraper. Alors, je me suis jeté dessus et je me suis esquinté.
– Oh ! dit-elle – cette fois avec un accent de compréhension, mais, dans le fond, son explication était de l’hébreu pour elle et elle se demandait ce que pouvait être un « bout-dehors ».
– Ce poète, Swinburne, reprit-il, suivant son idée, il y a longtemps qu’il est mort ?
– Non, je ne l’ai pas entendu dire ! (Elle le regarda avec curiosité.) Où avez-vous fait sa connaissance ?
– Moi ?… je ne sais même pas comment il est fait. Mais avant que vous n’entriez, je venais de lire quelques vers de lui, dans ce livre, là, sur la table. Vous aimez la poésie ?
Alors, elle se mit à parler, avec vivacité et naturel, sur le sujet qu’il avait lancé. Il se sentit mieux et s’enfonça un peu plus dans son siège auquel il s’agrippait des deux mains, de peur qu’il ne se dérobe sous lui. Enfin, il était parvenu à la faire parler et, pendant qu’elle bavardait, il tâchait de la suivre ; il s’émerveillait de toute la science emmagasinée dans cette jolie tête et s’imprégnait de la pâle beauté de son visage. Il arrivait à la suivre mais était gêné par les locutions inconnues qu’elle employait, par ses critiques et par le processus de sa pensée – toutes choses qui lui étaient étrangères, mais qui cependant stimulaient son esprit et le faisaient vibrer. « C’est ça, la vie intellectuelle ! se disait-il, la beauté intense et merveilleuse ! » Il s’oublia et la dévora des yeux. Vivre pour une femme pareille !… pour la gagner, pour la conquérir – et… mourir pour elle. Les livres avaient raison : de telles femmes existaient – elle en était une. Elle donnait des ailes à son imagination et de grandes toiles lumineuses se déployaient devant lui, tissées de vagues et gigantesques silhouettes d’amour, de poésie et de gestes héroïques accomplis pour une femme – pour une femme pâle comme une fleur d’or. Et, à travers la vision miroitante, palpitante – comme à travers un mirage féerique – il regardait avidement la femme réelle, assise auprès de lui qui parlait de littérature et d’art. Il la regardait fiévreusement, sans se rendre compte de la fixité de son regard et du fait que toute la masculinité de sa nature luisait dans ses yeux. Mais elle, qui savait peu de choses des hommes, sentait la brûlure de ce regard. Jamais aucun homme ne l’avait dévisagée de cette manière – et cela la troubla. Gênée, elle s’interrompit au milieu d’une phrase, le fil de ses idées était coupé net. Il l’effrayait et en même temps, elle trouvait agréable d’être regardée ainsi. Son éducation l’avertissait d’un danger et d’une tentation mauvaise, subtile, mystérieuse. D’autre part, parcourant tout son être, son instinct l’induisait à rejeter l’esprit de caste et à séduire cet habitant d’un autre monde, ce rude jeune homme aux mains abîmées, au cou marqué à vif par le frottement inaccoutumé d’un faux col et qui, trop évidemment, était souillé, dégradé par une pénible existence. Elle était pure et son sens de la propreté morale se révoltait – mais elle était femme et elle commençait à apprendre les paradoxes de la femme.
– Comme je vous le disais… Mais que vous disais-je donc ? (Elle s’arrêta court et rit de son étourderie.)
– Vous disiez que cet homme – Swinburne – n’a pas été un grand poète, parce que… et vous n’êtes pas allée plus loin, mademoiselle, dit-il avec empressement. (Il se sentit tout à coup une sorte de faim et de délicieux petits frissons montaient et descendaient le long de son épine dorsale en écoutant le son de son rire.)
« Comme en argent ! se dit-il. – Comme un carillon de sonnettes d’argent. »
Et à l’instant – et pour un instant seulement – il se sentit transporté dans un pays lointain, où, sous des cerisiers en fleur, il fumait une cigarette, en écoutant les clochettes d’une pagode pointue appelant à la prière les fidèles aux sandales de raphia.
– Oui, merci, dit-elle. Swinburne nous déçoit, en somme, parce que, mon Dieu… il manque de délicatesse. Beaucoup de ses poèmes ne devraient même pas être lus. Un vraiment grand poète n’écrit pas une ligne qui ne soit pleine de vérité et ne s’adresse à tout ce qui est noble et pur en vous. On ne devrait pouvoir supprimer aucune ligne d’un grand poète sans occasionner une irréparable perte pour le patrimoine commun !
– Ça m’a paru beau, dit-il, en hésitant, le peu que j’en ai lu. Je ne me doutais pas que c’était un… individu aussi peu recommandable. Je suppose que ça ressort mieux dans ses autres livres.
– Dans le volume que vous lisiez, il y a bien des choses qui auraient pu être évitées, dit-elle d’une voix nette, dogmatique.
– Je dois les avoir manquées, affirma-t-il. Ce que j’ai lu était épatant. C’était lumineux, brillant et ça m’a traversé, ça m’a chauffé comme le soleil et éclairé comme un projecteur. Voilà l’effet que ça m’a fait… Mais il se peut bien que je ne connaisse pas grand-chose à la poésie, mademoiselle.
Il s’arrêta, car il était gêné. Il était confus, terriblement conscient de son inaptitude à s’exprimer. Il sentait la grandeur, l’intensité de ce qu’il avait lu, mais les mots n’obéissaient pas à sa pensée, il ne pouvait décrire ce qu’il ressentait et se compara lui-même à un matelot, perdu par une nuit sombre sur une mer inconnue, et manœuvrant à l’aveuglette. Eh bien ! décida-t-il, c’était à lui de s’habituer à ce nouveau monde. Il n’y avait rien dont il ne fût venu à bout quand il le voulait et il était temps d’apprendre à dire ce qu’il sentait en lui, pour qu’Elle le comprenne. « Elle » remplissait déjà tout son horizon.
– Parlons à présent de Longfellow, dit-elle.
– Oui, j’ai lu, interrompit-il vivement, désireux de faire valoir son petit bagage littéraire et de lui montrer qu’il n’était pas absolument un imbécile. Le Psaume de la Vie, Excelsior et… Je crois que c’est tout.
Elle hocha la tête, sourit et il sentit que son sourire était condescendant, plein de pitié. Il était idiot d’essayer de se faire valoir sur ce sujet. Ce Longfellow devait avoir écrit quantité d’autres choses.
– Excusez-moi, mademoiselle, de parler à tort et à travers. En réalité je ne connais pas grand-chose dans ce domaine. Ce n’est pas de mon bord. Mais je vais m’arranger pour que ça le devienne.
Ça sonna comme une menace. Sa voix était résolue, ses yeux lançaient des éclairs, ses traits s’étaient durcis. Elle vit que sa mâchoire se crispait : les angles en étaient devenus agressifs. Au même moment, une virilité intense parut émaner de lui, ce qui la troubla.
– Je crois que vous pourriez y arriver, conclut-elle en riant. Vous êtes très fort !
Un instant son regard fixa la nuque de taureau puissamment musclée, bronzée par le soleil, impressionnante de santé et de force. Et bien qu’il se tînt assis humblement, rougissant de nouveau, elle se sentit attirée vers lui. Une pensée folle lui traversa l’esprit. Il lui sembla qu’en mettant ses deux mains sur cette nuque, toute cette force et cette santé passeraient en elle. Et cette pensée la choqua, car elle lui parut révéler une dépravation insoupçonnée de sa nature –, car jusqu’à ce jour, la force physique lui était apparue comme une chose brutale et vulgaire. Son idéal de beauté masculine avait toujours été tout de grâce et de finesse. Cependant le même désir étrange persistait : cela l’affolait de penser qu’elle pouvait avoir envie de poser ses mains sur ce cou hâlé. En vérité, elle ne se rendait pas compte que c’était son instinct qui la poussait à puiser la force dont son faible organisme manquait. Elle savait simplement que jamais aucun homme ne l’avait impressionnée comme celui-ci – qui pourtant la choquait à tout moment avec son langage impossible.
– Oui, je ne suis pas un infirme, dit-il. Quand il le faut, je peux digérer des cailloux !… Mais pour le moment, j’ai de la dyspepsie ! La plus grande partie de ce que vous venez de dire, je n’ai pas pu le piger. Je ne suis pas entraîné, vous comprenez. J’aime les livres et la poésie et chaque fois que j’avais le temps, je lisais – mais ça ne m’a jamais fait réfléchir comme vous. Voilà pourquoi je ne peux pas en parler. Je suis comme un navigateur à la dérive, sur une mer inconnue, sans carte ni boussole. Maintenant je veux faire le point. Peut-être pourrez-vous m’aider… Comment avez-vous appris tout ce que vous m’avez dit là ?
– À l’école évidemment et en travaillant.
– J’ai été à l’école quand j’étais gosse…
– Oui, mais je veux dire l’école secondaire et les cours et l’Université !…
– Vous avez été à l’Université !…
Il était confondu d’étonnement. Elle lui semblait s’être éloignée de lui d’un million de lieues, au moins.
– J’y vais toujours. Je suis les cours supérieurs de littérature anglaise.
Il ignorait ce qu’elle voulait dire par là, mais se contenta de noter mentalement cette nouvelle preuve d’ignorance et passa outre.
– Combien de temps faudrait-il travailler avant d’entrer à l’Université ? questionna-t-il.
Elle lui adressa un rayonnant sourire d’encouragement et répondit :
– Ça dépend des études que vous avez faites jusqu’à présent. Vous n’avez jamais été au lycée ?… Non, naturellement. Mais avez-vous terminé l’école élémentaire ?
– Il me restait deux ans à faire quand j’ai quitté, dit-il. Mais j’ai toujours été convenablement noté, à l’école, se hâta-t-il d’ajouter – et aussitôt, furieux de s’être ainsi vanté, il serra le bras du fauteuil si violemment, qu’il ressentit des fourmillements au bout de ses doigts.
Au même moment, il s’aperçut qu’une femme entrait dans la pièce. La jeune fille se leva et courut à elle. Il pensa que ce devait être sa mère. C’était une grande femme blonde, mince, majestueuse, magnifique. Il se réjouit à regarder la ligne harmonieuse de sa robe, qui lui rappela des femmes qu’il avait vues sur la scène. Puis, il se souvint d’avoir aperçu de grandes dames, habillées de la même façon, qui entraient au théâtre, à Londres, tandis qu’il regardait et qu’un sergent de ville le repoussait en dehors de la marquise, sous la pluie. D’un bond, son imagination le transporta ensuite à Yokohama, où, sur la promenade, il avait également rencontré de grandes dames. Comme dans un kaléidoscope, le port et la ville de Yokohama défilèrent devant ses yeux. Mais il chassa vite cette vision, oppressé par les exigences de la réalité. Il savait qu’il lui fallait être présenté. Il quitta donc péniblement son siège, avec son pantalon qui faisait des poches aux genoux, ses bras ballants et son visage contracté par l’épreuve qui l’attendait.
2
Se rendre dans la salle à manger fut une opération cauchemardesque. Il lui sembla qu’il n’y arriverait jamais – et il n’y parvint qu’avec des haltes soudaines et des trébuchements, des saccades et des embardées. Mais enfin il l’atteignit et se trouva assis à côté d’Elle. Le déploiement de couteaux et de fourchettes l’effraya et lui parut hérissé d’embûches. Il les regarda, fasciné, si bien que leur miroitement devint le fond sur lequel se mouvait une succession d’images. Il se revit dans l’entrepont d’un schooner : lui et ses compagnons mangeaient du bœuf salé avec leurs doigts et des couteaux à cran d’arrêt, ou puisaient avec des cuillers de fer toutes bosselées, une épaisse soupe aux pois dans de grossières gamelles. La puanteur du mauvais bœuf emplissait ses narines, tandis qu’il entendait, accompagnant le crissement des membrures et le gémissement des cloisons étanches, les bruyants claquements des mâchoires. En regardant ses compagnons, il estimait qu’ils mangeaient comme des cochons. Mais ici, il ferait attention de ne pas faire de bruit et toute sa volonté se tendrait vers ce but.
Son regard fit le tour de la table. Arthur et Norman étaient en face de lui. C’étaient ses frères, à Elle. Son cœur eut un chaleureux élan vers eux. Comme cette famille était unie !… Il revit la jeune fille courant au-devant de sa mère, leur baiser, le tableau qu’elles faisaient toutes deux en s’avançant, les bras entrelacés. De pareils témoignages d’affection entre enfants et parents n’existaient pas, dans son milieu. C’était une révélation des choses auxquelles pouvait prétendre ce monde supérieur – et il en fut ébloui. Par sympathie, son cœur fondit de tendresse. Toute sa vie, il avait été affamé d’amour – mais il avait dû s’en passer, et s’était endurci à la tâche. Il avait ignoré que l’amour lui était nécessaire et l’ignorait encore. Mais il en voyait les manifestations qui l’émouvaient profondément.
M. Morse n’était pas là, heureusement. Il était déjà suffisamment ardu de causer avec Elle et sa mère et son frère Norman (Arthur, il le connaissait déjà un peu). De sa vie il n’avait peiné aussi durement, lui sembla-t-il. Les travaux les plus pénibles n’étaient que des jeux d’enfants, comparés à cette épreuve… Sur son front perlaient de minuscules gouttes de sueur et sa chemise était trempée par tant d’exercices inaccoutumés. Il lui fallait manger d’une façon inhabituelle, se servir d’étranges ustensiles, regarder subrepticement autour de lui pour savoir comment accomplir chaque nouveau rite ; de plus, recevoir le flot d’impressions neuves qui l’inondaient, les noter, les classer. Le plus dur, peut-être, était de refréner cet élan vers Elle qui le tenaillait sous la forme d’une inquiétude sourde et douloureuse, d’un désir torturant de l’approcher, de cheminer sur la même route qu’Elle. Mais comment diminuer l’effroyable distance qui les séparait ?… Il lui fallait aussi, furtivement, guetter les autres, pour choisir le couteau ou la fourchette qu’il convenait de prendre pour tel ou tel plat, enregistrer les traits de cette personne, les évaluer et les comparer à ceux de la Femme Esprit. Puis, il lui fallait parler, écouter et répondre au bon moment, en se surveillant sévèrement – lui qui était habitué à un si grand relâchement de langage ! Et, pour ajouter encore à son embarras, il y avait l’incessante menace du maître d’hôtel – terrible sphinx qui apparaissait silencieusement par-dessus son épaule et parlait par énigmes qu’il s’agissait de résoudre immédiatement. Tout le temps du repas, il fut oppressé par l’idée des rince-doigts. Leur spectre ne cessait de le hanter. Quand viendraient-ils ? et à quoi pouvaient-ils bien ressembler ?… Dans quelques minutes, peut-être seraient-ils là et lui, Martin Eden, assis à la même table que les surhommes qui en faisaient usage, s’en servirait comme eux ! Enfin, dominant tout, revenait l’angoissant problème : quelle attitude adopter ? Tantôt, lâchement, il décidait de jouer un rôle, tantôt, plus lâchement encore, il se disait qu’il n’y réussirait pas, qu’il n’était pas fait pour le mensonge et qu’il se rendrait ridicule.
Au début du dîner, il fut très silencieux, tant était grande la tension de tout son être. Il ignorait que son silence donnait un démenti à Arthur, qui la veille leur avait annoncé qu’il allait amener un sauvage à dîner, mais qu’il ne faudrait pas s’en effrayer, parce que ce sauvage les intéresserait sûrement. Jamais Martin Eden n’aurait imaginé le frère de son idole capable d’une telle trahison, étant donné surtout qu’il avait eu la chance de sortir ce frère d’une bagarre dont l’issue menaçait d’être fâcheuse pour lui.
Il était donc installé à cette table, à la fois gêné parce qu’il ne se trouvait pas dans son milieu et charmé de ce qui se passait autour de lui. Pour la première fois il comprenait que l’acte de manger pouvait être autre chose qu’une fonction. Il ignorait d’ailleurs ce qu’il mangeait : c’était de la nourriture, voilà tout ! Il nourrissait son amour de la beauté à cette table où manger devenait esthétique. Son cerveau bouillonnait. Il entendait des mots qui pour lui n’avaient aucun sens, d’autres qu’il n’avait vus que dans les livres et que pas une de ses connaissances passées n’aurait été capable de prononcer. Quand il entendait un de ces mots tomber négligemment des lèvres d’un membre de cette extraordinaire famille – sa famille à Elle – un frisson délicieux le parcourait. Tout le romanesque, toute la beauté des livres se réalisaient. Il se trouvait dans cet état rare et merveilleux, où on voit ses rêves se dégager des limbes de la fantaisie et prendre corps.
Il se tenait donc à l’arrière-plan ; il écoutait, dégustait, et répondait par monosyllabes : « Oui, madame », « Non, madame », « Non, mademoiselle » et « Oui, mademoiselle ». Il avait du mal à ne pas dire comme les marins : « Oui, capitaine » au frère, mais il sentait que ce serait donner une preuve de plus d’infériorité – et que dirait Celle qu’il voulait conquérir ?…
« Bon Dieu ! se disait-il, je vaux autant qu’eux et, s’ils savent un tas de trucs que je ne sais pas, je pourrais leur en apprendre quelques autres dont ils ne se doutent pas.
L’instant d’après, quand Elle ou sa mère l’appelaient M. Eden, son orgueil agressif s’évanouissait et il exultait de joie. Il était un homme civilisé, qui était ce qu’il était et dînait côte à côte avec des héros de romans ; lui-même évoluait dans ce roman et ses faits et gestes seraient un jour imprimés dans un livre.
Cependant, tandis qu’il donnait à Arthur un si flagrant démenti en se révélant agneau bêlant et timide, son cerveau se torturait à élaborer une ligne de conduite, car il n’avait vraiment rien d’un agneau bêlant et un rôle de second plan ne convenait nullement à sa nature orgueilleuse. Il ne parlait que lorsqu’il le fallait absolument et alors sa conversation ressemblait à son entrée dans la salle à manger : remplie de cahots et d’arrêts brusques – tandis qu’il fouillait dans son vocabulaire, à la recherche de l’expression exacte ; il hésitait à se servir des mots qu’il savait être justes, mais qu’il craignait de ne pouvoir prononcer convenablement, en écartait d’autres qu’il jugeait grossiers. Mais il était, pendant tout ce temps, oppressé par le sentiment que cette recherche de langage le rendait stupide et l’empêchait d’exprimer sa pensée intime. Son amour de la liberté, également, se cabrait contre la contrainte – celle de la pensée, comme celle du carcan qui lui encerclait le cou, sous forme de faux col. Et puis, il ne savait pas s’il pouvait tenir le coup. Sa puissance de pensée et de sensibilité était grande autant qu’était opiniâtre et vif son esprit. Emporté par la spontanéité de ses sensations, il lui arrivait d’oublier où il était et il finissait par employer son pauvre langage d’antan.
À un moment donné, un domestique l’ayant interrompu pour lui offrir d’un plat, il refusa d’un « Pouh ! » emphatique, sonore, qui fit la joie du domestique, celle de la table entière et le remplit de honte. Mais il se remit aussitôt et expliqua :
– C’est un mot canaque, qui veut dire « fini ». Il m’est venu tout naturellement. On l’écrit : « p-a-u ».
Puis, comme la jeune fille regardait curieusement ses mains, il continua :
– Je viens de revenir le long des côtes, sur l’un des courriers du Pacifique. Il était en retard et, dans les ports du Puget Sound nous avons trimé comme des nègres, à embarquer la cargaison – du fret mixte… Vous savez ce que c’est ? Voilà pourquoi ma peau est arrachée.
– Oh ! ce n’est pas ça, répondit-elle vivement. Vos mains sont trop petites pour votre corps.
Il rougit, persuadé qu’elle avait découvert en lui une nouvelle tare.
– Oui, dit-il en s’excusant. Elles ne sont pas assez fortes pour le reste. Avec mes bras et mes épaules, je peux taper comme un bœuf. Mais, quand je cogne sur la mâchoire de quelqu’un, mes mains s’abîment aussi.
Il regretta cette phrase aussitôt et se dégoûta lui-même. Il avait parlé sans réflexion, de choses laides.
– C’est bien de votre part d’être venu au secours d’Arthur, comme vous l’avez fait vous, un étranger, dit gentiment la jeune fille, en s’apercevant de son embarras, dont elle ignorait la cause, d’ailleurs.
Il la comprit et la chaude bouffée de reconnaissance qui l’envahit lui fit encore une fois oublier son langage trop familier.
– Ça ne vaut pas la peine d’en parler, dit-il. N’importe quel type en aurait fait autant. Cette bande de voyous cherchait la bagarre. Arthur les laissait tranquilles. Ils lui sont tombés dessus… Alors moi, je leur suis rentré dedans… C’est en leur faisant sauter quelques dents que je me suis arraché la peau des mains… Je n’aurais pas voulu manquer ça ! Quand j’ai vu…
Il s’arrêta net, la bouche ouverte, conscient de l’abîme qui la séparait de lui et le rendait indigne de respirer le même air qu’elle. Et, tandis qu’Arthur, pour la vingtième fois, racontait son aventure avec les ivrognes sur le transbordeur et comment Martin Eden, bondissant à son aide, l’avait secouru – le Martin Eden en question, sourcils froncés, méditait sur son incorrigible vulgarité et réfléchissait une fois de plus au problème ardu de sa tenue vis-à-vis de ces gens-là. Jusqu’alors, il avait certainement gaffé. Il se dit qu’il n’était pas de leur espèce et qu’il était inutile de faire semblant d’en être. Le déguisement ne réussirait pas, et d’ailleurs, toute comédie lui était odieuse. Il ne pouvait pas ne pas être sincère quoi qu’il arrivât. Pour l’instant il ne parlait pas leur langue, mais cela viendrait un jour, il y était décidé. Pour le moment, il fallait parler, quitte à parler sa langue à lui, mise au diapason, bien entendu, de leur compréhension et assagie de façon à ne pas les choquer. Et puis il n’aurait pas l’air – même tacitement – de connaître des choses qui lui étaient totalement inconnues. En foi de quoi, les deux frères, en parlant de leurs études, employèrent à plusieurs reprises le mot « trigo » ; Martin Eden leur demanda :
– Trigo ? Qu’est-ce que c’est ?
– Trigonométrie, répondit Norman. Une forme supérieure de « math ».
– Et qu’est-ce que c’est que « math » ?
– Les mathématiques, l’arithmétique, répondit Norman en riant.
Martin hocha la tête, il entrevoyait des horizons de science infinis, illimités. Et cette pensée devenait tangible, car son anormale puissance de vision lui faisait concrétiser les choses les plus abstraites. Métamorphosées par son cerveau bouillonnant, trigonométrie, mathématiques et tout le vaste champ de savoir qu’elles comportaient, se changèrent en autant de paysages. Il voyait des clairières doucement lumineuses, des échappées de feuillages frais brutalement traversés par les rais d’un soleil ardent. Dans le lointain, l’horizon se perdait dans un brouillard de pourpre. Mais – et il en était certain – derrière ce brouillard de pourpre habitait l’inconnu merveilleux, aux attraits enchanteurs. Il se sentit comme enivré, car là était l’aventure à tenter, le monde à conquérir, et du fond de lui-même, une pensée fulgura : devenir digne d’Elle, le conquérir, ce lis pâle, qui se trouvait à ses côtés.
La vision féerique fut dissipée par Arthur qui, toute la soirée, s’était efforcé de montrer « l’homme sauvage » à son avantage. Martin se rappela sa décision. Pour la première fois il se montra tel qu’il était – avec effort d’abord – mais bientôt il s’oublia lui-même en remarquant combien sa façon de raconter plaisait à son auditoire. Il avait fait partie de l’équipage du contrebandier Alcyon, lors de sa capture par un cotre des Douanes. Et il sut leur faire voir ce que ses yeux avaient vu. Il évoqua la grande mer violente, les bateaux, les marins avec une telle puissance, qu’il leur sembla y être avec lui. D’une touche d’artiste, il choisissait les détails à mettre en valeur, l’image claire, saisissante, et leur donnait ensuite une couleur et une lumière si vivantes, que ses auditeurs étaient emportés par son éloquence irrésistible, son enthousiasme et son pouvoir d’évocation. À certains moments, il les choquait par la crudité, le réalisme de sa parole, mais toujours la brutalité s’accompagnait de beauté, et, souvent, le tragique se tempérait d’humour quand il racontait les étranges saillies et les boutades des matelots.
Et tandis qu’il parlait, la jeune fille ne cessait de le regarder, étonnée. Elle s’animait à cette flamme… Il lui prenait envie de se pencher vers cet homme bouillonnant qui projetait de la force, de la santé, une inépuisable vigueur. Elle se sentait irrésistiblement poussée vers lui. D’autre part, un sentiment contraire la retenait. Ses mains abîmées, tellement encrassées par le travail que toute la souillure du labeur journalier semblait s’y être incrustée, lui causaient une violente répulsion, ainsi que la striure de sa nuque et ses muscles saillants. Sa rudesse l’effrayait. La crudité de son langage insultait son oreille ; les épisodes mouvementés de sa vie insultaient son âme. Et cependant, l’attirance subsistait malgré tout, si bien qu’elle l’imagina doué d’une puissance mauvaise. Tout ce qui était le plus solidement édifié dans son cerveau, tout un monde de conventions sociales chancelait, battu par le souffle héroïque du romanesque et de l’aventure. Devant ses dangers quotidiens et sa constante gaieté, la vie n’était plus un effort et une contrainte ; elle devenait un jouet fait pour s’amuser, pour jouer à pile ou face et pour être jeté ensuite, négligemment. « Donc, amuse-toi ! » lui criait une voix intérieure. « Penche-toi vers lui, puisque ça te plaît, et pose tes deux mains sur sa nuque ! » La hardiesse de cette pensée faillit la faire crier tout haut. En vain elle fit appel à sa propre culture, à son raffinement, opposant tout ce qu’elle valait, à tout ce qu’il ne valait pas. Autour d’elle, les autres le dévoraient des yeux ; elle aurait désespéré, si elle n’avait pas vu de la terreur dans les regards de sa mère – de la terreur admirative, soit, mais de la terreur quand même. Oui ! cet homme venu des ténèbres était un être démoniaque. Sa mère le sentait, et sa mère avait raison. Elle se confierait à elle, en ceci comme en toutes choses. La flamme cessa aussitôt de la brûler et elle cessa de le craindre.
Plus tard, au piano, elle joua pour lui – contre lui, pour ainsi dire – agressive, avec la vague intention d’agrandir l’infranchissable abîme qui les séparait. Elle lui assenait sa musique, brutalement comme à coups de gourdin ; mais, s’il en fut étourdi, presque écrasé, il n’en fut que plus surexcité. Avec une stupeur respectueuse, il la contemplait. Certes, dans son esprit aussi, l’abîme s’élargissait, mais plus vite encore montait en lui l’ambition de le franchir. Il était d’ailleurs d’une sensibilité trop complexe, pour contempler cet abîme toute une soirée, surtout en écoutant de la musique. Il y était remarquablement sensible. Comme un alcool elle s’emparait de son imagination, enflammait ses sens et l’emportait au-delà des hideurs de la vie, dans un infini vaporeux où son esprit volait. La musique qu’elle jouait, il ne la comprenait pas. Elle ne pouvait se comparer au vacarme du piano des bals publics, ni aux bruyants orphéons de village qu’il avait entendus. Ses lectures lui avaient vaguement fait pressentir l’existence de ce genre de musique. Il l’écoutait religieusement, content d’abord des motifs simples et faciles, surpris ensuite quand ces motifs s’arrêtaient. Au moment précis où il en avait compris le rythme et où son imagination s’envolait à leur suite, un chaos de sons les engloutissait – et son imagination, découragée, retombait lourdement sur la terre.
Un instant il crut que tout cela était fait exprès pour le rebuter. Il se rendit compte de l’antagonisme qu’elle provoquait et s’efforça de deviner le langage des mains sur le clavier. Puis, cette idée lui paraissant impossible, indigne d’Elle, il la chassa et se laissa charmer par la musique. De nouveau son esprit s’envola, libéré de son enveloppe charnelle ; devant ses yeux et au-delà, resplendissait une triomphale lumière ; l’entourage extérieur disparut, et il partit vers les mondes inconnus… Il vit des rives étranges inondées de soleil, des campements sauvages et inexplorés, s’enivra de l’arôme épicé des Îles, tel qu’il l’avait respiré, certaines nuits brûlantes, en mer. Il longea des côtes désertiques par des après-midi tropicaux, et, du miroitement des flots turquoise, émergeaient des îlots de corail couronnés de palmes. Les images se succédaient à un rythme accéléré. Tantôt il montait un cheval sauvage et galopait à travers un désert féerique ; l’instant d’après, du sommet d’une montagne, il contemplait, sous une chaude lumière papillotante, le sépulcre blanchi de « la vallée de la Mort » ; ou bien il ramait sur l’océan Arctique, parmi les grandes banquises étincelantes au soleil – ou encore il se revoyait, par une chaude nuit de parfums voluptueux, couché sur le sable satiné d’une plage bordée de cocotiers. À la lueur fantastiquement bleue d’une épave en flammes, les « hulas » dansaient sur des airs de chants d’amour barbares au son de cliquetants « ukelelés » et de sonores tam-tams. À l’horizon, un volcan se profilait contre le ciel étoile ; au-dessus de lui brûlaient un pâle croissant de lune, et, tout là-bas, la Croix du Sud.
Il vibrait comme une harpe ; les échos de sa vie passée en étaient les cordes. Le flot des mélodies qui passait comme une brise à travers les cordes, en faisait chanter les souvenirs et les rêves. La sensation ne le possédait pas uniquement : elle revêtait des formes, des couleurs, des rayonnements, et les ardeurs de son esprit se contredisaient d’une façon magique. Le Passé, le Présent, l’Avenir se confondaient ; il voguait par-delà les vastes mondes, à travers aventures et nobles actions, il voguait vers Elle… puis avec Elle conquise, il la saisissait dans ses bras, et continuait son vol, emporté par sa fantaisie triomphante.
À la dérobée, elle le regarda – et vit quelque chose de tout cela sur son visage – visage transfiguré, où les grands yeux rayonnants semblaient voir bien au-delà de ce qu’elle jouait, la course et le bondissement de la vie et tous les rêves merveilleux de l’imagination. Elle fut saisie. Le rustre, le marin vulgaire avaient disparu – bien que les vêtements mal coupés, les mains abîmées fussent toujours là – mais ils semblaient être le déguisement terrestre d’une grande âme condamnée au silence par la faute de ces lèvres inhabiles. En un éclair elle vit tout cela, puis, le rustre reparut à ses yeux… et elle se moqua d’elle-même. Cependant l’impression de ce bref éclair lui resta, et quand Martin Eden effectua son départ, aussi maladroit que son arrivée, elle lui prêta deux volumes de Swinburne et de Browning. Elle étudiait Browning en ce moment.
Debout devant la jeune fille, tout rouge et balbutiant ses remerciements, il avait tellement l’air d’un grand enfant timide, qu’une onde de pitié maternelle l’envahit. Elle oublia le rustre, la grande âme déguisée, l’homme dont les regards avides l’avaient effrayée et ravie. Elle ne vit plus qu’un enfant qui lui serrait la main d’une poigne calleuse aussi dure qu’une râpe et qui disait maladroitement :
– La meilleure soirée de ma vie !… Je ne suis pas habitué à ce genre de choses, vous comprenez… (Il regarda autour de lui comme pour appeler à l’aide.) À des gens comme vous autres et à des maisons comme celle-ci… Tout ça est nouveau et ça me plaît.
– J’espère que vous reviendrez, dit-elle, pendant qu’il prenait congé de ses frères.
Il enfonça sa casquette sur sa tête, gagna précipitamment la porte et disparut.
– Eh bien ! que penses-tu de lui ? questionna Arthur.
– Tout ce qu’il y a de plus intéressant !… une bouffée d’ozone ! répondit-elle. Quel âge a-t-il ?
– Vingt ans, près de vingt et un… Je le lui ai demandé cet après-midi. Je ne le croyais pas si jeune.
« … Et moi, j’ai trois ans de plus !… » se dit-elle en embrassant ses frères.
3
En descendant l’escalier, Martin Eden mit sa main dans sa poche. Il en sortit une feuille de papier de riz brun, une pincée de tabac mexicain et roula une cigarette. Il tira la première bouffée en avalant la fumée et la rejeta lentement, avec volupté.
– Bon Dieu ! s’écria-t-il, d’un ton de respectueuse admiration. (Et plus bas il répéta deux fois encore :) Bon Dieu !
Puis il arracha son col empesé et le fourra dans sa poche. Une bruine glacée tombait, mais il se découvrit et déboutonna son veston avec une parfaite insouciance. S’apercevait-il seulement de la pluie ? Il marchait comme dans un rêve, revivant ses dernières extases et les heures qu’il venait de passer.
Enfin il l’avait rencontrée, la femme, celle à laquelle il avait peu pensé, – car il pensait peu aux femmes – mais qu’il avait attendue, inconsciemment peut-être, et qui devait venir. Il l’avait eue à côté de lui à table, avait serré sa main ; il avait vu dans ses regards le reflet d’une âme splendide, aussi belle que les yeux qui la reflétaient, aussi belle que la chair qui l’incarnait. Il ne pensait d’ailleurs pas à cette chair comme à celle des autres femmes ; pourtant, jusqu’alors son intérêt pour les femmes se bornait à ça. Celle-ci était d’essence différente, devait échapper aux maux et aux fragilités humaines. Ce corps était mieux que la gaine de son âme : c’était l’émanation même de cette âme, une gracieuse et pure cristallisation de son essence divine. Ce sentiment du divin le saisit d’abord, puis rappela son esprit troublé à des réflexions plus calmes. Cette perception du divin ne l’avait jamais frappé : il avait toujours été incroyant et se moquait gaiement des bigots et de l’immortalité de leur âme. Il n’y avait pas de vie future, avait-il décidé ; il fallait vivre et bien vivre, et puis sombrer dans le néant. Mais dans les yeux de cette femme il avait vu une âme, une âme impérissable. Personne, jamais, ne lui avait donné cette impression-là et il l’avait eue dès la première rencontre de leurs regards.
En marchant, il ne cessait de voir son visage, pâle et sérieux, doux et délicat, souriant avec une pitié et une tendresse immatérielles, et pur. Il n’aurait jamais pu imaginer qu’une telle pureté existât. Cette pureté le frappait plus que tout le reste. Il avait rencontré du vice et de la bonté, mais de la pureté jamais, et il l’ignorait totalement. À présent, il concevait la pureté comme le superlatif de la bonté et de la propreté morale, comme l’essence même de la vie éternelle… Et il ambitionna aussitôt d’acquérir la vie éternelle. Évidemment, il n’était pas digne de dénouer les cordons de ses souliers : c’était même un coup de chance inouïe d’être arrivé à la connaître, à l’approcher, à lui parler ce soir-là. C’était un accident, qu’il n’avait pas amené et qu’il ne méritait pas. Envahi d’une sorte d’humilité religieuse, plein d’abattement et de dégoût de lui-même, il sentait profondément le poids de ses péchés. Mais, tel le pécheur qui se prosterne devant le tribunal de la pénitence, entrevoit, du fond de son humble détresse, l’espoir d’un au-delà radieux, lui, ne concevait le suprême salut que par la conquête de cette femme. Cette conquête, d’ailleurs, demeurait irréelle, nébuleuse, totalement différente du sens qu’il y attachait généralement. Emporté par son ambitieuse fantaisie, il se voyait, planant avec elle dans les hauteurs spirituelles, communiant aux mêmes sources d’art et de beauté. Son rêve n’allait pas au-delà d’une possession d’âme absolument éthérée, d’une amitié cérébrale qu’il ne savait lui-même définir. Il était hors d’état de définir quoi que ce fût en ce moment. La sensation triomphait du raisonnement ; il palpitait d’émotions inconnues et s’abandonnait délicieusement au flot d’impressions nouvelles qui l’emportaient vers d’inaccessibles sommets.
Il titubait comme un homme ivre, en murmurant avec ferveur : « Bon Dieu ! Bon Dieu ! »
Au coin d’une rue, un sergent de ville le regardait venir et, d’un œil méfiant, observait sa démarche incertaine.
– Où c’est que tu t’es soûlé comme ça ? questionna-t-il.
Martin Eden revint sur terre. Sa nature s’adaptait immédiatement aux circonstances et ce fut le Martin Eden habituel qui répondit en riant au sergent de ville :
– C’est du propre ! hein ? Et j’ignorais que je faisais des discours tout haut…
– Ouais. Et tout à l’heure tu chanteras, diagnostiqua l’agent.
– Non, pas de danger… Donnez-moi du feu, et je vais tâcher d’attraper le dernier tram.
Il alluma sa cigarette, remercia et poursuivit son chemin en grognant :
– … Non, mais des fois !… Le flic qui me croyait soûl ! (Il sourit et réfléchit un instant.) J’aurais jamais pensé qu’une femme vous mette dans un état pareil.
Il monta dans le tram de Berkeley. Il était bondé de jeunes gens qui braillaient des chansons et des refrains de collège. Martin les étudia avec curiosité. C’étaient des universitaires. Ils allaient évidemment à la même Université qu’elle, étaient du même milieu social, la connaissaient peut-être, pouvaient à leur gré la voir tous les jours… Alors, pourquoi, ce soir, étaient-ils dans ce tram, au lieu d’être auprès d’elle, à l’entourer d’une respectueuse adoration ?… Il remarqua un jeune homme aux petits yeux bridés, à la lèvre pendante, un vicieux, sûrement, se dit-il. À bord ce serait le fouineur, le geignard, le mouchard de l’équipage. Lui Martin Eden était un autre gars que celui-là !… Cette idée lui fit plaisir, parce qu’elle semblait le rapprocher d’elle. Et il poursuivit sa comparaison. À mesure qu’il regardait les étudiants, il se rendait compte du beau mécanisme de son corps et de sa supériorité physique. Oui, mais leur cerveau bourré de science leur permettait de parler la même langue qu’Elle et cette idée le déprima. Mais à quoi sert le cerveau ?… Ce qu’ils avaient fait, il pouvait le faire. Ils avaient appris la vie dans les livres, et lui l’avait vécue. Son cerveau contenait tout autant de choses que le leur, des choses différentes, voilà tout. Combien d’entre eux sauraient nouer un garant, prendre la barre, ou faire le point ?… Sa vie se développait devant lui en tableaux – aventures, dangers, travail éreintant, coups d’audace désespérée… Il se rappelait ses maladresses du début, toutes les avanies subies. C’était mieux ainsi, d’ailleurs. Ceux-ci allaient vivre à leur tour et manger de la vache enragée… Parfait ! Lui, pendant ce temps, apprendrait la vie dans les livres.
Tandis que le tram traversait la zone clairsemée de masures lamentables qui sépare Oakland de Berkeley, il guettait l’immeuble familier à deux étages dont la façade s’enorgueillissait de cette enseigne : Denrées Alimentaires, MAISON HIGGINBOTHAM. Arrivé là, il descendit et contempla l’enseigne un instant. Elle renfermait pour lui une profonde signification : des lettres elles-mêmes semblait émaner tout un monde de mesquinerie, d’égoïsme et de basse hypocrisie. Bernard Higginbotham était le mari de sa sœur et il le connaissait bien. Avec son passe-partout il ouvrit la porte et grimpa au premier étage, où habitait son beau-frère. L’épicerie était en bas. Un relent de vieux légumes flottait dans l’air. En tâtonnant à travers le vestibule, il buta dans une voiture de poupée, qu’un de ses nombreux neveux avait abandonnée là et l’envoya rouler à grand bruit contre la porte. « Quel vieux grippe-sou ! se dit-il. Ça refuse de brûler deux cents de gaz pour empêcher que ses pensionnaires ne se cassent le cou ! »
En tâtonnant encore, il tourna le bouton et entra dans une pièce éclairée où étaient assis sa sœur et Bernard Higginbotham. Elle raccommodait un pantalon, et lui, répandu sur deux chaises, des savates en tapisserie éculées pendillant au bout de ses pieds, lisait un journal. Il leva ses yeux noirs, perçants et faux et Martin Eden, comme toujours, éprouva un sentiment de répulsion. Qu’est-ce que sa sœur avait bien pu trouver chez cet homme ? Il lui faisait l’effet d’une vermine qu’il avait envie d’écraser sous son pied. « Un de ces jours, je lui casserai la figure », se disait-il souvent, pour se faire patienter. Les yeux de fouine, cruels et bordés de rouge, le regardaient avec reproche.
– Eh bien ! demanda Martin. Qu’est-ce qu’il y a ?
– J’ai fait repeindre cette porte la semaine dernière, gémit M. Higginbotham, et tu sais les prix du syndicat. Tu devrais faire attention.
Martin eut envie de répondre, mais il se tut, sachant combien c’était inutile. Il regarda le chromo qui ornait le mur et fut frappé de sa monstrueuse vulgarité. Jusqu’alors il lui avait plu, mais il lui parut qu’il le voyait pour la première fois. C’était misérable, comme d’ailleurs tout dans cette maison. Et sa pensée revint à l’intérieur qu’il venait de quitter. Il revit les tableaux d’abord. Elle ensuite, et la douceur attendrie de son adieu. Il oublia complètement où il se trouvait et l’existence même de Bernard Higginbotham jusqu’au moment où cet individu l’interpella :
– Qu’est-ce que tu vois, un fantôme ?
Martin revit les yeux de méchant rongeur ricanants, peureux, cruels, puis se les représenta aussitôt tels qu’ils étaient en bas, au comptoir – serviles, doucereux, flatteurs.
– Oui, répondit-il J’ai vu un fantôme… Bonsoir, Gertrude ! Il fit demi-tour vivement et se prit les pieds dans l’ourlet déchire du tapis malpropre.
– Ne tape pas la porte ! recommanda M. Higginbotham.
Il rougit de colère, mais se contint et ferma doucement la porte derrière lui.
Exultant de joie mauvaise, M Higginbotham se tourna vers sa femme.
– Il a bu ! grogna-t-il avec emphase. Je te l’avais dit qu’il boirait.
Elle hocha la tête avec résignation en concédant :
– Ses yeux étaient bien brillants, et il n’avait plus le col qu’il avait en partant, je l’ai vu. Mais il n’a peut-être pas bu plus de deux ou trois verres.
– Il tenait à peine sur ses jambes, affirma le mari. Je l’ai observé. Il n’a pas pu traverser la chambre sans trébucher. Tu l’as bien entendu dans le vestibule ? Il a failli tomber.
– Ça devait être par-dessus la voiture d’Alice, répondit-elle. Il ne l’a pas vue dans le noir.
M. Higginbotham éleva la voix et sa colère monta en même temps. Toute la journée il prenait sur lui, dans la boutique, et réservait pour les soirées familiales le privilège de se montrer tel qu’il était.
– Je te dis que ton charmant frère était ivre.
Sa voix froide, incisive, martelait les mots avec la netteté coupante d’un emporte-pièce. Sa femme soupira et se tut. C’était une femme corpulente, débraillée, qui semblait éternellement fatiguée du poids de son corps, de son travail et de son mari.
– Il tient ça de son père, je te dis, poursuivit M Higginbotham. Et il finira dans le ruisseau comme lui, tu verras.
Elle fit oui de la tête, soupira et continua de coudre.
Martin Eden était rentré ivre, c’était entendu. Si leur âme avait été capable de comprendre la beauté, n’auraient-ils pas vu dans ces yeux rayonnants, sur tout ce visage ardent, le signe évident du premier amour ?
– Un joli exemple pour les enfants ! grogna subitement M. Higginbotham après un silence dont il voulut à sa femme. (Il aurait préféré quelquefois être contredit davantage.) S’il recommence, je le mets dehors ! Compris ? Je ne tolérerai plus ça ! Débaucher de pauvres innocents par le spectacle de ses soûleries ! (M. Higginbotham aimait ce mot « débaucher », glané dans un journal et nouvellement ajouté à son vocabulaire.) C’est bien ça ; il n’y a pas d’autre mot : il les débauche.
Sa femme soupira encore, secoua tristement la tête et continua sa couture. M. Higginbotham reprit sa lecture.
– Est-ce qu’il a payé sa pension de la semaine dernière ?… lança-t-il par-dessus son journal.
Elle fit signe que oui, et ajouta : « Il a encore un peu d’argent. »
– Quand reprend-il la mer ?
– Quand sa paye sera dépensée, je suppose, répondit-elle. Il a été hier à San Francisco pour se faire embaucher. Mais il a encore de l’argent et il est difficile pour le choix d’un bateau.
– Il n’y a rien de tel qu’un pouilleux pour faire des manières, grogna M. Higginbotham. Ça lui va bien de faire le difficile !
– Il a parlé d’un schooner qui se prépare à partir pour un pays perdu à la recherche d’un trésor… Il partirait dessus si son argent dure jusque-là.
– Si seulement il voulait se ranger, je l’emploierais ici, à conduire la voiture, dit le mari, sans aucune bienveillance. Tom s’en va.
La femme eut un regard à la fois interrogateur et anxieux.
« Il s’en va ce soir. Il entre chez Carruthers, qui lui donne davantage. »
– Je te l’avais dit qu’il s’en irait ! s’écria-t-elle. Il valait plus que tu ne lui donnais !
– Écoute, ma vieille ! rugit Higginbotham menaçant. Je t’ai déjà dit cent fois de ne pas fourrer ton nez dans mes affaires. Je ne te le répéterai pas.
– Ça m’est égal, larmoya-t-elle. Tom était un bon garçon !
Son mari la foudroya du regard. Voilà qui était de la dernière insolence.
– Si ton espèce de frère n’était pas un propre à rien, il pourrait conduire la voiture, siffla-t-il.
– Il paye sa pension tout comme un autre, répliqua-t-elle. C’est mon frère, d’abord, et tant qu’il ne te doit pas d’argent, tu n’as pas le droit de l’insulter tout le temps. J’ai tout de même un cœur, bien que je sois ta femme depuis sept ans.
– Lui as-tu dit qu’il payerait son gaz, s’il continue à lire dans son lit ?
Mme Higginbotham ne répondit pas. Sa révolte était passée, vaincue par sa chair fatiguée, et le mari triomphait : il avait le dessus. Ses yeux clignaient vicieusement, tandis qu’il se réjouissait d’être arrivé à la faire pleurer. Il éprouvait un grand bonheur à lui fermer son caquet et elle marchait facilement maintenant, bien mieux qu’au début de leur mariage, avant que ses nombreuses maternités et les continuelles taquineries de son mari n’aient entamé son énergie.
– Tu lui diras demain, voilà tout ! dit-il. Et, pendant que j’y pense, il faudra faire chercher Marianne demain pour garder les enfants. Tom parti, je serai dehors toute la journée avec la voiture, et tu peux te préparer à rester au comptoir, en bas.
– Mais demain, c’est jour de lessive ! dit-elle faiblement.
– Tu te lèveras de bonne heure et tu laveras avant. Je ne partirai pas avant dix heures.
Et, dépliant rageusement son journal, il continua sa lecture.
4
Martin Eden, encore tout hérissé de cette prise de contact avec son beau-frère, suivit dans l’obscurité le couloir et entra dans sa chambre – petite niche contenant tout juste un lit, un lavabo et une chaise. M. Higginbotham était bien trop pratique pour avoir une bonne, du moment qu’il avait une femme. D’autre part, la chambre de la bonne lui permettait de prendre deux pensionnaires au lieu d’un seul.
Martin déposa Swinburne et Browning sur la chaise, enleva son pardessus et s’assit sur son lit sans même remarquer le grincement douloureux des ressorts sous son poids. Il se baissa pour enlever ses bottines, puis s’interrompit, et se mit à observer en face de lui le mur de plâtre, que la pluie, filtrant du toit, avait rayé de longues bavures brunâtres. Sur ce fond misérable, les visions reparurent, en images lumineuses. Il oublia ses chaussures et resta longtemps immobile, jusqu’au moment où ses lèvres tremblantes murmurèrent : « Ruth ! »
Il répéta ce nom à l’infini, comme un talisman, un mot magique. Chaque fois qu’il le prononçait, en effet, le visage aimé apparaissait devant ses yeux, illuminait le pauvre mur d’une clarté radieuse. Et cette clarté envahissait toutes choses, entraînait son âme vers Elle sur des rayons incandescents… Tout ce qu’il y avait de meilleur en lui s’amplifiait, magnifiquement ennobli et purifié… Sensation étrangement nouvelle !… Jamais aucune femme ne l’avait rendu meilleur – au contraire. Pourtant, beaucoup d’entre elles avaient fait de leur mieux, sans qu’il s’en doute. Il ignorait, étant sans vanité aucune, l’attirance des femmes vers sa belle jeunesse ; souvent même il en avait été lassé. Il se souciait peu d’amour, et l’idée d’avoir pu rendre certaines femmes meilleures, ne lui était jamais venue. Jusqu’à ce jour il avait vécu dans la plus parfaite indifférence ; maintenant il lui semblait n’avoir eu affaire qu’à des êtres bas et des amours avilissantes – ce qui était injuste et pour elles et pour lui. Mais, prenant conscience de lui-même pour la première fois, il n’était pas en état de juger sainement et sombrait totalement dans la honte de ce qu’il croyait des souvenirs infâmes.
Brusquement il se leva et s’efforça de se regarder dans le miroir terni du lavabo. Il l’essuya, puis se regarda de nouveau, longuement et minutieusement, pour la première fois de sa vie. Ses yeux savaient voir cependant, mais jusqu’à cet instant, il ne s’en était servi que pour regarder le monde avec ses panoramas éternellement changeants, et n’avait jamais pris le temps de se regarder lui-même.
Ce qu’il vit – sans savoir l’évaluer – fut le visage d’un jeune homme de vingt ans, au front carré, bombé, couronné d’une forêt de cheveux châtains, dont les vagues légèrement bouclées devaient tenter les mains caressantes des femmes. Mais il n’accorda aucune attention à un objet aussi indigne d’Elle, se contentant d’étudier longuement son grand front carré, s’efforçant de le pénétrer, d’en apprécier le contenu. Quel genre de cerveau habitait là-dedans ? De quoi était-il capable ? Jusqu’où pourrait-il le mener ? Jusqu’à Elle ?… Il se demanda ce que reflétaient ses yeux d’acier, parfois bleus, avivés par la brise saline des mers ensoleillées. Qu’avait-elle pensé de ses yeux ? Il essaya de se substituer à Elle… vainement. Que savait-il de sa façon de juger ? Comment pourrait-il deviner une seule de ses pensées ? En Elle tout était enchantement et mystère. Eh bien, conclut-il, ce sont d’honnêtes yeux, sans détours et sans ruse. La couleur de son visage le surprit. Il ne le croyait pas si bronzé par le soleil. Vite, il releva la manche de la chemise pour se rassurer. Oui, sa peau était blanche, somme toute, bien que ses bras soient tannés, eux aussi. Il tendit le bras, tâta son biceps et chercha l’endroit le moins touché par le soleil… Là, c’était très blanc… La pensée qu’autrefois son visage avait été aussi blanc que cela le fit rire. Il ne s’imagina pas un instant que peu de femmes blondes aient pu se flatter d’avoir la peau aussi blanche et aussi douce que la sienne, là où elle avait échappé aux atteintes du soleil.
Il avait une bouche d’enfant, quand les lèvres pleines, sensuelles, ne se serraient pas trop durement sur les dents, ce qui alors rendait sévère et même ascétique cette bouche sensuelle, vraiment faite pour l’amour et pour la lutte… On la sentait aussi bien capable de savourer les douceurs de la vie que de renoncer à ces mêmes douceurs, pour dominer la vie. Le menton, la mâchoire, forts et légèrement agressifs, accentuaient cette impression de volonté corrigeant la sensualité, la tonifiant en quelque sorte. Et les dents, blanches, régulières et solides, n’avaient jamais eu besoin du dentiste ; il le remarqua avec plaisir en poursuivant son examen. Mais une pensée le troubla tout à coup : n’y avait-il pas des gens qui se lavaient les dents tous les jours ? des gens très supérieurs à lui, certes, des gens de sa classe à Elle… Elle, naturellement, se lavait les dents tous les jours… Que penserait-elle de lui si elle apprenait que de sa vie il ne se les était nettoyées ? Il décida d’acheter une brosse à dents et de prendre cette habitude, dès le lendemain. Des exploits héroïques ne suffiraient pas à la conquérir ; il lui fallait s’éduquer en tout, s’habituer même au port du col empesé, bien cette seule évocation lui parût une véritable atteinte à son indépendance.
Il étendit la main, en tâta du pouce l’intérieur calleux et contempla la crasse qui s’y était incrustée, sans qu’aucune brosse soit parvenue à l’en débarrasser. Combien sa paume à Elle était différente ! Il frissonna délicieusement à ce souvenir. Elle était couleur de pétale de rose, se dit-il, et fraîche et douce comme un flocon de neige. Comment une simple main de femme pouvait-elle être si adorablement douce ? En se représentant ce que pouvait être la caresse d’une main pareille, il rougit, comme pris en faute, s’en voulut d’une telle pensée, incompatible avec la vénération mystique qu’il vouait à cette blanche créature éthérée. Cependant la douceur de cette main le poursuivit. Il était habitué à la peau rugueuse des ouvrières et des femmes du peuple. Eh bien ! il le savait, pourquoi leurs mains étaient rudes ! Sa main à Elle était douce, parce qu’elle n’avait jamais travaillé. L’abîme qui les séparait se creusa davantage à la pensée troublante de quelqu’un qui n’avait pas besoin de travailler pour vivre. Il s’imagina tout à coup ce qu’était l’aristocratie : les gens qui n’ont besoin de rien faire – et sur le mur, devant ses yeux, elle prit la forme d’une puissante statue de bronze qui le défiait de toute sa gigantesque stature. Il avait toujours travaillé, toute sa famille aussi. Et Gertrude donc !… quand ses mains n’étaient pas durcies par le ménage, elles étaient rouges et crevassées par la lessive. Et sa sœur Marianne ! Elle avait travaillé dans une fabrique de conserves, l’été précédent, et ses jolies mains fines étaient complètement tailladées par le coupage des tomates. L’hiver d’avant, l’extrémité de deux de ses doigts avait été enlevée par une machine, dans une manufacture de boîtes en carton. Il se rappela les mains rugueuses de sa mère, couchée dans son cercueil… Et son père avait travaillé jusqu’à son dernier soupir : la corne de ses mains devait bien avoir un centimètre d’épaisseur à sa mort… Mais ses mains à Elle étaient douces, celles de sa mère aussi, ainsi que celles de ses frères. Cette dernière pensée l’étonna : c’était un signe terriblement précis de leur caste supérieure et de l’énorme distance qui les séparait de lui.
Il se rassit sur le lit avec un rire amer et enleva ses bottines. Il était idiot. Un visage de femme, les mains blanches et douces d’une femme l’avaient soûlé. Puis, sur le mur délabré, une autre vision apparut. Il se vit devant une sinistre maison garnie, la nuit, à Londres, dans East End. Devant lui se tenait Maggie, une petite ouvrière de fabrique de quinze ans. Il l’avait accompagnée chez elle après le « bean-feast ». Elle habitait ce garni sinistre, dont les pourceaux n’auraient pas voulu. Il lui avait tendu la main en disant bonsoir, et elle lui avait tendu ses lèvres. Mais il n’avait pas voulu l’embrasser. Elle lui faisait un peu peur. Alors elle avait refermé sa main sur la sienne et l’avait serrée fiévreusement. Il sentait les cals de ses mains frotter contre les siens, et une grande pitié lui gonflait le cœur. Il voyait ses yeux affamés, pleins de désir et son pauvre corps de jeune femelle mal nourrie, d’une maturité précoce déjà flétrie. Alors doucement, il l’avait enveloppée de ses deux bras, s’était baissé et l’avait embrassée sur les lèvres. Il avait encore dans les oreilles son petit cri heureux et la sentait se pelotonner contre lui, comme une chatte. Pauvre petite malheureuse ! La vision de cette nuit-là le poursuivait. Sa chair se hérissait encore, comme alors, quand elle s’était accrochée à lui désespérément, et son cœur fondait de pitié. C’était une soirée grise, d’un gris sale, une pluie triste souillait le pavé. Puis, une lumière chaude irradia la muraille, substituant à cette vision le blanc visage de l’Autre, couronnée d’or – lointaine, inaccessible comme une étoile.
Il prit Browning et Swinburne sur la chaise et les embrassa. « Elle m’a tout de même dit de revenir », se dit-il. Une dernière fois, il se regarda dans la glace et déclara tout haut, solennellement :
– Martin Eden, demain matin, à la première heure, tu iras à la bibliothèque populaire et tu t’instruiras sur les bonnes manières. Compris ?
Il éteignit le gaz et les ressorts gémirent sous son poids.
– Mais il faut cesser de jurer, Martin, mon vieux ; il faut absolument cesser, conclut-il.
Puis il s’endormit et fit des rêves qui par leur folie et leur audace rivalisaient avec ceux des mangeurs de haschich.
5
Le lendemain matin, à son réveil, les senteurs enivrantes de ses rêves d’or s’étaient dissipées, pour faire place à une lourde odeur de lessive et de linge sale qui était la manifestation même d’une vie misérable. En sortant de sa chambre il entendit un clapotement d’eau, une exclamation irritée et le bruit sonore d’une gifle dont sa sœur gratifiait l’un ou l’autre de sa nombreuse nichée. Le braillement de l’enfant lui tapa désagréablement sur les nerfs. Il se rendit compte que tout cela, l’air même qu’il respirait, était sordide et répugnant. Combien différente était l’atmosphère paisible de la maison de Ruth ! Là-bas, tout était élevé. Ici, tout était matière, et bassement matériel.
– Viens ici, Alfred, dit-il à l’enfant qui pleurait, tout en explorant la poche de son pantalon, où, selon son habitude, il portait son argent. (Il en sortit vingt-cinq cents, qu’il mit dans la main du petit, après l’avoir dorloté un instant.) Va-t’en vite à présent, cours acheter des sucres d’orge et n’oublie pas d’en donner aussi à tes frères et sœurs. Surtout achète de ceux qui durent très longtemps !
Sa sœur releva la figure empourprée qu’elle penchait au-dessus de la lessiveuse et le regarda.
– Deux cents auraient suffi, dit-elle. C’est bien toi, ça ! Aucune idée de la valeur de l’argent. Le gosse va s’en donner une indigestion.
– Ça va bien, Sis, répondit gaiement Martin. Il trouvera bien à les dépenser. Si tu n’étais pas si occupée, je t’embrasserais.
Il avait envie d’être affectueux envers sa sœur, qui était bonne et qui l’aimait à sa manière. Mais, plus les années passaient, plus elle changeait, plus elle le déroutait. Il songea que c’était la faute du travail si dur, des nombreux enfants, des éternelles taquineries de son mari et il lui parut tout à coup, qu’elle ressemblait un peu à ces légumes passés, à cette lessive, et à toute cette monnaie sale qu’elle tripotait du matin au soir.
– Allez ! va prendre ton petit déjeuner ! dit-elle avec mauvaise humeur, mais dans le fond contente, car de toute sa couvée de frères nomades, celui-ci avait toujours été son préféré. Après tout, je vais t’embrasser ! ajouta-t-elle, le cœur un peu remué.
Du revers de sa main, elle essuya la mousse de savon qui dégoulinait de ses bras. Et quand, ayant enlacé sa taille massive, il l’eut embrassée sur les deux joues, il vit des larmes remplir ses yeux, non pas tant de tendresse que de lassitude. Elle le repoussa tout de suite.
– Tu trouveras le petit déjeuner dans le four, dit-elle précipitamment. Jim doit être levé à présent. Il a fallu que je me lève tôt pour laver. Maintenant va… et arrange-toi pour sortir de bonne heure. La maison ne va pas être drôle aujourd’hui : Tom est parti et Bernard est obligé de conduire la voiture.
Martin gagna la cuisine, avec un poids sur le cœur ; la vue du visage congestionné de sa sœur et de son corps avachi le préoccupait beaucoup. Il conclut qu’elle l’aimerait bien si elle avait le temps – mais voilà : elle travaillait à en crever. Bernard Higginbotham était une brute de l’éreinter ainsi. D’autre part il ne put s’empêcher de trouver que ce baiser l’avait un peu dégoûté. Il est vrai qu’il était très inhabituel : depuis longtemps il ne l’embrassait que lorsqu’il partait ou revenait de voyage. Ce baiser à la mousse de savon manquait de charme, car c’était celui d’une femme fatiguée, depuis si longtemps, qu’elle a oublié ce que c’est qu’un baiser. Il se souvint d’elle jeune fille, quand elle dansait toute la nuit, avec les meilleurs danseurs, après une dure journée de blanchissage, sans se préoccuper du dur lendemain. Puis il pensa à Ruth et imagina la douceur de ses lèvres. Son baiser devait ressembler à sa poignée de main et à son regard – il devait être appuyé et doux à la fois. Oui, il osa évoquer la vision de sa bouche sur la sienne, et cela si vivement, qu’un vertige le saisit et qu’il lui sembla tourbillonner dans un nuage de pétales de roses embaumées.
À la cuisine, il trouva Jim, l’autre pensionnaire, qui mangeait de la bouillie d’un air dolent, les yeux lointains et vagues. Jim était apprenti plombier ; son menton mou et son tempérament lymphatique joints à une certaine apathie nerveuse n’indiquaient pas qu’il dût arriver bon premier dans la course à l’assiette au beurre.
– Pourquoi ne manges-tu pas ? dit-il, tandis que Martin trempait avec dégoût sa cuiller dans la bouillie d’avoine froide et mal cuite. Tu étais encore soûl, hier soir ?
Martin secoua la tête. Il était écœuré par la sordidité qui l’entourait. Ruth Morse lui semblait de plus en plus lointaine.
– Moi, je l’étais, poursuivit Jim avec un ricanement bruyant… mais alors soûl comme une vache ! Oh ! quelle gentille fille ! Billy m’a ramené à la maison.
Martin fit un signe affirmatif – c’était une habitude de toujours écouter qui lui parlait – et se servit une tasse de café tiède.
– Tu vas danser au club des Lotus, ce soir ? demanda Jim. Ils auront de la bière, et si la bande des Temescal vient, il va y avoir du chahut. Je m’en fous d’ailleurs. J’emmène en tout cas ma copine ! Zut ! j’ai la bouche amère !
Il fit la grimace et but du café pour chasser le mauvais goût.
– Tu connais Julie ?
Martin fit signe que non.
– C’est ma copine, expliqua Jim, un amour ! Je te présenterais bien, mais tu me la faucherais. Je ne sais pas ce que tu leur fais… mais la façon dont tu les chipes à tes potes est décourageante.
– Je ne t’ai jamais enlevé personne, répondit Martin indolemment, pour dire quelque chose.
– Parfaitement ! affirma l’autre avec chaleur. Tu m’as fauché Maggie.
– Il ne s’est rien passé entre nous. Je n’ai dansé avec elle que cette nuit-là.
– Justement ! c’est à cause de ça ! s’écria Jim. Tu as dansé avec elle, et tu l’as regardée, tout simplement, et ça a été fini. Bien sûr, toi, tu n’avais rien à en foutre, mais moi, elle m’a plaqué ! Elle ne m’a plus adressé un seul regard. Elle me demandait toujours après toi. Tu n’aurais eu qu’à te baisser pour la prendre, si tu avais voulu.
– Mais je ne voulais pas.
– Quand même, elle m’a plaqué. (Jim le regarda avec admiration.) Comment tu te débrouilles, dis, Mart ?…
– Je m’en fiche, répondit-il.
– Tu leur fais croire que tu t’en fiches ? questionna Jim vivement.
Martin réfléchit une seconde, puis répondit :
– C’est sans doute le bon système, mais pour moi, c’est différent. Je ne m’en suis jamais soucié… enfin pas beaucoup… Si tu peux faire semblant, ça marchera, j’en suis sûr.
– Tu aurais dû venir, à la grange de Riley, déclara Jim, dont les idées manquaient de suite. Un tas de mecs ont passé les gants de boxe. Il y avait là un type épatant de West-Oakland, qu’on appelle « le Rat ». Souple comme une anguille. Personne n’a pu le tomber. On t’a regretté. Où étais-tu donc, au fait ?
– À Oakland, répondit Martin.
– Au spectacle ?…
Martin repoussa son assiette et se leva.
– Tu viendras danser ce soir ? lui cria l’autre.
– Non, je ne pense pas, répondit-il.
Il sortit et respira l’air à grandes bouffées. Cette atmosphère l’avait suffoqué et le bavardage de l’apprenti l’avait exaspéré. À certains moments, il avait dû se retenir pour ne pas lui fourrer la tête dans sa bouillie. Plus l’autre bavardait, plus Ruth semblait s’éloigner de lui. Comment pourrait-il, parmi ce troupeau de brutes, devenir jamais digne d’elle ? La tâche qu’il s’était donnée le terrifiait, tant il se sentait handicapé par l’atavisme de sa classe. Tout se coalisait pour l’empêcher de s’élever, sa sœur, la maison de sa sœur et sa famille, Jim, l’apprenti, toutes ses connaissances, ses moindres attaches. Et il trouva un goût amer à l’existence. Jusqu’alors il l’avait acceptée telle qu’elle était et trouvée bonne. Il ne l’avait jamais interrogée, excepté dans les livres ; mais ces livres étaient pour lui des contes de fées parlant d’un monde impossible et magnifique. À présent qu’il avait vu ce monde possible et réel, dont cette femme-fleur, Ruth, était le centre, tout le reste n’était qu’amertume, désirs douloureux et désespoirs exaspérés par l’espoir même.
Il avait hésité entre la Bibliothèque populaire de Berkeley et celle d’Oakland ; il se décida pour cette dernière parce que Ruth habitait Oakland. Qui sait ?… Une bibliothèque était bien un endroit pour elle et il pouvait l’y rencontrer. Comme il ignorait la façon de s’y prendre, il erra parmi d’innombrables rayons de romans, jusqu’au moment où la gentille fille à l’air français qui semblait être la préposée du lieu, lui dit que le service des renseignements était en haut. Il n’était pas assez fixé pour s’adresser à l’homme au pupitre et s’élança dans la salle réservée à la philosophie. Il avait entendu parler de philosophie, mais ne s’était pas figuré qu’on ait pu écrire tant d’ouvrages sur ce sujet. Les hauts rayons ployant sous les lourds volumes l’humilièrent et le stimulèrent en même temps. Quelle bonne besogne pour son cerveau vigoureux ! Il tomba sur des livres de trigonométrie dans la section des mathématiques, les feuilleta et contempla, médusé, des formules et des figures incompréhensibles… Certes, il comprenait l’anglais, mais cet anglais-là lui sembla de l’hébreu. Norman et Arthur savaient cette langue : ils l’avaient parlée devant lui. Et c’étaient les frères de Ruth ! Il quitta la salle de philosophie, désespéré. De tous côtés les livres semblaient se rapprocher de lui pour le narguer, l’écraser. Jamais il ne s’était imaginé que la science humaine pût constituer une masse aussi imposante de livres, et cela l’effrayait. Comment son cerveau pourrait-il emmagasiner tout cela ?… Puis il se souvint que d’autres, beaucoup d’autres, l’avaient fait ; et, tout bas, ardemment, il se jura de faire rendre à son cerveau ce que d’autres avaient su faire rendre au leur.
Il erra de nouveau, tantôt déprimé, tantôt espérant, à la vue des rayons bourrés de science. Dans une section de « divers » il tomba sur un Épitomé de Nerrie et le parcourut avec déférence. Cette langue il la comprenait enfin : comme lui cet homme parlait de la mer. Puis il trouva un Bowditch et des livres de Leckey et de Marshall. Voilà ! il allait apprendre la navigation. Il allait cesser de boire, travailler et devenir capitaine. Ruth, à ce moment-là, parut très près de lui. Une fois capitaine, il pourrait l’épouser – si elle voulait de lui. Et si elle ne voulait pas, eh bien ! il vivrait une vie meilleure parmi les hommes, à cause d’Elle, et n’en cesserait pas moins de boire. Puis il se souvint des assureurs et des armateurs – maîtres obligés du capitaine – qui pourraient le brimer et dont les intérêts étaient diamétralement opposés aux siens. Il lança un regard à travers la salle et baissa les yeux devant les dix mille volumes. Non, plus de mer pour lui. Il y avait d’infinies richesses dans tous ces livres et s’il parvenait à en tirer de grandes choses, c’est sur terre qu’il les accomplirait. D’ailleurs, un capitaine ne peut emmener sa femme avec lui.
Midi vint, puis l’après-midi. Il oublia de manger et continua à chercher des livres sur les bonnes manières ; car, en plus du choix d’une carrière, son esprit était tourmenté par un problème plus immédiat : quand une jeune fille vous demande de venir la voir, quand pouvez-vous y aller ? Mais quand il tomba sur le rayon en question, il chercha en vain une réponse. Les mille et une subtilités du savoir-vivre l’ahurirent, et il se perdit dans le labyrinthe des cas variés où l’on échange des cartes de visite entre gens de bonne société. Il abandonna la partie sans avoir trouvé ce qu’il cherchait, mais en découvrant qu’un homme n’a pas assez de toute sa vie pour être poli, et que lui, personnellement, devrait vivre une existence préparatoire pour apprendre à le devenir.
– Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? lui demanda l’homme au pupitre quand il sortit.
– Oui, monsieur, dit-il. Vous avez une excellente bibliothèque.
L’homme fit un signe d’assentiment.
– Nous serons heureux de vous revoir souvent. Vous êtes marin ?
– Oui, monsieur, je suis marin, répondit Martin. Je reviendrai.
« Comment a-t-il vu ça ? » se demanda-t-il en descendant l’escalier.
Et dans la rue pendant quelques minutes, il s’efforça à une démarche raide, et gauche, mais, bientôt perdu dans ses pensées, il reprit le gracieux balancement qui lui était habituel.
6
Une terrible inquiétude tourmenta Martin Eden. Il avait faim de voir la jeune fille dont les mains fines s’étaient emparées de sa vie, mais il ne pouvait trouver le courage d’aller la voir. Il craignait, en y allant trop tôt, de commettre une grave infraction à cette chose effrayante appelée le savoir-vivre. Il passait de longues heures dans les bibliothèques d’Oakland et de Berkeley et remplissait les fiches d’abonnement pour lui-même, ses sœurs Gertrude et Marianne et pour Jimmy, dont quelques verres de bière avaient obtenu le consentement. Avec la provision de livres que quatre cartes lui permettaient d’emporter chez lui, il usa tant de gaz dans sa pauvre chambrette, que M. Higginbotham lui fit payer cinquante cents de supplément.
La masse de livres qu’il lut, ne lui servit qu’à stimuler son impatience. Chaque page de chaque volume n’entrebâillait qu’une fenêtre minuscule du paradis intellectuel, et son appétit, aiguisé par la lecture, augmentait à mesure. Puis, il ne savait par quel bout commencer et souffrait continuellement du manque d’études préparatoires. Les plus simples allusions – évidemment comprises par n’importe quel lecteur – lui échappaient. Il en fut de même pour la poésie qu’il adorait. Il lut le Swinburne prêté par Ruth, d’autres encore, comprit Dolores d’un bout à l’autre. Mais il estima que Ruth ne devait pas le comprendre ! Comment l’aurait-elle pu, vivant une vie aussi raffinée ? Il tomba par hasard sur des poèmes de Kipling, dont le rythme, l’envolée, l’éclat qui transformaient les moindres choses, les détails les plus familiers, le transportèrent. La compréhension de cet homme, sa psychologie à l’emporte-pièce le stupéfiaient. « Psychologie » était un nouveau mot dans le vocabulaire de Martin. Il avait acheté un dictionnaire, ce qui avait fait une brèche assez importante à ses économies et avancé le jour de son embarquement. De plus cela agaçait M. Higginbotham qui aurait préféré que cet argent lui profite. Le jour, il n’osait pas s’aventurer dans les parages de Ruth ; mais à la nuit, il rôdait comme un voleur autour de la maison des Morse ; il regardait furtivement les fenêtres, attendri à la seule vue des murs qui l’abritaient. Il faillit plusieurs fois être surpris par ses frères et suivit un soir M. Morse en ville, étudiant sa figure dans les rues éclairées et souhaitant de tous ses vœux l’accident terrible qui lui permettrait de bondir à la rescousse pour sauver le père de sa bien-aimée. Une autre fois il fut récompensé de son attente en entrevoyant la silhouette de Ruth à une fenêtre du premier étage. Les bras levés, elle se coiffait devant un miroir ; il ne vit que sa tête et ses épaules, l’espace d’un éclair en réalité, mais cette vision fugitive accéléra son pouls et fit battre son sang dans ses artères. Puis, elle fit tomber le store. Mais il savait à présent où était sa chambre et il revint la guetter souvent, caché dans l’ombre d’un arbre, sur le trottoir opposé, en fumant d’innombrables cigarettes. Un après-midi, il rencontra sa mère qui sortait d’une banque, ce qui lui démontra une fois de plus l’énorme distance qui le séparait de Ruth. Elle appartenait à la classe qui se servait des banques. Jamais il n’avait pénétré dans un de ces sanctuaires et s’imaginait qu’ils ne pouvaient être fréquentés que par les millionnaires et les puissants de la terre.
Il subissait une sorte de révolution morale. La pureté, la beauté d’âme de son idole avaient opéré chez lui une réaction et il éprouvait un ardent besoin de propreté. Il devait être propre, pour être digne de respirer le même air qu’elle. Il se lava les dents ; il se brossa les mains avec une brosse à récurer l’évier, jusqu’au jour où, ayant vu une brosse à ongles à la devanture d’un droguiste, il en devina l’usage et l’acheta. Le vendeur, ayant jeté un regard sur ses ongles, proposa une lime et il acquit sur-le-champ ce nouvel ustensile de toilette. Après avoir parcouru un livre sur les soins corporels, il décida qu’il lui fallait un bain froid tous les jours, à la stupéfaction de Jim, et à l’indignation de M. Higginbotham qui, voyant d’un sale œil ces notions abracadabrantes, se demanda sérieusement s’il ne ferait pas payer à Martin l’eau en plus. Un autre progrès fut réalisé à propos du pli du pantalon. Martin, orienté vers ce genre de choses, remarqua vite la différence entre le pantalon du travailleur, dont le genou fait une poche, et celui dont la ligne droite tracée du pied à la hanche indique un milieu plus élevé. Il travailla la question et envahit la cuisine de sa sœur, pour réquisitionner des fers et une planche à repasser. Au début il eut quelques mésaventures, brûla un pantalon et fut forcé d’en acheter un autre, ce qui rapprocha encore la date de son embarquement.
Mais le changement ne s’opérait pas seulement sur son apparence extérieure. Il fumait encore, mais ne buvait plus. Jusqu’alors il s’était imaginé qu’un homme devait boire et il se vantait d’avoir la tête solide, ce qui lui permettait de voir les autres rouler sous la table tandis que lui-même tenait parfaitement le coup. Quand, par exemple, il rencontrait un camarade de bord – et il en avait beaucoup à San Francisco – il l’invitait, ou était invité, comme autrefois ; mais à présent, c’était du ginger-ale ou de la limonade qu’il commandait pour lui et il acceptait gaiement leurs mises en boîte. Et, tandis qu’ils se grisaient, que la brute s’éveillait en eux et les possédait, il les étudiait et remerciait Dieu de ne plus leur ressembler. Il leur fallait oublier leurs misères et pendant leur ivresse ces brutes stupides se sentaient pareils aux dieux et régnaient dans leur paradis d’intoxiqués.
D’ailleurs, Martin ne sentait plus le besoin d’alcool. Il était ivre de mille autres façons nouvelles, bien plus graves, ivre de Ruth qui avait embrasé son cœur d’amour et de désir d’immortalité ; ivre de lecture, ce qui avait déchaîné en lui d’innombrables aspirations ; ivre enfin de sa force, doublée par les soins qu’il prenait de son corps et qui lui donnaient un équilibre joyeux et magnifique.
Un soir il alla au théâtre, espérant vaguement qu’elle y viendrait, et voilà que, des seconds balcons où il était assis, il la vit ! Il la vit arriver par un des bas-côtés, avec Arthur et un jeune homme – pourvu d’un gazon ras à la place de cheveux, et de lunettes – dont la vue le plongea dans des affres de méfiance et de jalousie. Il la vit s’asseoir aux fauteuils d’orchestre, et, toute sa soirée il ne distingua guère que ceci : de délicates épaules blanches et une masse de cheveux d’or pâle, pâlis encore par la distance. Mais d’autres que lui étaient distraits et il remarqua, en regardant autour de lui, deux jeunes filles, assises à côté qui lui souriaient d’un air effronté. Il avait toujours été d’un abord facile ; ce n’était pas dans sa nature d’envoyer promener les gens. Autrefois, il aurait souri en retour et, par son attitude, encouragé leur sourire. À présent, c’était différent. Il répondit à leur sourire, puis se détourna et ne regarda plus de ce côté-là. Plusieurs fois, pourtant, sans le faire exprès, son regard rencontra de nouveau leur sourire. On ne change pas en un jour et il ne pouvait guère modifier sa gentillesse foncière. Il finit donc par sourire à ces jeunes filles, par sympathie. Que lui apportaient-elles de neuf ? Il savait bien qu’elles tendaient vers lui leurs mains caressantes. Mais, à présent, là-bas, très loin, à l’orchestre, était la femme unique, si terriblement différente de ces deux filles de sa classe à lui, qu’il ne pouvait ressentir à leur égard que peine et pitié. Il désirait de tout son cœur qu’il leur soit donné de posséder un peu de la bonté de Ruth et de sa splendeur morale. Mais pour rien au monde il n’aurait voulu les blesser à cause de leurs avances, dont il n’était d’ailleurs pas flatté : il ressentait même une vague honte de son infériorité qui les y autorisait. S’il avait appartenu au milieu de Ruth, jamais ces filles ne se seraient permis de familiarité ; dans leurs œillades il sentait l’emprise de son milieu qui l’obligeait à se maintenir à leur niveau.
Il se leva avant le baisser du rideau, pour essayer de voir sortir Ruth. Il y avait toujours du monde sous le péristyle du théâtre et, s’il rabattait la visière de sa casquette sur ses yeux pour se dissimuler, elle ne le verrait pas. Il sortit le premier de la foule ; mais à peine s’était-il placé sur le chemin de la sortie, que les deux filles apparurent. Elles l’avaient suivi, c’était évident, et sur l’instant il maudit le charme qu’il exerçait sur les femmes. Elles avançaient lentement, dans le flot de la foule, et c’est en le frôlant que l’une d’elle l’aperçut. C’était une mince fille brune, aux sombres yeux pleins de défi. Toutes deux lui sourirent et il leur répondit.
– Hello ! dit-il automatiquement : il l’avait déjà fait si souvent dans des cas semblables ! D’ailleurs, il ne lui était guère possible de faire moins, étant donné sa grande indulgence et le besoin de cordialité inhérent à sa nature. La fille aux yeux noirs accentua son sourire et fit mine de s’arrêter, ainsi que l’amie qui l’accompagnait et qui riait en se tortillant. Il réfléchit rapidement. Il ne fallait pas qu’en sortant « Elle » le vît avec ces filles. Tout naturellement il emboîta le pas à la brune et la poussa vers la sortie. Là, il était à son affaire ; loin de manifester de la maladresse ou de la timidité, il plaisanta, maniant avec verve l’argot et le compliment gentil, préliminaires indispensables dans ce genre d’aventures rapides. Au coin il voulut quitter la foule qui suivait la rue, pour en prendre une transversale. Mais la fille aux yeux noirs lui saisit le bras et s’écria en entraînant sa compagne :
– Hé ! Bill ! Où courez-vous comme ça ?… Vous allez pas nous plaquer tout de suite ?…
Il s’arrêta, se mit à rire et fit volte-face. Par-dessus leurs épaules il voyait la foule passer sous les réverbères. L’endroit où il se trouvait n’étant pas éclairé, il pourrait la voir passer sans être vu. Elle devait passer par là, puisque c’était son chemin pour rentrer.
– Comment s’appelle-t-elle ? dit-il à la copine, en désignant la fille brune…
– Demandez-lui ! répondit-elle en pouffant.
– Alors, votre nom ? fit-il en se tournant vers la fille en question.
– Vous ne m’avez pas dit le vôtre, répliqua-t-elle.
– Vous ne me l’avez pas demandé, dit-il en souriant. D’ailleurs vous l’avez deviné : c’est Bill, justement.
– Allons donc ! (Elle le regarda dans les yeux, tandis que les siens se faisaient tendres.) C’est vrai, ça ?…
Elle l’observait toujours. L’éternel féminin brillait dans ses yeux éloquents. Et il l’évaluait, négligemment, sachant d’avance qu’elle allait à présent, s’il l’attaquait, se tenir sur la défensive, soudain réservée, pudique, mais prête à renverser les rôles s’il reculait. N’étant après tout qu’un homme, il sentait l’attirance qu’elle exerçait sur lui et, dans son for intérieur, appréciait sa flatteuse insistance. Il connaissait bien tout cela !… Il le connaissait trop bien, depuis A jusqu’à Z… Bonne, elle l’était, comme on peut l’être dans ce milieu-là, travaillant dur, mal payée et dédaignant de se vendre pour vivre mieux ; elle recherchait ardemment une bouffée de bonheur pour égayer sa triste existence et n’avait devant elle d’autre alternative qu’une lamentable éternité de travail, ou le sombre gouffre d’une misère plus terrible encore, qui payait mieux mais tuait plus vite.
– Bill, répondit-il, en hochant la tête. Je vous assure, Bill ou Pierre.
– Sans blague ?
– Allons donc ! Il ne s’appelle pas Bill, interrompit l’autre.
– Qu’en savez-vous ? dit-il, vous ne me connaissez pas.
– Pas besoin de vous connaître pour savoir que vous mentez !
– Sérieusement, Bill, c’est votre nom ? dit la brune.
– Bill me va très bien, répondit Martin.
Elle lui prit le bras en riant.
– Je sais que vous mentez, mais vous êtes gentil quand même.
Il prit la main qui s’offrait, en sentit de suite les marques et les déformations qu’il ne connaissait que trop bien.
– Depuis quand avez-vous plaqué la fabrique de conserves ? interrogea-t-il.
– Comment savez-vous ?… Eh bien ! c’est un sorcier ! s’écrièrent les filles en chœur.
Tandis qu’il échangeait avec elles toutes les stupidités habituelles, dans son esprit passaient et repassaient les innombrables rayons de la bibliothèque où s’accumulaient les merveilles des siècles passés. Et l’incongruité de ses pensées le fit sourire.
Cependant ses rêves intimes et le badinage qu’il affectait ne l’empêchaient pas de surveiller la sortie du théâtre. Et, tout à coup, il aperçut Ruth, dans la lumière, entre son frère et le jeune homme aux lunettes, et son cœur s’arrêta de battre. Comme il avait espéré ce moment ! À peine eut-il le temps d’apercevoir la gaze légère qui voilait sa tête fière, l’arrangement plein de goût de sa silhouette drapée, la grâce de son allure et sa main fine, quand elle releva sa jupe ; puis elle disparut, et il se retrouva en face des deux ouvrières, de leurs vains essais d’élégance et de propreté, en face de leurs vêtements bon marché et de leurs bijoux de pacotille. Il sentit qu’on lui tiraillait le bras, entendit vaguement qu’on lui parlait :
– Réveillez-vous, Bill ! qu’avez-vous ?
– Quoi ?… vous disiez ?…
– Oh ! rien, répondit la brune avec un geste vif de la tête. Je me disais seulement…
– Quoi… ?
– Eh bien ! je me disais que ce serait une bonne idée si vous emmeniez un de vos amis… pour elle (montrant sa compagne) et alors on irait quelque part prendre un « ice-cream soda », ou autre chose.
Une nausée morale le secoua. De Ruth à ceci, la transition était trop brusque. À côté des yeux hardis de cette fille, il voyait les clairs yeux lumineux de Ruth, dont le regard angélique venait à lui des ultimes profondeurs de la pureté. Et il se sentit soudain supérieur à cette aventure. La vie pour lui avait une autre signification ; elle ne se bornait pas à des « ice-cream sodas » en partie carrée. Il se rappela que de tout temps il avait, dans un jardin secret, cultivé des pensées rares et précieuses. S’il avait essayé d’en faire part, jamais il ne s’était trouvé de femme capable de les comprendre, d’homme non plus. Et comme ces pensées allaient au-delà de leur compréhension, il en concluait à présent qu’il devait leur être supérieur.
Il serra les poings. Du moment que la vie signifiait pour lui davantage, c’était à lui de demander davantage à la vie ; mais ce n’était pas cette compagnie-là qu’il lui fallait : les hardis yeux noirs ne pouvaient rien lui offrir de neuf. Il savait ce qu’il y avait derrière : de l’ice-cream et un vague intérêt de plus. Mais les yeux angéliques là-bas lui offraient bien mieux et plus qu’il ne pouvait imaginer : des livres et de la peinture, le repos et la beauté, toutes les élégances physiques et morales d’une existence raffinée. Il connaissait par cœur ce que dissimulaient si mal ces yeux noirs : il voyait, comme un intérieur de montre, tous les rouages de la pauvre mécanique cérébrale ; le bas plaisir en était le but, le plaisir morne menant à la mort absolue de toute espérance. Mais dans les yeux angéliques s’offraient le mystère, l’enchantement, l’au-delà. En eux miroitait le reflet d’une âme et aussi un peu de son âme à lui.
– Il n’y a qu’une chose qui cloche dans ce programme, dit-il tout haut. Je suis déjà pris.
Les yeux noirs de la brune le foudroyèrent.
– Vous allez veiller un ami malade, sans doute ? ricana-t-elle.
– Non, j’ai un rendez-vous, avec… avec une jeune fille.
– Vous me faites marcher ? dit-elle gravement.
Il la regarda dans les yeux et répondit :
– Pas du tout, je vous assure. Mais ne pouvons-nous pas nous rencontrer un autre jour ? Vous ne m’avez pas encore dit votre nom, ni où vous habitez.
– Lizzie, répondit-elle, radoucie. (Appuyée tout entière contre lui, elle lui pressait le bras.) Lizzie Connolly. Et j’habite à Fifth and Market.
Il bavarda quelques minutes encore et leur souhaita bonne nuit.
Mais au lieu de rentrer directement, il alla jusqu’à l’arbre à l’ombre duquel il avait rêvé tant de fois, leva la tête vers sa fenêtre et murmura :
– Le rendez-vous était avec vous, Ruth. Je l’ai gardé.
7
Depuis la soirée chez Ruth Morse, une semaine avait passé, remplie par la lecture uniquement, et il n’avait pas encore osé retourner chez elle. De temps en temps il prenait son courage à deux mains, mais devant les doutes qui l’assaillaient il reculait au dernier moment. À quelle heure fallait-il y aller ? Personne ne pouvait le lui dire et il craignait de commettre une gaffe irréparable. S’étant affranchi de son milieu et de ses habitudes passées et n’ayant pas fait de nouvelles connaissances, il n’avait d’autre occupation que la lecture et s’y consacrait avec une telle frénésie que des yeux normaux n’auraient pas pu résister longtemps. Mais les siens étaient exceptionnels. De plus, son cerveau – vierge en ce qui concernait la pensée abstraite – était mûr pour les bienfaisantes semailles. Aucune étude ne l’avait fatigué et il mordait au travail intellectuel avec une surprenante ténacité.
À la fin de la semaine, il lui parut – tant sa vie passée et sa façon de voir ancienne semblaient lointaines – qu’il avait vécu cent ans. Mais le manque d’études préparatoires le gênait beaucoup. Il essayait de lire des choses qui demandaient des années de spécialisation préliminaire. Comme il se plongeait un jour dans un livre de philosophie antique, le lendemain dans de la philosophie ultra-moderne, dans sa tête tourbillonnaient les idées les plus contradictoires. Avec les économistes, il en était de même. Sur la même rangée, à la bibliothèque, il trouva Karl Marx, Ricardo, Adam Smith et Mill, et les idées abstraites de l’un ne permettaient pas de conclure que les idées de l’autre fussent surannées. Il était dérouté, mais assoiffé du désir de s’instruire. En un seul jour, l’économie sociale, l’industrie, la politique, le passionnèrent. Dans le Parc de City-Hall, il avait remarqué un groupe d’hommes au milieu desquels en péroraient une demi-douzaine ; le sang au visage, la voix excitée, ils discutaient avec animation. Il se joignit au public et écouta le langage – pour lui nouveau – des philosophes populaires. Le premier était un chemineau, le second un travailliste, le troisième un étudiant en droit et les autres des ouvriers bavards. Pour la première fois, il entendit parler de socialisme, d’anarchie, de taxe réduite et sut qu’il existait des philosophies sociales contradictoires. Il entendit cent mots techniques inconnus, car ils faisaient partie d’un champ d’étude qu’il n’avait pas abordé. Il lui fut impossible, à cause de cela, de suivre de près leurs arguments et il ne put que deviner les idées exprimées par des expressions si neuves. Il y avait aussi un garçon de café théosophe, un boulanger agnostique, un vieillard qui les confondit tous par la théorie étrange du : « Ce qui est, a sa raison d’être », et un autre vieillard qui pérora interminablement sur le cosmos, l’atome-mâle et l’atome-femelle.
Au bout de plusieurs heures, Martin Eden s’en alla, complètement abruti, et courut à la bibliothèque, pour étudier la définition d’une douzaine de mots inusités. Et il en sortit, emportant sous son bras quatre volumes de Mme Blavatsky : La Doctrine secrète ; Pauvreté et progrès ; La Quintessence du socialisme et La Lutte de la religion et de la science. Malheureusement, il débuta par la Doctrine secrète. La moindre ligne était hérissée de mots polysyllabiques qu’il ne comprenait pas. Assis dans son lit, un dictionnaire ouvert à côté du livre en question, il recherchait tant de mots, qu’il en avait oublié la signification lorsqu’ils se représentaient et il lui fallait les rechercher de nouveau. De guerre lasse il se décida d’écrire ces mots sur un calepin et en remplit bientôt des pages entières.
Mais il ne comprenait pas davantage. Il lut jusqu’à trois heures du matin ; son cerveau était près d’éclater, mais il n’avait toujours pas saisi une seule idée essentielle du texte. Il s’arrêta. Sa chambre lui parut tanguer, rouler, plonger comme un navire en mer. Alors furieux, il lança la Doctrine secrète à travers la chambre, en jurant tout ce qu’il savait, éteignit le gaz… et s’endormit.
Avec les trois autres volumes, il n’eut pas beaucoup plus de chance. Son cerveau n’était cependant ni faible, ni paresseux : il aurait pu comprendre ces idées, sans son manque d’entraînement à réfléchir et son ignorance des moyens techniques pour y parvenir. C’est ce qu’il devina et il entretint un instant l’idée de ne lire que le dictionnaire, jusqu’au jour où il en aurait compris tous les mots.
La poésie, toutefois, était sa grande consolatrice ; il en lisait beaucoup, préférant les poètes simples, qu’il comprenait mieux. Comme la musique, la poésie l’émouvait profondément ; et, sans s’en rendre compte, il préparait ainsi son cerveau au labeur plus ardu qui allait venir. Les feuillets vierges de son esprit se remplissaient des choses qu’il aimait, de sorte qu’il put bientôt, à sa grande joie, se réciter des poèmes entiers qui lui plaisaient. Puis il découvrit les Mythes classiques de Gayley, et l’Époque mythologique de Bulfinch, qui jetèrent une grande lumière sur son ignorance totale à ce sujet et, plus que jamais, il se mit à dévorer la poésie.
À la bibliothèque, l’homme au pupitre avait si souvent vu Martin, qu’il était devenu très aimable ; il l’accueillait toujours à son entrée d’un sourire et d’un signe de tête. Encouragé par cette attitude, Martin, un beau jour, s’enhardit. Tandis que l’homme pointait ses cartes, il lança péniblement :
– Dites donc, je voudrais vous demander quelque chose…
L’homme eut un sourire et attendit.
– Quand vous rencontrez une dame et qu’elle vous demande d’aller la voir, quand pouvez-vous y aller ?
Martin sentait la sueur coller sa chemise contre ses épaules, tant il était gêné.
– Eh bien ! n’importe quand ! répondit l’homme.
– Oui, mais là c’est différent, expliqua Martin. Elle… je… Voyez-vous, voilà l’affaire : elle n’y sera peut-être pas. Elle suit les cours de l’Université.
– Retournez-y !
– Écoutez, ce n’est pas encore ça, confessa Martin en balbutiant, décidé à se confier entièrement. Voilà : je ne suis qu’un pauvre gars assez fruste et je ne connais rien à la société. Cette jeune fille est tout ce que je ne suis pas et je ne suis rien de ce qu’elle est… Vous ne croyez pas que je me moque de vous, au moins ? interrogea-t-il brusquement.
– Non, non, pas du tout, je vous assure, protesta l’autre. Votre requête n’entre pas exactement dans la ligne de mes références, mais je serais enchanté de vous rendre service.
Martin le regarda avec admiration :
– Si seulement je pouvais être comme ça, ça irait tout seul ! dit-il.
– Pardon ?
– Je dis : si je savais parler comme vous, facilement, poliment et tout ça.
– Ah ! oui, dit l’autre avec sympathie.
– À quelle heure faut-il y aller ? L’après-midi, pas trop tôt après le déjeuner ?… Ou le soir ? ou un dimanche ?
– Écoutez ! dit le bibliothécaire, le visage illuminé. Appelez-la au téléphone, et demandez-le-lui.
– C’est une idée ! dit Martin en prenant ses livres. Il fit deux pas, puis se retourna :
– Quand vous adressez la parole à une jeune fille – à, disons Miss Lizzie Smith – devez-vous dire : Miss Lizzie, ou Miss Smith ?
– Dites Miss Smith ! déclara le bibliothécaire avec autorité. Dites toujours Miss Smith, jusqu’à ce que vous la connaissiez mieux.
C’est ainsi que Martin résolut le problème.
– Venez quand vous voudrez ; j’y serai tout l’après-midi, répondit Ruth au téléphone, quand il lui demanda en balbutiant quand il pourrait lui rapporter les livres prêtés.
Elle le reçut elle-même sur le seuil du salon et son œil féminin remarqua immédiatement le pli du pantalon et un changement indéfinissable, mais certain, de toute sa personne. Son visage la frappa aussi. Une force violente, saine, émanait de lui et semblait ruisseler vers elle en ondes puissantes. De nouveau elle ressentit ce désir de se pencher vers cette force pour s’y réchauffer et s’étonna encore de l’effet que lui produisait sa présence. Et lui, à son tour, retrouva la divine sensation de bonheur infini au seul contact de sa main. Il y avait cependant une différence entre eux deux : elle était froide et calme et lui rouge jusqu’à la racine des cheveux. Il la suivit en trébuchant, aussi maladroit que la première fois, et ses épaules tanguaient et roulaient d’une façon inquiétante.
Une fois assis au salon, il se sentit plus à l’aise, bien plus même qu’il ne s’y attendait. Elle l’y aida de son mieux, avec une bonne volonté gracieuse qui la lui fit aimer plus follement que jamais. Ils parlèrent d’abord des livres prêtés, du Swinburne qu’il adorait et du Browning qu’il n’avait pas compris ; et elle mena la conversation d’un sujet à un autre, tout en se demandant comment elle pourrait lui être utile. Souvent, depuis leur première entrevue, elle avait pensé à lui. Il avait éveillé en elle une pitié, une tendresse que personne ne lui avait fait éprouver encore, moins peut-être par la compassion qu’il pouvait inspirer, que par un inconscient sentiment maternel. Sa pitié ne pouvait être banale, car l’homme qui la lui inspirait était trop viril pour ne pas effrayer sa pudeur et la troubler étrangement. Comme la première fois sa nuque la fascinait et elle retenait son envie d’y poser ses mains. C’était un instinct impudique, soit, mais elle s’était habituée à cette idée.
Elle n’imaginait pas un instant qu’un sentiment pareil pût être le commencement de l’amour, ni même qu’il pût s’agir d’amour. Elle croyait ne s’intéresser à lui que comme à un rare spécimen possédant certains pouvoirs occultes et se complaisait même à ce qu’elle croyait être de la philanthropie.
Elle ignorait qu’elle le désirait. Lui, au contraire, savait qu’il l’aimait et il la désirait comme jamais il n’avait désiré personne au monde. Il aimait la poésie parce qu’il aimait la beauté ; mais depuis qu’il l’avait rencontrée, les portes d’or donnant accès aux champs divins de l’amour poétique s’étaient ouvertes. Plus que Bulfinch et que Gayley, elle lui donnait la compréhension des choses de l’amour. Une semaine auparavant, il n’aurait pas seulement remarqué cette phrase : « L’amant fou d’amour mourant d’un baiser. » Maintenant elle le hantait ! il s’émerveillait de la trouver si vraie et, en contemplant Ruth, il sentait qu’il mourrait volontiers d’un baiser d’elle. De se savoir lui-même l’amant fou d’amour, l’enorgueillissait autant qu’un titre de noblesse. Enfin, il connaissait le sens de la vie et pourquoi il était sur terre.
À mesure qu’il la regardait, qu’il l’écoutait, ses pensées devenaient plus audacieuses. Il se remémora l’ardent bonheur que sa poignée de main, en entrant, lui avait donné et la souhaita encore. Son regard erra vers ses lèvres, et il les désira passionnément. Mais rien n’était grossier ni matériel dans ce désir. Il ressentait un plaisir exquis à étudier chaque mouvement, le moindre pli de ces lèvres, qui lui semblaient différentes de toutes les autres, faites d’une autre substance. C’étaient les lèvres d’un pur esprit, et son désir ne ressemblait pas au désir qu’il avait pu avoir pour d’autres lèvres de femmes… S’il baisait jamais cette bouche, ce serait avec toute la ferveur et la piété dont on baise la robe de Dieu. Il ne se rendait pas compte de cette transposition des valeurs en lui et ne se doutait pas que la lueur qui brûlait dans ses yeux était pareille à celle qui embrase tout regard masculin quand le désir d’amour le tient. Il ne connaissait pas l’ardeur de son regard, dont la flamme brûlante dissolvait peu à peu la chimie savante de ce cerveau de vierge. Cette chasteté évidente exaltait ses sentiments, en déguisait l’essence matérielle et il aurait été bien surpris d’apprendre que la lueur de ses yeux envahissait de ses ondes chaudes la jeune fille et lui communiquait une flamme subtilement troublante… Maintes fois, sans qu’elle sût pourquoi, ce délicieux envahissement rompit le fil de ses idées, la força à parler au hasard, de n’importe quoi. Elle causait d’habitude avec une grande facilité et ce trouble anormal l’aurait intriguée si, de parti pris, elle n’en avait imputé la cause à l’individualité remarquable de Martin. Comme elle était très sensible, il n’était nullement bizarre, après tout, que le rayonnement de la personnalité d’un tel voyageur l’ait impressionnée.
Le problème cependant se posait toujours de savoir comment pouvoir lui être utile et elle orienta la conversation dans ce sens ; ce fut d’ailleurs Martin qui la mit sur la voie.
– Je me demande si vous pourriez me donner un conseil, dit-il. (Le signe d’acquiescement qu’il reçut, fit bondir son cœur de joie.) Vous rappelez-vous que l’autre soir je vous ai dit que je ne pouvais parler de livres et de ce genre de choses, parce que je ne savais pas comment m’y prendre ? Eh bien ! depuis j’ai beaucoup réfléchi. J’ai passé mon temps à la bibliothèque, mais la plupart des livres que j’y ai lus étaient trop difficiles. Il faudrait peut-être commencer par le commencement. Je n’ai jamais eu l’occasion. Tout gosse je travaillais déjà dur, et depuis que je vais à cette bibliothèque, que je lis avec des yeux nouveaux, des livres nouveaux, j’ai compris que je n’avais jamais lu ce qu’il fallait. Ainsi, les livres qu’on trouve dans les corrals ou à la cambuse du bord ne ressemblent pas aux vôtres, vous comprenez ? Eh bien ! c’est à ce genre de lectures que j’étais habitué. Et pourtant, ce n’est pas pour me vanter, mais j’ai toujours été différent des gens avec qui j’ai vécu. Non pas que je sois meilleur que les matelots ou les bouviers avec qui je travaillais… – oui, pendant quelque temps j’ai été bouvier, – mais j’ai toujours aimé lire, lire tout ce qui me tombait sous la main, et… mon Dieu ! je crois que je pense différemment que la plupart de ces gens ! Maintenant, voilà où je voulais en venir : jamais je n’étais entré dans une maison comme celle-ci. Quand je suis venu la semaine dernière et que j’ai vu tout ça, votre mère, vous, vos frères et tout le reste, ça m’a plu ! On m’avait dit que ça existait et des livres le racontaient ; en voyant votre maison, j’ai compris que les livres disaient vrai. Mais ce que je veux dire, c’est ceci : tout ça m’a plu. J’en ai envie, tout de suite. Je veux respirer une atmosphère pareille à celle-ci, une atmosphère de lecture, de tableaux et de belles choses, où les gens ont des voix douces, des vêtements propres et des pensées propres. L’atmosphère que j’ai toujours respirée sentait la gargote, le loyer à payer, les vieux restes, l’alcool, et je n’ai jamais entendu parler que de ça. Tenez ! quand vous avez traversé la pièce pour embrasser votre mère, ça a été la plus belle chose que j’aie vue. Et j’en ai vu, des choses dans ma vie ! bien plus de choses que les types avec lesquels je me suis trouvé. J’aime voir, et je veux voir davantage et je veux apprendre à voir différemment. Mais je ne suis pas encore à la question ! Voilà ! je veux faire mon chemin vers une vie comme la vôtre. Il n’y a pas dans la vie que des soûleries, du travail éreintant et du vagabondage. Seulement, quel est le moyen d’y arriver ? Par quoi commencer ? Le travail ne me fait pas peur, vous savez ! et quand il s’agit de travailler ferme, j’ai vite fait de semer les autres. Une fois en train, je travaillerai jour et nuit… Vous trouvez peut-être ça drôle, que je vous demande tout ça ? Vous êtes la dernière à qui je devrais m’adresser, mais je ne connais personne d’autre… Arthur excepté. J’aurais peut-être dû lui demander. Si j’étais…
Sa voix s’éteignit. Ses grandes résolutions s’arrêtèrent devant l’horrible impression d’avoir peut-être commis une maladresse en ne s’adressant pas à Arthur et de s’être rendu ridicule. Absorbée, Ruth ne répondit pas immédiatement. Elle s’efforçait d’harmoniser ce discours gauche, hésitant et naïf, avec ce qu’elle voyait sur ce visage. Jamais elle n’avait vu des yeux exprimer de force aussi grande. Avec la puissance exprimée par ce visage-là, cet homme pouvait arriver à tout. Mais comme elle s’accordait mal avec la façon dont il exprimait sa pensée ! Il ressemblait à un géant ligoté qui se débat pour arracher ses liens.
Quand elle parla, ce fut avec une grande sympathie.
– Ce dont vous avez besoin, vous vous en rendez compte vous-même, c’est de vous occuper de votre éducation. Vous devriez retourner à l’école, travailler la grammaire, puis suivre les cours supérieurs et ceux de l’Université.
– Mais il faut de l’argent pour ça ! interrompit-il.
– Ah ! je n’y avais pas pensé ! s’écria-t-elle. Mais vous avez bien des parents, quelqu’un qui puisse vous aider !
Il secoua la tête.
– Mon père et ma mère sont morts. J’ai deux sœurs, une mariée et l’autre qui le sera bientôt, je suppose. Et puis j’ai une tapée de frères – je suis le cadet – mais jamais ils n’ont aidé personne. Ils vagabondent à travers le monde, à la recherche du gros lot. L’aîné est mort aux Indes. Il y en a deux en Afrique du sud, un autre pêche la baleine, un autre travaille dans un cirque – il fait du trapèze. Depuis que ma mère est morte, j’avais onze ans, je me suis élevé moi-même. Il faut donc que je me mette à étudier seul et j’ai besoin de savoir par où il faut commencer.
– Il me semble que la première des choses est de vous procurer une grammaire. Votre façon de parler est… (elle avait l’intention de dire « épouvantable » mais elle atténua en disant :) assez incorrecte.
Il rougit et son front se mouilla.
– Je sais : je parle argot, je dis un tas de mots que vous ne comprenez pas. Mais voilà… Ce sont les seuls mots que je sache prononcer, en somme. Dans mon cerveau, j’ai bien d’autres mots, des mots ramassés dans les livres, mais comme je ne sais pas les prononcer, je ne m’en sers pas.
– Ce n’est pas tant ce que vous dites, que la manière dont vous le dites. Vous ne m’en voulez pas d’être franche ? Je ne voudrais pas vous blesser.
– Non, non ! s’écria-t-il en la bénissant secrètement pour sa gentillesse. Allez-y ! Il faut que je le sache et j’aime mille fois mieux que ce soit par vous !
– Eh bien ! vous dites « un atmosphère » au lieu « d’une atmosphère » et « que je sais » pour « que je sache ». Vous faites des « doubles négations »…
– Qu’est-ce que c’est que ça, une double négation ? demanda-t-il en ajoutant humblement : Vous voyez, je ne comprends même pas vos explications.
– Il est vrai que je ne vous l’ai pas expliqué, dit-elle en souriant. Une double négation, c’est quand – voyons – enfin : par exemple vous diriez : « Je ne sais pas ne pas vous l’expliquer. » La première partie de la phrase est négative, la deuxième partie est négative aussi, la règle étant que deux négations font une affirmation, le sens de votre phrase serait que vous sauriez l’expliquer.
– C’est parfaitement clair ! je n’y avais pas pensé, dit-il après avoir écouté attentivement – et certainement je ne ferai plus cette faute-là.
La rapidité avec laquelle il comprenait la surprit et lui fit plaisir.
– Vous trouverez tout ça dans la grammaire, continua-t-elle. Et puis voici autre chose que j’ai remarqué dans votre façon de parler. Vous dites : « j’y ai dit » au lieu de « je lui ai dit ». Cela ne choque pas votre oreille : J’y ai dit ?
Il réfléchit une seconde, puis avoua simplement en rougissant :
– J’peux pas dire que ça me choque.
– Pourquoi encore ne dites-vous pas : je ne peux pas dire, reprit-elle. Et la façon dont vous avalez la moitié des mots ! c’est terrible !
Il se pencha en avant, tenté de se mettre à genoux devant un être si merveilleusement éduqué.
– Écoutez ! il m’est impossible de tout vous montrer. Il vous faut une grammaire ; je vais en chercher une et vous montrerai comment commencer.
Elle se leva et il en fit autant, hésitant entre le vague souvenir d’une chose qu’il avait lue sur le savoir-vivre, et la crainte qu’elle ne crût qu’il s’en allait.
– À propos, monsieur Eden, s’écria-t-elle en quittant la pièce, qu’est-ce que c’est qu’être poivre ? Vous l’avez dit plusieurs fois.
– Oh ! être poivre ? dit-il en riant. C’est de l’argot ! c’est quand on a trop bu.
– Ne vous servez pas dans ce cas du pronom « on », dites plutôt « je », riposta la jeune fille gaiement.
Quand elle revint avec la grammaire, elle approcha sa chaise – il se demanda s’il devait l’aider – et s’assit à côté de lui. Alors qu’ils lisaient ensemble, leurs têtes inclinées se frôlaient. C’est à peine s’il pouvait suivre ses explications, tant ce voisinage délicieux le troublait. Mais, lorsqu’elle entreprit de lui démontrer l’importance des conjugaisons, il oublia tout. Jamais il n’avait entendu parler de conjugaison et ce qu’il entrevit de la construction du langage l’émerveilla. Il se pencha davantage au-dessus du livre et les cheveux blonds caressèrent sa joue. Il ne s’était évanoui qu’une fois dans sa vie et crut qu’il allait recommencer. C’est à peine s’il pouvait respirer, tout le sang de son cœur lui sembla bondir à sa gorge, prêt à l’étouffer. Jamais elle n’avait paru si accessible. Pour le moment, un pont était jeté sur le gouffre qui les séparait. Et cependant, son respect pour elle n’en était nullement diminué. Elle n’était pas descendue des hauteurs. C’était lui qui s’élevait dans les nuages, vers elle. Son sentiment demeurait aussi fervent, aussi immatériel. Il lui sembla qu’il avait indûment touché au tabernacle sacré et, soigneusement, il éloigna sa tête de ce contact délicieux qui l’avait électrisé tout entier, incident dont elle ne s’était nullement doutée.
8
Il se passa plusieurs semaines, que Martin Eden consacra à l’étude de la grammaire ; il repassa le livre sur le savoir-vivre et dévora les volumes qui l’intéressaient. De son milieu il ne vit personne. Les habitués du Club des Lotus se demandaient ce qu’il était devenu, pressaient Jim de questions et quelques gars, les mêmes qui passaient les gants de boxe au « Kiley’s », se réjouissaient de l’absence de Martin.
Il avait fait à la bibliothèque la découverte d’un trésor. De même que la grammaire lui avait montré la construction de la langue, ce trésor lui montra celle de la poésie, et il put ainsi apprendre à connaître la métrique, la cadence, la forme, en un mot, des choses qu’il aimait. Un autre volume traitait de la poésie comme art représentatif, avec force citations prises dans les œuvres les plus belles. Aucun roman ne l’avait passionné autant que ces livres. Et son cerveau en friche depuis vingt ans et mûr pour le travail retenait ces lectures avec une puissance d’assimilation inhabituelle aux cerveaux mieux préparés.
Lorsqu’il regardait en arrière, du haut de ses progrès acquis, l’ancien monde qu’il avait connu – le monde des villes et de la mer, des marins et des filles faciles – il le trouvait bien mesquin ; et cependant, cet ancien monde se mêlait avec le nouveau, et il fut tout surpris en découvrant les points de contact qui les reliaient. L’élévation de pensée, toute la beauté qu’il trouvait dans les livres, l’ennoblissaient et il en était conscient, ce qui l’amena à croire plus fermement que jamais, que dans la classe de Ruth et de sa famille, tout le monde pensait de la même façon haute et belle et vivait de même. Dans les bas-fonds où il vivait, habitait la laideur ; il décida donc de se purifier de la laideur qui avait souillé toute sa vie passée et de s’élever jusqu’à ces régions exaltées où évoluaient les classes supérieures. Son enfance et son adolescence avaient été hantées par une inquiétude vague ; sans savoir ce qu’il désirait, il désirait quelque chose qu’il avait vainement cherché, enfin il avait rencontré Ruth. À présent cette inquiétude était devenue aiguë, douloureuse, car il savait nettement ce qu’il lui fallait : la beauté, la culture intellectuelle et l’amour.
Durant ces quelques semaines, il vit Ruth cinq ou six fois, et chaque fois ce lui fut un progrès nouveau. Elle l’aidait à parler correctement, corrigeait son anglais et lui fit commencer l’arithmétique. Leurs entrevues ne se bornaient pas, d’ailleurs, à de sèches études élémentaires. Il avait vu trop de choses, son esprit était trop mûr, pour qu’il pût se contenter de fractions, de racines cubiques, d’analyses et de conjugaisons ; parfois, ils causaient des derniers livres qu’il avait lus, du dernier poème qu’elle avait étudié. Et quand elle lui lisait à haute voix ses passages favoris, il était au comble de la joie. Jamais il n’avait entendu de voix pareille à la sienne. La moindre de ses intonations l’enivrait ; il frissonnait tout entier à chacun des mots qu’elle articulait. Tout en l’écoutant, il se rappelait les vociférations aiguës de femmes sauvages, de mégères avinées, et aussi les voix rudes et stridentes de filles du peuple. Puis, son imagination se les représenta ; il les vit défiler en troupeaux misérables, chacun exaltant, par la comparaison, les qualités de Ruth. Et, de sentir qu’en lisant les œuvres qu’elle avait lues, il pouvait vibrer des mêmes joies, doublait son bonheur. Elle lui lut une grande partie de La Princesse et souvent il vit ses yeux se remplir de larmes, tant sa nature esthétique ressentait la beauté. À de tels moments, il se sentait pareil à un dieu. Il la regardait, l’écoutait, il lui semblait voir le visage même de la vie et en découvrir les secrets. Alors, conscient du degré de sensibilité qu’il avait atteint, il se disait que c’était bien là l’amour, seule raison d’être au monde ; il passait mentalement en revue tous les anciens frissons, les flammes d’autrefois, l’ivresse de l’alcool, les baisers des femmes, les jeux violents, la fièvre des coups donnés et reçus, et tout cela lui semblait trivial et minable à côté de cette sublime ardeur qui le transportait.
Pour Ruth, la situation était assez obscure. Elle n’avait aucune expérience personnelle des choses du cœur, ses lectures l’ayant habituée à voir les faits ordinaires de la vie transposés, par une littérature d’imagination, dans le domaine de l’irréel. Et elle ne se doutait guère que ce rude matelot se glissait dans son cœur, où s’emmagasinaient peu à peu des forces latentes qui, un beau jour, l’embraseraient tout entière. Elle ne s’était pas encore brûlée au feu de l’amour. Sa connaissance en était purement théorique ; elle le concevait comme la flamme légère, douce, d’une veilleuse fidèle, comme une froide étoile scintillant dans le velours sombre d’une nuit d’été. Elle aimait se le figurer comme une affection placide, comme le culte d’un être dans une atmosphère calme, embaumée de fleurs, aux lumières atténuées. Elle était loin de supposer les sursauts volcaniques de l’amour, son ardeur dévorante et ses déserts de cendres. Ses forces lui étaient inconnues ; et les abîmes de la vie se transformaient pour elle en des océans d’illusion. L’affection conjugale de ses parents lui semblait être l’idéal des affinités amoureuses et elle attendait tranquillement le jour où, sans secousses ni complications, elle glisserait de sa vie de jeune fille à une existence à deux, semblable, paisible et douce.
Martin Eden lui apparut comme une nouveauté bizarre, un individu étrange et elle mit sur le compte de la nouveauté et de la bizarrerie l’effet qu’il lui produisait. N’était-ce pas en somme tout naturel ? Elle s’intéressait à lui au même titre qu’elle s’intéressait aux fauves d’une ménagerie ou au spectacle d’une tempête dont les éclats la faisaient frissonner. Comme les fauves, l’ouragan, la foudre, il était une force cosmique de la nature. Il lui apportait toute l’odeur du large et le souffle des grands espaces, le reflet du soleil tropical sur son visage ardent et, dans ses muscles saillants, toute la primordiale vigueur de la vie. Il avait subi l’empreinte de ce mystérieux monde de rudes marins et d’aventures plus rudes encore, dont elle ne pouvait s’imaginer la plus médiocre. Il était inculte, sauvage et sa vanité était flattée de le voir venir si vite à elle : cela l’amusait d’apprivoiser la bête fauve. Tout au fond d’elle-même et sans presque s’en douter, elle avait le désir de remodeler cette argile informe à la ressemblance de son père, qui représentait pour elle l’idéal masculin. Et son inexpérience absolue l’empêchait de comprendre que l’attraction qui la poussait vers lui était bien la plus instinctive des attractions, celle dont la puissance précipite hommes et femmes dans les bras les uns des autres, pousse les animaux à s’entre-tuer pendant la saison du rut et contraint les éléments eux-mêmes à s’unir.
La rapidité des progrès de la part de Martin était pour elle une source de surprise et d’intérêt. Elle découvrait en lui des possibilités insoupçonnées, qui fleurissaient tous les jours comme des plantes dans un sol fertile. Souvent, en lui lisant du Browning, elle s’étonnait des étranges interprétations qu’il donnait à certains passages discutables et elle ne pouvait comprendre comment, avec sa seule connaissance de l’humanité et de la vie, il donnait des interprétations souvent bien plus justes que les siennes. Sa conception des choses lui paraissait naïve, bien qu’elle fût maintes fois électrisée par l’audace de son envol, dont la trajectoire était si tendue qu’elle ne pouvait la suivre. Elle se contentait alors de vibrer au choc de cette puissance inconsciente.
Elle lui joua du piano – pour lui, non contre lui, comme alors – et l’éprouva avec de la musique dont la profondeur dépassait d’ailleurs de beaucoup sa propre compréhension. Comme une fleur au soleil, l’âme de Martin s’ouvrit à l’harmonie et la transition fut rapide entre les « ragtimes » et les « two-steps » de son milieu, aux chefs-d’œuvre classiques auxquels elle l’initiait aujourd’hui. Cependant il voua à Wagner, lorsqu’elle lui en eut donné la clef – à l’ouverture de Tannhäuser en particulier – une admiration toute démocratique ; du répertoire de Ruth, rien ne le séduisit autant, car c’était la personnification même de sa vie jusqu’alors, le motif du Venusberg signifiant sa vie passée, Ruth identifiée par le chœur des Pèlerins.
Par les questions qu’il lui posait parfois, il arrivait à la faire douter de ses propres définitions et de sa compréhension musicale. Mais il ne discutait pas son chant. Ce chant, c’était elle tout entière ; le timbre angélique de son pur soprano l’extasiait toujours ; il ne pouvait s’empêcher de lui comparer le piaulement aigu, le chevrotement chétif des ouvrières malingres et le braillement aviné des filles de bouges à matelots. Ruth aimait jouer et chanter pour lui. À la vérité, c’était la première fois qu’elle avait une âme entre ses mains et l’argile de cette âme était exquise à modeler, car elle s’imaginait le modeler et ses intentions étaient bonnes. D’ailleurs sa compagnie lui était agréable. Il ne l’effrayait plus ; sa première frayeur – due en réalité à la découverte de son moi inconnu – s’était évanouie. Elle se sentait maintenant des droits sur lui. Et il exerçait sur elle une influence tonique. Après son travail à l’Université, au sortir de ces livres poudreux, elle se délassait au souffle frais et fort de sa personnalité. La force ! C’était cela dont elle avait besoin et il lui en donnait généreusement. Être à côté de lui, lui parler, c’était boire de l’essence de vie. Après son départ, elle retournait à ses livres avec un intérêt plus vif et une nouvelle provision d’énergie.
Malgré sa connaissance approfondie de Browning, elle n’avait jamais pensé que ce pût être chose dangereuse que de jouer avec une âme. À mesure que son intérêt pour Martin grandissait, elle se passionnait davantage à l’idée de le remodeler.
– Vous savez, M. Butler ? lui dit-elle un après-midi, une fois la grammaire, l’arithmétique et la poésie finies. Eh bien ! ses débuts ont été assez difficiles. Son père était caissier dans une banque, mais il a végété longtemps, poitrinaire, et est mort dans l’Arizona ; ce qui fait qu’à sa mort, M. Butler – Charles Butler – s’est trouvé seul au monde, et sans le sou. Son père était Australien, il n’avait donc aucun parent en Californie. Il est entré dans une imprimerie – je le lui ai entendu raconter bien des fois – à raison de trois dollars par semaine. Maintenant il en gagne trente mille par an. Comment y est-il parvenu ? Il a été honnête, dévoué, économe et travailleur. Il s’est refusé tous les plaisirs des jeunes gens de son âge. Il s’astreignait à mettre de côté tant par semaine, au prix de n’importe quelles privations. Bien entendu, il a vite gagné plus de trois dollars par semaine et à mesure que son salaire augmentait, il économisait davantage. Il travaillait le jour au bureau et le soir à l’école. Jamais il ne perdait de vue son avenir. Plus tard, il a suivi le soir, les cours supérieurs. À dix-sept ans, déjà il touchait d’excellentes journées comme typographe ; mais il avait de l’ambition. Il voulait une carrière, non pas un gagne-pain et peu lui importait de sacrifier son confort actuel en vue d’un bien-être futur. Il s’est décidé pour le droit et est entré dans les bureaux de mon père comme garçon de courses, pensez un peu ! à quatre dollars par semaine. Mais il avait appris l’économie et, sur ses quatre dollars, il a continué à économiser.
Elle s’arrêta pour respirer et pour voir comme Martin écoutait. Il semblait vivement intéressé par la jeunesse difficile de M. Butler, mais un certain froncement de sourcil l’inquiéta.
– Pour un jeune homme, ça n’a pas dû être drôle tous les jours, évidemment, fit-il. Quatre dollars par semaine ! Comment pouvait-il vivre avec ça ? Il ne devait pas se payer des chaussettes de soie ! Tenez ! je paye à présent cinq dollars par semaine de pension et je vous assure que ça n’a rien de particulièrement rigolo. Il devait vivre comme un chien. Sa nourriture…
– Il la faisait lui-même, interrompit-elle, sur un petit poêle à pétrole.
– Sa nourriture devait être pire que celle des marins sur les plus mauvais rafiots et il n’y a pas plus infecte au monde.
– Mais pensez à ce qu’il est devenu ! s’écria-t-elle avec enthousiasme. Pensez à ce qu’il gagne ! Il est mille fois payé de ses privations passées.
Martin la regarda attentivement.
– Parions une chose ! dit-il. C’est que M. Butler n’en est pas plus gai pour ça ! Il s’est serré la ceinture pendant des années et des années durant sa jeunesse et je suis sûr que son estomac se venge à présent.
Elle baissa les yeux sous son regard interrogateur.
– Je parie qu’il est dyspeptique ! dit Martin.
– Oui, il l’est, confessa Ruth, mais…
– Et je parie, poursuivit Martin, qu’il est solennel et triste comme un vieux hibou, et qu’il ne s’amuse pas, malgré ses trente mille dollars par an… Et je parie que ça ne lui fait aucun plaisir de voir que les autres prennent du bon temps ! Ai-je raison, oui ou non ?
Elle fit signe que oui et se hâta d’expliquer :
– Mais il n’a pas un caractère à ça. Il est naturellement calme et sérieux. Il l’a toujours été.
– Ça, j’en suis sûr ! proclama Martin. Trois dollars, puis quatre par semaine, tout gosse, faire sa cuisine sur un fourneau à pétrole, économiser toujours, travailler toute la journée, étudier toute la nuit, travailler en somme toujours et ne jamais s’amuser, ne pas même savoir ce que c’est que de rigoler un peu – naturellement, ses trente mille dollars sont arrivés trop tard !
Son imagination bondissante lui avait immédiatement représenté les mille détails de cette existence et de ce pauvre développement intellectuel qui avait abouti à faire un homme qui touchait trente mille dollars par an. En un clin d’œil, la vie entière de Charles Butler se projeta dans son cerveau.
– Vous savez que je plains M. Butler, dit-il. Il était trop jeune pour le savoir, mais il s’est privé de vivre pour l’amour de trente mille dollars de rente, dont il ne profite même pas. Eh bien ! Tout cet argent ne lui achètera pas ce qu’il aurait pu s’acheter, enfant, avec les quatre sous qu’il économisait, de sucres d’orge et de billes ou de places à Guignol.
Cette façon de juger les choses surprenait Ruth… Non seulement elle lui était nouvelle et contraire à ses propres sentiments, mais elle y trouvait aussi des parcelles de vérité qui menaçaient d’effriter ou de modifier ses convictions. À quatorze ans, ses idées auraient peut-être pu changer ; mais à vingt-quatre ans, conservatrice par nature et par éducation, figée dans le milieu où elle était née et qui l’avait formée, les raisonnements bizarres de Martin la troublaient sur le moment, mais elle les attribuait à l’étrangeté de son existence et les oubliait vite. Pourtant, tout en les désapprouvant, la conviction qu’il mettait à les énoncer, l’éclair de ses yeux et la gravité de son visage la troublaient chaque fois et l’attiraient vers lui. Jamais elle n’aurait deviné qu’à ces moments-là, cet homme venu d’un milieu inférieur, la dépassait par la grandeur et la profondeur de ses conceptions. Comme tous les esprits limités qui ne savent reconnaître de limites que chez les autres, elle jugea que ses propres conceptions de la vie étaient vraiment très vastes, que les divergences de vues qui les séparaient l’un de l’autre marquaient les limites de l’horizon de Martin et rêva de l’aider à voir comme elle, d’agrandir son esprit à la mesure du sien.
– Mais je n’ai pas fini son histoire, dit-elle. Mon père affirme qu’il n’a jamais vu de travailleur pareil à M. Butler, quand il était garçon de courses. Il était toujours prêt à l’ouvrage ; non seulement il n’était jamais en retard, mais il venait généralement au bureau quelques minutes avant l’heure. Et avec ça, il trouvait le moyen d’étudier à ses moments perdus. Il étudiait la comptabilité, la dactylographie, et il prenait des leçons de sténographie la nuit, en faisant faire des dictées à un chroniqueur judiciaire qui avait besoin de s’exercer. Il est rapidement devenu clerc et a rendu d’inappréciables services. Papa voyait bien qu’il était de ceux qui réussissent. C’est papa qui l’a poussé à faire son droit. Il est devenu notaire et à peine rentré au bureau, papa en a fait son associé. C’est un homme remarquable. Il a refusé plusieurs fois d’entrer au Sénat des États-Unis et papa dit qu’il peut être juge à la Cour suprême à la première vacation, s’il en a envie. Une existence pareille est un bel exemple pour chacun de nous. Elle nous prouve qu’avec de la volonté tout homme peut s’élever au-dessus de son milieu.
– C’est un homme remarquable ! dit Martin sincèrement.
Mais il lui semblait que dans cette histoire, quelque chose choquait son sens de la beauté et de la vie. Il ne pouvait arriver à trouver une raison suffisante à la vie de privation et de misère de M. Butler. Qu’il l’ait fait pour l’amour d’une femme ou d’un idéal de perfection aurait été compréhensible. « L’amant fou d’amour » fait n’importe quoi pour un baiser, mais non pour trente mille dollars par an. Réflexion faite, la carrière de M. Butler ne le satisfaisait pas. Elle avait quelque chose de mesquin, après tout ! C’est très joli, trente mille dollars par an… mais la dyspepsie et l’incapacité d’être heureux leur enlèvent beaucoup de valeur.
Il essaya d’expliquer tout ceci à Ruth, la mécontenta et la persuada plus que jamais de la nécessité d’un remodelage complet. Elle avait une de ces mentalités comme il y en a tant, qui sont persuadées que leurs croyances, leurs sentiments et leurs opinions sont les seules bonnes et que les gens qui pensent différemment ne sont que des malheureux dignes de pitié. C’est cette même mentalité qui de nos jours produit le missionnaire qui s’en va au bout du monde pour substituer son propre Dieu aux autres dieux. À Ruth, elle donnait le désir de former cet homme d’une essence différente, à l’image de banalités qui l’entouraient et lui ressemblaient.
9
Une fois de plus, Martin Eden revint en Californie, cette fois enflammé par un désir d’amant. Sa provision d’argent épuisée, il s’était embarqué comme matelot de pont sur le schooner chercheur de trésor ; aux îles Salomon, après huit mois de recherches vaines, l’expédition s’était dissoute. L’équipage avait été licencié en Australie et Martin avait immédiatement repris passage sur un paquebot, à destination de San Francisco. Ces huit mois lui avaient rapporté non seulement de quoi rester de longs mois à terre, mais encore de quoi lire et étudier beaucoup. Il avait le goût très vif de l’étude, une grande facilité, une volonté indomptable, et, dominant tout, l’amour de Ruth comme but. Il avait travaillé la grammaire qu’il avait emportée, jusqu’à ce que son cerveau l’ait possédée à fond. Le langage incorrect dont se servaient ses compagnons, le choquait à présent et il s’amusait mentalement à corriger leurs barbarismes. À sa grande joie, il découvrit que son oreille s’éduquait et qu’il acquérait le sens de la grammaire.
Il avait potassé le dictionnaire et ajouté vingt mots par jour à son vocabulaire. Ce fut une tâche difficile ; à la barre ou en vigie il se forçait à repasser indéfiniment des prononciations et des définitions ; il les répétait en s’endormant, pour s’habituer à parler le langage de Ruth. Un jour, à sa grande surprise, il remarqua qu’il commençait à parler un anglais plus correct, plus pur que les officiers eux-mêmes et que ces espèces de « gentlemen aventuriers » qui avaient organisé l’expédition.
Le capitaine, un Norvégien aux yeux de poisson, possédait, Dieu sait par quel hasard, un Shakespeare, qu’il ne lisait jamais, et Martin, pour obtenir la permission de lire les précieux volumes, lui lava son linge. Cette lecture éduquait son oreille et lui faisait apprécier un anglais supérieur ; en revanche il emmagasina beaucoup de termes archaïques et démodés.
Ces huit mois avaient été bien employés, en somme ; en dehors de ce qu’il avait étudié, il avait appris bien des choses sur lui-même. Avec le sentiment de son ignorance, grandissait en lui le sentiment de sa puissance. Il sentait une grande différence entre ses camarades de bord et lui, et il était cependant assez sage pour reconnaître que cette différence consistait en possibilités plutôt qu’en faits. Ce qu’il faisait, ils auraient pu le faire ; mais au fond de lui-même, l’obscur levain qui fermentait lui faisait pressentir qu’il y avait en lui davantage et mieux. L’adorable splendeur du monde le transportait et il souhaitait ardemment la partager avec Ruth. Il décida de lui décrire tout ce qu’il pourrait des beautés des mers du Sud. À cette idée, l’esprit créateur qui était en lui s’éveilla et lui suggéra de recréer ces beautés pour un public plus nombreux. Alors, dans une auréole de splendeur et de gloire, naquit la grande idée : il écrirait. Il serait un de ces êtres privilégiés à travers lesquels le monde entier voit, entend et sent. Il écrirait – quoi ? de tout – des vers et de la prose, des romans et des pièces comme Shakespeare. Voilà quelle était sa carrière véritable et le chemin vers la conquête de Ruth. Les littérateurs étaient les conquérants du monde et il les trouvait autrement plus admirables que tous les Butler qui gagnent trente mille dollars par an et pourraient être juges à la Cour suprême, s’ils le voulaient.
Une fois qu’il eut cette idée dans la tête, elle le posséda entièrement et ce voyage de retour à San Francisco se fit comme dans un rêve. Il était ivre de forces inconscientes et enchaînées. Et voilà qu’un jour, sur la vaste mer déserte, le sens de la perspective naquit en lui. Pour la première fois, nettement, il vit Ruth et son milieu, concrétisés comme une chose qu’on peut saisir entre ses mains, tourner et retourner à loisir. Il y avait certes bien des points vagues, nébuleux, dans sa vision de ce monde, mais il n’entrevoyait que l’ensemble, non les détails et il voyait aussi le moyen de le posséder. Écrire !… Cette pensée le brûlait. Il commencerait aussitôt rentré. La première chose qu’il ferait serait de décrire le voyage des chercheurs de trésors. Et il apporterait cela à un journal de San Francisco, sans rien dire à Ruth, qui serait bien surprise et contente quand elle verrait son nom imprimé. Tout en écrivant, il continuerait d’étudier. Les jours n’avaient-ils pas vingt-quatre heures ? Il était invincible. Il savait comment on travaille et les citadelles les plus imprenables tomberaient devant lui. Il ne prendrait plus la mer – comme matelot du moins ; un instant, il eut même la vision d’un yacht. Bien entendu, se disait-il prudemment, il ne réussirait pas tout de suite, et pendant quelque temps il devrait se contenter de gagner assez d’argent avec sa littérature pour pouvoir continuer ses études. Puis, après un temps indéterminé – très indéterminé – une fois bien préparé, il écrirait un grand ouvrage et son nom serait célèbre. Mais ce n’était rien encore : au-dessus de tout ce triomphe, il y avait ceci : il se serait montré digne de Ruth. La gloire, c’était bien, mais Ruth, c’était la réalisation d’un rêve divin. Il n’était pas un arriviste, mais « l’amant fou d’amour »… tout simplement.
Une fois à Oakland, avec une paye rondelette dans sa poche, il reprit sa vieille chambre chez Bernard Higginbotham et se mit au travail, sans même faire savoir son retour à Ruth. Il irait la voir une fois son article sur les chercheurs de trésors terminé. L’excitation violente produite par la fièvre créatrice, l’empêcherait de trouver trop dure son abstention volontaire. D’ailleurs, le sujet même qu’il traitait la lui rendrait moins lointaine. Ne sachant trop quelle longueur lui donner, il se basa sur un article de deux pages dans le supplément du San Francisco Examiner dont il compta les mots. Au bout de trois jours de travail forcené, ce fut fini ; mais après l’avoir soigneusement copié, d’une large écriture facile à lire, il vit dans un livre de rhétorique trouvé à la bibliothèque, qu’il existait certaines choses appelées « paragraphes » et « renvois ». Il recommença donc son travail avec l’aide du livre de rhétorique et en un jour en apprit davantage sur la composition qu’un écolier moyen en un an. Après avoir recopié son article une seconde fois et l’avoir précieusement roulé, il lut dans un journal une notice de conseils aux débutants, qui prescrivait que les manuscrits ne devaient jamais être roulés, ni écrits sur les deux côtés de la feuille. Il avait donc doublement violé la loi. Cette notice lui apprit également que les articles de premier ordre se payaient au minimum dix dollars la colonne. Il se consola, en recopiant son manuscrit pour la troisième fois, à la pensée de toucher dix fois dix dollars, soit cent dollars et estima que c’était une meilleure affaire que la navigation. Sans ces erreurs, son article aurait été fini en trois jours. Cent dollars en trois jours !… Sur mer, il lui aurait fallu trois mois et davantage pour gagner autant. Comme c’est idiot d’être marin quand on peut être littérateur ! conclut-il. Pourtant il ne tenait pas à l’argent pour l’argent, mais pour l’indépendance qu’il donne, pour les vêtements présentables qu’on peut acheter avec, pour ce qui pourrait enfin le rapprocher, le plus vite possible, de la frêle et pâle jeune fille qui lui avait révélé le sens de la vie et l’avait inspiré.
Il mit le manuscrit dans une grande enveloppe et l’adressa au rédacteur du San Francisco Examiner. Il s’imaginait que tout ce qui était accepté par un journal était immédiatement publié, de sorte qu’ayant envoyé le manuscrit le vendredi, il s’attendit à le voir paraître le dimanche suivant. Ce serait magnifique d’apprendre de cette manière son retour à Ruth ! Le dimanche après-midi, il irait la voir. Il avait aussi une autre idée, une idée particulièrement morale, prudente et modeste, il s’en flattait. Il allait écrire une histoire d’aventures pour petits garçons et l’envoyer au Youth’s Companion. Les histoires en feuilleton y étaient habituellement publiées en cinq parties, de trois mille mots environ, chacune. Quelques histoires en avaient sept, et il décida d’en écrire une de la même longueur.
Il avait fait sur un baleinier, un voyage antarctique, quelques années auparavant, voyage qui devait durer trois ans et qui s’était terminé, par un naufrage, au bout de six mois. Bien qu’il eût une imagination pleine de fantaisie, quelquefois même de fantastique, son amour fondamental de la vérité le poussait à décrire les choses qu’il avait vues.
Il connaissait la pêche à la baleine et, avec son expérience personnelle comme base, il se mit à raconter l’histoire fictive de deux petits garçons. Un ouvrage facile ! se dit-il le samedi soir.
Le soir même, il avait fini la première partie, de trois mille mots, au grand amusement de Jim et sous les sarcasmes de M. Higginbotham, qui se moqua, durant tout le repas, du « scribouillard » qu’on avait découvert dans la famille.
Martin se contenta de se représenter la surprise de son beau-frère quand, dimanche matin, en ouvrant l’Examiner, il verrait l’article sur les chercheurs de trésors. De bonne heure, ce jour-là, il était sur le seuil de la porte d’entrée, parcourant nerveusement les nombreuses feuilles du journal. Il recommença une seconde fois très soigneusement, puis le replia, et le laissa là où il l’avait trouvé. Heureusement qu’il n’avait parlé à personne de cet article. En y réfléchissant, il conclut qu’il s’était trompé : dans les publications, les choses vont moins vite qu’il ne le pensait. D’ailleurs, son article n’était peut-être pas d’une actualité pressante et très probablement l’éditeur lui écrirait avant de l’insérer.
Après le petit déjeuner, il travailla son autre histoire. Les phrases coulaient de sa plume, bien qu’il s’interrompît souvent pour consulter le dictionnaire ou son livre de rhétorique. Il en relisait même des chapitres entiers et se consolait en pensant que, s’il n’écrivait pas les grandes choses qu’il sentait en lui, il apprenait en tout cas la composition et s’entraînait à former des images, à exprimer des pensées. Il travailla jusqu’à la nuit, puis s’en fut à la salle de lecture, compulser des magazines et des revues jusqu’à la fermeture. Tel fut son programme pendant une semaine. Chaque jour, il écrivait ses trois mille mots et chaque soir il piochait les magazines, prenant des notes sur des nouvelles, des articles, des poèmes. Il y avait une chose certaine : ce que cette multitude d’écrivains faisait, il pouvait le faire ; si on lui laissait le temps, il ferait même mieux. Il fut ravi de voir à « Livres nouveaux » dans un paragraphe sur le paiement des écrivains de magazines, non pas que l’on payait à Rudyard Kipling un dollar le mot, mais que le minimum payé par les magazines les plus cotés était de deux cents le mot. Le Youth’s Companion était certainement des mieux cotés ; dans tous les cas, d’ailleurs, les trois mille mots qu’il avait écrits ce jour-là, lui rapporteraient soixante dollars, deux mois de paye sur mer.
Le jeudi soir, l’histoire en sept parties fut terminée ; elle avait vingt et un mille mots. Il calcula qu’à deux cents le mot, il toucherait quatre cent vingt dollars, ce qui ne faisait pas une mauvaise semaine ! Jamais il n’aurait eu tant d’argent à la fois. Comment le dépenser ? Il avait découvert une mine d’or, en apparence inépuisable. Il projeta de s’acheter plusieurs complets, de s’abonner à quelques magazines et d’acheter une quantité de catalogues, qu’il était forcé jusqu’alors d’aller consulter à la bibliothèque. Malgré ces folles dépenses les quatre cent vingt dollars étaient à peine entamés. Il y réfléchit sérieusement et enfin l’idée lui vint de payer une servante à Gertrude et une bicyclette à Marianne.
Le volumineux manuscrit fut expédié au Youth’s Companion et le samedi après-midi, après avoir élaboré le plan d’un article sur la pêche des perles, il alla voir Ruth, non sans lui avoir préalablement téléphoné.
Elle vint le recevoir à la porte. De même qu’alors, la fraîche bouffée de saine vitalité qui émanait de lui la pénétra délicieusement ; il lui parut qu’un liquide brûlant s’infiltrait dans ses veines et faisait vibrer ses nerfs comme des cordes tendues. Il rougit violemment quand ils se serrèrent la main et qu’il rencontra son regard bleu – mais le hâle tout frais de ces huit mois de soleil cacha sa rougeur, bien qu’il fût impuissant à dissimuler la barre rouge produite par le col sur son cou. Elle s’amusa de ce dernier détail, puis, continuant son examen, s’étonna : ses vêtements lui allaient vraiment bien, faits sur mesure pour la première fois et le faisaient paraître plus mince et plus dégagé. Sa casquette était remplacée par un feutre mou ; elle le pria de le remettre pour juger de son allure générale puis elle le complimenta. Elle ne se rappelait pas avoir été si contente. Ce changement était son œuvre ; elle en était fière et de plus en plus désireuse de lui être utile.
Mais ce dont elle s’émerveilla, ce fut de son progrès dans sa façon de parler. Là, le changement était radical ; il parlait non seulement correctement, mais avec plus d’aisance, en choisissant ses mots – excepté quand il s’animait par trop : il retombait alors dans ses anciennes habitudes. Parfois aussi, en essayant des mots nouveaux, il hésitait, gêné. D’autre part, il déployait une légèreté, un esprit qui l’enchantèrent.
Cet humour, cette ironie légère l’avaient rendu populaire parmi ses camarades d’autrefois, mais jusqu’à ce jour il n’avait pu s’en servir avec elle, par manque de mots appropriés et par timidité. Il commençait à présent à s’orienter, à se sentir à l’aise. Il se lançait, entraînant Ruth dans la fantaisie et la gaieté sans oser la dépasser.
Il lui raconta ce qu’il avait fait, lui parla de ses projets d’avenir et de ses études. Mais là, il fut désappointé. Elle ne parut guère approuver ses vues.
– Vous comprenez, dit-elle franchement, écrire est un métier comme le reste. Je n’y connais rien, bien entendu, mais je l’ai entendu dire. Pour devenir forgeron, il faut travailler trois ans, ou même cinq. Et comme les écrivains sont bien mieux payés que les forgerons, il doit y avoir bien plus de gens encore qui aimeraient écrire… qui essayent d’écrire.
– Mais pourquoi ne serais-je pas spécialement doué pour écrire ? insista-t-il, secrètement ravi de la tournure de phrase raffinée qu’il avait employée, son imagination vive lui représentant en arrière-plan des scènes de sa vie passée, grossières, rudes, crues et bestiales.
En un éclair, des visions défilent et disparaissent sans interrompre la conversation ni le calme enchaînement de ses pensées. Il se voit, assis à côté de cette belle et douce jeune fille, causant en un anglais de bon ton dans une pièce pleine de livres et de tableaux, cossue et raffinée.
Et à travers un brouillard flottant, que transpercent les rayons d’une lumière rouge, il se voit dans un bar, avec des cow-boys qui boivent du whisky. Comme eux il jure et dit des obscénités, sous la lampe à huile fumeuse, tandis que sur la table on bat les cartes, au milieu du bruit des verres brisés, dans l’atmosphère lourde de fumée et d’haleines avinées… Il se voit sur le gaillard d’avant de la Susquehanna, nu jusqu’à la ceinture, les poings serrés, le jour de sa grande rencontre avec le Rouquin de Liverpool, et il se voit sur le pont sanglant du John-Roggers, le jour de la mutinerie, une triste matinée grise ; le vieux maître s’agrippait à la coupée dans les affres de la mort, le capitaine ; revolver au poing, abattait les hommes aux faces de brutes, qui tombaient en hurlant des blasphèmes.
… Il vit tout cela, puis se retrouva dans la douce clarté du grand salon, causant avec Ruth parmi des livres et des tableaux, non loin du piano à queue qu’elle ouvrirait tout à l’heure ; et il entendit l’écho de sa propre voix, dire en termes choisis :
– Mais pourquoi ne serais-je pas spécialement doué pour écrire ?
– Un forgeron aussi peut être doué pour son métier, dit-elle en riant, mais je n’ai jamais entendu dire qu’il puisse se passer d’apprentissage.
– Que me conseillez-vous ? demanda-t-il. N’oubliez pas que je sens en moi cette capacité d’écrire. Je suis incapable de l’expliquer exactement : je sais seulement que je l’ai.
– Il vous faut une éducation complète, répondit-elle, que vous vous destiniez ou non à la littérature. Peu importe le choix de votre carrière, il vous faut cette éducation, et il faut qu’elle soit faite à fond et sérieusement. Vous devriez aller à l’école supérieure.
– Oui, fit-il.
Mais elle l’interrompit pour ajouter :
– Bien entendu, vous pourriez continuer à écrire aussi.
– Il le faudra bien, dit-il d’un ton acerbe.
– Pourquoi ?
Elle le regarda, gentiment perplexe, car elle n’aimait guère l’obstination qu’il mettait à soutenir son idée.
– Parce que si je n’écrivais pas, il n’y aurait pas d’Université. Il faut que je vive, que j’achète des livres et des vêtements, vous comprenez !
– J’avais oublié ! dit-elle en riant. Pourquoi n’êtes-vous pas né avec des rentes ?
– Je préfère avoir une bonne santé et de l’imagination, répondit-il. Pour des rentes, je m’en contrefous : je peux me tirer d’affaire sans elles ; tandis que pour le reste… (Il faillit dire : je n’arriverais jamais à vous – mais corrigea sa phrase :) je n’arriverais jamais à rien.
– Ne dites pas : je m’en contrefous, s’écria-t-elle avec pétulance. C’est de l’argot !… C’est horrible !…
Il rougit, balbutia :
– C’est vrai. Je voudrais que vous me corrigiez chaque fois.
– Je… je veux bien, dit-elle en hésitant. Vous êtes un type si bien que je vous désire parfait.
Il fut alors une cire molle entre ses mains, aussi impatient d’être modelé par elle, qu’elle-même était désireuse de le former à l’image de son idéal masculin. Quand elle lui fit remarquer qu’il fallait se presser, les examens d’entrée à l’école supérieure commençant le lundi suivant, il se déclara prêt à les affronter.
Puis elle joua et chanta pour lui, tandis qu’il la buvait des yeux ; il s’enivrait de sa beauté et s’étonnait de ce qu’il n’y ait pas autour d’elle une foule d’admirateurs à l’écouter et à la désirer, comme il l’écoutait et la désirait.
10
On le retint à dîner ce soir-là et, à la grande satisfaction de Ruth, il fit bonne impression à son père. On parla de la carrière de marin, sujet que Martin possédait sur le bout du doigt ; et M. Morse déclara ensuite qu’il lui semblait être un jeune homme de beaucoup de bon sens.
Dans son désir de parler correctement, Martin était forcé de parler lentement, ce qui lui permit de mieux exprimer sa pensée. Il se sentait plus à l’aise que lors du premier dîner, un an auparavant : sa modestie et sa réserve plurent à Mme Morse qui ne fut pas sans remarquer ses progrès évidents.
– C’est la première fois que Ruth remarque un homme, dit-elle à son mari. Elle est toujours si indifférente en ce qui concerne les hommes, que ça m’ennuyait beaucoup.
M. Morse dévisagea sa femme avec curiosité.
– Tu as l’intention de te servir de ce jeune matelot pour la réveiller ? lui demanda-t-il.
– Je veux faire, en tout cas, mon possible pour qu’elle ne meure pas vieille fille. Si ce jeune Eden peut éveiller son intérêt pour l’humanité en général, tant mieux !
– Parfaitement, répliqua M. Morse. Mais supposons, – car il faut quelquefois supposer l’impossible, ma chère, – supposons qu’il éveille en elle un intérêt par trop particulier ?…
– Impossible ! dit Mme Morse en riant. D’abord, elle a trois ans de plus que lui, et puis… non, c’est impossible. Rien de pareil n’arrivera, fie-toi à moi !
Pendant que le rôle de Martin se précisait ainsi, il méditait, entraîné par Arthur et Norman, une excentricité. Ils avaient arrangé une promenade à bicyclette pour le dimanche matin, projet qui n’intéressa Martin que lorsqu’il apprit que Ruth devait en être aussi. Il ne savait pas monter à bicyclette et d’ailleurs n’en avait pas : mais, puisque Ruth montait, il n’avait qu’à apprendre, se dit-il. En rentrant donc, il se rendit dans un magasin de cycles et en acheta une de quarante dollars – un mois de paye durement gagnée ! Cette dépense réduisait singulièrement ses économies. Mais il réfléchit qu’en ajoutant aux cent dollars qu’il toucherait de l’Examiner, les deux mille que lui devrait le Youth’s Companion, tout s’arrangerait. Il traita avec la même indifférence le fait d’abîmer complètement son nouveau complet, en essayant de rentrer à bicyclette ce soir-là ! En arrivant au magasin de M. Higginbotham, il commanda, par téléphone, un nouveau complet au tailleur. Puis, le long de l’escalier étroit, aussi vertical que l’échelle de secours qui occupait un côté de la maison, il hissa la bicyclette et découvrit qu’en écartant le lit du mur, il y avait juste assez de place, dans la petite chambre, pour lui et son vélo.
Il avait eu l’intention de consacrer tout le dimanche à la préparation du fameux examen ; mais l’article sur les pêcheurs de perles l’entraîna et il passa la journée à recréer fiévreusement les belles images qui le hantaient. Le fait que l’Examiner de ce jour-là avait oublié de publier son article sur les « Chercheurs de trésors » ne l’affectait nullement. Il planait bien trop haut pour cela. Comme il avait fait la sourde oreille à tous les appels, il se passa du lourd dîner dominical dont M. Higginbotham gratifiait invariablement sa famille. Pour M. Higginbotham, ce dîner représentait la marque extérieure de sa situation sociale et de sa prospérité ; il le fêtait donc par des platitudes sur les institutions américaines, sur la reconnaissance que l’on doit à ces institutions, qui permettent à tout honnête travailleur de s’élever, – et dans ce cas « s’élever » signifiait, ainsi qu’il le remarquait infailliblement, de garçon épicier devenir propriétaire des Denrées alimentaires Higginbotham.
Martin Eden, ce lundi matin, salua d’un soupir « les Pêcheurs de perles » non terminé et prit le tram pour Oakland et le collège. Et, lorsque quelques jours après, il vint savoir le résultat de ses examens, il apprit qu’il avait été mauvais en tout, excepté en grammaire.
– Votre grammaire est excellente, lui dit le professeur Hilton en le dévisageant à travers ses grosses lunettes, mais vous ignorez tout – absolument tout – des autres branches et votre histoire des États-Unis est abominable – il n’y a pas d’autre mot – abominable. Je vous conseillerais…
Le professeur Hilton s’arrêta, l’observant toujours, aussi hostile et incompréhensible qu’une de ses éprouvettes. Il était professeur de physique à l’Université, possédait une nombreuse famille, un maigre salaire et un fonds choisi de science apprise à la façon des perroquets.
– Oui, monsieur, dit humblement Martin, qui regrettait beaucoup de ne pas avoir en face de lui l’homme au pupitre de la bibliothèque, à la place du professeur Hilton.
– Je vous conseillerais donc de retourner à l’école pendant deux ans, au moins. Au revoir.
Martin ne fut pas autrement affecté par cet échec, et s’étonna de l’air vexé de Ruth, quand il lui rapporta le conseil du professeur. Son désappointement était si flagrant qu’il fut peiné d’avoir échoué – à cause d’elle, surtout.
– Vous voyez, dit-elle, j’avais raison. Vous en savez beaucoup plus que tous les étudiants qui entrent au lycée et pourtant vous échouez aux examens, parce que votre éducation est partielle, superficielle. Vous manquez de la discipline de l’étude, que seuls peuvent vous donner des professeurs expérimentés. Vous avez besoin de bases solides. Le professeur Hilton a raison, et si j’étais à votre place, j’irais à l’école du soir. Un an et demi vous suffirait. D’autre part, ça vous laisserait le temps d’écrire, ou bien, si vous ne pouvez pas gagner votre vie avec votre plume, vous pourriez vous trouver une situation.
« Mais si mes journées sont prises par un travail et mes soirées par l’école, quand vous verrai-je ? » se dit Martin, mais il ne formula pas sa pensée et se borna à dire :
– Ça me paraît si enfantin, d’aller à l’école du soir ! Ça me serait encore égal, si je pensais que ça servira à quelque chose. Mais je ne le crois pas. Je peux travailler plus vite qu’ils ne peuvent m’enseigner. Ce serait une perte de temps (Il pensa à son désir d’elle) et je ne veux pas perdre de temps. Je n’ai pas de temps à perdre.
– Il y a tant de choses nécessaires ! (Elle le regardait gentiment et il sentit qu’il était une brute de lui résister.) La physique et la chimie, impossible d’en faire, sans études de laboratoire et sans guide. L’algèbre et la géométrie vous décourageront. Il faut des professeurs expérimentés, des spécialistes dans l’art d’enseigner.
Il resta un moment silencieux, en cherchant la façon la moins vaniteuse de s’exprimer.
– Je vous en prie, ne me croyez pas vantard, fit-il enfin. Je ne sais pas m’exprimer. Mais j’ai le sentiment d’être ce que j’appellerais « instinctivement scientifique ». Je sais étudier tout seul, naturellement, comme un canard sait nager. Vous voyez les progrès que j’ai réalisés en grammaire. Et j’ai appris bien d’autres choses – vous ne vous en doutez pas. Et ce n’est que le début ! Attendez que je me mette en train ! À présent seulement je commence à voir clair, à piger.
– À piger ?… interrompit-elle en appuyant malicieusement.
– À savoir de quoi il retourne, se hâta d’expliquer Martin.
– Cela ne veut rien dire, en langage correct, fit-elle encore.
Il pataugea davantage.
– Je veux dire que je commence à voir la manière d’accoster.
Par pitié elle n’insista pas et il continua :
– La science me fait l’effet d’un bureau de renseignements. Chaque fois que je vais à la bibliothèque j’ai la même impression. Le rôle des professeurs est de donner des renseignements aux écoliers, d’une façon systématique. Ce sont des guides, voilà tout. Ils ne donnent rien d’eux-mêmes, ils ne créent rien. Tout est contenu au bureau de renseignements et ils ne font que désigner aux clients ce dont ils ont besoin, pour les empêcher d’errer indéfiniment. Mais moi, je ne me perds pas facilement. J’ai la bosse de l’orientation. Je sais toujours où j’en suis, s’pas… Quoi ? qu’est-ce que j’ai encore dit ?
– Ne dites pas « s’pas ».
– Vous avez raison, dit-il avec reconnaissance. N’est-ce pas ? Alors, s’pas – pardon ! n’est-ce pas ?… – Où en étais-je ? Ah ! oui, au bureau de renseignements. Eh bien ! il y a des mecs…
– Des gens ! corrigea-t-elle.
– Des gens, qui ont besoin de guides – presque tout le monde ; mais je crois que je peux, moi, m’en passer. J’ai passé un temps infini au bureau de renseignements et je commence à m’y reconnaître, à savoir ce que je veux trouver, quels rivages je veux explorer. Et de la façon dont je m’y prends, je naviguerai bien mieux tout seul. La marche d’une escadre se règle d’après la vitesse du bateau le plus lent, vous le savez ; pour l’enseignement, c’est la même chose. Les professeurs ne peuvent aller plus vite que la moyenne de leurs écoliers, et mon pas serait plus rapide que celui de la classe tout entière.
– Qui veut voyager vite, doit voyager seul ! cita Ruth.
Il eut envie de répondre : Avec vous, je voyagerais encore plus vite – car il voyait apparaître la vision d’un monde d’infinie clarté, qu’il parcourait, avec elle dans ses bras, ses cheveux d’or pâle caressant ses joues. Bon Dieu ! combien était pitoyable cette impuissance d’exprimer ce qu’il ressentait ! Un désir lancinant le poignait, de pouvoir lui décrire des visions qui flamboyaient dans son cerveau. Ah ! maintenant il comprenait ! Il avait la clé du mystère. Voilà ce que réalisaient les grands écrivains, les grands poètes. Voilà pourquoi c’étaient des Titans ! Ils savaient exprimer leurs pensées, leurs rêves et leurs sentiments. Souvent, endormis au soleil, les chiens gémissent, aboient, mais ils sont incapables de dire ce qui les fait gémir ou aboyer. Voilà ce qu’il était : un chien endormi au soleil. Des visions nobles et magnifiques lui apparaissaient, et il ne savait que gémir et aboyer vers Ruth. Mais il ne dormirait plus au soleil. Debout, les yeux grands ouverts, il lutterait, travaillerait, souffrirait, en attendant le jour où, la langue déliée et les yeux dessillés, il saurait lui faire partager ses richesses cérébrales. Pourquoi ne trouverait-il pas, comme tant d’autres, la façon de dominer les mots, de les assembler de façon à leur donner une signification personnelle… L’apparition du mystère le remua profondément, et, de nouveau la vision des grands espaces étoilés l’emporta très loin… Tout à coup, frappé par le silence, il vit Ruth qui le regardait d’un air amusé.
– Une vision m’est apparue, dit-il, et le son de sa propre voix le fit sursauter. D’où venaient ces mots, expression adéquate de l’interruption que son rêve avait fait subir à la conversation ? Quel était ce miracle ? Jamais encore il n’avait su exprimer aussi nettement une pensée élevée. Il est vrai qu’il n’avait jamais essayé. Mais Swinburne, Tennyson, Kipling et tous les autres poètes l’avaient fait. Soudain ses « Pêcheurs de perles » lui revinrent à l’esprit. Il ne s’était pas encore lancé dans les grandes choses ; il pourrait se servir du sentiment de la beauté qui le brûlait. Mais une fois fini, cet article serait différent. La grandeur du sujet le frappa tout à coup ; il se demanda audacieusement pourquoi il n’essayerait pas de célébrer cette beauté en vers ? Et pourquoi ne chanterait-il pas les délices infinies et l’enchantement de son amour pour Ruth ? Tant de poètes avaient célébré l’amour ! Il le ferait aussi, nom de Dieu !
À son oreille stupéfaite, il entendit cette exclamation retentir, nette et sonore. Entraîné par son enthousiasme, il avait pensé tout haut. Le sang afflua à son visage, en bouffées si violentes qu’elles en teintèrent même le hâle bronzé jusqu’à la racine des cheveux.
– Je… je vous demande pardon…, bégaya-t-il. Je pensais.
– Vous paraissiez prier, dit-elle bravement, mais dans son for intérieur elle était profondément choquée.
C’était la première fois qu’un homme de sa connaissance jurait devant elle et cela la froissait, non seulement dans ses principes et son éducation, mais dans son esprit car ce souffle brutal de la vie pouvait en effet offusquer une jeune fille que l’existence avait jusqu’ici épargnée.
Mais elle l’excusa et s’étonna de sa facilité à le faire. Il n’avait pas eu la chance de naître comme tant d’autres, il faisait tout son possible – et il progressait si vite. Elle ne se figurait pas qu’elle pût avoir d’autres raisons d’être si bien disposée à son égard. De la tendresse qui la penchait vers lui, elle ne se doutait pas. Comment aurait-elle pu s’en douter ? La sérénité de vingt-quatre ans de vie toute blanche ne pouvait lui donner la perception nette de ses propres sentiments ; n’ayant jamais brûlé ses ailes, elle ne sentait pas le danger de la flamme.
11
Martin se remit à son article sur « les Pêcheurs de perles » ; il aurait été plus vite achevé, s’il n’avait été si fréquemment interrompu par ses essais de poésie. Ses vers étaient, bien entendu, des vers d’amour, inspirés par Ruth, et jamais terminés. Ce n’est pas en un jour qu’on peut apprendre à chanter sur un si noble thème. En eux-mêmes déjà, le rythme, la métrique et la forme étaient une assez sérieuse affaire, mais, par-dessus tout, il y avait une chose intangible, impalpable qui se sent dans tout beau poème et qu’il ne pouvait arriver à saisir. C’était l’insaisissable esprit de la poésie elle-même, qui ne se laissait pas capturer. Il le sentait autour de lui, comme un feu voletant, comme une chaude et molle vapeur, à portée de la main et pourtant hors d’atteinte ; quelquefois il en saisissait quelques lambeaux, une traînante nuée et en tissait des phrases qui chantaient dans son cerveau ou s’évanouissaient comme un brouillard léger. C’était décourageant. Il brûlait du désir de s’exprimer avec lyrisme et n’arrivait qu’à un pathos prosaïque et sans originalité. Il lut à haute voix ses essais. Ils avaient le nombre de pieds voulus, les rimes étaient impeccables, mais l’inspiration, l’envol faisaient défaut. C’était à n’y rien comprendre – et, de guerre lasse, désespéré, déprimé, vaincu, il se remit à son article. La prose était sûrement d’un accès plus facile.
Après « Les Pêcheurs de perles », il écrivit un article sur la carrière de marin, un autre sur la chasse à la tortue et un troisième sur les alizés du nord-est. Puis il composa, à titre expérimental, une courte nouvelle et, pendant qu’il y était, il en fit six autres, qu’il expédia à plusieurs magazines.
Il écrivait sans arrêt, du matin au soir et tard dans la nuit, s’interrompant seulement pour aller à la salle de lecture prendre des livres à l’abonnement, ou voir Ruth. Il était profondément heureux. La vie était intense et belle. Sa fièvre enthousiaste ne tombait jamais, car l’ivresse créatrice des Dieux était en lui. Le monde extérieur, les relents de légumes pourris et de lessive, l’apparence débraillée de sa sœur et la figure ironique de M. Higginbotham, tout cela était un rêve. Le monde véritable était celui de son cerveau et les histoires qu’il écrivait la seule réalité possible.
Les jours étaient trop courts. Il voulait étudier tant de choses ! Il ne dormit plus que cinq heures et, trouvant que c’était encore exagéré, il essaya de rogner une demi-heure de plus, mais il fut obligé, à son grand regret, de revenir à ses cinq heures. C’est avec regret qu’il cessait d’écrire pour étudier, qu’il cessait d’étudier pour aller à la bibliothèque, qu’il s’arrachait de là ou de la salle de lecture remplie des œuvres de ces écrivains heureux qui avaient réussi à placer leur marchandise. C’était un crève-cœur, quand chez Ruth, il fallait se lever et partir, et il galopait le long des rues sombres, pour retrouver bien vite ses chers volumes. Ce qui lui semblait le plus dur, c’était de fermer ses livres de physique et d’algèbre, de ranger bloc-notes et crayon et de clore ses yeux las pour dormir. Il détestait l’idée qu’il cessait de vivre, même pour peu de temps et ne se consolait qu’à la pensée d’entendre le réveil cinq heures après. Il ne perdrait que cinq heures, en tout cas, puis, la sonnerie le ferait bondir hors de son inconscience et il aurait de nouveau devant lui une admirable journée de dix-neuf heures.
Avec tout cela, les semaines passaient, son argent aussi et les rentrées ne se faisaient pas. Un mois après son envoi au Youth’s Companion, la suite d’aventures pour enfants lui fut retournée, avec un mot de refus si plein de tact, qu’il ne put en vouloir au rédacteur. Mais il n’en fut pas de même pour le rédacteur du San Francisco Examiner. Après avoir attendu deux semaines, Martin lui avait écrit. Il recommença au bout de huit jours. À la fin du mois, il s’en fut à San Francisco, chez le rédacteur, mais sans rencontrer ce haut personnage, grâce à un cerbère d’une douzaine d’années à cheveux carotte, qui gardait la porte. À la fin de la cinquième semaine, le manuscrit lui revint par la poste, sans commentaires, sans explications, sans rien. Ses autres articles lui furent renvoyés de la même manière. Il les expédia alors immédiatement à d’autres magazines, de l’Est cette fois, qui les retournèrent rapidement, toujours accompagnés d’un mot de refus imprimé.
Les nouvelles revinrent également. Il les relut plusieurs fois, et les trouva si bien qu’il ne pouvait comprendre le motif de leur renvoi, jusqu’au jour où il vit dans un journal que les manuscrits devaient toujours être écrits à la machine. Voilà qui expliquait tout. Bien entendu, les rédacteurs étaient trop occupés pour perdre leur temps à lire des ouvrages écrits à la main. Martin loua aussitôt une machine à écrire et passa une journée à apprendre à s’en servir. Tous les jours il copiait sa dernière composition et recopiait ses manuscrits à mesure qu’on les lui renvoyait. Il s’étonna le jour où les copies dactylographiées commencèrent à lui revenir aussi. Sa mâchoire se serra, son menton avança légèrement, et il renvoya les manuscrits à d’autres éditeurs.
Il en vint alors à se demander s’il pouvait porter un jugement de valeur sur ses propres ouvrages et les lut à Gertrude. Elle le regarda avec des yeux brillants d’orgueil et déclara :
– C’est beau de savoir écrire des choses comme ça !
– Oui, oui, dit-il avec impatience. Mais l’histoire ? Comment trouves-tu l’histoire ?
– Magnifique, absolument magnifique ! Et intéressante aussi. J’en étais toute bouleversée.
Il vit qu’elle ne disait pas entièrement sa pensée : sa bonne figure était perplexe et il attendit.
– Mais, dis-moi, Mart, fit-elle après une longue hésitation, comment ça finit-il ?… Ce jeune homme si poseur, l’a-t-il obtenue ?…
Il lui expliqua la fin, qu’il croyait cependant claire et artistement soignée. Alors elle déclara :
– Voilà ce que je voulais savoir ! Pourquoi ne l’as-tu pas raconté comme ça, dans ton histoire ?
Après avoir lu un certain nombre de ses élucubrations il fut au moins certain d’une chose : c’est qu’elle aimait les fins heureuses.
– Cette histoire est absolument magnifique. (Elle redressa, avec un soupir de lassitude, son corps lourd penché au-dessus de la lessiveuse, en essuyant, du revers de sa main rouge, son front suant.) Mais ça me rend triste. J’ai envie de pleurer. Il y a déjà trop de choses tristes dans la vie. Je préfère les histoires gaies, qui me font rire. S’il l’avait épousée, n’est-ce pas, et… Ça ne te fait rien, Mart ? interrogea-t-elle, avec appréhension. J’ai cette idée parce que je suis fatiguée, je suppose. Mais ton histoire est tout de même splendide – tout à fait splendide. Où vas-tu la vendre ?
– Ça, c’est une autre paire de manches ! dit-il en riant.
– Mais si tu la vends, combien t’en donnera-t-on ?
– Oh ! cent dollars au moins, étant donné le prix qu’on en demande.
– Dieu ! J’espère que tu la vendras !
– C’est facilement gagné hein ? (et il ajouta fièrement) J’ai écrit ça en deux jours. Ça me fait cinquante dollars par jour !
Il mourait d’envie de lire sa littérature à Ruth, mais il n’osa pas. Il décida d’attendre qu’une de ses histoires fût publiée ; elle comprendrait alors la raison de son obstination à écrire. Et, en attendant ce moment-là, il continua à travailler avec rage. Jamais son esprit aventureux ne s’était encore jeté avec autant de passion dans ce qu’il appelait l’exploration de son cerveau. Il acheta des livres de physique et de chimie et, avec l’aide de l’algèbre, il se plongea dans des problèmes et des démonstrations. Son intense puissance imaginative lui permettait de comprendre les réactions chimiques sans en voir faire l’expérience, plus facilement que la moyenne des étudiants qui vont au laboratoire. Martin poursuivait son chemin à travers les textes lourds de science, enthousiasmé par les explications qu’il y trouvait de la nature des choses. Autrefois il acceptait le monde tel qu’il était, sans chercher plus loin : il en comprenait à présent le jeu et les courants contraires de la force et de la matière. Des solutions spontanées surgirent dans son esprit sur maints petits détails de son métier d’autrefois. Les lois de la navigation qui permettent aux navires de suivre infailliblement leur voie à travers l’océan illimité lui furent expliquées, ainsi que les mystères des éléments ; et il se demanda s’il n’aurait pas, par malheur, écrit trop tôt son article sur les vents alizés du nord-est. En tout cas, il comprit qu’il l’aurait mieux écrit à présent.
Un après-midi, Arthur le conduisit à l’Université de Californie où, haletant et avec un respect quasi religieux, il parcourut des laboratoires, assista à des démonstrations et entendit le cours d’un professeur de physique.
Mais rien ne lui faisait négliger d’écrire. Un torrent de nouvelles s’écoula de sa plume et il se lança dans des vers plus faciles, du genre de ceux qu’il lisait dans les magazines. Cependant, une tragédie en vers libres lui mit le cerveau à la torture ; elle lui fit perdre deux semaines, car elle fut renvoyée par une demi-douzaine de journaux, avec une célérité qui le surprit. Puis il découvrit Henley, ce qui lui fit écrire une série de poèmes marins sur le modèle de Croquis d’hôpital, des poèmes simples et romanesques, pleins de lumière, de couleur et d’action, qu’il appela « Poèmes de la Mer ». Il les jugea meilleurs que tout ce qu’il avait écrit précédemment. Il y en avait trente et il les termina en un mois, en écrivant un par jour, après avoir fini son travail quotidien, qui équivalait à une semaine du travail d’un écrivain moyen. Le travail ne lui coûtait rien : pour lui ce n’était pas du travail. Il avait découvert une forme d’expression, il donnait tout simplement libre cours au trésor de beauté et d’émerveillement que, pendant ces longues années, ses lèvres scellées n’avaient pas su formuler.
Ses « Poèmes de la mer » il ne les montra à personne, pas même aux rédacteurs de revues, dont il commençait, d’ailleurs, à se méfier. Mais ce n’était pas la méfiance qui l’empêchait de leur soumettre les « Poèmes de la mer ». Ils lui plaisaient à tel point qu’il avait envie de les garder secrets, jusqu’au jour glorieux – lointain, hélas ! – où il oserait en faire partager la beauté à Ruth. Il les garda donc pour lui, en les relisant à haute voix, et en les apprenant par cœur.
Il vivait intensément toutes ses heures de veille et les heures de son sommeil, il les vivait aussi, car son esprit subjectif, pendant ces cinq heures de détente, transformait ses pensées et les événements du jour en de grotesques et fantastiques aventures. En réalité, il ne se reposait jamais : un tempérament moins solide ou un cerveau moins équilibré n’aurait pas résisté. Ses visites de l’après-midi à Ruth étaient rares maintenant, car juin approchait et elle allait passer sa licence à l’Université. « Licenciée es lettres ! Elle lui semblait s’envoler à des distances telles, qu’il ne pourrait jamais la rattraper.
Elle lui accordait un après-midi par semaine et, comme il venait tard, il restait généralement à dîner ; elle lui faisait ensuite de la musique. Il marquait ces jours-là d’une pierre blanche. L’ambiance de la maison, contrastant si fortement avec celle qu’il connaissait, et la seule présence de Ruth, enracinaient chaque fois plus solidement sa volonté de monter au sommet. Au-dessus de son désir impérieux de créer de la beauté, il y avait son désir de la conquérir, de haute lutte. C’était un amant avant tout et la magnifique aventure de son âme lui semblait plus miraculeuse encore que celle de son cerveau. La genèse d’où était sorti le monde, était un miracle moindre que la présence de Ruth dans ce monde. Pour lui, rien n’était aussi étonnant, aussi inouï que Ruth.
Cependant la distance qui les séparait l’oppressait toujours. Comment la franchir ? Dans son milieu, il avait eu beaucoup de succès auprès des femmes, sans jamais tenir à aucune d’elles ; mais il aimait Ruth, et la considérait, non seulement comme un être d’une classe supérieure, mais comme un être à part, tellement à part qu’il ignorait comment l’approcher. Pourtant, plus il se cultivait et plus il s’en approchait, en parlant le même langage, en partageant les mêmes idées et les mêmes jouissances intellectuelles. Mais rien de tout cela ne parvenait à satisfaire les aspirations de son cœur. Son imagination d’amoureux l’avait trop idéalisée pour qu’il pût rêver de s’approcher autrement que par l’esprit. C’était son amour même qui l’éloignait de lui et la lui rendait insaisissable. C’était l’amour lui-même qui lui refusait la seule chose qu’il désirât.
Et un beau jour, brusquement, une passerelle fut jetée sur l’abîme ; bien sûr, le gouffre existait toujours, mais il cessa d’être aussi large. Ils avaient mangé des cerises, de grosses cerises noires et luisantes, au jus couleur de vin sombre. Et, plus tard, tandis qu’elle lui lisait un passage de la Princesse, il remarqua que les cerises avaient taché ses lèvres. À l’instant même, son essence divine disparut. Elle était faite d’argile, après tout – comme lui, comme tout le monde ! Ses lèvres étaient d’une chair pareille à la sienne, puisque le jus des cerises les tachait aussi. Elle était femme – femme tout entière, comme toutes les femmes ! Cette révélation l’abasourdit. Il lui sembla que le soleil mourait au ciel.
Ensuite il comprit ce que cela signifiait – et son cœur se mit à danser et il pensa à faire la cour à cette femme, puisqu’elle était non pas un pur esprit, mais une simple femme, dont les lèvres pouvaient être tachées par des cerises. L’audace de cette pensée le fit trembler, mais son âme chantait joyeusement et le bon sens, triomphalement, lui clamait qu’il avait raison. Ruth dut sentir un peu de ce changement qui s’opérait en lui, car elle interrompit sa lecture, le regarda et sourit. Les yeux de Martin glissèrent de ses yeux bleus à ses lèvres et la vue de cette tache l’affola. Il faillit ouvrir ses bras et les refermer sur elle, comme il le faisait autrefois, du temps de sa vie insouciante. Elle se penchait vers lui et semblait attendre… Il se contint de toute sa volonté.
– Vous n’avez pas écouté un mot ! dit-elle d’un ton boudeur.
Puis elle éclata de rire, ravie de sa confusion, et, lorsqu’il la regarda dans les yeux, il vit qu’elle n’avait rien deviné de ce qui s’était passé en lui. Alors, il eut honte ; vraiment sa pensée avait été trop loin. Toutes les femmes qu’il avait connues auraient deviné ce qu’il en était. Et voilà où était la différence : Ruth n’avait rien compris. Il fut de nouveau désolé de sa propre grossièreté, et ému de l’innocence exquise de Ruth – et se retrouva de l’autre côté de l’abîme. La passerelle était rompue.
Malgré tout, cet incident les rapprocha. Quand il se sentait particulièrement découragé, le souvenir de cette minute lui revenait et il la savourait avidement. Oui, l’abîme était moins profond ; il avait accompli ce jour-là une chose autrement plus difficile que la licence es lettres et toutes les autres licences du monde. Elle était pure, divinement pure, c’est vrai, mais… des cerises avaient taché ses lèvres. Elle était sujette aux lois de l’univers, tout aussi inexorablement qu’il l’était lui-même. Il lui fallait manger pour vivre, et elle attrapait un rhume quand elle se mouillait les pieds. Mais là n’était pas la question. Si elle ressentait les atteintes de la faim, de la soif, de la chaleur et du froid, elle pouvait également ressentir celles de l’amour, de l’amour pour un homme : Et pourquoi ne serait-il pas celui-là ?…
– C’est de moi que cela dépend, murmura Martin avec ferveur. Je veux être cet homme. Je serai cet homme !
12
Un soir de bonne heure, tandis que Martin se battait avec un sonnet dans lequel il s’efforçait en vain d’exprimer les idées imprécises qui flottaient dans son cerveau, on l’appela au téléphone.
– C’est une voix de femme, de femme chic ! ricana M. Higginbotham.
Martin se dirigea vers le téléphone, dans le coin de la pièce, et une bouffée de chaleur l’envahit quand il entendit la voix de Ruth. Dans sa lutte avec le sonnet, il avait oublié son existence et le son de la voix aimée lui donna un coup au cœur. Quelle voix ! délicatement nuancée, comme une musique lointaine, comme un carillon d’argent, d’une pureté cristalline. Aucune femme n’avait une pareille voix. Elle venait de l’au-delà. C’est à peine, dans son ravissement, s’il entendit ce qu’elle disait, mais il ne laissa rien paraître de son trouble car il sentait les yeux de furet de M. Higginbotham braqués sur lui.
Ruth lui dit simplement que Norman, qui devait l’emmener à une conférence ce soir-là, avait la migraine ; elle était désappointée, car elle avait ses billets. S’il n’était pas pris déjà, voulait-il l’accompagner ?
S’il le voulait ? Il tâcha de calmer l’enthousiasme que pouvait trahir sa voix. Quelle chose inouïe ! Il ne l’avait encore vue que chez elle et jamais il n’avait osé lui demander de l’accompagner nulle part. Tout à coup, tout en continuant à lui parler, il désira mourir pour elle et des rêves d’héroïques sacrifices traversèrent son cerveau bouleversé. Il l’aimait tant ! si désespérément ! Qu’elle daigne sortir avec lui, – avec lui Martin Eden – le faisait délirer d’un tel bonheur qu’il lui semblait ne pouvoir le mériter qu’en mourant pour elle : pareil à tous les vrais amants, c’est par ce moyen seul qu’il aspirait à exprimer sa reconnaissance. Mourir pour elle, n’était-ce pas avoir bien vécu et bien aimé ? C’était la sublime abnégation de l’amour telle que peut la manifester le véritable amant. Il n’avait que vingt et un ans et il aimait pour la première fois.
Sa main tremblait lorsqu’il raccrocha.
– Ça, c’est un rendez-vous en ville, hein ?… persifla le beau-frère, on sait ce que ça veut dire ! Ça finira en correctionnelle !
Mais Martin ne l’écoutait pas, tout à son rêve étoilé. La vulgarité de l’allusion ne l’atteignit même pas. Il se sentait l’égal des dieux et n’aurait ressenti qu’une profonde pitié pour ce minus, s’il l’avait vu, mais ses yeux l’effleurèrent sans même le remarquer et il rêvait encore en quittant la pièce pour aller s’habiller. C’est lorsqu’il était en train de nouer sa cravate, que son ouïe se souvint d’un bruit désagréable qu’elle avait précédemment enregistré et c’était le reniflement final dont Bernard Higginbotham avait ponctué sa phrase.
Lorsque la porte d’entrée de Ruth se fut refermée sur eux et qu’ils descendirent l’escalier, il commença à être considérablement troublé. Tout n’était pas rose dans cette soirée impromptue. Il ne savait exactement quoi faire. Dans les rues il avait remarqué que certaines femmes donnaient le bras aux hommes qui les accompagnaient. Mais quelquefois elles ne le donnaient pas ; il se demanda si on offrait son bras le soir seulement, ou bien si cette coutume était réservée aux époux et aux parents.
Juste avant d’arriver au trottoir, il se rappela Minnie. Minnie l’attrapait toujours sur tout. La seconde fois qu’ils étaient sortis ensemble, elle l’avait rappelé à l’ordre parce qu’il marchait du côté intérieur, partant du principe qu’un gentleman doit toujours marcher du côté extérieur. Et Minnie ne manquait jamais de lui marcher sur les talons chaque fois qu’on traversait une rue, afin de lui rappeler de changer de côté. Il se demanda où elle pouvait bien avoir appris ces principes et s’ils étaient corrects.
Somme toute, il ne risquait rien d’essayer, se dit-il en arrivant au trottoir et, se précipitant derrière Ruth, il prit position à l’extérieur. Mais le second problème s’offrait encore. Fallait-il lui offrir le bras ? Jamais cela ne lui était arrivé, car les filles qu’il fréquentait n’en avaient pas l’habitude. Les premières fois, on marchait côte à côte ; puis, les bras enlaçaient les tailles et les têtes s’appuyaient à l’épaule de l’amoureux, dans les rues sombres. Ici, c’était différent. Elle n’était pas de ces femmes-là. Il fallait inventer autre chose.
Il arrondit le bras, très légèrement, sans affectation, comme s’il avait l’habitude de se tenir ainsi en marchant. Et la chose extraordinaire se produisit. Elle posa sa main sur son bras. Ce contact le fit frissonner délicieusement et il crut un instant avoir quitté la terre. Mais il y retomba aussitôt, affolé par de nouvelles complications. Il fallait traverser la rue ; il se trouverait par conséquent à l’intérieur. Devait-il dégager son bras et lui offrir l’autre ? Et dans ce cas, recommencer la même manœuvre chaque fois ? Question insoluble, dont il résolut de ne pas se tracasser. Cependant, quand il lui arrivait de se trouver à l’intérieur, pour cacher son embarras, il parlait vite et chaleureusement, feignant d’être tellement absorbé par son sujet que son enthousiasme lui ferait pardonner son incorrection, s’il y en avait une.
Lorsqu’ils traversèrent Broadway, un autre problème se présenta. Dans la clarté crue de l’électricité, il aperçut tout à coup Lizzie Connolly et sa copine qui pouffait toujours de rire. Un instant seulement il hésita, puis salua. Non, il ne renierait pas ceux de son espèce. Elle fit un signe de tête et le regarda bien en face, non pas avec l’expression douce et gentille de Ruth, mais de toute la profondeur appuyée de ses beaux yeux durs, puis son regard glissa vers Ruth, interrogeant son visage, sa robe, sa condition. Et il remarqua que Ruth l’enveloppait aussi d’un coup d’œil rapide, timide et doux – critique cependant ; un coup d’œil qui ne faisait qu’effleurer l’ouvrière à l’élégance bon marché, au chapeau excentrique très en vogue à cette époque-là parmi les filles d’usines.
– Quelle jolie fille ! dit Ruth un instant plus tard. (Martin l’aurait bénie pour cette parole. Pourtant, il dit simplement :)
– Je n’en sais rien. C’est une affaire de goût, évidemment, mais elle ne me paraît pas spécialement jolie.
– Comment ! peu de femmes ont des traits aussi réguliers. Elle est ravissante. Son visage a la finesse d’un camée. Et elle a des yeux admirables.
– Vous trouvez ? dit Martin d’un air indifférent. (Pour lui, il n’existait qu’une beauté au monde : celle qui marchait à son bras.) Il faudrait lui apprendre à parler. Je suis sûr que vous ne saisiriez pas le quart de ce qu’elle dit.
– Quelle bêtise ! Vous êtes aussi obstiné qu’Arthur quand il veut avoir raison.
– Vous oubliez comment je parlais quand vous m’avez connu. J’ai appris depuis. Mais autrefois, je parlais comme cette fille. À présent je peux me faire comprendre suffisamment dans votre langue pour vous dire que vous ne connaissez pas l’autre langage. Savez-vous d’ailleurs pourquoi cette fille se conduit comme ça ? Autrefois, je ne pensais pas à tout ça, mais je commence à comprendre un tas de choses…
– Et pourquoi donc ?
– Parce que depuis des années elle travaille aux machines. Quand on est très jeune, le corps est malléable, et la besogne trop dure le déforme à son gré, selon la nature du travail. Je peux deviner, du premier coup d’œil, le métier de la plupart des ouvriers rencontrés dans la rue. Regardez-moi : pourquoi mes épaules roulent-elles ?… À cause de mes années de mer. Si j’avais été cow-boy pendant aussi longtemps, je ne roulerais pas des épaules, mais j’aurais les jambes cagneuses. Pour cette fille, c’est pareil. Vous avez remarqué son regard si dur ? Personne n’a pris soin d’elle. Elle s’est élevée comme elle a pu, et une jeune fille qui n’a qu’elle pour se défendre ne peut avoir un regard doux, gentil, comme… comme le vôtre, par exemple.
– Je crois que vous avez raison, murmura Ruth. C’est triste. Elle est si jolie !
Il vit que ses yeux resplendissaient de pitié. Puis il se rappela qu’il l’aimait et s’émerveilla encore de la chance qui lui permettait de l’aimer et de lui donner le bras pour l’accompagner à cette conférence.
Ce soir-là, une fois rentré dans sa chambre, il se tint un discours, en se regardant dans la glace, longuement, avec curiosité. « Qui es-tu ? D’où sors-tu ? De fait, tu appartiens aux filles comme Lizzie Connolly, à la légion des travailleurs, à tout ce qui est bas, vulgaire et laid. Tu es de la même espèce que le bétail et les esclaves qui vivent dans l’immondice et la puanteur. Dans l’odeur des déchets de légumes, comme ceux-ci… Ces pommes de terre sont pourries ! Sens-moi ça !… Bon Dieu ! Et pourtant, tu oses ouvrir un livre, écouter de la musique admirable ; tu apprends à apprécier la belle peinture, à parler un anglais correct, à penser comme personne de ton milieu ne pense, à t’éloigner du bétail et des Lizzie Connolly ; tu oses aimer une adorable femme qui vit à cent mille lieues de toi, parmi les étoiles. Qui es-tu ? et qu’es-tu ? Bon Dieu ! Crois-tu au moins réussir ?… »
Il montra le poing à son reflet, s’assit au bord de son lit et se mit à rêver, les yeux grands ouverts. Puis il ouvrit calepin, algèbre et se perdit dans les équations. Les heures s’écoulèrent, les étoiles pâlirent et l’aube grise apparaissant à la fenêtre le trouva encore à sa table.
13
Ce furent une poignée de socialistes verbeux et de philosophes ouvriers, tenant leurs assises au Parc de City Hall, les chauds après-midi, qui furent responsables de la grande découverte.
Une ou deux fois par mois, en traversant le parc pour aller à la bibliothèque, Martin descendait de bicyclette, écoutait les controverses et ne s’en arrachait qu’à regret chaque fois. Le ton de la discussion y était bien moins élevé qu’à la table de M. Morse et l’assemblée n’était ni grave ni digne. Ils se mettaient volontiers en colère, s’insultaient : jurons et allusions obscènes émaillaient leurs altercations. Une ou deux fois même, ils en virent aux coups. Et pourtant, il ne savait pourquoi, quelque chose de vivant émanait de ces pensées apparemment confuses. Leur rhétorique stimulait bien davantage son intellect que le dogmatisme pondéré de M. Morse. Ces hommes qui assassinaient l’anglais, qui gesticulaient comme des fous et combattaient leurs idées réciproques avec une violence toute primitive, lui semblaient autrement vivants que M. Morse et son fidèle associé M. Butler.
Plusieurs fois Martin avait entendu citer Herbert Spencer dans ce parc. Et, un après-midi, apparut un disciple de Spencer – un chemineau minable dont le veston sale, boutonné sous le menton, dissimulait l’absence de chemise. La bataille fut engagée au milieu d’une formidable tabagie et de jets de salive brune, et le vagabond s’en tira avec honneur, même vis-à-vis d’un ouvrier socialiste qui lança en ricanant :
– Il n’y a de Dieu que l’Inconnu et Herbert Spencer est son prophète.
Martin se demanda quel était le sujet de la discussion, mais il continua son chemin vers la bibliothèque, animé d’un nouvel intérêt pour Herbert Spencer, et comme le chemineau avait fréquemment cité les Premiers Principes, il prit ce volume.
C’est ainsi que se fit la grande découverte. Une fois déjà il avait essayé du Spencer, mais, ayant choisi les Principes de psychologie pour débuter, il avait pataugé aussi piteusement qu’avec Mme Blavatsky. Sans avoir rien pu y comprendre, il l’avait rapporté. Mais cette nuit-là, après la physique, l’algèbre et les essais de poèmes, il se coucha et ouvrit les Premiers Principes. Au jour levant, il lisait encore. Et il n’écrivit pas de tout le jour. Allongé sur son lit il lut ; puis, fatigué du lit, il s’allongea par terre et lut, changeant de temps à autre de position. La nuit suivante il dormit et écrivit toute la matinée ; puis le livre l’attira de nouveau et il lut tout l’après-midi ; il en oublia même que ce jour était celui que Ruth lui accordait. Il ne reprit conscience du monde extérieur, que lorsque Bernard Higginbotham, ouvrant violemment la porte, lui demanda s’il croyait vraiment avoir affaire à un restaurant.
Toute sa vie Martin Eden avait été dévoré de curiosité. Il voulait savoir, tout savoir, et ce fut ce désir qui l’envoya courir les aventures à travers le monde. Mais Spencer lui apprenait aujourd’hui qu’il ne savait rien, et qu’il n’aurait jamais rien su, s’il avait continué à naviguer, à errer éternellement. Il n’avait fait qu’effleurer la surface des choses, n’avait observé que des phénomènes isolés, accumulé des faits fragmentaires, n’avait que généralisé d’une façon superficielle, tout cela sans méthode, au hasard de la chance et de son caprice. Il avait étudié avec compréhension la technique du vol des oiseaux, mais il n’avait jamais cherché à s’expliquer de quelle manière les oiseaux s’étaient développés en tant que mécanismes volants. Il ne se doutait même pas qu’un processus de ce genre existât ; les oiseaux avaient été créés ainsi et cela lui suffisait.
Il en était de même pour tout. Ses maladroits essais de philosophie avaient avorté, faute de préparation. La métaphysique moyenâgeuse de Kant ne lui avait servi à rien, qu’à douter de ses propres moyens intellectuels. De même, sa tentative d’étudier l’origine des espèces s’était bornée à parcourir une étude aride, toute technique, de Romanès.
Il n’y avait rien compris, si ce n’est que cette théorie sèche et poussiéreuse appartenait exclusivement à un petit nombre d’esprits mesquins dont le vocabulaire copieux était inintelligible. Et voilà qu’il apprenait à présent que l’évolution de la matière, au lieu d’être une théorie abstraite, était un mode de développement admis par tous les savants avec de simples divergences de méthodes.
Spencer lui simplifiait tout cela et présentait à son regard étonné un univers si parfaitement concrétisé qu’il lui semblait voir un de ces minuscules modèles de navires que les marins mettent dans des bouteilles transparentes. Rien n’était dû au hasard. Tout obéissait à des lois. L’oiseau obéissait à une loi en volant ; et la même loi avait pétri le limon de la terre, l’avait fait fermenter, lui avait fait pousser des ailes afin qu’il devienne oiseau.
Martin, de sommets en sommets, montait toujours. Les mystères de la création s’ouvraient devant lui : il était ivre de curiosité et de compréhension. La nuit, pendant son sommeil, il évoluait parmi les dieux en de colossaux cauchemars ; éveillé, il vivait comme un somnambule, le regard perdu, plongé dans l’univers qu’il découvrait. À table, il n’entendait pas les conversations mesquines et vulgaires. Dans son assiette il voyait luire le soleil et en suivait les transformations jusqu’à leur source, à des centaines de millions de lieues ; ou bien, il étudiait les réflexes des muscles de ses bras, qui lui permettaient de couper sa viande, les suivait jusqu’au cerveau, d’où jaillissait la volonté qui commandait ces réflexes. Il vivait dans l’hypnose, sans entendre le : « Bon à enfermer chez les dingues ! » murmuré par Jim, sans voir les regards inquiets de sa sœur, ni le geste moqueur de Bernard Higginbotham, imitant l’araignée qui habitait évidemment le cerveau de son beau-frère.
Ce qui, en quelque sorte, impressionnait Martin le plus profondément, c’était la corrélation de toutes les sciences entre elles. De tout temps, il avait emmagasiné beaucoup de choses dans des cases séparées de son cerveau. Ainsi, il en savait énormément sur la navigation. Sur les femmes également. Mais entre ces deux sujets il n’établissait aucun rapport. Qu’au point de vue scientifique, il pût y avoir une corrélation quelconque entre une femme sujette aux vapeurs et un schooner bravant la tempête, lui aurait semblé ridicule, impossible. Herbert Spencer lui démontra qu’il est au contraire impossible qu’il n’y ait pas corrélation. Tout est relié à tout, depuis les myriades d’atomes qui composent un grain de sable sur la plage.[1]
Cette nouvelle conception plongeait Martin dans une stupéfaction perpétuelle. Il dressa une liste des choses les plus incongrues : amour, poésie, tremblement de terre, feu, serpents à sonnettes, arc-en-ciel, pierres précieuses, montres, coucher de soleil, lion rugissant, électricité, cannibalisme, beauté, meurtre, poulie et tabac ; il jubilait quand il parvenait à les apparenter entre elles. Il unifiait ainsi l’univers et le contemplait, ou bien il se promenait à travers sa jungle, en voyageur pacifique ; il observait, notait, se familiarisait avec tout ce qu’il voulait connaître encore. Et plus il apprenait, plus il admirait la création, la vie et sa propre existence au milieu de toutes ces merveilles.
– Imbécile ! criait-il à son image dans le miroir. Tu voulais écrire, tu essayais d’écrire. Qu’est-ce que tu avais dans le ventre ? Quelques notions enfantines, quelques sentiments encore imprécis, beaucoup de beauté mal digérée, une énorme ignorance, un cœur plein d’amour à en éclater, une ambition aussi grande que ton amour, que ton ignorance. Et tu voulais écrire ! mais tu commences aujourd’hui seulement à acquérir en toi ce qu’il faut pour ça ! Tu voulais créer de la beauté ! et tu ne savais rien de ce qui fait la beauté ! Tu voulais parler de la vie, et tu ignorais tout ce qui fait l’essence même de la vie ! Tu voulais parler de l’univers et des problèmes de l’existence, quand l’univers n’était pour toi qu’un rébus chinois ! Mais courage, Martin, mon vieux ! Il y a de l’espoir, cette fois, bien que tu sois encore très ignorant. Un beau jour, avec de la chance, tu sauras à peu près tout ce qu’on peut savoir. Ce jour-là tu écriras.
Il fit part de sa grande découverte à Ruth pour qu’elle partage sa joie. Mais elle ne manifesta aucun enthousiasme particulier, ces choses-là lui étant évidemment familières, à cause de ses études personnelles. Arthur et Norman croyaient à l’évolution et avaient lu Spencer, sans en avoir reçu d’impression bien profonde, à ce qu’il semblait. Et Will Olney, le jeune homme à lunettes, ricana désagréablement au nom de Spencer et répéta l’épigramme : « Il n’y a de Dieu que l’Inexplicable et Herbert Spencer est son prophète. »
Mais Martin lui pardonna son ricanement, car il avait découvert qu’Olney n’était pas amoureux de Ruth. Plus tard, différents petits faits lui apprirent même, à sa grande stupéfaction, que, non seulement il n’en était pas amoureux, mais encore qu’elle lui déplaisait carrément. Martin fut impuissant à établir une corrélation entre ce phénomène et les autres phénomènes de la nature, et se borna à plaindre le jeune homme de ne pouvoir apprécier à sa valeur la finesse de Ruth et sa beauté.
Ils firent, le dimanche, plusieurs promenades à bicyclette dans la campagne et Martin put observer à loisir la paix armée qui existait entre Ruth et Olney. Celui-ci s’accordait fort bien avec Norman et laissait Arthur et Martin s’occuper de Ruth, ce dont Martin lui fut reconnaissant.
Ce furent là de beaux dimanches pour Martin, d’abord à cause de Ruth, puis à cause des rapports d’égal à égal, qu’ils créaient entre lui et les jeunes gens de ce milieu. Il se sentait intellectuellement leur pareil, en dépit de leurs nombreuses années d’éducation et de discipline cérébrale, et ses heures de conversation avec eux étaient autant d’heures utiles, pendant lesquelles il s’entraînait à suivre les règles de cette grammaire tant étudiée. Les traités de savoir-vivre, il les avait abandonnés ; il se contentait d’observer par lui-même ce qu’il convenait de faire. Sauf quand il se laissait entraîner par ses ardeurs enthousiastes, sa surveillance de lui-même ne se relâchait pas ; aucune de leurs manières ne lui échappait et il prenait d’eux, sans cesse, de nouveaux exemples de politesse et de raffinement mondain.
Durant quelque temps il resta surpris de voir qu’en somme, Herbert Spencer était peu lu.
– Herbert Spencer, lui dit l’homme au pupitre à la bibliothèque, oui… un grand cerveau.
Mais il lui parut ne rien savoir du contenu de ce grand cerveau.
Un soir, à un dîner où était également invité M. Butler, Martin engagea la conversation sur Spencer.
M. Morse condamna vertement l’agnosticisme du philosophe anglais, tout en avouant qu’il n’avait pas lu les Premiers Principes. M. Butler déclara que Spencer l’exaspérait, qu’il n’en avait jamais lu une ligne et n’en avait pas été plus malheureux pour cela. Des doutes s’élevèrent dans l’esprit de Martin ; il aurait abandonné Spencer pour se rallier à l’opinion générale, si sa personnalité avait été moins trempée. Mais malgré tout, les explications de Spencer lui paraissaient convaincantes et il se dit que lâcher Spencer équivaudrait, pour un navigateur, à jeter par-dessus bord compas et chronomètre.
Martin continua donc d’approfondir ses études sur l’évolution, de plus en plus convaincu par les témoignages corroborants d’un millier d’écrivains indépendants. Plus il travaillait, plus le champ de la science s’ouvrait devant lui ; il finit par avoir le regret maladif de ce que les jours n’avaient que vingt-quatre heures.
À cause de la brièveté des jours, il abandonna l’algèbre et la géométrie. De la trigonométrie, il n’en avait pas encore été question. Puis il retrancha également la chimie et ne garda que la physique.
– Je ne suis pas un spécialiste, dit-il pour s’excuser à Ruth. Et je ne veux pas essayer de le devenir. Il y a trop de spécialités, pour qu’un seul homme puisse, en une seule existence, en posséder à fond une seule miette. Des généralités, en fait de science, doivent me suffire. Quand j’aurai besoin des spécialistes, j’en appellerai à leurs livres.
– Mais ce ne sera pas comme si vous possédiez vous-même le sujet, dit-elle en protestant.
– C’est inutile. Nous profitons du travail des spécialistes. Ils sont faits pour ça. En arrivant, j’ai vu des ramoneurs à l’ouvrage. Ce sont des spécialistes, n’est-ce pas ? Eh bien, quand ils auront fini, vous serez contente de la propreté de vos cheminées, sans vous préoccuper le moins du monde de la manière dont elles ont été construites !
– C’est un peu tiré par les cheveux.
Elle le regarda avec curiosité et il sentit un vague reproche dans son regard et dans son attitude. Mais il était certain d’avoir raison.
– Toutes les grandes intelligences, les plus grands penseurs par exemple, se fient aux spécialistes. Herbert Spencer le faisait. Il généralisait sur les découvertes de milliers de chercheurs : pour faire tout lui-même, il aurait dû vivre plusieurs vies. Darwin de même, se servait de tout ce que lui avaient appris les botanistes et les éleveurs.
– Vous avez raison, Martin, dit Olney. Vous savez ce que vous voulez faire et Ruth n’en sait rien. Elle ignore elle-même ce qu’elle veut.
« … Oh ! certainement, continua Olney sans attendre son objection. Je sais que vous appelez ça : la culture générale. Mais si vous voulez avoir une culture générale, peu importe ce que vous étudiez. Vous pouvez apprendre le français ou l’allemand ou même l’espéranto : vous n’en serez pas moins cultivé. Vous pouvez également étudier le latin ou le grec ; ça ne vous servira à rien, mais ce sera quand même de la culture. Tenez !… Ruth, il y a deux ans, a étudié l’anglais ancien, et savez-vous ce qu’elle en a retenu ? – Whan that Sweet Aprile with his schowers soote. – C’est bien ça ?… (Il continua en riant, sans tenir compte de son interruption :) Mais votre culture générale, vous l’avez, je le sais : nous étions dans la même classe !
– Vous parlez de culture comme un moyen d’arriver à quelque chose ! s’écria Ruth. (Ses yeux étincelaient et ses joues délicates rougirent de colère.) La culture doit être le but.
– Mais ce n’est pas ça dont Martin a besoin.
– Qu’en savez-vous ?
– De quoi avez-vous besoin Martin ? demanda Olney, en se tournant brusquement vers lui.
Martin, très gêné, lança un regard d’appel à Ruth.
– Oui, de quoi avez-vous besoin ? questionna Ruth, ça tranchera la question.
– Mais, bien entendu, j’ai besoin de culture, balbutia Martin. J’aime la beauté, et la culture me la fera mieux apprécier.
Triomphante, elle fit un signe d’assentiment.
– Ça n’a pas le sens commun et vous le savez, fit Olney. Martin a besoin d’une carrière et non de culture. Mais il se trouve que dans son cas, la culture est indispensable à la carrière. S’il voulait être chimiste, elle serait inutile. Martin veut écrire, mais il a peur de vous le dire, parce que ça vous mettrait dans votre tort.
Il continua :
– Et pourquoi Martin veut-il écrire ?… parce qu’il ne roule pas sur l’or. Pourquoi vous bourrez-vous la tête d’anglais ancien et de culture générale ? Parce que vous n’avez pas besoin de gagner votre vie. Votre père est là pour ça. Il vous achète des robes et le reste. À quoi diable sert notre éducation, la vôtre, la mienne, celle d’Arthur et de Norman ? Nous sommes abreuvés de culture générale, et si nos bons parents se trouvaient tout d’un coup sur la paille, nous serions bien obligés de gagner notre croûte. Ce que vous pourriez souhaiter de mieux, Ruth, serait une place d’institutrice ou de professeur de piano dans une pension de jeunes filles.
– Et vous, que feriez-vous ? demanda-t-elle.
– Pas grand-chose de fameux ! Je gagnerais un dollar cinquante par jour, l’un dans l’autre, et je pourrais peut-être entrer comme professeur à Hanley, cette boîte à bachot, je dis « peut-être », vous entendez ! car je pourrais bien être fourré à la porte au bout de huit jours pour incapacité notoire !
Martin suivait de près la discussion et, tout en étant persuadé qu’Olney avait raison, il désapprouvait sa façon cavalière de traiter Ruth. Une nouvelle conception de l’amour se formait dans son cerveau en l’écoutant. La raison n’a rien à voir avec l’amour. Peu importe que la femme aimée raisonne plus ou moins justement, l’amour étant au-dessus de la raison. S’il arrivait à Ruth par hasard, de ne pas reconnaître clairement son besoin absolu d’une carrière, elle n’en était pas moins adorable. Elle était adorable et ses idées n’avaient rien à faire avec son charme.
– Quoi ? que dites-vous ? fit Martin, car Olney, en lui parlant, avait interrompu le cours de ses réflexions.
– Je disais : J’espère bien que vous ne serez pas assez bête pour taquiner le latin.
– Mais le latin, c’est plus que de la culture, dit Ruth. C’est une base.
– Alors, allez-vous vous y mettre ? insista Olney.
Martin fut très ennuyé, car il voyait que Ruth attendait anxieusement sa réponse.
– J’ai peur de ne pas avoir le temps, dit-il enfin. Mais ça me plairait.
– Vous voyez ! Martin ne recherche pas la culture ! (Olney exultait.) Il essaye d’arriver quelque part, de faire quelque chose !
– Mais c’est un entraînement mental ! C’est ça qui discipline les cerveaux ! (Ruth regarda Martin comme si elle en attendait un changement d’idées.) Les joueurs de football ont besoin de s’entraîner avant les grands matches. C’est à quoi sert le latin pour l’intellectuel : il entraîne.
– Idiotie et puérilité ! c’est ce qu’on nous dit quand nous sommes petits. Mais il y a une chose qu’on se garde bien de nous dire et qu’on nous laisse le soin de trouver par nous-mêmes plus tard ! (Olney s’arrêta pour mieux réussir son effet, puis ajouta :) Ce qu’on ne nous dit pas, c’est que tout le monde doit avoir étudié le latin, mais que personne n’a besoin de le savoir !
– Que vous êtes de mauvaise foi ! s’écria Ruth. Je savais bien que vous alliez vous en tirer de cette façon.
– C’est évidemment assez habile, mais pourtant assez juste ; les seules personnes qui savent le latin sont les pharmaciens, les notaires et les professeurs de latin. Maintenant, si Martin veut être l’un de ceux-là, je veux être pendu. Quel rapport avec Herbert Spencer, d’ailleurs ? Martin vient de découvrir Spencer et il en raffole. Pourquoi ? Parce que Spencer le mène quelque part. Or, Spencer ne peut me mener nulle part, ni vous non plus. Nous n’en avons pas besoin. Vous, Ruth, on vous mariera et moi, je n’aurai rien à faire qu’à surveiller les notaires et les hommes d’affaires qui prendront soin de l’argent que mon père me laissera un jour.
Olney se leva pour prendre congé, mais se retourna près de la porte pour lancer la flèche du Parthe.
– Laissez donc Martin tranquille, Ruth ! Il sait ce qui lui convient le mieux. Regardez ce qu’il a déjà fait ! Quelquefois il me fait honte. Il en sait plus à présent sur la vie, l’univers, les hommes et le reste qu’Arthur, que Norman, moi ou vous – oui, que vous, en dépit de tout votre français, votre latin, votre anglais et votre culture !
– Mais Ruth est mon professeur ! répondit courtoisement Martin. C’est à elle que je dois le peu que je sais.
– Quelle blague ! (Olney lança un coup d’œil malicieux à Ruth.) Je suppose que vous me direz la prochaine fois, que c’est sur sa recommandation que vous avez lu Spencer… seulement ce sera faux ! Et elle n’en sait pas plus sur Darwin et l’évolution de la matière que moi sur les mines du roi Salomon. Qu’est-ce que c’était déjà cette définition mirobolante de Spencer à propos de je ne sais quoi, que vous avez lancée l’autre jour ? Cette chose incohérente sur l’homogénéité ? Attaquez-la donc là-dessus ! et vous verrez si elle en comprend un seul mot ! Car ça, ce n’est pas de la culture, vous comprenez ? Allons, au revoir ! et si vous taquinez le latin, Martin, je n’aurai plus aucune considération pour vous !
Et tout le temps, malgré l’intérêt qu’il prenait à cette discussion, Martin s’ennuyait vaguement. On parlait d’études et de leçons, de sciences rudimentaires, sur un ton d’écoliers qui détonnait avec les grandes idées qui bouillonnaient en lui, avec l’étreinte donc il rêvait d’enserrer la vie comme d’une serre d’aigle, avec les frissons de puissance qui le secouaient presque douloureusement, avec la naissante conscience de sa valeur. Il se faisait l’effet d’un poète qu’un naufrage a jeté sur une rive étrangère et qui essaye en vain de chanter selon le mode barbare des habitants de ce pays nouveau. Puissamment conscient des beautés universelles, il était forcé de ramper, de croupir, au milieu des enfantillages, de discuter s’il apprendrait ou non le latin.
– Bon Dieu ! Mais qu’est-ce que le latin a à faire là-dedans ? se demanda-t-il ce soir-là devant son miroir. Je voudrais bien que les morts restent où ils sont. Pourquoi des morts me feraient-ils la loi ? La beauté est vivante et elle est éternelle. Et les langues passent. C’est la poussière des morts.
Puis il trouva qu’il avait fort bien énoncé son idée et se coucha en se demandant pourquoi il ne pouvait s’exprimer de la même façon avec Ruth. En sa présence, il n’était qu’un petit garçon, un tout petit garçon.
– Donnez-moi du temps, dit-il tout haut. Je ne demande que du temps.
Du temps, du temps, du temps ! telle était sa plainte continuelle.
14
Ce ne fut pas à cause d’Olney, mais en dépit de Ruth et en raison même de son amour pour elle, qu’il se décida finalement à ne pas apprendre le latin. Il y avait tant d’autres choses que le latin, tant d’études dont la nécessité était plus impérieuse. Et il lui fallait écrire, il lui fallait gagner de l’argent. On ne lui avait encore rien pris. Deux ballots de manuscrits faisaient le tour des Revues. Il passait de longues heures à la salle de lecture, à prendre connaissance de la littérature des autres ; la critiquait, la comparait avec la sienne et cherchait, cherchait toujours le « truc » qui leur avait permis de vendre leur prose. Comment s’y prenaient-ils ?
L’énorme quantité de littérature momifiée le surprenait. Aucune lumière, aucune couleur, aucune vie ne l’animaient et cependant cela se vendait, deux cents le mot, vingt dollars le mille ! La publicité des journaux le disait. Il s’étonnait du nombre incalculable de nouvelles – alertes et adroitement écrites, il est vrai – mais sans vitalité, sans réalité. L’existence était si étrange, si merveilleuse, remplie d’une telle immensité de problèmes, de rêves et d’exploits héroïques ! Et cependant ces historiettes ne traitaient que de banalités. Mais le poids, l’étreinte de la vie, ses fièvres et ses angoisses et ses révoltes sauvages, voilà ce qu’il fallait écrire ! Il voulait chanter les chasseurs de chimères, les éternels amants, les géants combattant parmi la douleur et l’horreur, parmi la terreur et le drame, qui faisaient craquer la vie sous leur effort désespéré. Et pourtant, les nouvelles dans les magazines semblaient se complaire à glorifier les Butler, tous les sordides chasseurs de dollars et les vulgaires amourettes de vulgaires petites gens. Est-ce parce que les éditeurs eux-mêmes sont vulgaires ? se demanda-t-il. Ou parce que la vie leur fait peur, à tous, auteurs, éditeurs et lecteurs ?
Ce qui l’ennuyait le plus, c’était de ne connaître aucun éditeur, aucun écrivain. Bien plus, il ne connaissait personne qui ait jamais essayé d’écrire, et soit capable de le conseiller, et lui indiquer la voie à suivre.
Il finit par se demander si les éditeurs n’étaient pas tout simplement les rouages d’une machine et non pas des êtres vivants. Mais oui, c’étaient des machines et voilà tout. Il mettait toute son âme dans des poèmes, dans des nouvelles ou des articles et les confiait à une machine. Il pliait ses feuillets, les glissait avec des timbres dans une grande enveloppe qu’il cachetait, affranchissait et jetait le tout dans la boîte aux lettres. Après un tour sur le continent et un certain laps de temps, un facteur lui rapportait le manuscrit dans une autre enveloppe, affranchie avec les timbres qu’il avait envoyés. Il n’y avait évidemment aucun éditeur en chair et en os à l’autre bout, mais un ingénieux rouage qui changeait le manuscrit d’enveloppe, et la timbrait, exactement comme ces distributeurs automatiques qui, moyennant deux cents vous délivrent une tablette de chocolat ou un chewing-gum. La machine éditoriale délivrait de la même manière un chèque ou un refus. Jusqu’à présent, il ne s’était adressé qu’à la mauvaise fente.
La fiche de refus, écrite à la machine, complétait la ressemblance. Il en avait reçu des centaines. Si seulement il avait reçu une ligne personnelle, le refus lui aurait été moins pénible. Mais non, jamais ! Décidément, il n’y avait personne à l’autre bout, que les rouages bien huilés d’une admirable machine.
C’était un bon lutteur obstiné et courageux que Martin ; il aurait bien continué à nourrir la machine pendant des années ; mais il se saignait aux quatre veines et il ne s’agissait pas d’années, mais de semaines, pour déterminer la fin du combat. Tous les huit jours, la note de sa pension et souvent l’affranchissement d’une quarantaine de manuscrits le rapprochaient de la ruine. Il n’achetait plus de livres et il économisait sur tout pour retarder l’échéance fatale. Cependant il l’avança encore d’une semaine en donnant cinq dollars à Marianne pour s’acheter une robe.
Sans conseil, sans encouragement, profondément écœuré, il luttait dans la nuit. Gertrude elle-même commençait à le regarder de travers. Au début, sa tendresse lui avait fait tolérer ce qu’elle considérait comme une toquade ; maintenant, sa sollicitude la rendait inquiète : il lui semblait que cette toquade ressemblait à de la folie. Martin le savait et en souffrait davantage que du mépris avoué et taquin de Bernard Higginbotham. Et pourtant, il gardait sa foi en lui-même ; mais il était seul à l’avoir. Ruth n’en avait aucune. Elle souhaitait qu’il continue ses études et, sans désapprouver ouvertement sa littérature, elle ne l’encourageait pas.
Il ne lui avait pas proposé de lui montrer ses œuvres, par une discrétion exagérée. D’ailleurs, comme elle travaillait beaucoup à l’Université, il répugnait à lui faire perdre son temps. Mais lorsqu’elle eut passé sa licence, elle lui demanda elle-même de lui montrer quelque chose. Martin fut transporté de joie ; il fut inquiet aussi. Un juge se présentait enfin ! Elle était licenciée es lettres, avait étudié la littérature avec de savants professeurs et le traiterait autrement que les éditeurs. Peut-être ceux-ci était-ils bons critiques aussi. Mais Ruth, au moins, ne lui tendrait pas le refus stéréotypé, si elle n’aimait pas son œuvre et lui reconnaîtrait peut-être quand même certain mérite. Elle parlerait, enfin, de sa façon alerte et gaie, et, chose plus importante que tout, elle ferait la connaissance du véritable Martin Eden. Elle verrait de quoi étaient faits son cœur et son âme et arriverait peut-être à comprendre quelque chose, un tout petit quelque chose, à ses aspirations et à sa force de volonté.
Martin choisit un certain nombre de ses nouvelles, puis, après un instant d’hésitation, y ajouta ses « Poèmes de la mer ».
Un après-midi, vers la fin de l’automne, ils allèrent faire un tour à bicyclette du côté des collines. C’était la seconde fois qu’il sortait seul avec elle et, tandis qu’ils roulaient ensemble, éventés par une brise tiède au goût salin, il se dit que vraiment le monde était beau et bien ordonné et qu’il faisait bon vivre et aimer.
Ils descendirent de leurs vélos sur le bas-côté de la route et grimpèrent au sommet d’un tertre où l’herbe brûlée par le soleil avait une odeur délicieuse et reposante de moisson mûre.
– Sa tâche est achevée, dit Martin, quand ils se furent installés, elle sur son chandail, lui, étendu sur la terre tiède, aspirant voluptueusement la senteur douce de gazon. Elle n’a plus sa raison d’être et, dès lors, a cessé d’exister, poursuivit-il en caressant amicalement l’herbe fanée. Pleine d’ambition, elle a poussé sous les longues averses de l’hiver dernier, a lutté contre le violent printemps, a fleuri l’été, séduisant abeilles et insectes, a confié au vent sa semence, s’est mesurée avec la vie et…
– Pourquoi analysez-vous toujours tout d’un œil aussi froid ? interrompit-elle.
– Parce que j’ai étudié l’évolution de la matière, je suppose. Il y a peu de temps que j’ai des yeux, en somme.
– Mais il me semble que vous perdez le sens de la beauté, de cette façon-là, que vous la détruisez comme les enfants qui attrapent des papillons et abîment le velours de leurs ailes brillantes.
Il secoua la tête.
– Jusqu’à présent j’ignorais la signification de la beauté. Elle s’imposait à moi, voilà tout, sans rime ni raison. Maintenant je commence à savoir. Cette herbe – à présent que je sais pourquoi c’est de l’herbe et comment elle l’est devenue, – me paraît plus belle. Mais c’est tout un roman, que l’histoire du moindre brin d’herbe et un roman d’aventures ! Cette seule idée m’émeut. Quand je réfléchis à tout ce drame de la force et de la matière et à leur formidable lutte, j’ai envie d’écrire l’épopée du brin d’herbe !
– Comme vous parlez bien ! dit-elle d’un air absent, et il remarqua qu’elle le regardait avec attention.
Tout embarrassé, il rougit jusqu’aux cheveux :
– J’espère que je fais des progrès, bredouilla-t-il. Il y a tant de choses en moi que je voudrais exprimer ! Mais je ne peux pas y arriver. Il me semble quelquefois que l’univers entier m’habite et m’a choisi pour le chanter. Je sens, non, je ne peux pas vous le décrire !… je sens la grandeur de tout ça et tout ce que j’arrive à faire, c’est balbutier comme un nouveau-né. C’est une tâche grandiose que d’exprimer des sentiments et des sensations par des mots écrits ou parlés, qui donneront à celui qui écoute ou qui lit, la même impression qu’à son créateur. Tenez ! je plonge ma figure dans l’herbe et l’odeur qu’aspirent mes narines évoque en moi mille pensées, mille rêves. C’est l’haleine de l’univers que j’ai respirée ; c’est sa chanson et son rire, sa douleur, ses larmes, ses luttes et sa mort. J’aimerais vous dire, à vous, à l’humanité entière, les visions évoquées en moi par cette odeur d’herbe… Mais comment le pourrai-je ? Ma langue est liée. J’ai essayé de vous décrire ce qu’évoquait en moi ce parfum et je n’ai fait que bafouiller. Oh ! (Il eut un geste désespéré.) C’est impossible ! impossible !
– Mais vous parlez très bien, insista Ruth. Vous avez fait un tas de progrès depuis que je vous connais ! M. Butler est un orateur remarquable. Son comité lui demande toujours de parler dans les réunions publiques pendant les campagnes d’élections. N’empêche, vous venez de parler aussi bien que lui. Seulement lui, a plus de sang-froid. Vous, vous vous excitez trop ; avec le temps ça vous passera. Savez-vous que vous feriez un bon orateur ? Vous irez loin, si vous voulez. Vous avez de l’autorité, donc vous saurez mener les hommes, et vous pouvez réussir n’importe quoi, si vous vous y prenez comme pour la grammaire. Pourquoi ne pas devenir avocat ? ou homme politique ? Qui vous empêche de devenir un second M. Butler ?… moins la dyspepsie !… ajouta-t-elle en souriant.
Ils bavardèrent ; elle, comme d’habitude douce et têtue, revenant toujours à l’importance d’une base solide d’éducation et à l’avantage du latin comme base d’une carrière quelconque. Elle traça l’image de l’homme arrivé, mélange de son père et de M. Butler, et il écouta passionnément, couché sur le dos ; il la regardait, jouissant du moindre mouvement de ses lèvres. Mais son cerveau n’était que vaguement attentif, rien, dans les modèles qu’elle lui présentait, ne l’attirait et il ne ressentait à l’écouter qu’une sorte de désappointement douloureux : son amour s’en exaspérait jusqu’à la souffrance. Dans tout ce qu’elle disait, il n’était pas question de sa littérature, et les manuscrits qu’il avait apportés gisaient à terre, oubliés.
Enfin, pendant un silence, il regarda le soleil comme pour en mesurer la hauteur au-dessus de l’horizon et le geste qu’il fit en ramassant ses manuscrits, rappela à Ruth leur existence.
– J’avais oublié ! dit-elle vivement. Et je suis tellement impatiente d’entendre ça !
Il lui lut d’abord une nouvelle qu’il aimait entre toutes. Cela s’appelait « Le Vin de la Vie », et l’ivresse qui était montée à son cerveau lorsqu’il l’avait écrite, l’envahit en la relisant.
L’idée en était originale ; il l’avait parée de phrases colorées et d’images lumineuses. Entraîné par le feu de sa conception première, il ne s’apercevait pas de ses défauts ni de ses lacunes. Mais il n’en était pas de même pour Ruth. Son oreille exercée remarquait les faiblesses et les exagérations, l’emphase du novice, le manque de rythme, ou bien son tour pompeux. En somme, c’était une œuvre d’amateur. Mais au lieu de le lui dire, elle se borna, quand il eut fini sa lecture, à critiquer quelques défauts légers et déclara que l’histoire lui plaisait.
Mais il fut désappointé. Ses critiques étaient justes. Il se l’avoua, tout en se disant qu’il ne lui lisait pas son travail dans le seul but de s’en faire faire la correction, comme un petit garçon en classe. Qu’importaient les détails ? Il apprendrait bien tout seul à les corriger.
La chose importante était celle-ci : il avait tiré de la vie une grande leçon qu’il avait essayé d’emprisonner dans cette histoire : avait-il ou non réussi à la lui faire voir comme ses yeux l’avait vue ? Son cerveau l’avait-il comprise, son cœur l’avait-il sentie ?… Il décida qu’il n’avait pas réussi. Peut-être les éditeurs avaient-ils raison. Il dissimula son désappointement et tomba si bien d’accord avec elle sur les critiques, qu’elle ne put se douter de la profonde déception qu’il en éprouvait au fond de lui-même.
– J’ai appelé ça « La Marmite », dit-il en dépliant un autre manuscrit. Quatre ou cinq magazines l’ont déjà refusé, mais je crois que ce n’est pas mal. À vrai dire, je ne sais pas trop quoi en penser, ça me semble original… Mais vous ne serez peut-être pas de cet avis. C’est court : il n’y a que deux mille mots.
– C’est épouvantable ! s’écria-t-elle lorsqu’il eut achevé sa lecture. C’est tout simplement horrible !
Avec une secrète satisfaction, il remarqua sa pâleur, son regard tendu et dilaté, ses mains crispées. Il avait donc réussi à lui communiquer ce qu’il ressentait lui-même. Le coup avait porté. Que cela lui plût ou non, elle était frappée, matée : cette fois, elle négligerait d’analyser le détail.
– C’est la vie, dit-il, et la vie n’est pas toujours belle. Et pourtant – est-ce parce que je suis bizarrement fait ? – je trouve là-dedans quelque chose de splendide. Il me semble justement que la…
– Mais pourquoi cette malheureuse femme n’a-t-elle pas… (Elle s’interrompit, désorientée, puis reprit, révoltée :) Oh ! c’est dégradant ! c’est mal ! c’est atroce !…
Sur le moment, il eut l’impression que son cœur s’arrêtait de battre. « Atroce » ! Il ne se serait jamais attendu à ça. Sa nouvelle tout entière lui apparut en lettres de feu et il y chercha en vain quelque chose d’atroce. Puis son angoisse cessa. Il n’était pas coupable. Cependant Ruth avait repris :
– Pourquoi n’avoir pas choisi un sujet agréable ? Nous savons tous qu’il existe de par le monde des choses atroces, mais ce n’est pas une raison…
Elle continua à déverser son indignation, mais il ne l’écoutait guère. Souriant en lui-même, il regardait son visage virginal, d’une pureté si pénétrante qu’elle lui semblait entrer en lui, le baigner d’un rayonnement aussi frais, aussi doux, aussi limpide qu’une lumière stellaire. « Nous savons tous qu’il existe, de par le monde, des choses atroces ! » Il se représenta ce qu’elle pouvait bien savoir et eut envie de rire, comme d’une bonne plaisanterie. Puis, subitement, il eut un soupir en songeant à l’immensité de choses « atroces » qu’il avait connues, étudiées, et il lui pardonna de n’avoir rien compris à son histoire. Ce n’était pas sa faute. Et il remercia Dieu d’avoir ainsi protégé sa blancheur. Mais lui, qui connaissait la vie, sa laideur comme sa beauté, sa grandeur – en dépit de la boue qui la souillait – Bon Dieu ! il la dirait telle qu’elle est. Les saints du paradis peuvent-ils voir autre chose que de la beauté, de la pureté ? Mais des saints au milieu de la boue, voilà le miracle éternel ! Voilà qui donne à la vie sa valeur. Voir la grandeur morale se dégager de la fange ; entrevoir la beauté à travers un rideau de boue ; puis peu à peu – surgissant de l’abîme d’inconscience, de vice – la voir monter, grandir en force, en vérité, en splendeur.
Il saisit au vol une de ses critiques.
– Le ton est bas. Et il y a tant de choses élevées ! Tenez ! In Memoriam, par exemple !
Il eut envie de lui suggérer Lockley Hall et l’aurait fait, si, lorsqu’il la regarda de nouveau, ce fait étrange ne l’avait émerveillé : Ruth, la femelle de son espèce, était sortie du ferment primordial, avait monté, en rampant, l’échelle infinie des incarnations successives, pendant des milliers et des milliers de siècles, pour aboutir au sommet et devenir cette Ruth si belle, si pure, quasi divine, la Ruth qui lui avait fait connaître l’amour et avait fait aspirer à la pureté, à la divinité un homme comme lui, Martin Eden, sorti lui aussi des abîmes sans fond de la création. Voilà du roman, du fantastique, du surnaturel ! Voilà ce qu’il fallait écrire, s’il pouvait trouver des mots assez beaux. Les saints du paradis ? Ce n’étaient que des saints, après tout, incapables de se débrouiller ! Mais lui était un homme.
Il l’entendit dire :
– Vous avez de la puissance. Mais de la puissance qu’il faut maîtriser.
– Un taureau dans un magasin de porcelaine ! suggéra-t-il.
– Et il faut acquérir du discernement, du goût, de la finesse, de la mesure, répondit-elle dans un sourire.
– J’ai trop d’audace, murmura-t-il.
Elle approuva d’un sourire et s’installa en vue d’écouter une nouvelle histoire.
– Je me demande ce que vous allez penser de ça, dit-il en s’excusant. C’est une chose bizarre. Je crains d’avoir dépassé ma mesure, mais l’intention était bonne. Ne vous attachez pas aux détails, mais voyez si vous en saisissez l’intention, qui a de la grandeur et de la vérité. Il y a des chances, malheureusement, pour que je ne sois pas parvenu à les rendre tangibles.
Il lut tout en épiant son visage. Enfin, je l’ai touchée, se dit-il. Immobile, sans le quitter des yeux, elle respirait à peine ; il la crut prise, enchaînée par la magie de son évocation. Cette histoire s’appelait « Aventure » et c’était l’apothéose de l’aventure, non pas de la banale aventure des livres d’images, mais de la véritable aventure infidèle et capricieuse – guide féroce, formidable dans ses punitions et formidable dans ses récompenses – celle qui exige une terrible patience et le labeur qui tue, qui offre le triomphal ensoleillement, ou la mort lugubre après la famine et les délires affreux de la fièvre, à travers la sueur, le sang et la vermine, celle qui conduit, parmi les ignobles contacts, aux sommets magnifiques, et à la domination du monde.
Il avait mis tout cela et davantage dans cette histoire et il crut qu’elle comprenait. Les yeux dilatés, une rougeur montant à ses joues pâles, elle écoutait, un peu haletante. Mais ce qui la passionnait, ce n’était pas l’histoire, c’était lui. De l’histoire, elle n’en pensait pas grand-chose ; mais elle subissait l’intention de Martin, la surabondance de sa force, comme un fétu de paille est enlevé, roulé par un torrent. Au moment où elle croyait être entraînée par l’histoire, elle l’était en réalité par une chose toute différente, par une idée insensée, dangereuse, qui apparaissait tout à coup dans son esprit. Elle s’était surprise à penser au mariage ; et chose effrayante, elle s’était complu à cette idée, l’avait caressée ardemment. C’était indigne d’elle. Jusqu’alors elle avait vécu dans le pays des rêves poétiques de Tennyson, fermée même à ses délicates allusions à la matérialité possible des rapports entre reines et chevaliers. Elle dormait dans son manoir enchanté, et voilà que la vie frappait impérieusement à la porte. Hésitant entre la crainte et son instinct de femme, elle était partagée entre l’envie de verrouiller cette porte et l’envie de l’ouvrir toute grande pour faire entrer le visiteur inconnu.
Martin attendait son verdict avec une certaine satisfaction. Il le connaissait d’avance, mais fut quand même surpris de l’entendre dire :
– C’est beau.
« C’est très beau, répéta-t-elle avec emphase, après un silence.
Oui, c’était beau ; mais il y avait là-dedans plus que de la beauté : quelque chose de supérieur et de plus poignant. Vautré dans l’herbe, silencieux, il sentait monter devant ses yeux l’affreuse vision d’un grand doute. Il avait échoué. Ayant senti en lui une chose admirable, il n’avait pas su l’exprimer.
– Que pensez-vous du… (il s’arrêta, hésitant à se servir d’un mot nouveau) du… motif ?…
– Il est confus, répondit-elle. C’est ma seule critique, en gros. J’ai suivi la trame, mais voyez-vous, c’est trop verbeux. Vous écrasez l’action en y introduisant tant de détails superflus.
– Je parle du motif principal, se dépêcha-t-il d’ajouter. Du grand motif cosmique et universel. J’ai tâché d’empêcher qu’il dépasse l’histoire elle-même, qui n’est qu’un prétexte – mais sans doute n’ai-je pas su m’y prendre. Je n’ai pas réussi à suggérer ce que je voulais. Ce sera pour une autre fois.
Elle ne le suivait pas. Elle était licenciée es lettres, mais il l’avait dépassée. Loin de s’en douter, elle attribuait son incompréhension à l’incohérence de Martin.
– Ça manque de sobriété, dit-elle, mais par moments, c’est très beau.
Sa voix lui parvint vaguement, car il était en train de se demander s’il lui lirait ses « Poèmes de la Mer ». Il restait là, découragé, tandis qu’elle l’observait, troublée par ses idées de mariage.
– Vous voulez être célèbre ? interrogea-t-elle, brusquement.
– Oui, avoua-t-il. Ça fait partie de l’aventure. Ce n’est pas d’être célèbre, c’est la manière d’y arriver, qui compte. Après tout, pour moi la célébrité n’est qu’un moyen d’arriver à autre chose. Je désire être célèbre à cause de ça aussi. (Il faillit ajouter, « et à cause de vous », et l’aurait fait si elle avait montré de l’enthousiasme pour ses œuvres.)
Mais elle était trop occupée à lui chercher une carrière possible, pour lui demander la raison de son « aussi ». La littérature n’était pas son affaire, elle en était convaincue. Il l’avait prouvé aujourd’hui, avec sa prose d’amateur, de collégien. Certes, il parlait bien, mais ne savait pas s’exprimer d’une façon littéraire. Elle le compara à Tennyson, à Browning et à d’autres de ses prosateurs favoris, à son absolu désavantage. Cependant, elle omit de lui dire ouvertement sa pensée, l’étrange intérêt qu’il éveillait en elle, l’amenant à temporiser. Son désir d’écrire n’était, après tout, qu’une petite faiblesse qui lui passerait avec le temps. Il se consacrerait alors à des affaires plus sérieuses, et il y réussirait, elle en était sûre. Avec une volonté pareille, il ne pouvait pas ne pas réussir… si seulement il cessait d’écrire.
– Je voudrais que vous me montriez tout ce que vous écrivez, monsieur Eden ! dit-elle.
Il rougit de plaisir. Elle s’intéressait à ce qu’il faisait, sûrement. Non seulement il n’avait pas reçu de refus ronéotypé, mais elle avait trouvé belles certaines parties de son œuvre : c’était le premier encouragement qu’il ait jamais reçu.
– D’accord, dit-il ardemment. Et je vous promets, Miss Morse, que j’arriverai. J’ai fait du chemin, je le sais, j’en ai encore beaucoup à faire, et je le ferai, serait-ce sur les genoux. (Il lui montra une liasse de manuscrits.) Voilà les « Poèmes de la mer ». Quand vous rentrerez, je vous les laisserai, pour que vous les lisiez. Surtout, dites-moi bien votre impression. Ce dont j’ai besoin par-dessus tout, c’est de critique. Je vous en prie, soyez franche !
– Je serai absolument franche, promit-elle, en pensant avec un petit malaise qu’elle ne l’avait pas été ce soir-là et qu’elle ne le serait sans doute pas davantage une autre fois.
15
Voilà le premier combat livré, et perdu, dit Martin à son miroir, dix jours après. Mais il y en aura un second et un troisième, et ainsi de suite, à moins que…
Il interrompit sa phrase pour jeter un regard à sa pauvre petite chambre ; ses yeux s’arrêtèrent tristement sur la pile de manuscrits refusés qui, dans leurs longues enveloppes, encombraient un coin du plancher. Il ne pouvait plus se payer de timbres pour les réexpédier et, depuis une semaine, la pile montait de plus en plus. Demain il en reviendrait d’autres et après-demain et le jour suivant, en attendant le retour du dernier. Il devait un mois de machine à écrire, ayant tout juste de quoi payer sa semaine de pension et les frais de l’agence de placement.
Il s’assit et regarda pensivement la table. Elle était maculée de taches d’encre ; cette vue l’attendrit.
– Chère vieille table, dit-il, j’ai passé avec toi de bonnes heures et, somme toute, tu t’es montrée une vraie amie. Tu n’as jamais regimbé, tu ne m’as jamais refusé de copie, tu ne t’es jamais plainte de surmenage…
Ses bras s’abattirent sur la table, et il y ensevelit son visage. Sa gorge contractée lui faisait mal et il ne pouvait pleurer. Cela lui rappela sa première bagarre, quand il avait six ans ; son adversaire, de deux ans plus âgé, l’avait battu, rossé jusqu’à n’en plus pouvoir. Mais lui, pleurant toutes les larmes de ses yeux, tapait toujours, de toute la rage de ses petits poings. Il vit le cercle d’enfants, autour d’eux, qui poussaient des hurlements de sauvages quand il tomba enfin, presque évanoui, saignant du nez, les yeux ruisselants de larmes.
– Pauvre môme ! murmura-t-il. Aujourd’hui tu t’es sérieusement fait battre, tu es réduit en bouillie. Tu es fini, liquidé.
Le souvenir de cette première bagarre s’évanouit et d’autres souvenirs apparurent, ceux des batailles qui avaient suivi. Six mois après, « Tête-de-Fromage », c’était le nom du garçon, l’avait battu de nouveau. Mais cette fois, Martin lui avait poché un œil. Et cela avait continué ainsi, lui toujours battu, Tête-de-Fromage toujours triomphant. Mais jamais il ne s’était enfui et ce souvenir le réconforta. Chaque fois, il avait encaissé bravement, malgré la méchanceté implacable de Tête-de-Fromage qui, pas une fois, ne l’avait épargné. Mais il ne s’était jamais dégonflé.
Puis il vit une impasse étroite, entre des maisons délabrées. L’impasse était close par une construction en briques, d’un étage, d’où sortait le vacarme rythmé des rotatives, imprimant la première édition de l’Enquirer. Il avait onze ans, Tête-de-Fromage treize, tous deux vendaient l’Enquirer et ils étaient là, attendant leurs ballots. Bien entendu, Tête-de-Fromage lui était encore tombé dessus, mais le résultat de la bagarre fut incertain, car à quatre heures moins un quart les portes de l’imprimerie furent ouvertes et tout le troupeau de gosses se précipita pour plier les journaux.
– Demain je te rosserai, promit Tête-de-Fromage.
Et il entendit sa propre voix, aiguë et tremblante de larmes contenues, assurer qu’il serait au rendez-vous le lendemain.
Et le jour suivant, il s’était dépêché de sortir de l’école pour être en avance de deux minutes sur Tête-de-Fromage. Les autres garçons l’encouragèrent, l’accablèrent de conseils et, lui montrant ses erreurs de la veille, lui promirent la victoire s’il suivait leurs instructions. Ils donnèrent ensuite les mêmes conseils à Tête-de-Fromage, d’ailleurs. Et cette bataille les transporta de joie ! Il leur enviait certes, aujourd’hui, le spectacle inénarrable que lui et Tête-de-Fromage avaient dû leur offrir. Le combat continua, sans arrêt, pendant trente minutes jusqu’à l’ouverture des portes de l’imprimerie.
Il se vit, tout jeune écolier, quittant journellement la classe pour galoper à l’Enquirer. Courbaturé, contusionné par ses batailles incessantes, il ne courait pas très vite. Ses bras étaient marbrés des coups qu’il avait reçus et même à certains endroits les meurtrissures s’envenimaient. Il souffrait de la tête, du bas des reins, son cerveau alourdi tourbillonnait de vertige. Il ne jouait plus aux récréations et ne travaillait pas davantage. Même de rester tranquillement assis à son pupitre était une véritable torture. Il vivait dans un perpétuel cauchemar dont il n’entrevoyait pas la fin. Pourquoi ne pouvait-il pas rosser Tête-de-Fromage à son tour ? se demandait-il souvent ; ses misères seraient alors terminées. Il ne lui venait pas à l’esprit d’en rester là, en se laissant fouetter une bonne fois par Tête-de-Fromage sans riposter.
Et tous les jours, il se traînait jusqu’à l’impasse du journal, éreinté, dégoûté mais éternellement patient, pour affronter son ennemi qui, tout aussi éreinté que lui, aurait certes accepté la paix, sans toute la bande de gamins, devant lesquels il convenait d’afficher de l’orgueil. Un après-midi, après vingt minutes de lutte acharnée en vue d’un knock-out définitif, combat mené selon les lois sévères qui défendaient les coups de pied, les coups bas et les coups sur l’adversaire à terre, Tête-de-Fromage, haletant, titubant, proposa à Martin d’être quittes. Et Martin, la tête dans ses mains, se revit, chancelant, haletant, étouffé par le sang ruisselant de sa lèvre fendue et qu’il avalait ; il s’avançait en titubant sur Tête-de-Fromage, crachait une gorgée de sang pour pouvoir parler et lui criait qu’ils ne seraient jamais quittes même si Tête-de-Fromage cédait. Tête-de-Fromage ne céda pas et la bataille continua.
Le lendemain, le surlendemain, les jours suivants virent se renouveler la bagarre quotidienne. Au moment où il se mettait en garde, ses bras lui faisaient un mal affreux et les premiers coups donnés ou reçus lui arrachaient les entrailles ; puis la douleur s’engourdissait et il tapait comme un sourd, apercevant comme à travers un brouillard, la large face et les yeux flamboyants de Tête-de-Fromage. Il ne voyait que cette face : tout le reste n’était que du vide tourbillonnant. Rien n’existait plus pour lui que cette face : il ne connaîtrait le repos, le divin repos, que lorsque ses poings sanglants auraient réduit en bouillie cette face, ou lorsque les poings sanglants de l’autre l’auraient lui-même réduit en bouillie. Alors seulement il se reposerait de toutes façons. Mais abandonner la partie, lui Martin ? Impossible !
Et voilà qu’un beau jour (Martin s’était traîné jusqu’à l’impasse) Tête-de-Fromage ne vint pas. Les gamins le complimentèrent et lui annoncèrent qu’il avait battu Tête-de-Fromage. Mais Martin n’était pas satisfait. Il n’avait pas battu Tête-de-Fromage, pas plus que celui-ci ne l’avait battu. Le problème n’était pas résolu. On apprit plus tard que le père de Tête-de-Fromage était mort subitement ce jour-là.
Martin saute quelques années et se voit, un soir, au « paradis » à l’Auditorium. Il a dix-sept ans et revient de naviguer. Une rixe éclate. Martin s’interpose et se trouve face à face avec Tête-de-Fromage, dont les yeux flamboient.
– Je te ferai ton affaire après le spectacle, siffle son ancien ennemi.
Martin acquiesce d’un signe. Le videur du « paradis » se dirige de leur côté.
– Après le premier acte, dehors, chuchote Martin, l’air très intéressé par ce qui se passe sur la scène.
Le videur les foudroie du regard et s’en va.
– As-tu des seconds ? demande Martin à Tête-de-Fromage à l’entracte.
– Bien sûr !
– Alors je vais m’en procurer aussi.
Pendant les entractes il rassemble ses seconds, trois individus qu’il a connus à la fabrique de clous, un chauffeur de locomotive, une demi-douzaine de types de la bande des « Boo-Gang » et quelques-uns de sa terrible bande des « Dix-huit des Halles ».
Après le théâtre les deux bandes marchèrent, sans avoir l’air de rien, de chaque côté de la rue, puis se réunirent dans un coin tranquille et tinrent conseil.
– Le pont de la 8e Rue sera le lieu de la rencontre, déclare un rouquin de la clique de Tête-de-Fromage. On se battra au milieu, en pleine lumière ; et si un flic s’amène, on se taille soit d’un côté, soit de l’autre.
– Ça me va ! dit Martin après avoir consulté les chefs de sa clique.
Le pont de la 8e Rue, qui traverse un bras de l’estuaire de San Antonio, est très long. Aux deux extrémités et au milieu il y a des lampadaires. Impossible à un agent d’approcher sans être vu. C’est un bon coin pour la bagarre qu’évoque à présent Martin. Il voit les deux bandes, silencieuses, menaçantes, gardant strictement leur distance et soutenant leur champion respectif. Tête-de-Fromage et lui se déshabillent. Des sentinelles sont placées non loin, pour surveiller les deux extrémités du pont. Un des « Boo-Gang » tient le veston de Martin, sa chemise et sa casquette, prêt à les emporter au galop si la police intervenait. Martin s’avance au centre du « ring », face à Tête-de-Fromage et, levant la main, il lance son avertissement final :
– On se serre pas la pogne ! Compris ? L’un de nous y restera.
Tête-de-Fromage hésite – Martin le voit – mais devant les deux cliques son orgueil d’autrefois l’emporte.
– Allons-y ! répond-il. Arrête ton baratin, tu veux ? je suis sûr de t’avoir !
Alors, comme de jeunes taureaux, ils bondissent l’un vers l’autre, les poings nus, de toute l’ardeur de leur haine, de tout leur désir de détruire, de tuer. Que sont devenus les milliers d’années de civilisation et de nobles aspirations ? Il ne reste plus que la lumière électrique pour marquer le chemin parcouru par la grande aventure humaine. Martin et Tête-de-Fromage sont redevenus deux sauvages de l’âge de pierre. Ils sont redescendus au plus profond des abîmes limoneux, dans la fange primordiale et ils luttent aveuglément, instinctivement comme lutte la poussière d’étoiles, comme lutteront les atomes de l’univers, éternellement.
– Bon Dieu ! nous n’étions que des bêtes, de sombres brutes ! murmure Martin qui suit toujours, comme à travers un kaléidoscope, les péripéties de sa bataille d’antan. En même temps spectateur et acteur, l’être cultivé et raffiné qu’il est devenu, frissonne de dégoût à ce spectacle ; puis le présent s’efface, les fantômes du temps passé le possèdent, il n’y a plus que Martin Eden, à dix-sept ans, et qui combat Tête-de-Fromage sur le pont de la 8e Rue. Il souffre, il cogne, il sue, il saigne – et il exulte quand ses poings nus frappent juste.
Pareils à deux tourbillons de haine, ils s’entremêlent furieusement. Le temps passe – et les deux bandes adverses se taisent. Ils n’ont jamais senti semblable intensité dans la férocité et en sont frappés d’une sorte de respect. Ces deux brutes leur sont supérieures.
La première vague de jeunesse et l’excellence de leur condition se sont usées ; ils luttent plus prudemment, avec plus de mesure. Jusqu’à présent, la partie est égale. « Ça casse vraiment rien, ce combat », entend dire Martin. À ce moment-là, il suit une feinte du droit et du gauche, subit la riposte féroce et sent sa joue s’ouvrir jusqu’à l’os.
Ce n’est pas qu’avec le poing nu qu’on a fait ça ! Des murmures effarés se font entendre ; il ruisselle de sang, mais ne dit rien. Son cœur est lourd, car il apprend la ruse basse, la sournoise vilenie de ses pareils. Il attend, il guette, feint une attaque foudroyante et s’arrête à mi-chemin : il a vu luire un éclair de métal.
– Montre voir ! hurle-t-il. Qu’est-ce que c’est que tu tiens dans la main ?
Les deux bandes se précipitent, grognant et grondant. Dans une seconde cela va devenir une bataille générale et il sera privé de sa vengeance. Il est hors de lui.
– Arrière ! vous autres ! rugit-il, la voix rauque. Compris ? arrière, nom de Dieu !
Ils reculent. Ce sont des brutes, mais il est la super-brute, un être terrible qui les domine de toute sa puissance.
– C’est mon affaire à moi, et je défends qu’on s’en mêle !… Toi, donne-moi ça.
Tête-de-Fromage, refroidi et vaguement inquiet, tend son coup-de-poing américain.
– Le Rouquin, c’est toi qui le lui as passé tout à l’heure ! continue Martin en balançant l’arme à l’eau. Je t’ai vu te glisser derrière lui et je me demandais ce que tu faisais là. Si tu recommences, je t’étripe. Compris ?
Ils reprennent le combat, éreintés, à demi morts. Enfin, le public de brutes, saturé de sang, les prie impartialement d’arrêter. Et Tête-de-Fromage prêt à mourir à terre ou debout – un Tête-de-Fromage monstrueux, méconnaissable – hésite, mais Martin bondit et cogne, cogne toujours.
Quelques minutes passent – qui lui paraissent durer un siècle – pendant lesquelles Tête-de-Fromage faiblit visiblement. Soudain, au milieu d’un corps à corps, un craquement sec se fait entendre, et le bras droit de Martin retombe, mou, à son côté. C’est une fracture. Tous le comprennent, et Tête-de-Fromage, bondissant comme un tigre, précipite ses coups. Les seconds de Martin veulent s’interposer, mais Martin, abruti par cette avalanche terrible, les repousse en les insultant et sanglote tout haut son impuissance et son désespoir.
De sa main gauche à présent il frappe, à demi inconscient, et il entend, comme venant de très loin, des murmures de frayeur et une voix tremblante qui dit : « Ce n’est plus de la lutte, les gars… C’est un meurtre, faut arrêter ça. »
Mais on laisse faire, et il en est content ; il frappe, plus mollement mais sans arrêt, de son unique bras, sur la chose sanglante en face de lui ; ce n’est plus une figure, mais une vision horrible sans nom, vacillant, trébuchant devant ses yeux papillotants, et qui ne veut pas disparaître. Et il frappe toujours, de plus en plus faiblement, avec le peu de vitalité qui lui reste, et il lui semble que des siècles passent et que ça ne finira jamais – quand, tout à coup, il se rend vaguement compte que la chose innommable s’affaisse, doucement, tombe sur le parapet du pont… L’instant d’après, tenant à peine sur ses jambes flageolantes, il se penche au-dessus de la forme écroulée, et dit d’une voix qu’il ne reconnaît pas :
– T’en veux encore ?… dis ?… T’en veux encore ?…
Il répète indéfiniment ces mots, il le conjure, menaçant, de lui répondre s’il « en veut encore ». Enfin, ses camarades lui tapent amicalement dans le dos et s’efforcent de lui mettre son veston…
Puis une vague d’obscurité et d’oubli le submerge.
Comme alors, Martin Eden, le visage enseveli dans ses mains, n’entend plus rien, ne pense plus à rien – il a revécu avec tant d’intensité l’effroyable scène d’autrefois, qu’il a perdu connaissance – comme alors.
Une longue minute, tout n’est en lui qu’oubli, obscurité… Puis, comme un homme qui se réveille d’entre les morts, il bondit sur ses pieds, les yeux étincelants, le visage ruisselant de sueur, en hurlant :
– Je t’ai rossé, Tête-de-Fromage ! Ça m’a pris onze ans, mais je t’ai rossé !
Ses genoux se dérobaient sous lui et il retomba assis sur son lit. Encore mal réveillé, il regarda autour de lui, perplexe, en se demandant où il était. Enfin, son œil rencontra la pile de manuscrits entassés dans un coin. Alors il reprit pied dans le présent, se souvint des livres qu’il avait lus et des richesses infinies qu’il y avait puisées, de ses rêves, de ses ambitions. Il se souvint de son amour pour une pâle fleur de serre, sensitive[2], irréelle, qui mourrait d’horreur si elle assistait – ne serait-ce qu’une seconde – à la scène qu’il venait de revivre, si elle vivait une seule seconde dans la boue d’où il s’était évadé.
Il se leva et fut à son miroir.
– Ainsi, tu es sorti de la boue, Martin Eden, dit-il solennellement. Tu as baigné tes yeux de divine clarté et, en t’élevant jusqu’aux étoiles, tu as tué « le serpent et le tigre » pour conquérir le plus grand trésor qui soit.
Il se regarda plus attentivement et se mit à rire.
– Un peu de folie et pas mal de mélodrame, hein ? dit-il, moqueur. Ça ne fait rien. Tu as rossé Tête-de-Fromage et tu rosseras bien les éditeurs, même si ça te prend onze ans. Tu ne peux pas t’arrêter là. Il faut continuer. C’est une lutte sans merci, tu sais ?
16
La sonnerie du réveil arracha brusquement Martin au sommeil. Bien que dormant profondément, il se réveilla instantanément, comme les chats – et tout joyeux que ces cinq heures d’inconscience soient passées. Avant même que la pendule ait terminé son vacarme, sa tête était plongée dans la cuvette et il s’ébrouait sous la morsure de l’eau glacée.
Mais, ce jour-là, il ne suivit pas son programme habituel. Aucune histoire inachevée ne l’attendait ; aucun nouveau poème ne demandait la suprême retouche. Ses études l’avaient mené tard et l’heure du déjeuner approchait. Il essaya de lire un chapitre de Fiske mais son cerveau s’énervait et il ferma le livre. Aujourd’hui commençait une nouvelle bataille et pour quelque temps la littérature serait supprimée. La tristesse qu’il en ressentit fut semblable à celle que l’on éprouve en quittant famille et foyer. Il regarda la pile de manuscrits ; il allait quitter ses pitoyables enfants déshonorés dont personne ne voulait. Il s’approcha d’eux et se mit à les feuilleter, relisant de-ci de-là ses passages favoris. Il relut même « La Marmite », tout haut, ainsi que « L’Aventure ». – « La Joie », son dernier-né de la veille qu’il avait jeté dans le coin, dans sa rage de n’avoir plus de timbres, le transporta d’aise.
– Je ne comprends pas, murmura-t-il. Ou bien ce sont les éditeurs qui ne comprennent pas… Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Sans compter que ce qu’ils publient devient pire tous les mois ! Presque tout est mauvais…
Après le petit déjeuner, il mit la machine à écrire dans sa boîte et l’apporta à Oakland.
– Je vous dois un mois, dit-il à l’employé. Mais vous direz au patron que je vais travailler, que dans un mois environ je serai revenu, et remis à flot.
Il prit le transbordeur pour San Francisco et s’en fut à l’agence de placement.
– N’importe quoi, excepté du commerce, dit-il à l’agent.
Il fut aussitôt interrompu par un nouveau venu, habillé avec la recherche affectée de certains ouvriers attirés d’instinct par l’élégance. L’agent secoua la tête.
– Rien qui puisse aller, hein ? dit l’autre. Il n’y a pas à dire, faut que je trouve quelqu’un aujourd’hui.
S’étant retourné, il vit Martin et Martin à son tour le dévisagea.
L’individu, frêle et beau, avait un visage pâle, bouffi ; on sentait qu’il venait de faire « une fête à tout casser ».
– Vous cherchez un emploi ? interrogea-t-il. Qu’est-ce que vous savez faire ?
– Les plus durs ouvrages ; je sais aussi naviguer, écrire à la machine, monter à cheval : je peux faire n’importe quoi et me mettre à tout, répondit Martin.
L’autre hocha la tête.
– Ça m’irait ! Je m’appelle Dawson, Joe Dawson et je cherche un blanchisseur.
– C’est trop dur pour moi. (Martin, amusé, se vit repassant des dessous de femme. Mais comme l’autre lui plaisait, il ajouta :) Je saurais à la rigueur faire le blanchissage de gros. Sur mer, j’ai appris.
Joe Dawson réfléchit un instant :
– Attendez ! On va voir si on peut s’arranger. Vous écoutez ?
Martin fit signe que oui.
– C’est une petite blanchisserie à la campagne, à Shelly Hot Springs – l’hôtel, vous voyez ? – Deux hommes pour le travail, un patron et un employé. C’est moi le patron. Vous ne travaillez pas pour moi, mais sous mes ordres. Ça vous irait ?
Martin se tut. La perspective le tentait. Quelques mois de ce boulot, assez de temps pour étudier… Il pourrait travailler dur, étudier dur.
– Bonne nourriture et une chambre à vous.
Une chambre à lui, où il pourrait brûler sa lampe jusqu’à minuit ! L’affaire fut décidée.
– Mais un travail d’enfer ! ajouta l’autre.
Martin caressa ses biceps saillants d’un geste significatif.
– Alors, écoutez. (Joe porta la main à sa tête.) J’ai la tête en compote. J’y vois à peine. Hier soir, j’ai fait la foire, une foire carabinée… Voilà l’affaire : pour deux les gages sont de cent dollars, logés et nourris. J’en touche soixante et mon aide quarante. Mais vous êtes novice. Il faudra que je vous apprenne et au début c’est surtout moi qui travaillerai. Supposons que vous commenciez à trente ? Parole ! dès que vous serez à la coule, vous aurez vos quarante dollars.
– Ça va ! répondit Martin en lui tendant la main que l’autre serra. Pas d’avance pour le billet de chemin de fer et les extras ?
– Je l’ai bue ! dit tristement Joe avec un geste expressif, tout ce qui me reste, c’est mon billet de retour.
– Et moi je serai fauché, quand ma pension sera payée.
– Ne la payez pas !
– Impossible. C’est à ma sœur que je la dois.
Joe émit un long sifflement perplexe et parut se creuser la cervelle.
– J’ai encore de quoi boire pour deux, dit-il enfin ; venez, on trouvera peut-être une idée.
Martin déclina l’invitation.
– Vous ne buvez que de l’eau ?
Martin fit signe que oui et Joe gémit :
– Je le voudrais bien aussi ! Mais j’peux pas ! fit-il d’un air désespéré. Quand j’ai travaillé comme un forcené toute la semaine, il faut que je me cuite. Si je ne me cuitais pas, je me couperais la gorge ou je mettrais le feu à la baraque. Mais je suis content que vous buviez de l’eau. Continuez.
Martin, malgré l’énorme gouffre qui le séparait de cet homme, gouffre que les livres avaient creusé, n’éprouvait aucune difficulté à se remettre à son niveau. Toute sa vie il avait vécu dans la classe ouvrière et l’esprit de camaraderie du travail était chez lui une seconde nature. Il trancha le problème du voyage, trop ardu pour la migraine de l’autre : avec le billet de Joe il expédierait sa malle à Shelly Hot Springs et irait à bicyclette. C’était à 75 kilomètres environ ; en partant le dimanche, il serait au travail le lundi matin. En attendant, il allait rentrer faire ses paquets. Pas d’adieux à faire : Ruth et sa famille passaient l’été dans la Sierra, au lac Tahoe.
Le dimanche soir, il arriva à Shelly Hot Springs, las et poussiéreux, et fut reçu à bras ouverts par Joe. Une serviette mouillée autour de sa tête malade, il sortait du travail.
– Le linge de la semaine dernière s’est amoncelé pendant que j’étais allé te chercher et j’ai dû travailler sans arrêt, expliqua-t-il. Ta malle est arrivée sans encombre : elle est dans ta chambre. Mais tu as du toupet d’appeler ça une malle ! Qu’est-ce qu’il y a dedans ?… des lingots d’or ?…
Il s’assit sur le lit, tandis que Martin déballait. La malle n’était autre qu’une vieille caisse à provisions que M. Higginbotham lui avait cédée moyennant un demi-dollar. Deux poignées de corde, fixées par Martin, l’avait transformée en malle. Joe, les yeux ronds, en vit extraire un peu de linge, quelques ustensiles de toilette, puis des livres et encore des livres.
– Il y en a comme ça jusqu’au fond ? interrogea-t-il.
Martin fit signe que oui et continua à ranger ses livres sur la table de la cuisine qui servait de lavabo.
– Zut ! alors, s’écria Joe. (Puis il réfléchit longuement et déclara enfin :) Dis donc, les filles, ça doit pas t’intéresser beaucoup ?
– Non, répondit Martin. Avant de me mettre à la lecture, je cavalais pas mal. Mais depuis, je n’ai pas le temps.
– Et ici tu ne l’auras pas non plus. Tout ce qu’on peut faire c’est travailler et dormir.
Martin pensa à ses cinq heures de sommeil par nuit et sourit. Sa chambre était au-dessus de la blanchisserie, dans le même bâtiment que la machine qui pompait l’eau, produisait l’électricité et faisait marcher la lessiveuse.
Le mécanicien, qui habitait la chambre voisine, vint faire la connaissance du nouvel employé et aida Martin à placer une ampoule électrique au bout d’un fil assez long pour pouvoir aller de la table au lit.
Le lendemain, Martin fut arraché de son lit à six heures moins le quart et stupéfia Joe en prenant une douche froide.
– Ben, mon vieux, t’es réchauffé ! déclara-t-il quand ils s’assirent pour déjeuner à un coin de table dans la cuisine de l’hôtel.
Il y avait aussi le mécanicien, le jardinier, son aide et deux ou trois palefreniers. Ils mangèrent vite, d’un air renfrogné, silencieusement et Martin en les écoutant, se rendit compte combien il s’était éloigné d’eux. Leur basse mentalité le déprima et dès qu’il eut avalé son petit déjeuner, il se leva et soupira d’aise en fermant derrière lui la porte de la cuisine.
La petite blanchisserie à vapeur était parfaitement organisée, les machines les plus modernes y faisaient tout ce qu’il est possible à des machines de faire. Martin après quelques indications, tria les grands tas de linge sale, tandis que Joe mettait la lessiveuse en train et préparait des provisions nouvelles de savon mou dont la composition chimique l’obligeait à se garantir le nez, la bouche et les yeux avec des serviettes, ce qui le faisait ressembler à une momie. Une fois le triage fini, Martin l’aida à tordre le linge, en le plongeant dans une rotative, qui, à raison de quelques milliers de tours à la minute, en exprimait l’eau. Puis Martin alterna entre le séchoir et le tordeur, en secouant entre-temps les bas et les chaussettes. À la fin de l’après-midi, Joe les passant et Martin les empilant, ils ajustèrent bas et chaussettes sur le cylindre pendant que les fers chauffaient.
Puis ce fut du repassage de linge de corps jusqu’à six heures. À ce moment-là Joe hocha la tête d’un air dubitatif.
– On est à la bourre ! dit-il. Faudra travailler après dîner.
Donc, après dîner, ils travaillèrent jusqu’à dix heures sous l’aveuglante électricité et repassèrent jusqu’à la dernière chemise ; ils plièrent ensuite le tout dans une autre salle. C’était une chaude nuit californienne, et, malgré les fenêtres grandes ouvertes, la pièce, avec son fourneau à repasser chauffé à blanc, était une vraie fournaise. Martin et Joe, en gilet de corps, transpiraient et suffoquaient.
– Ça ressemble à l’arrimage d’une cargaison sous les tropiques, dit Martin quand ils remontèrent chez eux.
– Tu feras l’affaire, répondit Joe. Tu n’es pas un tire-au-flanc. Si tu continues, t’auras tes quarante dollars dès le mois prochain. Mais ne me raconte pas que t’as jamais repassé. Je ne suis pas idiot.
– Parole ! je n’ai jamais repassé, même pas un mouchoir, assura Martin.
Il fut surpris d’être aussi fatigué, en entrant dans sa chambre ; il avait oublié qu’il était resté sur ses jambes quatorze heures sans arrêter de travailler. Il mit le réveil à six heures et calcula qu’il pourrait, en se réservant cinq heures de sommeil, lire jusqu’à une heure. Il enleva ses chaussures pour délasser ses pieds enflés, s’assit à la table devant ses livres, ouvrit Fiske qu’il avait commencé deux jours auparavant et se mit à lire. Mais dès les premiers mots, il eut de la peine à concentrer son attention et se mit à les relire. Puis… il se réveilla courbaturé et glacé par le vent de la montagne qui soufflait par la fenêtre. Il regarda la pendule : elle marquait deux heures. Il avait donc dormi quatre heures ! Il se déshabilla au galop, s’écroula sur son lit et s’endormit dès que sa tête eut touché l’oreiller.
Le mardi, ils travaillèrent sans arrêt également. La vitesse avec laquelle Martin abattait la besogne, faisait l’admiration de Joe. Celui-ci était un vrai bourreau de travail. N’ayant que cette préoccupation en tête, il ne perdait jamais une minute, cherchait sans cesse le moyen de gagner du temps, montrait à Martin la façon d’exécuter en trois temps ce qu’il accomplissait en cinq, ou en deux ce qu’il faisait en trois. Procédé d’élimination, disait Martin en le copiant. Il était lui-même un bon travailleur, adroit, rapide et il avait toujours mis son point d’honneur à ne permettre à quiconque de l’aider ou de le surpasser. Il sauta donc avidement sur les conseils de son camarade et désamidonna cols et manchettes, de façon à ce qu’il ne reste la moindre bulle d’air au repassage ; sa rapidité et son adresse lui valurent des compliments de Joe.
Jamais il ne se produisait d’arrêt. Joe n’attendait rien ni personne et bondissait d’une tâche à une autre. Ils amidonnèrent deux cents chemises blanches, cueillant de la main droite, d’un seul mouvement circulaire, la chemise, de façon à faire tomber les poignets, le col et le plastron ; la main gauche élevait le corps, pour le préserver de l’amidon.
Puis la main gauche plongeait dans l’amidon brûlant, tellement brûlant qu’il leur fallait continuellement tremper leurs mains dans une cuve d’eau froide pour en détacher la pâte. Et ce soir-là, ils amidonnèrent jusqu’à dix heures et demie de coquettes et légères fanfreluches de femmes.
– Vivement les tropiques et la feuille de vigne, dit Martin en riant.
– Et moi, vivement des rentes, répondit Joe sérieusement. Je ne connais que ça : le blanchissage.
– Mais ça, tu le connais à fond.
– Ça serait vraiment malheureux. J’ai commencé à la Contra Costa, à Oakland, à onze ans, au secouage des bas pour le cylindre. Il y a dix-huit ans de ça et jamais je n’ai rien fait d’autre. Mais ce boulot-là est le plus dur que j’aie jamais eu. On devrait avoir un homme de plus, au moins. Nous travaillerons la nuit de demain. On cylindre toujours les mercredis soir, les cols et les manchettes.
Martin remonta son réveil, s’assit à sa table et ouvrit Fiske. Il ne put finir le premier paragraphe : les lignes s’enchevêtraient devant ses yeux et sa tête retombait à chaque instant sur sa poitrine. Il marcha de long en large, martela sa tête de grands coups de poing ; tout fut inutile. Il planta le livre devant lui, soutint ses paupières du bout de ses doigts et… s’endormit les yeux grands ouverts. Alors, il s’avoua vaincu et se coucha. Un lourd sommeil de brute le terrassa pendant sept heures, et lorsqu’il en fut brutalement tiré par la sonnerie du réveil, il sentit qu’il n’avait pas assez dormi.
– Beaucoup lu ?… demanda Joe.
Martin secoua la tête.
– Ça ne fait rien ! ce soir on cylindre, mais jeudi nous finirons à six heures et tu pourras t’y remettre.
Ce jour-là, Martin lava des lainages à la main dans une grande cuve, avec du savon doux, à l’aide d’une machine de fortune dont Joe tirait une grande fierté.
– Mon invention ! dit-il orgueilleusement. Ça remplace la planche, économise les genoux, et fait gagner au moins quinze minutes, ce qui n’est pas à dédaigner dans cet enfer.
Le cylindrage des manchettes et des cols était également de l’invention de Joe. Cette nuit-là, pendant leur travail à l’électricité, il le lui expliqua.
– Je suis le seul à le faire. Il le faut bien, si je veux avoir fini samedi après-midi à trois heures. Mais je connais la manière et c’est ça qui fait toute la différence. Il faut la chaleur voulue, la pression voulue, puis on les y passe trois fois. Regarde ça ! (Il leva une manchette en l’air.) À la main on ne ferait pas mieux.
Le jeudi Joe entra dans une rage folle. Un ballot « d’amidonnage fantaisie » supplémentaire était rentré.
– Je m’en vais ! hurla-t-il. J’en ai assez. Je m’en vais, froidement. À quoi ça sert-il de travailler comme un esclave toute la semaine, sans perdre une minute, pour qu’ils viennent me coller un travail de fantaisie par-dessus le marché ?… Nous sommes dans un pays libre, et je vais aller dire à ce gros Hollandais ce que je pense de lui. Et je ne le lui enverrai pas dire ! Je lui en flanquerai, moi, des fantaisies supplémentaires !…
– On travaille ce soir, dit-il un instant après, résigné à son sort.
Et ce soir-là, Martin n’essaya même pas de lutter. De toute la semaine il n’avait pas lu le journal et, chose étrange, cela ne lui manquait pas. Les nouvelles ne l’intéressaient plus. Il était trop fatigué, trop abruti pour s’intéresser à quoi que ce soit, bien qu’il projetât, s’il finissait son travail le samedi à trois heures de partir pour Oakland à bicyclette. Soixante-quinze kilomètres pour aller, autant pour le retour le dimanche après-midi, ne le prépareraient sans doute pas très bien au travail de la semaine suivante. Il aurait été plus pratique de prendre le train – mais le billet coûtait deux dollars cinquante et il voulait faire des économies.
17
Martin apprit à faire bien des choses. Dans le courant de la première semaine, en une après-midi, les deux hommes livrèrent deux cents chemises blanches. Joe manœuvrait la machine – composée d’un fer chaud accroché à un ressort d’acier qui fournissait la pression – repassait ainsi le plastron, les poignets, le col, dont il retournait les coins en angles droits et qu’il terminait par un impeccable glaçage. Aussitôt la chemise finie, il la lançait sur un râtelier, où Martin la prenait et en repassait tout ce qui n’était pas empesé.
C’était un travail éreintant, qui se poursuivait pendant des heures sans arrêt, à toute vitesse. Sous les spacieuses vérandas de l’hôtel, des hommes et des femmes, tout de blanc vêtus, suçaient des boissons glacées, en se maintenant à une agréable température. Mais dans la blanchisserie, l’air était accablant. Le grand fourneau ronflait, rougi à blanc et, des fers passés sur le linge mouillé, s’élevaient des nuages de vapeur. Ces fers étaient différents de ceux dont se servent les ménagères et dont elles éprouvent la chaleur du bout de leurs doigts humides. Comme il leur fallait une chaleur bien plus élevée, ils les essayaient en les rapprochant de leurs joues.
Martin admirait ce procédé sans toutefois le comprendre. Quand les fers étaient trop chauds, on les accrochait à des tringles de fer et on les trempait dans l’eau froide. Cette opération demandait également un coup d’œil précis et sûr : une fraction de seconde de trop, et tout était à recommencer. Martin se félicita de la précision qu’il avait acquise, quasi automatiquement, et basée sur l’observation de symptômes presque impondérables.
Mais il n’avait pas beaucoup le temps de réfléchir ni de se féliciter ; et tout son moi conscient se concentrait sur sa besogne. Son cerveau et son corps sans cesse en action, n’étaient plus qu’une machine intelligente ; les problèmes insondables de l’univers n’y trouvaient plus de place et il leur en interdisait l’accès.
Son être entier n’était plus qu’un réduit étroit, la cabine directrice qui dirigeait les muscles de ses bras, de ses doigts agiles ; ceux-ci à leur tour dirigeaient les fers rapides et leurs longues glissades fumantes, mesurées à un millimètre près, le long d’interminables manches, de dos et de côtés. Puis, le même bras, mécaniquement, lançait la chemise au râtelier approprié sans la froisser et en saisissait immédiatement une autre. Et cela pendant des heures et des heures torrides, au cours desquelles tout le monde pantelait sous le soleil californien. Mais dans la blanchisserie surchauffée, on n’avait pas le temps de panteler : les clients au frais sous la véranda avaient besoin de linge propre.
Martin ruisselait de sueur. Il buvait d’énormes quantités d’eau ; mais la chaleur était si grande, qu’elle s’évaporait en transpiration, avant même de parvenir à son estomac. Autrefois en mer, son travail lui laissait presque toujours assez de loisir pour qu’il pût se retremper en lui-même. Le patron du bateau était le maître de son temps : mais le patron de l’hôtel était le maître de ses pensées également : il ne pouvait plus en avoir que pour ce travail qui éreintait le corps, qui exaspérait les nerfs. En dehors de cela, impossible de penser. Il ne savait plus qu’il aimait Ruth. Elle n’existait pas, car il n’avait pas le temps de se souvenir d’elle. Le soir seulement, lorsqu’il tombait sur son lit, ou bien au petit déjeuner, de fugaces visions d’elle lui apparaissaient.
– C’est l’enfer, hein ? dit un jour Joe.
Martin répondit par un signe de tête irrité. La constatation d’un fait aussi flagrant était inutile. Pendant le travail ils ne parlaient pas, toute conversation en interrompait le cours automatique ; cette fois-ci Martin manqua un coup de fer et fut obligé de faire deux mouvements de plus pour rattraper le courant.
Le vendredi matin, ce fut au tour de la lessiveuse. Deux fois par semaine, ils faisaient le « gros linge » de l’hôtel : draps, taies d’oreiller, nappes et serviettes. Ensuite ils s’attelaient à l’empesage de fin, travail long, ennuyeux et délicat auquel Martin se mit plus difficilement et qui ne pouvait s’apprendre que par tâtonnements, la moindre erreur pouvant être désastreuse.
– Regarde ça, dit Joe en lui montrant une combinaison arachnéenne, qu’il aurait pu dissimuler tout entière dans le creux de sa main. Abîme-moi ça, et ça te coûtera vingt dollars sur ton mois !
Mais Martin, bien que sa tension nerveuse augmentât de plus en plus, relâcha sa tension musculaire et n’abîma rien ; il prêta même une oreille sympathique aux blasphèmes de Joe soufflant et peinant sur les ravissantes fanfreluches que portent les femmes qui ne repassent pas leur linge elles-mêmes.
Le repassage de fin était le cauchemar de Martin comme celui de Joe. C’est le repassage de fin qui les privait de quelques minutes de pause. Tout le jour ils y travaillaient. À sept heures du soir ils le quittaient pour cylindrer le linge d’hôtel. À dix heures, quand les clients allaient dormir, les deux blanchisseurs transpiraient encore sur le repassage de fin, jusqu’à minuit, une heure, quelquefois deux heures du matin. À deux heures et demie ils s’en allaient.
Le samedi matin, on mit les bouchées doubles et à trois heures le travail de la semaine fut terminé.
– Tu ne vas pas t’appuyer les 75 kilomètres d’ici Oakland, après ce turbin ? demanda Joe, lorsque, assis sur l’escalier, ils allumèrent une cigarette bien méritée.
– Il le faut, répondit-il.
– Pourquoi : à cause d’une fille ?…
– Non. Pour économiser deux dollars cinquante et changer des livres à la bibliothèque.
– Pourquoi ne les envoies-tu pas par l’express ? Ça te coûterait moins d’un dollar.
Martin réfléchit.
– Tu te reposerais demain, insista l’autre. T’en as besoin. Moi aussi, je suis vanné.
Il en avait bien l’air. Infatigable, n’arrêtant jamais, luttant toute la semaine pour gagner une minute ou une seconde de plus, il tournait les difficultés, surmontait les obstacles, colosse d’énergie inlassable, moteur humain à marche incessante, démon d’acier, et une fois sa tâche finie, il tombait dans le coma. Il se traînait, hagard, et sa belle figure se creusait de fatigue. Tout son feu, tout son ressort avaient disparu. Et le moral était à zéro.
– Et la semaine prochaine, tout sera à recommencer, dit-il tristement. Et pour quoi faire ? pour arriver à quoi ? hein ?… Quelquefois, je voudrais être chemineau. On ne travaille pas et on est nourri. Bon Dieu ! un verre de bière me ferait plaisir ! mais je n’ai pas le courage d’aller jusqu’au village pour ça. Reste donc ici et envoie tes livres par l’express ou bien tu n’es qu’un imbécile !
– Mais que vais-je faire, tout le dimanche ? demanda Martin.
– Tu te reposeras. Tu ne te doutes pas combien tu es fatigué. Moi, je suis si éreinté le dimanche que je ne peux même pas lire les journaux. Une fois je suis tombé malade de la typhoïde. À l’hôpital, deux mois et demi, sans rien faire. Ça, c’était vivre.… C’était vivre ! répéta-t-il rêveusement, un instant plus tard.
Martin, après avoir pris un bain, s’aperçut de la disparition du blanchisseur en chef. Il devait être allé boire son verre de bière, se dit Martin et il décida que les sept cents mètres à faire jusqu’au village étaient un trop long voyage pour lui. Il s’étendit sur son lit après avoir enlevé ses chaussures et s’efforça de reprendre ses esprits. Il n’essaya même pas de lire ; il ressentait une fatigue trop grande pour avoir sommeil. À demi inconscient, stupéfié d’éreintement, il demeura là, jusqu’au dîner. Joe ne vint pas. Et lorsque Martin entendit le jardinier annoncer qu’il devait très probablement être en train d’user ses coudes sur le zinc du bar, il comprit la raison de son absence. Martin alla se coucher immédiatement après et décida le lendemain matin qu’il était très reposé. Joe était toujours absent, Martin se procura un journal et s’assit à l’ombre d’un arbre. La matinée s’écoula, il ne sut pas comment. Il n’avait pas dormi, personne ne l’avait dérangé et il n’avait pas terminé son journal. Il revint au même endroit l’après-midi, après déjeuner et, cette fois, il s’endormit.
Ainsi passa le dimanche et, le lundi matin, il fut au travail triant le linge, tandis que Joe, gémissant, blasphémant, actionnait la lessiveuse et préparait le savon mou.
– Je ne peux pas m’en empêcher ! expliqua-t-il. Quand le samedi soir arrive, il faut que je me soûle !
Une autre semaine s’écoula, d’éreintantes journées, d’intolérables nuits à l’électricité – jusqu’au samedi après-midi à trois heures où Joe savoura un instant de contentement et partit ensuite au village pour oublier. Le dimanche de Martin fut pareil au précédent. Il dormit à l’ombre des arbres, jeta un œil vague sur le journal et passa de longues heures allongé sur le dos, sans rien faire, sans penser. Il était trop abruti pour penser, bien qu’il fût mécontent de lui-même. Il se dégoûtait, comme s’il avait subi une dégradation morale, une diminution de sa valeur intrinsèque. Tout ce qui le rendait semblable aux dieux était annihilé ; aucune ambition ne l’éperonnait plus. Son âme semblait morte. Il n’était plus qu’une bête – une bête de somme. La beauté du soleil perçant de flèches d’or le feuillage, ne le frappait plus ; l’azur du ciel ne lui murmurait plus rien ; les secrets de la nature et l’immensité du mystérieux univers ne l’attiraient plus. La vie était intolérablement monotone, stupide, amère au goût. Un écran sombre recouvrait le miroir de sa vision intérieure et sa fantaisie dormait dans une chambre de malade où ne pénétrait aucun rayon de soleil. Il enviait Joe là-bas au village, traînant ses coudes sur le zinc du bar, ruminant des idées fixes, ressassant de façon inepte d’ineptes choses, oubliant dans son ivresse le lundi matin et l’éreintante semaine à venir.
Une troisième semaine s’écoula et Martin se maudit et maudit la vie. Le sentiment d’une faillite l’oppressa. Il y avait une raison pour que les éditeurs refusent ses œuvres, il le voyait à présent et il se moquait de lui-même et de ses rêves. Ruth lui renvoya ses « Poèmes de la mer » par la poste. Il lut sa lettre, sans manifester aucune réaction. Elle le complimentait de son mieux. Mais elle ne savait pas mentir et il vit de la désapprobation entre les lignes courtoisement élogieuses. Et elle avait raison, il en fut convaincu en relisant son poème. L’enchantement était tombé et il se demanda ce qui avait pu lui passer par l’esprit quand il l’écrivit. L’audace de sa phraséologie lui parut grotesque, son lyrisme d’expression, monstrueux ; tout était absurde, irréel, impossible. Il aurait sur-le-champ brûlé les « Poèmes de la mer » s’il ne lui avait fallu pour cela un effort de volonté. Il y avait bien le foyer des chaudières, mais la fatigue de les y porter aurait été grande. Toute son énergie était employée à laver le linge des gens : il ne lui en restait plus pour ses affaires personnelles.
Il résolut de se ressaisir le dimanche suivant et de répondre à Ruth. Mais le samedi après-midi, quand l’ouvrage fut fini et son bain pris, le désir d’oublier l’emporta. « Je vais aller voir ce que fabrique Joe », prit-il comme prétexte, tout en sachant parfaitement qu’il mentait. Mais il se refusa à l’admettre, parce qu’il voulait oublier. Il s’achemina d’abord lentement, comme par hasard, vers le village, augmentant l’allure malgré lui à mesure qu’il approchait du café.
– Je croyais que tu ne buvais que de la flotte ? dit Joe en guise de bienvenue.
Martin, dédaignant de fournir des explications, commanda du whisky et en remplit son verre jusqu’au bord avant de passer la bouteille.
– Ne la garde pas toute la nuit, dit-il d’un ton rude.
L’autre jouait avec la bouteille et Martin, agacé de l’attendre, avala son verre d’une lampée et le remplit de nouveau.
– À présent je peux t’attendre, dit-il d’un air renfrogné, mais dépêche-toi.
Joe se dépêcha et ils burent ensemble.
– C’est le travail qui te fait ça, hein ? questionna Joe.
Mais Martin se refusa à toute discussion sur ce sujet.
– Ah oui ! c’est un bel enfer, continua l’autre, seulement ça me dégoûte de te voir en venir là, Mart. Eh bien ! voilà ! c’est comme ça qu’on y arrive.
Martin buvait sans rien dire ; il donnait ses ordres d’une voix mordante et terrorisait le tenancier du bar, jeune campagnard efféminé aux yeux bleus aqueux, aux cheveux séparés par une raie.
– La façon dont ils nous traitent, nous autres pauvres diables, est scandaleuse, énonça Joe. Si je ne me soûlais pas, j’éclaterais et je brûlerais leur cambuse ! La boisson, voilà ce qui me sauve, je te jure !
Mais Martin ne répondit pas. Quelques tournées de plus et, dans son cerveau, les fantasmagories de l’intoxication se mirent en branle. Ah ! voilà qui était de nouveau, vivre ! la première bouffée de vie qu’il ait aspirée depuis trois semaines !… Ses rêves lui réapparurent. La fantaisie s’évada de la chambre sombre, toute vêtue de flamboyante clarté et lui fit signe. Le miroir de sa vision intérieure reflétait de nouveau, transparent comme le cristal, des images éclatantes. L’enchantement et la beauté, les mains entrelacées, lui souriaient ; tout son pouvoir était revenu. Il essaya d’en parler à Joe, mais Joe, tout à ses marottes personnelles, exposait d’infaillibles plans qui devaient lui permettre d’échapper à l’esclavage du blanchissage, pour devenir lui-même propriétaire d’une grande blanchisserie à vapeur.
– Je vais te dire, Mart, il n’y aura pas de gosses à travailler, dans ma blanchisserie – non, pas un, parole ! Et pas une âme ne turbinera après six heures du soir. Tu entends ? Il y aura assez de machines et de monde pour que le travail se fasse à des heures décentes. Et, Mart, tu m’aideras, dis ? Je te nommerai surintendant de la boîte, de tout le bastringue, de tout le monde. Maintenant voici le plan : je me fais buveur d’eau pendant deux ans, je fais des économies et alors…
Martin, se détournant, le laissa faire ses confidences au tenancier du bar. Mais bientôt celui-ci fut appelé pour servir à boire à deux fermiers, qui acceptèrent l’invitation de Martin. Martin fit largesse, invita tous ceux qui entraient, valets de ferme, cochers, l’aide-jardinier de l’hôtel, le tenancier du bar et le furtif chemineau qui se glissa comme une ombre dans le bar et, comme une ombre, se dissimula dans un coin.
18
Le lundi matin, Joe gémit à la première fournée de linge plongée dans la lessiveuse.
– Dis donc !…
– Ne me parle pas ! gronda Martin.
– Pardon Joe, dit-il à midi, quand ils allèrent ensemble déjeuner.
Des larmes mouillèrent les yeux de l’autre.
– Ça va, ça va, mon vieux ! dit-il. Nous sommes en enfer et nous ne pouvons rien y faire. Seulement tu sais, je t’ai à la bonne. Voilà ce qui m’a vexé. Tu m’as plu tout de suite.
Martin lui serra la main.
– Si on lâchait ça ? suggéra Joe. Lâchons ça et faisons-nous chemineaux. Je n’ai jamais essayé, mais ça doit être très facile. Et rien à faire, pense donc ! rien à faire ! j’ai été malade une fois – la typhoïde – à l’hôpital et c’était épatant ! Je voudrais bien retomber malade.
La semaine fut longue. L’hôtel était plein et « l’empesage de fin » s’accumulait. Ils firent des prodiges. Ils travaillaient tard chaque nuit, dépêchaient leurs repas et commençaient même une demi-heure avant le petit déjeuner. Martin ne prenait plus de bain froid. Chaque instant était précieux et Joe, gardien attentif du troupeau, n’en perdait pas un, les comptait et les recomptait comme un avare son trésor ; il peinait fiévreusement, comme une machine forcenée, aidée par cette autre machine, Martin Eden – un homme.
Mais les moments étaient rares, où Martin pouvait se permettre de penser. La maison des pensées était close, ses volets fermés et il en était le sombre gardien. Joe avait raison : tous deux n’étaient que des ombres, travaillant dans les limbes éternelles du labeur. Ou bien était-ce un rêve ?… Quelquefois, au milieu de la vapeur bouillante, tout en faisant aller et venir les lourds fers sur le linge blanc, il avait l’impression de vivre un rêve. Bientôt, ou peut-être dans un siècle ou deux, il s’éveillerait dans sa petite chambre, près de la table tachée d’encre et reprendrait sa littérature au point où il l’avait laissée la veille. Ou bien, si ceci aussi était un rêve, la relève de vigie le réveillerait : il bondirait de sa couchette dans l’entrepont et, secoué par le roulis, il prendrait la barre et sentirait la fraîcheur des vents alizés caresser sa chair, sous le clair regard des étoiles tropicales.
Vint le samedi et son précaire triomphe de trois heures.
– Je crois bien que je vais aller là-bas boire un verre de bière ! dit Joe, de la voix bizarre, désaccordée, qui annonçait le coma hebdomadaire.
Martin parut soudain s’éveiller. Il ouvrit le sac de cuir des accessoires, huila ses roues, et sa chaîne, ajusta sa selle. Joe n’était pas à mi-chemin du bar, que Martin le dépassait, penché sur son guidon, pédalant vigoureusement ; il était visiblement décidé à avaler ses 75 kilomètres de poussière et de chaleur le plus vite possible. Il arriva à Oakland pour dormir, refit le dimanche les 75 kilomètres de retour, et le lendemain matin se remit à l’ouvrage, fatigué.
Mais il n’avait pas bu.
Une cinquième semaine passa, puis une sixième, durant lesquelles il vécut comme une machine ; il ne lui restait plus dans l’âme qu’une toute petite étincelle, qui le forçait, toutes les fins de semaines, à avaler ses 150 kilomètres, non pas pour se reposer, mais pour tâcher au contraire, d’éteindre cette petite étincelle, dernier vestige de sa vie passée. À la fin de la septième semaine, malgré lui, mais incapable de résister, il descendit au village avec Joe et but l’oubli et la joie de vivre jusqu’au lundi matin.
Puis il refit un samedi, les 150 kilomètres, effaçant l’engourdissement de sa trop grande fatigue par une fatigue encore plus grande. Au bout de trois mois, il retourna au village avec Joe ; c’était la troisième fois. Il but, oublia, revécut, et, soudain éclairé, vit la brute qu’il allait devenir, non par la faute de la boisson, mais par la faute du travail. La boisson n’était que l’effet, non la cause. Elle succédait inévitablement au travail comme la nuit succède au jour. Ce n’était pas en devenant une bête de somme qu’il gagnerait les sommets – lui chuchotait le whisky à l’oreille – et il approuva l’avis. Le whisky était sage et connaissait bien son œuvre. Il demanda du papier, un crayon, à boire pour tout le monde et, pendant qu’on buvait à sa santé, il s’appuya au bar et gribouilla quelque chose.
– Un télégramme, Joe, dit-il. Lis !
Joe lut d’un œil vague, comiquement torve. Mais ce qu’il lut le dégrisa. Il regarda Martin avec désespoir ; des larmes jaillirent de ses yeux et descendirent le long de ses joues.
– Tu ne vas pas me planter là, Mart ? interrogea-t-il, d’un ton lamentable.
Martin fit signe que oui et pria le garçon de porter le télégramme à la poste.
– Attends ! bredouilla pâteusement Joe. Laisse-moi réfléchir.
Il se cramponna au bar, les jambes flageolantes, tandis que Martin, un bras autour de lui, le maintenait en équilibre.
– Dis : deux blanchisseurs ! dit-il brusquement. Voilà qui est décidé.
– Pourquoi veux-tu quitter ? demanda Martin.
– Pour la même raison que toi.
– Mais je vais m’embarquer ! Tu n’y connais rien, toi !
– Non ! répondit Joe. Mais je peux prendre la route, parfaitement ! parfaitement !
Martin le regarda attentivement un instant, puis s’écria :
– Bon Dieu ! Tu as raison ! Mieux vaut être chemineau que bête de somme. Au moins tu vivras, mon vieux ! et ce sera bien la première fois que ça t’arrivera !
– J’ai été une fois à l’hôpital, corrigea Joe. C’était épatant. La typhoïde – je te l’ai dit ?…
Martin changea la rédaction du télégramme, mit « deux blanchisseurs », et Joe poursuivit :
– À l’hôpital, je n’ai jamais eu envie de boire. C’est drôle, hein ? Mais quand je trime comme un esclave toute la semaine, il faut que je me soûle. Tu n’as pas remarqué que les cuisiniers boivent comme des trous ? et les boulangers donc ?… C’est le travail. Ils ne peuvent pas faire autrement. Là, laisse-moi payer la moitié du télégramme…
– Nous allons le jouer, offrit Martin.
– Allez ! pour tout le monde à boire ! cria Joe, pendant que les dés roulaient sur le zinc poisseux.
Le lundi matin, Joe était fou d’impatience. Il ne s’occupait pas de sa migraine et ne s’intéressait guère à son travail. Les instants se perdaient, par troupeaux, tandis que leur gardien inattentif regardait par la fenêtre le soleil et les arbres.
– Regarde ! regarde ! s’écriait-il. Tout ça est à moi ! Entrée libre ! Je peux me coucher sous les arbres et dormir cent ans si ça me plaît. Allez, Mart, filons ! À quoi bon attendre une minute de plus ? En voiture, pour le pays de la flamme éternelle ! J’ai mon billet ! et c’est pas un billet d’aller et retour, je te le jure !
Quelques instants plus tard, en remplissant la cuve de linge sale, Joe aperçut la chemise du patron de l’hôtel ; il en connaissait la marque. Dans un accès d’indépendance frénétique, il la jeta sur le sol et la piétina.
– Je voudrais que tu sois dedans, sale gros Hollandais ! hurla-t-il. Dedans, et sous mes pieds ! Tiens, saligaud ! Arrête-moi, ou je fais un malheur.
Martin en riant lui fit reprendre son ouvrage. Le mardi soir, les nouveaux blanchisseurs arrivèrent et le reste de la semaine se passa à les mettre au courant. Joe, assis, expliquait sa méthode, mais ne travaillait plus.
– J’en fous plus une rame ! annonça-t-il. Qu’ils me foutent à la porte s’ils veulent, mais, s’ils le font, je m’en vais illico ! Très peu pour moi, merci bien ! À moi les routes, les prés et les siestes à l’ombre, sous les arbres ! Allez les esclaves ! Ça va bien ! Parfait ! Trimez et suez ! Trimez et suez ! Et quand vous serez morts, vous pourrirez, comme moi. D’abord, qu’est-ce que ça peut faire, que vous viviez ou non ? hein ?… dites, qu’est-ce que ça peut faire ?…
Le samedi on les paya et ils se dirent adieu.
– C’est pas la peine que je te demande de changer d’idée et de courir les routes avec moi ? interrogea Joe désespérément.
Martin secoua la tête. Il s’apprêtait à enfourcher sa bicyclette. Ils se serrèrent la main. Joe retint la sienne un instant, puis dit :
– Je te reverrai, Mart, avant qu’on ne meure, nous deux. C’est certain. Je le sens. Salut, Mart. Je t’aime rudement, tu sais !…
Silhouette désolée plantée au milieu de la route, il attendit que Martin eût disparu au tournant.
– C’est un bon zig, ce gars-là, grogna-t-il, un bon zig.
Puis il s’achemina lentement vers les citernes, où une demi-douzaine de réservoirs vides attendaient, sur le bas-côté, les convois montants.
19
Ruth et sa famille étaient de retour, et Martin, dès son arrivée, la vit souvent. Elle avait terminé ses études ; lui, déprimé physiquement et cérébralement, n’écrivait pas. Ils purent donc se voir à leur aise, pour la première fois, et leur intimité grandit rapidement.
Au début, Martin ne fit que se reposer. Il dormit énormément, passa de longues heures à rêvasser, à penser, à ne rien faire. Il était pareil à un convalescent relevant d’une terrible maladie. Le premier signe de renaissance se produisit le jour où il s’intéressa de nouveau à la lecture des journaux. Alors il se remit à lire des nouvelles frivoles, des vers, et, quelques jours après, il se replongeait, tête baissée, dans le Fiske tant négligé. Son tempérament et sa santé splendides avaient repris le dessus et il jouissait plus que jamais des ressources profondes de sa jeunesse.
Ruth, quand elle apprit qu’aussitôt reposé il reprendrait la mer, ne dissimula pas son désappointement.
– Pourquoi faites-vous ça ? fit-elle.
– Pour gagner de l’argent, répondit Martin. Il faut que j’en fasse une nouvelle provision, en vue d’une nouvelle campagne contre les éditeurs. L’argent est le nerf de la guerre, dans mon cas, surtout – l’argent et la patience.
– Mais s’il ne vous faut que de l’argent, pourquoi n’êtes-vous pas resté à la blanchisserie ?
– Parce que la blanchisserie faisait de moi une brute. Un travail pareil vous mène forcément à la boisson.
– Vous n’allez pas me dire que vous… ? (Elle le fixa avec de grands yeux horrifiés.)
Il aurait pu facilement éluder la question : mais sa nature était franche d’instinct et il se souvint de son ancienne résolution d’être sincère, quoi qu’il arrive.
– Oui, répondit-il. Justement. Plusieurs fois.
Avec un frisson elle s’éloigna de lui.
– Dans mon entourage, personne n’a jamais fait ça.
– C’est qu’ils n’ont jamais travaillé à la blanchisserie de Shelly Hot Springs, dit-il en riant amèrement. Le travail est une bonne chose. Il est nécessaire à la santé humaine, disent les prédicateurs, et Dieu sait qu’il ne m’a jamais fait peur. Mais « abondance de biens, nuit » comme dit le proverbe, et la blanchisserie exagérait, vraiment. Voilà pourquoi je reprends la mer. Je crois que ce sera mon dernier voyage, car à mon retour, je réussirai avec ma littérature. J’en suis certain.
Elle demeura silencieuse, hostile, et il l’observait mélancoliquement, se rendant compte qu’elle était incapable de comprendre par quoi il avait passé.
– Un jour, j’écrirai : « De la dégradation produite par le travail » ou « La Psychologie de la boisson dans la classe ouvrière », quelque chose de ce genre.
Jamais depuis leur première entrevue ils ne s’étaient sentis aussi éloignés l’un de l’autre. Sa confession si franche, faite dans un esprit de révolte, l’avait dégoûtée. Sa dégradation la choquait, bien plus que ce qui en avait été la cause directe ; elle dut admettre à quel point elle s’était rapprochée de lui et, ceci accepté, à quel point leur intimité devrait se resserrer encore. Sa pitié se réveillait aussi, ainsi que d’innocents et idéalistes projets de rééducation. Elle sauverait cette jeunesse sauvage si pleine de bonne volonté. Elle le sauverait de l’influence maudite de son milieu d’autrefois, et elle le sauverait de lui-même, malgré lui. Tout ceci lui semblait être un très noble état d’âme et elle ne doutait guère qu’il dissimulait simplement de la jalousie et du désir d’amour.
Ils firent beaucoup de bicyclette, par ces délicieuses après-midi de l’arrière-saison et, là-bas, sur la colline, ils lurent à haute voix des vers – tantôt l’un, tantôt l’autre de ces nobles poèmes qui élèvent l’âme. La renonciation, la patience, l’application, le devoir, l’ordre, tels étaient les principes qu’elle lui prêchait de cette façon indirecte et qui lui avaient été inculqués par son père, par M. Butler et par Andrew Carnegie, qui, de pauvre petit émigrant était devenu le grand dispensateur de livres de l’univers.
Martin appréciait tout cela et en jouissait. Il suivait mieux la mentalité de Ruth à présent et son âme avait cessé d’être pour lui un coffret mystérieux, aux surprises toujours renouvelées. Intellectuellement, il se sentait son égal. Mais leurs divergences ne troublaient pas son amour qui était plus fort, plus ardent que jamais, car il l’aimait pour ce qu’elle était et sa fragilité physique même augmentait son charme à ses yeux. Il avait lu l’histoire de cette maladie d’Elisabeth Barrett, qui, après avoir passé des années couchée, fut enlevée, un jour, par Browning et guérie par la force de son ardent amour. Et, ce que Browning avait fait pour Elisabeth, Martin décida de le faire pour Ruth. Mais il fallait, d’abord, qu’elle l’aime. Il lui donnerait ensuite la force et la santé. Et il entrevit leur vie future : dans un décor de travail et de confort, lui et Ruth évoluaient, lisaient des vers et parlaient d’art, Ruth, allongée parmi des monceaux de coussins épars. Parfois elle lui lisait à haute voix ; ou bien c’était lui qui lisait, et elle appuyait la tête sur son épaule. D’autres fois, ils regardaient ensemble des gravures. Puis, comme elle aussi aimait la nature, sa généreuse imagination changeait le décor de leurs lectures. Ils lisaient dans de profondes gorges ou bien assis dans des prairies ensoleillées, sur la montagne ; ou encore sur la dune de sable gris perle, où les vagues festonnaient des guirlandes à leurs pieds ; ou bien très loin, dans une île des tropiques où les cascades, en atteignant la mer, se dissolvent en vapeurs légères qui tremblent et ondulent à la moindre brise. Mais toujours, au premier plan, régnant sur ces royaumes d’éternelle beauté, ils étaient là, Ruth et Martin, et au-delà du décor formé par la nature, il y en avait un autre, nuageux – celui du travail, du succès, et de l’argent gagné qui les avaient affranchis du monde.
– Je recommande à ma petite fille d’être prudente… dit un jour Mme Morse à Ruth, d’un air plein de sous-entendus.
– Je sais ce que tu veux dire. Mais c’est impossible. Il n’est pas de ma…
Ruth rougit, mais cette rougeur était celle de la vierge qui pour la première fois discute les problèmes sacrés de la vie avec une mère respectée.
– De ta condition, termina la mère.
Ruth fit un signe d’assentiment.
– Je n’osais pas le dire, mais c’est ça. Il est rude, brutal, fort, trop fort. Il n’a pas…
Elle hésita encore, sans oser poursuivre. Jamais elle n’avait encore abordé un sujet de ce genre avec sa mère. Et de nouveau sa mère compléta sa pensée.
– Il n’a pas vécu une existence propre, tu veux dire.
Ruth acquiesça et rougit à nouveau.
– C’est ça, dit-elle. Ce n’est pas sa faute, mais il a beaucoup joué avec…
– Avec le feu ?
– Oui, avec le feu. Et il me fait peur. Quelquefois j’en ai une véritable terreur, quand il me raconte les choses qu’il a faites, de la façon la plus naturelle du monde, comme si ça n’avait aucune importance. Mais elles en ont une, n’est-ce pas ?
Elles étaient assises, les bras entrelacés et, dans un silence, la mère caressa la main qui s’abandonnait, en attendant qu’elle continue.
– Mais je m’intéresse follement à lui. Il est, en somme, mon premier ami homme – pas tout à fait mon ami, mais mon protégé et mon ami combinés. Quelquefois aussi, quand il me fait peur, il me semble que c’est un bull-dog que l’on m’a donné comme jouet et qui tire sur sa chaîne, qui montre les dents et menace de tout arracher.
Sa mère attendit encore.
– Il m’amuse, je crois, comme un bull-dog. Il y a beaucoup de choses bonnes en lui ; mais il y en a aussi beaucoup que je n’aime pas… Tu vois, j’ai beaucoup réfléchi. Il jure, il fume, il boit, il boxait – il me l’avoue et ne le regrette pas – il me l’a dit. Il est tout ce qu’un homme ne doit pas être, un homme dont je voudrais comme… (sa voix ne fut plus qu’un murmure) comme mari. Et puis il est trop athlétique. Mon prince charmant sera grand, mince et brun, plein d’élégance et de charme. Non. Il n’y a aucun danger que je devienne amoureuse de Martin Eden. Ce serait bien la plus terrible chose qui puisse m’arriver.
– Mais ce n’est pas de ça que je parlais, dit finement la mère. As-tu jamais pensé à lui ? Il est hors concours de toutes façons, naturellement ; mais supposons qu’il en arrive à t’aimer ?
– Mais il m’aime… déjà ! s’écria Ruth.
– C’était à prévoir, dit doucement Mme Morse. Comment pourrait-il en être autrement pour un homme qui t’approche ?
– Olney me hait ! dit-elle avec véhémence. Et je hais Olney. Quand il est là, je me sens pousser des griffes de chat. Il faut que je sois mauvaise, et quand je ne le suis pas, eh bien ! c’est lui qui l’est ! Mais avec Martin Eden je suis contente. Personne ne m’a jamais aimée avant lui – aucun homme, je veux dire – et de cette manière. Et c’est bon d’être aimée… ainsi. Tu comprends ce que je veux dire, maman chérie ? C’est si doux de se sentir si vraiment, si profondément femme.
Et cachant son visage sur les genoux de sa mère, elle sanglota :
– Tu me trouves épouvantable, je sais ! mais je suis honnête et je te dis exactement ce que je ressens.
Mme Morse fut en même temps triste et heureuse. Sa petite fille, la licenciée es lettres, n’existait plus : c’était une jeune fille, une femme. L’expérience avait réussi. Le tempérament si étrangement apathique de Ruth s’était réveillé, sans heurt ni catastrophe. Ce rude marin avait été l’instrument et, bien que Ruth ne l’aime point, il l’avait éveillée à la féminité.
– Sa main tremble, avoua Ruth en rougissant. C’est amusant et ridicule ; mais je le plains aussi quelquefois. Et quand sa main tremble trop, que ses yeux brillent exagérément, eh bien ! je le sermonne et lui indique la façon de s’amender. Mais il m’adore, je le sais. Ses yeux et sa main ne mentent pas. Et cette idée me fait sentir plus femme ; je sens que j’ai en moi une chose à laquelle j’ai droit, une chose qui me rend semblable aux autres filles et… aux femmes. Je sais aussi qu’avant je n’étais pas semblable à elles et ça te tracassait. Tu pensais que je ne le voyais pas, mais je l’ai vu et je voulais… faire mon possible, comme dit Martin Eden.
Ce fut une heure exquise pour la mère et la fille et leurs yeux étaient humides, tandis qu’elles causaient dans la pénombre, Ruth toute innocence et franchise, sa mère compréhensive, sympathisant doucement, expliquant tout et conseillant avec calme et clarté.
– Il a quatre ans de moins que toi, dit-elle. Il n’a ni situation, ni fortune. Il n’a aucun sens pratique. Puisqu’il t’aime, il devrait, s’il avait du bon sens, faire quelque chose qui lui donnerait un jour le droit de t’épouser, au lieu de perdre son temps à écrire ces histoires et à faire des rêves enfantins. Martin Eden, je le crains, ne sera jamais sérieux. Il n’envisage nullement l’idée d’un métier convenable comme l’ont fait certains de nos amis – M. Butler, par exemple. Martin Eden, je le crains, ne sera jamais riche. Et dans ce monde, l’argent est nécessaire au bonheur. Oh ! je ne parle même pas d’une énorme fortune !… mais d’une fortune suffisante à assurer un confort convenable. Il… il n’a jamais parlé ?…
– Il ne m’a jamais dit un mot ; mais, s’il le faisait, je l’arrêterais, car, tu sais, je ne suis pas amoureuse de lui !
– Tant mieux. Je ne serais pas contente de voir mon enfant, ma fille unique, si nette, si pure, aimer un homme pareil. Il existe de par le monde, des hommes nets, fidèles, virils. Attends un de ceux-là. Tu le trouveras un jour, tu l’aimeras et il t’aimera et vous serez aussi heureux ensemble que ton père et moi l’avons été. Il est une chose à laquelle tu dois toujours penser…
– Oui, maman.
La voix de Mme Morse se fit plus basse et plus douce encore pour dire :
– Ce sont les enfants.
– Oui… j’y ai pensé… avoua Ruth. (Elle rougit encore en se souvenant des pensées voluptueuses qu’elle avait eues.)
– Et c’est l’idée des enfants qui rend impossible M. Eden, poursuivit Mme Morse d’une voix incisive. Leur hérédité doit être pure, et la sienne ne peut pas l’être. Ton père m’a raconté la vie des marins et… tu me comprends.
Ruth pressa la main de sa mère en signe d’assentiment ; elle la comprenait, bien que l’allusion lui semblât vague, étrange, effrayante au-delà de son imagination.
– Tu sais que je te dis tout, fit-elle…, seulement quelquefois, il faut me questionner comme tu l’as fait aujourd’hui. Je voulais t’en parler, mais je ne savais pas comment commencer. C’est de la fausse honte, je le sais, mais tu me facilites les choses. Car, maman, tu es femme aussi ! s’écria-t-elle avec exaltation. (Debout, elle saisit les mains de sa mère et, toutes deux face à face, dans la pénombre grandissante, eurent conscience de leur égalité devant l’homme.) Je ne t’aurais jamais connue de cette manière sans cette conversation. Il a fallu que je me découvre femme pour savoir que tu en étais une aussi !
– Oui, nous sommes femmes toutes les deux, dit la mère, en l’attirant à elle pour l’embrasser. Elles sortirent de la pièce enlacées, le cœur gonflé d’une tendresse nouvelle.
– Notre petite fille est devenue femme ! dit Mme Morse à son mari une heure après.
– Ça veut dire, dit-il après un long regard à sa femme, ça veut dire qu’elle est amoureuse.
– Non, mais qu’elle est aimée, répondit-elle souriante. L’expérience a réussi. Elle est éveillée.
– Alors, il faut nous débarrasser de lui, répondit M. Morse, de son ton précis d’homme d’affaires.
Mais sa femme secoua la tête :
– C’est inutile, Ruth dit qu’il va partir en mer dans quelques jours. Quand il reviendra, elle ne sera plus là. Nous allons l’envoyer dans l’Est chez la tante Clara. D’ailleurs un an dans l’Est, avec le changement de climat, d’idées, d’entourage, lui fera grand bien.
20
Une fois de plus le désir d’écrire s’empara de Martin. Des sujets de romans, de poèmes, germaient spontanément dans son cerveau et il les notait pour les retrouver plus tard et leur donner une forme. Mais il n’écrivait pas. Il se donnait un congé, ne voulait l’employer qu’au repos et y réussissait fort bien. Bientôt sa vitalité déborda et, comme autrefois, Ruth subit cette emprise étrange de sa force et de sa santé qui lui donnaient une espèce de choc physique.
– Sois prudente ! lui répéta un jour sa mère. Je crains que tu ne voies trop souvent Martin Eden.
Mais Ruth riait. Elle se sentait sûre d’elle-même ; dans quelques jours il prendrait la mer et à son retour, elle serait partie. Cependant l’exubérante vitalité de Martin était presque magnétique. Mis au courant du projet de voyage dans l’Est, il sentait qu’il lui fallait se hâter et, d’autre part, il ne savait comment faire la cour à une jeune fille comme Ruth, sa large expérience d’antan ne pouvant lui servir à rien. Les femmes qu’il avait fréquentées différaient par trop de Ruth ; elles se connaissaient fort bien en flirt et en coquetterie, tandis que Ruth ne s’en doutait pas. Sa prodigieuse innocence le médusait, glaçait sur ses lèvres toute parole ardente, le convainquait, en dépit de lui-même, de sa propre indignité. De plus, il avait un autre désavantage : jamais il n’avait aimé auparavant. Des femmes lui avaient plu, au temps de son aventureux passé, des femmes avaient pu le captiver un instant, mais d’amour, il n’en avait jamais éprouvé pour elles. Pour les avoir, il lui avait suffi du plus négligent appel et elles étaient accourues. Elles avaient été des incidents, des distractions – pas autre chose. Et maintenant, le suppliant, le timide, le tendre et l’hésitant, c’était lui. Il ne savait aucune des roueries de l’amour, ni son langage, et la lumineuse innocence de sa bien-aimée l’épouvantait. En évoluant dans des milieux variés, à travers leurs multiples décors, il avait appris la règle de conduite qui consiste, lorsqu’on joue à un jeu inconnu, à toujours amener l’adversaire à jouer le premier. Bien des fois cela lui avait réussi et il en avait tiré d’utiles renseignements. Il savait surprendre le symptôme, attendre une faiblesse de l’adversaire pour en profiter, se loger au moment propice. C’était en somme comme un jeu de feintes et de parades, à la boxe. Et lorsque la feinte amenait le coup qu’il escomptait, il savait depuis longtemps déjà comment en profiter, et touchait juste.
Il attendit donc avec Ruth ; il désirait lui dire son amour, sans oser le lui avouer. Il craignait de la choquer et se méfiait de lui-même. Et cependant, sans le savoir, il employait avec elle le bon moyen. L’amour naquit sur la terre avant la parole ; son cours, ses atteintes et ses manifestations, sont éternellement les mêmes. Ce fut de la manière la plus primitive que Martin conquit Ruth, sans s’en douter tout d’abord. Le contact de sa main sur la sienne avait une action plus efficace que tous les mots ; l’effet de sa force sur son imagination la séduisait davantage que n’importe quel poème et que les discours passionnés de tous les amants célèbres. Les sentiments qu’il aurait peut-être pu exprimer auraient sans doute en partie atteint son cœur ; le toucher de sa main, un contact léger, atteignaient son instinct. La raison de Ruth était jeune comme elle, mais l’instinct qui l’animait était vieux comme le monde ; né avec l’amour, il avait mûri avec lui et sa puissance prévalait sur les conventions et les préjugés de classe ou d’opinion. Sa raison n’entra donc pas en ligne de compte et elle n’eut pas conscience des efforts constants de Martin sur son cœur. Qu’il l’aimât, d’autre part, était clair comme le jour et elle se délectait aux manifestations de cet amour – aux tendres lueurs de ses yeux ardents, aux tremblements de ses mains, aux rougeurs sombres qui empourpraient son visage bronzé. Elle alla même plus loin : timidement, d’un toucher si délicat qu’il ne s’en apercevait pas et – presque inconsciemment, de sorte qu’elle ne se méfiait pas d’elle-même – elle le provoquait. La preuve de son pouvoir, qui la proclamait femme, la ravissait et elle jouissait de le tourmenter et de jouer avec le danger.
Par inexpérience et par excès d’amour, Martin continuait ses travaux d’approche par la simple influence physique, par le contact seul. Que le toucher de sa main fût à ce point agréable à Ruth, il l’ignorait, tout en sentant cependant qu’il ne lui était pas désagréable. Ils n’avaient pourtant pas souvent l’occasion de se prendre la main, excepté pour se dire bonjour ou adieu, mais les promenades à bicyclette, qui nécessitent mille petits arrangements en commun, la lecture du même livre, à la campagne, serrés l’un contre l’autre, fournissaient bien des prétextes à des frôlement soi-disant involontaires. Il arrivait aussi par hasard qu’une mèche blonde caresse la joue brune, qu’une épaule effleure l’autre épaule, tandis qu’ils se penchaient ensemble sur le même livre.
Elle souriait en elle-même des envies soudaines qui la prenaient tout à coup de lui passer la main dans les cheveux, à rebrousse-poil ; lui, de son côté, souhaitait, une fois leur lecture finie, reposer sa tête sur ses genoux, fermer les yeux et rêver de leur avenir commun. Autrefois, à certains pique-niques du dimanche à Shellmound Park ou à Schuetzen Park, il avait posé sa tête sur bien des genoux différents ; habituellement, il y dormait profondément, tandis que l’élue du moment abritait son visage du soleil, le contemplait et s’étonnait de la suprême indifférence avec laquelle il recevait les hommages. Mettre sa tête sur les genoux d’une femme, avait été jusqu’à présent l’opération la plus facile du monde, tandis que les genoux de Ruth lui semblaient inaccessibles, imprenables. Cependant, sans le savoir, là encore, il avait raison de ne rien oser. À cause de cette réserve même elle ne se tenait pas sur la défensive, elle n’avait pas conscience du danger qu’elle côtoyait au cours de leurs entrevues seule à seul. D’une façon subtile et insensible, elle se rapprochait de lui et lui, sentant ce rapprochement s’accentuer de jour en jour, voulait oser, et… n’osait pas.
Un jour il osa, un après-midi où il l’avait trouvée dans le salon obscur, souffrant d’une affreuse migraine.
– Rien n’y fait, répondit-elle à ses questions. D’ailleurs, je ne prends aucune drogue, le Dr Hall ne me le permet pas !
– Je peux vous guérir, je crois, et sans drogue, dit Martin. Je n’en suis pas sûr, bien entendu, mais je voudrais essayer. C’est un massage, qu’un Japonais m’a appris. Puis j’en ai appris des variantes chez les Hawaïens. Ils appellent ça « Lomi-Lomi ». Et le « Lomi-Lomi » fait à peu près tout ce que font les drogues et même davantage.
À peine ses mains eurent-elles touché le front de Ruth, qu’elle poussa un profond soupir.
– Que c’est bon ! dit-elle.
Une demi-heure plus tard elle dit encore :
– Vous n’êtes pas fatigué ?
La question était oiseuse car elle savait d’avance la réponse et se perdit aussitôt dans une béate admiration du fluide calmant qu’il possédait. La vie semblait jaillir du bout de ses doigts, extrayant la douleur d’une façon magique, si bien que, grisée de bien-être, elle s’endormit et il s’éclipsa doucement.
Elle l’appela au téléphone ce soir-là pour le remercier.
– J’ai dormi jusqu’au dîner, dit-elle. Vous m’avez complètement guérie et je ne sais comment vous remercier.
Ravi et empressé, il bredouilla sa joie de la savoir remise et, durant cette conversation il ne fit que penser à Browning et à la maladive Elisabeth Barrett. Ce qu’on avait fait, pouvait être refait et lui, Martin Eden, le referait pour Ruth Morse.
Il revint dans sa chambre et au volume de Spencer, Sociologie, qui était resté ouvert sur son lit : mais il ne put lire. L’amour le tourmentait, et annihilait sa volonté à tel point que, malgré sa résolution, il se retrouva à la petite table tachée d’encre. La poésie qu’il composa cette nuit-là fut la première d’un cycle de cinquante sonnets d’amour qui fut terminé en deux mois. Inspiré vaguement par les « Sonnets d’amour portugais », il les écrivit dans toutes les conditions voulues pour faire une belle œuvre, au summum de sa vitalité, de sa divine folie d’amour.
Toutes les heures qu’il passait loin de Ruth, il les employait au « Cycle d’amour », à lire, ou encore aux cabinets de lecture, car il voulait rester au courant de ce qui paraissait. Les heures passées avec Ruth étaient toutes pareilles, affolantes de promesses et d’incertitudes. Une semaine après la guérison de sa migraine, Norman, Olney et Arthur organisèrent une promenade en bateau sur le lac Merritt, au clair de lune. Martin, étant le seul capable de manœuvrer une embarcation, fut naturellement requis. Ruth s’assit à l’arrière, à côté de lui, et les trois jeunes gens s’étendirent plus loin, très occupés à discuter femmes et bagatelles.
La lune ne s’était pas encore levée et Ruth, qui regardait le ciel étoilé, en silence, se sentit tout à coup très seule. Elle regarda Martin. Le bateau donnait de la bande sous une bise fraîche, jusqu’à mouiller le pont, et lui, une main au gouvernail et l’autre à la voile lofait légèrement, tout en surveillant attentivement le rivage proche en avant d’eux. Il ne se doutait pas qu’elle le regardait et l’observait avec intensité, en se demandant par quel étrange aveuglement ce jeune homme, si puissamment organisé, s’acharnait à gâcher son temps à écrire des histoires et des vers fatalement voués à la médiocrité et à l’insuccès.
Son regard erra le long du cou puissant à peine éclairé par la lueur des étoiles, s’arrêta à la tête fière, et l’ancien désir la reprit, de poser les deux mains sur sa nuque. Cette force qu’elle détestait, l’attirait en même temps. Puis elle se sentit plus seule encore et lasse. La position inclinée du bateau la fatiguait et elle se rappela la migraine qu’il avait guérie grâce au fluide calmant qui émanait de lui. Il était assis à côté d’elle, tout près, et le bateau semblait la pousser vers lui. Et puis, soudain, sans même qu’elle ait eu le temps de résister, elle céda à l’impulsion. Était-ce une vague ?… Elle n’en sut jamais rien. Elle sut simplement qu’elle s’appuyait contre lui, et qu’elle était bien. Si le bateau seul fut fautif, elle ne fit rien pour se redresser. Elle s’appuyait contre son épaule, légèrement il est vrai, mais elle continua à s’y appuyer lorsqu’il s’arrangea pour qu’elle soit plus confortable.
C’était de la folie, mais elle se refusa à l’envisager ainsi. Ruth n’était plus Ruth, mais une femme, une faible femme, qui avait besoin d’appui. Elle était bien ainsi, ne sentait plus sa fatigue. Martin, heureusement, ne disait rien, car un mot de lui aurait suffi à rompre le charme. Sa timidité le retenait. Il était ébloui, étourdi, incapable de comprendre ce qui lui arrivait ; c’était trop merveilleux pour ne pas être un rêve. Il maîtrisa le désir fou de lâcher gouvernail et voile et de la serrer passionnément dans ses bras, mais son instinct lui suggéra de n’en rien faire et il fut content que la direction du bateau lui permette de repousser la tentation. Mais il lofa moins légèrement, carguant exagérément la voile afin de louvoyer plus longtemps devant la côte nord, car une fois près de la côte, il serait forcé de virer de bord, et le contact serait brisé. Il navigua adroitement, sans éveiller l’attention des causeurs, bénissant en lui-même ses plus périlleuses traversées, grâce auxquelles cette nuit merveilleuse était possible, car il y avait acquis la maîtrise des flots et du vent et sa bien-aimée pouvait s’abandonner, confiante, contre son épaule.
La lune se leva, inondant le bateau d’un rayonnement nacré et Ruth s’écarta vivement. Il fit de même. Ainsi, tous deux étaient tacitement d’accord pour dissimuler quelque chose ; ils avaient un secret en commun. Les joues brûlant de honte, elle se rendit compte soudain de son geste. Elle s’était rendue coupable d’une action qu’elle devait cacher à ses frères, à Olney. Pourquoi l’avoir faite… Jamais – – et cependant elle avait fait bien d’autres promenades en bateau au clair de lune avec des jeunes gens… – jamais rien de pareil ne lui était arrivé et elle n’en avait même jamais eu envie. La honte l’accabla et aussi le mystère de sa féminité naissante. Elle glissa un coup d’œil à Martin, très occupé à virer de bord ; elle faillit le haïr car par sa faute, elle s’était laissée aller à un acte immodeste. Lui – entre tous ! – Sa mère avait peut-être raison : elle le voyait trop… Elle le verrait moins à l’avenir, et jamais, jamais une pareille chose n’arriverait plus ! Un instant, elle eut l’idée folle de lui raconter qu’une faiblesse l’avait prise peu avant le lever de la lune, ce qui l’avait obligée à s’appuyer sur lui. Puis elle se souvint du mouvement tout semblable qui les avait écartés l’un de l’autre, par crainte de la clarté révélatrice et comprit qu’il verrait bien qu’elle mentait.
Les jours qui suivirent, elle ne fut pas elle-même, mais une étrange créature, incapable de jugement ou d’analyse, se refusant à envisager l’avenir, à réfléchir où son penchant l’entraînait. Toute frémissante d’une fièvre mystérieuse, tantôt charmée, tantôt épouvantée, elle vivait dans un rêve perpétuel. Une seule idée raisonnable lui restait, qui devait assurer sa sécurité : elle ne permettrait pas à Martin de déclarer son amour. Tant qu’elle en aurait le courage, tout irait bien. Dans quelques jours il serait sur mer. D’ailleurs, même s’il parlait, rien n’était perdu, bien entendu, puisqu’elle ne l’aimait pas. Ce serait naturellement une demi-heure pénible pour lui, gênante pour elle, car ce serait sa première demande en mariage. Elle frissonnait délicieusement à cette pensée. Elle était vraiment devenue femme, puisqu’un homme la demandait en mariage ! Le mariage, cet éternel, invincible attrait pour son sexe ! Comme un papillon attiré par la flamme, sa pensée troublée voletait, éperdue, autour du piège divin. Elle se représenta Martin se déclarant, imagina ce qu’il dirait ; elle s’entendit le refuser avec douceur, l’exhorter à devenir un homme, un brave homme. Elle lui demanderait surtout de ne plus fumer… Mais non, il fallait avant tout l’empêcher de se déclarer et cela, elle le ferait, elle l’avait promis à sa mère. Palpitante et toute brûlante de regrets, elle renonça à la scène dangereuse qui lui plaisait tant. Sa première demande en mariage devait provenir d’un prétendant plus digne d’elle et à un moment mieux choisi.
21
C’était un admirable après-midi de l’été indien, languide et chaud ; le soleil n’était pas très fort et de légères brises erraient, sans troubler la somnolence de l’air. D’aériennes nuées pourpres se cachaient au creux des vallées qui dominent San Francisco impénétrablement enveloppé de fumée. La baie, pareille à une terne nappe de métal fondu, était semée de bateaux immobiles, ou mollement bercés par la marée nonchalante. Au loin, à peine percevait-on le Tamalpaïs, dont l’immense silhouette se perdait dans le brouillard près de la Porte d’Or, que le soleil couchant rendait semblable à un sentier d’or pâle. Au-delà, le Pacifique se confondait avec de lourds nuages, avant-coureurs menaçants des premiers souffles de l’hiver.
L’été allait finir. Cependant, sur les collines il s’attardait encore, doucement tendre, il se couchait, voluptueux, dans la pourpre des vallons et tissait, dans les brumes pâlissantes, le linceul saturé de beauté où il allait mourir, heureux d’avoir vécu et bien vécu. Et, sur la colline, à leur place favorite, Ruth et Martin côte à côte étaient assis, penchés tous deux sur le même livre ; Martin lisait à haute voix des sonnets d’amour : ceux que Browning a dédiés à la femme qui fut aimée comme peu de femmes le furent.
Mais la lecture languissait. Autour d’eux, le charme de la beauté mourante était trop puissant. La saison vermeille s’évanouissait comme elle avait vécu, splendide et voluptueuse, et le souvenir de ses ivresses alourdissait l’air. Elle pénétrait en eux, avec ses rêves et ses langueurs, amollissait leurs nerfs, enveloppait leur volonté, leur raison, d’un brouillard vaporeux. Martin se fondait de tendresse et parfois des ondes brûlantes le parcouraient. Leurs têtes étaient bien près l’une de l’autre et, lorsque l’haleine d’une imperceptible brise faisait voltiger vers son visage les cheveux d’or, les lignes dansaient aussitôt devant ses yeux.
– Je ne crois pas que vous ayez compris un mot de ce que vous venez de lire, dit-elle, quand il eut complètement perdu le passage qu’il récitait.
Il l’observa de ses yeux dévorants, mais cette fois, au lieu de s’intimider, la réponse lui vint tout naturellement.
– Vous non plus, d’ailleurs. De quoi parlait le dernier sonnet ?…
– Je ne sais pas ! avoua-t-elle en riant. J’ai déjà oublié. Ne lisons plus : la journée est trop belle.
– C’est notre dernière sur la colline, d’ici quelque temps, dit-il gravement. Un orage s’amasse à l’horizon.
Le livre glissa sur l’herbe et ils restèrent silencieux, immobiles, perdant vers la baie dormante leurs yeux rêveurs qui ne voyaient pas. Ruth, quelquefois, glissait un regard vers son cou. Une force impérieuse l’attirait vers lui, inévitable comme le destin. Sans qu’elle l’ait voulu, son épaule effleura l’autre épaule, aussi légèrement qu’un papillon frôle une fleur. Elle sentit le frisson qui répondait à ce contact ; il n’était que temps qu’elle s’écarte. Mais sa volonté ne lui obéissait plus et elle ne pensa même pas à vouloir résister, envahie par une enivrante folie.
Il glissa son bras autour d’elle. Délicieusement torturée, elle en suivit les gestes lents. Elle attendait – elle ne savait trop quoi – haletante, les lèvres sèches et brûlantes, le cœur bondissant, une fièvre dans les veines. Doucement, d’un mouvement infiniment caressant, le bras remonta et l’attira vers lui. Elle n’attendit plus. Avec un grand soupir las, elle laissa tomber sa tête sur la poitrine de Martin ; il se pencha, tendant vers elle ses lèvres, et celles de Ruth firent la moitié du chemin.
« Voilà, c’est l’amour ! se dit-elle, dans une lueur de raison. Si ce n’est pas l’amour, je n’ai plus qu’à mourir de honte. » Mais ce ne pouvait être que l’amour. Elle aimait cet homme dont les bras l’enserraient, dont les lèvres pressaient les siennes. Elle se pelotonna contre lui, d’un mouvement câlin de tout son corps. Et soudain s’arrachant à son étreinte, elle posa ses deux mains sur le cou hâlé de Martin. La sensation de ce désir réalisé fut si violente, qu’avec un sourd gémissement elle laissa retomber ses mains et s’affaissa à demi évanouie dans ses bras.
Pas un mot n’avait été dit, pas un mot ne fut échangé pendant de longues minutes. Par deux fois, il se pencha pour l’embrasser ; chaque fois ses lèvres recevaient timidement le baiser et elle se nichait davantage contre lui. Elle ne pouvait s’éloigner de lui ; et lui, la tenant serrée contre son cœur, regardait la grande cité perdue dans la fumée, au-delà de la baie, sans la voir. Pour une fois, dans son cerveau ne flottait aucun rêve. La lumière, la couleur, toute la beauté du monde étaient là, resplendissantes comme le jour, brûlantes comme son amour. Il se pencha vers elle. Elle murmura :
– Depuis quand m’aimez-vous ?…
– Depuis toujours. Depuis le jour où je vous ai vue pour la première fois. Je suis parti fou d’amour et depuis ce temps, ma folie n’a fait qu’augmenter. Et maintenant, chérie, je suis plus fou que jamais. Je ne sais plus où j’en suis… ma tête tourne de joie.
– Je suis heureuse, Martin… chéri, dit-elle avec un long soupir.
Il la serra contre sa poitrine à l’étouffer, puis demanda :
– Et vous ? quand vous en êtes-vous doutée ?
– Oh ! mais je l’ai su tout de suite ! presque tout de suite.
– Et je n’ai rien vu ! s’écria-t-il, vexé. Je ne m’en suis aperçu que… que maintenant, quand je vous ai embrassée.
– Ce n’est pas ça que je voulais dire. (Elle se redressa un peu et le regarda.) Je voulais dire que dès le début j’ai su que vous m’aimiez.
– Et vous, quand m’avez-vous aimé ?
– C’est venu subitement. (Elle parlait très lentement, dans ses yeux luisait une flamme vacillante et douce, une roseur exquise animait ses joues.) Je n’en ai rien su jusqu’au moment où… vous m’avez prise dans vos bras. Et je n’avais pas l’intention de vous épouser, Martin… jusqu’à ce moment-là. Qu’avez-vous fait pour que je vous aime ?
– Je n’en sais rien, dit-il en riant, à moins que ce ne soit à force de vous aimer, car l’immensité de mon amour aurait attendri une pierre – à plus forte raison votre cœur, chérie.
– L’idée que je me faisais de l’amour était absolument différente, dit-elle brusquement.
– Quelle idée vous en faisiez-vous ?
– Je ne le croyais pas ainsi. (Elle baissa les yeux et continua :) Je ne me doutais pas de ce que c’était.
Il resserra l’étreinte de ses bras autour d’elle avec l’appréhension de se montrer trop empressé. Mais son corps s’abandonna et, cette fois encore, leurs lèvres se rencontrèrent.
– Que va dire ma famille ? fit-elle ensuite avec une soudaine crainte.
– Je n’en sais rien. Mais ce ne sera pas difficile de connaître leur opinion.
– Mais si maman fait des objections ?… j’ai peur de lui dire.
– Laissez-moi faire, proposa Martin courageusement. Je crois que votre mère ne m’aime pas, mais je tâcherai de la gagner. L’homme qui a pu vous conquérir peut prétendre à tout. Et, si nous ne réussissons pas…
– Eh bien ?
– Nous nous appartiendrons quand même. Mais il est impossible que votre mère ne consente pas à notre mariage : elle vous aime trop.
– Je ne veux pas lui briser le cœur, dit Ruth, pensive.
Il eut envie de la rassurer en lui disant qu’un cœur de mère ne se brise pas si facilement que ça, mais se borna à ajouter :
– L’amour est la plus belle chose du monde.
– Savez-vous, Martin, que vous m’effrayez, parfois ? Vous me faites peur en ce moment, quand je pense à ce que vous avez été ! Il faudra être très, très bon avec moi. Souvenez-vous que je ne suis qu’une enfant après tout. Je n’ai jamais aimé.
– Ni moi. Nous sommes deux enfants. Et nous avons de la chance, car nous avons trouvé, l’un par l’autre, notre premier amour.
– Mais c’est impossible ! s’écria-t-elle en le repoussant d’un mouvement passionné. C’est impossible pour vous ! Vous avez été marin et on m’a dit que les marins étaient… avaient…
Elle s’arrêta, hésitante, bouleversée.
– Avaient nécessairement une femme dans chaque port, acheva-t-il. C’est ça que vous voulez dire ?
– Oui, dit-elle tout bas.
– Mais ça, ce n’est pas de l’amour. (Le ton de sa voix était autoritaire.) J’ai touché bien des ports, mais jamais avant de vous connaître, l’amour ne m’a seulement effleuré. Savez-vous que le soir où je vous ai quittée pour la première fois, j’ai failli être arrêté ?
– Arrêté ?…
– Oui. L’agent de police m’a cru ivre. Je l’étais… mais de vous.
– Mais vous disiez que nous étions des enfants, et je prétendais que pour vous c’était impossible et nous avons parlé d’autre chose.
– Je disais que je n’avais jamais aimé personne que vous, répondit-il. Vous êtes mon premier, mon seul amour.
– Et pourtant, vous étiez marin, insista-t-elle.
– Mais ça n’empêche pas que vous soyez quand même la seule que j’aie aimée.
– Mais il y a eu des femmes… d’autres femmes, oh !…
Et à la grande surprise de Martin, elle éclata en sanglots qu’il fallut bien des baisers, bien des caresses pour apaiser. Et tout le temps lui revenait cette phrase de Kipling : Et la femme du colonel et Judy O’Grady sont sœurs par la peau. C’est vrai, se dit-il, quoique bien des lectures l’aient conduit à penser autrement. Il croyait – et cette erreur était imputable aux romans – que, dans les classes élevées, seules les demandes en mariage officielles avaient cours, que ce n’était guère que dans son milieu d’autrefois, que les jeunes gens et les jeunes filles s’obtenaient par le contact physique. Les romans avaient tort, la preuve en était là. Les mêmes moyens, les mêmes caresses, les mêmes baisers, les mêmes mots qui séduisaient les ouvrières étaient également efficaces auprès des femmes comme Ruth. Toutes, elles étaient faites de la même chair, « sœurs par la peau » ; il aurait dû le savoir s’il s’était souvenu de Spencer. Et, tout en serrant Ruth dans ses bras et en la calmant, il trouva une grande consolation dans cette pensée que la femme du colonel et Judy O’Grady se ressemblaient d’étrange façon. Ruth lui en parut plus proche de lui, plus accessible. Sa chair était pareille à toutes les autres chairs, à sa chair à lui. Il n’y avait aucun empêchement à leur mariage. La différence de classe, soit, et une classe est une chose extrinsèque, dont on peut se débarrasser. Un esclave, avait-il lu, s’était élevé à la pourpre romaine. Donc, il pouvait s’élever jusqu’à Ruth. Avec toute sa culture, sa pureté, son infinie beauté d’âme, elle demeurait humaine, exactement comme Lizzie Connelly et toutes ses semblables. Tout ce qu’elles ressentaient, Ruth pouvait le ressentir. Elle pouvait aimer et haïr, avoir ses nerfs, sans doute, sûrement être jalouse comme elle l’était en ce moment, étouffant ses derniers sanglots dans ses bras.
– Et puis, je suis plus vieille que vous, dit-elle, en ouvrant les yeux et en le regardant. De trois ans.
– Chut !… vous n’êtes qu’une petite fille et j’ai quarante ans de plus que vous par l’expérience, répondit-il.
Par le fait, en ce qui concernait l’amour, ils n’étaient tous deux que des enfants, bien qu’elle fût bourrée d’éducation universitaire, bien qu’il fût farci de philosophie scientifique et des dures leçons de la vie.
Ils restèrent ainsi, dans les feux du jour mourant ; ils parlaient comme parlent les amoureux, s’émerveillaient de leur amour et de la destinée qui les avait jetés si étrangement sur la route l’un de l’autre, persuadés qu’ils s’aimaient comme jamais personne n’avait aimé avant eux. Et toujours, ils revenaient à leurs premières impressions et s’évertuaient en vain à analyser exactement la nature et la profondeur de leurs sentiments réciproques.
Le soleil se coucha derrière les nuages menaçants, vers la Porte d’Or, l’horizon devint rose, tout le ciel s’embrasa. Une lumière pourprée les inonda, tandis que Ruth chantait : « Adieu, douce journée. » Elle chantait d’une voix douce, entre les bras de Martin, ses mains dans les siennes, son cœur contre son cœur.
22
Mme Morse n’eut pas besoin de grandes réflexions pour comprendre à l’attitude de Ruth, quand elle fut rentrée, qu’il s’était passé quelque chose. La rougeur persistante de son visage et, plus encore, les grands yeux brillants révélaient un grand trouble.
– Que s’est-il passé ? demanda Mme Morse, lorsque Ruth fut couchée.
– Tu as deviné ? dit Ruth, les lèvres tremblantes.
Pour toute réponse la mère l’entoura de ses bras et lui caressa doucement les cheveux.
– Il n’a pas parlé, continua Ruth désespérément. Je ne m’y attendais pas et je ne l’aurais jamais laissé parler… mais il n’a rien dit.
– Mais s’il n’a rien dit, alors rien n’a pu se passer, n’est-ce pas ?
– Mais… si, justement.
– Voyons, mon petit, qu’est-ce que tu racontes ? dit Mme Morse, désorientée. Je ne comprends plus du tout alors. Qu’est-il donc arrivé ?
Surprise, Ruth regarda sa mère.
– Je pensais que tu avais compris. Eh bien ! nous sommes fiancés, Martin et moi.
Mme Morse éclata d’un rire incrédule.
– Non, il n’a rien dit, expliqua Ruth. Il m’aimait, voilà tout. J’ai été aussi étonnée que toi. Il n’a pas dit un mot. Il a simplement mis son bras autour de moi et… et je n’ai plus été moi-même. Et il m’a embrassée et je l’ai embrassé, sans pouvoir m’en empêcher. C’était plus fort que moi. Alors, j’ai compris que je l’aimais.
Elle s’arrêta, espérant l’absolution maternelle, mais Mme Morse se renferma dans un silence glacial.
– Je sais, c’est un accident impardonnable, poursuivit Ruth, d’une voix mal assurée. Je ne sais pas comment tu me pardonneras jamais. Mais je n’ai pas pu m’en empêcher. Je ne me doutais pas que je l’aimais avant ce moment-là. Dis-le à papa.
– Il vaut mieux ne rien dire à ton père. Je verrai Martin Eden, je lui parlerai, je lui expliquerai, il comprendra et te rendra ta parole.
– Non ! non ! s’écria Ruth, en sursautant. Je ne veux pas ! Je l’aime. Je veux l’épouser !… si tu le permets, bien entendu.
– Nous avons formé d’autres projets pour toi, ton père et moi, ma chère Ruth et je… oh ! non, non ! il n’y a rien d’arrangé, nous n’avons personne en vue. Nous projetons simplement ton mariage avec quelqu’un de ton milieu, avec un homme honorable et comme il faut, que tu choisiras toi-même et que tu aimeras.
– Mais c’est Martin que j’aime ! protesta Ruth d’un ton plaintif.
– Nous n’influencerons pas ton choix ; tu es notre fille unique et nous ne pourrions admettre que tu fasses un mariage semblable. En échange de ton éducation, de tout ce qui est fin et délicat en toi, qu’est-ce qu’il a à t’offrir ? C’est un garçon vulgaire, sans éducation. Ce n’est pas un parti pour toi. Il n’a pas de quoi te faire vivre. Nous n’avons pas de préjugés stupides au point de vue fortune, mais une certaine aisance est indispensable et notre fille doit épouser un homme qui peut lui donner au moins ça et non pas un aventurier sans le sou, un matelot, un contrebandier et Dieu sait quoi encore, qui par-dessus le marché est un écervelé et un irresponsable.
Ruth demeura muette, reconnaissant la vérité de chaque mot.
– Il perd son temps avec la littérature, en essayant d’accomplir par entêtement ce à quoi parviennent rarement des génies et quelques rares hommes doués d’une parfaite culture. Un homme qui veut se marier doit se préparer au mariage. Mais lui ! Comme je te l’ai déjà dit – et je sais que tu es de mon avis – il est irresponsable. Et comment ne le serait-il pas ? Il a le tempérament d’un marin. Jamais il n’a appris à économiser ou à s’abstenir de boire. Sa jeunesse l’a marqué pour toujours. Ce n’est pas sa faute, bien entendu, mais sa nature ne changera pas pour ça. Et as-tu réfléchi aux années de débauche que forcément il a vécues ? As-tu pensé à ça, mon enfant ? Tu sais ce que signifie le mariage.
Ruth frissonna et se serra contre sa mère.
– J’y ai réfléchi. (Elle attendit un long moment que sa pensée s’éclaircisse.) Et c’est terrible. Ça me rend malade d’y penser. Je vous l’ai dit : mon amour pour lui est un affreux accident… mais je ne peux rien y faire. As-tu pu ne pas aimer mon père ? Eh bien ! pour moi, c’est la même chose. Il y a quelque chose en moi, en lui, que j’ignorais jusqu’à ce jour ; mais ce quelque chose existe et me force à l’aimer. Je n’ai jamais pensé que je pourrais l’aimer et pourtant je l’aime ! conclut-elle avec un léger accent de triomphe.
Elles causèrent longtemps, sans aboutir à d’autre conclusion que d’attendre un temps indéterminé sans rien faire.
La confession sincère de l’insuccès de son plan, que fit Mme Morse plus tard à son mari, eut la même conclusion.
– C’était à peu près fatal, jugea M. Morse. Ce marin est le seul homme avec qui elle est en contact. Un jour ou l’autre, elle devait s’éveiller, de toute façon : elle s’est éveillée, ce matelot s’est trouvé justement là et comme il n’avait pas de rival, elle n’a rien eu de plus pressé que de l’aimer ou de le croire, ce qui revient au même.
Mme Morse se déclara prête à travailler Ruth indirectement, en sourdine, plutôt qu’à la contredire ouvertement. On aurait tout le temps nécessaire, puisque Martin n’était pas dans une situation à se marier.
– Laisse-la le voir autant qu’elle voudra, conseilla M. Morse. Mieux elle le connaîtra, moins elle l’aimera, je parie. Et donne-lui des points de comparaison. Entoure-la de jeunes filles, de jeunes gens – de toute espèce de jeunes gens intelligents, qui ont fait quelque chose ou en passe de devenir quelqu’un ; d’hommes de notre milieu, enfin, de gentlemen ! Elle comparera forcément : ils lui montreront ce qu’il est. D’ailleurs, il n’a que vingt et un ans : un gamin. Ruth n’est également qu’une enfant. Ce sont des amours enfantines, ça passera vite.
L’affaire en resta là. Il fut entendu dans la famille que Ruth et Martin étaient fiancés, mais non officiellement : on pensait bien ne jamais en venir là. Et il fut tacitement entendu que les fiançailles seraient longues. Comme on n’avait aucune envie d’encourager Martin à s’amender, on ne lui demanda ni de chercher une situation, ni de cesser d’écrire. Et il entra on ne peut plus complètement dans leurs vues sournoises : jamais l’idée de se faire une situation n’avait été plus éloignée de ses pensées.
– Je me demande si vous approuverez ce que j’ai fait, dit-il à Ruth quelques jours plus tard. Comme la pension chez ma sœur est trop chère, je vais m’installer chez moi, tout seul. J’ai loué une petite chambre dans le quartier nord d’Oakland, un endroit tranquille, très bien et j’ai acheté un fourneau à pétrole pour faire la cuisine.
Ruth fut ravie. Le fourneau à pétrole surtout lui plaisait.
– C’est de cette manière que M. Butler a commencé, dit-elle.
Martin n’apprécia pas à sa valeur cette allusion aux mérites du digne gentleman et poursuivit :
– J’ai affranchi tous mes manuscrits et les ai expédiés à de nouveaux éditeurs. Aujourd’hui j’ai emménagé et demain je me mets au travail.
– Une situation ! s’écria-t-elle. (Tout heureuse, elle se serra contre lui, lui saisit la main, souriante.) Et vous ne l’aviez pas dit ! Qu’est-ce que c’est ?…
Il secoua la tête.
– Je veux dire que je me remets à écrire. (Voyant son amer désappointement, il continua hâtivement :) Comprenez-moi bien : je ne me mets pas cette fois à l’ouvrage avec des idées extravagantes. J’en fais une affaire, froidement, prosaïquement. Ça vaut mieux que de reprendre la mer et me rapportera autant que le métier que je pourrais faire à Oakland sans connaissances spéciales.
« Voyez-vous, les vacances que j’ai prises m’ont donné de la perspective. Je ne me suis pas fatigué le corps et je n’ai pas écrit, pour la publication du moins. Je n’ai fait que vous aimer et réfléchir. J’ai aussi lu un peu, surtout des magazines. J’ai réfléchi sur moi, sur le monde, sur la place que j’y occupe, sur ma chance d’y conquérir une place digne de vous. J’ai lu aussi la Philosophie du style de Spencer et j’y ai trouvé beaucoup de renseignements intéressants. Et le résultat de tout ça, de mes réflexions, de mes lectures et de mon amour, c’est mon installation à Grub Street. Je vais laisser de côté les chefs-d’œuvre et faire du « gros ouvrage » : des articles gais, des portraits, des vers humoristiques, des vers pour dire en société – toutes sortes de bêtises très demandées. Puis, il y a les syndicats de journaux, les syndicats de chroniqueurs et les syndicats des suppléments du dimanche. Je leur fournirai ce dont ils ont besoin et je gagnerai pas mal. Il y a des publicistes indépendants qui gagnent quatre ou cinq cents dollars par mois, vous savez. Je ne tiens pas à en devenir un ; mais je peux gagner convenablement ma vie et avoir pas mal de temps à moi, ce qui serait impossible dans n’importe quelle situation.
« J’aurai ainsi le temps d’étudier et de travailler pour moi. Une fois l’ouvrage fini, je pourrai tenter une grande œuvre et je m’y préparerai. Vraiment, quand j’y pense, je suis abasourdi du chemin que j’ai fait ! Au début, je ne savais pas sur quoi écrire, à part quelques expériences banales, mal comprises et plus mal analysées. Je n’osais pas penser, et je ne possédais même pas les éléments pour ça. Mes expériences personnelles n’étaient que des tableaux sans âme. Puis, en augmentant mes connaissances et mon vocabulaire, tout ça m’est apparu différemment et j’ai trouvé la véritable façon d’interpréter mes tableaux. J’ai commencé à faire du bon travail en écrivant Aventure, Joie, La Marmite, Le Vin de la vie, La Bousculade, Le Cycle d’amour et Les Poèmes de la mer. J’en écrirai d’autres comme ça, et de meilleurs pendant mes heures libres. Mes pieds reposent solidement sur terre, à présent ! Le gros ouvrage et de l’argent, d’abord ! les chefs-d’œuvre ensuite. Pour vous les montrer, j’ai écrit hier soir une demi-douzaine de plaisanteries pour journaux humoristiques ; et, comme j’allais me coucher, l’idée m’est venue d’essayer d’écrire un triolet humoristique : au bout d’une demi-heure j’en avais pondu quatre ! Ça vaut bien un dollar pièce. Quatre dollars pour quelques instants perdus avant de dormir.
« Naturellement, tout ça n’a aucune valeur, c’est un travail fastidieux, assommant. Mais ce n’est pas plus fastidieux, ni plus assommant, que de tenir des livres à soixante dollars par mois, en additionnant d’interminables colonnes de chiffres, jusqu’à ce qu’on meure. Et d’autre part, cette besogne me fait garder le contact avec le milieu littéraire et me donne du temps pour risquer de plus grandes choses.
– Mais à quoi serviront ces grandes choses, ces chefs-d’œuvre ? demanda Ruth. Vous ne les vendez pas.
– Oh ! si, je les vendrai.
– De toutes les œuvres que vous m’avez énumérées et que vous dites être bonnes vous n’en avez pas vendu une seule. Ce n’est pas avec des chefs-d’œuvre invendables que nous pourrons nous nourrir.
– Alors, nous nous nourrirons grâce aux triolets qui se vendent ! affirma-t-il avec emphase en attirant à lui une bien-aimée fort peu enthousiaste. Tenez, écoutez, continua-t-il avec une gaieté affectée. Ce n’est pas de l’art… mais c’est un dollar !
He came in
When I was out
To borrow some tin
Was why he came in,
And he went without ;
So I was in
And he was out.
L’enthousiasme enfantin qu’il avait mis à déclamer sa plaisanterie fit place à une expression navrée quand il vit que Ruth, bien loin de rire, le regardait d’un air à la fois perplexe et réprobateur.
– Ça vaut peut-être un dollar, dit-elle, mais un dollar faux. Ne voyez-vous pas que tout ça est rabaissant ? Je veux que l’homme que j’aime et que j’estime soit quelque chose de plus qu’un faiseur de vers burlesques et stupides.
– Vous voulez qu’il ressemble à… M. Butler, par exemple ?
– Je sais que vous n’aimez pas M. Butler, dit-elle, mais il l’interrompit.
– M. Butler est parfait. Mais j’en ai jusque-là de M. Butler. Non, j’ai beau réfléchir, je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas des vers humoristiques ou des devinettes, tout aussi bien que de la machine à écrire, des copies ou de la comptabilité. En fin de compte, ça revient au même. Vous partez de ce principe qu’il me faut absolument commencer par aligner des chiffres pour devenir ensuite un notaire habile ou un homme d’affaires. Je veux commencer avec du journalisme inférieur et devenir un bon écrivain.
– Il y a une différence, objecta Ruth.
– Laquelle ?
– Mon Dieu… vous ne pouvez pas vendre votre bonne littérature, celle que vous trouvez bonne. Vous avez essayé, n’est-ce pas ? mais aucun éditeur n’en veut.
– Laissez-moi le temps, chère, pria-t-il. Ce bas journalisme n’est qu’un moyen, que je ne prends pas du tout au sérieux. Donnez-moi deux ans. J’aurai réussi à ce moment-là et les éditeurs seront enchantés de me prendre de bons ouvrages. Je sais ce que je dis : j’ai foi en moi ; je sais ce dont je suis capable et je sais ce que vaut la littérature actuelle ; je connais par cœur toute cette prose pourrie, que pond journellement une multitude de ratés ; et je sais que dans deux ans, je serai sur le chemin du succès. Quant aux affaires, je n’y réussirai jamais. Je n’ai aucun goût pour ça. Je trouve ce genre de choses ennuyeux, stupide, mercantile et malhonnête. En tout cas, je ne m’y ferai jamais. Jamais je ne pourrais être autre chose qu’un employé et que ferions-nous, grands dieux, avec les misérables appointements d’un employé ?… Je veux que vous soyez entourée de ce qu’il y a de mieux et de plus beau, plus tard. Et j’y arriverai : j’arriverai à tout. À côté des rentes d’un auteur en vogue, celles de M. Butler n’existent pas. Un auteur en vogue gagne facilement entre cinquante et cent mille dollars, bon an, mal an. Elle ne répondit rien, visiblement contrariée.
– Eh bien ? interrogea-t-il.
– Mes espoirs et mes projets étaient autres. J’avais pensé – et je pense toujours – que la meilleure chose pour vous serait d’étudier la sténographie – vous savez déjà dactylographier – et d’entrer dans les bureaux de mon père. Vous avez un cerveau bien équilibré et je suis certaine que vous feriez un excellent notaire.
23
Que Ruth n’eût aucune foi en l’avenir de Martin comme écrivain, ne la diminua en rien à ses yeux. Pendant ses vacances reposantes il avait passé de longues heures à s’analyser et à s’étudier. Il découvrit qu’il aimait la beauté mieux que la gloire et que, s’il souhaitait la célébrité, c’était surtout pour Ruth. Il voulait être « grand » aux yeux du monde, afin que la femme qu’il aimait soit fière de lui et le trouve digne d’elle.
Mais pour lui-même, il aimait passionnément la beauté et la joie de la célébrer lui suffisait. Et, plus que la beauté, il aimait Ruth. Il trouvait que l’amour était la plus admirable chose du monde. C’était l’amour qui avait opéré en lui cette extraordinaire transformation, qui, du matelot grossier, avait fait un étudiant et un artiste ; l’amour était donc plus grand encore que la science et l’art. Il avait déjà découvert qu’intellectuellement il dépassait Ruth, comme il dépassait ses frères et son père. En dépit des avantages d’une éducation universitaire, de ses diplômes de licenciée es lettres, elle restait très au-dessous de la puissance intellectuelle de Martin à qui cette année d’études solitaires donnait une connaissance de la vie, de l’art, qu’elle n’acquerrait jamais.
Il se rendait compte de tout cela, mais sans l’aimer moins et sans qu’elle l’aime moins. Y avait-il le moindre rapport entre leur amour et leurs différences d’opinions sur l’art, la morale, la Révolution française et le suffrage universel ? Ce n’étaient que des raisonnements et l’amour était au-delà de la raison. L’amour habite les hauts sommets, bien au-dessus des froides vallées de la raison et celui qui cueille cette fleur rare ne peut plus descendre parmi les humains tant qu’elle n’est pas fanée. Grâce aux philosophes scientifiques qu’il affectionnait, la signification biologique de l’amour lui était connue ; mais procédant par ce même raisonnement scientifique, il arriva à cette conclusion que l’organisme n’obtient son plus haut développement qu’au moyen de l’amour et que l’amour ne doit pas être discuté, mais accepté comme la suprême récompense de la vie. Il considérait donc que l’amour ennoblissait toute créature et il aimait penser à « l’Amant éternel » s’élevant au-dessus de toutes les choses terrestres, au-dessus des richesses et du jugement des hommes, de l’opinion publique et de la gloire, au-dessus même de la vie, et « mourant d’un baiser ».
Tout en réfléchissant à ces choses, Martin travaillait sans relâche – excepté quand il allait voir Ruth – et vivait en Spartiate. Il payait deux dollars cinquante par mois la petite chambre qu’il occupait chez une Portugaise veuve, Maria Silva, dure à l’ouvrage et dure de caractère, qui élevait comme elle pouvait sa nombreuse progéniture et noyait parfois ses soucis et sa fatigue dans l’aigre vinasse à quinze cents le litre, achetée chez l’épicier du coin. Martin commença par la détester, elle et sa terrible langue ; puis, il l’admira pour sa vaillance.
Il n’y avait que quatre pièces en tout, dans la petite maison ; l’une d’elles – le salon décoré d’un gai tapis à fleurs et du portrait d’un enfant qu’elle avait perdu – était strictement réservé aux visites. Les volets en étaient toujours fermés et l’entrée en était sévèrement interdite à la marmaille nu-pieds, sauf aux grandes occasions. On mangeait dans la cuisine où elle lavait, empesait et repassait tous les jours – sauf le dimanche – pour ses voisins, ce qui constituait le plus clair de ses revenus. Restait l’unique chambre à coucher – aussi petite que celle de Martin – dans laquelle grouillaient et dormaient les sept gosses et leur mère. Martin se demandait toujours par quel miracle ils pouvaient y arriver, quand le soir, à travers la mince cloison, tous les détails du coucher lui parvenaient, les piaillements et les vagissements, les babils et les pépiements pareils à ceux des oiseaux qui s’endorment. Une des sources de revenus de Maria était ses deux vaches, qu’elle trayait matin et soir et qui se nourrissaient tant bien que mal de l’herbe des terrains vagues, gardées par l’un de ses gosses loqueteux ; leur tâche principale consistait à déjouer la vigilance tracassière des inspecteurs chargés des enclos.
Dans sa petite chambre, Martin étudiait, écrivait et faisait son ménage. Devant l’unique fenêtre, face au porche minuscule, était la table de cuisine qui servait tour à tour de bureau, de bibliothèque et de support pour la machine à écrire. Le lit, appuyé au mur du fond, occupait les deux tiers de la pièce. La table était flanquée, d’un côté, par un bureau fastueux ne servant que pour la décoration car son mince placage s’écaillait un peu plus tous les jours. Dans le coin opposé, étaient installés la cuisine, le fourneau à pétrole, une boîte à biscuits désaffectée renfermant des assiettes et divers ustensiles, une planche fixée au mur, pour les provisions et, par terre, un seau d’eau. Martin devait aller chercher son eau au robinet, dehors. Au-dessus du lit, accrochée par une poulie, pendait la bicyclette, qu’il avait d’abord essayé de laisser dans les sous-sols, mais, comme la tribu des Silva s’amusait à démonter le guidon et à crever les pneus, il y avait renoncé. Il avait tenté ensuite de l’abriter sous le porche, mais un violent orage l’ayant inondée pendant toute une nuit, il la suspendit finalement dans sa chambre.
Une armoire minuscule contenait ses vêtements et les livres qui s’accumulaient tellement, qu’ils ne trouvaient plus de place, sur la table, ni dessous. Il avait pris l’habitude de prendre des notes en lisant et si copieusement que sa chambre aurait été inhabitable, sans quelques ficelles tendues en travers, sur lesquelles il accrochait ses notes, comme du linge à sécher. Et il était tellement encombré quand même, qu’évoluer à travers la chambre était une entreprise difficile et qu’il ne pouvait ouvrir la porte d’entrée sans fermer d’abord celle de l’armoire et vice versa. Quant à traverser la chambre en ligne droite, il n’y fallait pas penser ; le trajet ne pouvait se faire qu’en zigzag et de jour seulement. Après avoir élucidé la question des portes, il fallait virer à angle droit pour éviter la cuisine, puis, à gauche, pour ne pas se cogner au pied du lit – mais délicatement, sans quoi on risquait de buter contre le coin de la table. Entre le lit et la table vous suiviez ensuite un étroit canal, qui devenait impraticable quand la chaise occupait sa place normale devant la table. Aussi, quand elle ne servait pas, était-elle posée sur le lit. Il lui arrivait souvent de surveiller la cuisine en lisant, ou même d’écrire un paragraphe ou deux pendant que grillait le bifteck. D’ailleurs, le coin réservé à la cuisine était si petit qu’il pouvait de sa chaise atteindre tout ce qu’il voulait. Debout, au contraire, il tenait trop de place pour ne pas s’encombrer lui-même.
Doté d’un estomac d’autruche, il savait quels étaient les aliments à la fois nutritifs et bon marché. La soupe de pois cassés, les pommes de terre et les haricots bruns cuits à la mexicaine, entraient pour une grande part dans son régime. Le riz, préparé comme les ménagères américaines ne sauront jamais le réussir, paraissait sur la table de Martin au moins une fois par jour. Les fruits séchés étant moins chers que les frais, il en avait toujours un pot cuit à l’avance, car ils lui tenaient lieu de beurre sur son pain. Quelquefois il se payait le luxe d’un pot-au-feu. Deux fois par jour, il prenait du café noir et le soir du thé, l’un et l’autre délicieux d’ailleurs.
Il lui fallait absolument économiser. Ses vacances avaient mangé à peu près tout son gain de la blanchisserie et des semaines s’écouleraient encore avant qu’il puisse espérer le résultat de son travail actuel. À part ses visites à Ruth ou à sa sœur Gertrude, il vivait en reclus ; sa tâche quotidienne représentait au moins trois journées du travail d’un homme ordinaire. Il dormait à peine cinq heures et il fallait avoir une constitution de fer pour supporter, comme il le faisait, dix-neuf heures de travail consécutif. Jamais une seconde n’était perdue. À sa glace étaient affichées des listes de définitions, de prononciations : en se rasant, en s’habillant, en se coiffant, il repassait ces listes. D’autres listes étaient épinglées au mur au-dessus du fourneau et il les compulsait en cuisinant ou en lavant la vaisselle. Dès qu’il les savait par cœur, il les remplaçait par d’autres. Chaque mot nouveau ou incompris rencontré dans ses lectures, était immédiatement inscrit. Il emportait même de ces listes dans ses poches et les étudiait dans la rue ou en attendant son tour chez le boucher ou l’épicier.
Il alla plus loin. En lisant les œuvres d’hommes arrivés, il nota les résultats auxquels ils étaient parvenus, les trucs qu’ils avaient employés et tout cela devenait matière à études. Il ne plagiait pas, mais cherchait des principes. Il dressa des listes de procédés habiles, puis en inventa lui-même en s’ingéniant à leur trouver des applications originales. Il collectionna de la même façon des phrases parlées, des phrases mordantes comme de l’acide, ou brûlantes comme une flamme, d’autres suaves, lumineuses et fraîches comme des sources d’eaux vives dans le désert aride du langage conventionnel. Partout il recherchait le principe et le procédé. L’apparence seule de la beauté ne le satisfaisait plus : il la disséquait dans son laboratoire où les odeurs de cuisine alternaient avec les bruits de ménagerie de la tribu des Silva, et connaissant l’anatomie de la beauté, il se sentait plus près de pouvoir en créer.
Il était incapable de travailler sans comprendre, en aveugle qui se fierait simplement à sa chance et à sa bonne étoile… Selon lui, rien ne devait se faire par hasard. Il voulait le pourquoi et le comment. Son talent était résolument créateur et, avant de commencer une histoire ou un poème, l’œuvre vivait déjà tout entière dans son cerveau, avec sa conclusion et le moyen d’arriver à cette conclusion de la façon la plus intéressante. D’autre part, il s’émerveillait d’une trouvaille spontanée qui se révélait à l’épreuve de la plus sévère analyse. Et, bien qu’il disséquât la beauté pour en découvrir les principes ésotériques, il restait toujours convaincu que l’essence même de cette beauté est impénétrable. Il savait parfaitement, d’après son Spencer, que nul ne peut atteindre l’absolue connaissance et que le mystère inhérent à la beauté ne le cède en rien à celui de la vie même ; bien plus : que les fibres de la beauté et de la vie sont intimement mêlées et que lui-même n’était qu’une parcelle de cet insondable, tissé de soleil, de poussière d’étoiles et d’éther.
Plein de ces pensées, il écrivit l’essai intitulé Poussière d’étoiles dans lequel il prenait à partie, non pas les principes de la critique, mais les critiques les plus célèbres. C’était profond, brillant, philosophique et délicieusement spirituel. Aussi, toutes les revues le refusèrent-elles avec un ensemble remarquable. Mais, s’en étant débarrassé l’esprit, il continua son chemin avec sérénité. C’était devenu une habitude : une fois son sujet mûri, il le réalisait immédiatement à la machine à écrire. Qu’il fût ou non publié ensuite, n’avait qu’une importance relative. Ce qui importait, c’était de débarrasser son cerveau d’un fardeau qui l’encombrait, afin de pouvoir élucider d’autres problèmes et mûrir d’autres pensées. Il ressemblait un peu à ces gens qui, tourmentés par une souffrance – véritable ou fictive, – rompent périodiquement un silence méritoire, pour plaisanter sur l’objet de leur martyre, avec d’autant plus de violence qu’ils se sont contenus davantage.
24
Les semaines passaient, Martin n’avait plus le sou et les chèques des éditeurs se faisaient attendre. Ses anciens manuscrits étaient revenus, puis repartis et son journalisme ne réussissait pas davantage. Ses menus devinrent d’une simplicité de plus en plus rudimentaire. Pendant cinq jours il vécut d’un demi-sac de riz et de quelques kilos de haricots secs. Puis, il tâcha de vivre sur son crédit. L’épicier portugais, jusqu’alors payé comptant, refusa toute avance, lorsque la note de Martin eut atteint la somme énorme de trois dollars quatre-vingt-cinq.
– Comprenez, dit-il, je vois bien que vous ne trouvez pas de travail et je perdrai mon argent.
Et Martin n’eut rien à répliquer. À quoi bon se lancer dans des explications ? La plus élémentaire conception commerciale s’opposait à ce qu’on fasse crédit à un garçon vigoureux, visiblement trop paresseux pour travailler.
– Si vous trouvez du travail, je vous fournirai de la marchandise, assura l’épicier. Pas de travail, pas de marchandises. Ça, ce sont les affaires. (Puis, pour bien lui prouver qu’il ne lui en voulait pas, il proposa :) Allons boire un verre au comptoir, on est tout de même des amis !
Martin but, pour montrer qu’il ne lui en voulait pas non plus, puis rentra se coucher sans dîner.
Le magasin où Martin achetait ses légumes était tenu par un Américain dont les principes commerciaux furent assez faibles pour laisser monter la note à cinq dollars. Puis il arrêta les frais. Le boulanger alla jusqu’à deux dollars, le boucher jusqu’à quatre. Martin, en faisant le compte de ses dettes, dit qu’il en avait pour quatorze dollars, sans parler de ce qu’il devait pour la machine à écrire ; puis il se dit qu’on lui ferait bien deux mois de crédit. Mais, au bout de ces deux mois-là…
Son dernier achat chez le fruitier avait été d’un sac de pommes de terre, et pendant huit jours il mangea des pommes de terre, rien que des pommes de terre, trois fois par jour. Un dîner chez Ruth, de temps en temps, l’aidait à ne pas s’affaiblir, mais il souffrait de devoir se modérer par bienséance, quand son appétit faisait rage, à la vue de tant de bons plats étalés devant lui. Quelquefois, il entrait chez sa sœur au moment des repas et mangeait à sa faim, ce qu’il n’osait jamais faire chez les Morse.
Et il travaillait toujours. Et tous les jours, le facteur lui rapportait des manuscrits refusés. Quand il n’eut plus de quoi les affranchir, ils s’accumulèrent sous la table. Puis vint un jour où il n’eut pas de quoi manger, puis un second jour. Il ne pouvait compter sur un dîner chez Ruth, car elle était partie à San Rafaël pour quinze jours et une fausse honte l’empêchait d’aller chez sa sœur. Pour comble de malchance, le facteur, l’après-midi, lui rapporta cinq manuscrits refusés. Alors Martin alla porter son pardessus au Mont-de-Piété d’Oakland et revint avec cinq dollars en poche. Il donna un dollar d’acompte à chacun de ses quatre fournisseurs, se paya un bifteck et des oignons frits, but du café et fit cuire un grand pot de prunes. Puis, rassasié, il s’assit à sa table et termina un essai qu’il intitula : De l’usure, institution philanthropique. L’ayant dactylographié il le jeta sous la table, car il ne lui restait rien des cinq dollars pour acheter des timbres.
Quelque temps plus tard, il mit sa montre et sa bicyclette au clou et, ne retenant sur les sommes ainsi réalisées qu’un minimum pour acheter des provisions, il affranchit tous ses manuscrits et les expédia de nouveau. Son journalisme le décevait. Personne ne se souciait de lui prendre ses articles. Cependant, en les comparant avec ce qu’il voyait dans les journaux, les publications hebdomadaires et les revues populaires, il les trouvait décidément mieux, beaucoup mieux que la moyenne. Et pourtant ça ne se vendait pas !
Dans un des grands périodiques pour la jeunesse, il remarqua des colonnes entières de nouvelles et d’anecdotes. Il tenta aussi cette chance – en vain. Plus tard, lorsqu’il n’en eut plus besoin, il apprit que les rédacteurs avaient coutume d’augmenter leurs salaires en fournissant eux-mêmes ce genre de prose. Les journaux humoristiques lui renvoyèrent ses histoires drôles et ses poèmes burlesques ; les « vers pour dire en société » ne trouvèrent pas davantage grâce dans les magazines. Restaient encore les nouvelles pour quotidiens. Il savait que les siennes étaient meilleures que celles qu’on publiait. Ayant obtenu les adresses de deux syndicats de journaux, il les inonda de nouvelles. Quand il en eut écrit une vingtaine sans succès, il y renonça. Et cependant chaque jour il lisait, dans les quotidiens et les hebdomadaires, des masses de nouvelles dont pas une ne valait les siennes. Découragé, il en arriva à la conclusion qu’il n’avait aucun jugement, qu’il s’hypnotisait sur ce qu’il écrivait – bref, qu’il n’était qu’un illuminé plein de prétention.
L’inhumaine machine éditoriale suivait sa marche habituelle. Il joignait des timbres à ses manuscrits, les glissait dans la boîte : environ trois semaines après le facteur montait l’escalier et les lui rapportait. Sûrement, rien d’humain n’était au bout de tout cela ; ce n’étaient que rouages perfectionnés, engrenages bien combinés, distributeurs automatiques et burettes à huile. Dans son désespoir, il en vint à douter de l’existence même des éditeurs. Jamais un seul ne lui avait donné signe de vie et l’hypothèse était parfaitement plausible d’une grande manufacture anonyme, actionnée par des mécaniciens, des typographes et des camelots. Les heures qu’il passait avec Ruth étaient les seules heureuses ; mais toutes n’étaient pas heureuses. Une inquiétude morbide le tenaillait continuellement, bien plus énervante maintenant qu’elle l’aimait, car la possession réelle lui apparaissait plus éloignée que jamais. Il avait demandé deux ans : le temps passait et il n’aboutissait à rien. De plus, il se rendait parfaitement compte du fait qu’elle n’approuvait nullement son genre de vie. Ce n’était pas du ressentiment – car elle avait une nature trop douce – mais elle était déçue de voir que cet homme qu’elle avait décidé de modeler à sa guise, refusait de se laisser faire. Jusqu’à un certain point, il s’était prêté à ce remaniement, puis soudain buté, il avait refusé d’être formé à l’image de M. Butler ou de M. Morse.
Ce qui était grand, puissant, original en lui, elle ne le voyait pas ou – pire – elle ne le comprenait pas. Cet homme d’une matière intellectuelle si souple, qu’il était capable, lui si grand, de vivre dans n’importe quel trou de souris, elle le jugeait borné, parce qu’elle ne pouvait le forcer à vivre dans son trou de souris à elle, le seul qu’elle connût. Elle était incapable de suivre les envolées de son esprit et, quand son cerveau dépassait le sien il lui semblait fou, tout simplement. Jamais elle n’avait été surpassée par personne. Son père, sa mère, ses frères et Olney étaient à son niveau ; donc, puisqu’elle ne pouvait suivre Martin, le fautif, c’était lui : toujours l’éternelle comédie de l’insulaire voulant faire la loi à l’univers entier.
– Vous n’aimez que les valeurs bien établies, lui dit-il un jour, au milieu d’une discussion sur Praps et Vanderwater. Je vous l’accorde, ce sont les deux critiques les plus avancés des États-Unis. Tous les maîtres d’école du pays regardent Vanderwater comme le souverain maître de la critique. J’ai lu sa prose et elle me semble le sommet de la stupidité satisfaite. Ce n’est qu’un pompeux soporifique, comme dit Gelett Burgess. Et Praps ne vaut pas mieux. Son Hemlock Mosses, en revanche, est admirablement écrit : pas une virgule n’y manque ! Et le diapason en est si élevé, si superlativement sublime ! C’est le critique le mieux payé des États-Unis ; seulement grands dieux ! ce n’est pas un critique du tout. En Angleterre ils font mieux. « Mais voilà : ils connaissent leur public et le flattent magnifiquement, avec une parfaite sérénité et une moralité à toute épreuve. Leurs revues me rappellent un dimanche à Londres. Ils sont les porte-voix du populaire. Ils soutiennent vos professeurs d’anglais et vos professeurs d’anglais les soutiennent : Il n’y a pas une idée originale dans leurs ouvrages et ils ne connaissent que la chose conventionnelle et bien établie ; en fait, c’est eux, la Chose établie. Leur pauvre cerveau est aussi fortement frappé par les idées conventionnelles que l’est le mouton par la marque du troupeau. Et leur fonction consiste à mettre le grappin sur tous les jeunes universitaires, à en chasser soigneusement tout ce qu’ils peuvent avoir d’original dans le cerveau et à les marquer du sceau des valeurs établies.
– Je crois être plus près de la vérité, répondit Ruth, en m’en tenant aux valeurs établies, que vous avec votre rage iconoclaste pareille à celle des sauvages des îles de l’Archipel.
– Ce sont les missionnaires qui ont brisé les images, répliqua-t-il en riant. Malheureusement, tous les missionnaires sont partis chez les païens, de sorte qu’il n’en reste plus chez nous pour briser ces vieilles idoles, M. Vanderwater et M. Praps !
– Vous oubliez les professeurs des Universités, ajouta-t-elle.
Il secoua la tête avec emphase.
– Non. Il faut laisser vivre les professeurs de sciences. Ils sont vraiment grands. Mais ce serait vraiment une bonne œuvre d’exterminer quatre-vingt-dix-neuf pour cent des professeurs de littérature anglaise à cervelles de perroquets !
Jugement sévère, mais qui, pour Ruth, était véritablement blasphématoire. Elle ne pouvait s’empêcher de comparer les professeurs – délicats, doctes, bien habillés, parlant d’une voix modulée, respirant la culture la plus raffinée – avec cet indescriptible jeune homme, qu’elle aimait pourtant, toujours un peu débraillé, dont les gros muscles révélaient le passé vulgaire et qui s’excitait en parlant, exagérait tout et s’emballait à la moindre contradiction. Et puis eux, au moins, gagnaient largement leur vie, tandis que lui n’était pas capable de gagner un penny. Elle ne jugeait pas les arguments de Martin d’après ses paroles. Elle estimait simplement – inconsciemment, il est vrai – que ses arguments étaient faux. Les professeurs avaient raison, parce qu’ils avaient réussi. Martin avait tort parce qu’il échouait. Pour parler comme lui : ils étaient quelque chose, et lui n’était rien. D’ailleurs, il était inconcevable qu’il ait raison, lui, qu’elle voyait encore, il n’y avait pas si longtemps, dans ce même salon, gauche et rougissant, jetant autour de lui des regards effrayés, affolé à l’idée que ses épaules roulantes allaient renverser un bibelot, demandant depuis combien d’années Swinburne était mort et annonçant triomphalement qu’il avait lu Excelsior et Le Psaume de la vie !
Inconsciemment Ruth fournissait la preuve qu’elle n’estimait que les valeurs établies. Martin suivait l’évolution de ses pensées mais se défendait d’aller plus loin. Il ne l’aimait pas pour l’opinion qu’elle avait de Praps, de Vanderwater et des professeurs de littérature anglaise et il se convainquit de plus en plus qu’il possédait des capacités cérébrales, une envolée philosophique qu’elle ne pourrait jamais comprendre, ni même entrevoir.
Sur le chapitre musique, elle le jugeait insensé et, en matière d’opéra, complètement perverti.
– Eh bien ! vous avez aimé ? lui demanda-t-elle un soir, en rentrant de l’opéra où il l’avait amenée, au prix d’un mois d’économies sordides sur sa nourriture. Émue et troublée par la musique, elle avait vainement attendu qu’il parle.
– J’ai aimé l’ouverture, dit-il. Elle est admirable.
– Oui, mais l’opéra en lui-même ?
– Admirable aussi… enfin la musique ; ç’aurait été parfait si ces épileptiques étaient restés tranquilles ou avaient quitté la scène.
Ruth fut abasourdie.
– Vous ne parlez pas de la Tetralani ou de Barillo ? interrogea-t-elle.
– De tous, de toute cette bande de fous.
– Mais ce sont de grands artistes ! fit-elle en protestant.
– Ça ne les a pas empêchés de saboter la musique, avec leur jeu faux et conventionnel.
– Mais vous n’aimez pas la voix de Barillo ?… C’est le meilleur après Caruso, paraît-il.
– Bien sûr, je l’aime, bien que je préfère encore la Tetralani. Sa voix est exquise – à mon avis, du moins.
– Mais, mais… balbutia Ruth. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous admirez leur voix et cependant vous dites qu’ils sabotent la musique !
– Précisément. Je donnerais cher pour les entendre au concert, et donnerais encore davantage pour ne pas les entendre quand l’orchestre joue. Voyez-vous, j’ai peur de n’être qu’un affreux réaliste. Les grands chanteurs ne sont pas de grands acteurs. Entendre Barillo chanter une phrase d’amour d’une voix céleste, entendre la Tetralani lui donner la réplique d’une voix également céleste et les entendre accompagnés par une musique colorée, rutilante, est un régal absolument merveilleux. Je fais mieux que l’admettre : je l’affirme. Mais, tout l’effet en est gâté quand je les regarde, quand je vois la Tetralani – cent kilos et 1,85 m – et Barillo, avec sa figure huileuse, son torse trapu et ses jambes trop courtes ; quand je les vois tous les deux prendre des poses plastiques, se frapper la poitrine, agiter leurs bras comme des fous échappés d’un asile d’aliénés. Et quand on me demande de m’imaginer que j’assiste à une scène d’amour entre une jeune et belle princesse et un prince charmant, eh bien non ! je ne peux pas accepter ça, voilà tout !… C’est stupide, absurde et faux ! C’est surtout faux. Ne me dites pas que quelqu’un a jamais chanté son amour de cette manière. Comment ! mais si je vous faisais la cour ainsi, vous m’enverriez des gifles !
– Mais vous faites erreur, protesta Ruth. Chaque forme d’art a ses limites. (Elle faisait son possible pour se rappeler une conférence sur la convention dans les arts, qu’elle avait entendue à l’Université.) En peinture, vous n’avez que deux dimensions sur la toile ; pourtant, vous acceptez l’illusion des trois dimensions que l’art du peintre lui permet de représenter. Pour la littérature, c’est la même chose. Vous trouvez parfaitement légitime que l’auteur vous décrive les pensées intimes de son héroïne et vous savez que l’héroïne était seule et que ni l’auteur ni personne ne pouvait savoir ce qu’elle pensait. C’est la même chose pour le théâtre, la sculpture, l’opéra, pour toutes les manifestations d’art. Certaines choses inévitables doivent être acceptées.
– Oui, je comprends, dit Martin. Chaque art a ses conventions. (Ruth fut surprise de l’entendre employer ce mot. On aurait dit qu’il avait étudié à l’Université, au lieu d’avoir glané quelques notions au hasard à travers les livres de la bibliothèque). Mais les conventions mêmes doivent approcher de la réalité. Nous admettons que des arbres peints grossièrement sur du carton et dressés de chaque côté de la scène, représentent une forêt. Bien. Mais d’autre part, nous n’admettrions pas que cette même forêt soit représentée par un paysage marin ; ce serait une absurdité ; nous ne pouvons l’admettre. Et vous-même ne pouvez pas – ou plutôt ne devriez pas – accepter que les frénésies ridicules, les contorsions et les grimaces pénibles des deux fous de ce soir, soient censées représenter une scène d’amour.
– Alors, vous ne vous croyez pas supérieur à tous les critiques musicaux ?…
– Non, non ; pas pour l’instant ! J’use de mon droit individuel, simplement. Je viens de vous dire ce que je pense, afin que vous compreniez pourquoi les gambades éléphantines de Mme Tetralani sabotent pour moi le plaisir de la musique. Les grands juges musicaux peuvent avoir raison, tous tant qu’ils sont. Mais moi, je suis moi, et je ne subordonnerai pas mon goût au jugement unanime du public. Si je n’aime pas une chose, je ne l’aime pas, voilà tout ; et rien au monde ne me fera l’aimer, parce que la grande majorité de mes contemporains l’aime, ou fait semblant de l’aimer. Mes goûts et mes aversions ne suivent pas la mode.
– Mais vous savez, la musique est une éducation, discuta Ruth, l’opéra surtout. Ne croyez-vous pas que…
– Que je ne suis pas éduqué pour l’opéra ? fit-il vivement.
Elle fit un signe affirmatif.
– Justement, dit-il. Et je me considère comme très heureux de n’avoir pas été pris quand j’étais petit. Si je l’avais été, ce soir j’aurais versé de douces larmes et les clowneries surannées de ce couple délirant, n’auraient, à mes yeux, que mieux fait valoir la beauté de leur voix et celle de la musique. Vous avez raison. Oui, ce n’est qu’une affaire d’éducation. Mais à présent, je suis trop vieux : il me faut de la vérité, ou rien du tout. Une illusion qui n’est qu’une parodie est un mensonge, tout simplement : et c’est l’effet que me produit le grand opéra, quand le petit Barillo, subitement enragé, s’évertue à écraser contre sa poitrine la volumineuse Tetralani (également enragée) et lui hurle à l’oreille combien il l’adore.
Une fois de plus, Ruth le condamna au nom des préjugés et de sa foi dans les valeurs établies. Pourquoi aurait-il eu raison contre les gens cultivés ? Ses discours et ses pensées ne lui produisaient aucune impression. Elle avait trop le respect des opinions officiellement accréditées, pour avoir la moindre sympathie pour les idées révolutionnaires. De tout temps, la musique et l’opéra lui avaient plu comme ils plaisaient à son entourage. De quel droit Martin Eden, à peine sorti des « ragtimes » et des chansons populaires, s’érigeait-il en juge de la musique de son monde à elle ?… Tout en marchant à côté de lui, elle s’énervait et se sentait vaguement blessée dans son orgueil. Même en faisant appel à toute son indulgence, elle considérait sa profession de foi comme un caprice d’assez mauvais goût, une gaminerie un peu déplacée. Mais quand, devant sa porte, il la prit avec tendresse dans ses bras et l’embrassa amoureusement, elle oublia tout.
Et, plus tard, dans son lit, sans pouvoir trouver le sommeil, elle se demanda avec étonnement, ainsi qu’elle se l’était souvent demandé depuis quelque temps, comment elle avait pu aimer un homme aussi étrange et comment elle l’aimait malgré l’opposition de ses parents.
Le lendemain, Martin Eden, laissant de côté le journalisme, se mit, encore tout bouillant de sa discussion de la veille, à un essai qu’il intitula La Philosophie de l’illusion et le termina d’une traite. Il le timbra et l’expédia aussitôt – mais il devait le timbrer bien des fois encore et le réexpédier bien souvent pendant les mois qui suivirent.
25
Maria Silva était pauvre et rien de ce qui touche à la pauvreté ne lui était étranger. Pour Ruth, être pauvre signifiait simplement un genre d’existence dépourvu d’agréments. C’était tout ce qu’elle connaissait de ce sujet. Elle savait que Martin était pauvre et comparait volontiers sa situation avec celle d’Abraham Lincoln jeune, de M. Butler ou de quelques autres, arrivés depuis à la réussite. D’ailleurs, tout en pensant que la pauvreté n’avait rien de réjouissant, elle avait la conviction bien bourgeoise qu’elle est salutaire et constitue un coup de fouet excellent pour faire arriver tout homme qui n’est pas irrémédiablement esclave. D’apprendre que Martin était si pauvre qu’il avait engagé sa montre et son pardessus, ne la troubla donc pas. Elle considérait même ce fait comme assez satisfaisant, car elle pensait que tôt ou tard, il en aurait assez de cette situation et se déciderait à abandonner la littérature.
Jamais elle n’avait deviné la faim sur le visage de Martin, dont les joues se creusaient davantage tous les jours. Elle remarquait au contraire le changement avec satisfaction : il lui semblait plus affiné ; il perdait un peu de cette animalité vigoureuse qui l’attirait et qu’elle détestait. Quelquefois, quand ses yeux brillaient d’un éclat plus fiévreux, elle s’en réjouissait ; elle le trouvait plus semblable à un savant ou à un poète, ce qu’au fond elle aurait aimé qu’il fût.
Mais Maria Silva vit autre chose dans les joues creuses et les yeux fiévreux de son locataire et notait les changements de jour en jour, selon les alternatives de sa bourse. Elle le voyait partir avec son pardessus puis revenir sans lui, bien que le temps soit aigre et mordant. Ce jour-là ses joues s’étaient remplies un peu et la fièvre de ses yeux s’était atténuée. Elle vit de même disparaître la bicyclette et la montre et, à chaque disparition sa mine s’améliorait momentanément.
Elle mesura également l’intensité de son labeur à la quantité de pétrole qu’il brûlait la nuit et comprit qu’il la dépassait encore comme travail, bien que celui-ci soit différent du sien. Ce qui la surprit, ce fut de constater que moins il mangeait, plus il travaillait. Parfois, quand elle jugeait que le besoin s’en faisait par trop sentir, elle lui envoyait une galette cuite par elle, sous le prétexte qu’il ne savait sûrement pas la réussir aussi bien. Ou bien, elle lui dépêchait un de ses mioches avec un grand bol de soupe chaude, tout en se demandant si elle avait le droit d’en priver sa nichée. Et Martin lui en était reconnaissant, car il connaissait l’existence des pauvres et savait que, s’il existe de la charité sur terre, c’en était et de la vraie.
Un jour que Maria avait lesté sa nichée de ce qui restait à la maison et dépensé ses derniers quinze cents à l’achat d’un litre de piquette, Martin, entré à la cuisine pour chercher de l’eau, fut invité à s’asseoir et à boire un verre avec elle. Il but à sa santé, et elle but à la sienne. Puis, elle but à la réussite de ses affaires et il but à l’espoir que James Grant lui payerait sa note de blanchissage. James Grant était un charpentier à la journée qui ne payait pas volontiers et devait trois dollars à Maria.
Maria et Martin burent leur litre, l’estomac vide et l’âpre vin nouveau eut tôt fait de leur monter à la tête. Aussi différents qu’ils fussent, leur détresse était pareille et bien que tacitement ignorée, la misère les rapprochait. Maria fut abasourdie d’apprendre qu’il avait été aux Açores, où elle avait vécu jusqu’à l’âge de onze ans. Elle le fut encore davantage en apprenant qu’il connaissait bien les îles Hawaï, où elle avait émigré ensuite avec sa famille. Mais son étonnement devint de la stupeur, quand il lui dit qu’il avait été à Maui, l’île où elle s’était mariée. À Kahului, où elle avait connu son mari, il avait été deux fois. Oui, elle se souvenait des navires chargés de sucre, et lui, Martin, était à leur bord ! Vraiment le monde est petit ! Et Wailuku ! là aussi ! Connaissait-il le contremaître de la plantation ?… Oui, il avait même bu quelques verres avec lui. Ainsi tous deux évoquaient le passé, en trompant leur faim avec le petit vin aigre. L’avenir parut à Martin moins noir. Le succès tremblotait au bout, comme une étoile. Bientôt il le saisirait. Puis, il observa le visage cruellement ridé de la femme usée, vieillie par le travail, se souvint des soupes et des miches de pain, et une chaude vague de reconnaissance et de philanthropie l’envahit brusquement.
– Maria ! s’écria-t-il à brûle-pourpoint. Que voudriez-vous avoir ?
Elle le regarda, intriguée.
– Que voudriez-vous avoir, tout de suite, sur l’heure, si vous pouviez ?
– Des souliers pour les gosses, sept paires de souliers.
– Vous les aurez ! assura-t-il, tandis qu’elle hochait gravement la tête. Mais je voulais dire : que souhaitez-vous de beau, de tout à fait beau ?
Les yeux de Maria brillèrent gaiement. Il voulait plaisanter avec elle. Les gens ne plaisantaient pas souvent avec elle.
– Réfléchissez bien ! recommanda-t-il, comme elle ouvrait la bouche pour parler.
– Oui, oui, dit-elle. J’ai bien réfléchi. Je voudrais avoir cette maison à moi, bien à moi, toute, ne plus payer de loyer, sept dollars par mois.
– Vous l’aurez, promit-il, et bientôt. Maintenant, faites encore un vœu, tout à fait beau. Imaginez que je suis le bon Dieu et que je vous dise : tout ce que vous désirerez sera accordé. Allez-y ! J’écoute !
Maria réfléchit solennellement un instant.
– Vous n’avez pas peur ? le prévint-elle.
– Non, non, dit-il en riant. Je n’ai pas peur. Allez-y !
– C’est un gros morceau !
– D’accord Lâchez tout !
– Eh bien voilà… (Elle prit une grande respiration, comme les enfants qui se risquent à demander un cadeau impossible) J’aimerais avoir une ferme, une grande ferme. Beaucoup de vaches, un grand terrain, beaucoup d’herbages, pas loin de San Leandro – ma sœur habite là. Je vendrais le lait à Oakland. Ça me rapporterait beaucoup d’argent. Joe et Nick ne garderaient pas les vaches, ils iraient à l’école. Un jour ils pourraient devenir ingénieurs, construire des chemins de fer. Oui, j’aimerais avoir une grande ferme.
Elle s’arrêta et regarda Martin avec des yeux brillants.
– Vous l’aurez, dit-il aussitôt.
Elle hocha la tête et but poliment à la santé du donateur de ce cadeau qu’elle n’aurait jamais. Mais elle appréciait son bon cœur et l’intention généreuse.
– Non, Maria, poursuivit Martin. Joe et Nick n’auront pas besoin de s’occuper du lait et tous vos gosses iront à l’école et porteront des souliers toute l’année. Ce sera une belle ferme, avec tout ce qu’il faut. Il y aura une maison d’habitation, une écurie pour les chevaux et, naturellement, une étable. Il y aura des volailles, des cochons, des légumes, des arbres fruitiers et bien d’autres choses ; et les vaches seront assez nombreuses pour que vous puissiez vous payer un ou deux garçons de ferme. Vous n’aurez donc rien à faire qu’à vous occuper des enfants. Si vous trouvez un bon mari, il faudra le prendre et vous payer du bon temps, et lui s’occupera de la ferme.
Puis, ayant distribué ses largesses en acompte sur l’avenir, Martin s’en fut prendre son meilleur complet et alla l’engager, sacrifice suprême qui le désespérait, car il le séparait de Ruth. Son autre complet n’était pas présentable et s’il pouvait le mettre pour aller chez le boucher, le boulanger ou chez sa sœur, il lui était absolument impossible de se présenter chez les Morse dans une tenue aussi misérable.
Il trimait toujours, dénué de tout et presque sans espoir. Sa deuxième bataille était perdue sans doute et il allait être obligé de chercher un travail quelconque. En s’y résignant, il contenterait tout le monde, l’épicier, sa sœur, Ruth et même Maria, à qui il devait un mois de pension. Pour sa machine à écrire, il devait deux mois et l’agence le harcelait pour qu’il paye ou rende la machine. Désespéré, mais pourtant plus que jamais décidé à ne pas se rendre et en quelque sorte, pour conclure un armistice avec le destin, il s’inscrivit aux examens du personnel des chemins de fer. À sa grande surprise, il fut reçu premier. Ce gagne-pain était donc assuré, sans qu’il eût pourtant aucune idée de l’époque où on réclamerait ses services.
Ce fut à ce moment-là, le plus dur, que le mécanisme éditorial, pourtant si bien huilé d’habitude, subit un arrêt incompréhensible. Un pignon dut casser ou un graisseur tarir, car un matin, le facteur apporta une petite enveloppe mince, sur le coin de laquelle étaient imprimés le nom et l’adresse du Transcontinental Monthly. Son cœur fit un bond désordonné et il se sentit subitement faible, avec une étrange sensation dans les genoux. Titubant, il rentra dans sa chambre, s’assit sur son lit, l’enveloppe encore cachetée à la main et comprit tout à coup comment il arrive que des gens tombent morts, à l’annonce d’une nouvelle extraordinaire.
C’était bien une nouvelle extraordinaire. La petite enveloppe ne contenait pas de manuscrit, c’était donc une acceptation. Ce qu’il avait envoyé au Transcontinental, c’était « l’Appel des cloches », conte tragique de cinq mille mots.
Puisque les premières revues payaient toujours à la réception du manuscrit, l’enveloppe contenait évidemment un chèque. À deux cents le mot, vingt dollars, le mille ; le chèque devait être de cent dollars. Cent dollars ! En déchirant l’enveloppe, il récapitula le montant de ses dettes : 3 dollars 85 à l’épicier ; 4 au boucher ; au fruitier 5 et 2 au boulanger ; total 14 dollars 85. Puis il y avait sa chambre : 2 dollars 50, plus un mois d’avance, 2 dollars 50 ; deux mois pour sa machine à écrire, 4 dollars, et un mois d’avance, total : 31 dollars 85. Et pour en finir, ses reconnaissances, plus l’intérêt : montre, 5 dollars 50 ; pardessus, 5,50 ; bicyclette, 7,75 ; complet, 5,50 ; et 60 % d’intérêts. En tout, ça faisait 56 dollars 10. Il lui restait donc en poche, une fois toutes ses dettes payées, 43 dollars 90, et en payant d’avance un mois pour la machine et un mois de pension.
Il avait fini par retirer de l’enveloppe une feuille dactylographiée et l’avait dépliée… Il n’y avait pas de chèque. Il observa l’enveloppe, la regarda par transparence et enfin, n’en croyant pas ses yeux, la défit entièrement, avec des doigts tremblants… Il n’y avait pas de chèque. Il lut la lettre, ligne par ligne, passant vite sur les éloges de l’éditeur, pour arriver à la seule chose importante : la raison de l’absence de chèque. Il n’en trouva pas ; mais il trouva autre chose qui le fit soudain défaillir. La lettre lui glissa des mains. Il tomba sur l’oreiller, ses yeux vacillèrent et il tira la couverture à lui, envahi subitement d’un grand frisson.
Cinq dollars pour « l’Appel des cloches », pour cinq mille mots ! Au lieu de deux cents le mot, dix mots pour un cent. Et l’éditeur le complimentait par-dessus le marché ! Le chèque lui serait envoyé aussitôt l’histoire publiée. Alors, ces deux cents le mot au minimum, payés d’avance, tout cela c’était de la fumisterie ! Jamais il n’aurait essayé d’écrire, s’il avait su ce qu’il en était. Il aurait pris une situation, pour l’amour de Ruth. Il se rappela le jour où il avait écrit pour la première fois et fut effrayé du temps énorme qu’il avait perdu, tout cela pour un cent les dix mots ! Et ce qu’on racontait au sujet des grands revenus des auteurs arrivés devait être faux aussi. Le Transcontinental se vendait vingt-cinq cents et sa pompeuse et artistique couverture le proclamait un des premiers magazines. C’était une publication sérieuse, respectable, datant de bien avant sa naissance et qui n’avait jamais cessé de paraître depuis. Tous les mois, sur la couverture, paraissait une phrase d’un des grands pontifes de la littérature, proclamant la bienfaisante action du Transcontinental qui, en publiant ses premières élucubrations, lui avait permis de devenir illustre. Et c’était ce même Transcontinental, cette revue inspirée des dieux, qui payait cinq dollars les 5 000 mots ! Ce grand pontife venait de mourir à l’étranger – dans la plus noire misère, d’ailleurs – chose fort naturelle, étant donné la façon généreuse dont on payait les auteurs.
Eh bien ! il avait mordu à l’hameçon ; les journaux mentaient au sujet des écrivains et de ce qu’on leur donnait, et il avait perdu deux ans. Mais à présent, c’était bien fini. Il n’écrirait plus jamais une ligne. Il ferait ce que Ruth voulait, ce que tout le monde voulait : il se ferait une situation. Cette résolution le fit penser à Joe, à Joe qui cheminait par monts et par vaux, sans rien faire, et Martin eut un grand soupir d’envie. La réaction de son régime de dix-neuf heures de travail pendant si longtemps se faisait sentir. Seulement voilà : Joe n’était pas amoureux et, s’il mangeait le pain du chemineau, cela ne regardait que lui. Lui, Martin, avait un but et il travaillerait en vue de ce but. Demain matin, de bonne heure, il s’en irait à la recherche d’une situation. Et il ferait savoir à Ruth également qu’il s’était amendé et ne demandait pas mieux que d’entrer dans les bureaux de son père.
Cinq dollars les cinq mille mots, dix mots pour un cent, la cote de l’Art ! La désillusion, le mensonge l’infamie de tout cela l’obsédaient ; sous ses paupières closes, brûlantes, dansaient en chiffres de feu les 3 dollars 85 qu’il devait à l’épicier. Il frissonna et s’aperçut que ses os lui faisaient mal. Ses reins aussi. Il avait mal au front, à la nuque, au cerveau ; sa tête lui semblait enfler démesurément, et la douleur du front devenait intolérable. Et toujours, sous ses paupières, dansaient les inexorables 3 dollars 85. Il ouvrit les yeux pour leur échapper, mais la lumière blanche lui fit si mal qu’il dut les refermer.
Cinq dollars pour mille mots, dix mots pour un cent, ressassait son cerveau ; il ne pouvait pas plus échapper à cette pensée qu’il ne pouvait effacer ces 3 dollars 85. Puis, le chiffre changea et il vit que deux dollars s’inscrivaient à la place. Ah ! oui, le boulanger ! Puis apparurent deux dollars cinquante et il se demanda ce que c’était, comme si c’était une question de vie ou de mort. Il devait ces deux dollars cinquante à quelqu’un, mais à qui ?… Il chercha péniblement, fouillant tous les recoins de son cerveau, en vain. Tout d’un coup, le problème se résolut : à Maria Silva. Soulagé, il crut pouvoir se reposer. Mais non ! sous ses paupières, les deux dollars cinquante avaient fait place à huit dollars ! Qu’était-ce encore ? Il lui fallait faire le tour de son cerveau exténué et trouver.
Il ne sut pas la durée de ses angoisses, mais après un temps qui lui sembla démesuré, un coup frappé à la porte le fit revenir à lui : Maria lui demandait s’il était malade. Il répondit d’une voix sourde qu’il ne reconnut pas, qu’il faisait un somme. L’obscurité de la chambre le surprit. Il faisait donc nuit ? Il avait reçu la lettre à deux heures de l’après-midi… il se rendit compte qu’il était malade.
Bientôt les huit dollars se remirent à danser devant ses yeux fermés et il fut repris par le torturant esclavage des chiffres. Mais rusant rageusement avec lui-même, il se défendait de chercher à travers son cerveau. Pour quoi faire ? Il n’avait été qu’un idiot. Il eut la sensation de manœuvrer un levier et son cerveau se mit à tourner autour de lui ; c’était une monstrueuse roue de la Fortune, un manège de la mémoire, sphère vertigineuse de la sagesse. Ça tournait de plus en plus vite, puis il fut happé par le tourbillon, et rejeté tournoya dans un gouffre noir.
Tout naturellement il se retrouva devant un cylindre, avec un monceau de manchettes amidonnées. Mais à mesure qu’il les cylindrait, des chiffres y apparaissaient. Une nouvelle façon de marquer le linge ! se dit-il : mais en regardant de plus près, il vit 3 dollars 85 inscrits sur une manchette. Il se souvint alors que c’était la note de l’épicier ; ce qu’il s’imaginait cylindrer, c’étaient les notes de ses fournisseurs. Une idée lumineuse lui vint alors. Il allait jeter les notes par terre, ce qui lui éviterait de les payer. Mais à mesure que les manchettes, rageusement chiffonnées, jonchaient le sol sale, leur tas s’élevait de plus en plus et bien que chaque note ait une centaine de duplicata, une seule frappait son regard, une de deux dollars cinquante, celle de Maria. Brave Maria ! Ça signifiait évidemment qu’elle attendait pour le paiement et il décida généreusement qu’elle serait la seule à être payée. Il se mit donc à chercher sa note dans le tas. Il cherchait depuis un temps infini, quand le patron de l’hôtel, le gros Hollandais, entra. Sa figure grasse grimaçait de colère et il hurla d’une voix de stentor : « Je retiendrai le prix de ces manchettes sur vos gages ! » La pile de manchettes montait toujours, c’était une montagne à présent et Martin comprit qu’il lui faudrait travailler un millier d’années pour les payer. Eh bien ! il ne lui restait donc qu’à tuer le patron et à brûler la blanchisserie. Mais le gros Hollandais, prévenant son intention, le saisit par la peau du cou et le fit voler à travers la pièce. Il le lança sur la table à repasser, contre le fourneau, le cylindre, le précipita dans la laverie, à travers le séchoir et la lessiveuse. Martin fut secoué à en ébranler ses dents, à lui faire douloureusement tourner la tête et il s’étonna de la vigueur de ce gros Hollandais. Et il se retrouva devant le cylindre, recevant cette fois les manchettes que le rédacteur d’une revue introduisait de l’autre côté. Chaque manchette était un chèque, Martin les inspectait tous anxieusement, mais ils étaient tous en blanc. Pendant un million d’années environ, il resta là, sans oser s’en aller de peur de manquer le seul chèque qui fût rempli. Enfin il y en eut un. Avec des doigts tremblants il le regarda au jour… Il était de cinq dollars. Ha ! ha ! ricana l’éditeur de l’autre côté du cylindre. « Bien ! dit Martin, je vais vous tuer. » Il alla chercher la hache dans la laverie et trouva Joe qui empesait des manuscrits. Il essaya de l’en empêcher, puis leva sur lui la hache. Mais l’arme resta suspendue en l’air et Martin se retrouva dans l’autre pièce au milieu d’une tourmente de neige. Mais non, ce n’était pas de la neige, mais de formidables chèques dont le moindre était de cent dollars. Il se mit en devoir de les trier par paquets de cent, qu’il ficela solidement.
Ensuite, en levant les yeux, il vit Joe, debout devant lui, qui jonglait avec des fers à repasser, des chemises et des manuscrits. Parfois il prenait une liasse de chèques et l’ajoutait au tourbillon de linge et de papiers qui traversait le toit, et s’envolait vers le ciel. Martin leva sur lui la hache, mais Joe la saisit et l’ajouta au tourbillon. Puis il cueillit Martin et l’y ajouta également. Martin s’envola à travers le toit, s’agrippa à un monceau de manuscrits, retomba à terre avec, fut lancé à nouveau en l’air, retomba et ainsi de suite, tandis qu’une voix enfantine chantait : « Valse avec moi, Willie, encore, encore, encore… » Il finit par remettre la main sur la hache, au beau milieu du tourbillon neigeux de chèques, de linge et de manuscrits et se prépara à tuer Joe, aussitôt qu’il retomberait à terre. Mais cette consolation lui fut refusée. Car il eut vers deux heures du matin, la visite de Maria. À travers la mince cloison, elle avait entendu ses gémissements. Elle le réchauffa avec des fers chauds et posa des linges mouillés sur son front brûlant.
26
Le lendemain matin, Martin n’alla pas à la recherche d’un boulot. Vers la fin de l’après-midi, son délire s’arrêta et ses yeux las errèrent à travers la chambre. Mary, l’une des petites Silva, âgée de huit ans, qui le veillait, poussa un cri en le voyant reprendre conscience et Maria, du fond de sa cuisine, accourut aussitôt. Elle posa sa main calleuse sur le front brûlant et lui tâta le pouls.
– Vous voulez manger ? lui demanda-t-elle.
Il secoua la tête. Manger était bien le dernier de ses désirs, et il se demanda si de sa vie il avait jamais eu faim.
– Je suis malade, Maria, dit-il d’une voix faible. Qu’est-ce que c’est ?… Savez-vous ?
– La grippe, répondit-elle. Dans trois ou quatre jours ça ira bien. Ne mangez pas, ça vaut mieux. Plus tard, demain, peut-être.
Martin n’était pas habitué à être malade : il essaya de se lever et de s’habiller, dès que Maria et la petite furent sorties. Par un suprême effort de volonté, le cerveau battant la campagne et les yeux si douloureux qu’il ne pouvait les tenir ouverts, il parvint à sortir du lit pour tomber sans connaissance sur la table.
Une demi-heure plus tard, il put regagner son lit où, les yeux clos, il analysa son mal avec soin. Maria entra plusieurs fois changer les linges frais de son front. Le reste du temps elle le laissait tranquille, trop avisée pour l’ennuyer par des bavardages. Il en fut touché et se murmura à lui-même : « Maria, vous aurez votre ferme, c’est sûr, c’est sûr. »
Puis la journée de la veille lui revint, si lointaine ! Il lui sembla qu’il s’était écoulé des siècles, depuis que cette lettre du Transcontinental était arrivée, que toute une vie s’était écoulée puisque tout ça était fini, enterré et qu’il allait tourner la page. Il avait brûlé sa dernière cartouche et maintenant il était sur le flanc. S’il ne s’était pas laissé mourir de faim, la grippe n’aurait pas eu de prise sur lui. Il était anémié et les microbes avaient trouvé en lui un terrain propice.
– À quoi sert à un homme d’écrire une bibliothèque entière et de gâcher sa vie ? dit-il tout haut. Ça m’est refusé. Plus de littérature ! À moi, le pupitre et le grand livre de caisse, l’honnête salaire et la petite maison avec Ruth.
Le surlendemain, après avoir mangé un œuf, deux toasts et bu une tasse de thé, il demanda son courrier ; mais ses yeux lui faisaient trop mal pour lui permettre de lire.
– Lisez-moi cela, Maria, dit-il. Pas les grandes enveloppes longues : jetez-les sous la table. Lisez-moi les lettres petites.
– Je ne sais pas lire, répondit Maria, Thérèse, qui va à l’école, elle sait, elle.
Thérèse Silva – neuf ans – ouvrit donc les lettres et les lui lut. Il écouta vaguement une longue lettre de récriminations du marchand de machines à écrire, l’esprit occupé à chercher un moyen de trouver du travail. Tout à coup, une phrase entendue par hasard, le fit tressaillir.
– Nous vous offrons quarante dollars pour les droits d’auteur de votre nouvelle, épelait lentement Thérèse, à condition que vous nous autorisiez à y faire tous changements jugés utiles.
– Quelle revue est-ce ? cria Martin. Tiens ! donne-moi ça !
Il y voyait clair à présent et ne sentait plus sa fatigue. C’était la White Mouse qui lui offrait quarante dollars de sa nouvelle « Le Tourbillon », un de ses contes dramatiques. Il relut la lettre plus de dix fois. L’éditeur lui disait que son idée n’était pas bien rendue, mais qu’elle était assez originale. S’il pouvait rogner un tiers de l’histoire, il la prendrait et lui enverrait les quarante dollars au reçu de sa réponse.
Martin demanda de l’encre et une plume et répondit que l’on pouvait en couper les trois quarts si on voulait et qu’il attendait les quarante dollars.
Une fois Thérèse partie à la poste avec la lettre, Martin s’étendit de nouveau et réfléchit. Après tout, ce n’était pas une blague : The White Mouse payait d’avance. « Le Tourbillon » avait 3.000 mots. En en coupant le tiers, ça ferait 1.000 – donc deux cents le mot. Les journaux avaient dit vrai. Et lui qui croyait The White Mouse une revue de troisième ordre ! Il n’y connaissait rien, c’était évident.
En tout cas, il y avait une chose certaine : aussitôt guéri, il ne chercherait pas de travail. Dans sa tête il y avait bien d’autres histoires aussi bonnes que « Le Tourbillon » ; à quarante dollars pièce, il gagnerait bien plus que dans n’importe quelle situation. Au moment précis où il croyait la bataille perdue, elle était gagnée. Il avait obtenu la preuve qu’il voulait Sa voie était tracée. The White Mouse commençant, les autres magazines suivraient inévitablement. La matérielle pouvait être éliminée ; ç’avait été du temps perdu, puisqu’il n’en avait pas touché un cent. Il allait se consacrer à la littérature, la vraie, et pourrait y déverser ce qu’il avait de meilleur en lui. Il souhaita ardemment pouvoir faire partager sa joie à Ruth – et voilà qu’en parcourant les lettres éparses sur le lit, il en trouva une d’elle. Gentiment elle le grondait, en lui demandant pourquoi il n’avait pas donné de ses nouvelles depuis si longtemps. Il relut avec transport la lettre adorée, le moindre trait de plume de son écriture et finit par embrasser la signature.
Dans sa réponse, il lui dit délibérément qu’il n’avait pas pu aller la voir parce que ses habits étaient au clou, qu’il avait été malade, mais qu’il était presque rétabli et que dans dix ou quinze jours – le temps pour une lettre d’aller à New York et d’en revenir – il aurait dégagé ses habits et irait la voir.
Mais Ruth ne se souciait pas d’attendre dix ou quinze jours. D’ailleurs son amoureux était malade. Le lendemain, accompagnée d’Arthur, elle vint dans la voiture des Morse, à la grande joie de la tribu des Silva et de toute la marmaille du voisinage, mais au grand désespoir de Maria. Elle gifla les Silva, qui se pressaient autour des visiteurs, sous le petit porche d’entrée et fit son possible pour excuser sa tenue, en un anglais encore plus atroce que d’habitude. Ses manches roulées sur des bras blancs de savon, une vieille toile à laver autour de la taille, disaient assez le genre de besogne qu’on avait interrompue. Complètement affolée par la visite de ces jeunes gens si chics, elle oublia totalement de les inviter à s’asseoir dans le petit salon. Pour entrer chez Martin, ils passèrent par la cuisine pleine de buée chaude. Dans sa surexcitation, Maria coinça la porte d’entrée contre celle du cabinet restée ouverte et, pendant cinq minutes, par la porte entrebâillée, des nuages de vapeurs sentant le savon et la saleté, envahirent la chambre.
Ruth, en traçant son chemin à travers les obstacles, parvint au chevet de Martin sans encombre ; mais Arthur vira trop court et alla cogner, avec grand fracas, contre les casseroles et les ustensiles culinaires. Il ne s’éternisa pas d’ailleurs. Jugeant qu’il avait rempli son devoir et Ruth occupant l’unique siège, il sortit et attendit près de la grille, entouré des sept petits Silva béants d’admiration ; ils le mangeaient des yeux comme un phénomène de foire. Tout autour de la voiture, les enfants du voisinage étaient massés, dans l’attente impatiente du tragique et terrible dénouement inévitable – car, dans cette rue, les voitures ne s’aventuraient que pour les mariages ou les enterrements – or, comme ce n’était pas le cas, quelque chose d’autre, d’inouï, allait évidemment se passer.
Martin avait failli devenir fou en voyant Ruth. C’était une nature essentiellement aimante, avide de sympathie, ou plutôt d’intelligente compréhension : et il ignorait encore que la sympathie de Ruth tenait plutôt à la gentillesse de sa nature qu’à la compréhension de l’objet de sa sympathie. Tandis que Martin lui disait sa joie de la voir, elle lui serrait tendrement la main sans répondre, les yeux humides à la vue de sa faiblesse et des ravages dont la souffrance avait marqué son visage.
Mais, quand il lui raconta son succès inespéré, les deux acceptations, son désespoir en lisant celle du Transcontinental, son enthousiasme en recevant celle de la White Mouse, elle cessa de le suivre. Les mots, elle les entendait, en comprenait le sens littéral, mais son désespoir et sa joie, elle ne les partageait pas. Que lui importaient ses histoires de revues ? Le mariage seul l’intéressait. Elle ne s’en doutait pas cependant, elle aurait rougi de honte si quelqu’un lui avait dit crûment que ce qu’elle désirait en Martin, c’était lui-même et pas autre chose. Indignée, elle aurait clamé que son seul but était l’intérêt de Martin et, par-dessus tout, son succès. Tandis que son fiancé épanchait son cœur, disait son bonheur d’être enfin sur la voie du triomphe, elle ne l’écoutait que distraitement et regardait la chambre à la dérobée, choquée de ce qu’elle voyait.
Pour la première fois, Ruth voyait de près l’image brutale de la pauvreté. Jusqu’alors, les amoureux mourant de faim, lui avaient semblé romanesques ; mais elle ne se doutait pas de quelle manière vivaient les amoureux qui meurent de faim. Et c’était ça ! Son regard allait sans cesse de la chambre à Martin, de Martin à la chambre. La fade odeur de linge sale qui venait de la cuisine, lui donnait des nausées. Martin devait en être imprégné, se dit-elle, pour peu que cette horrible femme lave souvent. Et, en regardant Martin, il lui semblait que le milieu qui l’environnait, l’avait sali. Elle ne l’avait jamais vu que rasé de frais et sa barbe de trois jours lui répugna. Ça cadrait avec son décor sordide et sinistre, accentuait encore cette animalité puissante qu’elle abhorrait. Et voilà que ces deux malencontreuses acceptations le confirmaient dans sa folie ! Quelques jours de plus et il aurait cédé, il aurait accepté un travail sérieux. À présent, il allait continuer à vivre dans cette horrible maison où il écrirait et mourrait de faim pendant quelques mois encore.
– Qu’est-ce que c’est que cette odeur ? demanda-t-elle subitement.
– Un des parfums de lessive de Maria, je suppose, répondit-il.
– Non, non, pas ça : quelque chose d’autre, une odeur écœurante, fade…
Martin renifla l’air consciencieusement avant de répondre.
– Je ne sens rien d’autre que la vieille fumée de tabac…
– C’est ça ! C’est horrible ! Pourquoi fumez-vous tant, Martin ?
– Je ne sais pas… Je fume davantage quand je suis seul. Et puis, c’est une si ancienne habitude ! Je fumais tout gosse.
– Ce n’est pas une bonne habitude, reprocha-t-elle. Ça sent affreusement mauvais.
– C’est la faute du tabac. Je ne peux m’en offrir que du meilleur marché. Mais attendez seulement que j’aie touché mes quarante dollars ! Je fumerai du tabac qui ne gênera même pas les anges du paradis ! Mais n’est-ce pas, ce n’est pas mal, deux acceptations en trois jours ? Ces quarante dollars payeront toutes mes dettes.
– Quarante dollars pour deux mois de travail ? interrogea Ruth.
– Non, pour moins d’une semaine de travail. Voulez-vous me passer ce livre de comptes relié en gris qui est au bout de la table, je vous prie ? (Il l’ouvrit, en feuilleta rapidement les pages.) Oui, j’ai raison. Quatre jours pour « L’Appel des cloches » et deux jours pour « Le Tourbillon ». Ça fait quarante-cinq dollars par semaine, cent quatre-vingt-dix dollars par mois. Aucune situation ne me donnerait ça. Et, d’ailleurs, ce n’est qu’un début. Mille dollars par mois n’est pas trop pour vous acheter tout ce que je veux que vous ayez. Il me faut au moins ça. Attendez que je mette la machine en train. Et puis, vous la regarderez galoper !
Ruth ne comprit pas sa plaisanterie et revint aux cigarettes.
– Vous fumez beaucoup trop et la qualité du tabac ne fera aucune différence. C’est de fumer, qui en soi n’est pas bon. Vous n’êtes qu’une cheminée, un volcan ambulant, un poêle à roulettes, une vraie désolation. Martin chéri, vous en doutez-vous ?
Elle se pencha vers lui, suppliante et, à la vue de son visage délicat et de ses grands yeux timides, il fut frappé de sa propre indignité.
– Je voudrais tant que vous ne fumiez plus ! murmura-t-elle. Je vous en prie, faites-le… pour l’amour de moi !
– Bon ! c’est entendu ! s’écria-t-il. Je ferai tout ce que vous demanderez, tout, vous le savez bien !
Une grande tentation l’assaillit. Elle fut tentée de lui demander de renoncer à écrire. Pendant le court silence qui suivit, les mots irréparables tremblèrent sur ses lèvres. Mais le courage lui manqua et, penchée vers lui, elle murmura simplement :
– Vous savez, ce n’est réellement pas pour moi, Martin ; c’est dans votre intérêt. Je suis sûre que la fumée vous fait du mal ; et d’ailleurs, il ne faut être l’esclave de rien, d’une drogue encore moins.
– Je ne veux être que votre esclave, toujours, dit-il en souriant.
– Dans ce cas, je vais dicter mes ordres !
Elle lui lança un regard malicieux. Pourtant dans son for intérieur elle regrettait déjà de ne pas lui avoir demandé davantage.
– Votre Majesté sera obéie !
– Eh bien ! voilà mon premier ordre : il faut vous raser tous les jours. Regardez comme vous m’avez égratigné la joue !…
Et cela se termina par des caresses et des baisers. Elle avait gagné un point : ça suffisait pour le moment. Son orgueil féminin était flatté d’avoir obtenu qu’il renonce à fumer. Une autre fois, elle le persuaderait d’accepter une situation. N’avait-il pas juré de faire tout ce qu’elle voudrait ?
Elle quitta son chevet pour explorer la chambre, examina les rangées de notes suspendues aux ficelles, se fit expliquer le système d’accrochage de la bicyclette, et s’attrista du monceau de manuscrits sous la table, qui représentait selon elle une si énorme perte de temps. Le fourneau à pétrole fit son admiration, mais en explorant la planche à provisions, elle la trouva vide.
– Mais vous n’avez rien à manger, pauvre chéri ! s’écria-t-elle avec une tendre pitié, vous devez mourir de faim !
– Je range mes provisions dans le garde-manger de Maria, dit-il, en mentant. Elles se conservent mieux. Pas de danger que je meure de faim. Regardez ça !
Elle était revenue auprès de lui et le vit contracter son biceps, faire saillir ses muscles énormes, durs comme du fer. Cette vue la dégoûta sentimentalement, elle avait horreur de ça. Mais son instinct, ses nerfs, sa féminité tout entière l’aimaient, en avaient irrésistiblement besoin, et comme toujours, elle se pencha vers lui. Comme il la serrait dans ses bras, le cerveau de Ruth était en révolte et son cœur, ses sens exultaient, triomphaient. Dans des instants pareils, elle sentait profondément son amour pour Martin, car elle éprouvait un ravissement extraordinaire à sentir ses bras puissants la serrer éperdument. À ces moments-là elle se sentait justifiée de trahir ainsi ses préjugés, son idéal, de désobéir tacitement à ses parents qui désapprouvaient ce mariage, et que cet amour choquait. D’ailleurs, loin de sa présence, redevenue froide et maîtresse d’elle-même, elle en était choquée aussi. Quand ils étaient ensemble, elle l’aimait – d’un amour parfois agacé, il est vrai, mais plus fort que sa volonté.
– Cette grippe est peu de chose, dit-il. C’est ennuyeux on a très mal à la tête ; mais ce n’est rien en comparaison de la fièvre ostéocopique.
– Vous l’avez eue aussi ! dit-elle distraitement, plongée dans la justification précieuse de l’agrément qu’elle trouvait à être dans ses bras.
Il continua sans qu’elle fît grande attention à ses paroles, quand tout à coup un mot la fit sursauter : il l’avait attrapée dans une colonie secrète de trente lépreux vivant sur une des îles Hawaï.
– Mais pourquoi y êtes-vous allé ? demanda Ruth. Une pareille imprudence lui semblait criminelle.
– Parce ce que je n’en savais rien, répondit Martin. J’étais loin de penser aux lépreux. Après avoir déserté ce schooner, j’ai abordé au rivage et me suis dirigé vers l’intérieur à la recherche d’un endroit sûr. Pendant trois jours je me suis nourri de goyaves, de poires d’ohia et de bananes qui poussaient en abondance dans la jungle. Le quatrième jour, j’ai trouvé une piste, une simple piste de piétons, qui menait vers l’intérieur, et je l’ai suivie. Elle portait des traces récentes. À certains endroits elle n’avait pas plus de trois pieds de large, le long d’une crête aussi étroite qu’une lame de rasoir, bordée de chaque côté par un précipice dont on ne voyait pas le fond. Bon endroit pour une embuscade ! avec des munitions, un homme seul aurait pu y tenir en échec dix mille.
« Il n’y avait pas d’autre chemin, d’ailleurs. Après trois heures de marche, j’ai trouvé la cachette : un petit vallon au creux des montagnes, un terrier au milieu des pics de lave, entièrement construit en terrasses étagées. Des arbres fruitiers y poussaient et il y avait huit ou dix huttes en herbe. Mais dès que j’ai vu les habitants, j’ai su ce qui en était. Un seul coup d’œil suffisait.
– Qu’avez-vous fait ? questionna Ruth haletante.
– Il n’y avait rien à faire. Leur chef était un bon vieillard en bien mauvais état déjà, mais d’une autorité indiscutée. Il avait découvert ce vallon et fondé cette colonie, absolument hors la loi. Mais il avait des fusils, beaucoup de munitions, et ces Canaques, entraînés à chasser les fauves et le sanglier, étaient des tireurs extraordinaires. Non, Martin Eden n’avait aucune chance de pouvoir s’enfuir. Et il y est resté trois mois.
– Mais comment avez-vous pu vous échapper ?
– Je serais encore là-bas, sans une jeune fille à moitié chinoise, avec un quart de sang européen, un quart de sang hawaïen. Une beauté – la pauvre créature – et bien élevée. Sa mère, à Honolulu, valait bien un million. Eh bien, cette fille m’a permis de m’enfuir, à la fin. C’était sa mère qui finançait la colonie, vous comprenez, et la fille ne craignait donc pas de se faire punir en me faisant fuir. Mais d’abord, elle m’a fait jurer de ne jamais révéler leur cachette, et j’ai tenu parole. Elle n’avait que les premiers symptômes de la lèpre : les doigts de sa main droite étaient légèrement tordus et il y avait une petite tache à son bras. C’est tout. Je suppose qu’elle doit être morte à présent.
– Mais vous n’aviez pas peur ?… Vous n’avez pas été heureux de vous en aller sans avoir attrapé cette épouvantable maladie ?
– Mon Dieu, avoua-t-il, au début, je n’étais pas précisément à mon aise ! Mais je m’y suis habitué. Et puis je plaignais tant la pauvre fille ! Ça me faisait oublier ma peur. Elle était aussi belle d’âme que de corps. La maladie l’avait à peine touchée et pourtant elle était vouée à cette vie primitive et à une mort plus affreuse encore, à une lente décomposition. La lèpre est plus terrible que vous ne pouvez vous l’imaginer.
– Pauvre créature ! murmura Ruth. Comment a-t-elle pu vous laisser partir ?
– Que voulez-vous dire ?
– Parce qu’elle devait vous aimer, dit Ruth d’une voix douce. Voyons sincèrement, elle vous aimait ?
Le hâle de Martin s’était effacé à la suite de son existence sédentaire et les privations, la maladie avaient pâli son visage ; qu’une rougeur sombre envahit lentement. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Ruth lui coupa la parole en riant :
– Ça ne fait rien ; ne répondez pas. C’est tout à fait inutile ! Mais il lui sembla qu’il y avait quelque chose de métallique dans son rire et que dans ses yeux brillait une lueur froide. Sur le moment, ça fit l’effet d’une tempête d’hiver, comme il en avait vu dans le nord du Pacifique. Il revit subitement cette nuit-là, le ciel clair, la tempête et les vagues immenses sous la lumière glaciale de la pleine lune. Puis il revit la jeune lépreuse et se souvint que c’était par amour pour lui qu’elle l’avait laissé partir.
– Son âme était belle, dit-il simplement. Elle m’a permis de vivre.
Il n’en dit pas davantage sur ce sujet, mais il vit soudain Ruth se détourner vers la fenêtre et l’entendit étouffer un sanglot. Puis elle se tourna vers lui, calmée, sans aucune trace de tempête dans les yeux.
– Je suis si bête ! dit-elle plaintivement. Et je ne peux pas m’en empêcher. Je vous aime tant… Martin, tant, tant. Avec le temps je deviendrai raisonnable, mais pour le moment, je ne peux pas ne pas être jalouse de tous ces fantômes de votre passé, car votre passé est plein de fantômes !
Et comme il allait protester, elle l’arrêta :
– C’est fatal. Ça ne pouvait être autrement. Mais je vois ce pauvre Arthur qui me fait signe. Il est fatigué d’attendre. Allons, au revoir, chéri…
– Il y a une espèce de potion que vendent les pharmaciens pour aider à s’arrêter de fumer, dit-elle à la porte. Je vais vous en envoyer.
La porte se ferma, puis se rouvrit.
– Je vous aime tant, tant ! chuchota-t-elle encore, puis la porte se ferma définitivement.
Maria, qui, malgré son affolement n’avait pas été sans remarquer la couleur de la toilette de Ruth et sa coupe – une coupe nouvelle, produisant un effet ravissant – l’accompagna à la voiture. Les mioches attroupés restèrent plantés là, désappointés. Puis elle disparut, alors ils contemplèrent Maria, devenue subitement un personnage important. Mais, un des enfants ayant révélé que les visiteurs étaient pour leur locataire, Maria retomba dans son obscurité et ce fut Martin qui bénéficia de la respectueuse considération du voisinage, ainsi que de celle de Maria. Quant à l’épicier portugais, s’il avait assisté à cet événement inouï, le crédit de Martin en aurait été augmenté de trois dollars quatre-vingt-cinq, au moins.
27
La roue de la fortune tournait. Le lendemain de la visite de Ruth, il reçut un chèque de trois dollars d’un journal hebdomadaire de New York pour trois de ses triolets. Deux jours après, un journal de Chicago accepta ses Chasseurs de trésors avec promesse de les lui payer dix dollars après publication. C’était peu, mais cet article était le premier qu’il eût écrit. Son second essai, la suite d’aventures pour garçons, fut accepté à la fin de la semaine par une revue mensuelle appelée Youth and Age. Il est vrai que cette suite avait vingt-deux mille mots et qu’on lui en offrait seize dollars après publication, ce qui faisait environ soixante quinze cents les mille mots ; mais il était également vrai que c’était là son second essai et qu’il en savait parfaitement les défauts.
Cependant, ses premières œuvres mêmes n’avaient rien de maladroit. Ce qui les caractérisait, c’était la lourdeur d’un tempérament trop puissant, la gaucherie du novice qui veut attraper des papillons à coups de massue.
Martin fut donc heureux de se débarrasser de ses essais de jeunesse qu’il avait vite jugés à leur valeur. Dans ses récentes œuvres, par exemple, il avait mis tout son espoir. Il avait essayé d’être plus et mieux qu’un écrivain ordinaire pour magazines. D’autre part, il n’avait pas étouffé son tempérament, mais l’avait endigué simplement. Il n’avait pas sacrifié non plus son amour de la vérité. Ses œuvres étaient réalistes, bien qu’imaginatives. Il aspirait à un réalisme passionné, mais profondément humain et croyant ; il voulait montrer la vie telle qu’elle est, avec toutes ses aspirations de l’esprit et toute sa soif d’idéal.
Dans le cours de ses lectures, deux écoles lui étaient apparues. L’une faisait de l’homme un dieu ignorant son origine terrestre ; l’autre en faisait un tas de boue, qui ignorait son essence céleste et ses possibilités divines. Selon Martin, dieu et tas de boue étaient également faux et les deux écoles se trompaient. Il y avait un compromis à faire pour approcher de la vérité. Dans sa nouvelle L’Aventure qu’il avait soumise à Ruth, Martin croyait l’avoir réalisé ; et dans son essai Dieu et le limon il avait exprimé ses idées sur le sujet en général.
Mais L’Aventure et ses meilleures œuvres continuaient leurs voyages chez les éditeurs. Ses premiers ouvrages ne valaient à ses yeux que par l’argent qu’ils rapportaient et il n’estimait guère davantage ses contes dramatiques dont deux étaient vendus. Ce n’étaient pour lui que de simples fantaisies d’imagination, mais elles étaient pourtant remplies de toute l’émotion de la réalité, et là résidait leur charme. Ce mélange de grotesque et d’impossible avec la réalité, il le regardait comme un truc habile, et voilà tout. Ce n’était pas de la littérature supérieure.
Il y avait de l’art certes, mais de l’art sans valeur, puisqu’il ne dérivait pas d’une source humaine. L’habileté avait été de dissimuler la fiction sous le masque de la réalité et c’est ce qu’il avait fait dans une demi-douzaine d’histoires tragiques qu’il avait écrites avant de s’élancer vers les sommets avec L’Aventure, la Joie, La Marmite et Le Vin de la vie.
Les trois dollars qu’il reçut pour les triolets lui servirent à vivre d’une façon précaire jusqu’à l’arrivée du chèque de la White Mouse. Il toucha le premier chez le méfiant épicier portugais, lui donna un dollar d’acompte et divisa les deux autres dollars entre le boulanger et le fruitier. Il ne put encore se payer de viande et ses menus se simplifiaient de plus en plus, quand le chèque de la White Mouse arriva. Il hésita sur la façon de l’encaisser. S’il n’avait jamais pénétré dans une banque, il y avait encore moins fait d’affaires et l’enfantin et naïf désir le hantait d’entrer dans une des grandes banques d’Oakland pour y toucher son chèque de quarante dollars. D’autre part, le plus ordinaire bon sens lui commandait de le toucher chez son épicier, ce qui procurerait une impression capable certainement d’augmenter son crédit à l’avenir. À contre-cœur, Martin céda aux objurgations de ce fournisseur, lui paya sa note complète et reçut en retour une poignée d’espèces sonnantes et trébuchantes. Il paya également ses autres dettes, dégagea complet et bicyclette, donna un mois d’avance pour la machine à écrire et à Maria ce qu’il lui devait, plus un mois d’avance. Il lui resta en poche trois dollars pour les dépenses imprévues.
En soi, cette petite somme représentait une fortune. Dès qu’il eut son complet, il alla voir Ruth et en chemin ne put s’empêcher d’agiter sa poche afin d’entendre tinter son trésor. Ça faisait si longtemps qu’il n’avait pas eu d’argent, que, pareil à un homme qui a failli mourir de faim et couve des yeux la nourriture qu’il ne peut plus consommer, il avait besoin de sentir dans sa main ses quelques pièces. Il n’était cependant ni avare ni mesquin, mais cet argent signifiait pour lui autre chose que des dollars et des cents. Il signifiait le succès, et les aigles gravées sur ces pièces étaient autant de victoires ailées.
Il en arriva à penser que le monde était vraiment admirable. Pendant des semaines, il l’avait trouvé bien triste, bien sombre ; mais à présent, avec presque toutes ses dettes payées, trois dollars tintant dans sa poche et la certitude du succès, le soleil lui semblait resplendissant et même l’averse qui le trempa en un clin d’œil, lui parut charmante. Pendant qu’il mourait de faim, il pensait constamment aux millions d’êtres qui, de par le monde, mouraient de faim comme lui ; aujourd’hui, qu’il était rassasié, il les oublia ; mais comme il était amoureux, il pensa aux innombrables amoureux et des motifs de poèmes d’amour s’imposèrent à son esprit. Distrait par l’inspiration il descendit du tram deux stations trop loin, sans que sa bonne humeur en soit altérée.
Chez les Morse il y avait du monde. Les deux cousines de San Rafaël étaient venues voir Ruth, et Mme Morse, sous prétexte de les distraire, avait invité plusieurs hommes. Sa campagne avait commencé durant l’absence forcée de Martin et battait son plein. Elle s’évertuait à n’avoir chez elle que des hommes de valeur. C’est ainsi qu’en plus des cousines Dorothée et Florence, Martin fit la connaissance de deux professeurs de l’Université – un de latin, l’autre d’anglais – d’un jeune officier de retour des Philippines, camarade de collège de Ruth ; d’un jeune homme appelé Melville, secrétaire privé de Joseph Perkins, directeur de la Compagnie des Trusts de San Francisco ; et enfin d’un banquier de trente-cinq ans, Charles Hapgood, gradué de l’Université de Stanford, membre des Clubs du Nil et de l’Unité, orateur de réunion publique du parti républicain pendant les élections, bref un garçon d’avenir. Parmi les femmes se trouvaient : un peintre portraitiste ; une musicienne professionnelle et une sociologue, célébrité locale à cause de ses établissements de travail dans les quartiers pauvres de San Francisco. Mais les femmes ne comptaient pas pour grand-chose dans le plan de Mme Morse et n’étaient tout au plus que des accessoires indispensables : il fallait bien attirer les hommes d’une façon quelconque.
– Ne vous excitez pas en parlant ! recommanda Ruth avant de commencer les présentations.
Gêné par la crainte de paraître gauche, contracté par son ancienne appréhension de démolir les bibelots, Martin fut d’abord paralysé. Jamais il n’avait été en contact avec des individus aussi remarquables, ni avec autant de monde à la fois et ça l’intimidait. Melville, le secrétaire, l’hypnotisait et il résolut de l’interviewer, à la première occasion. Car, malgré son respect admiratif, il avait trop conscience de sa propre valeur, pour ne pas désirer se mesurer avec ces hommes et ces femmes et découvrir ce qu’ils savaient de plus que lui des livres et de la vie.
Ruth, qui lui jetait de fréquents coups d’œil pour voir la façon dont il s’en tirait, fut surprise et ravie de la désinvolture avec laquelle il causait avec ses cousines. Il ne s’excitait pas, parlait posément et, une fois assis, il ne s’inquiétait plus de la maladresse de ses mouvements. Quant aux cousines, plus tard, en allant se coucher, elles ne surent comment chanter les louanges de Martin, chose qui étonna Ruth car elle les savait intelligentes, brillantes, mais superficielles. Lui d’autre part, qui était autrefois le boute-en-train de tous les bals et des pique-niques du dimanche, avait été spirituel, gai sans vulgarité, comme si toute sa vie s’était passée dans des salons. Il sentait, ce soir, qu’il tenait le succès et une voix lui murmurait à l’oreille que tout allait bien, qu’il pouvait donc rire, faire rire et jouir de l’heure présente.
Un peu plus tard, cependant, l’inquiétude de Ruth parut se justifier. Martin et le professeur Caldwell s’étaient isolés dans un coin et, bien que Martin eût perdu la fâcheuse manie de faire de grands gestes, l’œil critique de Ruth blâma l’ardeur exagérée de sa parole, la flamme par trop ardente de ses yeux, la rougeur de son visage animé. Il manquait de réserve et de sang-froid, et contrastait singulièrement avec le jeune professeur d’anglais, son partenaire.
Mais Martin ne se préoccupait pas des apparences. Il n’avait pas été long à remarquer l’esprit cultivé de l’autre et à apprécier son bagage scientifique. De plus, le professeur Caldwell se différenciait de l’ordinaire conception du professeur anglais. Martin voulait l’amener à parler « métier » et, malgré quelques difficultés au début, il y réussit. Martin ne comprenait pas pourquoi les gens ne veulent pas parler « métier ».
– C’est absurde et ridicule, avait-il déclaré à Ruth la semaine précédente, cette aversion de parler « boutique ». Pourquoi les hommes et les femmes se réunissent-ils, sinon pour échanger ce qu’ils ont de mieux en eux-mêmes ? Et ce qu’ils ont de mieux, c’est ce qui les intéresse, leur spécialité, leur raison de vivre, ce qui les fait réfléchir et rêver. Imaginez M. Butler énonçant des idées sur Verlaine ou l’art dramatique allemand, ou les romans de d’Annunzio ?… Ce serait à mourir d’ennui ! Pour ma part, si je suis absolument obligé d’écouter M. Butler, je préfère l’entendre parler code. C’est ce qu’il connaît le mieux, et la vie est si courte que je veux obtenir de tout être, le meilleur de ce qu’il peut donner.
– Mais, avait objecté Ruth, il existe des sujets d’intérêt général.
– C’est là où vous faites erreur, avait-il poursuivi. En général les individus ont une tendance à singer ceux dont ils reconnaissent la supériorité, qu’ils érigent en modèles. Et qui sont ces modèles ? Les oisifs, les riches oisifs. Ils ne savent rien, généralement, de ce que savent ceux qui travaillent et s’ennuieraient à mourir de les entendre causer de ce qui les occupe ; aussi décrètent-ils que ce genre de conversation c’est parler métier, ou mieux encore boutique et que parler « boutique » est mauvais genre. Les oisifs décident également des choses qui ne sont pas « boutique » et dont on peut parler : le dernier opéra, le livre du jour, le jeu, le billard, les cocktails, les voitures, les réunions hippiques, la pêche à la truite, les chasses au grand fauve, le yachting, etc., car, notez bien, ces sujets-là, les oisifs les connaissent. En somme, c’est leur façon, à eux, de parler boutique. Et, ce qu’il y a de plus drôle, c’est que beaucoup de gens intelligents, et tous ceux qui font semblant de l’être, permettent aux oisifs de leur imposer la loi. Quant à moi, je veux d’un homme ce qu’il a de mieux en lui, appelez ça « boutique », métier, ou ce que vous voudrez.
Et Ruth n’avait pas compris. Cette attaque contre les valeurs établies lui avait paru très arbitraire.
Donc, Martin, communiquant au professeur Caldwell un peu de sa propre intensité, l’avait forcé à exprimer ses idées. En passant près d’eux, Ruth entendit Martin qui disait :
– Sûrement, vous ne professez pas de telles hérésies à l’Université californienne ?
Le professeur Caldwell haussa les épaules.
– La fable de l’honnête contribuable et du politicien, vous comprenez ! Sacramento distribue les emplois et c’est pourquoi nous donnons notre approbation à Sacramento, où le Conseil d’administration des Régents tient la presse de notre parti, ou même la presse des deux partis.
– C’est clair ; mais vous-même ? insista Martin. Vous devez être comme un poisson sur le sable ?
– Il y en a peu de mon espèce, dans la mare universitaire. Évidemment, quelquefois, je me sens dépaysé, je sens que je serais mieux à Paris, ou dans Grub Street, ou dans une grotte d’ermite, où parmi la bohème la plus échevelée, dans un restaurant bon marché du Quartier Latin, à vociférer des opinions radicales, devant un auditoire tumultueux. Je crois vraiment que j’étais fait pour être radical. Mais voilà… il y a trop de questions dont je ne suis pas certain. Je deviens timide lorsque je me trouve en face de ma chétive personnalité, qui m’empêche de saisir tous les facteurs d’un problème, des grands problèmes humains, vitaux.
Et tandis qu’il parlait encore, Martin s’aperçut qu’il avait sur les lèvres la « Chanson des vents alizés » :
I am strongest at noon
But under the moon
I stiffen the bunt of the sail.
« Je suis le plus fort à midi, mais c’est sous la lune que je tends la toile. »
Il en chantonna les paroles presque à mi-voix et se rendit compte que l’autre lui rappelait ces vents alizés du nord-est, frais, continus et puissants. Il était impartial, on pouvait compter sur lui et il avait en lui une sorte de réserve qui en imposait. Martin eut l’impression qu’il ne révélait jamais sa pensée entière, comme il avait souvent eu l’impression que les alizés ne soufflent jamais tout ce qu’ils peuvent, mais gardent toujours des réserves de forces inemployées. Le pouvoir imaginatif de Martin était aussi puissant que jamais. Quoi qu’il arrive, il se présentait à son cerveau des associations d’antithèses ou de similitudes qui s’exprimaient presque toujours en visions, d’une façon automatique. De même que le visage de Ruth jalouse lui avait rappelé une bourrasque polaire au clair de lune, de même le professeur Caldwell lui fit revoir les vents alizés fouettant la blanche écume des vagues d’une mer pourprée. De même, à tous moments, évoquées par un mot, une phrase, de nouvelles visions lui apparaissaient, sans pour cela rompre le fil de ses sensations actuelles, en les classant au contraire, en les identifiant avec les actions ou les faits du passé.
Tout en écoutant l’élocution élégante du professeur, sa conversation d’homme intelligent, lettré, Martin continuait à se voir dans le passé. Il se vit jeune, coiffé d’un Stetson rejeté en arrière, en pardessus court, large des épaules, se dandinant légèrement, conscient de représenter le plus parfait type du « dur ». Il ne chercha pas à pallier le fait ni à l’excuser. À une certaine époque de sa vie, il n’avait été qu’un vaurien quelconque, chef d’une bande qui mettait la police sur les dents et terrorisait les honnêtes ménagères.
Son idéal avait changé depuis… Il embrassa d’un coup d’œil l’assemblée élégante, bien élevée, respira profondément cette atmosphère raffinée et vit en même temps le spectre de son adolescence, traverser le salon, en se dandinant, et venir causer avec le professeur Caldwell.
Après tout, il n’avait pas trouvé jusqu’à présent d’endroit où se fixer définitivement. Il s’était adapté partout, avait plu partout et à tout le monde à cause de sa facilité au travail et au jeu, de sa volonté de faire valoir ses droits qui commandait le respect. Mais jamais il n’avait pris racine. Il s’était adapté suffisamment pour satisfaire les autres, mais non pour se satisfaire lui-même. Partout, un sentiment d’inquiétude l’avait poursuivi, partout une voix l’avait appelé ailleurs et il avait erré à travers la vie, mécontent, jusqu’au jour où il avait trouvé les livres, l’art et l’amour. Et voici qu’il était là, au milieu de ce salon, le seul de ses camarades d’antan qui ait su se rendre digne d’être reçu chez les Morse.
Toutes ces réflexions ne l’empêchaient pas de suivre attentivement la parole du professeur Caldwell et de remarquer le vaste champ de ses connaissances. De temps en temps, il découvrait, au cours de la conversation, d’énormes lacunes dans son instruction, des sujets entiers qui lui étaient étrangers. Pourtant, il vit qu’il possédait, grâce à Spencer, les contours des connaissances générales ; remplir ces contours n’était qu’une question de temps. Donc, attention ! se dit-il. Tout le monde sur le pont ! Il eut le sentiment d’être assis attentif et adorant aux pieds du professeur ; puis soudain, il crut discerner un point faible dans les jugements énoncés, mais fugaces, à peine perceptibles. Il en conclut aussitôt à leur égalité intellectuelle.
Ruth revint dans leurs parages, juste au moment où Martin se mit à parler.
– Je vais vous dire où vous avez tort, ou plutôt, le point faible de votre jugement, dit-il. Vous n’avez pas étudié la biologie. Elle n’occupe aucune place dans votre vision des choses. Oh ! je veux parler de la véritable biologie explicative, fondamentale, depuis le laboratoire et les tubes d’épreuves, jusqu’aux généralisations sociologiques et esthétiques les plus échevelées.
Ruth était confondue. Elle avait assisté au cours du professeur Caldwell et le considérait comme l’authentique réceptacle de la science.
– Je ne vous suis pas bien, dit-il d’un air indécis.
Martin se demanda s’il l’avait même jamais suivi.
– Je vais tâcher de me faire comprendre, dit-il. Je me rappelle avoir lu dans l’histoire d’Égypte, qu’il était impossible de comprendre l’art égyptien sans avoir d’abord étudié le pays.
– Parfaitement, dit le professeur.
– Et il me semble, continua Martin, que d’autre part, la connaissance d’un pays ne peut s’acquérir sans celle de la constitution même de la vie dans ce pays. Comment pouvons-nous comprendre les lois et les institutions, la religion et les mœurs, sans avoir compris d’abord non seulement la nature de ceux qui les ont faites, mais la composition de cette nature ? La littérature est-elle moins humaine que l’architecture ou la sculpture égyptienne ? Y a-t-il une seule chose dans tout l’univers qui ne soit soumise aux lois de l’évolution ? Oh ! je sais qu’il existe une théorie compliquée sur l’évolution dans l’art, mais elle me semble trop mécanique. De l’évolution humaine, on n’en parle pas. L’évolution de l’instrument, de la musique, de la danse et du chant est admirablement comprise et décrite ; mais que faites-vous de l’évolution de l’homme, du développement de l’être intrinsèque, avant d’avoir fabriqué son premier outil et balbutié son premier chant ? Ça vous intéresse peu, c’est ce que j’appelle la biologie. C’est de la biologie sous son aspect le plus élevé.
« Je sais que je m’exprime d’une façon incohérente, mais j’essaye de vous exposer mes idées comme je peux. Elles me sont venues pendant que vous parliez. Vous avez dit vous-même que la fragilité humaine empêche de prendre en considération tous les facteurs. Mais vous laissez de côté le plus important, le facteur biologique, celui qui a tissé les matières premières de tout art, la trame, la chaîne de toute action humaine et des merveilles qu’elle engendre !
À la stupéfaction de Ruth, Martin ne fut pas immédiatement écrasé et la réponse du professeur lui parut être faite en considération de la jeunesse de Martin. Pendant un bon moment, le professeur Caldwell resta silencieux, jouant avec sa chaîne de montre.
– Savez-vous, dit-il enfin, qu’un jour déjà on m’a fait la même critique ? C’était un très grand savant et un évolutionniste, Joseph Le Conte. Mais il est mort et je pensais ne plus être disséqué ; et vous voilà, vous aussi, avec votre œil inquisiteur ! Sérieusement, d’ailleurs – et ceci est une confession – je crois qu’il y a quelque chose de vrai dans votre critique : beaucoup de vrai, même. Je suis trop classique, en ce qui concerne l’interprétation des branches diverses de la science et je ne peux que plaider l’insuffisance de mon éducation et une indolence naturelle qui m’a empêchée d’approfondir le sujet comme j’aurais dû le faire. Figurez-vous que je n’ai jamais mis les pieds dans un laboratoire de physique ou de chimie. Non, jamais. Le Conte avait raison, et vous aussi, monsieur Eden, jusqu’à un certain point, en tout cas.
Sous un prétexte quelconque, Ruth emmena Martin et, une fois à l’écart, elle lui dit tout bas :
– Vous n’auriez pas dû monopoliser ainsi le professeur Caldwell. D’autres gens que vous ont envie de discuter avec lui.
– Pardon ! répondit Martin, confus. Mais je l’ai forcé à s’extérioriser un peu et il était si intéressant que je n’ai pas réfléchi. Vous savez, c’est l’homme le plus brillant, le plus intelligent que j’aie rencontré. Et je vais vous avouer autre chose : j’ai cru autrefois que tous ceux qui sortaient des Universités ou qui occupaient de hautes situations dans la société, étaient aussi brillants et aussi intelligents que lui !
– Il est une exception, dit-elle.
– Je m’en suis aperçu. Avec qui voulez-vous que je discute, à présent ? Tenez, confrontez-moi avec ce jeune caissier.
Martin et lui bavardèrent un quart d’heure et Ruth n’eut rien à reprendre aux manières de son amoureux. Ses yeux ne jetèrent aucun éclair, son visage resta calme et elle fut surprise de la tenue parfaite de son langage. Mais dans l’estime de Martin, la corporation entière des caissiers tomba et tout le reste de la soirée il resta sous l’impression que caissiers et diseurs de platitudes étaient synonymes. Il trouva l’officier bon enfant, simple et sain, content d’occuper dans la vie une place que sa naissance et la chance lui avaient conférée. En apprenant qu’il avait passé deux ans à l’Université, Martin fut très intrigué de savoir où il avait bien pu cacher ce qu’il y avait appris. Cependant il le préféra au banal et plat caissier.
– Vraiment les platitudes me sont égales, dit-il plus tard à Ruth. Mais ce qui m’exaspère, c’est la prétention pompeuse, la conviction profonde avec lesquelles on les émet et le temps qu’on prend pour ça. Enfin ! mais j’aurais pu apprendre à cet individu toute l’histoire de la Réforme, pendant qu’il me racontait comment le parti de l’Union des Travaillistes s’était fondu avec les Démocrates. Il pèse ses mots avec autant de soin qu’un joueur de poker professionnel choisit les cartes qu’il doit abattre. Un jour je vous imiterai sa façon de faire.
– Je regrette qu’il ne vous plaise pas, répondit Ruth. M. Butler l’estime beaucoup. M. Butler dit qu’il est honnête, de tout repos, l’appelle le Roc et dit qu’on pourrait édifier avec lui n’importe quel établissement de banque.
– Je n’en doute pas, bien que je l’aie peu vu et que je l’aie encore moins entendu ; mais les banques ont un peu baissé dans mon estime. Vous ne m’en voulez pas de vous parler aussi franchement, chérie ?
– Non, non… c’est très intéressant.
– N’est-ce pas ! continua Martin gaiement. Je ne suis qu’un barbare, pour la première fois en contact avec la civilisation. Des impressions aussi neuves doivent paraître très amusantes aux gens civilisés.
– Que pensez-vous de mes cousines ? demanda Ruth.
– Je les préfère aux autres femmes. Elles sont drôles et sans prétention.
– Mais les autres femmes vous plaisent aussi ?
Il secoua la tête.
– Cette femme aux établissements ouvriers n’est qu’un perroquet sociologue. Je parie que si on l’examinait par transparence, on ne lui trouverait pas une seule idée originale. Quant à la femme peintre, elle est mortellement ennuyeuse et ferait une épouse parfaite pour le caissier. Et la musicienne ! ça m’est bien égal qu’elle ait des doigts extraordinaires, que sa technique soit parfaite et son jeu admirable ! Ce qui est certain, c’est qu’elle ne connaît rien à la musique.
– Elle joue magnifiquement, protesta Ruth.
– Oui, sa gymnastique musicale est parfaite ; mais je lui ai demandé ce que la musique signifiait pour elle – vous savez que je suis curieux de ce genre de choses – et elle n’en sait rien, excepté qu’elle adore la musique, que c’est le plus grand des arts et qu’elle ne vit que pour ça.
– Vous les avez toutes forcées à parler « boutique » !
– Je l’avoue. Et si elles n’ont pas réussi à m’intéresser, imaginez ce qu’auraient été mes souffrances si elles avaient parlé d’autre chose ! Voyez-vous, je croyais autrefois qu’ici, dans ce milieu où l’on jouit de tous les avantages de la culture… (Il s’arrêta un instant et revit le spectre de ses jeunes années entrer et traverser le salon en se dandinant.) Oui, je vous disais : je croyais que tous les hommes rayonnaient d’intelligence. Mais au contraire, je suis frappé de voir que ceux qui ne sont pas complètement nuls sont assommants. Évidemment il y a le professeur Caldwell, qui est différent. C’est un homme, et la moindre parcelle de sa matière grise est intelligente.
Le visage de Ruth s’éclaira.
– Parlez-moi de lui, dit-elle. Non pas de sa largeur d’idées ni de son brillant – je connais ses qualités – mais au contraire de ce que vous critiquez en lui. Je suis curieuse de le savoir.
– Je vais me faire honnir, sans doute ! déclara Martin gaiement. Si vous parliez d’abord ? Mais peut-être le trouvez-vous parfait en tout ?
– J’ai suivi deux de ses cours et je le connais depuis deux ans ; c’est donc votre première impression que je veux connaître.
– Une mauvaise impression, voulez-vous dire ! Eh bien ! voilà. Toutes les belles choses que vous pensez de lui sont exactes, je crois ; en tout cas, c’est le plus beau spécimen d’intellectuel que j’aie jamais rencontré. Mais il est miné par un secret remords. Oh ! non, rien de vulgaire ni de bas ! C’est un homme, je crois, qui, étant allé jusqu’au fond des choses, a eu si peur de ce qu’il y a vu, qu’il veut se persuader qu’il ne les a pas vues. Voici une autre explication, car celle-ci n’est peut-être pas très claire. Un homme a découvert le chemin qui conduit au temple mystérieux et il n’a pas pris ce chemin ; il a peut-être aperçu le fronton rayonnant et tâche de se convaincre qu’un mirage l’a trompé. Voulez-vous encore une autre explication ? Un homme aurait pu accomplir de belles choses, mais il ne leur a pas accordé d’importance et depuis, dans le plus profond de son cœur, il regrette de ne pas les avoir faites ; lui qui s’était moqué des récompenses possibles, il les pleure amèrement, ces récompenses, et pleure aussi de s’être frustré de la joie de l’action.
– Je ne le vois pas du tout de cette façon, dit-elle. Et d’ailleurs je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire.
– Ce n’est qu’une vague impression qui ne repose sur rien, atténua Martin. C’est une impression seulement – peut-être fausse. Vous le connaissez sûrement mieux que moi.
Martin remporta de cette soirée chez les Morse, une impression confuse de sentiments opposés. Le milieu, les sommets auxquels il avait aspiré, les gens dont il avait rêvé devenir l’égal le désappointaient. D’un autre côté, son succès l’encourageait. L’ascension avait été plus facile qu’il ne croyait et, d’ailleurs – il dut se l’avouer sans fausse modestie – il dominait le but qu’il s’était proposé : il se sentait supérieur à ces gens-là, exception faite toutefois du professeur Caldwell. Il en savait plus qu’eux, de la vie et des livres et il se demanda encore à quoi leur servait leur éducation. Ce qu’il ignorait, c’est qu’il était doué d’une puissance cérébrale extraordinaire, que les gens remarquables ne se rencontraient pas dans les salons de la catégorie de celui des Morse ; et il était loin de se douter que les êtres remarquables sont semblables aux grands aigles solitaires qui planent très haut dans l’azur, au-dessus de la terre et de sa banalité moutonnière.
28
Mais le succès, encore une fois, délaissait Martin ; aucun de ses messagers ne venait plus frapper à sa porte. Durant vingt-cinq jours, dimanches et fêtes compris, il travailla La Honte du soleil, long essai d’environ 30 000 mots, où il attaquait délibérément le mysticisme de l’école de Maeterlinck. Il se plaçait au point de vue de la science positive, contre les chasseurs de chimères, mais en admettant cependant tout l’idéal, tout le rêve compatibles avec les faits prouvés. Un peu plus tard, il continua ces attaques avec deux courts essais : Les Chasseurs de chimères et La Mesure du moi. Et les voyages aller et retour, de revue en revue, recommencèrent.
Pendant les vingt-cinq jours passés sur La Honte du soleil, il vendit quelques bêtises journalistiques pour la somme de six dollars cinquante. Un bout-rimé lui rapporta cinquante cents, un autre un dollar. Deux poèmes humoristiques lui valurent respectivement deux et trois dollars. Puis, ayant épuisé son crédit chez les fournisseurs – bien qu’il l’eût fait monter jusqu’à cinq dollars chez l’épicier – la bicyclette et le complet retournèrent au Mont-de-Piété. L’agence de machines à écrire recommença ses réclamations, insistant sur cette clause du contrat, que la location était payable d’avance.
Encouragé par ces petits profits, Martin continua le « gros ouvrage ». Peut-être était-ce un gagne-pain, après tout ! Les vingt nouvelles refusées par le syndicat des nouvellistes, gisaient sous la table. Il les relut, afin de voir comment il ne fallait pas écrire et découvrit ainsi la formule parfaite. Une nouvelle pour les journaux ne doit jamais avoir une fin malheureuse, ne doit jamais contenir aucune beauté de style, aucune pensée subtile, aucune véritable délicatesse de sentiment. Cependant, elle doit être remplie de beaux et nobles sentiments – de ceux qu’il applaudissait, tout jeune, du haut du poulailler –, de l’acabit du « Pour Dieu, pour la Patrie, pour le Tsar » et de « Je suis pauvre, mais honnête ».
Ainsi prévenu, Martin consulta La Duchesse comme diapason et se mit au travail selon la formule. Cette formule consistait en trois parties :
1° Un couple d’amoureux sont arrachés l’un à l’autre ;
2° Un événement quelconque les réunit ;
3° Mariage.
Les deux premières parties pouvaient se varier à l’infini, mais la troisième était immuable. Ainsi, le couple amoureux pouvait être séparé : 1° par erreur ; 2° par la fatalité ; 3° par des rivaux jaloux ; 4° par de cruels parents ; 5° par des tuteurs rusés ; 6° par des voisins cupides, etc., etc. Ils pouvaient être réunis : 1° par une bonne action de l’amoureux ou de l’amoureuse ; 2° par un changement de sentiment de l’un ou de l’autre ; 3° par la confession volontaire ou forcée du tuteur rusé, du voisin cupide ou du rival jaloux ; 4° par la découverte d’un secret ; 5° par la prise d’assaut du cœur de la jeune fille ; 6° par une abnégation sublime du jeune homme, et ainsi de suite à l’infini. Il était très amusant d’amener la jeune fille à déclarer son amour la première et Martin découvrit petit à petit d’autres trucs piquants et ingénieux. Mais le ciel pouvait s’ouvrir et la foudre tomber, le mariage final devait se célébrer dans tous les cas.
La formule prescrivait 1 200 mots au minimum et 1 500 au maximum.
Avant d’être allé très loin dans cet art, Martin se fit une demi-douzaine de schémas, qu’il consultait toujours avant d’écrire une nouvelle. Ces schémas étaient semblables à ces ingénieuses tables employées par les mathématiciens, qui peuvent se consulter par le haut, le bas, la droite, la gauche, au moyen d’une quantité de lignes et de colonnes, et dont on peut tirer, sans raisonnement et sans calcul, des milliers de conclusions différentes, toutes invariablement précises et exactes. De cette manière, Martin pouvait, à l’aide de ses schémas, en l’espace d’une demi-heure, faire une douzaine de nouvelles, qu’il mettait de côté et développait ensuite à son gré. Après une journée de travail sérieux il en faisait facilement une avant de se coucher. Il avoua même à Ruth plus tard qu’il les écrivait presque en dormant. La construction des schémas seule, exigeait une certaine application d’ailleurs purement mécanique.
Il ne doutait pas de l’excellence de sa formule et comprit enfin la mentalité des éditeurs le jour où il paria, en lui-même, que les deux premières nouvelles envoyées seraient acceptées. Au bout de douze jours on les lui paya quatre dollars chacune.
Dans l’intervalle il faisait d’alarmantes découvertes concernant les magazines. Bien que Le Transcontinental eût publié « l’Appel des cloches », il n’avait envoyé aucun chèque et comme Martin en avait besoin, il le réclama. Une réponse évasive lui parvint, avec une demande d’autres nouvelles. En attendant cette réponse, pendant deux jours, il n’avait pas mangé et avait de nouveau engagé sa bicyclette. Deux fois par semaine, régulièrement, il écrivit au Transcontinental, réclamant ses cinq dollars. De temps en temps, on lui répondait. Il ignorait que le Transcontinental végétait depuis quelques années déjà, et que ce n’était qu’une revue de dixième ordre, sans base solide, dont le tirage reposait en partie sur de petits chantages, en partie sur des appels patriotiques, et dont la publicité consistait surtout en donations charitables. Il ignorait également que Le Transcontinental était l’unique gagne-pain du rédacteur et du gérant qui ne pouvaient se tirer d’affaire qu’en ne payant ni leur loyer ni aucune autre facture. Il ne pouvait deviner non plus que les cinq dollars qui lui revenaient avaient été employés par le gérant à repeindre sa maison à Alameda, œuvre d’art qu’il accomplissait lui-même le dimanche parce qu’il lui manquait de quoi payer un peintre, et aussi parce que le barbouilleur qu’il avait convoqué, s’étant laissé choir du haut de son échelle, s’était cassé la clavicule.
Les dix dollars des Chasseurs de chimères vendus au journal de Chicago, ne vinrent pas non plus. L’article avait été publié, ainsi qu’il s’en convainquit à la salle de lecture Centrale, mais l’éditeur demeura sourd à toute réclamation. Ses lettres furent ignorées, simplement, bien que plusieurs fussent recommandées. C’était du vol, ni plus ni moins, conclut-il, un vol cynique. Pendant qu’il mourait de faim, on lui volait sa marchandise, dont la vente constituait son unique gagne-pain.
Youth and Age était une revue hebdomadaire ; à peine eut-elle publié les deux tiers de sa série de 21 000 mots, qu’elle fit faillite et avec elle s’évanouit son espoir de toucher ses seize dollars.
Pour comble de malheur La Marmite, qu’il jugeait une de ses meilleures œuvres, se perdit. Désespéré, ne sachant plus où s’adresser, il avait fini par l’envoyer au Billow, hebdomadaire mondain de San Francisco ; comme d’Oakland, il n’y avait que la baie à traverser, la réponse au moins serait rapide. Deux semaines plus tard, il bondit de joie, en voyant, dans le dernier numéro paru, son histoire en entier, illustrée, et à la place d’honneur. Il rentra, ravi, en se demandant combien on lui donnerait de son œuvre la meilleure. La promptitude avec laquelle on l’avait publiée était de bon augure. Que l’éditeur ne l’en ait pas informé, rendait sa surprise plus complète encore. Après avoir attendu huit jours, l’impatience l’emporta sur la timidité et il écrivit à l’éditeur du Billow que, sans doute par erreur, on avait négligé de régler son petit compte.
– Même si ce n’est que cinq dollars, se dit Martin, les haricots et les pois cassés que je pourrai m’acheter, me permettront d’en écrire une demi-douzaine d’autres, peut-être aussi bonnes.
La lettre que l’éditeur lui écrivit provoqua, par son froid cynisme, l’admiration de Martin.
« Nous vous remercions, disait-il, de votre excellente collaboration. Votre article nous a beaucoup plu, et, comme vous voyez, nous lui avons donné la place d’honneur et l’avons publié immédiatement. Nous espérons que les illustrations sont à votre goût. En relisant votre lettre, il nous semble qu’il y a un malentendu dans votre façon de comprendre les usages de notre journal. Nous n’avons pas l’habitude de payer les manuscrits que nous n’avons pas sollicités et tel est le cas pour le vôtre. Nous pensions, bien entendu, que vous étiez au courant de nos principes. Nous regrettons vivement ce fâcheux malentendu. Nous vous remercions encore de votre aimable contribution et, dans l’espoir que vous nous ferez parvenir d’autres articles, nous vous prions », etc., etc.
Dans le post-scriptum il était ajouté que, bien que le Billow ne fasse pas de service gratuit, il se ferait un plaisir de l’abonner gratuitement pour l’année suivante.
Instruit par cette expérience, Martin ne manqua plus d’imprimer sur la première feuille de chacun de ces manuscrits : « Accepté au tarif habituel. »
– Un beau jour, se dit-il pour se consoler, c’est mon tarif habituel qu’ils accepteront.
Pendant cette période, une rage de perfection l’amena à remanier et à polir La Bousculade, Le Vin de la vie, La Joie, Les Poèmes de la mer et d’autres œuvres plus anciennes. Comme autrefois, dix-neuf heures par jour ne lui suffisaient pas. Il écrivait prodigieusement, lisait prodigieusement, oubliant dans le travail les souffrances causées par la privation de cigarettes. La drogue désintoxiquante de Ruth, ornée d’une étiquette luxueuse, fut rangée dans le coin le plus inaccessible de son bureau. C’était pendant ses périodes de famine qu’il souffrait surtout du manque de tabac ; mais il tenait bon quand même, tout en se disant que ce qu’il accomplissait là, était bien l’acte le plus héroïque de sa vie. Quant à Ruth, elle trouvait qu’il ne faisait que son devoir. Elle lui acheta, sur son argent de poche, le remède et n’y pensa plus au bout de quelques jours.
Ses nouvelles faites à la chaîne, bien qu’il les méprisât avaient du succès. Grâce à elles il put payer ses dettes et acheter des pneus neufs à sa bicyclette. Les nouvelles faisaient bouillir la marmite, tout en lui laissant le temps de travailler sérieusement et les quarante dollars qu’il avait reçus de la White Mouse entretenaient son espoir. Toute sa confiance gisait là-dedans et il était convaincu qu’une revue véritablement de premier ordre payerait à un auteur inconnu le même prix, sinon plus. Mais comment se faire agréer par une revue de premier ordre ? Ses meilleures nouvelles, ses poèmes, continuaient leurs pérégrinations et tous les mois il lisait des monceaux de prose ennuyeuse, plate et mal écrite sous des couvertures diverses. Si seulement un seul de ces éditeurs, se disait-il quelquefois, voulait bien descendre de son piédestal, pour m’écrire une seule ligne encourageante ! Même si ma littérature est étrange, même si elle ne cadre pas avec le genre du journal, sûrement elle doit avoir, tout de même, une qualité quelconque, elle doit posséder une petite étincelle qui devrait leur arracher une appréciation ! Et là-dessus, il déterrait l’un ou l’autre de ses manuscrits, son Aventure par exemple, le relisait sévèrement, cherchant à tout prix à expliquer le silence éditorial.
Vint le doux printemps californien, et avec lui reparurent les pires jours de détresse. Depuis plusieurs semaines déjà, l’étrange silence du syndicat des nouvellistes l’avait inquiété. Et un beau jour, le facteur lui rapporta dix de ses plus impeccables nouvelles. Une courte lettre les accompagnait, disant que le syndicat était submergé de manuscrits pour quelques mois. Martin comptait tant sur ces nouvelles ! Vers la fin, on les lui acceptait toutes, les payant jusqu’à cinq dollars pièce. Il considérait donc ces dix-là comme vendues et vivait en conséquence, sur un pied de cinquante dollars en banque. Les jours maigres réapparurent brusquement, il continua de vendre ses premiers ouvrages à des publications qui ne payaient pas et de soumettre ses dernières œuvres à des revues qui n’achetaient pas. Ses promenades au Mont-de-Piété d’Oakland recommencèrent. Quelques bouts-rimés et plusieurs poèmes humoristiques publiés dans des hebdomadaires de New York parvenaient à le faire vivre misérablement. Ce fut à cette époque qu’il écrivit à plusieurs publications mensuelles et hebdomadaires pour avoir quelques renseignements ; on lui apprit que les articles non sollicités étaient rarement acceptés et que la plupart étaient demandés à des spécialistes connus, qui faisaient autorité en ces matières.
29
L’été fut dur pour Martin. Éditeurs et lecteurs de manuscrits étaient en vacances et les réponses qui prenaient ordinairement trois semaines à lui parvenir, mettaient à présent trois mois. Il se consola en constatant que la morte-saison lui économiserait des timbres. Seuls, les pilleurs d’articles continuaient activement leurs affaires et les premières œuvres de Martin, telles que Pêcheurs de perles, La Carrière de marin, La Chasse à la tortue et Les Vents alizés du Nord-Est, furent publiés par leurs soins intéressés. Il n’en reçut jamais un sou. Il est vrai qu’après six mois de correspondance, on lui envoya un rasoir pour sa Chasse à la tortue et que la revue Acropolis, décidée à lui payer cinq dollars comptant et cinq années d’abonnement gratuit, se borna à remplir la seconde moitié de cet engagement.
Pour un sonnet sur Stevenson, il extorqua deux dollars à un éditeur de Boston qui publiait une revue dans le goût de Matthew Arnold, mais sans aucun capital. La Péri et la perle, adroit poème de deux cents vers, à peine sorti de son cerveau, séduisit un éditeur de San Francisco dont la revue était commanditée par une grande compagnie de chemins de fer et qui lui en proposa le paiement en voyages gratuits. Martin demanda si ces voyages étaient remboursables, mais comme ils ne l’étaient pas, il réclama son poème. On le lui renvoya avec les regrets de l’éditeur et Martin le réexpédia à San Francisco, cette fois au Hornet, prétentieuse revue mensuelle qui eut un moment de vogue du temps du brillant journaliste qui l’avait fondée. Mais son étoile avait pâli longtemps avant la naissance de Martin. L’éditeur lui promit quinze dollars pour son poème, mais une fois publié, il s’empressa d’oublier l’engagement pris. Plusieurs de ses lettres étant restées sans réponse, Martin en écrivit une plus corsée, à laquelle on répondit. C’était un nouvel éditeur, qui l’informait froidement qu’il déclinait toutes responsabilités des erreurs de son prédécesseur et que, d’ailleurs, personnellement il n’appréciait pas énormément La Péri et la perle.
Mais ce fut Le Globe, revue de Chicago, qui traita Martin le plus cruellement. Il ne s’était résolu à y envoyer ses Poèmes de la mer, que poussé par la faim. C’était une série de trente poèmes et on devait les lui payer un dollar pièce. Le premier mois on en publia quatre et il reçut aussitôt un chèque de quatre dollars. Mais en les lisant dans la revue, la façon dont on les avait saccagés le consterna. Les titres eux-mêmes avaient été altérés. Finis, par exemple, avait été changé en La Fin, et La Chanson du dernier récif en La Chanson du banc de corail. On avait été jusqu’à substituer un titre absolument différent, incompréhensible, au titre indiqué. À la place des Méduses irisées était imprimé : Le Sentier du retour. Et ce n’était pas tout : les vers eux-mêmes étaient méconnaissables. Martin jura en s’arrachant les cheveux, de rage et de désespoir. Des phrases, des lignes, des stances entières étaient coupées, interchangées, maquillées de façon incompréhensible. Parfois même on y avait glissé des vers qui n’étaient pas de lui. Il ne pouvait croire qu’un éditeur, en possession de sa raison, ait pu être coupable d’une pareille insanité et se dit, comme toujours, que ses poèmes avaient dû être malmenés par un garçon de bureau ou le sténographe. Et il écrivit immédiatement à l’éditeur pour le prier de cesser la publication de ses poèmes et de les lui renvoyer. Il écrivit lettre sur lettre, priant, suppliant, menaçant – vainement. Tous les mois, le massacre continua jusqu’à ce que les trente poèmes aient disparu – et tous les mois, il recevait un chèque pour celui qui venait de paraître. En dépit de ces mésaventures variées, le souvenir du chèque de quarante dollars de la White Mouse le soutenait, bien qu’il en fût réduit de plus en plus au « gros ouvrage ». Il découvrit de quoi manger dans des journaux hebdomadaires d’agriculture et dans des revues professionnelles, mais en revanche les périodiques religieux l’auraient laissé mourir de faim. Au moment le plus critique, quand son complet noir était au Mont-de-Piété, il fit un coup de maître, dans un concours organisé par le comité local du parti républicain. Il fallait concourir dans trois épreuves distinctes et il les gagna toutes les trois, en riant amèrement d’en être arrivé là pour vivre. Son poème eut le premier prix de dix dollars, sa chanson de route le second de cinq dollars, son essai sur les principes du parti républicain le premier prix de vingt-cinq dollars, ce qui lui fit grand plaisir, jusqu’au moment où il essaya de les toucher. Quelque chose ne marchait pas au comité local et, bien qu’un riche banquier et un sénateur en fussent membres, l’argent ne rentrait pas. Tandis que cette affaire traînait en longueur, il prouva qu’il comprenait les principes du parti démocrate en gagnant le premier prix dans un concours semblable. Cette fois, il reçut l’argent, vingt-cinq dollars. Mais, des quarante dollars du premier concours, il n’en entendit plus parler.
Réduit à employer des stratagèmes pour voir Ruth et, ayant reconnu que d’aller à pied chez elle et d’en revenir, lui prenait trop de temps, il laissa son complet noir au Mont-de-Piété et garda sa bicyclette. De cette façon, il faisait de l’exercice, gagnait du temps pour travailler et pouvait aussi voir Ruth. Un pantalon de golf et un vieux chandail lui faisaient une tenue de cycliste assez convenable pour aller se promener avec Ruth, l’après-midi. D’ailleurs il n’avait guère l’occasion de la voir beaucoup chez elle, où Mme Morse poursuivait systématiquement sa campagne d’encerclement. Les gens supérieurs qu’il rencontrait, loin de continuer à être pour lui des sujets d’admiration, l’ennuyaient. Leur soi-disant supériorité ne l’impressionnait plus. Ses tracas, ses déceptions, son travail acharné le rendaient nerveux, irritable et la conversation de ces gens l’exaspérait. Il comparait aujourd’hui leur étroitesse d’esprit à l’envolée des penseurs dont il lisait les œuvres. Jamais, chez Ruth, il n’avait rencontré un être remarquable, à part le professeur Caldwell qu’il n’y avait vu qu’une fois. Les autres étaient des nullités – superficiels, dogmatiques, ignorants. Leur ignorance surtout le stupéfiait. En quoi leur éducation leur avait-elle profité ? Ils avaient puisé aux mêmes sources que lui. Comment faisaient-ils pour qu’on ne s’en aperçût pas ?…
Les plus grands esprits, les penseurs profonds et rationnels existaient, il le savait ; leurs livres le lui avaient appris, ces livres qui lui avaient fait dépasser le niveau des Morse. Il savait aussi que des intelligences plus hautes évoluaient dans d’autres milieux que celui des Morse. Dans des romans mondains anglais, il était question de femmes et d’hommes qui parlaient politique et philosophie et il avait entendu dire aussi que dans certains salons des grandes villes, aux États-Unis même, l’art et l’intellectualité fusionnaient. Autrefois, il s’imaginait naïvement que tout ce qui n’appartenait pas à la classe ouvrière, tous les gens bien mis avaient une intelligence supérieure et le goût de la beauté ; la culture et l’élégance lui semblaient devoir marcher forcément de pair et il avait commis l’erreur insigne de confondre éducation avec intelligence.
Eh bien ! il monterait plus haut encore ! Et il emmènerait Ruth avec lui, cette Ruth qu’il aimait tant et qui brillerait partout, il en était convaincu ; mais il était également convaincu qu’elle avait été handicapée par son milieu, comme il l’avait été par le sien. Elle n’avait pas eu l’occasion de se développer. Les livres dans la bibliothèque de son père, les tableaux du salon et même son piano, tout n’était chez eux qu’étalage et vanité. Les Morse et leurs semblables étaient sourds et aveugles à toute vraie littérature, toute vraie peinture, toute vraie musique. Et par-dessus tout, ils étaient ignorants de la vie, profondément, désespérément ignorants. En dépit de leurs dispositions unitaires et de leur apparence compréhensive, ils étaient de deux générations en retard en ce qui concerne la science interprétative : leur processus mental était moyenâgeux et leur opinion des grands problèmes de l’existence et de l’Univers lui semblait dater de l’âge des cavernes et de plus loin encore.
Telles étaient les réflexions de Martin. Il en vint à se demander si l’écart qui existait entre les travailleurs de son ancien milieu et les notaires, les officiers, les hommes d’affaires, les caissiers du milieu qu’il fréquentait à présent, ne se bornait pas uniquement à des différences de nourriture, de vêtements et d’entourage. Évidemment, ils manquaient totalement d’un certain quelque chose qu’il avait, lui, Martin Eden, et que les livres contenaient également. Les Morse lui avaient montré ce que leur position sociale pouvait lui offrir de mieux… et c’était peu. Il n’était qu’un sans le sou, la proie et l’esclave des usuriers et de son travail, mais il se sentait supérieur à tous ces gens ; et, quand son unique complet convenable n’était pas au Mont-de-Piété, il se promenait parmi eux comme un souverain avec le même sentiment d’orgueil blessé que doit avoir un roi en exil parmi les bouviers.
– Vous haïssez les socialistes et vous en avez peur, dit-il un soir à dîner à M. Morse. Mais pourquoi ? Vous ne connaissez ni ces gens ni leur doctrine.
La conversation avait été amenée sur ce sujet par Mme Morse, qui, insidieusement, avait chanté les louanges de M. Hapgood. Le caissier était la bête noire de Martin et il perdait vite patience quand il s’agissait du diseur de platitudes.
– Oui, avait-il déclaré, Charley Hapgood est ce qu’on appelle : un jeune homme d’avenir, paraît-il. Et c’est vrai. Il sera certainement Gouverneur de la Banque avant de mourir et – qui sait ? – peut-être sénateur des États-Unis.
– Qu’est-ce qui vous fait croire ça ? questionna Mme Morse.
– Je l’ai entendu parler dans une réunion publique. Son discours était si merveilleusement stupide, si banal et si convaincant, que les chefs de parti ne peuvent le regarder que comme un homme sûr et de tout repos ; d’autre part, les platitudes qu’il énonce sont si pareilles aux platitudes de tous ceux qui votent que… Mon Dieu ! vous faites toujours plaisir à un monsieur, quand vous lui présentez ses propres opinions, bien décorées, sur un plat d’argent !
– Je crois que vous êtes jaloux de M. Hapgood, taquina Ruth.
– Dieu m’en préserve !
L’expression horrifiée de Martin excita la combativité de Mme Morse.
– Vous ne prétendez pas dire, sûrement, que M. Hapgood est bête ?
– Pas plus bête que la moyenne des républicains, répondit-il, ou que la moyenne des démocrates, d’ailleurs. Ils sont tous idiots, quand ils ne sont pas de fins renards – et très peu d’entre eux le sont, de fins renards. Les seuls républicains avisés, sont les millionnaires et leurs valets conscients. Ceux-là au moins savent de quel côté leur tartine est beurrée et pourquoi.
– Je suis républicain, dit négligemment M. Morse. Dans quelle catégorie me mettez-vous, s’il vous plaît ?
– Oh ! vous êtes un valet inconscient.
– Un valet ?
– Mon Dieu ! oui. Vous travaillez pour votre corporation. Vos clients ne sont ni de la classe ouvrière ni des criminels. Vos revenus ne dépendent ni des cambrioleurs ni des pickpockets. Ce sont les maîtres de la société qui vous payent, et « qui nourrit un homme est son maître ». Oui, vous êtes un valet. Vous ne faites que représenter les intérêts du capitalisme que vous servez.
M. Morse avait légèrement rougi.
– Eh bien ! monsieur, dit-il, vous parlez comme un de ces chenapans de socialistes.
Ce fut alors que Martin fit cette remarque :
– Vous haïssez les socialistes et vous en avez peur ! mais pourquoi ? Vous ne les connaissez pas.
– Votre doctrine, en tout cas, ressemble singulièrement à celle des socialistes, répliqua M. Morse tandis que les regards de Ruth allaient anxieusement de l’un à l’autre et que Mme Morse exultait de cette occasion d’exciter l’antagonisme de son seigneur et maître.
– Ce n’est pas parce que je dis que les républicains sont bêtes et que la liberté, l’égalité ne sont que des bulles de savon, que je suis socialiste, dit en souriant Martin. Ce n’est pas parce que j’interroge Jefferson et le Français ignare qui l’a instruit, que je suis socialiste. Croyez-moi, monsieur Morse, vous êtes bien plus près du socialisme que moi, son ennemi juré.
– Vous plaisantez, fut tout ce que l’autre sut lui répondre.
– Pas du tout. Je parle très sérieusement. Vous croyez encore à l’égalité, mais vous travaillez pour les corporations qui, tous les jours davantage, piétinent l’égalité. Et vous m’appelez socialiste, parce que je nie l’égalité, parce que je dénonce ce pour quoi vous vivez. Les républicains sont les ennemis de l’égalité et en son nom ils la combattent. Voilà pourquoi je les trouve stupides. Quant à moi, je suis individualiste. Je crois que la course est gagnée par le plus rapide, que la vie est au plus fort. Voilà la leçon que m’a apprise la biologie, ou que je crois avoir apprise. Oui, je suis individualiste, et l’individualisme est l’ennemi éternel, héréditaire du socialisme.
– Mais vous fréquentez des meetings socialistes, lança M. Morse.
– Certainement ! exactement comme les espions fréquentent les camps ennemis. Comment sauriez-vous autrement ce qui s’y passe ? Du reste, je m’y amuse. Ce sont de bons lutteurs et, qu’ils aient tort ou raison, ils ont lu leurs auteurs. Le moindre d’entre eux s’y connaît davantage en sociologie, que la grande moyenne des industriels. Oui, j’ai assisté à quelques-uns de leurs meetings ! Mais ça ne m’a pas rendu plus socialiste que d’écouter Charley Hapgood ne m’a rendu républicain.
– Je ne sais pourquoi, dit faiblement M. Morse, mais je crois tout de même que vous inclinez vers le socialisme.
« Dieu me pardonne ! se dit Martin, il n’a pas compris un mot de ce que je lui ai dit. Et lui, qu’a-t-il fait de son instruction ? »
Ce fut ainsi que Martin se trouva face à face avec la morale économique, ou morale des classes ; et bientôt elle lui apparut comme un épouvantail. Personnellement c’était un moraliste intellectuel et la morale de son entourage lui était encore plus désagréable que la platitude pompeuse des raisonneurs. Cette morale était un curieux mélange d’économie politique, de métaphysique, de sensiblerie et d’esprit d’imitation.
Il rencontra un exemple de ces mélanges bizarres dans son entourage le plus immédiat. Sa sœur Marianne avait été courtisée par un jeune mécanicien d’origine allemande, qui, après avoir consciencieusement appris son métier, avait pris à son compte un magasin de réparations de cycles ; comme il représentait aussi une marque – de deuxième ordre – son commerce prospérait. Marianne était venue, quelque temps avant, annoncer ses fiançailles à Martin ; par manière de plaisanterie, elle avait regardé les lignes de sa main et lui avait dit la bonne aventure. À la visite suivante, elle amena Hermann von Schmidt avec elle. Martin fit les honneurs et les félicita tous deux si aimablement et avec tant d’aisance, que le fiancé plutôt rustre en fut aussitôt désagréablement impressionné. Cette mauvaise impression augmenta quand Martin lut les quelques stances qu’il avait faites, en souvenir de la précédente visite de Marianne. C’étaient des vers légers et délicats, qu’il avait intitulé : La Chiromancienne. Il fut surpris, à la fin de sa lecture, de voir que sa sœur, loin de manifester du plaisir, regardait anxieusement son fiancé ; et Martin, suivant la direction de ses yeux, vit que le visage asymétrique du brave garçon reflétait une sombre désapprobation. Il n’y eut aucune explication d’ailleurs ; le couple opéra une prompte retraite et Martin oublia vite cet incident, bien qu’il eût été assez étonné, sur l’instant, qu’une femme, même du peuple, pût être à ce point insensible à des vers faits en son honneur.
Quelques soirs plus tard, Marianne revint le voir, cette fois seule. Elle alla droit au but et le morigéna de ce qu’il avait fait.
– Comment, Marianne ! dit Martin, tu parles comme si tu avais honte de ta famille… de ton frère, en tout cas !
– Bien sûr, j’ai honte ! s’écria-t-elle.
Martin vit avec stupéfaction qu’elle avait des larmes d’humiliation dans les yeux. De toute façon, son chagrin était sincère.
– Mais, Marianne, pourquoi ton Hermann serait-il jaloux parce que j’écris des vers sur ma propre sœur ?
– Il n’est pas jaloux, sanglota-t-elle. Il dit que c’est indécent, ob… obscène !
Martin fit entendre un long sifflement d’incrédulité, puis il alla chercher une copie de La Chiromancienne et la relut.
– Je ne vois pas, dit-il ensuite, en lui tendant le manuscrit Lis-le toi-même et montre-moi ce qui te semble obscène – c’est bien le mot qu’il a employé, n’est-ce pas ?
– C’est ça, et il doit savoir, répondit Marianne, en repoussant le manuscrit d’un air dégoûté. Et il dit qu’il faut que tu le déchires, qu’il ne veut pas d’une femme sur laquelle on a écrit des choses que n’importe qui peut lire. Il dit que c’est une honte et qu’il ne veut pas de ça.
– Écoute, Marianne, tout ça est absurde, commença Martin ; puis il s’arrêta, car il avait changé d’avis. Il vit la pauvre fille malheureuse, se rendit compte de l’inutilité de ses efforts à les convaincre, elle et son fiancé, et résolut de céder, bien qu’il trouvât l’incident absurde et insultant.
– Parfait ! déclara-t-il, en déchirant le manuscrit et en le jetant au panier.
Il lui suffisait de savoir que l’original se trouvait déjà à la rédaction d’une revue de New York. Marianne et son fiancé n’en sauraient jamais rien et, ni eux, ni le monde ne s’en porteraient plus mal si ce joli poème anodin était jamais publié.
Marianne fit un mouvement vers la corbeille à papier, puis se retint.
– Est-ce que je peux ? supplia-t-elle.
Il fit signe que oui, et la regarda d’un air songeur, tandis qu’elle ramassait les bouts de manuscrit et les fourrait dans la poche de sa jaquette, pour prouver le succès de sa démarche. Elle lui rappela Lizzie Connolly, mais pourtant cette fille qu’il avait vue deux fois, était plus vive, plus vibrante. Mais elles étaient semblables toutes deux, comme allure et comme mise et il s’amusa de les imaginer l’une ou l’autre, entrant dans le salon de Mme Morse. Puis son amusement s’éteignit, et il se sentit infiniment seul. Sa sœur et le salon Morse n’étaient que des bornes sur la route où il cheminait. Et il les avait dépassées. Il jeta un coup d’œil amical à ses livres. C’étaient les seuls camarades qui lui restaient.
– Hein ? Quoi ? fit-il en sursautant.
Marianne répéta sa question.
– Pourquoi je ne travaille pas ? (Il eut un rire un peu forcé.) Ton Hermann t’a raconté des bêtises.
Elle secoua la tête.
– Ne mens pas ! dit-il ; (et comme elle se taisait :) Écoute, tu diras à ton Hermann qu’il se mêle de ses affaires. Quand j’écris des vers à la fille qu’il courtise, ça le regarde ; mais en dehors de ça, il n’a rien à me dire. C’est compris ? Alors, tu ne crois pas à mon avenir d’écrivain, dis ? Tu crois que je suis un fainéant ? que je suis perdu et que je suis un déshonneur pour ma famille ?
– Je crois qu’il serait préférable que tu aies un métier, dit-elle avec fermeté. (Il vit qu’elle était profondément convaincue.) Hermann dit…
– Au diable ton Hermann ! interrompit-il gaiement. Ce que je voudrais savoir, c’est quand vous allez vous marier. Tâche de savoir aussi si ton Hermann daignera accepter un cadeau de moi pour votre mariage.
Il réfléchit à cet incident, après le départ de Marianne, et eut un rire amer en pensant à sa sœur et à son fiancé, à tous ceux de sa classe, à tous ceux de la classe de Ruth, dirigeant leur mesquine petite vie selon de mesquines petites formules – fantoches moutonniers, modelant leur existence sur celle du voisin, incapables de vivre réellement la vie, à cause des préjugés enfantins qui les guident. Il les voyait défiler devant lui, processionnellement : Bernard Higginbotham, bras dessus bras dessous avec M. Butler, Hermann von Schmidt avec Charley Hapgood et d’autres, tous par paires ; il les examinait, les jugeait et les renvoyait. En vain il se demandait : où sont les grandes âmes ? Où sont les grands penseurs ? Et parmi la foule d’êtres indifférents, informes, stupides qu’il évoquait, il ne trouvait rien. Un dégoût l’envahit, semblable à celui que Circé dut avoir pour son troupeau de pourceaux.
Quand il eut renvoyé le dernier, quand il se crut seul enfin, un nouveau venu se présenta à l’improviste, sans avoir été appelé. Martin le regarda et vit en face de lui, le chapeau rejeté en arrière, en veston croisé et se dandinant, le jeune voyou qu’il avait été jadis.
– Tu étais comme les autres, mon vieux, ricana Martin. Ta morale et tes connaissances étaient pareilles aux leurs. Tu n’avais aucune personnalité. Tes opinions, comme tes habits étaient tout faits ; tu agissais pour la galerie. Tu étais le coq de la bande parce que les autres t’acclamaient. Tu commandais la bande et tu te battais – non par goût car au fond tu en avais le mépris, mais parce que les autres te tapaient sur l’épaule et te flattaient. Tu as rossé Tête-de-Fromage parce que tu ne voulais pas céder, et tu ne voulais pas céder, d’abord parce que tu étais la dernière des brutes, ensuite parce que tu croyais, comme tous ceux qui t’entouraient, que la virilité d’un homme se mesure à la férocité qu’il déploie à démolir l’anatomie de ses semblables. Comment donc, tu leur fauchais leurs filles, non pas par désir, mais parce que dans la moelle de tes parents fermentait l’instinct de l’étalon sauvage et du taureau. Eh bien ! les années ont passé : qu’en penses-tu, à présent ?… Comme pour lui répondre, la vision changea aussitôt. Le chapeau, le veston trop court disparurent, et furent remplacés par des vêtements plus sobres ; l’insolence du visage, la dureté des yeux firent place à une expression sereine, lumineuse, qui semblait le reflet d’une admirable clarté intérieure. L’apparition ressemblait étrangement au Martin Eden actuel et, en regardant mieux, il vit la petite lampe qui l’éclairait, le livre qu’il étudiait. Il lut le titre : La Science de l’esthétique. C’était bien lui… Il remonta la lampe et reprit La Science de l’esthétique à l’endroit où il l’avait laissée.
30
Ce fut par un bel après-midi de fin d’été, pareil au jour qui vit éclore leur amour un an auparavant, que Martin lut son Cycle d’amour à Ruth. Comme alors, ils s’étaient installés dans leur coin favori sur la colline. De temps à autre elle avait interrompu sa lecture par des exclamations de plaisir et, lorsqu’il eut rangé la dernière feuille avec les autres, il attendit son jugement.
Elle le fit attendre, puis parla avec des pauses, hésitant à exprimer la dureté de sa pensée.
– Je les trouve très beaux, vraiment très beaux. Mais vous ne pouvez pas les vendre, n’est-ce pas ?… Vous comprenez ce que je veux dire ? dit-elle, d’une voix presque implorante. Votre littérature est invendable. Il y a quelque chose là-dedans qui vous empêche de gagner votre vie… peut-être est-ce la faute des autres… Mais, chéri, comprenez-moi bien. Je suis flattée, je suis fière – quelle vraie femme ne le serait pas ? – que vous ayez écrit ces poèmes sur moi. Mais ce n’est pas eux qui rendront notre mariage possible. Vous ne le voyez pas, Martin ?… Ne me croyez pas intéressée. C’est l’amour, c’est la pensée de notre avenir qui me tourmentent. Toute une année s’est écoulée depuis que nous nous sommes dit notre amour, et notre mariage est tout aussi lointain. Ne me jugez pas mal, Martin ; vraiment il s’agit de mon cœur, de tout moi-même. Pourquoi n’essayez-vous pas d’entrer dans un journal, puisque vous tenez absolument à écrire ? Pourquoi ne pas devenir reporter… pour quelque temps, du moins ?
– Je gâterais mon style, dit-il d’une voix basse, monotone. Vous ne savez pas les efforts que j’ai faits pour acquérir mon style.
– Mais ces nouvelles ? insista Ruth. Vous appeliez cela du « gros ouvrage » et vous en avez écrit beaucoup. Est-ce qu’elles n’ont pas aussi gâté votre style ?
– Non, c’est différent. Les nouvelles se faisaient toutes seules, après une longue journée de travail de style. Mais la besogne d’un reporter est de toutes les minutes et l’absorbe complètement. Ce n’est plus une existence, c’est un tourbillon, sans passé, sans avenir et, certes, sans aucune préoccupation de style ni de littérature. Me faire reporter, à présent que mon style se cristallise, serait commettre un suicide littéraire. Pensez donc ! chaque nouvelle, le moindre mot de chaque nouvelle me blessait dans mon respect de moi-même, dans mon respect de la beauté. J’en étais malade. Il me semblait que je commettais un péché. Et lorsqu’on me les refusait, j’en étais heureux, au fond. Et pourtant j’étais obligé de ramener mes vêtements au clou ! Mais, la joie d’écrire Le Cycle d’amour !… La joie du créateur dans sa plus noble expression ! Elle m’a payé de tout, de tout !…
Martin ne sut pas à quel point ces mots laissaient Ruth indifférente. « La joie de créer » – c’était cependant sur ses lèvres qu’il avait entendu cette phrase pour la première fois. Elle l’avait lue, en avait étudié la signification à l’Université en travaillant sa licence ; mais elle n’avait aucune originalité, le don de créer lui manquait totalement et sa culture n’était que le reflet de celle des autres.
– En somme, le rédacteur n’a pas eu raison de corriger vos Poèmes de la mer ? questionna-t-elle. Souvenez-vous qu’il faut avoir fait ses preuves pour être rédacteur.
– Voilà qui cadre à merveille avec l’omnipotence des valeurs établies, répliqua-t-il, entraîné par son animosité contre la gent éditoriale. Ce qui est, non seulement est bien, mais ne pourrait être mieux. Le fait qu’une chose existe suffit à sa justification ! Notez que l’ignorance des gens seule, leur fait croire une pareille stupidité – leur ignorance, qui n’est autre que l’homicide mental décrit par Weininger. Ils se figurent qu’ils pensent et ce sont ces êtres sans pensées qui s’érigent en arbitres de ceux qui pensent vraiment.
Il se tut, s’étant aperçu qu’il avait parlé au-delà de la compréhension de Ruth.
– Je ne connais pas ce Weininger, dit-elle. Et vous généralisez tellement que je ne peux pas vous suivre. Je disais que les rédacteurs étaient qualifiés…
– Je vais vous dire, interrompit Martin. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des rédacteurs sont des ratés, qui n’ont pas réussi comme écrivains. Ne croyez pas qu’ils préfèrent leur corvée bureaucratique, leur asservissement au public et aux commanditaires, à la joie d’écrire. Ils ont essayé d’écrire et ils n’ont pas pu. Et voilà justement le paradoxe idiot de la chose : toutes les portes de la littérature sont gardées par ces cerbères : les ratés de la littérature. Éditeurs, rédacteurs, directeurs des services littéraires des revues et librairies, tous, ou presque tous, ont voulu écrire et n’ont pas réussi. Et ce sont ces gens-là – les moins qualifiés cependant – qui décident de ce qui doit ou non, être publié ! Ce sont ces gens-là, qui ont prouvé leur manque d’originalité et de talent, qui sont chargés de juger l’originalité et le talent des autres ! Ensuite, il y a les critiques de revues – encore des ratés. Eux aussi ont rêvé d’écrire des vers ou des romans, et ils n’ont pas pu. Comment ! mais la moyenne des revues est aussi nauséabonde à avaler que de l’huile de foie de morue !… Je vous ai déjà dit tout ça. Il existe de grands critiques, c’est certain, mais ils ont la rareté des comètes. En tout cas, si je rate mon affaire comme écrivain, je serai mûr pour la carrière d’éditeur. C’est le pain, le beurre et même la confiture assurés.
L’esprit prompt de Ruth et sa désapprobation des idées de son fiancé la firent sauter sur la contradiction que lui semblait contenir sa diatribe.
– Mais, Martin, si c’est ça, si toutes les portes sont fermées, ainsi que vous le démontrez, comment les grands écrivains ont-ils fait pour arriver ?…
– En accomplissant l’impossible, répondit-il. Ils ont fait des choses si merveilleuses, si inouïes, qu’à leur flamme les portes d’airain ont fondu. Ils sont arrivés par miracle, à mille contre un. Ils sont arrivés, parce qu’ils étaient pareils aux « géants balafrés » de Carlyle, que rien ne peut abattre. Et voilà ce qu’il faut que j’accomplisse : l’impossible.
– Mais si vous manquez votre but, Martin ?… Et puis vous semblez oublier que j’existe, moi !
– Si je le manque ?… (Il la regarda un instant, comme si l’hypothèse qu’elle venait d’énoncer était impossible. Puis son visage s’éclaira :) Si je le manque, je serai éditeur, et vous serez la femme d’un éditeur !
Elle fronça le sourcil à cette plaisanterie, avec une si adorable moue qu’il la prit dans ses bras et la couvrit de baisers.
– Ça suffit, déclara-t-elle, en se dégageant par un effort de volonté de la douceur de son étreinte. J’ai discuté avec mes parents. Jamais je ne leur avais tenu tête ainsi et je me suis comportée en fille très peu obéissante. Ils sont contre vous, Martin ; mais je les ai tellement convaincus de mon amour pour vous, qu’à la fin, mon père a déclaré accepter que vous entriez dans ses bureaux, si vous voulez. Il a même dit de lui-même qu’il vous payerait suffisamment, dès le début, pour que nous puissions nous marier et avoir une petite maison quelque part. Ce qui est très gentil, n’est-ce pas ?
Martin, le cœur désespéré, émit quelques sons inarticulés, tout en cherchant machinalement dans sa poche de quoi rouler une cigarette – en vain, puisqu’il n’avait plus ni tabac ni papier sur lui – et Ruth continua :
– Franchement, et j’espère que je ne vous froisse pas – je vous le dis pour que vous sachiez exactement à quoi vous en tenir – il n’aime pas vos opinions radicales et vous trouve paresseux. Bien entendu, je sais, moi, que vous ne l’êtes pas, que vous travaillez beaucoup, au contraire.
« À quel point, elle ne s’en doute certes pas », se dit Martin.
– Bien, dit-il. Et quant à mes opinions ? me croyez-vous vraiment radical ?
Il la tint sous son regard, attendant sa réponse.
– Vos opinions… eh bien !… je les trouve assez déconcertantes, dit-elle.
Il était renseigné, et la vie lui parut tout à coup si terne, si grise, qu’il en oublia son offre d’une situation chez son père. Quant à Ruth, maintenant que son jalon était posé, elle décida d’attendre, et puis de remettre la question sur le tapis à un moment plus favorable.
Elle n’attendit pas longtemps. Martin avait, lui aussi, une question à lui poser. Il désirait s’assurer de la mesure exacte de sa foi en lui. En l’espace d’une semaine, les deux questions furent résolues, hâtées par la lecture que lui fit Martin de La Honte du soleil.
– Pourquoi donc ne faites-vous pas de reportage ? demanda-t-elle quand il eut achevé. Vous aimez tant écrire et je suis sûre que vous réussiriez. Vous monteriez vite et vous vous feriez un nom. Il y a un grand nombre de correspondants spéciaux ; leurs salaires sont élevés et leur champ d’activité infini. On les envoie partout, au cœur de l’Afrique – comme Stanley – à Rome, pour interviewer le Pape, ou au Tibet, explorer les régions inconnues.
– Alors, vous n’aimez pas mon essai ? fit-il en insistant. Vous croyez que j’ai quelque chance dans le journalisme et aucune dans la littérature ?
– Mais si, mais si, je l’aime. C’est agréable à lire. Mais je crains que les lecteurs ne le comprennent pas – en tout cas, moi, je ne le comprends pas, bien que ça me paraisse beau. Votre argot scientifique me dépasse. Vous savez, chéri, vous êtes un extrémiste et ce qui vous semble intelligible, peut très bien sembler inintelligible au commun des mortels.
– Je suppose que c’est le jargon philosophique qui vous ennuie, fut tout ce qu’il put dire.
Il flambait encore de sa lecture, sous l’impression de la pensée la plus mûre qu’il ait jamais exprimée et le verdict de Ruth l’assommait brutalement.
– Ne vous attachez pas à la forme, qui laisse peut-être à désirer, insista-t-il. Mais dans le fond, dans la pensée…, n’y voyez-vous rien ?…
Elle secoua la tête.
– Non, c’est différent de tout ce que j’ai lu. J’ai compris Maeterlinck…
– Vous avez compris son mysticisme ? lança Martin.
– Oui ; mais ce que vous avez voulu exprimer – et ce que je suppose devoir être une attaque contre Maeterlinck – je ne le comprends pas. Naturellement, si l’originalité compte pour quelque chose…
Il l’interrompit d’un geste impatient puis se rendit compte tout à coup qu’elle parlait, qu’elle parlait même depuis un certain temps.
– Après tout, vous avez écrit pour vous amuser, disait-elle. À présent, vous avez assez joué. Il est temps de prendre la vie au sérieux, notre vie, Martin. Jusqu’à présent, vous n’avez pensé qu’à la vôtre.
– Vous me demandez de prendre un emploi ?
– Oui. Papa a proposé…
– Je sais, interrompit Martin, mais ce que je veux savoir c’est, si, oui ou non, vous avez perdu votre foi en moi.
Elle lui prit la main et des larmes montèrent à ses yeux.
– En votre avenir littéraire, oui, chéri, avoua-t-elle tout bas.
– Vous avez beaucoup lu de mes élucubrations, poursuivit-il avec brusquerie. Qu’en pensez-vous ? N’y a-t-il aucun espoir ? Par rapport aux autres, comment est-ce ?
– Mais ils vendent leurs œuvres et vous… non.
– Vous ne répondez pas à ma question. Croyez-vous vraiment que je n’ai aucune vocation littéraire ?
– Alors, je vais vous répondre. (Elle ramassa tout son courage.) Non je ne crois pas que vous soyez doué pour ça. Pardonnez-moi, chéri. Vous me demandez de vous le dire, et vous savez que je m’y connais en littérature un peu plus que vous.
– Oui, vous êtes licenciée es lettres, dit-il pensivement, vous devez savoir.
« Mais je veux encore vous dire ceci, poursuivit-il après un silence pénible. Je sais ce que j’ai en moi. Personne ne le sait que moi. Je sais que je réussirai, et je ne veux pas qu’on m’étouffe. Je ne vous demande pas de croire en moi, ni en mon avenir littéraire. Tout ce que je vous demande, c’est de m’aimer, et d’avoir foi en l’amour.
« Il y a un an, je vous ai demandé deux ans. J’ai un an encore devant moi. Et je crois vraiment – je vous en donne ma parole d’honneur – qu’avant un an j’aurai réussi. Vous rappelez-vous ce que vous m’avez dit, il y a longtemps : que je devais faire d’abord mon apprentissage ?… Je l’ai fait, et bien fait, je vous jure, puisque vous m’attendiez. Savez-vous que j’ai oublié ce que c’est de dormir paisiblement ?… Autrefois – il me semble qu’il y a des siècles – je dormais tout mon soûl et me réveillais quand j’avais assez dormi. Maintenant, c’est toujours la sonnerie qui me réveille. Que je m’endorme tôt ou tard, je dors le même nombre d’heures ; remonter la pendule et éteindre la lampe, sont mes deux derniers actes conscients. Quand je commence à avoir sommeil, je change le livre trop ardu que je lis, contre un autre plus léger. Et quand je m’endors dessus je me donne des coups de poing sur la tête pour chasser le sommeil. J’ai lu l’histoire d’un homme qui avait peur de dormir… elle est de Kipling. Cet homme s’était fixé un éperon de telle manière que la molette d’acier lui entrait dans la chair quand il cédait au sommeil. Eh bien ! j’ai fait la même chose. Je regarde l’heure et je décide de ne pas détacher l’éperon avant minuit, ou une heure, ou deux ou trois heures du matin. Et j’éperonne ma chair fatiguée, jusqu’à l’heure dite. Cet éperon est mon camarade de lit depuis des mois. Ma rage de travail est devenue si grande que je ne dors même plus cinq heures et demie. J’en dors quatre à présent ! Je suis affamé de sommeil. Il y a des moments où j’ai des vertiges à cause de mon manque de sommeil ; des moments où la mort, qui procure le repos et le sommeil, me tente ; des moments où je suis hanté par ces vers de Longfellow :
The sea is still and deep
All things within its bosom sleep ;
A single step and all is o’er,
A plunge, a bubble, and no more.
« La mer est muette et profonde
Toute chose dort dans son sein ;
Un seul pas et tout est fini,
Un plongeon, une bulle, et plus rien. »
« Bien entendu, ça ne dure pas. C’est la nervosité, due à une trop grande tension cérébrale… Mais voilà à quoi je veux en venir : Pourquoi ai-je fait tout ça ? Pour vous. Pour hâter mon apprentissage, pour hâter le succès. À présent, mon apprentissage est terminé. Je suis en possession de tous mes moyens. Je vous jure que j’apprends plus de choses en un mois, que la moyenne des universitaires n’en apprend en un an. Je le sais, je vous dis ! D’ailleurs, si mon besoin d’être compris par vous n’était pas désespéré, je ne vous aurais rien dit. Je ne me vante pas, vous savez. J’estime les résultats d’après les livres. À présent, vos frères sont des barbares ignorants, à côté de moi et de la somme de connaissances que j’ai arrachée aux livres pendant qu’ils dormaient, eux ! Autrefois, je voulais être célèbre. Maintenant, ce que je veux, c’est vous ; je suis plus assoiffé de vous que de gloire ou de fortune. Je ne rêve qu’une chose : poser ma tête sur votre cœur, pour toujours. Et ce rêve, d’ici un an sera réalisé.
Un fluide irrésistible émanait de lui, en vagues puissantes ; et à mesure que sa volonté se dressait contre celle de Ruth, elle s’abandonnait, irrésistiblement attirée. Sa voix passionnée, ses yeux ardents, flambaient de vie intense et d’intelligence. À cette minute – à cette minute seulement – le voile se déchira et elle vit le vrai Martin Eden splendide et triomphal ; et, comme le dompteur doute par instants de son pouvoir sur ses fauves, elle douta du sien sur l’esprit indépendant de cet homme.
– Autre chose encore, poursuivit-il, fougueux – vous m’aimez. Mais pourquoi m’aimez-vous ? À cause justement de ce que vous sentez en moi, de cette force irrésistible qui me contraint d’écrire. Vous m’aimez parce que je suis différent des hommes que vous avez connus et que vous auriez peut-être aimés. Je ne suis pas fait pour le bureau et les comptes courants, pour les petits ergotages d’affaires et les finasseries d’hommes de loi. Rendez-moi pareil à ces gens, faites-moi accomplir la même besogne, respirer le même air qu’eux, envisager l’existence sous le même angle, et vous aurez détruit Martin Eden, vous aurez détruit votre amour. Mon besoin d’écrire est un besoin vital. Si je n’avais été qu’un fantoche, je n’aurais jamais rêvé d’écrire et vous n’auriez jamais désiré m’épouser.
– Mais, vous oubliez quelque chose, interrompit-elle, contente d’avoir trouvé un argument. Vous oubliez ces inventeurs illuminés, qui passent leur vie à courir après des chimères, pendant que leur famille meurt de faim. Leur femme les aime sans doute quand même et elle souffre avec eux, pour eux, non pas à cause de leur égarement, mais en dépit de lui.
– C’est vrai, répondit Martin. Mais il y a aussi des inventeurs qui ne sont pas des illuminés, qui meurent de faim en essayant d’inventer des choses admirables et qui, parfois, y réussissent. Dieu sait que je ne cherche pas l’impossible.
– Vous l’avez pourtant dit.
– Je parlais au figuré. Je cherche à faire ce que d’autres ont fait avant moi, à écrire et à vivre de ma plume.
Son silence le piqua au vif.
– Alors, pour vous, mon but est une chimère aussi folle que la recherche du mouvement perpétuel, dit-il.
Elle ne répondit qu’en lui pressant la main avec pitié, comme une mère calme son enfant malade. Il ne fut plus pour elle qu’un enfant malade, cet illuminé assoiffé d’impossible.
À la fin de cette conversation, elle lui rappela encore l’opposition de ses parents.
– Mais vous m’aimez ? demanda Martin.
– Oui, oui, je vous aime ! répondit Ruth.
– Alors, rien ne peut nous séparer, déclara-t-il triomphalement. Car je crois en notre amour et l’antipathie de vos parents ne me fait pas peur. Tout, dans ce bas monde, peut aller à vau-l’eau, sauf l’amour… L’amour, à moins d’être débile et chancelant, doit triompher.
31
Martin avait rencontré par hasard sa sœur Gertrude dans Broadway – hasard favorable, mais assez déconcertant, comme on va le voir. Elle attendait le tram à un coin de rue et vit son frère la première ; elle vit aussi ses traits tirés, fatigués, et son regard. Las, désespéré, il l’était, car le Mont-de-Piété avait refusé de lui prêter quelques dollars de plus sur sa bicyclette. Le mauvais temps ayant fait son apparition, Martin avait engagé son vélo et retiré son complet noir.
– Voilà le complet noir, avait répondu le prêteur sur gages, qui connaissait son actif dans le moindre détail. Mais si j’apprends jamais que vous l’avez engagé chez ce Juif, Lipka…
Martin, effrayé de la menace sous-entendue, se hâta de répondre :
– Non, non ! j’en ai besoin, il faut que je le mette !
– Bon, dit l’usurier, radouci. Mais vous n’aurez pas un sou de plus. Je ne veux pas y être de ma poche.
– Mais c’est une bicyclette de quarante dollars, en parfait état, insista Martin. Et vous ne m’en avez donné que sept. Non ! même pas six dollars vingt-cinq ! puisque vous avez pris l’intérêt d’avance.
– Si vous voulez davantage, apportez le complet.
Et Martin était sorti de la misérable boutique, si désespéré que sa sœur en fut frappée.
À peine se furent-ils dit bonjour, que le tram de Telegraph Avenue stoppa pour charger une foule de gens pressés. Mme Higginbotham, que Martin aidait à monter, sentant à la pression de sa main qu’il ne la suivait pas, se retourna sur le marchepied et le visage défait de son frère la navra.
– Tu ne viens pas ? dit-elle, et aussitôt elle redescendit.
– Non, je marche ; il faut faire de l’exercice…
– Je t’accompagne un bout de chemin, déclara-t-elle. Ça me fera peut-être du bien. Je ne me sens pas dans mon assiette depuis quelques jours.
Martin lui jeta un coup d’œil. En effet, l’allure générale de sa sœur, sa graisse malsaine, ses épaules voûtées, son visage tiré, ridé, sa démarche lourde, n’offraient pas l’image de la santé.
– Tu ferais mieux de t’arrêter là, dit-il au prochain carrefour, où déjà elle reprenait haleine, et de grimper dans le prochain tram.
– Dieu ! que je suis déjà fatiguée ! fit-elle, essoufflée. Je suis aussi capable de marcher que toi, avec les souliers que tu as aux pieds. Ils sont si usés qu’ils te lâcheront avant d’arriver à Nord-Oakland.
– J’en ai une autre paire chez moi, dit-il.
– Viens dîner demain, suggéra Gertrude brusquement. Bernard n’y sera pas. Il va à San Leandro pour affaires.
Martin secoua la tête, mais ne put réprimer l’expression affamée de ses yeux à la pensée d’un dîner.
– Tu n’as pas le sou, Mart ! C’est pour ça que tu vas à pied. De l’exercice !… (Elle s’efforça de renifler avec mépris, mais le mépris resta en route.) Attends, laisse-moi voir !
Et, fouillant dans son sac, elle lui glissa une pièce de cinq dollars dans la main.
– J’ai oublié de te souhaiter ton dernier anniversaire, Mart, murmura-t-elle, confuse.
Instinctivement, Martin avait refermé la main sur la pièce d’or. Puis, il se dit qu’il ne devait pas accepter et se débattit dans les affres de l’indécision. Cet argent signifiait la nourriture, la vie, la lumière pour son corps et son cerveau, pouvoir continuer d’écrire et – qui sait – d’écrire peut-être l’œuvre qui lui rapporteraient de l’or, beaucoup d’or. Dans son esprit flamboyèrent les titres de deux essais qu’il venait d’achever : Les Grands Prêtres du Mystère et Le Berceau de la beauté. Il les vit sous la table, parmi le monceau de manuscrits renvoyés, qu’il ne pouvait plus affranchir. Ceux-là, personne ne les connaissait et ils n’étaient pas inférieurs au reste. Si seulement il avait de quoi les affranchir !
Puis la certitude de l’ultime succès s’affirma, il sentit sa faim et… d’un geste vif il empocha la pièce.
– Je te le revaudrai cent fois, Gertrude, fit-il avec effort, la gorge contractée, les yeux humides. Souviens-toi de ce que je te dis : avant la fin de l’année, je te remettrai dans la main une centaine de pièces pareilles. Je ne te demande pas de me croire. Attends et tu verras.
Elle n’en crut rien, bien entendu, et, un peu gênée, sans chercher à ruser davantage :
– Je sais que tu as faim, Mart, dit-elle. Ça se voit tout de suite. Viens manger quand tu voudras. Je t’enverrai un des enfants pour t’avertir quand M. Higginbotham ne sera pas là. Et, Mart, écoute…
Il attendit, mais il se doutait de ce qu’elle allait dire.
– Tu ne crois pas qu’il serait temps de te trouver du travail ?
– Tu ne crois pas à ma réussite ? répliqua-t-il.
Elle secoua la tête.
– Personne ne croit en moi, Gertrude, personne… que moi. (Le ton de sa voix était passionné.) J’ai déjà fait du bon travail, beaucoup de bon travail et, tôt ou tard, il se vendra.
– Comment sais-tu qu’il est bon ?
– Parce que… (Il s’arrêta, sentant qu’il était inutile de lui expliquer la raison de sa confiance.) Mon Dieu, parce que c’est meilleur que presque tout ce qui paraît dans les revues.
– Je voudrais que tu sois raisonnable, dit-elle timidement, mais satisfaite d’avoir deviné ce qui le tourmentait. Je voudrais que tu sois raisonnable et que tu viennes dîner demain à la maison.
Quand elle fut montée dans le tram, Martin courut à la poste, acheta pour trois dollars de timbres et, plus tard, en allant chez les Morse, il y retourna, fit peser un gros paquet de longues et volumineuses enveloppes, puis les affranchit minutieusement.
Ce fut une nuit mémorable pour Martin, car il rencontra Russ Brissenden. Comment il se trouvait là, de qui il était l’ami, qui l’avait amené, il n’en savait rien et n’eut pas la curiosité de le demander à Ruth. Au premier abord, Martin le trouva superficiel, et sans intérêt. Une heure plus tard, il décida que Brissenden était par-dessus le marché un sauvage, à la manière dont il allait d’une pièce à l’autre, dont il fixait les tableaux et fouillait sans façon dans les livres et les magazines qu’il prenait sur la table ou sur un rayon de la bibliothèque.
C’était la première fois qu’il venait dans cette maison, mais sans s’occuper de personne, il finit par se pelotonner dans un profond fauteuil, tira de sa poche un mince volume et s’y plongea, s’isolant complètement du reste de l’assemblée. Tout en lisant, il se passait une main distraite et caressante dans les cheveux. Martin cessa ensuite de l’observer ; plus tard cependant il l’entendit plaisanter avec succès au milieu d’un essaim de jeunes femmes.
Le hasard fit que Martin, en s’en allant, rattrapa Brissenden dans la rue.
– Ah ! c’est vous ? dit Martin.
L’autre eut un grognement revêche, mais emboîta le pas. Ils se turent tous deux assez longtemps.
– Quelle solennelle vieille carne !
La soudaineté, la virulence de cette exclamation surprirent Martin et l’amusèrent, tout en ne diminuant en rien son antipathie pour le personnage.
– Pourquoi allez-vous là-dedans ? lui lança Brissenden brusquement, après un autre silence.
– Et vous ? riposta Martin.
– Ma parole, je n’en sais rien ! D’ailleurs, c’est ma première tentative. Le jour est composé de vingt-quatre heures et il faut bien le passer d’une façon quelconque. Venez boire quelque chose.
– D’accord, dit Martin.
Il s’en voulut aussitôt d’avoir accepté aussi facilement. À la maison l’attendaient plusieurs heures de « gros ouvrage » à bâcler avant d’aller se coucher, ainsi qu’un volume de Weismann, sans compter l’autobiographie d’Herbert Spencer, dont le tour aventureux le passionnait autant que le plus intéressant roman. Pourquoi perdrait-il son temps avec cet homme qui lui déplaisait ? Ce n’était ni à cause de l’homme ni à cause de la boisson qu’il avait accepté, c’était à cause des vives lumières, des glaces, de l’étincellement des cristaux et de l’argenterie, des visages heureux et riants, du brouhaha des voix. Oui, de ça surtout : il avait besoin d’entendre les voix de ces hommes heureux, arrivés, qui claquent joyeusement leur argent. Il se sentait seul, terriblement seul : voilà pourquoi il avait sauté sur l’invitation comme la bonite saute sur le chiffon blanc au bout de l’hameçon. Depuis Joe, à Shelly Hot Springs, et à l’exception des verres de vin qu’il prenait avec l’épicier portugais, Martin n’avait pas mis les pieds dans un bar. La fatigue cérébrale ne lui donnait pas, comme l’éreintement physique, l’impérieux besoin de boire et il n’en était nullement privé. À ce moment-là, c’est de l’atmosphère du bar dont il eut envie, bien plus que de la boisson elle-même.
Le « Grotto » les accueillit, ils s’étalèrent dans de confortables fauteuils, burent du scotch et discutèrent.
Ils causèrent de bien des choses, chacun à son tour commandant le whisky. Martin, qui avait la tête extrêmement solide, admirait la capacité de son partenaire et s’interrompait parfois pour admirer sa conversation. Il ne fut pas long à découvrir que Brissenden savait tout et à estimer qu’il était le second homme vraiment intellectuel qu’il eût rencontré. Cependant Brissenden possédait ce qui manquait au professeur Caldwell : la flamme, la flamboyante vision intérieure, le rayonnement spontané du talent. Sa parole jaillissait comme une source vive. Ses lèvres minces prononçaient des phrases coupantes, cinglantes, d’autres douces, veloutées, de caressantes phrases de beauté et de lumière, qui reflétaient tout le mystère insondable de la vie. D’autres fois encore, les lèvres minces claironnaient le tumulte des combats cosmiques, et des phrases couleur d’argent lunaire, étincelantes comme un ciel étoilé, qui résumaient toute la science avec des mots de poète.
Martin avait oublié sa première impression hostile. Il trouvait enfin ce que les livres lui avaient promis : une intelligence, un homme vivant qu’il regardait avec respect. « Je suis par terre, dans la boue, à vos pieds », se répétait-il.
– Vous avez étudié la biologie, dit-il tout haut.
À sa stupéfaction, Brissenden secoua la tête.
– Mais vous émettez des vérités que la biologie seule peut donner, insista Martin, tandis que l’autre le regardait d’un air vague. Vos conclusions sont les mêmes.
– Enchanté de l’apprendre ! répondit l’autre. Il m’est très rassurant de savoir que mes pauvres connaissances m’ont amené à la vérité par un raccourci. Quant à moi, je ne me préoccupe jamais de savoir si j’ai raison ou non. Cela n’a aucune importance. L’homme ne peut jamais atteindre à l’ultime vérité.
– Vous êtes un disciple de Spencer ! s’écria Martin triomphalement.
– Je ne l’ai pas ouvert depuis mon adolescence, et même alors, je n’ai lu que son Éducation.
– Je voudrais savoir ce que vous savez et l’avoir appris aussi facilement, déclara Martin une demi-heure plus tard, après avoir analysé attentivement le bagage intellectuel de Brissenden. D’un seul coup vous trouvez la solution juste. Par un raccourci qui tient du prodige, vous arrivez à la vérité.
– Oui, c’est ce qui inquiétait beaucoup le Père Joseph et le Frère Dutton, répondit Brissenden. Oh non ! ajouta-t-il, je ne suis rien du tout. Un hasard heureux m’a fait faire mon éducation dans un collège catholique. Et vous ? où avez-vous ramassé ce que vous savez ?
Martin le lui raconta ; en même temps il étudiait Brissenden, depuis sa longue et mince figure aristocratique et ses épaules tombantes, jusqu’à son pardessus jeté sur la chaise voisine, dont les poches bâillaient, déformées par les livres qui les bourraient. Le visage de Brissenden et ses longues mains fines étaient hâlés par le soleil, extrêmement hâlées, ce qui intrigua Martin. Il était évident que Brissenden n’était pas un sportif. Comment le soleil avait-il pu le hâler ainsi ? Quelque chose de morbide se cachait là-dessous, se dit Martin, revenant à l’étude de ce visage étroit, aux pommettes saillantes, aux joues creuses, au nez aquilin – le plus fin, le plus délicat que Martin eût jamais vu. La grandeur ni la couleur de ses yeux n’avaient rien de remarquable : ils étaient moyens et d’un marron banal ; mais en eux couvait une flamme étrangement complexe, contradictoire. Ils défiaient, ces yeux fiers et durs à l’excès, et en même temps, éveillaient la pitié. Et Martin le plaignit, sans savoir pourquoi.
– Oui, je suis tuberculeux, déclara Brissenden un instant plus tard, négligemment, après avoir dit qu’il revenait d’Arizona. J’y ai vécu deux ans, à cause du climat.
– Vous n’avez pas peur du climat d’ici ?
– Peur ?…
Il n’avait mis dans cette interrogation nulle emphase.
Mais Martin lut sur ce visage ascétique que cet homme n’avait peur de rien. Les yeux fixes ressemblaient à ceux des aigles ; le nez aux narines dilatées, défiant, agressif, était semblable au bec d’un oiseau de proie.
Magnifique ! résuma Martin en lui-même. Puis tout haut il cita le poète :
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody but unbowed.
(Sous les coups de massue du Hasard, ma tête saigne, mais ne se courbe pas.)
– Vous aimez Henley ? dit Brissenden d’une voix tout à coup tendre et pleine de charme. Naturellement ! Je devais m’y attendre de votre part. Ah ! Henley ! Quelle belle âme ! il est au milieu des rimailleurs contemporains, ces rimailleurs de magazines, comme un gladiateur dans un troupeau d’eunuques.
– Vous n’aimez pas les magazines ? questionna Martin légèrement agressif.
– Et vous ? grogna-t-il d’un ton tellement mauvais, que Martin sursauta.
– Je… j’écris, ou plutôt, j’essaye d’écrire pour les magazines, balbutia Martin.
– Voilà qui est mieux, répondit l’autre, radouci. Vous essayez, mais sans succès ! D’ailleurs je vois à peu près ce que vous écrivez : et ça renferme un ingrédient, qui ne convient pas aux magazines. Il y a des entrailles, là-dedans, et les magazines ne tiennent pas cet article. Ce qu’ils veulent c’est de la lavasse, de la guimauve. Et Dieu sait qu’on leur en procure ! mais pas vous.
– Je ne dédaigne pas le travail de mercenaire, avoua Martin.
– Au contraire… (Brissenden s’arrêta et son œil insolent détailla la pauvreté décente de Martin, passant du nœud de cravate un peu défraîchi, au col légèrement élimé, aux coudes luisants et à la manchette un tantinet éraillée ; puis son regard s’arrêta à son visage creusé.) Au contraire, c’est le travail de mercenaire qui vous dédaigne ; il vous dédaigne même si bien qu’il n’y a aucune chance que vous parveniez jusqu’à lui. Voyons, mon garçon, mais ce serait vous insulter que de vous inviter à venir manger quelque chose !
Martin rougit si violemment, que Brissenden eut un rire triomphant et ajouta :
– Un homme rassasié ne se juge pas insulté par une telle invitation.
– Vous êtes diabolique ! s’écria Martin irrité.
– En tout cas, je ne vous ai pas invité !
– Vous n’avez pas osé.
– C’est à savoir. D’ailleurs, à présent je vous invite.
Brissenden s’était levé à demi, tout en parlant, avec l’intention évidente d’aller aussitôt au restaurant. Martin avait serré les poings, le sang battait violemment à ses tempes.
– Attention ! mesdames et messieurs ! Il les avale tout crus, tout crus !… s’écria Brissenden imitant le bonimenteur d’un fameux mangeur de serpents qui faisait courir tout Oakland à ce moment-là.
– De vous… je ne ferais certainement qu’une bouchée, lança Martin, en toisant à son tour d’un œil insolent la misérable anatomie de l’autre.
– Seulement je n’en vaux pas la peine.
– Si, réfléchit Martin, mais c’est l’incident qui n’en vaut pas la peine ! (Il éclata de rire, d’un rire bon enfant, sans arrière-pensée.) J’ai été idiot, Brissenden. J’ai faim, vous l’avez deviné… Ce sont des phénomènes fort ordinaires et qui n’ont rien de déshonorant. Vous voyez, je ris des petits préjugés courants de la foule, et puis vous arrivez, et, d’un trait juste, acéré, vous me démontrez que je suis moi-même l’esclave de ces misérables petits préjugés.
– Vous vous êtes cru insulté, hein ?
– Il y a un instant, oui. Un préjugé de jeunesse, vous savez ! J’ai eu cette mentalité autrefois et il m’en reste encore quelque chose. C’est mon petit musée de fossiles personnel !
– Mais la porte est fermée maintenant ?
– Verrouillée.
– Sûr ?
– Absolument.
– Alors, allons manger quelque chose.
– C’est bien, je vous suis, répondit Martin qui voulut changer sa dernière pièce de deux dollars, pour payer les whiskys ; mais Brissenden, rudoyant le garçon, remit sa pièce sur la table.
Martin l’empocha avec une grimace et sentit à cet instant la main de Brissenden se poser avec sympathie sur son épaule.
32
L’après-midi suivant, de bonne heure, Maria fut de nouveau révolutionnée par une autre visite pour Martin. Mais cette fois elle ne perdit pas la tête, et introduisit d’abord Brissenden dans le salon des invités de marque, où elle le fit asseoir.
– J’espère que je ne vous dérange pas ? dit Brissenden, une fois chez Martin.
– Non, non, pas du tout, répondit Martin en lui serrant la main ; il lui donna l’unique chaise et s’assit sur le lit. Mais comment diable avez-vous su où j’habitais ?
– Par les Morse. J’ai téléphoné à Miss Morse. Et me voilà. (Il fouilla dans la poche de son pardessus, en sortit un mince volume et le jeta sur la table.) Voilà le livre d’un poète. Lisez-le et gardez-le. (Et comme Martin protestait :) Des livres, qu’est-ce que j’en ai à faire ? J’ai eu ce matin une nouvelle hémorragie. Avez-vous du whisky ? Non, bien entendu. Attendez.
Il disparut. Martin vit sa longue silhouette descendre le perron, fermer la grille et remarqua avec tristesse ses épaules voûtées, et sa poitrine rentrée… Il prépara deux gobelets et se mit à lire le volume de vers, œuvre récente d’Henry Vaughn Marlow.
– Pas de scotch, annonça Brissenden à son retour. Ce brigand ne vend que du whisky américain. En voilà un quart.
– Je vais envoyer un des gosses chercher des citrons et nous allons faire un toddy, proposa Martin. (Puis désignant le livre en question :) Je me demande ce qu’un livre comme celui-ci rapporte à Marlow ?
– Peut-être cinquante dollars, répondit Brissenden. Mais il peut s’estimer heureux de les toucher, et surtout d’être arrivé à persuader son éditeur de le lui publier.
– Alors, il est impossible de gagner sa vie en faisant des vers ?
– Absolument impossible. Il n’y a que les imbéciles pour le croire. En rimaillant, oui. Regardez Bruce et Virginia Spring et Sedgwick. Ils réussissent très gentiment. Mais la poésie, la vraie… Savez-vous comment Vaughn Marlow gagne sa vie ? Il est professeur dans une boîte à bachot en Pennsylvanie ; et de tous les enfers, celui-là a le pompon. Je ne changerais pas de place avec lui, pour cinquante ans de vie. Et pourtant, ses œuvres tranchent sur la grisaille des versificateurs contemporains, comme une rose parmi des chardons. Et si vous voyiez ce que les critiques disent de lui ! Quels idiots, tous, tant qu’ils sont ! Bon Dieu !
– Les hommes sans talent ont la rage de juger ceux qui en ont, confirma Martin. J’ai été stupéfié de la montagne d’imbécillités qu’on a écrites sur Stevenson et son œuvre.
– Des vampires et des harpies ! gronda Brissenden, en montrant les dents. Oui, je connais cette engeance : ils l’accablaient de coups de bec à propos de sa lettre au père Damien. Ils l’analysaient, le pesaient.
– Ils le mesuraient à l’aune de leur propre nullité, dit Martin.
– Oui, c’est ça, bonne définition ! Ils galvaudaient et salissaient la Vérité, la Bonté, la Beauté, tout en lui tapotant le dos et en disant : « Bon chien ! » Richard Realfe, la nuit où il mourut, les appela « les charognards bavards ».
– Ils picoraient la poussière d’étoiles, continua Martin avec chaleur. J’ai écrit une satire là-dessus, sur les critiques et les revuistes surtout.
– Ah ! faites voir, pria Brissenden avec insistance.
Martin déterra donc une copie de Poussière d’étoiles et Brissenden lut en riant sous cape, en se frottant les mains, oubliant complètement de boire son toddy.
– Vous me faites l’effet vous-même d’une poussière d’étoile jetée dans un monde de gnomes aveugles, fit-il ensuite. Bien entendu, ça a été enlevé par la première revue ?
Martin feuilleta les pages d’un petit carnet.
– Ça a été refusé par vingt-sept revues.
Brissenden partit d’un long éclat de rire joyeux qu’une quinte de toux brisa.
– Dites, vous n’allez pas me raconter que vous n’avez pas taquiné la muse, dit-il en reprenant haleine. Montrez-moi quelque chose.
– Ne le lisez pas maintenant, pria Martin. Parlons plutôt. J’en ferai un paquet que vous emporterez chez vous.
Brissenden partit, emportant Le Cycle d’amour et La Péri et la perle. Et le lendemain il revint, saluant Martin d’un :
– J’en veux encore.
Non seulement il assura à Martin qu’il était un vrai poète, mais Martin comprit qu’il en était un aussi, bien qu’il n’eût jamais essayé de faire publier ses vers.
– Qu’ils aillent à tous les diables ! répondit-il à Martin qui lui proposait de s’occuper de faire paraître ses œuvres. Aimez la beauté pour elle-même et laissez les revues tranquilles. Retournez sur vos bateaux et à votre mer, Martin Eden, c’est ce que je vous conseille. Pourquoi rester dans ces cités malsaines et pourries ? Vous vous tuez à essayer de prostituer la beauté, et c’est tout. Qu’est-ce que vous me citiez l’autre jour ? Ah ! oui ! Homme, dernier des éphémères. Eh bien ! vous, le dernier des éphémères, avez-vous besoin de gloire ? Si jamais vous l’atteignez, elle vous empoisonnera. Vous êtes trop simple, trop élémentaire, trop rationnel, pour réussir là-dedans. J’espère bien que pas une revue ne vous publiera jamais. Il ne faut être esclave que de la beauté. Servez-la et envoyez au diable la foule imbécile. Le succès ! Le succès est là, dans votre sonnet sur Stevenson, qui dépasse L’Apparition d’Henley, et dans Le Cycle d’amour et dans ces Poèmes de la mer. Ce n’est pas dans le succès d’une œuvre qu’on trouve sa joie, mais dans le fait de l’écrire. Je le sais. Et vous le savez aussi. La beauté vous hante. Elle est en vous comme une douleur qui ronge, comme une plaie qui ne veut pas guérir, comme une lame de flamme. Et vous voulez la monnayer ? D’ailleurs, vous ne le pouvez pas, de toute façon ! Ce n’est vraiment pas la peine de m’emballer là-dessus. Lisez les revues pendant dix siècles, vous n’y trouverez pas une seule ligne valant un seul mot de Keats. Laissez de côté la gloire et la fortune, signez un engagement sur un bateau demain et retournez à votre mer.
– Il ne s’agit pas de gloire, mais d’amour, dit Martin en riant. L’amour ne semble pas tenir une grande place dans votre Cosmos ; dans le mien la Beauté est la servante de l’Amour.
Brissenden lui lança un coup d’œil où il y avait à la fois de la pitié et de l’admiration.
– Que vous êtes jeune, mon petit Martin, que vous êtes jeune ! Vous volerez haut, mais vos ailes sont d’une gaze bien délicate, d’un duvet bien fragile. Ne les abîmez pas. Mais, bien entendu, c’est déjà fait. Le Cycle d’amour a été écrit à la gloire d’une femme, et c’est dommage.
– Il a été également écrit à la gloire de l’amour, répliqua Martin gaiement.
– La philosophie de la folie, continua l’autre. Les rêves du haschich m’en ont appris autant. Mais prenez garde ! La grande cité, les Philistins vous perdront. Tenez ! regardez ce repaire de traîtres où je vous ai rencontré. C’est de la pourriture, tout bonnement. Il est impossible de conserver sa raison dans une pareille atmosphère. Il n’y en a pas un seul là-dedans, homme ou femme, qui vaille quelque chose ; ce ne sont que des estomacs guidés par des préjugés intellectuels et artistiques…
Il s’arrêta brusquement, regarda Martin et devina tout à coup la situation. Son visage prit une expression d’horreur stupéfaite.
– Et c’est pour elle que vous avez écrit cet admirable Cycle d’amour ! pour cette insignifiante poupée ratatinée !…
Il avait à peine prononcé ces mots, que la main de fer de Martin l’avait saisi à la gorge et le secouait furieusement. Mais dans ses yeux, Martin ne vit aucune frayeur, rien qu’une curiosité amusée et railleuse. Redevenu maître de lui, il lâcha prise, et Brissenden alla tomber sur le lit où il resta une minute, pantelant, cherchant à reprendre son souffle, puis il se mit à rire doucement.
– Je vous aurais été éternellement reconnaissant, si vous aviez éteint la flamme ! dit-il.
– Mes nerfs sont à vif, en ce moment, dit Martin en s’excusant. J’espère que je ne vous ai pas fait mal ? Attendez ! je vais préparer un autre toddy.
– Ah ! jeune Hercule ! poursuivit Brissenden. Je me demande si vous appréciez votre physique à sa valeur ? Vous êtes diablement fort. Seulement, voilà le malheur… Vous paierez la rançon de cette belle force.
– Que voulez-vous dire ? demanda Martin avec curiosité, en lui tendant un verre plein. Tenez, avalez ça.
– À cause… (Brissenden avala son toddy avec une grimace de satisfaction.) À cause des femmes. Elles vous tourmenteront jusqu’à la mort, comme elles vous ont déjà tourmenté, ou je me trompe fort. Non, il est inutile de m’étrangler : je dirai ce que j’ai à dire. Il est certain que vous en êtes à votre premier béguin, mais, pour l’amour de la Beauté, choisissez mieux, la prochaine fois ! Mais, bon Dieu ! qu’est-ce que vous voulez faire d’une petite bourgeoise ? Laissez tomber. Choisissez une belle créature de flamme et de volupté, qui rit de la vie, se moque de la mort, amoureuse de l’amour. Elle vous aimera autant que n’importe lequel de ces misérables produits des serres chaudes de la bourgeoisie.
– Misérables ? protesta Martin.
– Parfaitement. Misérables et timorés, timorés devant la vie et confits dans la petite morale mesquine qu’on leur a inculquée. Ils vous aimeront, Martin, mais ils aimeront davantage leur chère petite morale. Ce qu’il vous faut, c’est le magnifique abandon de soi-même, une grande âme libre, un papillon étincelant, et non la petite mite grise. Oh ! vous vous fatiguerez vite, d’ailleurs, de ces puérilités féminines, si vous avez le malheur de vivre. Mais vous ne vivrez pas. Vous ne retournerez pas à vos bateaux et à votre mer : vous traînerez dans ces villes putrides, plus tard vous pourrirez et alors vous mourrez.
– Sermonnez-moi tant que vous voudrez, dit Martin, mais vous ne me ferez pas changer d’avis. Après tout, vous jugez d’après votre tempérament et moi je juge d’après le mien, qui est différent.
Leurs vues sur l’amour, sur les revues, sur beaucoup de choses s’opposaient, mais ils se plaisaient mutuellement et Martin éprouvait une profonde sympathie pour son nouvel ami. Ils se virent journellement ; tous les jours, Brissenden venait passer une heure dans la petite chambre encombrée. Il apportait régulièrement son quart de whisky et lorsqu’ils dînaient ensemble, il buvait du scotch pendant le repas. Invariablement, c’était lui qui payait et c’est par lui que Martin connut tous les raffinements de la nourriture, qu’il but du champagne pour la première fois et du vin du Rhin.
Mais Brissenden demeurait une énigme. En dépit de son apparence ascétique, il était, de toute la force déclinante de son sang appauvri, un voluptueux. Insoucieux de la mort, plein d’amertume et de cynisme devant la vie, ce mourant adorait la vie dans ses moindres manifestations. Il voulait jouir de la vie jusqu’à la dernière goutte, vibrer jusqu’au dernier frisson, « afin de regagner sans regret ma petite place dans la poussière cosmique d’où je viens », disait-il. Il avait essayé de tous les paradis artificiels, de bien des choses étranges, en quête de nouveaux frissons, de sensations inédites. Il raconta à Martin qu’il avait passé trois jours sans boire, exprès, afin d’expérimenter les exquises délices de la soif assouvie. Qui il était, ce qu’il était, Martin l’ignora toujours. C’était un homme sans passé, à l’avenir sombre, à l’amer présent enfiévré du désir de vivre.
33
Et Martin, lentement – mais sûrement – perdait la bataille. Malgré ses économies, le journalisme ne suffisait pas à le faire vivre. Quand vint le Thanksgiving Day, son complet noir étant de nouveau au Mont-de-Piété il ne put accepter l’invitation à dîner des Morse. Ruth en fut désolée, ce qui le désespéra. Il lui déclara alors qu’il viendrait quand même, qu’il irait à San Francisco réclamer les cinq dollars qui lui étaient dus et pourrait ensuite dégager son complet.
Dans la matinée, il emprunta dix cents à Maria. Il aurait préféré les emprunter à Brissenden, mais cet individu bizarre avait disparu. Martin ne l’avait pas vu depuis quinze jours et il se creusait vainement la tête pour savoir ce qui avait pu le vexer. Grâce aux dix cents de Maria, Martin put prendre le transbordeur pour San Francisco et, tout le long de Market Street il se demanda ce qu’il ferait, au cas où on ne lui donnerait pas son argent. Il n’aurait aucun moyen de retourner à Oakland et ne connaissait personne à San Francisco qui pourrait lui prêter dix cents.
La porte du bureau du Transcontinental était entrebâillée et Martin, qui s’apprêtait à la pousser, s’arrêta, en entendant une voix forte venant de l’intérieur, qui criait :
– Là n’est pas la question, monsieur Ford (Martin savait par sa correspondance, que Ford était le nom du rédacteur). La question est de savoir si vous êtes prêt à payer. En argent, et comptant ! L’avenir du Transcontinental ne m’intéresse pas du tout et ce que vous comptez en faire l’année prochaine me laisse froid. Ce que je veux, c’est être payé, et je vous jure bien que le numéro de Noël ne s’imprimera pas tant que je n’aurai pas touché mon argent. Quand vous l’aurez, venez me voir.
La porte s’ouvrit violemment, un homme furieux en sortit et disparut au bout du corridor, en jurant et en serrant les poings. Martin, qui jugea préférable de ne pas entrer immédiatement, attendit un quart d’heure dans le hall, puis il poussa la porte et entra. C’était la première fois qu’il pénétrait dans un bureau éditorial. Il était évidemment inutile d’y faire passer sa carte, car un groom, entrouvrant une autre porte, annonça tout simplement que « quelqu’un voulait voir M. Ford ». Sur un signe du groom, Martin s’avança et fut introduit dans le sanctuaire sacro-saint. Ce qui le frappa tout d’abord fut l’extrême désordre de la pièce. Puis il vit un jeune homme à favoris, assis devant un bureau à cylindre, qui le dévisageait avec curiosité. Martin s’étonna de la sérénité de ses traits. Il était évident que sa prise de bec avec l’imprimeur ne l’avait pas beaucoup affecté.
– Je… je suis Martin Eden (et je veux mes cinq dollars ! eut-il envie d’ajouter, mais, étant donné les circonstances, il ne voulut pas effaroucher le rédacteur).
À sa grande surprise, M. Ford sauta de son siège avec un : « Pas possible ! » enthousiaste et serra les deux mains de Martin avec effusion.
– Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux de vous connaître, monsieur Eden ! Je me suis souvent demandé de quoi vous aviez l’air.
Ici, il recula pour mieux observer Martin et son œil attendri fit le tour du vieux complet misérable, dont le pantalon, cependant, gardait le pli, grâce aux fers de Maria.
– J’avoue que je vous imaginais beaucoup plus vieux. Votre article dénotait tant de vigueur, de profondeur, une telle maturité, un tel souffle !… Un chef-d’œuvre, cette histoire ! Au bout de la sixième ligne, j’étais fixé. Je vais vous raconter comment je l’ai lue. Mais non ! venez que je vous présente d’abord à la rédaction.
Tout en parlant, M. Ford le mena dans un autre bureau où il le présenta à son associé, M. White, chétif petit homme aux favoris soyeux et clairsemés, qui semblait grelotter d’un froid perpétuel.
– Et M. Ends, M. Eden. M. Ends est notre gérant.
Martin serra la main d’un homme chauve, à l’œil vif, dont le visage semblait jeune – le peu que l’on en voyait, du moins, car il était presque entièrement caché par une barbe de neige, soigneusement peignée, de la main même de Mme Ends, tous les dimanches.
Les trois hommes entourèrent Martin, en parlant tous à la fois et sur le mode le plus admiratif, si bien qu’il se demanda si ce n’était pas le résultat d’un pari.
– Nous nous sommes souvent demandé pourquoi vous ne veniez pas, disait M. White.
– Je n’avais pas de quoi me payer le tram et j’habite de l’autre côté de la baie, répondit Martin, résolu à montrer son impérieux besoin d’argent. « Sûrement, se dit-il, mes glorieux haillons sont une indication suffisamment éloquente ! »
De temps en temps, dès que l’occasion se présentait, il faisait allusion au but de sa visite. Mais ses admirateurs faisaient la sourde oreille. Ils chantaient ses louanges, lui racontaient ce qu’ils avaient pensé de son histoire à première vue, puis ce que leur femme et leurs parents en avaient pensé, mais ne manifestaient pas la moindre intention de le payer.
– Vous ai-je dit comment j’ai lu votre histoire pour la première fois ? dit M. Ford. Mais non, bien entendu. Eh bien ! je revenais de New York et, quand le rapide s’est arrêté à Ogden, le groom a couru m’acheter le dernier numéro du Transcontinental.
« Bon sang ! se dit Martin, tu te payes des voyages en Pullman pendant que je crève de faim à cause des cinq dollars que tu ne me donnes pas. » Une vague de colère le submergea. Le tort que lui avait fait Le Transcontinental lui parut colossal ; tous ces longs mois d’attente vaine, de privations et de faim se dressèrent devant lui et, l’estomac tiraillé, il se souvint qu’il n’avait pas mangé depuis la veille, et, encore, si peu, qu’il était inutile d’en parler. Sur le moment, il vit rouge. Ces gens n’étaient même pas des brigands : ce n’étaient que de minables voleurs ! Par des promesses fallacieuses et des mensonges, ils lui avaient volé son histoire. Eh bien ! ils allaient voir ! Et il se jura de ne pas sortir du bureau avant d’avoir son argent. Il se rappela que, sans cet argent, il lui serait impossible de regagner Oakland. Avec effort, il reprit son sang-froid, mais son expression de loup affamé n’avait pas été sans inquiéter les trois complices. Ils parlèrent avec plus de volubilité que jamais. M. Ford recommença à raconter comment il avait lu pour la première fois L’Appel des cloches et M. Ends, en même temps, s’efforçait de répéter l’appréciation de sa nièce sur ce même ouvrage – sa nièce était institutrice à Alameda.
– Je vais vous dire le but de ma visite, finit par dire Martin. Je suis venu pour que vous me payiez cette histoire qui vous plaît tant à tous. Si je me souviens bien, c’est cinq dollars que vous m’aviez promis à la publication.
Le visage mobile de M. Ford exprima aussitôt l’acquiescement le plus enthousiaste ; il fit mine de fouiller ses poches, puis se tourna vers M. Ends et lui dit qu’il n’avait pas d’argent sur lui. M. Ends, l’air fort mécontent, fit le geste de protéger la poche de son pantalon, à quoi Martin comprit que de l’argent s’y trouvait.
– Je suis désolé, dit M. Ends, mais j’ai payé l’imprimeur il n’y a pas une heure et il a pris toute ma monnaie. C’est une étourderie de ma part d’être tellement à court, mais cette note n’était pas encore due et cet acompte à l’imprimeur m’a pris tout à fait à l’improviste.
Les deux hommes se tournèrent d’un air interrogateur vers M. White, mais ce gentleman se mit à rire et haussa les épaules. Celui-là, au moins, avait la conscience nette. Il était entré au Transcontinental pour s’initier à la littérature des revues ; au lieu de ça, il en avait surtout appris les principes financiers à ses dépens. Le Transcontinental lui devait quatre mois de salaire et il savait qu’il fallait calmer l’imprimeur avant l’associé.
– C’est vraiment ridicule, monsieur Eden, d’être surpris en aussi mauvaise posture, dit M. Ford d’un air dégagé. Mais voilà ce que nous allons faire. Demain matin, à la première heure, je vous envoie un chèque. Vous avez l’adresse de M. Eden, n’est-ce pas, monsieur Ends ?
Oui, M. Ends avait l’adresse et le chèque allait être expédié dès le lendemain matin. Martin, bien que peu ferré sur les questions de banques et de chèques, ne parvenait cependant pas à comprendre pourquoi on ne lui donnerait pas aussi bien son argent le jour même.
– Alors, c’est convenu, monsieur Eden ; nous vous enverrons le chèque demain, dit M. Ford.
– J’ai besoin de cet argent aujourd’hui, répondit Martin d’un ton ferme.
– Quel hasard malheureux ! si vous étiez venu un autre jour… fit suavement M. Ford, mais il fut interrompu par M. Ends dont l’œil vif dénotait un caractère emporté.
– M. Ford a déjà expliqué la situation, dit-il d’un ton agressif, et moi aussi. Le chèque sera expédié demain et…
– Et moi, coupa Martin, je vous ai déjà expliqué que j’ai besoin de cet argent aujourd’hui.
Son pouls s’était légèrement accéléré au ton brusque du gérant et il le surveillait d’un œil vigilant, certain que les fonds de la caisse du Transcontinental reposaient dans la poche du pantalon de ce digne gentleman.
– C’est vraiment malheureux, commença M. Ford.
Mais à ce moment précis, M. Ends, excédé, fit demi-tour pour quitter la pièce. Au même instant, Martin bondit sur lui et, d’une main lui saisit la gorge si bien que la barbe neigeuse de M. Ends, toujours impeccablement peignée, pointa vers le plafond à un angle de 45 degrés. Terrifiés, M. White et M. Ford virent leur gérant secoué comme un vulgaire tapis.
– Fouillez-vous, vénérable bousilleur de jeunes talents ! conseilla Martin. Fouillez-vous ! ou je vous secoue jusqu’à ce que le dernier sou dégringole de votre poche ! (Puis, s’adressant aux deux spectateurs effrayés :) Et n’approchez pas, vous autres : ça pourrait vous coûter chaud.
M. Ends étouffait et ne put signifier son acquiescement que lorsque la main de Martin eut desserré son étreinte. Après avoir fouillé dans ses différentes poches, il récolta quatre dollars quinze.
– Retournez vos poches ! ordonna Martin.
Dix cents tombèrent encore. Martin recompta le résultat de son raid, pour être sûr du compte.
– À vous ! cria-t-il à M. Ford. Il me faut encore soixante-quinze cents.
Sans attendre, M. Ford fouilla ses poches, mais n’en sortit que soixante cents.
– C’est tout ? interrogea Martin d’un ton menaçant, en s’emparant de la monnaie. Et dans les poches de votre veston ?
Pour prouver sa bonne foi, M. Ford retourna ses deux poches. Il en tomba un bout de carton qu’il se préparait à réempocher ; quand Martin s’écria :
– Qu’est-ce que c’est ? Un ticket de ferry-boat ? Donnez-le. Ça vaut dix cents. J’ai donc quatre dollars quatre-vingt-quinze, en comptant le ticket. Il me faut encore cinq cents.
Il regarda fixement M. White et le petit homme débile, tout frissonnant, les lui tendit aussitôt.
– Merci, dit Martin s’adressant collectivement aux trois journalistes. Je vous fais mes adieux.
– Brigand ! siffla M. Ends quand il vit Martin sur le seuil de la porte.
– Petits voleurs minables ! riposta Martin en tapant la porte derrière lui.
Martin était de si joyeuse humeur, que, se souvenant que Le Hornet lui devait quinze dollars pour La Péri et la perle, il décida aussitôt d’y aller et de se les faire donner, de la même façon s’il le fallait. Mais le personnel du Hornet était composé d’une bande de solides gaillards, flibustiers avérés, qui volaient tout et tout le monde et se volaient les uns les autres. Après que le mobilier de bureau eut été sérieusement malmené, le rédacteur, ancien champion universitaire, secondé par le gérant, un agent de publicité et le portier, réussirent à expulser Martin et à lui faire descendre tout un étage, plus vite qu’il n’aurait voulu.
– Revenez, monsieur Eden ! nous serons toujours enchanter de vous voir ! lui crièrent-ils du palier en riant.
Martin ricanait en se relevant :
– Bah ! riposta-t-il avec calme. Au Transcontinental, il n’y a que des gâteux, mais ici au moins vous êtes tous des costauds !
On éclata de rire à cette boutade.
– Il faut dire, monsieur Eden, lui cria d’en haut le rédacteur du Hornet que, pour un poète, vous êtes assez costaud aussi ! Où donc avez-vous appris cette clé si ce n’est pas indiscret ?
– Là où vous avez appris ce « demi-Nelson », répondit Martin. En tout cas, vous avez un œil au beurre noir.
– J’espère que vous n’aurez pas de torticolis, dit le rédacteur avec sollicitude. Dites donc, si on allait prendre un verre tous ensemble ?
Sur ce, voleurs et volé burent ensemble et furent tous d’accord pour admettre que la victoire étant au plus fort, les quinze dollars de La Péri et la perle appartenaient de droit au personnel du Hornet.
34
Arthur demeura à la grille tandis que Ruth grimpait le petit perron de Maria. Elle entendit le cliquettement rapide de la machine à écrire et trouva Martin en train d’achever la dernière page d’un manuscrit. Elle venait savoir si, oui ou non, il viendrait dîner, le Thanksgiving Day ; mais avant qu’elle eût ouvert la bouche, Martin bondit sur le sujet qui le remplissait tout entier.
– Tenez ! laissez-moi vous lire ça ! s’écria-t-il, en rassemblant les feuilles de son manuscrit. C’est ma dernière œuvre et elle est très différente de tout ce que j’ai écrit jusqu’à présent. Elle l’est même tellement que ça me fait un peu peur… et pourtant j’ai comme une idée que c’est bien. Jugez-en. C’est une histoire d’Hawaï. Je l’ai appelée « Wiki-Wiki ».
Son visage rayonnait de joie créatrice. Ruth avait été frappée de ses mains glacées et elle frissonnait dans la chambre sans feu, mais lui ne semblait pas sentir le froid. Elle écouta attentivement ; et, bien qu’il n’eût remarqué que de la désapprobation sur son visage, il lui demanda quand même à la fin de sa lecture :
– Franchement, qu’en pensez-vous ?
– Je n’en sais rien… répondit-elle. Est-ce que vous croyez que ça se vendra ?…
– Je crains que non, avoua-t-il. C’est trop fort pour les revues. Mais c’est exact, je vous promets que c’est authentique.
– Mais pourquoi persister à écrire des choses pareilles, puisque vous savez que ça ne se vend pas ? poursuivit-elle, inexorablement. Vous écrivez pour gagner votre vie ?
– C’est vrai ; mais c’est plus fort que moi. Je n’ai pas pu m’empêcher d’écrire cette histoire.
– Mais cet individu, ce Wiki-Wiki, pourquoi le faites-vous parler si grossièrement ? Vous choquerez vos lecteurs et c’est sûrement à cause de cela que les éditeurs refusent vos œuvres.
– Le vrai Wiki-Wiki parlerait comme ça.
– Mais c’est une faute de goût.
– C’est la vie, dit-il brusquement. C’est la vie vraie. Je ne peux dépeindre la vie que telle qu’elle est.
Elle ne répondit pas et il y eut un long silence embarrassant. Son amour pour elle l’empêchait de bien la comprendre et elle ne pouvait pas le comprendre parce qu’il lui était trop supérieur.
– Eh bien ! J’ai touché mon argent au Transcontinental, dit-il, en essayant d’orienter la conversation sur un sujet moins épineux.
Le souvenir du trio à favoris, tel qu’il l’avait vu, soulagé de quatre dollars quatre-vingt-dix et d’un ticket de transbordeur, le fit rire.
– Alors, vous venez ! s’écria-t-elle, toute joyeuse. Je venais justement pour le savoir.
– Je viens ?… murmura-t-il distraitement. Où ça ?
– Comment ! mais vous venez dîner demain ! Vous deviez dégager votre complet si vous touchiez votre argent.
– J’avais complètement oublié, avoua-t-il humblement. Figurez-vous que ce matin, l’agent de la fourrière a emmené les deux vaches de Maria et le petit veau et… mon Dieu, Maria n’avait justement pas d’argent et j’ai dû payer pour qu’on lui rende ses vaches. L’Appel des cloches a disparu dans la poche de l’agent !
– Alors, vous ne venez pas ?
– Je ne peux pas, fit-il en regardant son complet minable.
Dans les yeux bleus de Ruth brillèrent des larmes de déception et de reproche, mais elle ne répondit rien.
– Au prochain Thanksgiving Day, nous dînerons ensemble au Delmonico, dit-il gaiement, ou à Londres, ou à Paris, – où vous voudrez ! Je vous le promets !
– À propos, dit-elle à brûle-pourpoint, j’ai vu qu’on avait fait quelques nominations dans les Postes. Vous étiez le premier à passer, n’est-ce pas ?
Il fut forcé de convenir qu’en effet on lui avait offert une place, mais qu’il l’avait refusée.
– Je suis si sûr de moi, conclut-il. Dans un an d’ici, je gagnerai plus que tout le personnel de la Compagnie réuni. Attendez ! vous allez voir.
– Vraiment ! fit-elle sèchement. (Elle se leva et remit ses gants.) Il faut que je parte, Martin, Arthur m’attend.
Elle se laissa embrasser, passive, sans un geste tendre ; son corps ne vibra pas, et ses lèvres rencontrèrent celles de Martin sans cette fougue habituelle. Après l’avoir reconduite à la grille, il se dit qu’elle lui en voulait. Mais pourquoi ? Il était évidemment ennuyeux que l’agent ait coffré les vaches de Maria. Mais il n’y pouvait rien. L’idée qu’il aurait pu agir autrement ne lui venait pas. Il y avait bien cette situation dans les Postes qu’il n’avait peut-être pas eu raison de refuser. Et puis « Wiki-Wiki », qu’elle n’avait pas aimé.
Sur le palier il rencontra le facteur qui faisait sa tournée de l’après-midi. Une curiosité impatiente, toujours nouvelle, enfiévrait Martin chaque fois qu’on lui remettait le courrier. Il y avait aujourd’hui, en plus d’un paquet de longues enveloppes, une mince petite lettre, au coin de laquelle était imprimée l’adresse du New York Outview. Il se dit, avant de l’ouvrir, que ce ne pouvait être une acceptation, puisqu’il n’avait rien envoyé à cette revue. Peut-être, et son cœur bondit à cette pensée, peut-être lui demandait-on un article ! Mais il renonça aussitôt à un espoir aussi absurde.
C’était un petit mot correct de l’éditeur, l’informant simplement qu’il avait reçu la lettre anonyme ci-jointe et l’assurant qu’il n’était fait aucun cas chez eux de ce genre de correspondances.
La lettre en question était grossièrement écrite à la main. C’était un ramassis d’insultes et de calomnies sur Martin. On y affirmait que « le dit Martin Eden » n’avait rien d’un écrivain, qu’il se bornait à voler, de-ci de-là, des articles dans de vieux journaux, à les signer et à les envoyer ensuite aux revues comme étant de lui. L’enveloppe était timbrée de San Leandro et Martin n’eut pas à réfléchir longtemps pour en découvrir l’auteur. L’orthographe de Bernard Higginbotham, le style de Bernard Higginbotham, la mentalité de Bernard Higginbotham, s’y révélaient d’une façon transparente. Oui, c’était bien la patte grossière de son beau-frère qui avait tracé ces lignes imbéciles.
Mais pourquoi ? Il se le demanda vainement. Quel mal lui avait-il fait ? La chose était si insensée que rien ne pouvait l’expliquer. Dans le courant de la semaine, une douzaine de lettres semblables lui furent renvoyées par les éditeurs de plusieurs revues de l’Est et Martin jugea qu’ils agissaient fort bien vis-à-vis d’un inconnu, en somme ; quelques-uns même montrèrent une certaine sympathie. Il était évident qu’ils avaient l’anonymat en horreur et que l’espoir méchant de lui faire du tort avait manqué son but. Au contraire, peut-être cela tournerait-il à son avantage, maintenant que son nom avait attiré l’attention. Il n’était pas impossible qu’un jour, en lisant un de ses manuscrits, on se rappelât l’individu qui avait fait l’objet de lettres anonymes. Et qui sait si leur jugement n’en serait pas influencé favorablement ?
Ce fut à cette époque, que Martin fit un pas énorme dans l’estime de Maria. Un matin il la trouva dans la cuisine, gémissant de douleur, pleurant de fatigue, devant un gros tas de repassage. Il diagnostiqua aussitôt la grippe, lui administra du whisky chaud – reste des largesses de Brissenden – et lui ordonna le lit. Mais Maria ne voulait rien entendre. Le repassage devait être fait, sans quoi les sept petits Silva affamés n’auraient pas de soupe le lendemain.
À son profond étonnement – et jusqu’à son dernier soupir, elle ne cessa de rappeler ce souvenir –, Martin Eden saisit un fer sur le fourneau et jeta un chemisier de fantaisie sur la planche à repasser. C’était le chemisier du dimanche de Kate Flanagan, la plus difficile et la plus élégante cliente de Maria. Miss Kate avait spécifié que la blouse devait lui être livrée le soir même. Ainsi que personne ne l’ignorait, elle était courtisée par John Collins, le forgeron, et Maria savait, de plus, que miss Flanagan et M. Collins devaient aller le lendemain au Golden Gate Park. Maria tenta vainement de sauver la précieuse lingerie. Martin conduisit ses pas chancelants jusqu’à la chaise, d’où elle le surveilla d’un œil hagard. Dans le quart du temps qu’elle aurait pris le chemisier fut repassé et certainement aussi bien.
– Je travaillerais plus vite, dit-il, si vos fers étaient plus chauds.
Jamais elle n’aurait osé se servir de fers aussi chauds que ceux qu’il employait.
– Vous n’humectez pas bien le linge, dit-il ensuite. Tenez, je vais vous montrer comment on fait. Il faut presser, en même temps, si vous voulez repasser en vitesse.
Il se procura une boîte, parmi le tas de bois de la cave, y ajusta un couvercle et rassembla tous les bouts de ferraille que la tribu des Silva collectionnait pour le revendeur. Puis, il empila le linge fraîchement humecté dans la boîte, le comprima à l’aide du couvercle pressé par le tas de ferraille et le tour fut joué.
– Et quand il a eu fini de repasser, il a lavé les lainages, raconta plus tard Maria. « Maria, qu’il a dit, vous êtes ridicule. Je vais vous montrer comment qu’on lave les lainages ! » et il me l’a montré. En deux minutes il a tout manigancé, un tonneau, une vieille roue, deux perches, tout ça, quoi !
Martin avait appris le système de Joe à Shelly Hot Springs.
– Maria n’a plus jamais lavé les flanelles à la main, tranchait-elle invariablement, en achevant son récit. Les enfants faisaient manœuvrer la perche, le tonneau et la roue. Ah ! c’était un débrouillard, M. Eden !
Néanmoins, depuis cette remarquable opération, Martin tomba du piédestal où elle l’avait placé. L’auréole romanesque dont son imagination l’avait paré se dissipa à la lumière crue de ce fait : ce n’était qu’un ancien blanchisseur. Ses livres, ses amis du grand monde qui venaient le voir en voiture ou munis d’innombrables bouteilles de whisky, tout fut réduit à néant. Ce n’était, après tout, qu’un simple ouvrier comme elle, comme tous ceux de son milieu et de sa caste et s’il en était devenu plus humain, plus approchable, tout son attrait mystérieux avait disparu.
Martin continuait à être en froid avec sa famille. Imitant M. Higginbotham, Hermann von Schmidt se dévoila aussi. La vente heureuse de quelques nouvelles, de plusieurs poèmes humoristiques et autres bêtises avait procuré à Martin une passagère prospérité. Il avait payé ses notes, dégagé son complet et sa bicyclette. Mais comme son vélo avait besoin de réparations, il l’envoya gentiment à son futur beau-frère. L’après-midi du même jour, Martin eut le plaisir de voir ramener sa bicyclette par un petit garçon et il en conclut des bonnes dispositions de von Schmidt à son égard. Mais, lorsqu’il examina son vélo, il vit qu’on n’y avait pas touché. Un peu plus tard, il téléphona au magasin et le fiancé de sa sœur lui répondit qu’il ne voulait avoir affaire à lui en aucune façon ni d’aucune manière.
– Hermann von Schmidt, lui répondit Martin aimablement, j’ai terriblement envie d’écraser mon poing sur votre nez germanique.
– Venez-y seulement, lui répondit-il, et j’envoie chercher la police. Je vous ferai coffrer. Oh ! je vous connais, mais vous ne me faites pas peur. Je ne veux rien avoir à faire avec des individus comme vous. Vous êtes un fainéant. Vous n’allez pas m’embêter, parce que j’épouse votre sœur ?… Pourquoi ne cherchez-vous pas de travail et ne gagnez-vous pas honnêtement votre vie ? Répondez un peu à ça ?
Martin fit appel à toute sa philosophie, domina sa colère naissante et raccrocha avec un long sifflement amusé. Puis vint la réaction et le sentiment angoissant de sa solitude. Personne ne le comprenait, personne ne se souciait de lui, excepté Brissenden – et Brissenden avait disparu, Dieu sait où.
Le crépuscule tombait, lorsque Martin sortit de chez le fruitier et se dirigea chez lui, ses provisions sous le bras. Au coin de la rue, un tram avait stoppé et, à la vue de la longue silhouette familière qui en descendait, son cœur bondit de joie. C’était Brissenden et Martin put voir, à la lueur des phares du tram qui s’ébranlait, que les poches de Brissenden étaient pleines, l’une de livres, l’autre de whisky.
35
Brissenden n’expliqua pas les raisons de sa longue absence et Martin ne chercha pas à les savoir. Il était content de voir le visage cadavérique de son ami en face de lui, devant son gobelet de toddy fumant.
– Je n’ai pas été paresseux non plus, annonça Brissenden, après s’être fait donner le compte rendu du travail de Martin.
Il sortit de la poche intérieure de son pardessus un manuscrit et le tendit à Martin, qui en lut le titre avec curiosité, puis le regarda d’un air interrogateur.
– Oui, c’est bien ça, dit Brissenden en riant. Pas mal comme titre, hein ?… Éphémère… C’est le mot qu’il fallait. Et c’est vous qui en êtes responsable, car il s’agit de votre homme, de la créature inorganique, momentanément animée, le dernier des éphémères qu’un degré de plus au thermomètre fait éclore. Je l’avais dans la tête et il m’a fallu écrire pour en être débarrassé. Dites-moi ce que vous en pensez.
Le visage de Martin, d’abord animé, pâlit en lisant. C’était de l’art absolu. La forme triomphait de la substance, si l’on pouvait appeler ainsi une parfaite expression de la substance, comprise dans ses plus impondérables atomes, et Martin en extase, sentit des larmes d’admiration monter à ses yeux et un frisson le parcourir tout entier. C’était un long poème de six ou sept cents lignes, fantastique, terrifiant, inouï, supra-humain. Il traitait de l’homme et de ses rapports ultimes avec son âme tâtonnante : à travers les abîmes de l’espace, celle-ci interrogeait le témoignage des soleils éteints, et le reflet des arcs-en-ciel. C’était une orgie d’imagination, la folle ivresse d’un mourant qui tantôt sanglote tout bas et l’instant d’après s’élance, plein d’un sauvage espoir, au rythme désordonné d’un cœur qui s’éteint. Majestueux, le poème s’envolait jusqu’au tumulte glacé des combats stellaires, au chaos des soleils refroidis et à l’incendie des nébuleuses illuminant les ténèbres de l’infini. Et, à travers tout cela, s’élevait, incessante et frêle, pareille à un frisson cristallin, la faible voix flûtée de l’homme, chétif pépiement parmi le fracas des planètes et le craquement des mondes.
– Il n’existe rien de pareil en littérature, dit Martin, lorsqu’il put parler. C’est inouï ! J’en ai le vertige. Ça m’a soûlé. Ce problème prodigieux, éternel, incessant, ce vagissement de l’homme résonne toujours à mon oreille. On dirait la marche funèbre d’un moustique parmi le barrissement des éléphants et le rugissement des lions. L’insatiabilité du désir microscopique. Je sais que je suis ridicule en ce moment, mais ce n’est pas ma faute. Vous êtes… je ne sais pas… vous êtes extraordinaire… Mais comment faites-vous ? Comment faites-vous ?
Martin interrompit un instant sa rhapsodie, puis repartit de plus belle :
– Je n’écrirai plus jamais. Je ne suis qu’un pâle scribouillard. Vous me montrez ce que c’est que le génie ! c’est plus que du génie. C’est la vérité qui rend fou. C’est vrai à chaque ligne ! Je me demande si vous vous en rendez compte, espèce de dogmatiste !… C’est le verbe du prophète dont les rythmes puissants sont tissés de splendeur et de lumière. Et maintenant assez ! Je suis écrasé, vaincu. Si, encore un mot : laissez-moi m’occuper de le faire publier !
Brissenden ricana.
– Pas une revue de la chrétienté n’osera jamais publier ça, vous le savez bien !
– Je suis sûr, au contraire, que toutes se précipiteront dessus. Elles ne reçoivent pas tous les jours de pareilles œuvres. Ce n’est pas le poème de l’année : c’est le poème du siècle.
– J’ai bien envie de vous prendre au mot !
– Ne soyez pas cynique, conseilla Martin. Les éditeurs ne sont pas tous idiots. Et je veux bien accepter la gageure. Je vous parie tout ce que vous voudrez qu’Éphémère sera accepté à la première ou à la seconde offre.
– Il n’y a qu’une seule chose qui m’empêche de tenir le pari. (Brissenden se tut un instant.) Ce machin-là est fort, c’est ce que j’ai fait de plus fort. C’est mon chant du cygne. J’en suis fier. Je l’admire. C’est meilleur que le whisky. C’est la réalisation de mon rêve de jeunesse, quand j’étais un adolescent aux douces illusions, au pur idéal. Et maintenant que je l’ai réalisé avant de mourir je ne veux pas qu’il soit marchandé, tripoté, sali par un troupeau de pourceaux. Non, je ne tiens pas le pari. C’est à moi, c’est mon œuvre, et c’est un peu la vôtre aussi.
– Mais pensez aux autres ! la fonction de la beauté c’est de donner de la joie.
– Cette beauté m’appartient.
– Ne soyez pas égoïste !
– Je ne suis pas égoïste. (Brissenden ricana doucement, ainsi qu’il faisait d’habitude avant de dire quelque chose qui l’amusait.) Je ne suis pas plus égoïste qu’un chien affamé.
Martin s’efforça en vain de le faire revenir sur sa décision ; il lui déclara que sa haine des magazines était morbide et qu’il se conduisait d’une façon plus méprisable encore que le jeune Érostrate qui brûla le temple de Diane à Éphèse. Brissenden reçut l’avalanche d’injures d’un air satisfait, tout en sirotant son toddy et lui affirma qu’elles étaient parfaitement justifiées, excepté en ce qui concernait les éditeurs. Sa haine envers eux ne connaissait aucune limite et sur ce sujet le vocabulaire injurieux qu’il déversait, dépassait de beaucoup celui de Martin.
– Copiez-moi ça à la machine, dit-il. Ce sera bien mieux fait que par n’importe quelle dactylo. Et maintenant, laissez-moi vous donner quelques conseils. (Il tira de la poche extérieure de son pardessus un épais manuscrit.) Voici votre Honte du soleil. Je l’ai lu non pas une fois, mais trois ou quatre fois – c’est le plus grand compliment que je puisse vous faire. Après ce que vous m’avez dit d’Éphémère, je n’ai plus qu’à me taire. Mais laissez-moi vous dire ceci : quand La Honte du soleil paraîtra, ça fera sensation. Votre œuvre provoquera des controverses qui vous vaudront toute la publicité du monde.
Martin se mit à rire.
– Il ne manque plus que vous ayez l’audace de me conseiller de le soumettre aux magazines !
– Surtout pas ! Si vous voulez que ça paraisse, offrez-le à une maison d’édition de premier ordre. Vous tomberez peut-être sur un type assez fou ou assez soûl pour l’accepter. L’essence même, le sang concentré de tout ce que vous avez lu de beau, épuré encore en passant par l’alambic du cerveau de Martin Eden, s’est exprimé dans La Honte du soleil et Martin Eden, un jour, sera célèbre, en grande partie à cause de cette œuvre. Donc, vous devez chercher un éditeur, – le plus tôt sera le mieux.
Brissenden resta longtemps ce soir-là ; déjà perché sur la première marche du tram, il se retourna vivement vers Martin et lui glissa un petit chiffon de papier tout froissé.
– Tenez, prenez ça, dit-il. J’ai été aux courses aujourd’hui et suis tombé sur le bon tuyau.
Le timbre sonna et le tram s’ébranla, laissant Martin sur la chaussée à se demander ce que pouvait être ce bout de papier graisseux. Rentré dans sa chambre, il vit que c’était un billet de cent dollars.
Il ne se fit aucun scrupule de l’accepter, sachant d’abord que son ami était bourré d’argent ; de plus, il était absolument certain de pouvoir le lui rendre un jour. Le lendemain, il paya toutes ses notes, trois mois d’avance à Maria et dégagea tout ce qu’il avait porté au Mont-de-Piété. Puis il acheta le cadeau de mariage de Marianne et des cadeaux de Noël pour Ruth et Gertrude. Enfin, il emmena toute la tribu des Silva dans Oakland et, tenant sa promesse, avec quelques mois de retard, leur acheta à tous des chaussures ainsi qu’à Maria. Des trompettes, des poupées, des kilos de bonbons et de gâteaux encombrèrent finalement les bras des sept gosses ahuris de joie.
Ce fut au moment où il entrait avec Maria chez un confiseur, en quête d’un gigantesque sucre d’orge, suivi par cette extraordinaire procession qui se pressait sur ses talons, qu’il rencontra Ruth et sa mère. Mme Morse fut choquée. Ruth fut vexée, car elle avait un certain souci des apparences et la vue de l’homme qu’elle aimait, bras dessus, bras dessous avec Maria, traînant à sa suite une horde de petits loqueteux, n’offrait rien de bien flatteur. Mais, ce qui la désola le plus dans cet incident, c’est qu’elle y vit l’impossibilité de jamais le faire rompre avec son milieu. Bien plus, il l’affichait ouvertement à la face du monde, de son monde à elle. Vraiment c’était aller trop loin Bien que ses fiançailles avec Martin aient été tenues secrètes, leur longue intimité n’avait pas été sans faire jaser et, dans les magasins, elle avait aperçu plusieurs de leurs connaissances, regardant à la dérobée son flirt et son étrange suite. Aussi étroite et conventionnelle que Martin était large et généreux, il lui était impossible de s’élever au-dessus des contingences. Elle fut donc piquée au vif, ulcérée jusqu’au fond de l’âme, au point que Martin, lorsqu’il vint chez elle, plus tard, garda son cadeau de Noël dans sa poche, car il préférait le réserver pour une occasion plus favorable. Ruth en larmes, pleurant de honte et de colère, lui fut une révélation. Il se dit qu’il était une brute, mais sans savoir exactement pourquoi ni comment, car l’idée d’être honteux de ses amis ne lui vint pas un instant à l’esprit, comme il lui sembla que Ruth ne pouvait en aucune façon lui en vouloir du fait d’avoir procuré aux Silva un peu de bonheur pour Noël. Ensuite, lorsque Ruth lui eut expliqué son point de vue, il le comprit et le regarda comme une de ces faiblesses bien féminines dont toutes les femmes, même les meilleures, sont affligées.
36[3]
La première chose que fit Martin, le lendemain matin, fut d’agir exactement à rencontre de la volonté de Brissenden et de ses conseils. Il commença par expédier La Honte du soleil à The Acropolis, pensant que, s’il parvenait à la faire publier par une revue, une maison d’édition la lui prendrait ensuite d’autant plus facilement. Il envoya Éphémère à une revue également. En dépit de la phobie de Brissenden contre les revues, Martin décida que cet admirable poème devait voir le jour. Non pas qu’il crût pouvoir se permettre de le faire publier sans sa permission. Mais, une fois le poème accepté par un grand magazine, il espérait obtenir le consentement de son ami.
Ce matin-là, Martin commença une histoire esquissée quelques semaines auparavant et qui n’avait cessé de le hanter depuis. Elle devait se passer au XXe siècle, sur mer, être pleine d’aventures et de romanesque et évoluer cependant dans un monde réel, avec des personnages réels, dans des conditions vraisemblables. Mais à travers la trame pittoresque du récit, il y aurait autre chose, qu’un lecteur superficiel ne sentirait peut-être pas et qui en constituerait la valeur pour celui qui savait lire entre les lignes. Trop tard ! devait en être le titre et ça devait avoir au minimum soixante mille mots, – une bagatelle, étant donné la facilité de sa production. Il se plongea ce jour-là dans le travail avec le sentiment délicieux de l’ouvrier qui sent ses outils bien en main et n’a plus à craindre qu’un faux mouvement ne gâche sa besogne. Ses longs mois d’application et d’étude portaient leurs fruits. Il pouvait à présent, dégagé des détails élémentaires, s’appliquer d’une main sûre aux grandes lignes d’une œuvre et, d’heure en heure, il se rendait compte, comme jamais auparavant, de la façon solide et large dont il comprenait la vie et les choses de la vie – grâce à Herbert Spencer, se dit-il, en s’arrêtant une seconde d’écrire. Oui, c’est à Spencer qu’il devait la clé de la vie : l’évolution.
Il sentit que ce qu’il écrivait serait d’une grande envergure. « Ça marche ! ça marche ! » se répétait-il sans cesse. Enfin il avait découvert le genre de choses qui plairait forcément aux magazines. L’histoire tout entière fulgura devant ses yeux. Il s’interrompit pour écrire dans son calepin un long paragraphe, le dernier de Trop tard ! Le livre tout entier était si parfaitement composé dans sa tête, qu’il en pouvait déjà écrire la fin. Il le compara aux histoires de marins qu’il connaissait.
– Il n’y en a qu’un seul qui en approcherait, murmura-t-il tout haut, c’est Conrad. Et même celui-là pourrait venir me serrer la main et me dire : « C’est bien, Martin, mon garçon ! »
Il travailla toute la journée et ne se rappela qu’au dernier moment qu’il devait dîner chez les Morse. Grâce à Brissenden, son complet noir était dégagé et il pouvait de nouveau dîner en ville. Auparavant, il courut jusqu’à la librairie, acheter Le Cycle de la vie, un essai sur Spencer dont Brissenden avait parlé. À peine en tram, il l’ouvrit et à mesure qu’il lisait, la colère l’envahissait : le sang au visage, la mâchoire serrée, son poing se fermait, s’ouvrait puis se refermait, comme pour saisir et broyer quelque chose de haïssable. Une fois descendu du tram, il arpenta furieusement le trottoir et sonna à la porte des Morse avec une telle rage qu’il retrouva du coup sa maîtrise de soi et sourit de s’être emporté à ce point. À peine fut-il entré chez les Morse, qu’il se sentit oppressé. Bourgeois, boutiquiers, avait dit d’eux Brissenden… Mais quoi ? s’interrogea-t-il, furieux contre lui-même. Il épousait Ruth et non pas sa famille.
Il lui sembla que Ruth n’avait jamais été si belle, si éthérée et, du même coup, si bien portante. Ses joues étaient colorées et il ne pouvait s’empêcher de constamment regarder ses yeux, les yeux dans lesquels, pour la première fois, il avait lu l’immortalité. Depuis quelque temps, il négligeait un peu l’immortalité ! Mais, à cet instant, dans les yeux de Ruth, il lisait l’argument sans paroles qui réduisait à néant les arguments les plus spécieux. Toute discussion s’éteignait devant ces yeux, car il y voyait de l’amour. Cet amour était indéfinissable, incompréhensible, infini. Telle était sa doctrine passionnée.
Avant le dîner, il eut avec elle une demi-heure d’aparté qui le rendit profondément heureux et satisfait de vivre. Mais à table, l’inévitable réaction de sa dure journée de travail se fit sentir ; il avait mal aux yeux, se sentait irritable, nerveux. Il se souvint qu’à cette même table qu’il dénigrait à présent et où il s’ennuyait si souvent, il avait pour la première fois mangé avec des gens civilisés, dans ce qu’il imaginait alors le milieu le plus hautement intellectuel et le plus raffiné. Il évoqua le pathétique Martin Eden de ce soir-là, le sauvage embarrassé de lui-même, suant l’appréhension par tous les pores, affolé devant les mystères de la bienséance, médusé par le maître d’hôtel qui lui faisait l’effet d’un ogre, s’essayant à franchir d’un seul coup le gouffre énorme qui le séparait de ces êtres supérieurs et se décidant enfin à demeurer lui-même et à ne pas singer plus longtemps une éducation qu’il n’avait pas.
Il lança un coup d’œil inquiet à Ruth, un peu comme ces passagers qui, saisis par une panique soudaine, cherchent des yeux la ceinture de sauvetage. Si tout le reste avait fait faillite, il avait du moins gagné l’amour et Ruth. Seuls, Ruth et l’amour avaient supporté l’épreuve des livres et mérité la sanction biologique. L’amour était l’expression la plus exaltée de la vie. La nature avait travaillé un million de siècles à faire éclore ce chef-d’œuvre en lui, à le parfaire, à l’embellir de toutes les merveilles de l’imagination, pour le lancer ensuite sur cette planète à seule fin de vibrer, d’aimer et de s’unir. Sa main chercha celle de Ruth sous la table et elles échangèrent une ardente pression. Ruth le regarda rapidement ; ses yeux rayonnants, fondaient de tendresse. Un frisson le parcourut ; il ne se rendit pas compte que ce qu’il avait vu de si beau dans ce regard n’était que le reflet de ce qu’avait projeté le sien.
En face de lui, à la droite de M. Morse, était assis M. Blount, juge à la cour suprême. Martin l’avait rencontré plusieurs fois, sans parvenir à l’apprécier. Lui et M. Morse discutaient syndicalisme, situation locale, socialisme et M. Morse s’efforçait d’attirer Martin dans la discussion et de le mettre dans son tort. À la fin, le juge Blount lui lança un regard à la fois indulgent et plein d’une paternelle pitié, ce qui fit sourire Martin en dedans.
– Ça vous passera, jeune homme, dit-il d’un ton doucereux. Le temps est le meilleur remède pour tempérer les exagérations de la jeunesse. (Il se tourna vers M. Morse :) Dans des cas semblables, la discussion ne vaut rien. Elle ne sert qu’à renforcer l’entêtement du patient.
– C’est exact, répondit gravement M. Morse. Mais il est bon parfois de renseigner le patient sur son état.
Martin eut un rire joyeux, un peu forcé. La journée trop longue, trop intense provoquait en lui une réaction pénible.
– Je ne doute pas que vous ne soyez tous les deux d’excellents médecins, dit-il, mais, si vous vous souciez le moins du monde de l’avis du patient, permettez-moi de vous dire que votre diagnostic ne vaut pas grand-chose. En fait, vous souffrez de la maladie que vous me découvrez, soi-disant. Moi, je suis à l’abri. La philosophie socialiste que vous essayez péniblement de digérer, moi, je ne l’ai pas avalée.
– Pas mal, pas mal ! murmura le juge. C’est une excellente ruse, en controverse, que de renverser les situations.
– Pour vous ! (Les yeux de Martin lançaient des éclairs, mais il garda son sang-froid.) Voyez-vous, monsieur le Juge, j’ai suivi vos discours pendant la campagne électorale. Par un phénomène d’autosuggestion, vous vous persuadez que vous croyez au système des compétitions et à la suprématie du plus fort et en même temps, vous sanctionnez, tant et plus, toutes les mesures capables de diminuer la puissance du plus fort.
– Jeune homme…
– Rappelez-vous que j’ai entendu vos discours, répéta Martin. Il est flagrant que votre position, en ce qui concerne la réglementation du commerce intérieur, le trust des Chemins de fer et la Standard Oil, la conservation des forêts et mille autres mesures restrictives, est nettement socialiste.
– Voudriez-vous me faire croire que vous n’approuvez pas la réglementation de ces odieux abus de pouvoir ?
– Là n’est pas la question. Je tiens seulement à vous prouver l’inanité de votre diagnostic. Je tiens à vous dire que le microbe du socialisme ne m’a pas atteint et que c’est vous, au contraire, qu’il ronge et qu’il émascule. Quant à moi, je suis un adversaire résolu du socialisme, comme de votre démocratie hybride, qui n’est autre chose qu’un pseudo-socialisme que vous dispensez à coups de grands mots qui ne veulent rien dire.
« Je suis réactionnaire, tellement réactionnaire que mes opinions ne peuvent que vous être incompréhensibles, à vous qui vivez dans le mensonge d’une organisation sociale truquée et dont la vue n’est pas assez perçante pour découvrir ce truquage. Vous faites semblant de croire à la suprématie du plus fort et aux lois du plus fort. Moi, j’y crois. Voilà la différence. Quand j’étais un peu plus jeune, j’étais comme vous. Vos idées m’avaient influencé. Mais les marchands, les commerçants ne sont tout au plus que des patrons peureux qui passent leur vie à lécher l’assiette au beurre. Alors, je me suis retourné vers l’aristocratie. Ici, à cette table, je suis le seul individualiste. Pour moi, l’État n’est rien. J’attends l’homme fort, le Chevalier sans peur qui viendra sauver l’État de ce néant fangeux. Nietzsche avait raison – je ne perdrai pas mon temps à vous expliquer qui était Nietzsche – mais il avait raison. Le monde appartient aux forts, à ceux qui allient la force à la noblesse d’âme, qui ne se vautrent pas dans les mares croupies des compromissions, dans les pots-de-vin et les affaires plus ou moins véreuses. Le monde appartient à la grande brute racée, à celui qui n’a qu’une parole et qui la tient, aux vrais aristocrates. Et ils vous mangeront, vous, les socialistes qui avez peur du socialisme. Votre morale d’esclave ne vous sauvera pas. Je sais bien que tout cela est de l’hébreu pour vous et je ne vous ennuierai pas davantage. Mais souvenez-vous d’une chose : il n’y a peut-être qu’une demi-douzaine d’individualistes dans tout Oakland – Martin Eden est un de ceux-là.
Il se tourna vers Ruth, signifiant par là qu’il était décidé à ne plus discuter davantage.
– Je suis à bout ce soir, dit-il à mi-voix Tout ce que je peux faire encore, c’est de vous aimer.
Il fit semblant de ne pas entendre M. Morse qui disait :
– Je ne suis pas convaincu. Tous les socialistes sont jésuites dans l’âme. Voilà ce qu’il faut leur dire.
– Nous arriverons tout de même un jour à faire de vous un bon républicain, dit le juge Blount.
– Le sauveteur viendra avant, répondit Martin avec bonne humeur, puis il se tourna à nouveau vers Ruth.
Mais M. Morse n’était pas satisfait. La paresse de son futur gendre, sa répulsion pour tout travail « sérieux », ses idées inquiétantes, sa nature incompréhensible lui causaient un vif déplaisir. M. Morse lança donc la conversation sur Herbert Spencer. Le juge le seconda de son mieux et Martin, qui avait dressé l’oreille en entendant prononcer le nom du philosophe, entendit le digne magistrat énoncer gravement, avec complaisance, une diatribe sévère contre Spencer. De temps à autre, M. Morse lançait un regard furtif à Martin comme pour dire : Là, mon garçon, vous voyez bien.
– Sinistres raseurs ! marmotta Martin et il continua à discuter avec Ruth, mais le travail de la journée l’avait éprouvé et il était nerveux.
– Qu’avez-vous ? lui demanda Ruth tout à coup, inquiète de voir l’effort qu’il faisait pour se contenir.
– Il n’y a de Dieu que l’Inconnu et Herbert Spencer est son prophète ! disait le juge à ce moment précis.
Martin se retourna vers lui.
– Jugement facile, fit-il avec calme. Je l’ai entendu prononcer pour la première fois au City Hall Park, par un homme du peuple qui aurait dû être mieux renseigné. Depuis, je l’ai entendu souvent – et chaque fois, la bêtise de cette phrase me donne des nausées. Vous devriez être honteux. Entendre le nom de ce grand homme sur vos lèvres, c’est trouver une rose dans une poubelle. Vous me dégoûtez.
Ce fut catastrophique. Le juge le foudroya du regard et parut sur le point d’avoir une attaque d’apoplexie. M. Morse se réjouissait, dans son for intérieur : sa fille était visiblement choquée et c’était bien ce qu’il voulait faire : amener cet homme qu’il n’aimait pas à révéler sa brutalité et son manque absolu d’éducation.
La main de Ruth, implorante, alla chercher celle de Martin sous la table, mais le fauve était lâché. La prétention intellectuelle et le mensonge de ceux qui occupent les plus hautes situations, l’indignaient. Un juge de la cour suprême ! – Dire que peu d’années auparavant il avait regardé ces glorieuses entités comme des demi-dieux ! Le juge reprit son calme et tenta de continuer la discussion en affectant une politesse qui, Martin le comprit parfaitement, s’adressait uniquement aux femmes présentes. Ça l’exaspéra davantage encore. N’y avait-il décidément aucune sincérité de par le monde ?
– Vous ne pouvez pas discuter Spencer avec moi ! s’écria-t-il. Pas plus que ses propres compatriotes, vous ne le connaissez. Mais ce n’est pas votre faute, je vous l’accorde. Ça tient à la méprisable ignorance de l’époque où nous vivons.
« Un philosophe de l’Académie, qui n’était pas digne de respirer le même air que lui, l’a appelé : « le philosophe des demi-cultivés ». Je ne crois pas que vous ayez lu dix pages de Spencer ; mais certains critiques, probablement plus intelligents que vous, n’en ont pas lu davantage et ils osent défier ses disciples de trouver une seule idée dans tous ses écrits, des écrits de Spencer ! de l’homme dont le génie a influencé la science et la pensée modernes ; du père de la psychologie, de celui qui révolutionna la pédagogie de telle façon, que le petit paysan français en apprenant à lire, apprend ses principes ! Et des hommes insignifiants essaient de salir sa mémoire, quand le peu de connaissances qu’a emmagasiné leur cerveau lui est dû, en grande partie !
« Et pourtant, un homme comme Fairbank, le principal d’Oxford, un homme qui occupe une situation plus élevée que la vôtre, monsieur le Juge, a déclaré que Spencer sera considéré par la postérité comme un poète et un rêveur, plutôt que comme un penseur. Roquets et fantoches ! « Ses Premiers principes ne sont pas entièrement dénués d’un certain charme littéraire », a dit un autre. Et d’autres encore ont dit qu’il était un adroit besogneux, plutôt qu’un penseur original. Roquets et fantoches ! Roquets et fantoches ! »
Martin s’arrêta. Il y eut un silence de mort. Toute la famille de Ruth tenait le juge Blount pour un homme remarquable et puissant et la sortie de Martin les horrifia. Le dîner s’acheva dans une atmosphère de cérémonie funèbre. Le juge et M. Morse parlaient exclusivement ensemble : les autres parlaient à bâtons rompus. Puis, quand Ruth et Martin furent seuls, il y eut une scène.
– Vous êtes impossible ! sanglota-t-elle.
Furieux encore, Martin marmottait : « Les brutes ! les brutes ! »
Quand elle lui affirma qu’il avait insulté le juge, il répliqua :
– Parce que je lui ai dit la vérité !
– Que ce soit vrai ou faux, ça m’est égal ! s’écria-t-elle. Il y a des limites qu’on ne doit pas franchir, et vous n’aviez aucun droit d’insulter quelqu’un.
– Alors, pourquoi le juge Blount a-t-il le droit de dénaturer la vérité ? demanda Martin. Dénaturer la vérité est une chose beaucoup plus grave qu’insulter une aussi piètre personnalité que celle du juge. Il a fait pire. Il a sali la mémoire d’un grand mort. Les brutes ! les brutes !
Sa colère se réveilla de plus belle, devant Ruth épouvantée. Jamais elle ne l’avait vu si furieux et elle le trouvait déraisonnable et incompréhensible. Et pourtant, à travers son ressentiment craintif, l’ancien charme l’attirait encore vers lui, ce charme qui l’avait autrefois poussée à nouer ses deux mains sur la nuque de Martin. Ce soir encore, bien qu’humiliée et blessée par la scène du dîner, elle s’abandonna dans ses bras, tandis qu’il répétait : « Les brutes ! les brutes ! » – ajoutant finalement : « Je ne m’assoirai plus à votre table, chérie. Ils ne m’aiment pas et c’est mal de ma part de leur imposer une présence désagréable. Bon sang ! ils me rendent malade. Et dire que dans ma naïveté j’avais cru que les gens qui occupaient les situations élevées, qui habitaient de belles maisons et qui avaient de l’éducation et un compte en banque, étaient tous des gens supérieurs ! »
37
– Venez ! allons à la réunion.
Ainsi parla Brissenden, encore faible d’une hémorragie qui l’avait pris une demi-heure auparavant – la seconde en trois jours. Son éternel verre de whisky à la main, il l’avala d’un trait, tout tremblant encore.
– Vous savez, moi, le socialisme… fit Martin.
– Les opposants sont autorisés à parler pendant cinq minutes, insista le malade. Levez-vous et allons-y ! Dites-leur pourquoi vous ne voulez pas du socialisme. Dites-leur ce que vous pensez d’eux et de leur éthique surannée. Flanquez-leur Nietzsche à la figure et soyez rosse à tour de bras. Faites du boucan. Ça leur fera du bien ! Ils ont besoin de discuter et vous aussi. Voyez-vous, j’aimerais vous voir devenir socialiste avant de mourir. C’est la seule chose qui vous sauvera de la désillusion qui vous attend.
– Je n’arrive pas à comprendre comment vous – vous entre tous – pouvez être socialiste, s’étonna Martin. Vous détestez tellement le « populo ». Il n’y a vraiment rien, dans la canaille, qui puisse plaire à votre âme éprise d’esthétique ! (Il désigna du doigt le verre de whisky que son ami remplissait de nouveau.) Le socialisme n’a pas l’air de vous guérir !
– Je suis très malade, répondit l’autre. Pour vous, c’est différent. Vous avez la santé et mille raisons de vivre. Et il faut vous enchaîner à la vie d’une façon définitive. Vous vous demandez pourquoi je suis socialiste ? Je vais vous le dire. C’est parce que le socialisme est inévitable ; parce que le système actuel est déraisonnable et pourri, parce que les temps sont passés pour votre sauveteur. Les esclaves n’en voudront pas. Ils sont trop nombreux et, coûte que coûte, ils le feront tomber avant même qu’il ne se soit élancé dans l’arène. Vous ne pourrez pas vous esquiver et vous serez forcé d’avaler toute cette morale d’esclaves. Ce ne sera pas joli, joli, je l’avoue. Mais, quand le vin est tiré, il faut le boire. Vous êtes antédiluvien, d’ailleurs, avec vos idées nietzschéennes. Le passé est le passé et celui qui raconte que l’histoire se répète est un menteur. Bien entendu, je déteste la foule ; mais que faire ? N’importe quoi est préférable aux timides pourceaux qui nous gouvernent. En tout cas, venez ! À présent, je suis rond juste ce qu’il faut, tandis que si je reste ici, je serai complètement ivre. Et vous savez ce que dit ce docteur que le diable emporte ? Je lui ferai perdre son latin, vous verrez !
C’était un dimanche soir et ils trouvèrent la petite salle bondée de socialistes d’Oakland, presque tous ouvriers. L’orateur, juif intelligent, excita l’admiration de Martin, en même temps que son esprit de contradiction. Les épaules voûtées, la poitrine étroite, il affirmait assez son extraction et sa race et Martin ressentit puissamment la lutte centenaire des faibles, misérables esclaves, contre la poignée d’hommes qui les gouvernent et les gouverneront jusqu’à la fin des siècles. Pour Martin, cet être ratatiné était un symbole. Il représentait vraiment toute cette lamentable masse de chétifs, d’incapables, qui périssent selon les lois biologiques, parce qu’ils n’ont pas la force de lutter pour vivre. C’est le déchet. En dépit de leurs raisonnements philosophiques et de leurs ruses, la nature les rejette, pour choisir l’homme exceptionnel. De toutes les splendides semailles jetées par sa main prolifique, elle ne sélectionne que les meilleurs sujets, de même que l’homme, la singeant, élève des chevaux ou cultive des melons. Bien entendu, les sacrifiés ne se laissent pas faire sans pousser les hauts cris. Les socialistes n’ont jamais cessé de crier comme criaient cet orateur rachitique et son public surexcité, qui réclamaient à grands cris et palabraient sur le moyen de réduire au minimum les misères de l’existence.
Telles furent les réflexions de Martin et c’est ainsi qu’il parla quand Brissenden l’invita à leur secouer les puces. Il monta sur l’estrade et, selon l’habitude, s’adressa au président de la réunion. Au début, il parla d’une voix basse, avec des pauses, rassemblant les idées que le discours du juif avait fait naître dans son cerveau. Dans ces meetings, cinq minutes étaient accordées à chaque orateur : mais au bout de cinq minutes, Martin était lancé à fond, l’intérêt du public était capté et, par acclamations, on demanda au président de laisser la parole à Martin. Ils appréciaient cet adversaire digne d’eux, buvaient sa parole enflammée. Cependant, il leur assenait la vérité dure, en attaquant franchement les esclaves, leur morale, leur tactique sans leur dissimuler qu’il s’agissait d’eux. Il cita Spencer, Malthus et la loi biologique de l’évolution.
– Donc, conclut-il, en résumant rapidement, un État composé d’esclaves ne peut vivre. La vieille loi du développement des races tient toujours. Ainsi que je l’ai démontré, les forts et leur progéniture seuls, tendent à survivre à travers la lutte pour l’existence, tandis que les faibles et leur progéniture devront être écrasés. Il en résulte que, les forts seuls ayant survécu, la force de chaque génération augmentera. Telle est la loi. Mais, vous autres esclaves – il est triste d’être esclave, je vous l’accorde – rêvez d’une société d’où sera bannie l’évolution, où les faibles et les incapables pourront manger à leur faim, toute la journée s’ils le désirent, où ils se marieront et procréeront, tout comme les forts. Quel résultat obtiendrez-vous ?… La force et la valeur de la race diminueront de génération en génération. Votre société d’esclaves, créée par des esclaves et pour des esclaves, doit fatalement se dissoudre, tomber en poussière. Votre philosophie d’esclaves aura trouvé sa Némésis.
« Je vous rappelle que j’énonce des faits biologiques et non une éthique sentimentale. Aucun gouvernement d’esclaves ne peut exister…
– Que faites-vous des États-Unis ? hurla une voix dans l’auditoire.
– Des États-Unis ? répondit Martin. Écoutez ! Les treize colonies rejetèrent un jour leurs chefs et formèrent une soi-disant République. Les serfs devinrent leurs propres chefs. Mais, comme vous ne pouviez pas vous passer d’obéir, une nouvelle espèce de maîtres s’érigea, faite, non pas d’hommes grands, virils et nobles, mais de marchands rusés et cauteleux, d’usuriers avides. Et ils vous réduisirent de nouveau en esclavage, non pas franchement, ainsi que l’auraient fait de vrais hommes, par la puissance de leurs bras et de leur valeur réelle, mais hypocritement, au moyen de louches machinations, de basses cajoleries et de mensonges éhontés. Ils ont acheté vos juges, débauché votre magistrature et réduit vos enfants à des horreurs pires que l’esclavage. Deux millions de vos enfants peinent à l’heure qu’il est, dans cette oligarchie commerciale que sont les États-Unis. Deux millions d’esclaves, à peine nourris, à peine abrités !
Je reviens à la question. J’ai démontré qu’aucune société d’esclaves ne peut subsister, parce que, par sa nature même, elle annule la loi du développement. À peine une organisation de ce genre sera-t-elle édifiée qu’elle contiendra le germe de sa propre désorganisation. Il vous est facile de parler d’annuler cette loi de l’évolution, mais en connaissez-vous une autre qui maintiendra votre force ? Si vous en connaissez une, dites-le.
Martin revint s’asseoir au milieu d’un tumulte indescriptible. Une vingtaine d’individus, debout, réclamaient la parole à grands cris. Un par un, encouragés par les vociférations et les applaudissements-, ils répondirent à l’attaque de Martin, avec fougue et à grands gestes. Ce fut une nuit épique, mais toute de combat intellectuel, de lutte pour les idées. Presque tous s’adressèrent directement à Martin – quelques-uns trop sincères pour être polis – et plus d’une fois le président dut frapper sur son pupitre et rappeler à l’ordre.
Cependant, un jeune reporter se trouvait dans l’assemblée en quête d’un article à sensation. Non pas un grand reporter, certes ; il ne possédait qu’une certaine facilité et pas mal de verve. La discussion était un peu ardue pour lui, bien qu’il eût le confortable sentiment d’être infiniment supérieur à tous ces bavards fanatiques. Il avait également un énorme respect pour les grands manitous, pour ceux qui dirigent la police des nations et gouvernent la presse. Enfin il avait un idéal : celui d’arriver à être le parfait reporter, le reporter-type, celui qui, d’un petit fait divers de rien du tout, est capable de faire une catastrophe sensationnelle.
Il ignorait complètement de quoi il s’agissait et ce n’était d’ailleurs pas nécessaire. À l’instar du paléontologiste qui reconstitue tout un squelette avec un os de fossile, il était capable de reconstituer tout un discours sur ce seul mot : « Révolution ». C’est ce qu’il fit, ce soir-là, fort bien d’ailleurs ; et comme Martin avait fait sensation, il mit le discours tout entier dans sa bouche et en fit l’archi-anarchiste de toute la réunion, transformant son individualisme réactionnaire en socialisme outrancier, du rouge le plus violent. Le jeune reporter était artiste ; Il brossa donc largement, avec un grand souci de la couleur locale, le tableau de ces dégénérés neurasthéniques, aux longs cheveux, aux yeux terrifiants, brandissant leurs poings serrés, clamant leurs revendications avec des voix enragées de colère, parmi les hurlements, les injures et les grognements rauques d’une foule furieuse.
38
Le lendemain matin, dans sa petite chambre, Martin lut le journal, en buvant son café. Il s’y trouva en vedette et en première page et fut très surpris d’apprendre qu’il était le leader le plus notoire des socialistes d’Oakland. Il parcourut le discours violent que le jeune reporter lui avait attribué, en fut d’abord furieux, puis jeta le journal en riant.
– Ou bien cet homme était soûl, ou c’est un aimable farceur, déclara-t-il, l’après-midi, juché sur son lit, quand Brissenden, aussitôt entré, se fut affalé sur l’unique chaise.
– Qu’est-ce que ça peut faire ? dit Brissenden. Je suppose que l’approbation de ces salauds de bourgeois qui lisent ce journal vous importe peu ?
Martin réfléchit un instant, puis répondit :
– Non : elle m’indiffère. D’un autre côté, il est probable que mes rapports avec la famille de Ruth vont devenir tant soit peu tendus. Son père m’a toujours pris pour un socialiste et cette stupide histoire va le confirmer dans son idée. Non pas que je me soucie de son opinion, mais à quoi bon ? – Je voudrais vous lire ce que j’ai fait aujourd’hui. Il s’agit de Trop tard ! bien entendu ; j’en ai déjà fait à peu près la moitié.
Il lisait à haute voix, quand Maria ouvrit la porte et introduisit un jeune homme propret, dont le regard vif, faisant immédiatement le tour de la pièce, enregistra le fourneau à pétrole et l’attirail de cuisine, avant d’arriver jusqu’à Martin.
– Asseyez-vous, dit Brissenden.
Martin fit place au jeune homme sur le lit et attendit qu’il leur communique le but de sa visite.
– Je vous ai entendu parler hier soir, monsieur Eden, et je viens vous interviewer, fit-il.
Brissenden éclata de rire.
– Un camarade socialiste ? demanda le reporter, dont l’œil rapide évalua le personnage cadavérique.
– C’est lui qui a écrit cet article ! dit suavement Martin. Comment ! mais c’est un gamin.
– Pourquoi ne lui cassez-vous pas la figure ? répondit Brissenden. Je donnerais bien un billet de mille dollars pour avoir, pendant cinq minutes seulement, mes poumons d’antan.
Le jeune reporter fut légèrement perplexe du tour que prenait la conversation, conversation qui se poursuivait par-dessus sa tête et dont il faisait les frais. Mais on l’avait félicité de sa brillante description du meeting socialiste et il était envoyé pour interviewer personnellement Martin Eden, le principal meneur d’un péril social. Il se considérait donc en service commandé.
– Vous ne voyez aucun inconvénient à ce qu’on vous photographie, monsieur Eden ? dit-il. Mon photographe est dehors et dit qu’il serait préférable de vous prendre tout de suite, pendant qu’il fait encore jour. Nous pourrons nous occuper de l’interview ensuite.
– Un photographe ! dit Brissenden, rêveur. Cassez-lui la figure, Martin !
– Je crois que je vieillis, dit Martin. Je devrais le faire, c’est évident, mais je n’en ai pas le courage. Est-ce que ça en vaut réellement la peine ?
– Faites-le pour sa mère ! insista Brissenden.
– C’est une considération, répliqua Martin, mais je crains vraiment de me fatiguer inutilement. Il faut de l’énergie, vous savez, pour casser la figure à un type. Et puis, à quoi ça sert ?
– Parfait ! c’est ainsi qu’il faut prendre la chose ! déclara le jeune homme d’un air dégagé, bien qu’il eût lancé quelques regards inquiets vers la porte.
– Mais il n’a pas écrit un seul mot de vrai, poursuivit Martin en s’adressant toujours à Brissenden.
– Ce n’était, en somme, qu’un compte rendu très général, hasarda le jeune homme, et d’ailleurs, c’est une excellente réclame. C’est la seule chose qui compte. C’est une faveur qu’on vous a faite.
– C’est une excellente réclame, Martin, mon vieux ! répéta solennellement Brissenden.
– Et c’est une faveur qu’on m’a faite, songez-y ! ajouta Martin.
– Voyons, monsieur Eden, où êtes-vous né ? questionna le reporter, affectant un air profondément intéressé.
– Et il ne prend pas de notes, dit Brissenden. Quelle mémoire !
– Ça me suffit. (Le gamin faisait son possible, pour ne pas avoir l’air vexé.) Un vrai reporter n’a aucun besoin de notes.
– Ça vous a suffi hier soir évidemment ! (Brissenden, qui n’était pas particulièrement un disciple du quiétisme, changea brusquement d’attitude.) Martin, si vous ne le boxez pas, je le ferai moi-même, même si je dois en tomber raide mort.
– Une bonne fessée ça suffira, non ? demanda Martin.
Brissenden réfléchit un instant, puis opina du bonnet. Une seconde après, le jeune reporter était allongé sur l’estomac, en travers des genoux de Martin et maintenu d’une main ferme.
– Hé là, ne mordez pas, avertit Martin, sans quoi je serais obligé de vous démolir la figure et ce serait bien dommage : une si jolie figure !…
Sa main descendit, remonta, redescendit, sur un rythme rapide et vigoureux. Le gamin se tortilla, injuria, glapit, mais n’essaya pas de mordre. Brissenden regardait gravement : une seule fois il s’anima, empoigna la bouteille de whisky et implora :
– Martin, laissez-moi cogner dessus ! rien qu’une fois !…
– Désolé, mais ma main n’en veut plus, dit Martin, en le lâchant enfin. Elle est tout engourdie.
Il releva le reporter et le percha debout sur le lit.
– Je vous ferai arrêter ! grinça-t-il. (Des larmes de rage ruisselaient sur ses joues cramoisies.) Vous me le paierez ! Vous verrez !
– Joli personnage, oui ! remarqua Martin. Il ne se rend pas compte qu’il glisse sur la mauvaise pente. Ça n’est pas honnête, ça n’est pas propre, ça n’est pas d’un homme de dire des mensonges comme il l’a fait et il ne s’en doute même pas !
– Il est venu vers nous pour en être instruit, dit Brissenden, solennellement, après un petit silence.
– Oui, il est venu vers moi, qu’il a malmené, à qui il a fait du tort. Mon épicier va sûrement me refuser du crédit, à présent. Ce qu’il y a de plus triste, c’est que ce pauvre garçon poursuivra son chemin, jusqu’au naufrage définitif ; il sera alors devenu un journaliste de premier ordre et un chenapan de grande envergure.
– Il a encore du temps devant lui, dit Brissenden, encourageant. Qui sait ? peut-être a-t-il trouvé en vous l’instrument de sa rédemption. Pourquoi ne m’avez-vous pas laissé taper dessus une fois ? J’aurais voulu participer à cette bonne œuvre.
– Je vous ferai arrêter tous les deux, espèces de grandes br-br-brutes !… sanglota le gamin.
– Que sa bouche est mignonne et délicate ! (Martin secoua la tête d’un air lugubre.) Je crains de m’être fatigué la main pour rien. Ce jeune homme est incorrigible. Il sera plus tard un très grand journaliste, très célèbre : il n’a aucune conscience ; ça suffit à le faire réussir.
Sur ces mots, le petit reporter gagna la porte et disparut précipitamment, mourant de peur de recevoir dans le dos la bouteille que Brissenden brandissait encore.
Dans le journal du lendemain, Martin apprit sur lui-même une quantité de choses nouvelles. « Nous sommes les ennemis jurés de la société », lui faisait-on dire, dans l’interview qui parut de nouveau en première page. « Non, nous ne sommes pas anarchistes, mais socialistes. »
Et quand le reporter avait remarqué qu’il lui semblait que la différence entre les deux écoles était légère, Martin avait haussé les épaules affirmativement. On décrivait son visage : il était bilatéralement asymétrique et accusait plusieurs autres signes de dégénérescence. Ses mains de lutteur étaient formidables et ses yeux injectés de sang lançaient des flammes. Il apprit également qu’il parlait tous les soirs aux ouvriers de City Hall Park et que, de tous les agitateurs divers qui enflammaient l’esprit du peuple, c’était lui qui attirait le plus de monde et prononçait les discours les plus subversifs. Le gamin fit un croquis pittoresque de la misérable chambre avec son fourneau à pétrole, son unique chaise et du vagabond à tête de mort qui lui tenait compagnie et semblait sortir à l’instant d’un cachot après avoir subi vingt ans de détention.
Le petit reporter s’était donné du mal. Il avait fouillé, fouiné partout et découvert enfin la famille de Martin, avait produit une photographie du magasin Higginbotham, avec Bernard Higginbotham en personne sur le seuil. Ce gentleman était présenté comme un homme d’affaires digne et intelligent, auquel répugnaient les idées socialistes de son beau-frère, ainsi que son beau-frère lui-même, qu’il dépeignit comme un propre à rien qui n’avait jamais voulu accepter le travail qu’on lui offrait et qui finirait en prison. Hermann von Schmidt, mari de Marianne, avait été également interviewé. Il déclara que Martin était la brebis galeuse de la famille et il le reniait. « Il a essayé de m’avoir, mais j’ai arrêté ça tout de suite, avait dit Hermann von Schmidt au reporter – il n’y a pas de danger qu’il vienne rôder par ici. Un homme qui ne veut pas travailler, ne vaut pas un clou, croyez-moi. »
Cette fois, Martin fut vraiment furieux. Brissenden eut beau lui représenter la chose comme une bonne plaisanterie, il ne parvint pas à le consoler, car Martin savait que ce ne serait pas une tâche facile que d’expliquer l’affaire à Ruth. Quant à son père, il devait être enchanté de ce qui arrivait et ferait certainement tout son possible pour rompre les fiançailles. Martin s’en aperçut immédiatement. Le courrier de l’après-midi lui apporta une lettre de Ruth. Martin l’ouvrit avec le pressentiment d’une catastrophe et la lut debout sur le seuil de sa porte, à l’endroit même où le facteur la lui avait remise. À mesure qu’il lisait, sa main, d’un geste machinal, fouillait dans sa poche – en quête du tabac et du papier à cigarettes d’antan – sans même remarquer qu’elle était vide.
Ce n’était pas une lettre irritée. On n’y sentait aucune trace de colère. Mais, depuis le premier mot jusqu’au dernier, elle respirait l’amour-propre blessé et le désappointement. Elle s’était attendue à mieux de sa part. Elle avait pensé qu’il surmonterait son tempérament de sauvage, sa fougue juvénile, que l’amour qu’elle avait pour lui valait la peine qu’il se décide à prendre la vie sérieusement, décemment. Mais à présent ses parents avaient parlé haut et ordonné que ses fiançailles soient rompues. Et elle ne pouvait que leur donner raison. Leur union ne pouvait être heureuse. C’est d’ailleurs l’impression qu’elle avait eue dès le début. À travers toute cette lettre un regret surtout la hantait, dont Martin fut ulcéré.
« Si seulement, écrivait-elle, vous aviez accepté une situation quelconque et tenté de devenir quelqu’un ! Mais ça ne devait pas être. Votre vie passée a été trop bohème, trop irrégulière. Ce n’est pas de votre faute, je le comprends. Vous ne pouviez agir que suivant votre nature et votre éducation première. Donc, je ne vous blâme pas, Martin, souvenez-vous de ça. C’était une erreur, tout simplement. Ainsi que mes parents l’ont dit, nous n’étions pas faits l’un pour l’autre et nous devrions être heureux de l’avoir découvert avant qu’il ne soit trop tard… – Puis, pour finir : Il est inutile de chercher à me voir. L’entrevue serait trop pénible pour nous deux, aussi bien que pour ma mère. Je lui ai causé déjà assez de peines et de soucis. Il me faudra bien du temps pour me faire pardonner. »
Il relut la lettre une seconde fois, attentivement, puis s’assit à sa table et répondit. Il lui raconta son discours au meeting socialiste, en lui faisant remarquer qu’il était exactement l’opposé de ce que le journal avait dépeint. En terminant passionnément, il la supplia de lui garder son amour. « Répondez, je vous en prie ! disait-il. Je ne vous demande qu’une seule chose : m’aimez-vous ? C’est tout. Répondez à cette seule question. »
Mais aucune réponse ne vint, ni le lendemain, ni le surlendemain. Trop tard ! gisait sur la table sans qu’il y eût touché et chaque jour, la pile de manuscrits s’amoncelait dessous. Pour la première fois, il connut l’insomnie et l’énervement des longues nuits blanches. Il alla trois fois sonner à la porte des Morse, mais chaque fois, le domestique l’éconduisit, Brissenden était à l’hôtel, trop malade pour bouger, et Martin, bien qu’il lui tînt souvent compagnie, ne voulait pas l’ennuyer de ses tracas.
Car les tracas de Martin étaient nombreux. Les conséquences du reportage vindicatif du jeune homme fouetté avaient été plus graves encore que Martin ne l’avait pensé. L’épicier portugais lui refusa de nouveau tout crédit, tandis que le fruitier – Américain très fier de l’être – l’appelait traître à la patrie et lui défendait de remettre les pieds dans sa boutique : il poussa même le patriotisme à un tel degré qu’il annula le compte de Martin et lui défendit de le payer jamais. Le voisinage adopta les mêmes manières de voir et Martin fut unanimement honni. Personne ne voulut avoir affaire à un traître socialiste. La pauvre Maria, indécise, effrayée, demeurait pourtant fidèle. Les enfants du voisinage, revenus de leur stupeur admirative pour la magnifique voiture qu’ils avaient vue un jour devant la porte de Martin, se firent un malin plaisir de l’appeler « vagabond » et « clochard », tout en se tenant à une distance prudente, bien entendu. La tribu Silva le défendait bravement, et il ne se passait guère de jour qu’ils ne reviennent avec un œil poché, ou saignant du nez, ce qui ajoutait aux soucis et aux perplexités de Maria.
Un jour, Martin rencontra Gertrude dans la rue et apprit ce qu’il savait être inévitable, notamment que Bernard Higginbotham, furieux de ce qu’il ait compromis publiquement sa famille, lui défendait l’entrée de sa maison.
– Pourquoi ne pars-tu pas, Martin, implora Gertrude, pars, cherche quelque part une situation et deviens sérieux. Plus tard, quand tout sera calmé, tu reviendras.
Martin secoua la tête, mais sans offrir d’explication. Qu’aurait-il expliqué ? Il était épouvanté de l’effroyable abîme qui le séparait de son milieu. Il n’existait pas de mots en anglais, en aucune langue, qui pût leur rendre intelligible son attitude et sa conduite. Pour eux, la conception la plus haute d’une bonne conduite était, dans son cas particulier, de se faire une situation. En disant ça, ils avaient tout dit. Se faire une situation ! Se mettre à travailler ! Pauvres esclaves stupides ! se disait-il, tandis que sa sœur parlait. Ce n’était vraiment pas étonnant que le monde appartienne aux forts ! Les serfs avaient l’obsession de leur propre esclavage. Pour eux « se faire une situation » était la phrase cabalistique entre toutes.
Il secoua la tête quand Gertrude lui offrit de l’argent, mais il savait pourtant bien que le jour même il lui faudrait aller au Mont-de-Piété.
– N’approche pas Bernard en ce moment, lui recommanda-t-elle. Dans quelques mois, quand il sera calmé, si tu veux, tu pourras peut-être conduire sa voiture de livraison. Et, Martin, si jamais tu as besoin de moi, fais-moi chercher et je viens. N’oublie pas !
Elle s’éloigna, en pleurant tout bas, et, le cœur serré, il suivit des yeux son corps pesant et son allure de souillon. À ce moment précis, l’édifice nietzschéen trembla légèrement sur sa base et parut vaciller. À l’état abstrait, la classe d’esclaves, c’était parfait ; mais quand il s’agissait de sa propre famille, c’était moins satisfaisant. Et pourtant, sa sœur Gertrude était bien l’exemple le plus frappant du faible écrasé par le plus fort. Il ricana amèrement de ce paradoxe. Quel beau philosophe il faisait, vraiment, en permettant que ses principes soient ébranlés par la première sentimentalité venue ! et qui plus est, ébranlés par la morale d’esclaves elle-même ; car sa pitié pour sa sœur n’était que ça. Les vrais hommes, l’élite, planaient au-dessus de la pitié et de la compassion. Ces deux sentiments étaient éclos dans les taudis souterrains et c’était la sueur et la souffrance d’une humanité misérable qui les avaient fait fleurir.
39
Trop tard ! gisait toujours oublié sur la table. Dessous, les manuscrits, dont pas un n’avait été accepté, avaient réintégré leur place, à l’exception cependant de celui de Brissenden – Éphémère – qui, seul, continuait sa tournée, d’éditeur en éditeur.
Bicyclette et complet noir étaient de nouveau engagés et le marchand de machines à écrire réclamait une fois de plus le prix de sa location. Mais ce genre de soucis ne l’atteignait plus : il cherchait une orientation nouvelle et son existence en subissait forcément un temps d’arrêt. Au bout de plusieurs semaines, il se produisit ce qu’il n’avait jamais cessé d’espérer : la rencontre de Ruth dans la rue. Son frère Norman l’accompagnait ; tous deux firent semblant de ne pas le voir et Norman essaya même de lui barrer le passage en lui disant d’un ton menaçant :
– Si vous ennuyez ma sœur, j’appelle un agent. Elle ne désire pas vous parler et votre insistance est insultante.
– Si vous insistez, vous serez forcé, en effet, d’appeler un agent et votre nom tramera dans les journaux, répondit Martin sur le même ton. Et maintenant, laissez-moi passer et faites venir l’agent si vous y tenez. Je veux parler à Ruth.
– Je veux avoir la réponse de votre propre bouche, demanda Martin à Ruth.
Elle était pâle et tremblante, mais se contint et le regarda d’un air interrogateur.
– La réponse à la question que j’ai posée dans ma lettre.
Elle secoua la tête.
– Vous agissez entièrement de votre propre volonté ? insista Martin.
– De ma propre volonté, dit-elle d’une voix basse et ferme, sans une hésitation. Vous m’avez humiliée. Je n’ose même plus revoir mes amis. Tout le monde parle de moi, je le sais. C’est tout ce que je peux vous dire. Vous m’avez rendue très malheureuse et j’espère ne jamais vous revoir.
– Vos amis ! Des potins ! Des bobards de journaux !… Mais l’amour est plus fort que toutes ces futilités. Ou alors, vous ne m’avez jamais aimé.
Une vive rougeur envahit son visage pâle.
– Après ce qui s’est passé ? dit-elle faiblement. Martin, vous ne savez pas ce que vous dites. Je n’ai pas l’âme vulgaire.
– Vous voyez bien qu’elle ne veut plus avoir affaire avec vous, jeta Norman en entraînant sa sœur.
Martin se rangea pour les laisser passer, et d’un geste machinal il fouillait sa poche pour y chercher un tabac et un papier à cigarettes absents.
Il rentra comme un somnambule, s’assit au bord du lit et son regard vague erra autour de lui. Puis, ayant aperçu Trop tard ! traînant sur la table, il s’assit et prit sa plume. D’instinct, il ne pouvait supporter une chose incomplète. Et cet ouvrage était inachevé. À présent que la chose capitale de sa vie était finie, il allait s’atteler à sa tâche et la terminer. Après, on verrait. Il ne savait pas. Ce qu’il savait, c’est qu’il avait atteint un tournant critique de sa vie et qu’il allait le prendre à la corde, crispé sur la direction. L’avenir ne l’intéressait plus. Il verrait bien assez tôt ce qui lui était réservé : cela n’avait aucune importance. Rien n’avait plus aucune importance.
Pendant cinq jours, il peina sur Trop tard ! ; il n’allait nulle part, ne voyait personne, mangeait à peine. Le sixième jour, dans la matinée, le facteur lui remit une lettre de l’éditeur du Parthénon : Éphémère était accepté. « Nous avons soumis le poème à M. Cartwright Bruce, disait l’éditeur, et il l’a jugé si favorablement, que nous ne pouvons faire autrement que de le prendre. Nous le publierons donc dans notre numéro d’août, celui de juillet étant déjà composé.
« Transmettez nos remerciements et l’expression de notre gratitude à M. Brissenden et envoyez-nous, par retour, sa photographie et sa biographie. Si nos honoraires ne lui semblent pas suffisants, télégraphiez-nous immédiatement le prix qui vous paraîtra acceptable. »
Les honoraires offerts étaient de trois cent cinquante dollars. Martin jugea donc inutile de télégraphier. Il fallait d’ailleurs obtenir le consentement de Brissenden. Eh bien ! il avait eu raison, après tout. Il existait quand même un éditeur de magazine qui savait apprécier la vraie poésie.
Et, bien qu’Éphémère fût le poème du siècle, le prix offert était magnifique. Quant à Cartwright Bruce, Martin se rappela qu’il était le seul critique pour lequel Brissenden eût quelque respect.
Martin descendit en ville en tram et, tout en regardant distraitement les maisons et les rues filer derrière les vitres, il regrettait de n’être pas plus joyeux du triomphe de son ami et du succès de ses prévisions personnelles. Mais la source de ses enthousiasmes semblait tarie et son impatience de voir Brissenden était plus forte que le plaisir d’apporter de bonnes nouvelles. Pendant ces cinq jours entièrement consacrés à Trop tard ! il n’avait pas entendu parler de Brissenden et n’avait même pas pensé à lui. Pour la première fois, Martin se rendit compte à quel point il avait été absorbé et il eut honte d’avoir oublié son ami. Mais sa honte elle-même manquait de ferveur. Il vivait dans une sorte de transe hypnotique, insensible à tout ce qui n’était pas Trop tard ! Dans le tram même, tout ce qui l’entourait semblait irréel, lointain et la grande coupole de l’église qu’on venait de dépasser se serait effondrée en miettes sur sa tête, qu’il n’en aurait éprouvé qu’une très légère émotion.
À l’hôtel, il courut à la chambre de Brissenden, puis redescendit en courant. La chambre était vide. Les malles elles-mêmes avaient disparu.
– M. Brissenden a-t-il laissé son adresse ? demanda-t-il à l’employé qui le regardait avec curiosité.
– Comment ? vous ne savez pas ?
Martin fit un signe négatif.
– Mais les journaux n’ont parlé que de ça !… On l’a trouvé mort dans son lit. Il s’est tué d’une balle dans la tête.
– On l’a déjà enterré ? dit Martin d’une voix bizarre, qu’il ne reconnut pas.
– Non. Après enquête, le corps a été envoyé dans l’Est. Les hommes d’affaires de la famille s’en sont occupés.
– Ils ont fait vite, il me semble.
– Vous trouvez ? C’est arrivé il y a cinq jours.
– Il y a cinq jours ?
– Oui, cinq jours.
– Ah ! dit Martin. Il fit demi-tour et sortit. Il s’arrêta à la poste du coin pour envoyer une dépêche au Parthénon, en le priant de publier le poème. Comme il n’avait dans sa poche que cinq cents, il envoya le télégramme « payable par le destinataire ». Rentré chez lui, il se remit à l’ouvrage. Les jours, les nuits passaient sans qu’il quitte sa table. Il ne sortait que pour aller au Mont-de-Piété, mangeait quand il avait faim et qu’il avait de quoi manger, et, quand il n’avait rien, il s’en passait. Bien que son œuvre soit déjà composée, chapitre par chapitre, il y ajouta une préface de deux mille mots qui la renforça puissamment. Il n’avait pas envie de réussir une chose parfaite, mais il y était forcé, en quelque sorte, par son sens artistique. Il travaillait comme en rêve, étrangement détaché de tout ce qui l’entourait, pareil à un fantôme qu’un enchantement retient sur les lieux de son existence antérieure. Un fantôme n’est que l’âme d’un mort qui ne sait pas encore qu’il est mort, lui avait-on dit un jour, et il se demandait s’il n’était pas mort, par hasard, sans s’en douter.
Vint le jour où Trop tard ! fut achevé. Le marchand de machines à écrire était venu chercher la machine et il s’assit sur le lit pendant que Martin, sur son unique chaise, copiait les dernières pages du manuscrit.
– FIN, écrivit-il, en lettres majuscules, et vraiment pour lui, ce mot avait une signification profonde. Il vit disparaître l’employé emportant la machine, avec un sentiment de soulagement, puis s’étendit sur son lit. La tête lui tournait de faim. Depuis trente-six heures, il n’avait rien mangé, mais il n’y pensait même pas. Étendu sur le dos, les yeux fermés, il ne pensait à rien, envahi par une torpeur grandissante, moitié cauchemar, moitié délire. Il se mit à murmurer tout haut les vers d’un poète anonyme que Brissenden aimait à réciter. Maria, qui l’écoutait anxieusement derrière la porte, fut frappée du ton monotone dont il psalmodiait une sorte de litanie, dont elle ne comprit pas le sens. « C’en est fait », s’intitulait le poème.
I have done,
Put by the lute.
Song and singing soon are over
As the airy shades that hover
In among the purple clover.
I have done,
Put by the lute.
Once I sang like early thrushes
Sing among the dewy bushes ;
Now l’m mute.
I am like a weary linnet
For my throat has no song in it ;
I have given my singing minute :
I have done,
Put by the lute.
(C’en est fait ! – Assez, mon luth ! Chansons et chants sont passés – Comme les ombres légères qui flottent – Parmi les trèfles incarnats. – C’en est fait, – Assez, mon luth ! Jadis, je chantais comme la printanière alouette – Chante parmi les buissons pleins de rosée. – Aujourd’hui je suis muet. – Je suis pareil au pinson fatigué, – Car ma gorge n’a plus de chanson. – C’en est fait, – Assez mon luth !)
Maria n’y tint plus et, courant à la cuisine, elle remplit un bol de soupe, de tout ce que la cuiller à pot put racler de viande et de légumes dans le fond de la marmite. Martin se redressa et se mit à manger, assurant à Maria entre chaque bouchée, qu’il n’avait pas déliré et n’avait pas de fièvre.
Lorsqu’elle l’eut quitté, il resta assis sur le bord du lit, accablé, la tête basse, les yeux tristes et vagues, jusqu’au moment où, son regard s’étant posé sur l’enveloppe déchirée d’un magazine arrivé le matin et qu’il n’avait pas ouvert, une lueur traversa son cerveau engourdi.
– C’est Le Parthénon, se dit-il, Le Parthénon du mois d’août, qui contient sûrement Éphémère. Si Brissenden pouvait voir ça.
À peine eut-il feuilleté le magazine, qu’il tomba sur Éphémère orné d’un magnifique en-tête et d’illustrations genre Beardsley en marge. D’un côté de l’en-tête était la photographie de Brissenden ; de l’autre, celle de Sir John Value, ambassadeur de Grande-Bretagne. Une note préliminaire de la rédaction citait une phrase de Sir John Value, déclarant qu’il n’y avait pas de poètes en Amérique ; la publication d’Éphémère était par conséquent la réponse du tac au tac à Sir John Value ! On y représentait également Cartwright Bruce comme le plus grand critique d’Amérique et on citait le passage où il avait déclaré qu’Éphémère était le plus grand poème qui ait jamais été écrit en Amérique. La préface de la rédaction finissait ainsi : « Nous n’avons pas encore pu apprécier la valeur d’Éphémère comme elle le mérite ; peut-être ne le pourrons-nous jamais. Mais nous l’avons lu souvent, en nous émerveillant de ses idées et de sa forme admirable. »
Suivait le poème.
– Briss, mon vieux, vous avez bien fait de mourir, murmura Martin en laissant glisser le magazine. La vulgarité, la banalité qui s’en dégageait l’écœura, mais, apathique, il remarqua que son dégoût était superficiel. Il aurait bien voulu pouvoir se mettre en colère, mais l’énergie lui faisait totalement défaut. Son sang congelé ne parvenait pas à briser la glace qui pesait sur son indignation intérieure. Après tout, quelle importance tout ça avait-il ? Ça cadrait bien avec la société bourgeoise que Brissenden haïssait tant.
Pauvre Briss ! poursuivit Martin, il ne m’aurait jamais pardonné.
Il se leva par un effort de volonté et ouvrit une boîte qui avait autrefois contenu du papier pour machine à écrire. Il en sortit onze poèmes que son ami avait écrits, les déchira en plusieurs morceaux, qu’il jeta au panier. Il accomplit ces gestes nonchalamment, puis, quand il eut fini, il s’assit sur le bord du lit et ses yeux regardèrent fixement le vague.
Il ne sut pas combien de temps il resta ainsi. Tout à coup, sur l’écran vague de son esprit, il vit se former une longue ligne blanche, horizontale – bizarre. Elle se précisa et devint une chaîne de récifs de corail, fouettée par la houle écumeuse du Pacifique. Puis, dans la ligne des brisants, il distingua une mince pirogue. À l’arrière, un jeune dieu de bronze au pagne écarlate pagayait, et sa pagaie ruisselante brillait au soleil. Il le reconnut : C’était Moti, le plus jeune fils de Toti, le grand chef ; c’était Tahiti et au-delà de cette blanche ligne de récifs, fleurissait la douce Papara ; à l’embouchure du fleuve se cachait la hutte de feuillages du chef. Le crépuscule tombait : Moti rentrait de la pêche. Il attendait le bondissement de la lame qui l’emporterait au-dessus des récifs.
… Puis, il se vit lui-même, assis à l’avant de la pirogue comme il l’avait fait tant de fois jadis, la pagaie à la main, guettant le cri bref de Moti pour la plonger violemment dans le grand mur d’eau turquoise, au moment où il s’élevait derrière eux. L’eau sifflait sous l’étrave comme un jet de vapeur et retombait en pluie autour d’eux : un choc, un grondement, un sourd rugissement pareil à un coup de tonnerre, et la pirogue flottait sur la calme lagune bleue. Moti riait, secouait les gouttelettes salées de ses yeux et ils pagayaient ensemble vers la plage de sable poudré de corail. À travers les palmes des cocotiers, les murs de verdure de Toti se doraient au soleil couchant.
La vision s’éteignit et, devant ses yeux redevenus lucides, s’étala le désordre de sa chambre misérable. En vain, il essaya d’évoquer Tahiti. Il savait qu’il y avait des chansons parmi les cocotiers et que les filles dansaient au clair de lune mais ne put arriver à les voir. Il ne vit que sa table encombrée, la place vide de sa machine à écrire et la vitre crasseuse. Avec un gémissement il ferma les yeux et s’endormit.
40
Il dormit profondément toute la nuit et ce fut le facteur qui le réveilla dans la matinée. Martin, fatigué et sans entrain, parcourut ses lettres sans y prêter attention. Un magazine, auquel il réclamait son dû depuis un an, lui envoyait un chèque de vingt-deux dollars. Il l’inscrivit sur son livre de comptes sans la moindre joie. La fièvre ravie des premiers chèques reçus était passée : le temps était fini des grands espoirs. Ce n’était à présent qu’un chèque de vingt-deux dollars – de quoi manger, voilà tout.
Par le même courrier, un hebdomadaire de New York lui envoyait également un chèque de dix dollars, en paiement de quelques vers humoristiques publiés plusieurs mois auparavant. Une idée lui vint, qu’il considéra avec attention. Comme il ne savait pas ce qu’il allait faire, qu’il n’avait rien envie de faire, que d’autre part, il fallait vivre et qu’il avait de nombreuses dettes, ne serait-ce pas d’un bon placement que d’affranchir le volumineux tas de manuscrits empilés sous la table et de les expédier de nouveau à travers le monde ? On en accepterait peut-être un ou deux… Cela le ferait vivre.
Après avoir touché ses chèques à la banque d’Oakland, il acheta donc pour dix dollars de timbres, puis songea à déjeuner. Mais l’idée de rentrer faire la cuisine dans sa petite chambre encombrée ne l’enthousiasmait guère, bien qu’il réalisât ainsi une sérieuse économie. Il alla donc au café du Forum, commanda un déjeuner de deux dollars, donna vingt-cinq cents de pourboire au garçon et s’acheta un paquet de cigarettes égyptiennes de cinquante cents. C’était la première fois qu’il fumait, depuis que Ruth l’avait prié de ne plus le faire. Mais, à quoi bon, maintenant, se refuser ce plaisir ? Pour cinq cents, évidemment, il aurait pu s’acheter un paquet de Durham et du papier brun, de quoi rouler quarante cigarettes, mais pour quoi faire ? L’argent, pour lui, n’était plus que le moyen de satisfaire un désir momentané. Sans boussole, sans rames, sans port à l’horizon, il se laissait aller à la dérive, sans lutter davantage, puisque lutter c’est vivre et que vivre c’est souffrir.
Les jours s’écoulaient. Il dormait régulièrement huit heures par nuit. Bien qu’il prît ses repas, en attendant de nouveaux chèques, dans des restaurants japonais à dix cents, il se remplumait, ses joues creuses se remplissaient. Il ne s’exténuait plus à se priver de sommeil, à trop travailler. Il n’écrivait plus, n’ouvrait plus un livre, marchait beaucoup dans la campagne et vagabondait de longues heures dans les parcs tranquilles. Il n’avait ni amis ni connaissances, ne cherchait pas à en faire, n’avait de goût à rien. Il attendait qu’une impulsion nouvelle – venue d’où ?… il n’en savait rien – réorganise sa vie. Et les jours passaient, vides, plats, sans intérêt.
Parfois, il feuilletait les journaux et les revues, afin de voir à quel point Éphémère était maltraité. C’était un succès, certainement. Mais quel succès ! Tout le monde lisait le poème et tout le monde discutait pour savoir si, oui ou non, c’était vraiment de la poésie. Les feuilles locales s’en étaient emparées et publiaient tous les jours des colonnes entières de doctes critiques et des lettres de lecteurs très convaincus. Helen Della Delmar, que l’on avait proclamée à grand renfort de réclame et de battage, la plus remarquable poétesse des États-Unis, refusait absolument à Brissenden un siège au Parnasse à ses côtés et s’évertuait à prouver dans tous les journaux qu’il n’avait rien d’un poète.
Le numéro suivant du Parthénon parut ; il se félicitait copieusement du mouvement qu’il avait provoqué, ironisait sur Sir John Value, exploitait la mort de Brissenden de la façon la plus odieuse. Un journal qui tirait à cinq cent mille exemplaires, publia un poème inédit d’Helen Della Delmar, où elle se moquait de Brissenden. Dans un autre, elle le parodiait.
Bien des fois, Martin se dit que son ami avait bien fait de mourir. Il haïssait tellement la foule et voilà que tout ce qu’il avait eu de plus sacré et de plus haut en lui, était jeté en pâture à la foule. Tous les jours, la vivisection de la Beauté continuait. Les moindres petits scribouillards s’agrippèrent à la queue du Pégase qui portait Brissenden, pour, de cette manière, se faire porter devant le public.
Un journal écrivait : « Nous recevons à l’instant une lettre d’une personne qui écrivit un poème presque semblable – mais bien supérieur – il y a peu de temps. » Un autre journal, avec un imperturbable sérieux, reprochait sa parodie à Miss Delmar et ajoutait : « Évidemment Miss Delmar l’a écrite en plaisantant, mais en négligeant le respect qu’un grand poète doit éprouver pour un autre, surtout lorsque cet autre est peut-être le plus grand de tous. Cependant, que Miss Delmar soit jalouse ou non de celui qui écrivit Éphémère, il est certain qu’elle ne peut s’empêcher, comme tout le monde, d’être impressionnée par cette œuvre et qu’un jour viendra sans doute où elle s’efforcera de l’égaler. »
Des pasteurs tonnèrent en chaire contre Éphémère ; le seul qui prit sa défense fut expulsé comme hérétique. Le grand poème fut également une énorme source de gaieté. Les rimailleurs humoristiques, les caricaturistes s’en emparèrent ; ce fut une source inépuisable de plaisanteries de ce genre : Charley Frensham confiait à Archie Jennings, sous le sceau du secret, que cinq lignes d’Éphémère donnaient à un homme la danse de Saint-Guy et qu’au bout de dix lignes il n’avait plus qu’à se noyer.
Martin ne riait pas ; il ne grinçait pas des dents non plus. Tout ça l’attristait profondément. À côté de la faillite de son idéal, dont l’amour avait été le but, le krach de ses illusions sur le monde littéraire et sur le public était bien peu de chose en vérité. Brissenden avait eu raison, mille fois raison, et lui, Martin, avait perdu en travail stupide et forcené, plusieurs années de sa jeunesse, pour découvrir à son tour que les magazines, les revues, les journaux, n’étaient que basse réclame, snobisme et vil trafic. Eh bien ! c’était fini, se disait-il pour se consoler. Parti à tire-d’ailes vers une étoile, il avait naufragé dans un marais pestilentiel.
Fréquemment, des visions de Tahiti, de la claire et douce Tahiti, lui revenaient, comme aussi de Paumotu et des Marquises. Il se voyait souvent, à bord d’un schooner de commerce ou d’un frêle petit cotre, glissant à l’aube entre les atolls parsemés d’huîtres perlières, jusqu’à Nuka-Hiva et la baie de Taiohae. Là, Tamari, il le savait, tuerait un cochon en son honneur ; ses filles aux cheveux fleuris le prendraient par les mains et, parmi les chansons et les rires, le couronneraient de fleurs. Les mers du Sud l’appelaient. Et il savait qu’un jour ou l’autre il répondrait à leur appel.
En attendant, il errait à l’aventure ; il se reposait, se détendait, après son long voyage au pays de la science. Quand Le Parthénon lui adressa le chèque de trois cent cinquante dollars, il l’envoya au notaire de la famille de Brissenden et s’en fit donner un reçu, puis il signa une reconnaissance des cent dollars que Brissenden lui avait donnés un jour.
Bientôt Martin cessa de fréquenter les restaurants japonais. Au moment précis où il abandonnait la lutte, la chance avait tourné – trop tard. Ce fut sans un frémissement de plaisir qu’il ouvrit une mince enveloppe venant du Millenium, en tira un chèque de trois cents dollars et vit qu’il s’agissait de L’Aventure. Quand il eut payé toutes ses dettes et rendu les cent dollars de Brissenden au notaire, il lui resta plus de cent dollars. Il se commanda un complet neuf et prit ses repas dans les meilleurs restaurants. Il couchait toujours dans sa petite chambre chez Maria, mais à la vue de ses vêtements neufs, les enfants du voisinage cessèrent de l’appeler « vagabond » et « clochard », cachés derrière les barrières ou perchés sur les toits des masures.
Le Warren’s Monthly lui prit Wiki-Wiki, la nouvelle hawaïenne, pour deux cent cinquante dollars. La Northern Review publia son essai Le Berceau de la beauté et Makintosh’s Magazine sa Chiromancienne, le fameux poème écrit pour Marianne. Éditeurs et lecteurs étaient rentrés de vacances et les transactions marchaient rondement. Mais Martin ne parvenait pas à comprendre par quelle étrange lubie tout ce qui avait été obstinément refusé pendant deux ans, était à présent accepté d’emblée. Rien de lui n’avait été publié. En dehors d’Oakland personne ne le connaissait et à Oakland, le peu de gens qui croyaient le connaître, le prenaient pour un anarchiste notoire. Rien n’expliquait donc ce revirement soudain. Ce n’était qu’un caprice du destin.
La Honte du soleil ayant été refusée par bon nombre de revues, il finit par suivre le conseil de Brissenden et se mit en quête d’une maison d’édition. Après avoir essuyé plusieurs refus, Singletree, Darnley and Co l’acceptèrent, en promettant de le publier intégralement. Lorsque Martin leur demanda un acompte, ils répondirent que ce n’était pas leur habitude, que, non seulement les livres de ce genre faisaient rarement leurs frais, mais qu’ils doutaient de pouvoir en vendre plus d’un millier d’exemplaires.
Martin calcula que dans ce cas, le livre étant vendu un dollar pièce, en touchant quinze pour cent, cela lui rapporterait cent cinquante dollars et il regretta de ne pas s’être spécialisé dans le roman, puisque L’Aventure, à peine plus longue, lui avait rapporté le double. Après tout, le fameux paragraphe du journal qu’il avait lu autrefois, était vrai. Les magazines de premier ordre payaient d’avance et payaient bien, puisque le Millenium lui avait donné, non pas deux cents le mot, mais quatre. Et avec ça, ils ne prenaient que le dessus du panier en littérature : ne prenaient-ils pas la sienne ? À cette pensée, il eut un ricanement sarcastique.
Il écrivit à Singletree, Darnley and Co pour leur offrir de leur céder ses droits d’auteur sur La Honte du soleil, moyennant cent dollars, mais ils n’osèrent pas en courir le risque. Il n’avait aucun besoin d’argent en ce moment, car plusieurs de ses anciennes histoires avaient été acceptées et réglées aussitôt. Après avoir payé ses dettes, il se fit même ouvrir un compte en banque ; il avait un crédit de plusieurs centaines de dollars. Trop tard ! après avoir été refusé plusieurs fois, trouva asile à la Compagnie Meredith-Lowell. Alors Martin se souvint des cinq dollars que Gertrude lui avait donnés un jour et de sa promesse de les lui rendre au centuple. Il demanda donc une avance de cinq cents dollars. À sa grande surprise, l’éditeur lui envoya le chèque aussitôt, avec un contrat, par retour du courrier. Il toucha le chèque en pièces d’or et téléphona à Gertrude qu’il avait besoin de la voir.
Elle arriva, essoufflée, pantelante de s’être dépêchée. Certaine que Martin avait fait encore des siennes, elle avait fourré dans son sac ses quelques économies. Elle était même si persuadée d’un malheur, qu’elle se précipita dans ses bras en sanglotant : en même temps elle lui tendait le sac.
– Je serais bien venu chez toi, dit-il. Mais la perspective de l’inévitable scène avec M. Higginbotham m’ennuyait.
– Il se calmera sûrement un jour, assura-t-elle, tout en se demandant ce qui pouvait bien être arrivé à Martin. Mais tu ferais mieux de trouver une situation d’abord, une situation sérieuse. Bernard apprécie un honnête travailleur. Cette affaire de journaux l’a bouleversé. Jamais je ne l’ai vu si enragé.
– Je ne chercherai pas de situation, dit Martin avec un sourire. Tu peux le lui dire de ma part. Je n’ai pas besoin de situation et en voilà la preuve.
Et les cent pièces d’or s’égrenèrent sur les genoux de Gertrude avec un clair tintement.
– Tu te souviens des cinq dollars que tu m’as donnés un jour où je n’avais pas de quoi me payer le tram ? Eh bien ! je te les rends, avec quatre-vingt-dix-neuf petits frères, d’âges différents, mais de même grandeur.
Si Gertrude avait eu peur en arrivant, elle fut terrifiée à présent. Ses soupçons justifiés, devenaient des certitudes. Elle regarda Martin avec des yeux pleins d’horreur et tressaillit au contact de l’or, comme à celui d’un fer rouge.
– C’est à toi ! dit-il en riant.
Elle éclata en sanglots, gémissant d’une voix entrecoupée :
– Mon pauvre petit, mon pauvre petit !…
Un instant Martin fut intrigué. Puis, devinant la cause de son désarroi, il lui tendit la lettre de Meredith-Lowell qui accompagnait le chèque. Elle la lut avidement, tout en épongeant ses larmes et demanda quand elle eut fini :
– Et ça veut dire que tu as gagné honnêtement cet argent ?
– Beaucoup plus honnêtement qu’à la loterie. Je l’ai gagné par mon travail.
Elle reprit un peu confiance et relut attentivement la lettre. Il eut quelque peine à lui expliquer de quelle manière cet argent se trouvait en sa possession et plus de peine encore à lui faire comprendre qu’il lui en faisait réellement cadeau et n’en avait personnellement aucun besoin.
– Je vais te le placer dans une banque, dit-elle finalement.
– Pas question. C’est à toi ; fais-en ce qui te plaira ; si tu n’en veux pas, je le donnerai à Maria. Elle saura bien l’employer, je t’assure. Je t’engage, pourtant, à prendre une bonne et de longues vacances.
– Je vais raconter tout ça à Bernard, déclara-t-elle en s’en allant. (Martin fit la grimace puis ricana :) Fais-le donc. Il m’invitera peut-être de nouveau à dîner.
– Bien sûr, qu’il t’invitera, j’en suis sûre et certaine ! s’écria-t-elle en l’embrassant avec ferveur.
41
Un beau jour, Martin se sentit seul. Il était vigoureux, bien portant et inactif. La cessation de tout travail, la mort de Brissenden, sa rupture avec Ruth, avaient laissé un grand vide dans sa vie. Il ne lui suffisait décidément pas de bien manger au restaurant et de fumer des cigarettes égyptiennes. La mer l’appelait, il est vrai, mais il lui semblait qu’il lui restait encore quelque chose à faire aux États-Unis et qu’il y avait encore de l’argent à en tirer. Il attendrait donc pour en apporter une bonne provision là-bas. Aux îles Marquises, il connaissait une vallée et une baie qu’on aurait pour mille dollars chiliens. La vallée s’étendait de la baie en fer à cheval, jusqu’aux pics lointains dont les cimes se perdaient dans les nuages, et mesurait environ quarante mille kilomètres carrés.
Elle était remplie de fruits des tropiques, de poules sauvages, de sangliers, quelquefois de bétail sauvage ; et, sur les hauteurs, paissaient des troupeaux de chèvres, que chassaient des bandes de chiens sauvages. L’endroit tout entier était sauvage, nul être humain n’y habitait. Il n’avait qu’à l’acheter pour mille dollars chiliens. La baie, il s’en souvenait bien, était magnifique, avec un tirant d’eau suffisant aux plus forts tonnages et si sûre, que la Compagnie du Pacifique Sud la recommandait comme étant la meilleure à cent lieues à la ronde. Il achèterait un de ces schooners gréés en yacht, carénés de cuivre, qui filent comme le diable, et ferait le commerce du copra et des perles autour des îles. La vallée serait son quartier général ; il y bâtirait une paillote semblable à celle de Toti, et aurait de nombreux serviteurs à la peau sombre. Le directeur de la factorerie de Taiohae, les capitaines des navires marchands, tout le gratin des écumeurs du Pacifique seraient ses hôtes. Il tiendrait maison ouverte, recevrait comme un souverain. Il oublierait tout ce qu’il avait lu et le monde qui l’avait si amèrement déçu.
Mais pour faire tout ça, il fallait rester en Californie, le temps de remplir ses coffres. Journellement déjà, l’argent arrivait en un flot grossissant. Qu’un seul de ses livres fît sensation et tous ses manuscrits s’enlèveraient. Il pouvait aussi rassembler ses nouvelles et ses poèmes en volumes et s’assurer bien vite de la vallée, de la baie et du schooner. Ensuite il n’écrirait plus jamais. En attendant ce jour-là, il s’agissait de secouer son apathie anormale et de vivre d’une façon moins stupide et moins abrutie qu’il ne le faisait en ce moment.
Un dimanche matin, il apprit que le pique-nique des Briqueteurs avait lieu ce jour-là au Shell Mound Park, et y alla. Autrefois il avait trop souvent fréquenté les pique-niques populaires pour ne pas en connaître les moindres aspects et, dès l’entrée, il retrouva toutes ses anciennes impressions, amplifiées. Après tout, ce milieu-là, c’était le sien ! Il y était né, y avait vécu et, bien qu’il s’en fût volontairement éloigné, c’était bon de s’y retrouver.
– Je veux bien être pendu si ce n’est pas Mart !… dit une voix et une main cordiale lui tapa sur l’épaule. Où as-tu disparu, tout ce temps-là ? Tu étais en mer ? Viens boire un verre !
Il retrouva toute sa bande, son ancienne bande, avec quelques manquants et quelques nouveaux visages. Ce n’étaient nullement des briqueteurs, mais comme jadis, ils fréquentaient les pique-niques du dimanche pour la danse, les batailles et l’amusement. Martin but avec eux et se sentit revivre. Quelle folie de les avoir quittés ! se dit-il ; sans aucun doute, il aurait été mille fois plus heureux s’il était resté parmi eux, sans livres, sans culture, sans hautes fréquentations. Pourtant la bière lui semblait moins bonne qu’autrefois. Brissenden lui avait gâté le goût, il ne supportait plus les boissons bon marché ; les livres lui auraient-ils également gâté l’amitié de ses compagnons de jeunesse ? Il ne voulut pas y réfléchir et se dirigea vers la salle de danse. Il y rencontra Jimmy, le plombier, en compagnie d’une grande blonde, qui le lâcha immédiatement pour Martin.
– Là ! c’est comme autrefois ! déclara Jimmy à la bande qui se moquait de lui en voyant Martin et la blonde valser avec entrain. Et je m’en fous, je suis trop content de le revoir ! Regardez-le valser, il est formidable, non ? Je lui en veux pas, à cette môme.
Mais Martin rendit sa blonde à Jimmy et la bande de copains s’amusa à regarder les couples tourbillonner, tout en riant et en plaisantant à qui mieux mieux. Tous étaient heureux de revoir Martin. Ils ignoraient tout de sa vie pendant ces longs mois de sa carrière littéraire. Ils l’aimaient pour lui-même. Son cœur solitaire se détendit dans ce bain de cordialité ; il se sentait pareil à un souverain revenu d’exil. Aussi s’en donna-t-il à cœur joie ; et, comme aux anciens jours où il revenait de la mer avec sa paye, il jeta son argent à pleines mains.
À un moment donné, il aperçut Lizzie Connolly qui dansait avec un jeune ouvrier ; un peu plus tard, en faisant le tour de la salle, il la retrouva, assise à un buffet. Surprise et ravie de le voir, elle ne demanda qu’à le suivre au jardin, où ils pourraient parler sans que leur voix soit étouffée par le tintamarre de l’orchestre. Dès les premiers mots échangés il la sentit à lui. Tout le lui prouvait, la fière humilité de ses yeux, le don caressant de tout son corps tendu vers lui, la façon dont elle buvait ses moindres paroles. Ce n’était plus la petite jeune fille qu’il avait connue. C’était une femme à présent ; sa beauté n’avait rien perdu de son charme farouche, dont l’ardeur semblait plus contenue, plus discrète. Qu’elle était belle ! Bon Dieu ! qu’elle était belle !… Il sentait qu’il n’aurait eu qu’à lui dire : « Viens ! » et qu’elle l’aurait suivi jusqu’au bout du monde.
Il en était là de ses réflexions, quand il reçut un formidable coup sur la tête qui faillit l’assommer. C’était un magistral coup de poing ; il avait été assené avec une précipitation et une fureur telles qu’il avait manqué son but : la mâchoire de Martin. Celui-ci se retourna en chancelant et vit le poing revenir sur lui avec la rapidité d’un bolide ; il se baissa vivement. Le coup passa sans même l’effleurer, l’homme fut entraîné et pivota sur lui-même. Martin lui balança un vigoureux crochet du gauche, accompagné du poids de son corps tout entier. L’homme tomba sur le côté, se releva d’un bond, fonça à nouveau comme un forcené. Martin vit un visage convulsé de colère et se demanda quelle pouvait bien en être la cause. Mais tout en s’étonnant, il le frappait d’un formidable coup droit et l’homme tomba à la renverse, inanimé. Jimmy et sa bande accouraient vers eux.
Martin frémissait de surexcitation. Il retrouvait les anciens jours, avec leurs danses, leurs bagarres, leurs amusements ! Tout en surveillant d’un œil prudent son adversaire, il regarda Lizzie. En général, les femmes poussent des hurlements quand les garçons s’expliquent à coups de poing ; mais elle n’avait pas crié. Elle retenait sa respiration, légèrement penchée en avant, le visage animé, et regardait avec un intérêt passionné ; dans ses yeux flambait une ardente admiration.
L’homme s’était relevé et se débattait pour échapper aux mains qui cherchaient à le retenir.
– Elle m’attendait ! elle m’attendait ! criait-il à qui voulait l’entendre. Elle attendait que je revienne et puis ce gigolo est venu l’enlever. Laissez-moi, je vous dis ! Je veux lui faire son affaire !
– Qu’est-ce qui te prend ? dit Jimmy, en le retenant solidement. Ce gars, c’est Martin Eden. Quand il cogne, ça fait mal, je t’avertis, et il te bouffera tout cru, si tu l’asticotes.
– Je ne veux pas qu’il me la fauche comme ça ! s’écria l’autre.
– Il a battu Flying Dutchman, tu le connais, celui-là ? poursuivit Jimmy d’un ton conciliant. Et en cinq rounds. Toi, tu ne tiendras pas une minute contre lui, tu sais !
Cette information parut produire un effet émollient et l’irascible jeune homme honora Martin d’un regard évaluateur.
– Il n’a pas l’air si costaud que ça, ricana-t-il ensuite, déjà plus calme.
– C’est justement ce qu’avait pensé Flying Dutchman, répondit Jimmy. Allons, viens ! Il ne manque pas d’autres filles. Viens donc.
Le jeune homme consentit à se laisser emmener vers la salle de danse et toute la bande le suivit.
– Qui est-ce ? dit Martin à Lizzie. Et qu’est-ce qui lui a pris, d’ailleurs ?
Déjà, l’excitation du combat, si durable et si vive autrefois, était tombée et il sentit qu’il s’analysait trop à présent, pour vivre, de gaieté de cœur et avec conviction, une existence aussi primitive.
Lizzie eut un geste impatient.
– Lui ? c’est rien du tout, dit-elle. Il me faisait la cour. Vous comprenez, je me sentais terriblement seule. Mais je ne vous ai jamais oublié. (Elle baissa la voix en regardant droit devant elle.) Je l’aurais plaqué pour vous n’importe quand.
Martin jeta un regard vers le visage qui se détournait ; il savait qu’il lui suffirait d’étendre la main pour la cueillir et se demanda si, après tout, un langage châtié, parfaitement grammatical, était vraiment indispensable au bonheur. Comme il ne répondait rien, elle ajouta en riant :
– Vous l’avez bien arrangé !
– C’est un gars solide, pourtant, concéda-t-il généreusement. Si on ne l’avait pas emmené, je ne l’aurais peut-être pas eu si facilement.
– Qui était cette dame avec qui je vous ai rencontré un soir ? interrogea-t-elle brusquement.
– Une amie, voilà tout.
– Il y a longtemps de ça, murmura-t-elle songeuse. Il me semble qu’il y a des siècles.
Mais Martin changea de conversation. Il l’emmena goûter au buffet, lui offrit du vin, les gâteaux les plus chers ; puis ils dansèrent ensemble, rien qu’ensemble. Au bout d’un moment elle fut fatiguée. Il dansait bien et elle tourbillonnait avec lui, la tête appuyée à son épaule, dans un vertige extasié, qu’elle souhaitait éternel.
Plus tard, ils se promenèrent sous les arbres ; comme il l’avait fait tant de fois jadis, il s’allongea par terre, la tête sur les genoux de sa compagne. Il sommeillait à demi ; elle caressait ses cheveux et le contemplait avec adoration. En levant tout à coup les yeux, il lut le tendre aveu sur son visage. Elle baissa les yeux, puis les plongea dans les siens avec une exquise hardiesse.
– Je n’ai pas flirter pendant tout ce temps-là, murmura-t-elle si bas qu’il l’entendit à peine.
Et Martin comprit que c’était la vérité, la miraculeuse vérité. Et son cœur fut tenté. Il ne dépendait que de lui de la rendre heureuse. Si le bonheur lui avait été refusé, était-ce une raison pour le refuser à cette femme ? Il n’avait qu’à l’épouser et à l’emmener là-bas, dans son palais de verdure des îles Marquises. Le désir d’agir ainsi était fort, mais plus forte encore était la fidélité à l’Amour. Fini le temps du dévergondage et du laisser-aller ! Il avait changé – du tout au tout, il ne s’en rendait compte qu’à présent.
– Je ne suis pas fait pour le mariage, Lizzie, dit-il légèrement.
La main qui caressait ses cheveux s’arrêta une seconde, puis reprit son geste câlin. Il vit son visage changer d’expression, se durcir d’une résolution soudaine et rayonnante.
– Ce n’est pas ce que je voulais dire, fit-elle ; puis elle s’interrompit. De toute façon, je n’y tiens pas. Non, je n’y tiens pas, répéta-t-elle. Je serais fière d’être votre amie. Pour vous, je ferais n’importe quoi.
Martin se redressa et lui prit la main. Dans ce simple geste, il y avait une grande franchise, une chaude sympathie, mais si peu de passion qu’elle en fut glacée.
– Ne parlons pas de ça, dit-elle.
– Vous êtes une femme d’une grande noblesse ! dit Martin. C’est moi qui devrais être fier de vous connaître. Et je le suis, Lizzie ! Vous êtes le rayon de soleil de ma très sombre existence, et je veux être aussi sincère que vous l’avez été.
– Que vous le soyez ou non, ça m’est égal. Faites de moi ce que vous voudrez. Vous pouvez me jeter dans la boue et me piétiner. Et vous seriez le seul, dit-elle d’un air de défi. Ce n’est pas pour rien que j’ai appris à me défendre depuis que j’étais toute gosse !
– Et c’est justement pour ça que je ne le ferai pas, dit-il avec douceur. Vous êtes si droite, si généreusement confiante, que je veux vous traiter comme vous le méritez. Je ne veux pas me marier, et… je ne veux pas aimer sans me marier. Ce n’était pas mon genre autrefois. On change. Je regrette d’être venu ici aujourd’hui et de vous y avoir rencontrée. Mais nous n’y pouvons plus rien et je ne m’attendais vraiment pas à ce que ça tourne de cette façon-là ! Mais, Lizzie, écoutez-moi. Je peux vous dire que mon amitié pour vous est grande. Bien plus, je vous admire et je vous respecte. Vous êtes admirable et adorablement bonne. Mais, à quoi bon tout ça ?… Pourtant je voudrais faire quelque chose pour vous. Votre vie n’a pas été facile jusqu’à présent, laissez-moi vous la faciliter. (Un éclair de joie traversa ses yeux, puis s’éteignit.) Je suis presque sûr d’avoir bientôt pas mal d’argent, beaucoup d’argent.
Il abandonnait le rêve tant caressé, de la vallée là-bas, du palais de verdure et du beau yacht blanc. Après tout qu’est-ce que ça faisait ? Il s’en irait, comme tant d’autres fois, sur n’importe quel bateau, n’importe où.
– Il faudra que nous parlions de ça ensemble. Vous devez bien avoir envie de quelque chose ? De vous instruire, par exemple ? N’aimeriez-vous pas être sténographe ? J’arrangerais ça. Vos parents vivent-ils encore ? Je pourrais les installer dans une épicerie, ou un autre commerce. Dites ce qui vous ferait plaisir, n’importe quoi, et vous l’aurez.
Elle ne répondit rien. Les yeux fixes, immobile, elle restait là, insensible en apparence, mais Martin la sentit souffrir à un tel point qu’il en souffrit pour elle et regretta d’avoir parlé. Ce qu’il lui avait offert, de l’argent, tout vulgairement, semblait si mesquin, comparé à ce qu’elle lui offrait. Il lui offrait une chose indifférente, à laquelle il ne tenait pas, tandis qu’elle s’offrait elle-même, avec son fardeau de honte, de sacrifice et de péché.
– Ne parlons pas de ça, dit-elle enfin, avec un sanglot qu’elle dissimula par une petite toux. (Puis, se levant :) Allons, venez, rentrons. Je suis éreintée.
La fête était terminée et la jeunesse s’était en grande partie dispersée. Mais lorsque Martin et Lizzie quittèrent l’ombre des arbres, ils trouvèrent la bande des copains qui les attendait. Martin comprit immédiatement pourquoi. Il y avait de la bagarre dans l’air ; la bande se faisait sa garde du corps. Ils franchirent la grille du parc, suivis à quelque distance par l’autre bande, celle des amis que l’amoureux évincé de Lizzie avait rassemblés, pour se venger. Quelques agents, craignant du grabuge, essayèrent de le prévenir, en poussant les deux groupes séparément vers le train de San Francisco. Martin déclara à Jimmy qu’il descendrait à la station de la 16e Rue pour prendre le tram d’Oakland. Lizzie, très calme, ne semblait prendre aucun intérêt à ce qui se tramait. Lorsque le train s’arrêta à la station en question, le tram était là, prêt à partir, avec son wattman qui manœuvrait impatiemment le timbre d’appel.
– Le voilà ! conseilla Jimmy. Cours ! attrape-le ! Pendant ce temps-là, nous les retarderons. Allez ! Dépêche-toi !
Cette manœuvre déconcerta la bande adverse un instant ; puis, elle se rua à la poursuite du tram. Les braves gens d’Oakland qui le peuplaient, remarquèrent à peine le jeune homme et la jeune fille qui s’étaient dépêchés de monter et s’étaient assis devant, à l’extérieur. Ils n’établirent aucun rapport entre ce couple et Jimmy qui, sautant sur le marchepied, cria au conducteur :
– Vas-y plein tube, vieux ! Casse-toi en vitesse !
Au même moment, Jimmy pirouetta sur lui-même et les voyageurs le virent envoyer son poing sur la figure d’un homme qui essayait de sauter dans la voiture. Et, de chaque côté, des poings s’abattirent sur des figures. C’était la bande de Jimmy, qui, protégeant l’accès du véhicule, recevait l’attaque de la bande ennemie. Puis, le tram partit à toute vitesse, en carillonnant à grand fracas ; il abandonna les combattants, et les voyageurs stupéfaits ne devinèrent jamais que le tranquille jeune homme et la jolie ouvrière assis dans le coin, à l’extérieur, étaient la cause de cette bagarre.
Ce combat avait amusé Martin ; il y avait retrouvé un peu de sa fièvre combative d’autrefois. Mais elle s’éteignit vite et une grande tristesse l’oppressa. Il se sentit soudain très vieux, terriblement plus vieux que ses insouciants compagnons du temps passé. Il avait voyagé loin, trop loin pour pouvoir revenir. Leur manière de vivre, qui avait été un jour la sienne, lui déplaisait à présent. Tout le désappointait : il était devenu un étranger. De même que la bière lui semblait râpeuse, leur société lui semblait grossière. Il avait trop évolué. Trop de livres ouverts les séparaient. Il avait voyagé si loin au pays de l’intelligence qu’il ne pouvait plus revenir en arrière. D’autre part, son besoin bien humain de camaraderie, demeurait insatisfait. Il n’avait pu se faire un foyer nouveau. De même que ses copains d’antan ne pouvaient le comprendre, ni sa propre famille, ni la bourgeoisie – de même cette fille, assise à côté de lui et qu’il estimait beaucoup, était incapable de le comprendre ni de comprendre le sentiment qu’il avait pour elle. En y réfléchissant, sa tristesse s’imprégnait d’amertume.
– Raccommodez-vous avec lui, conseilla-t-il à Lizzie en la quittant devant la caserne ouvrière où elle habitait près de Sixth and Market.
Il faisait allusion au jeune homme dont il avait occupé la place ce jour-là.
– Je ne peux pas… pas maintenant, dit-elle.
– Allons donc ! dit-il gaiement. Vous n’avez qu’à siffler et il reviendra au galop !
– Ce n’est pas ça que je voulais dire, dit-elle avec simplicité.
Et il comprit.
Comme il allait lui dire bonsoir, elle se pencha vers lui, sans coquetterie, sans impudeur, mais ardemment, humblement. Il en fut touché jusqu’au tréfonds de son cœur indulgent. En l’entourant de ses bras, il la baisa sur la bouche, et le baiser qui lui fut rendu, fut le plus sincère qu’un homme eût jamais reçu.
– Mon Dieu ! sanglota-t-elle. Je voudrais mourir pour vous ! Je voudrais mourir pour vous !
Elle s’arracha précipitamment et monta l’escalier en courant.
Il sentit ses yeux se mouiller.
« Martin Eden, se confia-t-il, tu n’es pas une brute et tu n’es qu’un piètre nietzschéen. Si tu le pouvais, tu l’épouserais et tu remplirais ainsi de bonheur ce pauvre cœur frémissant. Mais tu ne peux pas ! Tu ne peux pas ! C’est terriblement dommage… »
– Le pauvre vieux vagabond raconte ses pauvres vieux ulcères, marmotta-t-il, se rappelant son Henley. La vie n’est, je crois, qu’une gaffe et une honte. C’est vrai, une gaffe et une honte.
42
La Honte du soleil fut publiée en octobre. Une pesante tristesse étreignit Martin, lorsqu’il coupa la ficelle qui contenait une demi-douzaine d’exemplaires de presse envoyés par l’éditeur. Il se représentait ce qu’aurait été sa joie délirante, quelques mois plus tôt, et la compara à son indifférence actuelle. Son livre ! son premier livre ! et son pouls n’avait pas battu plus vite et il n’éprouvait qu’une morne tristesse. Ça lui était complètement égal… C’était de l’argent en perspective, évidemment, et il ne tenait pas à l’argent.
Il en apporta un exemplaire à la cuisine et le tendit à Maria, confuse et affolée.
– C’est de moi, lui dit-il. J’ai écrit ça là, dans ma chambre, et vos bonnes soupes y ont beaucoup contribué. C’est pour vous. Un souvenir simplement.
Sa seule idée était de lui faire plaisir, de la rendre fière de lui, de justifier la confiance qu’elle n’avait cessé de lui témoigner. Elle rangea le livre au salon, à côté de la Bible familiale, comme une chose sacrée, le fétiche de l’amitié. Voilà qui atténuait son désappointement que son locataire ait été blanchisseur ; et, bien qu’elle ne pût en comprendre une seule ligne, elle sentait obscurément que chaque phrase en était noble et belle. Ce n’était qu’une femme du peuple, simple et terre à terre, mais elle avait le cœur bien placé.
Il lut avec la même indifférence les comptes rendus de La Honte du soleil, que L’Argus de la Presse lui envoyait toutes les semaines. Son livre faisait du bruit, c’était évident. Son magot allait s’arrondir. Il pourrait établir Lizzie, s’acquitter de ses promesses et il lui resterait encore de quoi bâtir son château de verdure.
Singletree, Darnley and Co ne s’étaient prudemment risqués qu’à tirer une édition de 1 500 exemplaires ; mais, à la suite des comptes rendus de la presse, ils en tirèrent une seconde de 3 000, puis une troisième de 5 000. Une firme de Londres demanda un arrangement par télégramme pour une édition anglaise, et on apprit en même temps qu’en France, en Allemagne, en Suède, des traductions se préparaient. L’attaque de l’école de Maeterlinck ne pouvait être lancée à un meilleur moment.
Une ardente controverse se déclencha ; Saleeby et Haeckel se trouvèrent pour la première fois du même avis pour approuver et défendre La Honte du soleil. Crookes et Wallace se rangèrent du parti opposé, tandis que Sir Oliver Lodge tentait de formuler un compromis, concordant avec ses propres théories cosmiques. Les disciples de Maeterlinck se rallièrent autour de l’étendard du mysticisme. Chesterton déchaîna un rire universel en publiant une série d’essais écrits par des adversaires fous furieux. Mais tous, partisans et ennemis, furent écrasés par une plaquette fulminante de George Bernard Shaw. Inutile de dire que l’arène était bondée de combattants moins illustres, mais qui n’en produisaient pas moins une poussière, un vacarme et une confusion épouvantables.
« C’est un prodige absolument déconcertant, écrivit à Martin la maison Singletree, Darnley and Co, qu’un essai philosophique et critique se vende comme un roman. Cet ouvrage est destiné à battre tous les records. Plus de 40 000 exemplaires ont déjà été vendus aux États-Unis et au Canada. Une nouvelle édition de 20 000 est sous presse. Nous sommes débordés par les demandes.
« Ci-inclus, le duplicata d’un contrat pour votre prochain ouvrage. Veuillez remarquer que nous y avons porté vos droits d’auteur à 20 %, ce qui est à peu près le maximum de ce qu’une maison d’édition peut se risquer à offrir. Si cette offre vous convient, veuillez inscrire le titre de votre livre dans l’espace réservé sur cette feuille. Nous vous laissons carte blanche quant au sujet. Peu nous importe. Si vous en avez déjà un de prêt, tant mieux. Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud.
« Au reçu de votre contrat signé, nous aurons le plaisir de vous envoyer un acompte de cinq mille dollars, pour vous marquer notre confiance. Nous voudrions aussi discuter les clauses d’un contrat de plusieurs années, – mettons dix – durant lesquelles le droit exclusif à la publication de toutes productions sous forme de volume nous serait réservée. »
Martin mit la lettre de côté, et s’étant livré à un calcul mental, aboutit à cette découverte que, soixante mille fois quinze cents faisaient neuf mille dollars. Il signa le contrat, en remplit le blanc avec le titre La Fumée de joie et l’envoya aux éditeurs avec les vingt nouvelles écrites autrefois. Et par retour du courrier, arriva le chèque de cinq mille dollars de Singletree, Darnley and Co.
– Voulez-vous venir avec moi en ville, Maria, cet après-midi, vers deux heures ? dit Martin, dans la matinée de ce jour. Ou plutôt, trouvez-vous au coin de Broadway et de la 14e Rue, à deux heures. J’y serai.
Elle fut exacte. La seule explication qu’elle eût trouvée du mystère de ce rendez-vous était le mot « chaussures » et son désappointement fut grand quand Martin, dépassant un grand marchand de chaussures, l’entraîna dans une agence immobilière. Ce qui suivit tint du rêve et elle le considéra comme tel jusqu’à la mort. De beaux messieurs lui sourirent aimablement, tout en parlant entre eux ou avec Martin ; une machine à écrire cliqueta ; des signatures furent apposées au bas d’un document imposant ; son propriétaire, convoqué également, signa aussi. Et quand tout fut fini et qu’ils furent sortis, son propriétaire lui dit :
– Eh bien, Maria ! Vous n’aurez pas à payer sept dollars cinquante ce mois-ci !
Maria, ahurie, ne sut que répondre.
– Ni le mois prochain, ni le suivant, ni celui d’après, continua le propriétaire.
Elle remercia avec incohérence, comme d’une faveur. Et ce ne fut qu’en rentrant à North Oakland, après en avoir conféré avec des amis et avec l’épicier portugais, qu’elle comprit vraiment qu’elle était devenue la propriétaire de la maisonnette qu’elle avait si longtemps habitée.
– Pourquoi ne m’achetez-vous plus rien ? demanda l’épicier portugais à Martin, ce jour-là, en l’abordant à sa descente du tram. Martin expliqua qu’il ne faisait plus la cuisine et dut entrer boire un verre de vin. Il remarqua que ce vin était le meilleur de la cave.
– Maria, déclara Martin ce même soir, je vais vous quitter. Et vous-même vous allez bientôt vous en aller d’ici. Vous louerez la maison à d’autres gens et vous en toucherez les loyers. Votre frère, m’avez-vous dit, habite San Leandro ou Haywards, je ne sais plus ; vous lui direz de venir me voir. Je serai à l’hôtel Métropole, à Oakland. Il sait ce que c’est qu’une belle ferme et je lui en montrerai une.
C’est ainsi que Maria devint propriétaire d’une maison en ville et d’une ferme à la campagne, avec deux ouvriers pour faire la besogne et un compte en banque qui augmentait de jour en jour, bien que sa progéniture tout entière fût pourvue de chaussures et allât à l’école. Peu de gens rencontrent les bons génies dont ils ont rêvé, mais Maria, qui avait travaillé ferme, dont la tête était dure et qui n’avait jamais rêvé de bons génies, rencontra le sien sous la forme d’un ancien blanchisseur.
Pendant ce temps, le monde commençait à se demander : Mais qui est donc ce Martin Eden ? Il avait refusé sa biographie à ses éditeurs, mais les journaux ne se décourageaient pas pour ça. Dans Oakland même, les reporters dénichèrent quantité d’individus à même de donner des indications précieuses. Tout ce qu’il était et ce qu’il n’était pas, tout ce qu’il avait fait et surtout ce qu’il n’avait pas fait, fut étalé au grand jour, pour la plus vive délectation du public et accompagné d’instantanés et de photographies. Au début, son dégoût pour les magazines et la société bourgeoise était si grand qu’il essaya de lutter contre la publicité ; puis, il lui céda par indolence. Il pensa qu’il ne pouvait guère refuser de recevoir les envoyés spéciaux qui venaient de loin pour le voir. Puis, les journées étaient longues, maintenant qu’il ne les occupait plus à travailler ou à écrire, et il fallait bien remplir les heures d’une façon quelconque. Il céda donc à ce qu’il considérait comme un engouement, accorda des interviews, donna son opinion sur la littérature et la philosophie et accepta même des invitations dans la bourgeoisie. Il adoptait un nouvel état d’esprit étrange et confortable. Tout lui était indifférent. Il pardonnait à tout le monde, même au jeune reporter fouetté qui avait fait de lui un anarchiste militant et à qui il octroya une page entière, avec photographie spéciale.
Il voyait parfois Lizzie ; elle regrettait visiblement la haute situation de Martin, qui les séparait encore davantage. Dans l’espoir de la diminuer peut-être, elle se laissa persuader de suivre le cours du soir et de se faire habiller chez une grande couturière qui prenait des prix fabuleux. Elle faisait des progrès de jour en jour, si bien que Martin en vint à se demander s’il avait raison d’agir ainsi, car il savait que tout ce qu’elle faisait, c’était dans l’espoir de lui plaire. Elle tâchait d’acquérir une valeur à ses yeux, le genre de valeur qu’il semblait apprécier. Et pourtant, il ne lui donnait aucun espoir, la traitait d’une façon toute fraternelle et la voyait rarement.
Trop tard ! fut lancé par la Cie Meredith-Lowell, au plus fort de sa popularité ; comme c’était un roman, son chiffre de vente fut plus énorme que celui de La Honte du soleil. Les semaines passèrent et il détenait toujours le record sans précédent d’avoir deux ouvrages à la fois sur la liste des best-sellers, car les admirateurs de La Honte du soleil étaient également attirés par la maîtrise avec laquelle il avait traité son roman d’aventures maritimes. Dans l’un il avait attaqué la littérature mystique avec une rare perfection ; dans l’autre il avait développé avec succès les principes qu’il préconisait, prouvant par là la complexité de son génie, en se révélant à la fois critique et créateur.
L’argent, la célébrité affluaient vers lui ; comme une comète il flamboyait au firmament littéraire et l’intérêt qu’il suscitait l’amusait, plutôt qu’il ne le flattait. Une seule chose l’étonnait – une toute petite chose. Bien des gens auraient été intrigués s’ils s’étaient doutés de son étonnement. Le juge Blount l’invita à dîner ! C’était là cette petite chose qui devait en devenir une si grande dans son esprit. Il avait insulté le juge, l’avait abominablement maltraité et le juge l’ayant rencontré dans la rue, l’avait invité à dîner… Martin énuméra les nombreuses occasions de l’inviter que le juge Blount avait eues chez les Morse et qu’il avait négligées. Pourquoi ne l’avait-il pas reçu chez lui alors ? Lui, Martin, n’avait cependant pas changé. C’était bien le même Martin Eden. Quelle différence y avait-il à présent ? Le fait que ses ouvrages avaient été imprimés ? Mais il les avait écrits au moment même où le juge, se ralliant à l’avis général, se moquait de ses idées et de Spencer. Ce n’était donc pas à cause de sa valeur réelle, mais à cause d’une valeur purement fictive, que le juge Blount l’invitait à dîner.
Martin ricana et accepta l’invitation, tout en s’émerveillant de sa magnanimité. Et, à ce dîner, dont Martin fut le lion, et où il y avait une demi-douzaine de gens haut placés, avec leurs épouses – le juge Blount, chaudement appuyé par le juge Hanwell, supplia Martin de faire partie du « Styx », club ultra-select, dont faisaient partie, non seulement les grosses fortunes mais les grands talents. Martin refusa et s’étonna plus que jamais.
Ses manuscrits partaient tous les uns après les autres. Il était débordé par les demandes des éditeurs. On avait découvert que c’était un styliste doublé d’un penseur. La Northern Review, après avoir publié Le Berceau de la beauté, lui avait demandé une demi-douzaine d’essais du même genre ; il l’aurait fait si le Burton’s Magazine, avide de spéculation, ne lui en avait pas demandé cinq à cinq cents dollars pièce. Il répondit qu’il acceptait, mais qu’il demandait mille dollars par essai. Il se souvenait que tous ces manuscrits avaient été refusés froidement, bêtement, systématiquement, par ces mêmes magazines qui l’imploraient à présent. Ils lui en avaient fait baver, maintenant c’était son tour.
Et le Burton’s Magazine accepta son prix et les quatre essais qui restaient furent enlevés aux mêmes conditions par le Makintosh’s Monthly, la Northern Review étant trop pauvre pour soutenir le train. Ainsi furent dispersés à travers le monde : Les Grands Prêtres du mystère, Les Chasseurs de chimères, La Mesure de l’Ego, La Philosophie de l’illusion, Dieu et limon, L’Art et la Biologie, Critiques et preuves. Poussière d’étoiles et De l’usure, institution philanthropique, qui déchaînèrent des orages, difficilement apaisés.
Des éditeurs lui écrivirent en le priant de fixer lui-même son prix – ce qu’il fit, mais toujours pour des ouvrages déjà écrits. Il refusa nettement de s’atteler à de nouveaux ouvrages. L’idée de se remettre à noircir du papier le rendait fou furieux. Il avait vu Brissenden mis en lambeaux par le public et, bien qu’il n’en fût pas de même pour lui – au contraire, on l’acclamait – il n’était pas revenu du choc reçu et ne pouvait que mépriser ce public. Sa popularité lui semblait une honte et une trahison vis-à-vis de Brissenden. Complètement dégoûté, il résolut de continuer à grossir sa provision d’argent. Il reçut des magazines des lettres ainsi conçues :
« Il y a environ un an, nous fûmes au regret de refuser votre série de poèmes d’amour. Ce n’est pas qu’ils ne nous aient pas vivement frappés, mais des arrangements préalables nous empêchèrent sur le moment de les accepter. Si vous les avez encore, nous serions très heureux de les publier en entier. À vous d’en fixer le prix. Nous serions également tout disposés à vous faire des offres très avantageuses pour les publier en volume. »
Martin se souvint de sa tragédie en vers blancs et la leur envoya au lieu des Poèmes d’amour, après l’avoir relue. Il la trouva digne tout au plus d’un amateur – prétentieux et parfaitement quelconque. Mais il l’envoya et elle fut publiée, au grand regret du rédacteur. Le public fut indigné et s’étonna. Du noble talent de Martin Eden à ce fatras insipide, la différence était trop grande. On affirma qu’il ne l’avait jamais écrite, que le magazine l’avait plagié très maladroitement ou bien que Martin Eden, imitant Dumas père, faisait écrire ses ouvrages par quelqu’un d’autre, maintenant qu’il était à l’apogée du succès. Mais, quand il eut expliqué que cette tragédie était une œuvre de ses débuts littéraires et que le magazine avait pleuré pour l’avoir, ce fut un formidable éclat de rire aux dépens du magazine, qui fut obligé de changer son rédacteur en chef. La tragédie ne connut pas les honneurs de la publication en volume, bien que Martin eût touché les avances qu’on lui en avait faites.
Peu après, Martin reçut du Coleman’s Weekly un long télégramme qui avait dû coûter pas loin de trois cents dollars, lui demandant vingt articles à raison de mille dollars chaque. Il devait voyager à travers les États-Unis, tous frais payés, et choisir dans les sujets qui lui sembleraient intéressants, dans un certain ordre d’idées dont on lui donnait la liste, et sans autre condition que de se limiter aux États-Unis. Martin déclina cette offre et télégraphia ses regrets par dépêche payable par le destinataire. Wiki-Wiki, publié dans le Warren’s Monthly, eut un succès foudroyant. Il parut ensuite en un magnifique volume, splendidement illustré, qui se vendit comme des petits pains. La critique fut unanime à déclarer que Wiki-Wiki n’était pas déplacé à côté des chefs-d’œuvre de deux grands écrivains classiques : Le Diablotin dans la bouteille et La Peau de chagrin.
Le public accueillit cependant la série de Fumée de joie avec assez de froideur. L’audace de ces nouvelles si anticonventionnelles choqua la morale et les préjugés bourgeois ; mais quand on apprit que leur traduction obtenait à Paris un succès fou, le public anglais et américain suivit le courant et les exemplaires filèrent en telle quantité, que Martin obligea la solide maison Singletree, Darnley and Co, à lui donner vingt-cinq % sur un troisième livre et trente % sur un quatrième. Ces deux volumes comprenaient toutes les nouvelles ayant déjà paru dans des revues ou des journaux, ou en voie de publication.
Martin poussa un soupir de soulagement quand il eut disposé de son dernier manuscrit. Le château de verdure et le beau yacht blanc se rapprochaient à vue d’œil. Il avait eu raison, après tout, contre Brissenden, qui affirmait que nulle œuvre de valeur ne pouvait réussir auprès des magazines. Son propre succès démontrait le contraire. Et pourtant, il lui semblait confusément que Brissenden avait quand même raison. La Honte du soleil avait été la cause première du succès, bien plus que la quantité d’ouvrages dont jamais aucun magazine n’avait voulu. Sans La Honte du soleil il serait resté inconnu ; et il avait fallu un véritable miracle, pour que La Honte du soleil réussît à ce point. Singletree, Darnley and Co étaient là pour l’attester. Ils en avaient d’abord tiré 1 500 exemplaires, en doutant de pouvoir les écouler. Leur expérience était notoire et ils avaient été confondus du triomphe qui s’en était suivi. Envers et contre toute évidence, le succès était là, indiscutable. C’était le coup de chance unique, mystérieux.
En raisonnant ainsi, Martin en arriva à douter de la valeur de sa popularité. C’était la bourgeoisie qui achetait ses livres, qui remplissait d’or ses poches et, d’après ce qu’il savait d’elle, il lui semblait difficilement admissible qu’elle pût apprécier sa littérature et la comprendre. La beauté intrinsèque, la puissance de ses œuvres n’existaient pas pour les milliers de gens qui l’acclamaient. Il n’était que le caprice de l’heure, l’aventurier qui avait cambriolé le Parnasse pendant le sommeil des Dieux. La foule le lisait, le portait aux nues, avec la même stupide incompréhension qui lui avait fait mettre en pièces Éphémère, de Brissenden. La meute de loups le léchait, au lieu de l’égorger, voilà tout : C’était une question de chance. Une seule chose demeurait évidente : Éphémère dépassait de beaucoup tout ce qu’il avait jamais écrit, tout ce qu’il pourrait jamais écrire… C’était donc un bien misérable tribut que la canaille lui payait là, puisque cette même canaille avait noyé Éphémère dans la boue. Il eut un profond soupir d’intense satisfaction : Il était heureux que son dernier manuscrit soit vendu et de voir approcher le moment où tout ça serait terminé.
43
Un jour M. Morse rencontra Martin au bureau de l’hôtel Métropole. Martin ne put démêler bien nettement s’il s’y trouvait par hasard pour affaires ou s’il y était venu tout exprès pour l’inviter à dîner : il pencha vers cette dernière hypothèse. Ce qui était certain, c’était ceci : il était invité à dîner par M. Morse, le père de Ruth, qui lui avait interdit sa maison et avait rompu ses fiançailles.
Martin ne ressentit aucune colère et ne se drapa point dans sa dignité. Il se demanda simplement pourquoi M. Morse s’abaissait ainsi et s’il en sentait même l’humiliation. Et, sans décliner l’invitation, il la remit à une époque indéterminée, tout en s’informant de la famille et de Ruth en particulier. Son nom lui vint aux lèvres tout naturellement, sans hésitation ; il fut même surpris de ne pas en éprouver le plus petit serrement de cœur.
On l’invitait beaucoup à dîner et il acceptait quelquefois. Des gens se faisaient présenter à lui tout exprès pour pouvoir le recevoir. Et il continua d’être intrigué par ce petit rien qui devenait une chose grave. Bernard Higginbotham l’invita à dîner. Cela l’intrigua davantage encore. Il se rappela ses jours de misère noire où personne ne l’invitait. C’est à ce moment-là qu’il en aurait eu besoin, alors qu’il s’affaiblissait faute de nourriture… Paradoxe ridicule ! Quand il avait faim, personne ne lui donnait à manger : à présent qu’il pouvait se gaver et avait perdu son appétit, les dîners affluaient de toutes parts. Pourquoi ? Qu’avait-il fait qui justifie ce changement ? Il était resté le même. M. et Mme Morse l’avaient condamné comme un fainéant, un incapable et, par l’intermédiaire de Ruth, lui avaient offert une place d’employé dans un bureau. Sa littérature, ils la connaissaient, puisque Ruth leur avait fait lire ses manuscrits, dès cette époque. C’était la même, exactement la même qui plus tard avait rendu son nom célèbre ; c’était donc cette célébrité qui lui valait de dîner chez eux.
Une chose était évidente : les Morse ne se souciaient ni de lui ni de ses œuvres. Il n’avait à leurs yeux que l’attrait de son triomphe actuel et – pourquoi pas ? – parce qu’il avait également cent mille dollars environ. C’est de cette façon que la société bourgeoise évalue un homme !… Pourquoi en aurait-il été autrement pour Martin ? Mais de cette estimation, sa fierté n’en voulait pas. C’est pour lui-même, pour son travail, qui n’était que l’expression de son moi, qu’il voulait être apprécié. Lizzie, elle, l’aimait pour lui-même. Pour elle, son œuvre ne comptait pas ; Jimmy le plombier, tous ses anciens camarades, l’aimaient pour lui-même : ils l’avaient prouvé bien des fois, du temps où il était un des leurs ; ils l’avaient prouvé une fois de plus, ce fameux dimanche à Shell Mound Park. Peu leur importait son œuvre, à ceux-là !… Celui qu’ils aimaient, celui qu’ils défendaient envers et contre tous c’était Martin Eden, tout simplement, leur copain – un brave type.
Il y avait aussi Ruth. Qu’elle l’ait aimé pour lui-même, c’était indiscutable. Et pourtant elle lui avait préféré son étroite morale bourgeoise. Elle avait combattu sa littérature ; et elle l’avait combattue surtout, lui semblait-il, parce qu’elle ne lui rapportait pas d’argent. De son Cycle d’amour, c’était tout ce qu’elle avait trouvé à dire. Elle aussi l’avait supplié de « se faire une situation ». Il lui avait lu tout ce qu’il avait écrit : poèmes, essais, nouvelles, Wiki-Wiki, La Honte du soleil, tout. Et toujours, obstinément, elle l’avait engagé à devenir « sérieux », à trouver « une situation ». Grands Dieux ! comme s’il n’avait pas travaillé, en se privant de sommeil et en menant cette vie éreintante, pour s’élever jusqu’à elle !…
Et le petit rien grandissait toujours. Il se portait bien, mangeait bien, dormait bien, et pourtant, le petit rien devenait une obsession. « J’étais le même ! » Cette idée hantait son cerveau. Un dimanche, à dîner, assis en face de Bernard Higginbotham, il eut de la peine à ne pas hurler :
– J’étais le même ! C’était à cette époque que j’ai écrit ces ouvrages ! Et maintenant vous me gavez quand alors vous m’avez laissé mourir de faim, vous m’avez fermé votre maison, vous m’avez renié, tout ça parce que je ne voulais pas « chercher une situation ». J’étais le même, tout ce que j’ai fait était déjà fait. À présent, vous vous interrompez respectueusement quand je vous parle, vous vous suspendez à mes lèvres, vous buvez avec admiration la moindre de mes paroles. Je vous dis que votre parti est pourri, et au lieu de vous mettre en colère, vous faites « hum ! » et « ah ! » et vous admettez qu’il y a beaucoup de vrai dans ce que j’avance. Et pourquoi ? Non pas parce que je suis Martin Eden, un bon garçon, pas complètement idiot, mais parce que je suis célèbre, parce que j’ai de l’argent, beaucoup d’argent. Je vous dirais que la lune est un fromage vert, que vous applaudiriez, ou du moins que vous n’oseriez pas me contredire, parce que je suis riche. Et je suis le même qu’alors, quand vous me rouliez dans la boue, sous vos pieds.
Mais Martin se retint. Ces pensées rongeaient son cerveau sans arrêt, pourtant il sourit et parvint à dissimuler sa tension nerveuse. Comme il se taisait, Bernard Higginbotham prit l’initiative de mener la conversation et ne la lâcha plus. Il était un « self-made man » et en était fier. Personne ne l’avait aidé. Il ne devait rien à personne. Il remplissait ses devoirs comme citoyen et comme chef d’une nombreuse famille. La maison Higginbotham était le monument de son savoir-faire et de son inlassable travail. Il éprouvait pour la maison Higginbotham la tendresse que d’autres éprouvent pour leur femme. Et il ouvrit son cœur à Martin, en lui dévoilant la somme d’intelligence et de persévérance qui avait présidé à la fondation de sa maison. Il avait aussi des projets pleins d’ambition. Le quartier se peuplait de plus en plus. Le magasin était vraiment trop petit. S’il avait plus de place, il pourrait y ajouter une vingtaine de perfectionnements qui feraient gagner du temps et de l’argent. Il le ferait un jour. Tous ses efforts étaient tendus vers ce but : avoir de quoi acheter le terrain avoisinant et y construire un autre bâtiment à un étage. Il louerait l’étage supérieur et les rez-de-chaussée des deux bâtiments seraient réunis aux magasins Higginbotham. Ses yeux brillèrent quand il parla de la nouvelle enseigne qui s’étendrait sur toute la façade.
Martin oublia d’écouter. L’incessant refrain « J’étais le même » qui obsédait son cerveau, couvrait le bavardage de l’autre. Ce refrain le rendait fou et il tenta d’y échapper.
– Combien ça coûterait, dites-vous ? fit-il tout à coup.
Son beau-frère s’interrompit au beau milieu d’un discours sur le chiffre d’affaires des commerçants du quartier. Il n’avait pas dit combien cela coûterait, mais il le savait, car il l’avait calculé bien des fois.
– Au prix où sont les matériaux à présent, dit-il, faudrait compter dans les quatre mille dollars.
– Avec l’enseigne ?
– Je ne l’ai pas comptée. Une fois la maison construite, elle viendra bien toute seule.
– Et le terrain ?
– Trois mille dollars.
Il se pencha en avant ; il mordilla nerveusement ses lèvres, ouvrit et ferma machinalement ses mains, tandis que Martin écrivait un chèque, qu’il lui tendit ensuite : il était de sept mille dollars.
– Je… je ne peux pas payer plus de six pour cent, dit-il d’une voix sourde.
Martin eut envie de rire, mais demanda simplement :
– Qu’est-ce que ça ferait ?
– Attendez ! six pour cent, six fois sept… quatre cent vingt.
– Soit trente-cinq dollars par mois, n’est-ce pas ?
Higginbotham fit un signe d’assentiment.
– Alors, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, nous arrangerons ça de la manière suivante (il lança un coup d’œil à Gertrude :) Je vous fais grâce des intérêts, à condition que vous dépensiez ces trente-cinq dollars par mois, pour le blanchissage, le ménage et la cuisine. Ces sept mille dollars sont à vous, si vous vous engagez à laisser Gertrude se reposer. Acceptez-vous ?
M. Higginbotham avait la gorge contractée. De songer que sa femme ne ferait plus le ménage, remplissait d’amertume son âme sordide. Le don magnifique dorait une pilule bien dure à avaler. Sa femme ne travaillerait plus ! Ça le mettait en boule.
– Parfait ! alors, dit Martin. C’est moi qui payerai les trente-cinq dollars par mois et…
Il fit un mouvement pour reprendre le chèque. Mais Bernard Higginbotham s’en empara précipitamment en s’écriant :
– J’accepte ! J’accepte !
Quand Martin prit le tram, il était fatigué, écœuré. Il leva les yeux vers l’enseigne du commerçant.
– Le cochon ! gronda-t-il, le cochon ! le cochon !
Lorsque le Makintosh’s Magazine publia La Chiromancienne, ornée d’illustrations de Berthier et de deux gravures de Wenn, Hermann von Schmidt oublia qu’il avait trouvé ces vers obscènes. Il cria sur tous les toits que c’était sa femme qui les avait inspirés, eut bien soin qu’un reporter en soit averti, et se laissa interviewer par un journaliste accompagné d’un photographe et d’un dessinateur de marque. Il en résulta, dans le supplément du dimanche, une page entière remplie de photographies et de croquis de Marianne idéalisée, d’une foule de détails intimes sur Martin Eden et sa famille et du texte complet de La Chiromancienne, en grands caractères, réédité avec la permission du Makintosh’s Magazine.
La sensation fut énorme dans le quartier et de braves ménagères gonflèrent d’orgueil d’être en relation avec la sœur du grand écrivain, tandis que celles qui l’avaient dédaignée jusqu’alors se hâtèrent de réparer cette erreur. Hermann von Schmidt riait sournoisement dans sa petite boutique de réparations et décida de commander un tour neuf.
– Épatant comme réclame ! dit-il à Marianne. Et ça ne coûte pas un sou.
– On ferait bien de l’inviter à dîner, suggéra Marianne.
Et Martin vint dîner et fit des frais avec un énorme boucher en gros, accompagné de sa femme plus énorme encore, gens importants qui pouvaient être utiles à l’ambitieux Hermann von Schmidt. Il avait fallu l’appât du célèbre beau-frère pour les attirer, ainsi que le directeur en chef des agences de la Côte du Pacifique pour la marque de bicyclettes « Asa », auquel von Schmidt désirait plaire, afin d’obtenir la représentation de cette marque pour Oakland. C’était en somme un bon atout que d’avoir Martin comme beau-frère mais, dans son for intérieur, von Schmidt ne pouvait en comprendre la raison. Dans le silence des nuits, tandis que sa femme dormait, il avait essayé de lire la littérature de Martin, et en était arrivé à la conclusion que les gens étaient fous d’acheter ça.
De son côté, Martin ne comprenait que trop bien la situation, tandis qu’appuyé au dossier de sa chaise, il caressait du regard la tête de son beau-frère, en rêvant qu’il lui écrasait de plusieurs coups de poing bien appliqués sa stupide face ricanante d’Allemand !
Une seule chose lui plaisait en Hermann, cependant. Bien qu’il fût pauvre et ambitieux, il avait pris une bonne pour éviter à Marianne le gros ouvrage.
Martin parla avec le directeur des agences « Asa » et après le dîner l’emmena dans un coin avec Hermann, dont il déclara commanditer le futur magasin de bicyclettes et de réparations – ce devait être le plus beau d’Oakland. Il alla plus loin encore et engagea confidentiellement Hermann à se chercher une agence d’automobiles et un garage, car rien ne l’empêchait de faire prospérer ces deux établissements à la fois.
Lorsqu’ils se quittèrent, Marianne, les larmes aux yeux, jeta ses bras au cou de Martin et lui dit combien elle l’aimait, combien elle l’avait toujours aimé. Cette tirade fut, il est vrai, coupée d’une pause un peu gênée, qu’elle meubla par une recrudescence de larmes, de baisers, et de balbutiements incohérents. Martin crut comprendre qu’il s’agissait d’oublier l’époque où elle avait manqué de confiance en lui et insisté pour qu’il trouve une « situation ».
– Il est incapable de garder son argent, c’est évident, confia Hermann von Schmidt à sa femme. Lorsque j’ai parlé d’intérêt, il est devenu fou et m’a dit que si jamais j’en reparlais, il me casserait ma sale tête d’Allemand. Parfaitement : ma sale tête d’Allemand ! Ça fait rien : ce n’est pas un homme d’affaires, mais c’est le bon gars. Il me donne un fameux coup de pouce ; c’est bien de sa part.
Les invitations à dîner pleuvaient de toutes parts, et Martin continuait à s’étonner. Au banquet du Club de la Bohême, il fut le convive de marque parmi des hommes connus dont il avait entendu parler toute sa vie et qui lui racontèrent comment, en lisant L’Appel des cloches dans le Transcontinental et La Péri et la perle, dans le Hornet, ils l’avaient immédiatement pris gagnant.
« Bon Dieu ! et dire que pendant ce temps, j’avais faim et j’étais en haillons ! se dit-il. Pourquoi ne m’avez-vous pas invité à dîner à cette époque-là ? C’était le moment. J’étais le même. J’avais déjà écrit ces ouvrages à l’époque où j’avais faim. Pas un mot n’a été changé depuis à L’Appel des cloches ni à La Péri et la perle. Mais non, vous ne m’invitez pas à présent à cause de ce que je suis, vous m’invitez parce que tous les autres m’invitent, parce que c’est un honneur de me recevoir à votre table. Vous m’invitez à présent parce que vous êtes de stupides animaux, parce que vous êtes la foule, parce qu’en ce moment même, l’aveugle et moutonnière fantaisie de la foule est de s’occuper de moi. Mais dans toutes ces flatteries, est-ce que Martin Eden et son travail entrent en ligne de compte ?… conclut-il plaintivement. Puis il se leva et répondit avec esprit à un toast plein de verve.
Et partout où il se trouvait, au club de la Presse, au Redwood Club, à des thés poétiques ou à des réunions littéraires, partout on rappelait L’Appel des cloches et La Péri et la perle et le bien qu’on en avait immédiatement pensé. Et, toujours, Martin se demandait, exaspéré : Mais pourquoi ne m’avoir pas tendu la main ? J’étais le même. L’Appel des cloches, La Péri et la perle, n’ont pas changé d’un iota. Ils contenaient autant d’art, avaient la même valeur. Mais leur valeur et l’art, vous vous en moquez. Vous me nourrissez à l’heure qu’il est, parce que la foule imbécile se dispute l’honneur de me nourrir.
Souvent alors, il voyait tout à coup apparaître, au beau milieu de l’assemblée, un jeune voyou, en veston trop court, coiffé d’un Stetson rejeté en arrière. Cela lui arriva un après-midi, à la société Gallina d’Oakland. Il venait de monter sur l’estrade et s’avançait vers le public, lorsqu’il aperçut, entrant fièrement par la porte de la grande salle, le jeune voyou avec son feutre rejeté en arrière. Cinq cents femmes élégantes se retournèrent aussitôt pour voir ce que Martin regardait avec une pareille insistance. Elles ne virent rien que l’allée centrale, vide. Mais lui voyait le jeune dur suivre, en se dandinant, cette allée, et il se demanda s’il allait enlever son chapeau, bien qu’il sût que ce n’était guère dans ses habitudes. Il suivit l’allée jusqu’au bout et monta sur l’estrade. Martin eut envie de pleurer sur ce fantôme de sa jeunesse à la pensée de toute la somme de souffrance qui l’attendait. Sur l’estrade, il vint droit à Martin, puis disparut. Les cinq cents femmes applaudirent doucement, pour encourager le grand homme timide qu’était leur hôte. Et Martin, chassant la vision de son esprit, sourit et commença sa conférence.
Le directeur des Écoles, digne vieillard, arrêta Martin dans la rue et lui rappela certaines scènes dans son bureau, à la suite desquelles Martin avait été expulsé de l’école pour cause de bataille.
– J’ai lu votre Appel des cloches, à sa parution, il y a déjà assez longtemps, dit-il. C’est aussi bien que de l’Edgar Poe. C’est magnifique ! ai-je dit en le lisant, magnifique !…
Et Martin faillit répondre : « Oui, et dans les mois qui suivirent, je vous ai rencontré deux fois et vous avez fait semblant de ne pas me voir. Les deux fois, j’avais faim et j’allais au Mont-de-Piété. J’étais le même alors, le même qu’aujourd’hui. Et vous ne m’avez pas reconnu. Pourquoi me reconnaissez-vous aujourd’hui ? »
– Je disais encore l’autre jour à ma femme, continua le digne vieillard, que ce serait une bonne idée si vous veniez dîner un de ces soirs. Elle était tout à fait de mon avis – tout à fait.
– Dîner ? dit Martin d’un ton si agressif que l’autre en sursauta.
– Mon Dieu, oui, oui… dîner ; oh ! à la fortune du pot, chez votre vieux directeur, hein ? brigand ! fit-il, nerveux, avec un timide essai de bourrade qui voulait être joviale.
Martin descendit la rue dans une sorte de torpeur. Il s’arrêta au coin et regarda vaguement autour de lui.
– Nom de Dieu ! murmura-t-il enfin. Le vieux a eu peur de moi.
44
Un jour, dans la rue, la voiture de Mme Morse passa tout près de Martin ; elle le salua en souriant. Il salua en souriant également. L’incident ne le frappa nullement. Un mois auparavant, ça l’aurait dégoûté ou intrigué et il aurait cherché à se rendre compte du degré d’inconscience de Mme Morse. À présent, il n’y pensa plus une seconde après. Il oublia comme il aurait oublié la Banque Centrale ou City Hall après avoir passé devant. Son cerveau était anormalement agité : ses pensées tournaient inlassablement dans le même cercle. Au centre de ce cercle ces mots : « J’étais le même », rongeaient son cerveau inlassablement. Il les retrouvait au réveil. À travers ses rêves, il les entendait. Les plus petits détails de la vie ne pénétraient ses sens qu’à travers ces mots : « J’étais le même ». Et une logique implacable l’amena enfin à conclure qu’il n’était rien, absolument rien. Mart Eden le voyou, Mart Eden le marin avaient existé, eux : mais Martin Eden, le célèbre écrivain, n’existait pas. Martin Eden, le célèbre écrivain, n’était qu’une illusion créée par l’imagination de la foule. Mais il ne s’y laissait pas prendre. Il n’était pas cette idole que la foule adorait et à qui elle offrait de la nourriture en sacrifice propitiatoire. Il ne marchait pas.
Il lut des articles sur lui et s’ébahit devant des portraits qui n’avaient absolument rien de vrai ; impossible de découvrir la moindre ressemblance. Il était celui qui a vécu, vibré, aimé ; celui dont le caractère facile et tolérant était tout indulgence pour les fragilités de l’existence ; celui qui, à son poste au gaillard d’avant d’un navire avait vogué vers d’étranges et lointaines contrées ; ou encore celui qui, à la tête d’une bande de chenapans, s’était battu à coups de poing. Il était celui que tant de milliers de livres à la bibliothèque populaire avaient fait reculer épouvanté le premier jour ; et celui qui s’était frayé un chemin au milieu d’eux et les avait conquis ; il était celui, enfin, qui se donnait des coups d’éperon pour chasser le sommeil et travailler jusqu’au-delà de la limite des forces humaines. Tout cela, il l’était. Mais ce qu’il n’était pas, c’était cette espèce d’ogre doté d’un appétit colossal que le public s’obstinait à vouloir gaver.
Certaines choses dans les magazines l’amusaient cependant. Tous se disputaient la gloire de l’avoir lancé. Le Warren’s Monthly annonça à ses abonnés, qu’étant constamment en quête de nouveautés littéraires, c’était lui qui avait présenté, entre autres, Martin Eden aux lecteurs. La White Mouse réclama la priorité, ainsi que la Northern Review et le Makin-tosh’s Magazine ; mais Le Globe les fit taire, en exhibant triomphalement de sa collection, Les Poèmes de la mer, si honteusement déchiquetés. Youth and Age revenu à la vie sans avoir jamais payé ses dettes et dont les seuls lecteurs étaient de jeunes campagnards, réclama à son tour. Le Transcontinental raconta d’une façon digne et convaincante, comment il avait découvert Martin Eden, prérogative qui lui fut chaudement disputée par le Hornet, qui exhiba La Péri et la perle. Dans la mêlée, les modestes droits de Singletree, Darnley and Co disparurent complètement. D’ailleurs, cette maison, ne commanditant aucun magazine, ne sut jamais revendiquer ses droits.
Les journaux discutèrent des gains de Martin Eden. D’une façon ou d’une autre, les offres magnifiques de certains magazines transpirèrent ; de dignes pasteurs d’Oakland vinrent le voir amicalement, et les demandes de mendiants professionnels vinrent grossir son courrier. Mais les femmes étaient pires que tout. Ses photographies avaient été semées aux quatre vents du ciel et des écrivains parlèrent de son rude visage bronzé, balafré, de ses épaules larges, de ses clairs yeux tranquilles et de ses traits émaciés qu’ils déclarèrent ascétiques. Il pensa à sa jeunesse mouvementée, et sourit. Souvent, parmi les femmes qu’il rencontrait, l’une ou l’autre le regardait, l’évaluait, le choisissait.
Mais il ne faisait qu’en rire. Il se rappelait la mise en garde de Brissenden et n’en riait que davantage. Les femmes n’étaient pas un danger pour lui, il en répondait. Il avait dépassé la période fatale.
Un soir, alors qu’il accompagnait Lizzie à l’école du soir, il surprit le regard d’une femme élégante et jolie. Le regard était un peu trop appuyé, un peu trop long. Lizzie en comprit la signification et se redressa, furieuse. Martin le remarqua, comme il en avait remarqué la cause et lui dit qu’il y était habitué et qu’il s’en moquait bien.
– Vous ne devriez pas vous en moquer ! répondit-elle, les yeux brillants de colère. Ce n’est pas possible, vous êtes malade !
– Jamais je ne me suis mieux porté ! J’ai pris dix livres de plus.
– Je ne parle pas de votre physique, mais de votre tête. Il y a quelque chose qui ne va pas, dans votre machine à penser. Même moi, qui ne suis rien, je peux voir ça !
Il marchait à côté d’elle, pensif.
– Je donnerais n’importe quoi pour vous voir sorti de là ! s’écria-t-elle brusquement. Un homme comme vous, ça devrait vous plaire, quand une femme vous regarde comme ça ! Ce n’est pas naturel. Vous êtes un homme. Et, vous me croirez si vous voulez, mais je serai bien heureuse le jour où vous tomberez sur une femme qui vous plaira.
Quand il quitta Lizzie à l’école du soir, il retourna tout droit au Métropole.
Une fois dans sa chambre, il tomba dans un grand fauteuil et se mit à regarder fixement, droit devant lui. Il ne sommeillait pas, ne pensait à rien, son cerveau était vide, sauf aux instants où des taches colorées, lumineuses, formaient des images vagues sous ses paupières. Il les voyait comme en rêve. Pourtant il ne dormait pas. Il se dressa à un moment donné et regarda l’heure : il était huit heures juste. Il n’avait rien à faire et il était trop tôt pour se coucher. Puis son cerveau se vida de nouveau et des images apparurent, puis s’évanouirent sous ses paupières. Ces images se ressemblaient toutes. Elles représentaient toujours des masses de feuillages et de buissons, traversées de soleil ardent.
Un coup frappé à sa porte le ramena sur terre.
Il pensa que c’était un télégramme, une lettre… ou, peut-être la blanchisseuse qui lui rapportait son linge. Puis, le souvenir de Joe lui passa par la tête et il se demanda où il pouvait bien être, en répondant :
– Entrez !
Il pensait encore à Joe et ne se retourna pas vers la porte. Elle se referma doucement. Il y eut un long silence. Ayant complètement oublié qu’on avait frappé, il s’était replongé dans sa torpeur, quand il entendit un sanglot de femme, un sanglot sourd, contenu, spasmodique. Alors, il se retourna et bondit sur ses pieds.
– Ruth ! s’écria-t-il, affolé, stupéfait.
Elle s’appuyait contre la porte, le visage pâle et contracté, une main sur son cœur. Puis elle étendit les bras vers lui, d’un air implorant et fit un pas en avant.
Il lui prit les deux mains et remarqua qu’elles étaient glacées.
Après l’avoir guidée vers le fauteuil il approcha un autre siège ; il s’assit sur le bras. Un profond embarras le paralysait. Dans son esprit, cette histoire était finie, enterrée. Si, tout d’un coup, par un miracle, la blanchisserie de Shelly Hot Springs avait été transportée à l’hôtel Métropole, lui offrant la perspective d’une semaine de linge à blanchir, il n’aurait pas été plus ennuyé. Plusieurs fois, il fut sur le point de parler, sans parvenir à trouver la phrase appropriée.
– Personne ne sait que je suis ici, dit Ruth d’une voix faible avec un sourire suppliant.
– Que dites-vous ?
Le son de sa propre voix l’étonna.
Elle répéta sa phrase.
– Ah ! dit-il, en se demandant ce qu’il allait bien pouvoir lui dire après.
– Je vous ai vu rentrer et j’ai attendu un instant.
– Ah ! dit-il encore.
De sa vie, il n’avait été tellement à court d’idées.
– Et alors, vous êtes entrée, dit-il enfin.
Elle fit un petit geste affirmatif, ses yeux eurent un éclair espiègle et elle défit l’écharpe qu’elle avait autour du cou.
– Je vous ai vu d’abord de l’autre côté du trottoir, quand vous étiez avec cette fille.
– Oui ? dit-il simplement. Je l’amenais à l’école du soir.
– Eh bien ! vous n’êtes pas content de me voir ? dit-elle après un nouveau silence.
– Si, si ! fit-il rapidement. Mais ça n’est pas très raisonnable de votre part de venir ici.
– Personne ne le sait. Je voulais vous voir. Je suis venue vous dire que j’ai été idiote. Je suis venue parce que je n’en pouvais plus, parce que mon cœur m’y poussait, parce que… parce que j’avais besoin de venir.
Elle se leva, vint vers lui, posa sa main sur son épaule un instant, haletante, puis glissa dans ses bras. Et comme sa nature facile et bonne répugnait à faire de la peine, comme il sentait que de la repousser lui causerait la plus cruelle blessure qu’une femme puisse recevoir, il referma ses bras autour d’elle et la tint serrée contre lui. Mais dans cette étreinte, il n’y avait aucune chaleur, aucun frémissement. Elle était venue dans ses bras et il la tenait, voilà tout. Elle se pelotonna contre lui, puis ses mains se glissèrent autour de son cou, se nouèrent sur sa nuque. Mais il ne s’enflamma pas sous la caresse de ces mains et il se sentait de plus en plus gêné et mal à l’aise.
– Pourquoi tremblez-vous ainsi ? lui demanda-t-il. Vous avez froid ? Voulez-vous que j’allume le feu ?
Il fit un mouvement pour se dégager, mais elle se serra davantage contre lui, en frissonnant violemment.
– Simple nervosité, dit-elle, en claquant des dents. Dans une minute, ça sera passé. Je vais déjà mieux.
Ses frissons diminuaient peu à peu. Il la tenait toujours dans ses bras, mais sa surprise embarrassée avait cessé. À présent, il savait pourquoi elle était venue.
– Ma mère voulait me faire épouser Charley Hapgood, dit-elle.
– Charley Hapgood ! Ce gars qui ne dit que des platitudes ! gémit Martin. (Puis il ajouta :) Et maintenant, je suppose que c’est moi que votre mère désire que vous épousiez.
Ce n’était point une question qu’il posait ; c’était l’affirmation d’une certitude.
– Elle ne s’y opposera plus, je le sais, dit Ruth.
– Elle me considère comme un parti tout à fait convenable ?
Ruth fit signe que oui.
– Et pourtant, je ne suis pas un parti plus convenable que le jour où elle vous a obligée à rompre nos fiançailles, dit-il, pensif. Je n’ai pas changé. Je suis le même Martin Eden – non ! je suis pire : je fume plus que jamais. Ne le sentez-vous pas ?
Sans lui répondre, elle posa ses doigts sur les lèvres de Martin, gracieusement mutine, et attendit le baiser que ce geste lui valait, autrefois. Mais le baiser ne vint pas. Martin attendit qu’elle ait retiré ses doigts et poursuivit :
– Je n’ai pas changé. Je n’ai pas de « situation ». Je n’en cherche pas. Je n’en chercherai pas. Et j’ai toujours la conviction que Herbert Spencer est un noble et grand homme et que le juge Blount est un âne bâté. J’ai dîné chez lui l’autre soir, ce qui m’a confirmé dans mon opinion.
– Mais vous n’avez pas accepté l’invitation de mon père, protesta-t-elle.
– Tiens ! vous savez ça ? C’est votre mère qui l’avait envoyé ?
Elle garda le silence.
– C’est bien votre mère. Je m’en doutais. Je suppose aussi que c’est elle qui vous a envoyée ici ?
– Personne ne sait que je suis venue, dit-elle en protestant. Croyez-vous que ma mère me l’aurait permis ?
– Elle vous permettrait de m’épouser. Ça c’est certain.
Elle poussa un cri :
– Oh ! Martin, comme vous êtes cruel ! Vous ne m’avez pas embrassée une seule fois. Vous êtes froid comme un marbre. Pensez à ce que j’ai osé faire ! (Elle jeta un coup d’œil autour d’elle en frissonnant, mais non sans une certaine curiosité.) Pensez que je suis ici, chez vous !
« Je voudrais mourir pour vous, mourir pour vous ! » La voix de Lizzie chantait encore à son oreille.
– Pourquoi ne l’avez-vous pas osé plus tôt ? interrogea-t-il d’un ton sec. Quand je n’avais rien ? Quand je mourais de faim ? Quand j’étais exactement ce que je suis aujourd’hui, le même homme, le même artiste, le même Martin Eden ?… Ça fait bien des jours que je me pose cette question, non pas à cause de vous spécialement, mais d’une façon générale. Je n’ai pas changé, voyez-vous, bien que la soudaine appréciation de ma valeur par le monde, m’amène constamment à devoir me rassurer sur ce point. Ma chair est restée la même et mes dix doigts et mon visage. Je n’ai acquis ni plus de force ni une qualité de plus. Mon cerveau est pareil. Je n’ai même rien inventé de plus ni en littérature ni en philosophie. Ma valeur personnelle est exactement semblable à ce qu’elle était quand personne ne voulait de moi. Pourquoi veut-on de moi, à présent ?… C’est ce qui m’intrigue. Il est évident que ce n’est pas pour moi-même, puisque je suis resté ce que j’étais quand on ne voulait pas de moi. Donc, c’est pour une raison extérieure, pour une chose qui n’est pas moi. Voulez-vous que je vous dise ce que c’est ? C’est mon succès. Mais ce succès, ce n’est pas moi. Et aussi, tout l’argent que j’ai gagné et que je continue à gagner. Et c’est également à cause de ça, de ce succès et de cet argent, que vous voulez de moi aujourd’hui.
– Vous me brisez le cœur ! sanglota Ruth. Vous savez que je vous aime, que je suis venue parce que je vous aime.
– Je crains que vous ne saisissiez pas bien mon point de vue, dit-il avec douceur. Je veux dire que du moment que vous m’aimez, comment se fait-il que votre amour actuel soit si fort, quand votre amour autrefois a été assez faible pour me renier ?
– Oubliez tout ça et pardonnez-moi ! s’écria-t-elle avec passion. Je n’ai jamais cessé de vous aimer, souvenez-vous-en ! Et je suis là maintenant, dans vos bras.
– J’ai bien peur d’être un marchand plein de méfiance qui regarde trop attentivement les balances, pour peser votre amour et craint de s’apercevoir que le poids n’y est pas.
Elle se dégagea de ses bras, se redressa et le regarda longuement, profondément. Elle fut sur le point de parler, puis hésita et se tut.
– Tenez, je vais vous expliquer la façon dont je vois les choses, poursuivit Martin. Autrefois, quand je n’avais pas reçu ma consécration officielle, en dehors de mon milieu, personne ne s’intéressait à moi. Lorsque j’écrivais mes livres, aucun de ceux qui en ont lu les manuscrits, ne s’en souciaient. Bien au contraire, on semblait ne m’en estimer que moins. On aurait dit, vraiment, qu’en écrivant, je commettais un acte pour le moins répréhensible. Et tout le monde me disait : Cherchez un gagne-pain !
Elle fit un geste de dénégation.
– Si, si, dit-il, vous exceptée. Vous, vous me disiez : Cherchez une situation ! Le mot familier de gagne-pain – comme bien des mots que j’ai écrits – vous choque. Il est brutal. Je vous réponds que je le trouvais brutal également, quand tout le monde me le jetait à la figure, comme on recommande la bonne conduite à un être dévoyé. Mais je m’écarte de la question. La publication de mes livres, l’accueil qu’ils ont reçu du public, ont changé la nature de votre amour. Le Martin Eden qui n’était que lui-même, vous ne vouliez pas l’épouser. Vous ne l’aimiez pas assez pour ça. Aujourd’hui votre amour est assez grand, et je ne peux m’empêcher d’en conclure qu’il a grandi en raison de la faveur du public qui a consacré mon talent. Pour vous, il ne s’agit pas de mon argent, je le sais – bien que je sois certain qu’il entre pour beaucoup dans le changement qui s’est opéré chez vos parents. Tout ça, naturellement, n’est pas très flatteur pour moi. Mais ce qui est pire, ça me fait douter de l’Amour… du divin Amour. L’amour est-il donc chose si matérielle qu’on doive le nourrir de réclames et de popularité ? On le dirait. C’est une idée qui m’a hanté à un tel point que j’ai failli en devenir fou.
– Pauvre chère tête ! (Elle étendit la main, passa doucement ses doigts à travers les cheveux de Martin.) Laissez toutes ces vilaines pensées. Reprenons depuis le commencement. Je n’ai jamais cessé de vous aimer. Oui, j’ai manqué de fermeté en cédant à la volonté de ma mère. Je n’aurais pas dû le faire. Mais je vous ai entendu parler si souvent, avec une grande compréhension, de la faillibilité, de la fragilité des humains ! Étendez-la sur moi, cette compréhension… J’ai péché par ignorance ! Pardonnez-moi !…
– Oh ! je vous pardonne ! dit-il avec impatience. Il n’y a d’ailleurs rien à pardonner. Chacun agit selon ses propres lumières et ne peut faire davantage. C’est comme si je vous demandais de me pardonner de n’avoir pas trouvé « une situation ».
– Je croyais bien faire, protesta Ruth. Vous le savez. Je ne vous aurais pas aimé si je n’avais pas cru agir pour votre bien ?
– Bon ! mais tout en croyant bien faire, vous vouliez détruire ce qui fait ma personnalité. Oui ! (Elle voulait l’interrompre, mais il l’en empêcha.) Oui, vous auriez détruit ma littérature, mon avenir. Ma nature est éprise de réalisme, et l’esprit bourgeois hait le réalisme par lâcheté, par peur de la vie. Vous avez tout fait pour me faire craindre la vie. Vous m’auriez rabaissé à la mesure de votre vie bourgeoise, où tout est mesquin, faux et vulgaire.
Elle eut un geste de protestation.
– La vulgarité – une vulgarité cordiale, je l’admets – est la base de la culture bourgeoise et de ses raffinements. Comme je vous l’ai dit, vous vouliez me rabaisser et me modeler à l’image des vôtres, d’après l’idéal de votre classe, l’évaluation de votre classe, les préjugés de votre classe. (Il secoua tristement la tête.) Et, même en ce moment, vous ne me comprenez pas. Mes mots, pour vous, ne signifient rien de ce que j’essaye d’y mettre. Pour vous ça n’est pas sérieux. C’est tout au plus si ça vous intrigue et vous amuse un peu que ce jeune sauvage, sorti en rampant d’un abîme de boue, se permette de juger votre classe et de la trouver vulgaire.
Elle appuya sa tête contre son épaule avec lassitude et de nouveau un frisson nerveux la secoua. Comme elle restait silencieuse, il continua :
– Et maintenant, vous voulez recommencer notre amour. Vous voulez m’épouser. Vous me voulez. Et pourtant, regardez, si mes livres n’avaient pas été remarqués, je n’en serais pas moins demeuré le même… Mais vous ne seriez pas venue. Ce sont tous ces livres. Bon Dieu !…
– Ne jurez pas, interrompit-elle.
Le reproche le fit éclater d’un rire amer.
– Voilà ! c’est bien ça ! dit-il, dans un moment critique, quand ce que vous croyez être le bonheur de votre vie est en jeu, un juron vous fait peur.
Ces mots firent sentir à Ruth la puérilité de son exclamation, mais elle trouva qu’il en avait exagéré la portée et lui en voulut. Un long silence s’établit. Elle réfléchissait désespérément au moyen de le reprendre. Il pensait à son amour défunt. Il ne l’avait jamais vraiment aimée, il le savait à présent. Il avait aimé une Ruth idéale, un être éthéré, sorti tout entier de son imagination, l’inspiratrice ardente et lumineuse de ses poèmes d’amour. La vraie Ruth, celle de tous les préjugés bourgeois, marquée du sceau indélébile de la mesquinerie bourgeoise, celle-là, il ne l’avait jamais aimée. Elle se mit à parler tout à coup.
– Je sais qu’il y a beaucoup de vrai dans ce que vous dites. J’ai eu peur de la vie. Je ne vous ai pas assez aimé. Mais j’ai appris à mieux comprendre l’amour. Aujourd’hui, je vous aime pour vous-même, pour ce que vous avez été, à cause même de la façon dont vous êtes devenu ce que vous êtes. Je vous aime à cause même de ce qui vous différencie de ce que vous appelez « ma classe », à cause de vos croyances que je ne comprends pas, mais que j’apprendrai à comprendre, je le sais. Je ferai tout pour les comprendre. Tenez ! fumez, jurez, ça fait partie de vous et je vous aimerai à cause de ça. J’apprendrai, vous verrez ! Depuis dix minutes, j’ai déjà beaucoup appris. Que j’aie osé venir ici, est une preuve de ce que j’ai déjà appris. Oh ! Martin…
Elle se serra contre lui en sanglotant.
Pour la première fois, ses bras l’enlacèrent avec tendresse et elle l’en remercia par un sourire heureux.
– Trop tard ! dit-il. (La phrase de Lizzie lui revint à l’esprit.) Je suis malade – oh ! pas physiquement !… Ce sont mon âme, mon cerveau qui sont malades. J’ai perdu le goût de vivre. Tout m’est égal. Si vous m’aviez dit tout ça il y a quelques mois, ç’aurait été différent. Maintenant, il est trop tard.
– Il n’est pas trop tard ! s’écria-t-elle. Vous verrez ! Je vais vous prouver que mon amour a grandi, que j’y tiens davantage qu’à « ma classe » et à tout ce qui m’est cher ! Je me moque de tous les préjugés. La vie ne me fait plus peur. Je quitterai mon père et ma mère, et mes amis n’oseront plus prononcer mon nom. Si vous voulez, je suis à vous, dès maintenant, heureuse et fière d’être votre maîtresse. Si j’ai trahi l’amour, je veux à présent, pour l’amour de l’Amour, trahir tout ce qui m’avait fait le renier.
Elle se leva, se tint devant lui, les yeux étincelants.
– J’attends, Martin… murmura-t-elle. J’attends que vous m’acceptiez. Regardez-moi !
Il la regarda, la trouva splendide. Elle rachetait vraiment sa conduite passée, se montrait enfin une vraie femme, supérieure aux lois de fer des conventions bourgeoises. C’était splendide, magnifique, sublime. Et pourtant… que lui arrivait-il donc ? Ce qu’elle faisait ne le touchait ni ne l’émouvait. Il l’appréciait, l’admirait cérébralement. Mais son cœur n’avait pas tressailli. Et il ne la désirait plus. De nouveau la phrase de Lizzie lui revint à l’esprit.
– Je suis malade, très malade, dit-il avec un geste désespéré. Je m’en aperçois seulement maintenant. Quelque chose en moi s’est éteint. Je n’ai jamais eu peur de la vie, mais je n’aurais jamais cru pouvoir être blasé de la vie. La vie m’a tellement saturé d’émotions, que je suis vidé de tout désir. Si je pouvais encore désirer, c’est vous que je désirerais. Vous voyez à quel point je suis malade !
Il renversa la tête et ferma les yeux ; et, de même que l’enfant qui pleure, oublie son chagrin en regardant la lumière se brouiller à cause de ses larmes, Martin oublia sa maladie, la présence de Ruth, tout, pour ne plus voir qu’un immense rideau de feuillages, traversé d’ardent soleil, qui se formait et flamboyait sous ses paupières. Ce soleil, trop ardent, l’éblouissait, lui faisait mal. Et pourtant, il le regardait… pourquoi ?
Il fut rappelé à lui par le bruit du bouton de la porte. Ruth s’en allait.
– Comment vais-je sortir ? dit-elle, d’un ton larmoyant. J’ai peur !
– Oh ! pardon ! s’écria-t-il, sautant sur ses pieds. Je ne suis pas moi-même, vous voyez. J’avais oublié que vous étiez là. (Il toucha sa tête du doigt.) Vous voyez, ça ne va pas très bien. Je vais vous ramener. Nous allons sortir par la porte de service. Personne ne nous verra. Baissez votre voile et tout ira bien.
Elle se cramponna à son bras le long des corridors mal éclairés et de l’escalier étroit.
– Je suis sauvée, dit-elle, quand ils furent sur le trottoir et, vivement, elle fit un mouvement pour dégager son bras.
– Non, non, je vous accompagne chez vous, répondit Martin.
– Non, je vous en prie, c’est inutile, dit-elle.
De nouveau elle essaya de dégager son bras. Martin eut une lueur de curiosité. À présent qu’elle était en sûreté, elle avait peur ! Elle n’avait qu’une idée : se débarrasser de lui, au plus vite. Il renonça à comprendre la raison, l’attribua à sa nervosité et, retenant son bras doucement, continua à l’accompagner. Avant le coin de la rue, un homme se dissimula tout à coup sous une porte cochère. Malgré son col remonté, il reconnut Norman, le frère de Ruth.
En chemin, Ruth et Martin causèrent peu. Elle était hébétée. Il était apathique. Il lui annonça seulement qu’il allait partir, retourner dans les mers du Sud. Elle lui demanda pardon d’être venue. Et ce fut tout. Leur adieu fut quelconque. Ils se serrèrent la main, se dirent bonsoir, il enleva son chapeau, puis la porte se referma bruyamment, il alluma une cigarette et fit demi-tour. En passant devant la porte cochère sous laquelle il avait vu Norman disparaître, il s’arrêta pour affirmer tout haut :
– Elle mentait ! Elle me faisait croire qu’elle courait les pires risques, sachant fort bien que son frère, qui l’avait amenée, l’attendait pour la reconduire.
Il éclata de rire.
– Oh ! ces bourgeois ! quand j’étais fauché, il n’aurait pas fallu qu’on me voie avec sa sœur. Maintenant que j’ai un compte en banque, c’est lui qui me l’amène.
Il tournait sur ses talons pour s’en aller, quand un clochard, qui marchait dans la même direction que lui, lui demanda l’aumône.
– Dites, M’sieur, donnez-moi vingt-cinq cents pour coucher à l’asile de nuit ! – Cette voix fit retourner Martin. L’instant d’après, il serrait la main de Joe.
– Tu te rappelles, quand on s’est quittés à Shelly Hot Springs ? dit l’autre. J’t’ai dit qu’on se reverrait. Je le sentais. Eh ben, ça y est !
– Tu as bonne mine, dit Martin d’un ton admiratif. On dirait que tu as engraissé.
– Bien sûr ! (La figure de Joe rayonnait de joie.) Je savais pas ce que c’est que de vivre, avant de devenir clodo. Je pèse quinze livres de plus et je me porte comme un charme. Tiens, autrefois, je me ruinais la santé à bosser comme un fou. La cloche, ça me convient parfaitement.
– Mais tu cherches un lit tout de même, dit Martin en plaisantant. Et il fait froid, ce soir.
– Je cherche un lit ? Attends voir. (Joe fouilla dans la poche de son pantalon et en retira une poignée de petite monnaie.) Tiens ! et ça ! dit-il triomphalement. Tu avais l’air chic, c’est pour ça que je t’ai tapé.
Martin se mit à rire et s’avoua battu.
– Avec ça, tu as de quoi te payer pas mal de litrons ! insinua-t-il.
Joe remit la monnaie dans sa poche.
– Très peu pour moi, déclara-t-il. Je ne me soûle plus. Pourtant qu’est-ce qui m’en empêcherait ? Je me suis soûlé une fois depuis que je t’ai vu et pas exprès : c’était parce que j’avais le ventre vide. Quand je travaille comme une brute, je bois comme une brute. Quand je vis en homme libre, je bois comme un homme libre, un coup de temps en temps, quand j’en ai envie, et c’est tout.
Martin lui donna rendez-vous pour le lendemain et rentra à l’hôtel. Il s’arrêta au bureau pour regarder les départs de bateaux. La Mariposa partait pour Tahiti cinq jours plus tard. – Téléphonez demain matin et faites-moi réserver une cabine de luxe, dit-il à l’employé. Pas sur le deck – en bas, à l’extérieur, par bâbord. Rappelez-vous : par bâbord. Notez-le, ça vaut mieux.
Une fois dans sa chambre, il se mit au lit et s’endormit comme un enfant. Les événements de la soirée ne lui avaient fait aucune impression. Aucune impression ne laissait plus d’empreinte sur son esprit. La bouffée de joie qu’il avait eue en rencontrant Joe, n’avait duré qu’un bref instant. Aussitôt après, la présence de l’ex-blanchisseur, la fatigue de soutenir une conversation, l’avaient ennuyé. L’idée de partir dans cinq jours pour son cher Pacifique lui était égale. Il ferma les yeux et dormit normalement et confortablement huit heures consécutives, sans bouger, sans rêver. Le sommeil, c’était l’oubli et chaque jour il ne se réveillait qu’à regret. La vie l’ennuyait affreusement. C’était si long, la vie !…
45
– Dis donc, Joe ! (Ce fut ainsi qu’il accueillit son ancien camarade des mauvais jours, le lendemain matin.) Je connais un Français qui habite la 28e Rue ; il a gagné le gros sac, retourne en France et vend sa blanchisserie, une jolie petite blanchisserie, épatante. Si tu veux t’établir, voilà ton affaire. Tiens, prends ça ; achète-toi des vêtements et va à dix heures au bureau de ce gars. Il m’a montré la blanchisserie ; il te la montrera aussi. Si elle te plaît et si tu crois qu’elle vaut le prix – douze mille dollars – dis-le-moi et elle est à toi. Maintenant laisse-moi. J’ai à faire. Je te verrai plus tard.
– Écoute, Mart, dit l’autre d’une voix lente où la colère montait. Je suis venu pour te voir. Tu entends ? Je ne suis pas venu pour voir une blanchisserie. Je viens causer, en vieux copain et tu me flanques une blanchisserie à la tête. Ben, j’vas te dire : tu peux la garder, ta blanchisserie et aller te faire voir…
Il partait déjà, furieux, quand Martin le saisit par l’épaule et le fit pirouetter sur lui-même.
– Écoute, Joe ! dit-il, si tu fais l’imbécile, je te casse la figure. Et en souvenir de notre vieille amitié, je te la casserai convenablement. Allons ! tu veux ou tu ne veux pas ?
Joe l’avait saisi à bras-le-corps, mais Martin ayant eu l’avantage de la prise, il tenta en vain de se dégager. Ils titubèrent à travers la chambre, puis dégringolèrent à grand fracas à travers un fauteuil d’osier qui fut réduit en miettes. Joe gisait dessous, les bras en croix, solidement maintenu, un genou de Martin sur l’estomac. Il haletait, pantelant, et soufflait comme un phoque lorsque Martin le relâcha.
– Maintenant, on va un peu discuter, dit Martin. Ce n’est pas la peine de faire le malin avec moi. Avant tout je veux terminer cette affaire de blanchisserie. Puis tu pourras revenir et nous causerons du bon vieux temps. Je t’ai dit que j’étais occupé. Regarde ça !
Un domestique venait d’entrer avec un volumineux courrier de lettres et de magazines.
– Comment veux-tu que j’examine tout ça et que je discute en même temps ? Va voir cette blanchisserie et puis tu reviendras.
– Bon, finit par admettre Joe, de mauvaise grâce. Je croyais que tu voulais te débarrasser de moi, je me suis trompé. Mais tu sais, Mart, tu n’aurais pas le dessus, si on faisait un vrai combat de boxe. J’ai le bras plus long que toi.
– Nous mettrons des gants un de ces jours et on verra ! dit Martin en souriant.
– D’accord ! dès que la blanchisserie marchera.
Joe étendit le bras.
– Tu vois cette allonge ? Eh bien ! tu la sentiras passer !
Martin poussa un soupir de soulagement quand la porte se referma sur le blanchisseur. Il devenait misanthrope. De jour en jour il trouvait plus difficile d’être poli avec les gens. Leur présence l’ennuyait, leur conversation l’irritait. Ils le rendaient nerveux et, dès le premier contact, il cherchait un prétexte pour se débarrasser d’eux.
Au lieu de dépouiller son courrier, il paressa dans son fauteuil pendant une demi-heure encore, sans rien faire, sans presque penser.
Puis il se secoua et prit connaissance de son courrier. Il y avait une douzaine de demandes d’autographes – du premier coup d’œil, il les reconnaissait – des demandes d’argent de mendiants professionnels ; des lettres de cinglés depuis l’inventeur d’un moteur perpétuel et le scientifique qui a découvert que la terre est l’intérieur d’une sphère creuse, jusqu’à l’illuminé demandant des fonds pour acheter la péninsule de la Californie méridionale en vue de fonder une colonie communiste.
Puis, des lettres de femmes qui voulaient faire sa connaissance ; parmi elles une seule le fit sourire : elle y avait joint le reçu de location de sa chaise à l’église, comme preuve de sa piété et de sa respectabilité.
Rédacteurs de journaux ou de revues et maisons d’édition contribuaient pour une large part à l’avalanche quotidienne de lettres ; les premiers se traînaient à ses genoux pour avoir ses manuscrits, les seconds pour avoir ses livres. Ses pauvres manuscrits dédaignés ! Dire que pour les envoyer par la poste il avait engagé tout ce qu’il possédait pendant de longs mois lamentables. Le courrier contenait aussi des chèques inattendus d’Angleterre pour des droits de publication ou des avances sur des traductions étrangères. Son agent anglais lui annonçait la vente des droits de traduction en allemand pour trois de ses livres et l’informait que les éditions suédoises sur lesquelles il ne touchait rien – la Suède ne faisant pas partie de la Convention de Berne – étaient déjà en vente. On lui demandait aussi la permission de traduire en russe un de ses ouvrages, la Russie n’étant pas non plus membre de la Convention de Berne.
Il examina le gros tas de coupures que L’Argus de la Presse lui envoyait, lut ce qu’on disait de lui et de sa vogue, qui était devenue inouïe. Toute sa production littéraire avait été jetée au public en un torrent magnifique qui l’avait emporté d’assaut ; c’était sans doute à cause de ça. Pour Kipling, ça s’était produit de la même manière : il était bien près de mourir quand la foule capricieuse se mit soudain à le lire. Et Martin se souvenait très bien que cette même foule, après avoir lu Kipling et l’avoir acclamé – sans en comprendre le premier mot d’ailleurs – avait brusquement fait volte-face quelques mois plus tard et l’avait déchiré à belles dents.
Martin ricana à cette pensée. Le même traitement l’attendait sans doute, pourquoi pas ? Eh bien ! cette foule, il allait la posséder. Il allait partir dans les mers du Sud ; il construirait sa maison de verdure, ferait le commerce des perles et du copra, sauterait les récifs dans de frêles pirogues, pécherait le requin et la bonite et chasserait la chèvre sauvage sur les pics qui surplombent la vallée de Taiohae.
Et, tout à coup, tout le désespoir de sa situation lui apparut. Il vit clairement qu’il était entré dans la Vallée de l’Ombre. Toute la vie qui était en lui se fanait, s’évanouissait, s’en allait vers la mort. Il comprit à quel point il aspirait à dormir toujours. Autrefois il haïssait le sommeil, qui lui dérobait de si précieux moments de vie. Sur vingt-quatre heures, ces quatre heures le privaient de quatre heures de vie. Qu’il avait dormi à regret ! À présent, il vivait à regret. La vie n’était pas bonne ; elle manquait de sel ; son goût était amer. Or, toute vie qui n’aspire pas à continuer est bien près de cesser ; Martin glissait sur une pente dangereuse. Un vague instinct de conservation lui fit sentir qu’il devait partir au plus vite. Il regarda autour de lui et l’idée de faire ses malles l’ennuya tellement, qu’il préféra remettre ça à plus tard. En attendant, il allait s’occuper de son équipement.
Il sortit, entra dans un magasin d’engins de chasse et de pêche et y passa la matinée à choisir des carabines automatiques, des munitions et des lignes perfectionnées. Mais pour commander sa pacotille en vue des échanges futurs, il lui fallait attendre d’être à Tahiti, car ce genre de commerce subissait les fluctuations de la mode tout comme les autres. Ses marchandises pouvaient venir d’Australie, d’ailleurs. Cette solution le soulagea. La perspective d’entreprendre quelque chose d’actif lui répugnait en ce moment.
Il revint à l’hôtel tout heureux à la pensée du fauteuil confortable qui l’attendait et poussa un grognement de désespoir en entrant dans sa chambre, car Joe s’y prélassait déjà.
Joe était ravi de la blanchisserie. Tout était arrangé ; il pouvait en prendre possession dès le lendemain. Martin s’était étendu sur le lit et avait fermé les yeux tandis que l’autre bavardait. Ses pensées l’emmenaient bien loin, si loin qu’il ne se rendit même plus compte qu’il pensait vraiment. Il devait faire un véritable effort pour répondre de temps en temps à une question de Joe. Et pourtant, il avait toujours eu de l’affection pour Joe. Mais Joe avait trop d’exubérance ; il l’extériorisait d’une façon bruyante qui fatiguait l’esprit malade de Martin, exaspérait sa sensibilité. Lorsque Joe lui rappela qu’ils devaient boxer ensemble un jour, il en aurait hurlé d’agacement.
– Souviens-toi, Joe, qu’il faudra faire marcher ta blanchisserie d’après les règles qui te tenaient au cœur, à Shelly Hot Springs, lui dit-il. Un travail raisonnable. Pas de travail de nuit. Pas d’enfants aux cylindres ni à un autre emploi. Et des gages convenables.
Joe fit un signe d’assentiment et exhiba un calepin.
– Regarde. J’ai inscrit ces règles avant de déjeuner ce matin. Qu’est-ce que tu en penses ?
Il les lut à haute voix et Martin approuva, tout en faisant des vœux pour que Joe le débarrasse au plus tôt de sa présence.
Il se réveilla en fin d’après-midi. Lentement il reprit conscience de la vie et regarda autour de lui. Joe s’était évidemment éclipsé en le voyant s’endormir. C’est vraiment bien gentil de sa part, se dit-il. Puis il referma les yeux et se rendormit.
Les jours qui suivirent, Joe fut trop absorbé par l’organisation de la blanchisserie pour l’ennuyer beaucoup ; et ce ne fut que la veille de son embarquement, que les journaux annoncèrent qu’il partait sur la Mariposa. Pendant un des rares moments où l’instinct de conservation se manifestait encore chez lui, il alla chez un médecin pour se faire soigneusement examiner. On ne lui découvrit rien. Son cœur, ses poumons étaient magnifiques. Tous ses organes, autant que le docteur put en juger, étaient sains et fonctionnaient normalement.
– Vous n’avez rien, monsieur Eden, dit-il, absolument rien. Vous êtes en parfaite condition. Sincèrement, j’envie votre santé. Elle est superbe. Regardez-moi cette poitrine ! Là et dans votre estomac, se trouve le secret de votre remarquable constitution. Physiquement, il n’y a pas un homme sur mille qui vous vaille, pas un sur dix mille. À moins d’un accident, vous devez vivre jusqu’à cent ans.
Et Martin comprit que le diagnostic de Lizzie était exact. Physiquement il allait bien. C’est « sa machine à penser » qui avait déraillé et rien ne pouvait la guérir que les mers du Sud. L’ennui, c’est que maintenant, au moment même de partir, il n’en avait plus envie. Les mers du Sud ne l’attiraient pas davantage que la civilisation bourgeoise. L’idée du départ n’avait rien d’excitant et l’acte même nécessitait toutes sortes d’efforts fatigants. Il aurait voulu déjà être à bord et au large.
Le dernier jour fut une pénible épreuve. Ayant appris son départ par les journaux du matin, Bernard Higginbotham, Gertrude et toute la famille vinrent lui dire adieu, ainsi que Hermann von Schmidt et Marianne. Puis il fallut régler des affaires, payer des notes, supporter les éternels reporters. Il dit adieu à Lizzie Connolly brusquement, à l’entrée de l’école et se hâta de s’en aller. À l’hôtel il trouva Joe, que sa blanchisserie avait trop occupé tout le jour pour qu’il pût venir plus tôt. C’était la dernière corvée. Martin, cramponné aux bras de son fauteuil, parla et écouta pendant une demi-heure.
– Tu sais, Joe, dit-il, tu n’es pas marié avec ta blanchisserie. On ne t’y retiendra pas de force. Tu pourras, quand tu voudras, la vendre et dépenser l’argent. Si tu en as assez et que tu aies envie de reprendre la route, à ton aise. Fais ce qui te fera plaisir.
Joe secoua la tête.
– Finie la route pour moi, merci bien. Être chemineau, c’est parfait, excepté pour une chose : les filles. J’peux pas m’en empêcher, je suis un homme à femmes. J’peux pas m’en passer, et il faut s’en passer, quand on est chemineau. Chaque fois que je passais devant des maisons où on dansait, où on s’amusait, que j’entendais les femmes rire et que je voyais à travers les vitres leurs robes blanches et leurs sourires, Bon Dieu ! Pour moi, c’était terrible ! J’aime la danse, les pique-niques, les promenades au clair de lune, et le reste – j’aime trop tout ça ! À moi la blanchisserie, une réputation honorable et de bons gros dollars sonnant dans ma poche. J’ai vu une fille, hier encore – eh bien ! figure-toi : j’ai comme une idée que je vais me marier avec elle. Toute la journée j’ai chanté, rien qu’en y pensant. C’est une beauté. Elle a les plus gentils yeux, la plus douce voix du monde. Oui, nous deux, ça collerait bien… Et toi ! pourquoi tu ne te maries pas, avec tout l’argent que tu as ? Tu pourrais t’offrir la plus jolie fille du pays.
Martin secoua la tête en souriant. Dans le fond de son cœur il se demandait pourquoi les hommes tiennent absolument à se marier. Ça lui semblait une chose stupéfiante, incompréhensible.
Du pont de la Mariposa, au moment de lever l’ancre, il vit sur le quai Lizzie Connolly qui se dissimulait dans la foule.
« Prends-la avec toi ! se dit-il tout à coup. Il est facile d’être bon. Tu la rendras si heureuse. »
Cela devint presque une tentation, puis l’instant d’après, une sorte de terreur l’envahit et il se détourna en gémissant : Mon pauvre vieux, tu es trop malade ! tu es trop malade !
Il s’enfuit dans sa cabine de luxe où il resta caché jusqu’au départ du paquebot. Dans la salle à manger, à déjeuner, il eut la place d’honneur, à la droite du capitaine ; et il ne fut pas long à découvrir qu’il était le grand personnage du bord. Mais jamais grand personnage ne donna moins d’agrément aux passagers d’un bateau. Il passait l’après-midi sur une chaise longue, sur le deck, les yeux clos, en sommeillant presque tout le temps et, le soir, se couchait tôt.
Au bout de deux jours, guéris du mal de mer, les passagers se montrèrent au complet. Ils ne trouvèrent point grâce à ses yeux ; et cependant c’étaient de braves gens aimables – il fut forcé de le reconnaître – aimables et cordiaux comme de bons bourgeois qu’ils étaient, avec toute la mesquinerie et la frivolité intellectuelle de leur milieu. Leur conversation insignifiante l’ennuyait à mourir. Quant aux jeunes gens, leur exubérance bruyante et leur incessant besoin de se dépenser, l’énervaient. Jamais ils ne pouvaient rester tranquilles ; et c’était, du matin au soir, des jeux, des courses, des promenades, de grands cris et des courses d’un bord à l’autre pour voir sauter les tortues de mer ou bondir les premiers escadrons de poissons volants.
Il dormait beaucoup. Après le petit déjeuner, il tombait sur sa chaise longue, avec un magazine qu’il ne finissait jamais. La lecture le fatiguait. Il se demandait comment les gens pouvaient trouver encore des choses à raconter et, en y réfléchissant, il s’endormait. Quand le gong le réveillait pour le déjeuner, ça l’exaspérait. D’être réveillé n’avait rien de drôle.
Il essaya une fois de secouer sa léthargie et gagna le gaillard d’avant, voir les matelots. Mais leur mentalité semblait avoir changé depuis le temps où il vivait parmi eux. Et il ne put trouver aucun lien de camaraderie entre lui et ces brutes aux faces stupides, aux cerveaux de ruminants. Il était au désespoir. Là-haut, personne ne tenait à Martin Eden pour lui-même, en bas il ne pouvait plus supporter ceux qui l’avaient accepté autrefois.
Comme une trop forte lumière blanche blesse les yeux fatigués d’un malade, la vie consciente le blessait et il était aveuglé de son éclat. C’était une souffrance, une intolérable souffrance. Jamais auparavant, Martin n’avait voyagé en première classe. Sur mer il s’était toujours tenu sur le gaillard d’avant, à la timonerie, ou dans les sombres profondeurs des soutes à charbon. En ces temps-là, quand il grimpait hors du gouffre étouffant par l’échelle de fer et qu’il apercevait les passagers, de blanc vêtus, flânant ou s’amusant, sous des tentes qui les protégeaient du soleil et du vent, servis par des stewards impeccables qui prévenaient leurs moindres besoins, il lui semblait, pour le moins, apercevoir un coin du paradis. Aujourd’hui, il était le grand personnage du bord que le capitaine faisait asseoir à sa droite, il était le point de mire de tous, et, du gaillard d’avant à la chaufferie, il errait vainement à la recherche du paradis perdu.
Il essaya de se secouer, de trouver un sujet d’intérêt. Il s’aventura dans le mess des sous-officiers : il n’y resta pas longtemps. Il discuta avec un quartier-maître, homme intelligent, qui l’entreprit aussitôt sur la propagande socialiste et lui bourra les poches de fascicules et de pamphlets. En écoutant cet homme exposer la morale des esclaves, il la compara languissamment à sa propre philosophie nietzschéenne. Mais que valait tout ça, après tout ? Il se rappela l’une des plus folles affirmations de Nietzsche, celle de la non-existence de la vérité. Qui sait ? peut-être Nietzsche avait-il raison ? Peut-être la vérité n’est-elle qu’un mirage… Puis la fatigue de penser le reprit et il fut heureux de retrouver sa chaise longue et de dormir.
Bientôt de nouvelles préoccupations l’obsédèrent. Qu’arriverait-il, une fois que le paquebot serait arrivé à Tahiti ? Il lui faudrait descendre à terre, commander sa pacotille, trouver un bateau en partance pour les îles Marquises, accomplir mille et mille choses dont l’idée seule le terrifiait. Chaque fois qu’il se forçait à réfléchir, le danger de sa situation lui apparaissait. En vérité, il avançait dans la Vallée de l’Ombre, – il y avançait à grands pas – sans crainte, c’était ça le danger. La peur l’aurait fait se raccrocher à la vie. Mais comme il n’avait pas peur, il s’enfonçait de plus en plus dans les ténèbres. Les choses qui l’enchantaient jadis, toutes les choses familières tant aimées, le laissaient indifférent. La Mariposa, à présent, voguait à travers les alizés du nord-est ; mais le souffle enivrant de ce vent l’exaspéra, et il fit changer sa chaise longue de place pour échapper aux embrassements de ce vigoureux compagnon des anciens jours de peine, des nuits si douces.
Le jour où la Mariposa passa l’Équateur, Martin était plus malheureux que jamais. Il ne pouvait plus dormir. Étant saturé de sommeil, il lui fallait maintenant rester éveillé et supporter l’aveuglante lumière de la vie. Il allait et venait, inquiet, sans trouver le repos. Les averses torrentielles ne parvenaient pas à rafraîchir l’atmosphère humide, accablante. Il souffrait de vivre. Il se promena sur le deck jusqu’à ce qu’il soit complètement éreinté, s’assit, puis se remit à marcher, à bout de nerfs. Enfin, il se força à achever la lecture de son magazine, puis alla choisir à la bibliothèque du bord plusieurs volumes de poésie. Mais il ne put s’y intéresser et il se remit à marcher, désespérément.
Après le dîner, il resta longtemps sur le pont, inutilement, car une fois dans sa cabine, il ne put dormir. Ce sursis de vivre que lui avait jusqu’ici procuré le sommeil, lui était refusé. C’en était trop, cette fois. Il alluma l’électricité et s’efforça de lire du Swinburne. Étendu sur son lit il le feuilleta, et s’aperçut tout à coup qu’il s’intéressait à ce qu’il lisait. Il finit le poème, essaya de continuer, revint au précédent. Puis, il posa le livre ouvert sur sa poitrine et réfléchit.
C’était ça, oui, c’était bien ça ! Comment n’y avait-il pas pensé plus tôt ? Ça expliquait tout ; il l’avait cherchée si longtemps, et aujourd’hui Swinburne lui montrait la voie, la voie du repos. Il avait tant besoin de repos !…
Il lança un coup d’œil vers le hublot. Oui, il était assez large.
Pour la première fois depuis de longues semaines, il fut heureux. Il avait enfin trouvé le remède à ses maux. Il reprit le livre, relut la strophe à haute voix, lentement…
From too much hope of living,
From hope and fear set free,
We thank with brief thanksgiving
Whatever gods may be,
That no life lives forever
That dead men rise up never ;
That even the weariest river
Winds somewhere safe to sea.
(De trop de foi dans la vie, – De trop d’espoir et de trop de crainte – Nous rendons grâce, en une brève prière – Aux dieux qui nous en délivrent. – Et grâce leur soit rendue – Que nulle vie ne soit éternelle. – Que nul mort ne renaisse jamais. – Que même la plus lasse rivière – trouve un jour son repos dans la mer.)
Ses regards se dirigèrent encore vers le hublot ouvert. Swinburne lui avait donné la clef. La vie était sans intérêt, ou plutôt elle l’était devenue ; elle était devenue intolérable. « Que nul mort ne renaisse jamais ! » Ce vers l’émut d’une profonde reconnaissance. C’était une des seules choses salutaires de la création. Lorsque la vie devenait par trop douloureuse ou trop fatigante, la mort était prête à bercer toutes les douleurs, toutes les fatigues dans l’éternel sommeil. Qu’attendait-il ? Il était temps de partir.
Il se leva, passa la tête par le hublot, regarda la mer laiteuse. La Mariposa étant fortement chargée, en s’accrochant par les mains, il toucherait l’eau avec ses pieds. Il pourrait s’y glisser sans bruit. Personne n’entendrait. Un paquet d’écume lui mouilla le visage et humecta ses lèvres d’un goût exquis. Il se demanda s’il fallait écrire un chant du cygne, puis cette idée le fit rire. Il n’avait pas le temps. Il était trop impatient de partir.
Il éteignit la lumière et descendit par le hublot, les pieds devant. Mais comme ses épaules ne pouvaient pas passer, il remonta, puis recommença la même manœuvre, cette fois en n’engageant qu’un bras à la fois. Un mouvement du paquebot l’aida et il se trouva en dehors, suspendu par les mains.
Quand ses pieds eurent touché l’eau, il se laissa tomber. La mer était semblable à une mousse blanche. Il glissa le long du flanc de la Mariposa qui ressemblait à un mur sombre percé ici et là par quelques hublots allumés. Sûrement, elle allait arriver en avance… Presque sans s’en apercevoir, il se retrouva à l’arrière et il nagea doucement dans l’écume pétillante.
Une bonite, attirée par son corps blanc, vint le mordre et ça le fit rire. Elle avait enlevé le morceau ; la petite douleur qu’il en ressentit lui rappela la raison de son geste. L’action la lui avait fait oublier. Les lumières de la Mariposa s’évanouissaient dans le lointain et il nageait aussi tranquillement que s’il avait eu l’intention d’aborder au rivage le plus proche, à un millier de lieues environ.
L’instinct de conservation agissait encore. Il cessa de nager, mais dès qu’il sentit le flot recouvrir ses lèvres, ses mains battirent fortement l’eau pour remonter à la surface. Le désir de vivre, se dit-il en se moquant de lui-même. Eh bien ! il avait de la volonté, assez de volonté pour en finir et, d’un dernier effort, cesser d’exister.
Il changea sa position, se mit debout. Il regarda les étoiles sereines, et expulsa tout l’air de sa poitrine. D’une vigoureuse poussée de ses mains et de ses pieds il sortit son buste hors de l’eau pour prendre son élan. Puis il se laissa aller et s’enfonça, sans un geste, dans les flots, comme une statue blanche. Il avala l’eau, de toutes ses forces, comme un anesthésique. Comme il étouffait, inconsciemment, ses bras et ses jambes battirent l’eau avec violence et il remonta à la surface sous la claire lumière des étoiles.
Le désir de vivre, se dit-il avec mépris, en tâchant vainement d’empêcher ses poumons en feu d’aspirer l’air. Il fallait essayer d’une autre manière. Il respira à fond, de façon à pouvoir descendre très profondément. Puis, il plongea la tête la première, en nageant de toutes ses forces et de toute sa volonté. Les yeux ouverts, il voyait les bonites rapides zébrer l’eau de flèches phosphorescentes. Il espéra qu’elles ne l’attaqueraient pas, car la tension de sa volonté aurait pu se relâcher. Mais elles ne s’occupèrent pas de lui et il remercia la vie de cette dernière faveur.
Il nagea encore, toujours plus profondément. Ses bras et ses jambes, rompus de fatigue, ne remuaient plus que faiblement. La pression de l’eau était douloureuse à ses tympans et sa tête bourdonnait. Son endurance était à bout, mais il se força à descendre plus bas encore. Bientôt sa volonté l’abandonna. Au milieu d’un grand bouillonnement, ses poumons se vidèrent complètement de l’air qu’ils conservaient encore. Tels de minuscules ballonnets, de petites bulles glissèrent en rebondissant sur ses joues et devant ses yeux dans une ascension éperdue vers la surface. Puis vinrent la souffrance et l’étouffement. Ce n’était pas la mort encore, se dit-il, au bord de l’inconscience. La mort ne faisait pas souffrir. C’était la vie, cette atroce sensation d’étouffement : c’était le dernier coup que devait lui porter la vie.
Ses mains et ses pieds, dans un dernier sursaut de volonté, se mirent à battre, à faire bouillonner l’eau, faiblement, spasmodiquement. Mais malgré ses efforts désespérés, il ne pourrait jamais plus remonter ; il était trop bas, trop loin. Il flottait languissamment, bercé par un flot de visions très douces. Des couleurs, une radieuse lumière l’enveloppaient, le baignaient, le pénétraient. Qu’était-ce ? On aurait dit un phare. Mais non, c’était dans son cerveau, cette éblouissante lumière blanche. Elle brillait de plus en plus resplendissante. Il y eut un long grondement, et il lui sembla glisser sur une interminable pente. Et, tout au fond, il sombra dans la nuit. Ça, il le sut encore : il avait sombré dans la nuit.
Et au moment même où il le sut, il cessa de le savoir.