
Luigi Pirandello
VIEILLE SICILE
Traduction
de Benjamin Crémieux
Gallimard, 1928
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
Table des matières
À propos de cette édition électronique
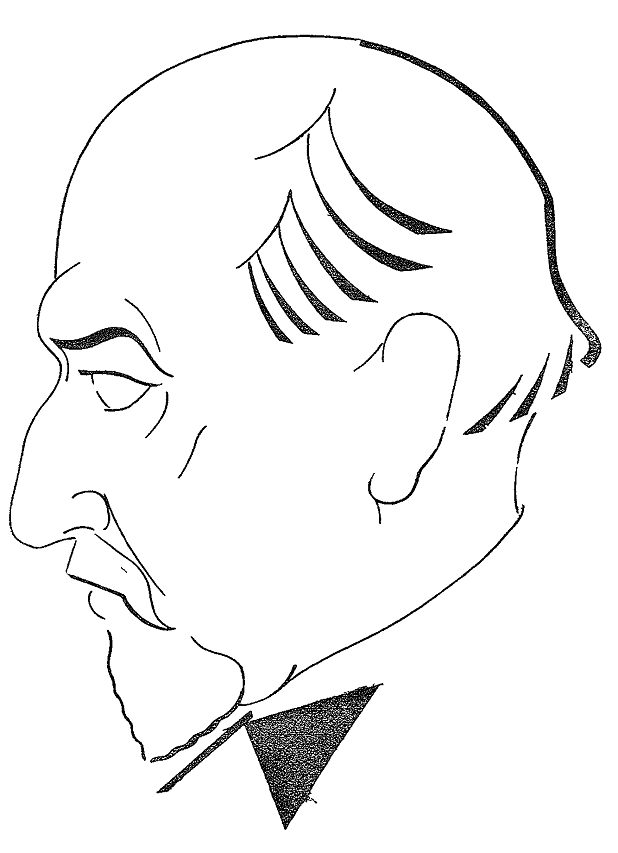
AVANT-PROPOS
Si tout le pirandellisme est dans Pirandello, Pirandello est loin d’être tout entier dans le pirandellisme. Le côté purement sicilien de l’œuvre de Pirandello, par exemple, reste encore à peu près ignoré du lecteur français. On ne peut pourtant comprendre à fond l’auteur des Six personnages, saisir l’authenticité, la spontanéité de son tourment foncier (considéré bien à tort le plus souvent comme un simple jeu cérébral) qu’en se reportant à ses origines siciliennes. Le Sicilien de mélodrame que nous connaissons est un être tout d’impulsion, qui vit sa vie, ses passions avec une « immédiateté » totale. Les Siciliens de Pirandello ne sont pas moins impulsifs que ceux de Cavalleria Rusticana. Seulement cette soudaineté qu’ils apportent dans l’action, ils l’apportent aussi dans la pensée. Ils pensent aussi vite qu’ils agissent, ils sentent aussi vite qu’ils pensent. À peine ont-ils agi qu’ils se jugent ; il leur arrive même de se juger plus vite qu’ils n’agissent et de s’abstenir alors d’agir comme on les voit passer instantanément du rire aux larmes, de la colère à la pitié et à l’attendrissement, de la fureur à l’ironie. La mobilité, voilà ce qui les caractérise avant tout et c’est à partir de cette mobilité que s’est peu à peu affirmé dans l’œuvre de Pirandello l’essentiel du pirandellisme, c’est-à-dire la faculté de se dédoubler, et l’instabilité, la discontinuité, la multiplicité de la personne humaine.
Un autre caractère constant chez les peuples méridionaux et particulièrement développé chez les insulaires de Sicile : l’individualisme, compliqué du sentiment de caste, a sans aucun doute aidé Pirandello à sentir, avant de la penser, sa théorie fondamentale de la solitude de l’homme, des cloisons étanches qui séparent les êtres, de l’imperméabilité de l’individu. Le vieux mot sur le peuple britannique : « Chaque Anglais est une île » n’est pas moins vrai des Siciliens.
L’originalité première de Pirandello, peut-être inconsciente à ses débuts, fut précisément de montrer dans chaque récit les points de vue particuliers et les réactions différentes de chaque personnage, depuis le personnage principal jusqu’au plus humble en présence d’une même situation. Il nous montre le même événement interprété d’autant de façons différentes qu’il y a de personnages dans l’histoire. Toutes les nouvelles rassemblées ici témoignent de ce souci et de ce don.
Mais ces nouvelles ont été également choisies à dessein pour dévoiler un autre aspect inconnu de Pirandello, un Pirandello régionaliste, tout nourri du folklore de son île, hanté par les récits entendus dans son enfance, – légendes garibaldiennes, évocations de brigands –, un émule sicilien du Mistral des Proses d’almanach et de Roumanille.
La Sicile de Pirandello se réduit d’ailleurs à un coin bien localisé, son pays natal, le pays d’Agrigente, son port, ses soufrières, sa campagne demi-tropicale, ses populations croupissantes dans la misère, la superstition et l’ignorance séculaires, entretenues par le régime des Bourbons et des prêtres et auxquelles le nouveau régime n’a pu encore entièrement remédier, le paganisme foncier de ces fils de la Grande-Grèce, leur besoin d’union avec toute la nature qui se manifeste si curieusement dans Chante-l’Épître, leur joie de vivre et de railler, si gaillardement traduite dans In Corpore vili ou Une Invitation à dîner, leur « Selbstironie » incarnée si comiquement par le Don Paranza de l’Étranger.
En même temps que quelques échantillons du vérisme si particulier de Pirandello – un vérisme qui s’évanouit dans un humour auquel il emprunte sa poésie –, ce qu’on trouvera dans ce recueil, à travers la variété des images et du ton, c’est l’atmosphère et comme la sensation charnelle de cette « Vieille Sicile », base solide et point de départ de toute l’œuvre pirandellienne.
B. C
CHANTE-L’ÉPÎTRE[1]
– Et vous aviez pris tous les ordres ?
– Non, pas tous. Je n’étais arrivé qu’au sous-diaconat.
– Ah, ah ! vous étiez sous-diacre… Et que fait un sous-diacre ?
– Il chante l’épître ; il présente le livre au diacre qui chante l’Évangile ; il s’occupe des vases de la messe ; il tient la patène sous le voile avant l’Élévation.
– Vous dites que vous chantiez l’évangile ?
– Non, Monsieur, c’est le diacre qui chante l’évangile ; le sous-diacre chante l’épître.
– Alors, vous chantiez l’épître ?
– Moi… moi… C’est-à-dire que le sous-diacre…
– … chante l’épître ?
– … chante l’épître.
Vous ne voyez pas ce qu’il y a de risible là-dedans ? Mais si vous aviez été, sur la place du village, toute bruissante de feuilles sèches, tandis que les nuages jouaient à cache-cache avec le soleil, si vous aviez assisté à ce dialogue entre le vieux docteur Fanti et Tommasino Unzio, revenu quelques jours plus tôt, sans soutane, du séminaire, ayant perdu la foi, si vous aviez vu le docteur plisser son visage de faune, vous auriez fait comme tous les désœuvrés du village, assis en cercle devant la pharmacie de l’hospice, vous auriez détourné la tête et pincé les lèvres pour ne pas éclater de rire.
À peine Tommasino s’était-il éloigné dans un tourbillon de feuilles sèches, que les rires fusaient en gloussements.
– Alors, il chante l’épître ? demandait l’un.
Et le chœur de répondre :
– Il chante l’épître.
Ce fut ainsi que Tommasino Unzio, revenu sous-diacre et défroqué du séminaire, parce qu’il avait perdu la foi catholique, se trouva surnommé : Chante-l’Épître.
*
* *
Il y a cent mille façons de perdre la foi. En général, celui qui la perd est convaincu, pendant quelque temps tout au moins, qu’il a gagné quelque chose au change, ne fût-ce que la liberté de dire ou de faire certaines choses qui, jusque-là, ne lui paraissaient pas compatibles avec la religion.
Mais quand on n’est pas détourné de sa croyance par la violence des appétits terrestres, mais parce que le calice de l’autel et la fontaine d’eau bénite ne suffisent plus à désaltérer votre âme, ni à l’apaiser, on se persuade moins facilement qu’on a gagné quelque chose au change. C’est tout au plus si, pour ne pas regretter ce qu’on a perdu, on réussit à se persuader qu’en définitive on a renoncé à une chose sans aucune valeur.
Tommasino Unzio, en perdant la foi, avait tout perdu, y compris le seul état que son père pouvait lui donner grâce au legs conditionnel d’un vieil oncle ecclésiastique. Son père n’avait pas manqué de le recevoir à coups de poings, à coups de pieds ; il l’avait laissé plusieurs jours au pain et à l’eau, avec accompagnement de reproches et d’injures de tout calibre. Mais Tommasino avait tout supporté avec une fermeté héroïque et attendu l’heure où son père se convaincrait que ce n’étaient pas là les meilleurs moyens pour réveiller une foi et une vocation.
La violence le touchait moins que la vulgarité du procédé, alors que sa renonciation au sacerdoce avait des motifs si peu vulgaires.
Mais il comprenait que le chagrin de son père devait normalement s’épancher en coups sur ses joues, son dos ou sa poitrine. Ce fils dont la carrière était irréparablement brisée, qui revenait encombrer la maison, il y avait là évidemment de quoi rendre un père enragé.
Le premier soin de Tommasino fut de démontrer à tout le village qu’il ne s’était pas défroqué pour « faire le porc » comme le publiait partout son père. Il se replia sur lui-même, ne sortit plus de sa chambre que pour se promener seul, montant, à travers les bois de châtaigniers, jusqu’au Pian della Britta, ou descendant, par des sentiers à travers champs, jusqu’à la chapelle abandonnée de Notre-Dame de Lorette, toujours plongé dans ses méditations et sans lever les yeux sur quiconque.
Mais le corps, même quand l’esprit est accaparé par quelque douleur profonde ou quelque tenace ambition, abandonne l’esprit à son idée fixe, et tout doucement, sans rien dire, se met à vivre pour son compte, à jouir du bon air et de la nourriture saine.
Ce fut ce qui advint à Tommasino. En peu de temps, et par une contradiction où il y avait quelque ironie, tandis que son âme s’abîmait dans la mélancolie et s’épuisait en méditations désespérées, son corps bien nourri lui donnait l’aspect florissant d’un père abbé.
Plus de Tommasino ! L’augmentatif en one lui convenait à présent beaucoup mieux : Tommasone Chante-l’Épître… À le voir si bien en chair, on était tenté de donner raison à son père. Mais tout le village connaissait sa façon de vivre, et quant aux femmes, aucune ne pouvait se vanter d’avoir été regardée par lui, fût-ce à la dérobée.
N’avoir plus conscience d’être, comme une pierre, comme une plante ; ne même plus se rappeler son nom ; vivre pour vivre sans savoir qu’on vit, comme les bêtes, sans passions, sans désirs, sans mémoire, sans idées, sans rien qui donne encore un sens, une valeur à la vie. Étendu sur l’herbe, les mains croisées derrière la nuque, regarder dans le bleu du ciel la blancheur aveuglante des nuages, gonflés de soleil ; écouter le vent comme un bruit de mer dans les châtaigniers, et dans la voix du vent, dans cette rumeur marine percevoir, comme venue d’une infime distance, la vanité de tout, l’angoisse et le poids mortel de l’existence.
Des nuages et du vent…
Mais n’est-ce pas déjà prendre conscience de tout que de reconnaître des nuages en ces formes, lumineuses, errantes dans le vide sans limites de l’azur ? Le nuage connaît-il son existence ? Et les arbres, les pierres qui s’ignorent eux-mêmes savent-ils que le nuage existe ?
Puisqu’il remarquait et reconnaissait les nuages, il pouvait tout aussi bien penser à l’eau, qui devient nuage pour redevenir eau. Le dernier des professeurs de physique peut expliquer ces transformations, mais le pourquoi du pourquoi qui l’expliquerait ?
Dans le haut du bois de châtaigniers, un bruit de hache ; en bas, dans la carrière, un bruit de pic sur la pierre.
Mutiler la montagne, abattre des arbres pour construire des maisons. De nouvelles maisons dans ce bourg perdu de montagne. Efforts, sueur, fatigue, peines de toute sorte, pourquoi ? Pour aboutir à une cheminée et pour que de cette cheminée sorte un peu de fumée, tout de suite perdue dans l’espace vide.
Toute pensée, toute mémoire humaine est semblable à cette fumée…
Mais le vaste spectacle de la nature, l’immense plaine verdissante de chênes, d’oliviers, de châtaigniers rassérénait son cœur, le plongeait dans l’infini d’une tristesse douce.
Toutes les illusions, toutes les déceptions, les douleurs et les joies, les espoirs et les désirs des hommes lui paraissaient vains et transitoires comparés au sentiment qui s’exhalait des choses, – des choses qui ne changent pas et survivent aux sentiments, impassibles. Les gestes humains au milieu de l’éternité de la nature lui semblaient pareils aux jeux des nuages. Pour s’en convaincre, il suffisait de regarder, au delà de la vallée, au loin, les montagnes s’effacer à l’horizon toutes légères dans les vapeurs roses du couchant.
Ô ambition des hommes ! Quels cris de victoire parce que l’homme s’est mis à voler comme un petit oiseau ! Mais regardez voler un oiseau : quelle facilité native, légère, que des trilles joyeux accompagnent spontanément… Comparez ce vol au monstrueux appareil qui vrombit, à l’anxiété, à l’angoisse mortelle de l’homme qui veut faire l’oiseau ! Ici un envol et un chant ; là un moteur pétaradant et puant, et la mort aux aguets. Une panne, le moteur s’arrête ; adieu, bel oiseau !
– Homme, disait Tommasino, étendu dans l’herbe, cesse de voler. Pourquoi veux-tu voler ? Et quand as-tu voulu voler ?
*
* *
Ébahissement général. La nouvelle s’abattit sur le village comme un cyclone. Tommasino Unzio, Chante-l’Épître avait été giflé, il allait se battre en duel avec le lieutenant de Venera, commandant le détachement. Tommasino reconnaissait avoir traité d’« idiote » mademoiselle Olga Fanelli, fiancée du lieutenant, le soir précédent, sur le chemin qui mène à la chapelle de N.-D. de Lorette ; il se refusait à toute excuse ou explication.
L’ébahissement se mêlait d’hilarité. Chacun posait cent questions de détail comme pour retarder le moment d’afficher son incrédulité.
– Tommasino ? – En duel ? – Idiote, à Mlle Fanelli ? – Confirmé ? – Sans explications ? – Et il se bat ?
– L’autre l’a giflé.
– Il se bat ?
– Demain matin, au pistolet.
– Avec le lieutenant de Venera, au pistolet ?
– Parfaitement, au pistolet.
Le motif qui poussait Tommasino ne pouvait qu’être grave. Personne n’en doutait plus ; il ne pouvait s’agir que d’une folle passion tenue secrète jusque-là. Il avait traité la jeune fille d’idiote parce qu’elle lui préférait le lieutenant. C’était évident ! Il n’y avait qu’une voix dans tout le village ; il fallait véritablement être idiote pour s’amouracher d’un homme aussi ridicule que de Venera. Mais il était naturel que de Venera fût seul à ne pas l’admettre, et réclamât des explications.
Toutefois mademoiselle Olga Fanelli jurait, les larmes aux yeux, que la raison de l’insulte ne pouvait être celle-là. Elle avait en tout et pour tout vu deux ou trois fois Tommasino, qui ne l’avait même pas regardée, et jamais, au grand jamais, n’avait donné le moindre signe de cette folle passion cachée dont tout le monde parlait. Non, il devait y avoir une autre raison. Mais laquelle ? On ne traite pas une jeune fille d’idiote sans motif.
Si tout le monde, et surtout le père et la mère, les deux témoins, le lieutenant et la jeune fille mouraient d’envie de connaître la véritable raison de l’offense, Tommasino était plus désespéré encore de ne pouvoir l’avouer. Mais il était trop certain que personne n’y croirait et qu’on imaginerait qu’à un secret inavouable il voulait ajouter le mépris.
Qui aurait pu croire que depuis quelque temps, dans sa mélancolie philosophique toujours plus profonde, il s’était pris d’une tendre pitié pour tout ce qui naît à la vie et ne dure qu’un instant, sans savoir pourquoi, dans l’attente de la décrépitude et de la mort ! Plus les formes prises par la vie lui apparaissaient frêles, chétives, inconsistantes, plus il s’attendrissait sur elles et parfois jusqu’aux larmes ! Que de façons de naître, et pour une seule fois, sous une forme donnée, unique, irréversible, sans que jamais se soient trouvées deux formes pareilles, et cela pour si peu de temps, pour un seul jour parfois et sur un espace infime, avec autour de soi l’inconnu du monde, le vide énorme, impénétrable du mystère de la vie ! Naître fourmi, moucheron ou brin d’herbe !… Une fourmi dans l’univers ! L’univers et un moucheron, un brin d’herbe… Le brin d’herbe naissait, poussait, fleurissait, se fanait, et puis disparaissait. Pour toujours. Fini pour lui. Jamais plus.
Depuis un mois, jour après jour, il suivait précisément la brève destinée d’un brin d’herbe. Un brin d’herbe entre deux pierres grises, tigrées de musc, derrière la chapelle abandonnée de N.-D. de Lorette.
Il en avait suivi avec une tendresse presque maternelle la lente croissance au milieu d’autres brins moins longs qui l’entouraient. Il l’avait vu naître timidement, trembler de faiblesse, pointer entre les deux pierres, apeuré et curieux à la fois d’admirer le spectacle étalé au-dessous, la plaine verte et sans tache : puis s’allonger, s’allonger encore, prendre de la hardiesse, agiter un petit plumet roux comme une crête de coq.
Chaque jour, pendant une heure ou deux, il le regardait vivre, il partageait sa vie, il frémissait au moindre souffle ; un jour de grand vent il était accouru tout tremblant ; d’autres fois il avait peur d’arriver trop tard pour le protéger d’un troupeau de chèvres qui passait derrière la chapelle tous les jours à la même heure et s’arrêtait parfois à brouter dans les touffes. Jusque-là, le vent et les chèvres avaient respecté le brin d’herbe. La joie de Tommasino, quand il le retrouvait intact, fier de son plumet, était indicible. Il le caressait, le lissait du bout des doigts, avec une extrême délicatesse. Il le protégeait de toute son âme, de tout son souffle. Quand il le quittait, le soir, il le confiait aux premières étoiles qui paraissaient dans le ciel crépusculaire, pour qu’avec toutes les autres elles veillassent sur lui pendant la nuit. Et en imagination, de loin, il revoyait son brin d’herbe, entre les deux pierres, sous la garde des milliers et des milliers d’étoiles qui luisaient dans le ciel noir.
Ce jour-là, comme il arrivait à l’heure habituelle à son rendez-vous avec le brin d’herbe, il aperçut derrière la chapelle, assise sur une des deux pierres, mademoiselle Olga Fanelli qui sans doute se reposait un instant avant de reprendre sa route.
Il s’arrêta, n’osant avancer ; il attendait qu’elle se fût reposée et lui cédât la place. Un instant passa. La jeune fille, ennuyée peut-être de se voir ainsi guettée, se leva, regarda autour d’elle, puis, distraitement, allongeant la main, elle arracha le brin d’herbe, son brin d’herbe et le mit dans sa bouche, le petit plumet au vent.
Tommasino Unzio se sentit arracher l’âme et quand elle passa devant lui, le brin d’herbe entre les dents, il lui cria sans pouvoir se retenir : Idiote !
Comment avouer qu’il avait insulté une jeune fille à cause d’un brin d’herbe ?
Alors le lieutenant de Venera l’avait giflé.
Tommasino était las de sa vie inutile, las du poids de sa chair stupide, las d’être tourné en dérision. S’il avait refusé de se battre, après avoir reçu une gifle, les persécutions auraient redoublé. Il accepta donc le cartel, mais exigea des conditions terribles. Il savait que le lieutenant de Venera excellait au pistolet. Il en donnait chaque matin des preuves au champ de tir. C’est pourquoi Tommasino avait choisi de se battre au pistolet, le jour suivant, à l’aube et précisément, au champ de tir.
*
* *
Il reçut la balle en pleine poitrine. La blessure tout d’abord ne semblait pas sérieuse ; mais elle s’aggrava. La balle avait touché le poumon. Fièvre, délire. Quatre jours et quatre nuits de soins héroïques, désespérés.
Madame Unzio, extrêmement pieuse, quand les médecins eurent déclaré qu’il n’y avait plus d’espoir, pria, supplia son fils, avant de mourir, de se réconcilier avec Dieu. Et Tommasino, pour faire plaisir à sa mère, accepta de recevoir un confesseur.
Quand le prêtre, penché sur le lit de l’agonisant, lui demanda :
– Mais pourquoi, mon fils, pourquoi ? Tommasino, les yeux mi-clos, la voix éteinte, dans un soupir qui avait la douceur d’un sourire, répondit simplement :
– Mon père, pour un brin d’herbe…
Tout le monde crut que le délire l’avait repris.
IN
CORPORE VILI[2]
I
Cosimino, le sacristain de Sainte-Marie Nouvelle, postait ses trois enfants en sentinelle aux trois marchés de la ville, avec mission de le prévenir au triple galop, dès qu’apparaissait la Sgriscia, la vieille servante boiteuse de Dom Ravana.
Ce matin-là, ce fut le plus jeune des trois enfants, de garde au marché aux poissons, qui accourut tout hors d’haleine :
– La Sgriscia, papa, voilà la Sgriscia !
Cosimino se précipita.
Il surprit la vieille en train de marchander des homards.
– Voulez-vous disparaître, démon tentateur !
Et se tournant vers le marchand de poissons :
– Je vous défends de l’écouter ! Elle n’a pas à acheter de homards ! C’est un plat défendu !
La Sgriscia, les mains sur les hanches, les coudes en bataille, s’apprêtait à la riposte, mais Cosimino ne lui laissa pas le temps de dire : « ouf ! » une poussée et, le bras tendu, il ordonna :
– Allez au diable, entendez-vous !
Le marchand de poisson prit le parti de sa cliente qui glapissait ; de tous les coins du marché, on accourait pour retenir les deux adversaires prêts à en venir aux mains. Cosimino, hors de lui, hurlait :
– Non, non et non, pas de homards. Je ne veux pas que Dom Ravana en mange. Ça lui est défendu ! Elle peut aller le lui dire de ma part… Mais elle le tente comme une diablesse qu’elle est, elle fait tout pour lui abîmer l’estomac.
Par chance, Dom Ravana en personne passait à cette minute précise :
– Tenez, le voilà. Approchez un peu, cria Cosimino en l’apercevant. Et dites si c’est vous qui avez commandé à votre bonne d’acheter des homards.
La large face de Dom Ravana blêmit ; un sourire nerveux la contractait. Il balbutia :
– À vrai dire, non, je n’ai pas…
– Non, vous dites que non, hurla la Sgriscia et elle se frappait du poing sa poitrine osseuse, pour exprimer sa stupeur indignée. Osez me le répéter en face.
Dom Ravana, soudain furieux, le prit de haut :
– Silence, bavarde. Je n’ai pas parlé de homard. Je vous ai dit du poisson.
– Jamais de la vie. Vous avez dit du homard.
– Du homard ou du poisson, c’est la même chose, déclara Cosimino, départageant la servante et le maître au milieu des rires. Du potage, du bouilli et du lait ; lait, bouilli, potage et rien d’autre. Voilà ce qu’a ordonné le médecin. C’est compris, n’est-ce pas ? Ne m’obligez pas à parler, au nom du ciel !
– Calme-toi, mon brave, tu as raison, fit Dom Ravana, mortifié et couvert de confusion.
Et se tournant vers sa gouvernante :
– Rentrez tout de suite. Et faites du bouillon comme d’habitude.
Derechef l’assistance accueillit cet ordre par un formidable éclat de rire. Dom Ravana aussi mal à l’aise qu’une limace dans le feu, s’ouvrait un chemin dans la foule et souriait jaune. Il expliquait à droite et à gauche :
– Quel brave homme que ce Cosimino… Ce bon Cosimino, il faut le comprendre… Il agit pour mon bien… Oui, oui… Allons, laissez-moi passer, mes enfants… Le Seigneur prodigue ses dons, mais moi je suis au potage, au bouilli et au lait. C’est l’ordonnance du docteur… Il ne faut pas que je mange autre chose… Cosimino a raison.
II
Dom Ravana dit sa messe au maître-autel.
– Pssstt, regarde un peu… murmure-t-il, les yeux baissés, au sacristain qui verse l’eau et le vin dans le calice. Le docteur Nicastro est là… au premier rang, contre la balustrade… Ne bouge pas, imbécile, ne te tourne pas… À droite… Quand tu pourras, fais-lui signe de rester après la messe et de passer me voir à la sacristie.
Cosimino fronce le sourcil, pâlit, serre les dents pour réfréner sa colère.
– Hier au soir vous avez… Allons, dites la vérité !
– Veux-tu te taire, mal élevé ! Devant le très Saint-Sacrement ! le gourmande Dom Ravana entre haut et bas en le dévisageant avec sévérité.
La réprimande du prêtre à son sacristain est entendue des premiers bancs et un murmure de réprobation s’élève contre le malheureux Cosimino qui rougit jusqu’aux cheveux tout frémissant de colère et de honte. Il ne sait plus où poser les ampoules du fiel et du vinaigre.
La messe achevée, il suit Dom Ravana à la sacristie, d’un air sombre et renfrogné. Un instant plus tard faisait son entrée le docteur Liborio Nicastro, un petit vieux, tout voûté et ratatiné par l’âge. Le bord arrière de son chapeau haut-de-forme reposait presque sur sa bosse. Il était vêtu à l’ancienne mode et portait la barbe en collier.
– Qu’est-ce qui ne va pas, Dom Ravana ? demanda-t-il. Il parlait du nez en fermant à demi ses petits yeux sans cils. – Vous avez une figure de prospérité.
– Ah, oui ?
Dom Ravana regarda un instant, perplexe, le médecin, se demandant s’il devait ou non le croire ; puis d’une voix irritée, comme pour se plaindre de tant d’injustice, il reprit :
– C’est l’estomac, mon cher docteur, l’estomac qui ne veut plus me laisser en paix, comprenez-vous.
– Et ça n’a rien d’étonnant, grogna Cosimino en se tournant pour regarder d’un autre côté.
Dom Ravana le foudroya du regard :
– Asseyez-vous, asseyez-vous, dom Ravana, reprit le docteur. Et voyons cette langue.
Cosimino, les yeux baissés, avança une chaise à Dom Ravana. Le docteur Nicastro tira flegmatiquement ses lunettes de leur étui, les ajusta sur son nez et examina la langue du prêtre :
– Elle est vilaine…
– Vilaine ? répéta Dom Ravana, en rentrant sa langue, comme si les paroles du docteur l’avaient ébouillantée.
Cosimino fit entendre, mais par le nez cette fois, un nouveau grognement. La bile lui gonflait l’estomac. Il serrait les poings, pinçait les lèvres. À la fin, il n’y tient plus :
– Alors quoi ? du tartre, comme vous dites…
– Oui, mon garçon, du tartre émétique, confirma avec placidité le docteur Nicastro, en tendant l’ordonnance à Dom Ravana. Il remit dans sa poche ses lunettes et son calepin :
– Si applicata juvant, continuata sanant ! L’adage manquait d’à propos, mais c’était du latin ; cela ferma la bouche au pauvre Cosimino.
– Faut-il faire comme d’habitude ? demanda le sacristain, pâle et soucieux, dès que le médecin fut sorti.
Dom Ravana écarta les bras en un geste de résignation sans le regarder :
– Tu n’as pas entendu ? dit-il.
– Alors, reprit Cosimino d’un ton funèbre, je vais prévenir ma femme… Donnez-moi les sous pour l’émétique et rentrez au presbytère. Je reviens tout de suite.
III
– Ah !… ah !
Et à chaque marche d’escalier, il recommençait à geindre :
– Ah !… ah !
La Sgriscia entendit ses gémissements ; elle courut ouvrir à Dom Ravana :
– Vous êtes malade ?
– Très malade… Mais laissez-moi ; restez dans votre cuisine… Cosimino va venir. Ne vous faites pas voir avant que je vous appelle. Allez… À la cuisine !
La Sgriscia regagna son antre sans piper. Dom Ravana monta dans sa chambre, enleva sa soutane et resta en culotte et en gilet de chasse. Un gilet trop long et trop large. Dom Ravana arpentait la pièce en manches de chemise, tout en réfléchissant amèrement.
Sa conscience était bourrelée de remords. Le doute n’était plus possible. Dieu dans sa miséricorde lui accordait la grâce de le mettre à l’épreuve par l’entremise de ce diable boiteux travesti en femme, et lui, l’ingrat, ne savait pas en profiter. Il succombait à la tentation.
– Ah ! s’écriait-il, dans son désespoir, s’arrêtant de temps à autre pour lever les bras au ciel.
Le pauvre mobilier semblait perdu dans cette chambre immense, sur ce pavé de vieilles briques de Valence, fendues et disjointes de place en place. Au milieu du mur de droite le petit lit bien propre sur ses tréteaux de fer apparents ; au-dessus un vieux crucifix d’ivoire, jauni par le temps. (Les yeux de Dom Ravana n’osaient pas, ce jour-là, se lever jusqu’à lui). Dans un coin, près du lit, une vieille carabine et, pendues au mur, quelques grosses clés, les clés de la maison de campagne.
Tin, tin, tin…
– Voilà Cosimino. Toujours ponctuel, le pauvre…
Il alla ouvrir lui-même.
– Je vous en prie, commença Cosimino avant de franchir le seuil, ne me faites pas voir cette sorcière boiteuse. C’est sa faute si… Mais ne parlons plus de ça. Voilà le remède. Allez me chercher une cuillerée.
Dom Ravana se fit humble et empressé :
– J’y vais, j’y vais… Et merci, mon fils. Tu me rends la vie. Entre, entre dans la chambre.
Il revint bientôt, pâle et tremblant, la cuillère à la main : – Je l’ai punie, tu sais ? Elle est en train de pleurer dans la cuisine. Tu as raison, mon fils, elle est la cause de tout. Tu as entendu hier au marché les ordres que je lui ai donnés. Eh bien, pendant que je suais sang et eau, Dieu le sait, à avaler cette étoupe que m’ordonne le médecin, je la vois entrer toute malicieuse, dans la salle à manger, et elle cachait avec sa main un beau plat de… Qu’est-ce que tu aurais fait, toi ?
– J’aurais mangé le homard, répliqua Cosimino d’un ton sec. Mais après, j’aurais expié moi-même mon péché de gourmandise, au lieu de le faire expier à un pauvre innocent !
Dom Ravana ferma les yeux d’un air navré et poussa un profond soupir. Cosimino parlait d’or ; sans aucun doute il était barbare de faire prendre chaque fois au sacristain l’émétique ordonné par le docteur Nicastro. Il suffisait à Dom Ravana d’assister aux effets du vomitif pour en éprouver le bienfait, et suivre l’exemple que Cosimino lui donnait. C’était barbare, mais Cosimino savait-il combien de fois dom Ravana avait été préservé de la tentation par la pensée de la scène qui suivrait. Pour triompher de sa chair, Dom Ravana avait besoin, comme d’un frein, du remords qui le prenait à voir son sacristain souffrir là sous ses yeux, injustement. Il avait comblé Cosimino de dons et de bienfaits. Que lui demandait-il en échange ? Ce seul et unique sacrifice pour la santé de son âme plus encore que pour celle de son corps. Chaque fois, le spectacle du supplice auquel la victime se soumettait sans révolte le bouleversait profondément ; le remords, la rage, la honte, l’assaillaient avec tant de force que l’envie le prenait de se jeter par la fenêtre.
– Qu’est-ce que c’est ? Vous pleurez maintenant ? disait Cosimino. Des larmes de crocodile !
– Non, gémissait Dom Ravana avec l’accent de l’affliction la plus sincère.
– Ça va bien, ça va bien ; étendez-vous sur le lit et regardez. Je prends la première cuillerée.
Dom Ravana s’étendit sur le lit les yeux gros de larmes, le visage contracté de douleur. Cosimino posa la bouilloire sur la lampe à alcool pour avoir de l’eau tiède au moment voulu ; puis, fermant les yeux, il avala la première cuillerée d’émétique.
– Voilà qui est fait… Mais ne me plaignez pas, ne me plaignez pas, taisez-vous, ou je fais un malheur.
– Je me tais, mon garçon, je me tais… Parlons d’autre chose… Demain, si le temps le permet et si je me sens mieux, j’irai à la campagne… Viens-y aussi. Amène ta femme et les enfants ; vous prendrez tous l’air sans penser à rien… Mais quelle mauvaise année, Cosimino !… Dieu nous punit de nos péchés ! La patience divine est à bout. Le monde pleure, mais les pleurs n’empêchent pas les massacres. Tu le sais, n’est-ce pas : guerre en Afrique, guerre en Chine. Les pauvres gens souffrent, mais souffrir ne les empêche pas de voler. La colère du Seigneur est sur nous. La grêle, tu as vu ? elle a pillé les jardins et les vignes… Et la gelée menace les oliviers. Dis un peu… Tu te sens déjà ?… Non ?
– Non, Monsieur le Curé, rien encore. Je vais prendre de l’eau tiède.
– C’est ça, parfait… Continuons à causer. Nous disions que la récolte de blé a été plutôt bonne et que si Dieu le veut et si la Vierge Marie nous en fait la grâce, elle compensera un peu la malechance de l’année.
Cosimino écoutait avec grande attention, mais probablement sans comprendre un seul mot. Par instants son visage passait par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ; puis il devenait blanc comme un linge ; une sueur froide coulait de son front. Il s’agitait sur sa chaise ; son œil se révulsait.
– Ah ! Monsieur le curé, ça commence à remuer… Je crois que nous y sommes.
– Sgriscia, Sgriscia, criait alors Dom Ravana, pâlissant à son tour et regardant fixement Cosimino pour retirer du spectacle tous les bons effets du remède. – Venez vite, je crois que nous y sommes.
La Sgriscia accourait tenir le front de son maître, pendant que Cosimino profitait de ses efforts et de ses contorsions pour lui appliquer sournoisement quelques solides coups de pieds dans les tibias.
IV
– Et maintenant un bol de bouillon pour Cosimino, ordonna vers le soir Dom Ravana à sa bonne. Veux-tu des languettes de pain dedans, dis, Cosimino ?
– Comme vous voudrez, Monsieur le Curé… Qu’on me laisse…, fit le pauvre sacristain à bout de forces, pâle comme un mort, la tête appuyée contre le mur.
– Avec des languettes de pain, des languettes et un jaune d’œuf, cria Dom Ravana, plein de prévenances. Dis, Cosimino, tu veux bien un jaune d’œuf dedans, n’est-ce pas ?
– Je ne veux rien ! Qu’on me laisse ! gémit Cosimino exaspéré ! Vous faites de beaux sermons et moi j’ai le poison dans l’estomac à votre place. Vous m’abîmez l’estomac et puis vous m’offrez des languettes de pain et un jaune d’œuf ! Est-ce que c’est digne d’un saint prêtre d’agir ainsi ? Laissez-moi m’en aller… C’est à perdre la foi… Aïe, aïe, aïe…
Et il s’en fut, les mains comprimant son ventre, tout en geignant.
– Quel mauvais caractère ! s’écria Dom Ravana avec colère. D’abord il est doux comme un agneau, puis il y pense, il y repense et il devient méchant comme une guêpe. Dire que je lui ai fait tant de bien à cet ingrat !
Il hochait la tête, plissait les coins des lèvres. Puis il appela Sgriscia.
– Donnez-moi le bouillon, je le prendrai moi-même. Vous y avez mis le jaune d’œuf ? Très bien. Maintenant, mon chapeau et mon manteau.
– Monsieur le curé veut sortir ?
– Mais naturellement, Dieu soit loué, je me sens très bien maintenant.
L’AUTRE FILS[3]
– Ninfarosa est là ?
– Elle est là. Frappez fort.
La vieille Maragrazia frappe, puis, pesamment, s’accroupit sur la marche usée du seuil. C’est sa place habituelle : le seuil de la maison de Ninfarosa ou de quelque autre masure de Farnia. Affalée là, elle dort ou pleure en silence. Les passants jettent dans son tablier un petit sou ou un quignon de pain ; à peine interrompt-elle son sommeil ou ses pleurs : elle baise le sou ou le pain, fait un signe de croix et recommence à pleurer ou à dormir.
On dirait un tas de chiffons. Un amas de loques crasseuses et sans couleur, toujours les mêmes, été comme hiver, déchirées, haillonneuses, d’où s’exhale une puanteur faite de sueur rancie et de toutes les ordures de la rue. Son visage terreux n’est que rides ; les paupières y rougeoient, retroussées, brûlées par les larmes incessantes, mais les yeux clairs, comme perdus au loin, pareils aux yeux sans mémoire de l’enfance, contrastent avec ces rides, ces paupières rougies, ce larmoiement. Ses yeux attirent les mouches qui se collent dessus, voraces ; mais elle est tellement abîmée dans son chagrin qu’elle n’y prend pas garde et ne les chasse pas. Les quelques pauvres cheveux qui lui restent, divisés par une raie, retombent en deux petits chignons sur les oreilles, ses oreilles aux lobes déchirés par le poids de lourds anneaux à pendentifs qu’elle a portés dans sa jeunesse. Du menton glissent le long du cou de lamentables fanons, séparés par un sillon noir qui se perd dans la poitrine creuse.
Les voisines, assises devant les portes, ne lui prêtaient plus attention. À longueur de journée, elles demeuraient là à ravauder le linge, à éplucher les légumes, à tricoter et, tout en travaillant, elles bavardaient devant les maisons basses, qui ne prennent jour que par la porte. Maisons qui servent aussi d’étables, avec leur pavé de caillou pareil à celui de la rue. D’un côté, le râtelier, un âne ou une mule qui piétinent devant, tourmentés par les taons ; de l’autre, le lit surélevé, monumental ; le long coffre noir, de sapin ou de hêtre, semblable à un cercueil et qui sert aussi de siège ; deux ou trois chaises paillées ; la huche et puis les outils. Sur les murs nus, noirs de suie, en guise d’ornements, quelques chromos à un sou, figurant les saints patrons du village.
Dans la rue enfumée, envahie par l’odeur de l’étable, des enfants jouent, bronzés par le soleil, les uns nus comme au jour de leur naissance, les autres couverts d’une simple chemise sale, en lambeaux. Les poules picorent, les porcs couleur de craie soufflent du groin dans les balayures et reniflent.
*
* *
Ce jour-là on parlait du nouveau convoi d’émigrants qui devait le lendemain partir pour l’Amérique.
– Saro Scoma est du départ, disait l’une. Il quitte sa femme et trois enfants.
– Vito Scordia, reprenait une autre, en laisse cinq et sa femme est enceinte.
– On dit que Carmine Ronca emmène avec lui son garçon qui a douze ans et travaillait déjà à la zoljara… Sainte Vierge, il aurait au moins pu laisser le petit à sa femme ! Comment fera cette pauvre créature maintenant ?
Une quatrième se lamentait :
– Toute la nuit, que de pleurs dans la maison de Nunzia Ligreci ! Son fils Nico, qui revient à peine de la caserne, veut partir aussi.
La vieille Maragrazia écoutait, et pour ne pas éclater en sanglots, elle enfonçait son châle dans sa bouche. Mais sa douleur débordait, coulait de ses yeux bouffis en pleurs intarissables.
Il y avait quatorze ans que ses deux fils aussi étaient partis pour l’Amérique ; ils lui avaient promis de revenir au bout de quatre ou cinq ans ; mais ils avaient fait fortune, là-bas, un surtout, l’aîné, et ils avaient oublié leur vieille mère. Chaque fois que partait de Farnia un nouveau convoi, elle venait chez Ninfarosa se faire écrire une lettre qu’elle confiait à un des émigrants en le suppliant de la remettre à l’un ou l’autre de ses fils. Longtemps elle suivait sur la route poudreuse le convoi qui gagnait, dans une houle de sacs et de paquets, la gare de la ville voisine, escorté par les mères, les femmes, les sœurs, qui pleuraient et hurlaient leur désespoir. Tout en marchant, elle regardait fixement les yeux de tel ou tel jeune émigrant qui affectait une bruyante allégresse pour dissimuler son émotion et donner le change aux parents qui l’accompagnaient.
– Vieille folle, lui criaient certains, pourquoi me regardez-vous comme ça ? Vous voulez m’arracher les yeux ?
– Non, trésor, je te les envie, répondait la vieille. Ils verront mes fils. Dis-leur dans quel état tu m’as laissée. S’ils tardent encore, ils ne me trouveront plus.
Les commères du voisinage continuaient à dénombrer les partants du lendemain. Tout à coup un vieux à la barbe et aux cheveux crépus, qui, jusque-là, avait écouté en silence, étendu sur le dos, le ventre au soleil, tout occupé à fumer sa pipe au fond de la ruelle, leva sa tête appuyée à un bât de mulet, et portant à son cœur ses grosses mains rugueuses :
– Si j’étais roi, dit-il (et ce disant, il cracha), si j’étais roi, je ne laisserais plus arriver à Farnia une seule lettre de là-bas.
– Bravo, Jaco Spina, s’écria l’une des voisines, et comment vivraient ici les pauvres mères, les femmes, sans nouvelles et sans argent ?
– Parlons-en ! Pour ce qu’ils envoient ! grogna le vieux en crachant de nouveau. Leurs mères sont forcées d’entrer en service et leurs femmes tournent mal. Mais pourquoi, dans leurs lettres, ne racontent ils pas tout le mal qu’ils trouvent là-bas ? Ils n’écrivent que le beau côté des choses, et chaque lettre pour les malheureux enfants d’ici, c’est comme une mère-poule – piou, piou, piou : – les petits répondent à l’appel et partent au diable-vert. Il n’y a plus de bras pour travailler nos terres. Des vieux, des femmes et des mioches, voilà tout ce qu’on trouve à Farnia. Mes champs, je les regarde pâtir. Qu’est-ce que je peux faire avec deux bras ? Et ils continuent à émigrer, ils continuent ! La pluie dans les yeux et le vent dans l’échine, voilà ce que je leur souhaite. Qu’ils se cassent la figure, ces saligauds !…
Ninfarosa ouvrit sa porte à ce moment précis, et ce fut comme si le soleil se levait dans la ruelle.
Brune, le teint chaud, les yeux noirs, brillants, les lèvres pourpres, son corps tout entier, solide et svelte, rayonnait de joie et de fierté. Un grand foulard de cotonnade rouge à lunes jaunes couvrait sa poitrine ferme, et de gros anneaux d’or lui pendaient aux oreilles. Ses cheveux aile de corbeau, ondulés, lustrés, rejetés en arrière, sans raie sur le sommet de la tête, se nouaient en un chignon énorme sur la nuque, retenus par une épingle d’argent. Une fossette bien placée au milieu du menton arrondi lui donnait une grâce malicieuse et provocante.
Veuve d’un premier mari, après deux ans à peine de mariage, elle avait été abandonnée par le second, parti cinq ans plus tôt pour l’Amérique. La nuit – c’était un secret – par la petite porte de derrière qui donnait sur le potager, quelqu’un venait la voir (un des riches du pays). Aussi les voisines, honnêtes et craignant Dieu, la regardaient-elles d’un mauvais œil ; dans leur for intérieur, elles l’enviaient. Elles lui en voulaient aussi pour une autre raison : on disait dans le pays que, pour se venger de l’abandon de son second mari, elle avait écrit en Amérique des lettres anonymes à des émigrés pour calomnier et déshonorer de pauvres femmes.
– Qui est-ce qui prêche comme ça ? demanda-t-elle en gagnant la rue. Ah ! c’est vous, Jaco Spina. Croyez-moi, mieux vaudrait que nous restions seules à Farnia. Les femmes se mettraient à piocher la terre.
– Les femmes, grogna encore le vieux de sa voix catarrheuse, les femmes ne sont bonnes qu’à une seule et unique chose.
Et il cracha.
– Quelle chose, zio Jaco ? Dites-le tout haut.
– À pleurer et à autre chose.
– Ça en fait au moins deux, alors. Mais voyez, moi, je ne pleure pas.
– Eh ! je le sais bien ! Tu n’as même pas pleuré à la mort de ton premier mari.
– Si c’était moi qui étais morte la première, répliqua Ninfarosa, est-ce qu’il ne se serait pas remarié ? Alors… Voyez celle qui pleure ici pour tout le monde : c’est Maragrazia.
– Ça dépend, prononça jaco Spina, en se recouchant le ventre au soleil, la vieille a de l’eau à rejeter, et elle la rejette aussi par les yeux.
Les voisines se mirent à rire. Maragrazia, secouant sa torpeur, s’écria :
– J’ai perdu deux fils, beaux comme le soleil, et vous ne voulez pas que je pleure.
– De beaux fils, je vous le promets, et qui méritent d’être pleurés, fit Ninfarosa. Ils nagent dans l’abondance, là-bas, et ils vous laissent mourir ici, comme une mendiante.
– Eux sont les enfants, moi, je suis la mère. Comment pourraient-ils comprendre ma peine ?
– Et puis, toutes ces larmes et toute cette peine, à quoi bon ? reprit Ninfarosa. On dit que c’est vous, à force de les tourmenter, qui les avez fait partir.
– Moi ? hurla Maragrazia, en se frappant la poitrine.
Elle se leva, hors d’elle :
– Moi ? Qui a dit cela ?
– Quelqu’un… l’a dit.
– C’est une infamie… Moi ? mes fils ? moi qui…
– Laissez-la dire, interrompit une des voisines, vous ne voyez pas qu’elle plaisante ?
Ninfarosa prolongeait son rire, ondulant sur ses hanches d’un air taquin ; puis, pour se faire pardonner sa cruelle plaisanterie, elle demanda à la vieille d’une voix affectueuse :
– Allons, grand’mère, dites-moi ce que vous voulez.
Maragrazia plongea une main tremblante dans son corsage et en retira une feuille de papier à lettres toute froissée, une enveloppe, et les tendant d’un air suppliant à Ninfarosa :
– Veux-tu me faire encore une fois le plaisir…
– Encore une lettre à écrire ?
– Oui, si tu voulais bien…
Ninfarosa fit la grimace, mais elle savait qu’elle ne se débarrasserait pas de la vieille ; elle la fit entrer.
Sa maison ne ressemblait pas à celles du voisinage. La pièce vaste, un peu sombre quand la porte était fermée, ne prenait jour que par une fenêtre grillée qui s’ouvrait au-dessus de la porte. Elle était blanchie à la chaux, pavée en briques, propre et bien meublée, avec son lit de fer, son armoire, sa commode à dessus de marbre, son guéridon de noyer : mobilier modeste, mais dont Ninfarosa n’aurait pu seule s’offrir le luxe sur ses gains de couturière de campagne.
Elle prit la plume, l’encrier, posa la feuille fripée sur le marbre de la commode et se disposa à écrire, sans s’asseoir :
– Allons, dites, dépêchons-nous.
– Mes chers fils, commença à dicter la vieille.
– Je n’ai plus d’yeux pour pleurer… continua Ninfarosa, avec un soupir de lassitude.
Et la vieille :
– Parce que mes yeux brûlent de vous voir au moins une dernière fois…
– Continuez, continuez, la pressa Ninfarosa. Vous leur avez déjà écrit ça une trentaine de fois au moins.
– Écris quand même. C’est la vérité, ma chérie, tu le vois bien. Écris : Mes chers fils…
– De nouveau.
– Non. Maintenant vient une autre chose. J’y ai pensé toute la nuit. Écoute : Mes chers fils, votre pauvre vieille maman vous promet et vous jure… Marque bien : vous promet et vous jure devant Dieu que, si vous revenez à Farnia, elle vous cédera de son vivant sa maison.
Ninfarosa éclata de rire :
– La maison à présent ? Mais que voulez-vous qu’ils en fassent, riches comme ils sont, de ces quatre murs de craie et de roseaux qui s’écrouleraient rien qu’en soufflant dessus ?
– Écris quand même, répéta la vieille, obstinée… Quatre pierres au pays valent plus qu’un royaume ailleurs. Écris, écris !
– C’est déjà écrit. Qu’est-ce que vous voulez encore ajouter ?
– Mets encore ça : votre pauvre maman, mes chers fils, à présent que l’hiver arrive, tremble de froid : elle voudrait s’acheter un vêtement et ne le peut pas ; veuillez lui faire la charité de lui envoyer au moins un billet de cinq « lire » pour…
– Ça va, ça va, fit Ninfarosa, en pliant la feuille et en la glissant dans l’enveloppe. J’ai tout écrit. Ça suffit…
– Tu as bien marqué pour les cinq « lire », demanda la vieille devant cette hâte inattendue.
– Tout, les cinq « lire » et le reste.
– Tout y est bien ?
– Puisque je vous dis que oui !
– Ma fille, montre un peu de patience avec une pauvre vieille ! Que veux-tu ? Je suis à moitié idiote… Que Dieu te récompense et la sainte Vierge Marie !
Elle prit la lettre, la glissa dans son corsage. Elle avait décidé de la confier au fils de Nunzia Ligreci qui allait à Rosario de Santa-Fé, où habitaient ses fils. Elle partit la lui remettre.
*
* *
Le soir était venu ; déjà les femmes étaient rentrées dans les maisons et presque toutes les portes se fermaient. Par les ruelles étroites, plus âme qui vive. L’allumeur de réverbères, son échelle sur l’épaule, faisait le tour du village pour allumer les quelques lampes à pétrole dont la chiche clarté pleurarde rendait plus tristes encore l’ombre et le silence des ruelles désertes.
La vieille Maragrazia cheminait pliée en deux ; d’une main elle pressait sur son cœur la lettre destinée à ses fils, comme pour transmettre à ce morceau de papier un peu de la chaleur maternelle. De sa main libre, elle se grattait l’épaule, puis la tête. À chaque nouvelle lettre, l’espoir tenace lui revenait d’émouvoir enfin ses fils et de les ramener à elle. En lisant ces mots tout imprégnés des larmes versées par leur mère depuis quatorze ans, comment ses beaux fils, ses tendres fils, pourraient-ils résister ?
Cette fois, à vrai dire, elle n’était qu’à moitié satisfaite de sa lettre. Il lui semblait que Ninfarosa l’avait rédigée trop vite ; elle n’était pas sûre que la dernière partie relative aux cinq « lire » pour un vêtement eût été écrite. Cinq « lire » ? Qu’est-ce que c’était que cinq « lire » pour des fils devenus riches, quand il s’agissait de protéger du froid leur vieille maman ?
À travers les portes closes des chaumines lui parvenaient les cris des mères qui pleuraient le départ prochain de leur enfant. Et Maragrazia, pressant plus fort sa lettre contre son cœur, gémissait :
– Enfants, enfants, comment avez-vous le cœur de partir ? Vous promettez de revenir, et puis vous ne revenez plus… Ah ! pauvres vieilles, ne vous fiez pas à leurs promesses ! Vos fils, comme les miens, ne reviendront plus… plus jamais.
Elle s’arrêta brusquement sous un réverbère. Un pas sonnait dans la ruelle. Qui était-ce ?
Ah ! c’était le nouveau médecin, ce jeune homme arrivé depuis peu, mais qui, à ce qu’on disait, ne tarderait pas à s’en aller. Ce n’était pas qu’il fît mal son métier, mais il était mal vu par les quelques tyranneaux du village. Tous les pauvres gens, au contraire, l’aimaient. Il avait l’air d’un adolescent ; et pourtant il était vieux par l’expérience et le savoir : quand il parlait, chacun demeurait bouche bée. On disait que lui aussi voulait partir pour l’Amérique. Mais il n’avait plus sa mère, lui : il était seul.
– Monsieur le docteur, supplia Maragrazia, voudriez-vous me faire une charité ?
Le jeune docteur s’arrêta en sursaut sous le réverbère. Il réfléchissait tout en marchant et n’avait pas pris garde à la vieille.
– Qui êtes-vous ? Ah ! c’est vous…
Il se rappelait avoir vu souvent ce tas de chiffons au seuil des maisons.
– Voudriez-vous me lire cette lettre que je dois envoyer à mes fils ?
– Si j’y vois suffisamment, dit le docteur qui était myope, en assujettissant son lorgnon.
Maragrazia tira la lettre de son corsage, la lui remit et attendit qu’il commençât à lui relire les phrases dictées par elle à Ninfarosa : – Mes chers fils… – Mais non ! Le docteur n’y voyait pas assez, ou bien il ne parvenait pas à déchiffrer l’écriture : il approchait la feuille de papier de ses yeux, l’écartait pour bien profiter de l’éclairage du réverbère, la retournait d’un côté, de l’autre. À la fin, il demanda :
– Mais qu’est-ce que c’est ?
– Vous ne pouvez pas lire ? questionna timidement Maragrazia.
Le docteur se mit à rire.
– Mais il n’y a rien d’écrit du tout Quatre coups de plume en zigzag. Regardez.
– Comment ! cria la vieille, stupéfaite.
– Regardez vous-même. Rien du tout. Il n’y a pas un mot d’écrit.
– Est-il possible ? fit la vieille. Mais comment ? J’ai tout dicté moi-même à Ninfarosa, un mot après l’autre. Et je l’ai vue qui écrivait…
– Elle a fait semblant, dit le médecin en haussant les épaules.
Maragrazia restait clouée sur place. Brusquement elle se frappa la poitrine :
– Ah ! l’infâme !… Pourquoi me trompait-elle ? Voilà pourquoi mes fils ne me répondent pas ! Elle n’a jamais rien écrit de tout ce que je lui ai dicté… Voilà la raison ! Alors, mes fils ne savent pas dans quel état je suis ? Que je meurs à cause d’eux ? Moi qui les accusais, monsieur le Docteur ! et c’était elle qui se moquait de moi !… Seigneur, comment peut-on trahir ainsi une pauvre mère, une pauvre vieille comme moi ! Oh ! quelle honte !
Le jeune docteur, ému et indigné, essaya d’abord de la calmer un peu ; il se fit expliquer qui était cette Ninfarosa, où elle habitait, pour lui faire le lendemain la semonce qu’elle méritait. Mais la vieille s’inquiétait surtout d’excuser ses fils lointains de leur long silence ; elle se sentait rongée par le remords de les avoir accusés pendant si longtemps de l’abandonner ; elle était sûre à présent qu’ils seraient revenus, qu’ils auraient volé vers elle si une seule des lettres qu’elle avait cru leur envoyer avait été vraiment écrite et leur était parvenue.
Pour en finir, le docteur dut promettre que le lendemain matin il écrirait lui-même une longue lettre pour les deux fils.
– Allons, allons, ne vous désespérez pas. Vous viendrez demain matin chez moi. Maintenant, allez vous reposer. Allez dormir.
Dormir ! Deux heures plus tard, repassant par là, le docteur la retrouva à la même place, qui pleurait, inconsolable, accroupie sous le réverbère. Il lui fit des reproches, l’obligea à se lever, lui ordonna de rentrer chez elle tout de suite.
– Où habitez-vous ?
– Ah ! monsieur le Docteur… J’ai une cabane, dans le bas du pays. J’avais dit à cette saleté d’écrire à mes fils que je la leur céderais de mon vivant, s’ils voulaient revenir. Elle s’est mise à rire, cette dévergondée, parce que ce sont quatre murs de craie et de roseaux. Mais moi…
– Ça va bien. Ça va bien…, interrompit le docteur. Allez vous coucher ! Demain nous n’oublierons pas de parler de la cabane dans la lettre. Allons, venez, je vous accompagne.
– Dieu vous bénisse, monsieur le Docteur, mais que dites-vous ? Votre Seigneurie m’accompagner ! Marchez, marchez devant ; moi, je suis vieille et je marche lentement.
Le docteur lui souhaita une bonne nuit et la quitta. Maragrazia le suivait à distance. Arrivée devant la porte où elle l’avait vu entrer, elle s’arrêta, ramena son châle sur sa tête, s’enveloppa soigneusement, et s’assit sur la marche du seuil, pour y passer la nuit dans l’attente.
À l’aube, elle dormait quand le docteur, qui était matineux, sortit pour ses premières visites. La porte n’avait qu’un seul battant ; quand il l’ouvrit, la vieille dormeuse, qui y était appuyée, tomba à la renverse, à ses pieds.
– C’est vous. Vous vous êtes fait mal ?
– Que Votre Seigneurie me pardonne, balbutia Maragrazia, en s’aidant de ses deux mains, enveloppées dans le châle, pour se relever.
– Vous avez passé la nuit à ma porte ?
– Oui, monsieur le Docteur… Ça ne fait rien. Je suis habituée, s’excusa la vieille. Que voulez-vous ? Je ne peux pas me consoler de la trahison de cette scélérate ! Je la tuerais, monsieur le Docteur. Elle aurait pu me dire que ça l’ennuyait d’écrire ; je serais allée chez quelqu’un d’autre ; je serais venue chez vous qui êtes si bon…
– Oui, attendez un moment ici, dit le docteur. Je vais d’abord passer chez cette bonne personne. Nous écrirons la lettre après. Attendez-moi.
Et il se hâta vers la rue que la vieille lui avait indiquée, le soir précédent. Le hasard voulut qu’il demandât justement à Ninfarosa, qui était déjà dehors, l’adresse exacte de celle à qui il voulait parler.
– C’est moi-même, monsieur le Docteur, répondit en riant et en rougissant Ninfarosa, et elle le pria d’entrer.
Elle avait souvent vu passer dans la ruelle ce jeune médecin au visage d’enfant ; et comme elle se portait à miracle, et n’aurait pas osé simuler une maladie pour le faire appeler, son contentement, mêlé de surprise, éclatait en voyant qu’il était venu de lui-même causer avec elle. Dès qu’elle sut de quoi il s’agissait, le voyant troublé et sévère, elle se pencha, coquette, vers lui, l’air désolé de la peine qu’il avait sans raison, vraiment ! À peine lui fut-il permis de parler, sans commettre l’inconvenance de l’interrompre, qu’elle s’écria, fermant à demi ses beaux yeux noirs :
– Mais pardon, monsieur le Docteur. Vous vous affligez pour de vrai sur le compte de cette vieille folle ? Dans le pays, tout le monde la connaît, monsieur le Docteur, et personne ne s’en inquiète plus. Demandez à qui vous voudrez : tout le monde vous dira qu’elle est folle, réellement folle depuis quatorze ans, vous savez, depuis que ses deux fils sont partis pour l’Amérique. Elle ne veut pas admettre qu’ils l’ont oubliée, comme c’est la vérité, et elle s’obstine à écrire, à écrire… Alors, pour la contenter, vous comprenez, je fais semblant d’écrire des lettres ; ceux qui s’en vont font semblant de les prendre pour les porter à destination. Et la pauvre femme s’illusionne. Mais, si nous faisions toutes comme elle, mon cher monsieur le Docteur, il n’y aurait plus de vie possible. Regardez, moi qui vous parle, j’ai été abandonnée par mon mari… Oui, monsieur. Et savez-vous le toupet qu’il a eu, ce joli coco ? Il m’a envoyé son portrait avec sa bonne amie de là-bas ! Je peux vous le montrer… Ils ont leurs têtes l’une contre l’autre, et ils se tiennent les mains comme ceci… Vous permettez ? Donnez-moi votre main. Comme ça. Et ils rient au nez de ceux qui les regardent : ils me rient au nez, autant dire. Ah ! monsieur le Docteur, on plaint ceux qui partent, on ne plaint pas ceux qui restent. Je pleurais moi aussi, naturellement, les premiers temps, mais ensuite, je me suis fait une raison. À présent… à présent je vis du mieux que je peux et, si j’ai l’occasion de m’amuser, je m’amuse. Il faut prendre la vie comme elle est…
Troublé par cette amabilité provocante, par la sympathie que lui témoignait sans retenue cette belle créature, le docteur baissa les yeux et dit :
– Mais vous, vous avez peut-être de quoi vivre. Tandis que cette pauvre vieille…
– Qui ? elle ? répliqua Ninfarosa avec vivacité. Mais elle a parfaitement de quoi vivre, sans se donner le moindre mal, servie comme une princesse. Elle n’aurait qu’à vouloir. Elle ne veut pas.
– Comment cela ? demanda le docteur stupéfait, en levant les yeux.
Ninfarosa, à l’aspect de ce visage étonné, éclata de rire, découvrant toutes ses dents solides et blanches qui donnaient à son sourire l’éclat splendide de la santé.
– Mais oui ! dit-elle. Elle ne veut pas, monsieur le Docteur. Elle a un autre fils, ici, le plus jeune, qui voudrait la prendre chez lui et ne la laisserait manquer de rien.
– Un autre fils ? Elle…
– Oui, monsieur. Il s’appelle Rocco Trupia. Elle ne veut rien savoir de lui.
– Et pourquoi ?
– Parce qu’elle est folle, je vous l’ai dit. Elle pleure jour et nuit à cause de ces deux-là qui l’ont abandonnée, et elle ne veut même pas accepter un morceau de pain de l’autre qui la supplie à mains jointes. Elle préfère l’aumône des étrangers…
Ne voulant pas montrer encore sa stupéfaction, pour cacher son trouble croissant, le docteur fronça les sourcils et dit :
– Ce dernier fils s’est peut-être mal comporté avec elle.
– Je ne crois pas, dit Ninfarosa. Il est laid, il a toujours l’air grognon, mais il n’est pas méchant. Et quel travailleur ! Son travail, sa femme et ses enfants, il ne sort pas de là. Si vous êtes curieux de le voir, vous n’aurez pas loin à aller… Tenez, vous n’avez qu’à suivre tout droit. Un quart de mille après la sortie du pays, vous trouverez à droite la Maison de la Colonne, comme on l’appelle. Il habite là. Il a une belle propriété en fermage, qui lui rapporte gros. Allez-y, vous verrez que tout est bien comme je vous dis.
Le docteur se leva. Bien disposé par cette conversation, pris au charme de cette tendre matinée de septembre, plus curieux que jamais d’éclaircir cette affaire, il annonça :
– Eh bien, j’y vais…
Ninfarosa porta ses mains à sa nuque pour consolider son chignon autour de l’épingle d’argent et regardant en dessous le docteur, les yeux riants et prometteurs :
– Alors, bonne promenade, dit-elle. Et mes respects !
*
* *
La côte gravie, le docteur s’arrêta pour reprendre haleine. Quelques pauvres masures de chaque côté de la route, le village finissait là. Le chemin débouchait sur la route départementale qui courait en palier, droite et poudreuse, pendant plus d’une lieue, sur le vaste plateau, au milieu des cultures : terres à blé, pour la plupart, où jaunissait le chaume. Un admirable pin parasol se dressait à gauche, ombrelle gigantesque, qui servait de but aux promenades vespérales des « messieurs » de Farnia. Une longue chaîne de montagnes bleuâtres bornait, tout au fond, le plateau ; d’épais nuages d’étoupe semblaient aux aguets derrière : parfois, se détachant des autres, l’un d’eux nageait lentement dans le ciel, passait au-dessus du mont Mirotta qui se dresse derrière Farnia. À son passage, le mont se couvrait d’une ombre foncée, violâtre, et aussitôt après s’éclairait à nouveau. Le calme silence du matin n’était rompu de temps à autre que par les détonations des chasseurs guettant le passage des tourterelles ou l’envol d’une alouette ; à ces détonations succédaient les aboiements furieux, sans fin, des chiens de garde.
Le docteur allait d’un bon pas, jetant un regard sur la terre séchée, qui attendait les premières pluies pour être labourée. Les bras manquaient ; de toute la campagne montait une impression profonde de tristesse et d’abandon.
Ah ! voici là-bas la Maison de la Colonne, ainsi nommée à cause de la colonne d’un vieux temple grec, toute rongée et découronnée, qui soutient un des angles. Pauvre masure, en vérité. Une roba, comme les paysans siciliens nomment leurs habitations rurales. Protégée derrière par une haie épaisse de figuiers de Barbarie, elle s’ornait sur le devant de deux grandes meules de paille, en forme de cône.
– Hé la ! de la roba, appela le docteur qui avait peur des chiens, en s’arrêtant devant une grille rouillée et assez mal en point.
Un petit garçon d’une dizaine d’années répondit à l’appel. Pieds nus, avec une toison de cheveux roux, décolorés par le soleil, et une paire d’yeux verts de bête foraine.
– Il y a un chien ? demanda le docteur.
– Oui, mais il ne mord pas, il « connaît », répondit l’enfant.
– Tu es le fils de Rocco Trupia ?
– Oui, monsieur.
– Où est ton père ?
– Il décharge du fumier, là-bas, avec les mules. Sur le banc de pierre devant la roba, la mère était assise ; elle peignait la fille aînée qui pouvait bien avoir douze ans et qui se tenait sagement assise sur un seau renversé, un bébé de quelques mois sur les genoux. Un autre enfant jouait par terre, au milieu des poules qui n’en avaient pas peur et contre le gré d’un beau coq qui, tout glorieux, dressait le cou et remuait sa crête.
– Je voudrais parler à Rocco Trupia, dit le docteur à la femme. Je suis le nouveau médecin.
La femme resta un moment à le dévisager, troublée, ne comprenant pas ce que le médecin pouvait vouloir à son mari. Elle enfonça sa chemise grossière dans son corsage qui était resté ouvert, – elle venait de donner le sein au dernier-né, – le boutonna et se leva pour offrir une chaise. Le docteur la refusa et se baissa pour caresser le petit qui jouait à terre. L’autre garçon courut appeler son père.
Bientôt on entendit le bruit de gros souliers ferrés, et des figuiers de Barbarie surgit Rocco Trupia, qui marchait courbé, les jambes en cerceau, une main à l’échine, comme la plupart des paysans.
Son large nez épaté, la longueur exagérée de sa lèvre supérieure, rasée, retroussée, lui donnaient un air simiesque ; il était rouge de poil ; son visage pâle était semé de taches de son ; ses yeux verts, enfoncés, lançaient par éclair des regards torves, puis se dérobaient.
Il leva la main et rejetant un peu en arrière sa casquette noire, en guise de salut :
– Je baise les mains à Votre Seigneurie. En quoi puis-je la servir ?
– Voilà. J’étais venu, commença le docteur, pour vous parler de votre mère.
Rocco Trupia se troubla aussitôt :
– Elle ne va pas bien ?
Le docteur se hâta de le rassurer :
– Si, elle va comme d’habitude. Mais elle est si vieille, comprenez-vous, si dénuée de tout, sans soins…
À mesure que le docteur parlait, le trouble de Rocco Trupia grandissait. À la fin, il ne put plus y tenir :
– Monsieur le Docteur, dit-il, je suis à vos ordres pour n’importe quoi. Mais, si Votre Seigneurie est venue ici pour me parler de ma mère, alors, pardon-excuse, je m’en retourne à mon travail.
– Attendez… Je sais que vous n’y êtes pour rien, dit le médecin pour le retenir. On m’a même assuré que vous, au contraire…
– Entrez, monsieur le Docteur, fit brusquement Rocca Trupia, en indiquant la porte de la roba. Maison de pauvres, mais, puisque vous êtes médecin, vous en avez vu d’autres. Je veux vous montrer le lit toujours fait pour cette… bonne vieille : c’est ma mère, je ne puis la nommer autrement. Voici ma femme, voilà mes enfants ; ils peuvent témoigner que je leur ai toujours ordonné de servir, de respecter ma vieille comme la Vierge sainte. Une mère est sacrée, monsieur le Docteur : Qu’est-ce que j’ai fait à la mienne ? Pourquoi me fait-elle honte aux yeux de tout le pays et laisse-t-elle croire de moi qui sait quoi ? J’ai été élevé, monsieur le Docteur, par les parents de mon père, c’est vrai, depuis que j’étais tout petit ; je ne devrais pas la respecter comme une mère ; elle a toujours été dure pour moi ; et pourtant je l’ai toujours respectée et chérie. Quand ses fils, que le diable emporte, sont partis pour l’Amérique, j’ai couru chez elle pour l’amener ici, comme la reine de la maison. Mais non. Elle préfère mendier dans les rues ; il faut qu’elle donne ce spectacle aux gens et me couvre de honte. Monsieur le Docteur, je vous jure que, si un de ses fils revient à Farnia, je le tue pour me venger de cette honte et de toutes les avanies que je subis à cause d’eux depuis quatorze ans : je le tue, aussi vrai que je vous parle, en présence de ma femme et de ces quatre innocents !
Frémissant, plus livide que jamais, Rocco Trupia essuya du bras sa bouche qui écumait. Ses yeux étaient injectés de sang. Le jeune docteur le contemplait, indigné.
– Mais voilà, dit-il enfin, voilà pourquoi votre mère ne veut pas accepter l’hospitalité que vous lui offrez, c’est à cause de votre haine pour vos frères. C’est clair.
– Ma haine ? fit Rocco Trupia, les poings serrés, en se penchant en avant. Oui, de la haine à présent, monsieur le Docteur, pour tout ce qu’ils ont fait souffrir à leur mère et à moi. Mais avant, quand ils étaient ici, je les aimais et les respectais comme des aînés. Et eux, au contraire, deux Caïns pour moi. Écoutez : ils ne travaillaient pas, c’était moi qui travaillais pour tous ; ils venaient ici me dire qu’il n’avaient pas de quoi manger le soir, que notre mère irait au lit le ventre vide et je leur donnais ; ils se saoulaient, ils faisaient la noce avec de sales femmes, et moi, je donnais toujours. Quand ils partirent pour l’Amérique, je me saignai pour eux aux quatre veines. Ma femme peut vous le dire.
– Mais pourquoi alors ? répéta le docteur, comme s’il se parlait à lui-même.
Rocco Trupia eut un ricanement :
– Pourquoi ? Parce que ma mère dit que je ne suis pas son fils.
– Comment ça ?
– Monsieur le Docteur, dites-lui de vous l’expliquer. Je n’ai pas de temps à perdre : les hommes m’attendent là-bas avec les mules chargées de fumier. J’ai du travail, et voyez, je me suis mis sens dessus dessous. Interrogez-la. Je vous baise les mains.
Et Rocco Trupia s’éloigna, comme il était venu, les jambes en cerceau et la main à l’échine. Le docteur le suivit un instant des yeux, puis se tourna vers les enfants, qui semblaient pétrifiés, et vers la femme. La femme joignit les mains et les agitant doucement, les yeux mi-clos, elle eut le soupir des résignés :
– Que la volonté de Dieu soit faite !
*
* *
De retour au village, le docteur voulut éclaircir sans tarder ce cas étrange, qui touchait à l’invraisemblance. La vieille était toujours assise sur la marche de son seuil ; elle n’avait pas bougé ; il l’invita à entrer avec quelque rudesse dans la voix :
– J’ai été parler à votre fils à la Maison de la Colonne, dit-il. Pourquoi m’avez-vous caché que vous aviez un autre fils ?
Maragrazia le regardait, éperdue, atterrée presque ; elle passa ses mains tremblantes sur son front et ses cheveux, puis :
– Ah ! monsieur le Docteur, fit-elle, j’ai les sueurs froides quand on me parle de ce fils. Ne m’en parlez pas, par pitié !
– Mais pourquoi ? demanda le docteur en colère. Qu’est-ce qu’il vous a fait ? Allons, dites !
– Il ne m’a rien fait, se hâta de répondre la vieille. En conscience, je dois le reconnaître ! Il m’a toujours couru après, respectueusement… Mais je… voyez comme je tremble, dès que j’en parle ? Je ne peux pas en parler ! Écoutez, monsieur le Docteur, ce n’est pas mon fils.
Le jeune homme perdit patience ; il s’écria :
– Comment, ce n’est pas votre fils ? Qu’est-ce que vous dites ? Vous êtes idiote ou vous devenez folle ? Est-ce que ce n’est pas vous qui l’avez fait ?
La vieille baissa la tête à cette sortie, elle ferma à demi ses yeux rouges et répondit :
– Oui, monsieur. Je suis peut-être idiote. Folle, non. Plût à Dieu ! Je n’aurais plus tant de peine. Mais il y a des choses que Votre Seigneurie ne peut pas savoir. Vous êtes trop jeune. Moi j’ai les cheveux blancs, je souffre depuis si longtemps, et j’en ai vu… j’en ai vu… J’ai vu des choses, moi, que vous ne pouvez même pas imaginer.
– Eh bien, qu’avez-vous vu ? Parlez !
– Des choses, des choses terribles, soupira la vieille en hochant la tête. Vous n’étiez pas encore né, ni à naître, et moi, je les ai vues de ces yeux qui depuis n’ont cessé de pleurer des larmes de sang. Est-ce que vous avez entendu parler d’un certain Canabardo ?
– Garibaldi ? demanda le docteur, stupéfait.
– Précisément, celui qui vint dans le pays et fit révolter les campagnes et les villes contre toutes les lois des hommes et de Dieu ? Vous en avez entendu parler ?
– Oui, oui. Mais dites. Qu’est-ce que Garibaldi a à voir là-dedans ?
– Il vous faut savoir que ce Canabardo donna l’ordre, en arrivant, d’ouvrir toutes les prisons. Vous imaginez quelle invasion ce fut dans nos campagnes ! Les pires voleurs, les plus terribles assassins, des bêtes fauves, sanguinaires, rendues enragées par leurs années de galère… Il y en avait un surtout, le plus féroce, un certain Cola Camizzi, un chef de brigands qui tuait les pauvres créatures de Dieu comme des mouches, par plaisir…, pour essayer la poudre, disait-il, pour voir si sa carabine portait juste. Celui-là se mit en campagne de nos côtés. Il passa par Farnia avec une bande qu’il avait formée, rien que des paysans ; mais il n’était pas encore satisfait, il en voulait d’autres, et il tuait tous ceux qui refusaient de le suivre. Moi, j’étais mariée depuis quelques années, et j’avais ces deux fils de ma chair qui sont maintenant là-bas en Amérique ! Mon pauvre mari était métayer sur les terres de Pozzetto. Cola Camizzi passa par là et emmena de force mon mari. Deux jours plus tard, je me le vois revenir pâle comme un mort ; il était méconnaissable ; il ne pouvait pas parler ; ses yeux étaient emplis de ce qu’il avait vu, et il cachait ses mains, le pauvre, par dégoût de ce qu’il avait été contraint de faire… Ah ! monsieur le Docteur, mon sang ne fit qu’un tour quand je le vis dans cet état. Je lui criai (Dieu ait son âme) : « Nino, Nino, qu’est-ce que tu as fait ? » Il ne pouvait pas parler. « Tu t’es sauvé ? Et maintenant s’ils te reprennent ? Ils vont te tuer ! » C’était mon cœur, mon cœur qui m’avertissait de tout. Mais lui, sans un mot, s’assit au coin du feu ; il tenait toujours ses mains cachées sous sa veste ; il avait des yeux de fou ; il regardait à terre. Il parla enfin : « Plutôt la mort ! » Il n’ajouta rien. Trois jours il resta caché. Le quatrième il sortit : nous étions pauvres, il fallait travailler. Il sortit pour travailler. Le soir, il ne rentra pas… J’attendis, j’attendis, ah ! Seigneur ! Mais déjà, je savais, j’avais tout deviné. Je me disais pourtant : « Qui sait ? Ils ne l’ont peut-être pas tué. Ils l’ont simplement repris ! » J’appris, six jours plus tard, que Cola Camizzi se trouvait avec sa bande à Montelusa, une propriété des moines qui s’étaient sauvés. Comme une folle, j’y allai. Depuis le Pozzetto, cela faisait plus de six milles de route. C’était une journée de vent, comme je n’en ai plus connu de pareille dans ma vie. Est-ce que vous avez jamais « vu » le vent ? Ce jour-là, on le voyait. On aurait dit que toutes les âmes de ceux qu’ils avaient assassinés criaient vengeance aux hommes et à Dieu. Je me jetai dans ce vent, et il me porta : je hurlais plus fort que lui. Je ne courais pas, je volais : je mis à peine une heure à arriver au couvent, qui était juché tout en haut, au milieu des peupliers noirs. Il y avait une grande cour, entourée de murs. On y entrait par une toute petite porte, à moitié cachée – je la vois encore – par une grande touffe de câpriers plantée dans le mur. Je pris une pierre pour frapper plus fort : je frappai ; ils ne voulaient pas m’ouvrir, mais je frappai tant et tant qu’à la fin ils m’ouvrirent. Ah ! ce que je vis !
Maragrazia se dressa, soulevée d’horreur, les yeux fixes ; sa main s’allongeait, les doigts crispés de dégoût. La voix lui manquait pour continuer :
– À la main…, dit-elle, à la main… ces assassins…
Elle s’arrêta encore, la voix étranglée, elle fit de la main le geste de lancer quelque chose.
– Eh bien ? demanda le docteur, bouleversé.
– Ils jouaient… dans la cour… aux boules… mais avec des têtes d’hommes… noires, pleines de terre…, ils les tenaient par les cheveux… et une, celle de mon mari, c’était Cola Camizzi qui la tenait… Il me la montra. Je jetai un cri qui me déchira la gorge et la poitrine, un cri si fort que les assassins en tremblèrent. Cola Camizzi me serra le cou pour me faire taire, mais un des hommes lui sauta dessus, furieux, et alors, quatre, cinq, dix d’entre eux, encouragés, se jetèrent sur lui, l’entourèrent. Ils étaient excédés. La tyrannie féroce de ce monstre avait fini par les révolter eux-mêmes, et j’eus la joie de le voir étranglé sous mes yeux par ses compagnons, ce chien…
La vieille s’abandonna sur la chaise, à bout de forces, haletante, agitée par un tremblement convulsif.
Le jeune homme la regardait, bouleversé, et sur son visage se mêlaient la pitié, l’horreur et le dégoût. Mais sa stupeur surmontée, il rassembla ses idées et ne parvint pas à saisir de rapport entre cette atroce histoire et l’autre fils. Il questionna.
– Attendez, répondit la vieille, dès qu’elle eut retrouvé son souffle. Celui qui s’était révolté le premier, qui avait pris ma défense, s’appelait Marco Trupia.
– Ah ! s’écria le médecin, Rocco est donc…
– Son fils, reprit Maragrazia. Pensez un peu, monsieur le Docteur, si je pouvais être la femme de cet homme après ce que j’avais vu ! Il me voulut de force ; trois mois il me garda avec lui, enchaînée, bâillonnée, parce que je criais, je le mordais. Au bout de trois mois, la justice finit par le dénicher et l’envoya aux galères, où il ne tarda pas à mourir. Mais j’étais enceinte. Ah ! monsieur le Docteur, je vous le jure, je me serais arraché les entrailles : il me semblait que je couvais un monstre. Je sentais que je ne pourrais pas le voir dans mes bras. À la seule idée de lui donner le sein, je criais comme une perdue. Je faillis mourir quand j’accouchai. Ma mère (Dieu ait son âme) m’assistait ; elle ne me le fit même pas voir : elle le conduisit aussitôt chez les parents du père qui l’ont élevé… Et maintenant, monsieur le Docteur, comprenez-vous que je puisse dire que ce n’est pas mon fils ? Le docteur demeura un instant absorbé dans ses pensées, puis :
– Mais, lui, votre fils, n’a rien fait de mal ?
– Rien ! répondit aussitôt la vieille. Mais quand mes lèvres ont-elles prononcé un seul mot contre lui ? Jamais, monsieur le Docteur. Au contraire… Mais que puis-je y faire, si je ne puis le voir, même de loin ? C’est tout le portrait de son père, le visage, l’allure, jusqu’à la voix… Je me mets à trembler rien qu’en l’apercevant ; j’ai des sueurs froides ! Ce n’est pas moi, c’est tout mon sang qui se révolte. Qu’y puis-je ?
Elle attendit un instant, s’essuyant les yeux du revers de la main ; puis craignant que le convoi des émigrants quittât Farnia sans emporter sa lettre pour ses véritables fils, pour ses fils bien-aimés, elle s’enhardit à nouveau et s’adressant au docteur abîmé dans ses réflexions :
– Si vous vouliez me faire la charité que vous m’avez promise…
Et comme le docteur, sortant de sa rêverie, lui disait qu’il était prêt, elle approcha sa chaise de la table et, une fois de plus, de sa voix trempée de larmes, elle recommença à dicter :
– Mes chers fils…
L’ÉTRANGER[4]
I
Cherche que tu chercheras, impossible de mettre la main sur le moindre vêtement… Pietro Milio (Don Paranza[5], comme on le surnommait dans le pays) lançait à tous les échos son juron favori : « Porco diavolo », sans y trouver le soulagement espéré. Pour mieux décharger sa bile, il s’approcha de la cloison qui séparait sa chambre de celle de sa nièce Venerina :
– Tu dors, hurla-t-il. À ton aise… Reste au lit jusqu’à midi si ça te plaît. Mais je te préviens que ton imbécile d’oncle ne te rapportera pas de poissons d’aujourd’hui…
C’était la vérité vraie… Don Paranza, ce matin-là, n’irait pas à la pêche, ainsi qu’il faisait chaque jour depuis des années. Il lui fallait – porco diavolo – s’habiller « en dimanche », comme il disait, en sa qualité de vice-consul de Suède et Norvège. Et cette Venerina, parfaitement au courant, depuis la veille, de l’arrivée d’un bateau norvégien, ne lui avait sorti ni chemise empesée, ni cravate, ni jumelles, ni redingote, rien de rien.
En fait de chemises, dans les deux tiroirs du haut de la commode, il avait trouvé des cafards que l’épouvante avait mis en fuite :
– Ne vous dérangez pas ! Ne vous dérangez pas !… Et pardon de l’indiscrétion !
Dans le dernier tiroir, une chemise, la seule et l’unique, amidonnée depuis une éternité, dont l’empois avait jauni. Don Paranza la sortit du tiroir du bout des doigts, avec toute espèce de précautions : il redoutait que les insectes des deux étages supérieurs n’y eussent élu domicile. Son regard tomba sur le col, le plastron et les poignets effilochés :
– Allons, bon ! fit-il, voilà que la barbe leur a poussé, maintenant !
Et il les frotta avec un bout de bougie pour égaliser les fils.
Il était évident que les autres chemises blanches (il ne devait pas y en avoir beaucoup !) attendaient depuis des mois dans la corbeille au linge sale les navires marchands de Suède et de Norvège.
Vice-consul de Suède et Norvège à Port-Empédocle, Don Paranza faisait, en même temps, fonction d’interprète sur les rares bateaux Scandinaves qui venaient prendre un chargement de soufre. Une chemise empesée par bateau : deux ou trois par an en tout. Ce n’était pas l’amidon qui le ruinait.
Il n’aurait pu vivre, bien entendu, des maigres revenus d’une profession aussi intermittente, sans l’appoint de sa pêche quotidienne et d’une misérable pension que lui valait sa qualité de « victime des Bourbons… » Sa stupidité ne datait pas d’hier, – il se plaisait à le répéter, – il avait toujours été idiot : il avait combattu pour le pays, pour la liberté et il s’était ruiné.
Il avait quitté Agrigente pour descendre habiter la Marine, comme on nommait alors la demi-douzaine de bicoques dressées sur la plage et contre lesquelles, les jours de siroco, les vagues venaient se briser furieusement. Il se rappelait l’époque où Port-Empédocle ne possédait que son petit môle, connu à présent sous le nom de Vieux-Môle, et la haute tour, sombre, carrée, bâtie peut-être pour défendre la côte au temps des Aragonais et où l’on enfermait les forçats.
Pietro Milio, à cette époque bénie, gagnait tout l’argent qu’il voulait. Il n’y avait pour tous les navires marchands qui relâchaient dans le port que deux interprètes : lui et cette grande perche d’Agostino di Nica, qui était toujours sur ses talons pour ramasser les miettes qu’il laissait tomber. Les capitaines au long cours, quelle que fût leur nationalité, devaient se contenter des trois mots de français qu’il leur jetait à la face, avec le plus pur accent sicilien : Mossiure, oune chosse, etc…
Ah ! s’il n’y avait pas eu la patrie, l’amour sacré de la patrie !
En réalité, la seule sottise de Don Paranza était d’avoir eu vingt ans en 1848. S’il en avait eu dix ou cinquante, il n’aurait pas gâché sa vie. Sa faute était donc bien involontaire.
Compromis, dans un complot politique, il avait, en pleine prospérité, dû s’exiler à Malte. Il avait eu, ensuite, la stupidité d’avoir trente-deux ans en 1860 : c’était la conséquence naturelle de la première. À Malte, établi à La Vallette, il s’était fait, au cours de ces douze ans, une jolie position, avec l’aide d’autres émigrés. Mais cette année 1860 ! Il frémissait encore rien que d’y repenser. À Milazzo, avec Garibaldi, pan ! il avait reçu une balle en pleine poitrine ! Et dire qu’il n’avait pas su profiter du cadeau que lui faisait ce sicaire des Bourbons : il n’en était pas mort.
Quand il revint, Port-Empédocle s’était miraculeusement agrandi aux dépens de la vieille Agrigente, allongée sur sa colline haute, à quatre milles de la mer, résignée à mourir d’une mort lente, pour la quatre ou cinquième fois, et contemplant d’un côté les ruines de l’antique cité grecque, de l’autre le port en train de naître. Milio avait trouvé là, se livrant une concurrence acharnée, une foule d’interprètes, plus savants les uns que les autres.
Agostino di Nica, demeuré seul après son départ pour Malte, s’était rempli les poches et avait bientôt abandonné la profession d’interprète pour s’adonner au commerce : un petit vapeur qu’il avait acheté faisait la navette entre Port-Empédocle et les deux îles voisines de Lampedusa et de Pantelleria.
– Agostino, et la patrie ?
Di Nica, sérieux comme un pape, donnait une tape à son gousset ; la monnaie tintait :
– Ma patrie, la voilà !
Mais l’argent ne l’avait pas changé, il faut bien l’avouer : pas plus fier qu’avant ! Son nez non plus n’avait pas changé, un nez énorme, présent gratuit de marâtre nature. Un nez, ça ? Un foc. Une voile de perroquet ! Et en guise de couvre chef, toujours la même casquette de toile, à visière de cuir. Quand on lui demandait pourquoi, riche comme il l’était, il ne s’accordait pas le luxe de porter chapeau, il répondait invariablement :
– Ce n’est pas pour le chapeau, c’est pour les conséquences du chapeau !
L’heureux homme !
– Tandis que moi, pensait Don Paranza, avec toute ma misère, il me faut passer une redingote et m’étrangler dans un faux-col dur. Je suis vice-consul !
Et tout vice-consul qu’il fût, certains jours, quand la pêche n’avait pas été bonne, il courait le risque d’aller se coucher sans dîner, ainsi que sa nièce, une pauvre orpheline qu’il avait hérité de son frère, si chanceux lui aussi, qu’à peine débarqué en Amérique, il y était mort de la fièvre jaune. Il est vrai qu’en compensation, Don Paranza avait la médaille des vétérans de 1848 et de 1860 !
La main crispée sur sa canne à pêche, l’œil fixé sur le liège, absorbé dans les souvenirs de sa longue existence, il hochait la tête, avec amertume. Il contemplait les deux jetées du nouveau port, tendues vers la mer comme deux bras démesurés, et encadrant le Vieux-Môle, minuscule, qui avait l’honneur, à cause de ses quais, de garder le siège de la capitainerie et le phare principal avec sa tour blanche.
Tout le pays se déployait sous ses yeux, depuis la tour du Rastiglio, au pied du môle, jusqu’à la gare, là-bas, tout au bout, et il lui semblait que, pareilles aux années et aux malheurs qui s’entassaient sur lui, toutes ces maisons s’étaient entassées l’une contre l’autre, l’une sur l’autre, grimpant jusqu’au bord du plateau marneux qui surplombe la plage, couronné d’un petit cimetière blanc, avec la mer devant, la campagne derrière.
La marine, illuminée par le soleil couchant, resplendissait de toute sa blancheur, tandis que la mer d’un vert sombre, d’un vert de bouteille près du rivage, s’étendait au loin, mouvante et dorée, jusqu’à l’horizon que Punta Bianca limite à l’orient et le cap Rossello à l’occident.
L’odeur de la mer sur les brisants de la jetée, l’odeur du vent saumâtre qui, souvent, le matin, quand il partait pour la pêche, l’assaillait avec furie, lui coupait le souffle, l’empêchait d’avancer, faisait battre sa veste et son pantalon autour de lui comme des étendards, l’odeur particulière que la poussière de soufre, partout répandue, donne à la sueur des hommes au travail, cuits par le soleil africain, l’odeur du goudron, l’odeur du sel, le remugle qui s’exhalait sur la plage de la fermentation des paquets d’algues sèches mêlées au sable mouillé, toutes les odeurs de ce port qui avait grandi en même temps que lui, étaient, pour Don Paranza, toutes chargées de souvenirs et, malgré son destin misérable, il songeait avec désolation que ces années, qui avaient suffi à le conduire à la vieillesse, marquaient seulement la première enfance de la ville. C’était si vrai que, chaque jour, les jeunes donnaient un nouvel essor au pays, et, trop vieux pour y participer, il restait en arrière, à l’écart, sans que nul se souciât de lui. Tous les matins, à l’aube, du haut de la rampe de Montoro, l’appel trois fois répété d’un crieur à la voix de stentor rassemblait les travailleurs sur la plage !
– Hommes de mer, au travail.
Don Paranza, tous les matins, du fond de son lit, entendait les trois appels et il se levait à son tour, mais c’était pour se rendre à la pêche, en grognant. Tout en s’habillant, il écoutait grincer les chariots chargés de soufre, les chariots sans ressorts, bardés de fer et cahotant sur la chaussée de la grand’route poussiéreuse, peuplée d’ânes étiques qui arrivent par bandes, portant un pain de soufre de chaque côté du bât. Et quand il descendait sur la plage, il voyait les spigonare, leur voile triangulaire à demi amenée contre le mât, prêtes à être emplies au-delà du bras de levant, tout le long du rivage, là où s’alignent les dépôts de soufre. Devant les tas, on installait déjà les bascules, sur lesquelles le soufre est pesé, avant d’être chargé sur les épaules des hommes de mer, protégées par un sac, posé comme un capuchon sur leur tête. Nu-pieds, en pantalon de toile, les hommes de mer, portaient leur chargement aux spigonare, enfonçant dans l’eau jusqu’à la ceinture, et les spigonare, à peine remplies, déployaient leur voile et allaient vider le soufre dans les cargos ancrés dans le port, ou plus loin. Et cela durait jusqu’au coucher du soleil, quand le siroco n’empêchait pas la manœuvre.
Et Don Paranza ? Sa ligne à la main, il trempait le fil ! Et de temps à autre, secouant avec rage sa ligne, il grommelait dans sa barbe de laine blanche, qui contrastait avec le brun de sa peau cuite au soleil et le vert de ses yeux pleins d’eau :
– Porco diavolo ! Ils ne laissent même plus de poissons dans la mer !
II
Assise sur son lit, ses cheveux noirs tout embroussaillés, les yeux gros de sommeil, Venerina ne se décidait pas encore à se lever, quand elle entendit dans l’escalier un piétinement, des souffles haletants et la voix de son oncle qui criait :
– Doucement, doucement… Nous y sommes… Elle se précipita pour ouvrir la porte, mais elle s’arrêta court, saisie de stupeur et d’effroi :
– Seigneur, qu’est-ce qui arrive ?
Gravissant l’étroit escalier, une sorte de civière approchait du seuil, soutenue avec peine par un groupe de matelots à bout de souffle, l’air consterné. Sous une grande couverture de laine, quelqu’un était étendu là.
– Mon oncle ! Mon oncle ! cria Venerina.
Mais la voix de l’oncle lui répondit de derrière le groupe des porteurs qui montaient lourdement les dernières marches.
– N’aie pas peur ! J’ai fait une bonne pêche, ce matin ! Dieu ne nous abandonne pas ! Doucement, doucement, les enfants, nous y sommes ! Entrez. Vous allez l’étendre sur mon lit !
Venerina vit, à côté de son oncle, un jeune homme d’une taille gigantesque, un étranger certainement, blond, le visage bronzé, un petit coffre sur le bras ; elle baissa les yeux sur la civière que les marins, pour reprendre haleine, avaient posée près de l’entrée, et elle demanda :
– Qui est-ce ? Que s’est-il passé ?
– C’est un poisson d’un nouveau genre, tu vas voir ! répondit don Pietro d’un ton qui fit sourire les matelots en train de s’éponger le front. Une vraie bénédiction du ciel ! Allons, les enfants, dépêchons-nous ! Là, sur mon lit.
Et il conduisit les matelots et leur triste fardeau jusqu’à sa chambre encore en désordre.
L’étranger géant, écartant tous les autres, se pencha sur la civière ; il fit glisser doucement la couverture et, sous les yeux de Venerina épouvantée, il découvrit un pauvre malade, réduit à l’état de squelette, qui élargissait de grands yeux d’un bleu si limpide, qu’on les eût dits de verre, au milieu de la tragique maigreur de son visage envahi de barbe ; puis, avec des précautions maternelles, il le souleva comme un enfant et l’étendit sur le lit.
– Sortez tous ! commanda don Pietro. Laissons-les seuls tous les deux. Soyez tranquilles, les enfants, le capitaine de l’Hammerfest ne vous oubliera pas !
La porte fermée, il reprit, s’adressant à sa nièce :
– Tu vois. Et tu disais encore que nous n’avions pas de chance ! Un bateau chaque fois qu’il meurt un pape ; mais, quand il en arrive un, il est béni. Remercions Dieu.
– Mais qui est-ce ? Est-ce qu’on peut savoir ce qui est arrivé ? redemanda Venerina.
Et Don Paranza :
– Rien ! Un matelot qui a la fièvre typhoïde ; il est à toute extrémité. Le capitaine, en voyant ma tête d’imbécile, s’est dit : « Tiens ! je vais te faire un cadeau, mon brave. » Si ce pauvre garçon était mort pendant la traversée, il aurait fini dans la gueule de quelque requin ; il a préféré arriver jusqu’à Port-Empédocle, parce qu’il savait qu’il y trouverait Pietro Milio. Il a préféré un âne à un requin. C’était son droit. J’irai, aujourd’hui même, à Agrigente, pour lui avoir un lit à l’hôpital. Je vais passer d’abord chez ta tante Rosolina. J’imagine qu’elle me fera la grâce de te tenir compagnie jusqu’à mon retour d’Agrigente. Espérons que nous en serons débarrassés ce soir. Attends… j’ai une chose à dire à ce…
Il rouvrit la porte de la chambre et adressa quelques phrases en français au jeune étranger, qui inclina plusieurs fois la tête en guise de réponse ; puis, il dit à sa nièce en s’en allant :
– Je t’en prie, ne bouge pas de ta chambre. Je vais revenir avec ta tante.
Dans la rue, les gens l’interrogeaient, et, à tous il répondait, sans même se retourner :
– Une bonne pêche, une bonne pêche : du beau travail !
La servante voulait l’empêcher d’entrer ; il pénétra quand même chez donna Rosolina. Il la trouva en chemise et jupon court, ses maigres bras nus, une serviette sur ses épaules osseuses, en train de préparer un lait de son pour se rafraîchir le teint.
– Malédiction ! glapit la vieille fille.
Et elle dissimula d’un bond, derrière un rideau, ses cinquante-quatre ans sonnés.
– Qui entre ici ? Qui a cette audace ?
– Je ferme les yeux ! Je ferme les yeux ! assura Pietro Milio. Ne craignez rien pour vos charmes !
– Tournez-vous ! commanda donna Rosolina.
Don Pietro obéit ; la porte de la chambre battit furieusement. Et ce fut à travers la porte qu’il lui conta ce qui était arrivé, en la priant de se dépêcher.
Impossible ! Une donna Rosolina ne sort pas de chez elle à pareille heure. Non, non, impossible !… C’était un cas exceptionnel ? Sans doute, sans doute, mais le malade était-il vieux ou jeune ?
– Dieu du Ciel et de la Terre, gémissait don Pietro. À votre âge, parlez-vous sérieusement ? Il n’est ni vieux ni jeune ; il est à l’agonie. Dépêchez-vous !
Il s’écoula plus d’une heure avant que donna Rosolina se décidât à prendre congé de son miroir. Elle se présenta à la fin sur son trente-et-un, pareille à une guenon endimanchée, son grand châle des Indes balayant le sol de ses franges et retenu sur la poitrine par un grand fermoir d’or incrusté à pendentifs, de grosses boucles aux oreilles, le front orné de deux accroche-cœur en virgules, tout luisants d’huile, les joues et les lèvres fardées :
– Je suis à vous ! Je suis à vous !…
Ses petits yeux porcins, aux longs cils, lançaient des regards en coulisse et réclamaient admiration et gratitude à don Pietro pour cet habillage extraordinairement rapide. (Ces yeux avaient, autrefois, réclamé beaucoup plus de don Pietro ; mais il était resté de pierre, comme son nom.)
Ils trouvèrent Venerina affolée. Le jeune étranger s’était risqué à frapper à la porte de la chambre où elle s’était enfermée ; il avait bredouillé quelque chose dans son jargon, puis il était parti.
– Patience jusqu’à ce soir ! grogna Don Paranza. Je cours à Agrigente. Mais dis un peu : le malade n’a rien demandé ?
Ils entrèrent tous les trois sur la pointe des pieds pour l’examiner. Ils restèrent près du seuil, retenant leur souffle.
Il était comme mort.
– Oh ! Seigneur Jésus ! geignait donna Rosolina. J’ai trop peur. Je rentre chez moi.
– Vous allez rester toutes les deux dans la pièce à côté, déclara don Pietro. De temps en temps, vous viendrez jusqu’à la porte voir comment il va. Si seulement il pouvait durer encore deux jours ! Mais il a l’air de tourner de l’œil ; il ne manquerait plus que ça ! Ah ! les beaux revenus que m’envoie la Norvège ! Enfin, laissez-moi m’en aller…
Donna Rosolina le saisit par le bras :
– Dites un peu : est-ce un Turc ou un chrétien ?
– Un Turc ! Un Turc ! Il ne se confesse pas ! répondit don Pietro, pour se débarrasser d’elles.
– Oh ! ma mère, un excommunié !
Et la vieille fille, faisant d’une main le signe de la croix et tendant l’autre vers Venerina pour l’entraîner, se prit à soupirer, dès qu’elle fut dans la chambre de sa nièce :
– Toujours pareil !
Elle faisait allusion à don Pietro, qui était enfin sorti.
– Toujours dans les nuages ! Ah ! s’il avait eu un peu plus de jugeote…
Donna Rosolina prenait prétexte des malheurs continuels de don Paranza pour parler, avec mille réticences et à grand renfort de soupirs, de leur mariage manqué. Et, cette fois encore, elle ne manqua pas de voir la main de Dieu levée pour châtier don Pietro de ne l’avoir pas épousée.
Venerina semblait prêter la plus grande attention aux propos de sa tante ; en réalité, elle pensait, avec un sentiment de pitié et d’effroi, au malheureux en train de mourir, seul, abandonné, loin de son pays, où une femme et des enfants l’attendaient peut-être. Elle proposa à sa tante d’entrer voir comment il allait.
Pressées l’une contre l’autre, sur la pointe des pieds, elles franchirent le seuil et tendirent la tête vers le lit.
Le malade avait les yeux fermés : on eût dit un Christ de cire, après la descente de croix. Dormait-il, ou était-il déjà mort ?
Elles s’avancèrent doucement ; au bruit, le malade entr’ouvrit les yeux, ses grands yeux bleus, au regard vague. Les deux femmes resserrèrent leur étreinte ; il souleva la main, fit mine de parler ; épouvantées, elles poussèrent un cri et coururent se réfugier dans la cuisine.
Sur le tard, entendant la clochette de la porte, elles se hâtèrent d’ouvrir ; mais ce n’était pas don Pietro. Le jeune étranger du matin se dressa devant elles. La vieille fille courut se cacher ; mais Venerina, courageusement, l’accompagna jusqu’à la chambre du malade, déjà plongée dans l’obscurité, alluma une bougie et la tendit à l’étranger, qui la remercia en inclinant la tête avec un triste sourire ; elle le contempla un instant, pleine de compassion : elle le vit se pencher sur le lit, poser doucement sa main sur le front du malade et elle l’entendit appeler avec douceur :
– Cleen… Cleen…
Était-ce son nom ou un mot d’affection ?
Le malade regardait dans les yeux son camarade, comme s’il ne le reconnaissait pas. Elle vit alors le corps gigantesque du jeune matelot brusquement soulevé de sanglots ; elle l’entendit pleurer, courbé sur le lit, et parler avec angoisse, d’une voix baignée de larmes, dans une langue inconnue. Les larmes montèrent aux yeux de Venerina. L’étranger, se tournant vers elle, lui fit signe qu’il voulait écrire. Elle inclina la tête pour montrer qu’elle avait compris et lui donna ce qu’il fallait. Quand il eut terminé, il lui remit la lettre et une petite bourse.
Venerina ne comprit pas les mots qu’il prononçait ; mais elle devina, à ses gestes et à l’expression de son visage, qu’il lui recommandait son malheureux compagnon. Elle le vit enfin se baisser à nouveau vers le lit, embrasser plusieurs fois le malade sur le front et sortir en courant, un mouchoir sur la bouche pour étouffer les sanglots qui le secouaient.
Donna Rosolina, un moment plus tard, prise de peur, passa la tête et aperçut Venerina assise, comme si de rien n’était, absorbée dans ses réflexions, les yeux pleins de larmes. Elle l’appela :
– Psstt !… Psstt !…
Et son geste voulait dire :
– Mais que fais-tu ? Tu es folle ?
Venerina lui montra la lettre et la petite bourse qu’elle tenait encore à la main et lui fit signe d’entrer. Il n’y avait pas de quoi avoir peur. Elle lui raconta, à voix basse, la scène émouvante entre les deux camarades et la pria de s’asseoir, elle aussi, pour veiller le pauvre homme qui agonisait, abandonné de tous.
Dans le silence de la nuit, tout à coup, éclata le cri d’une sirène, un cri aigu, qui n’en finissait plus, déchirant comme un cri humain.
Venerina regarda sa tante, puis le malade étendu sur son lit, environné d’ombre, et elle dit tout bas :
– Ils s’en vont… Ils lui disent adieu…
III
– Oncle Pietro, comment dit-on : bestia en français ?
Pietro Milio, qui faisait sa toilette dans la cuisine, tourna vers sa nièce un visage ruisselant :
– Pourquoi ? Tu voudrais me donner en français le nom que je mérite ? Ça se dit : bête, ma fille. Bête ! Bête ! Tu peux me le dire aussi fort que tu voudras, tu ne me le répéteras jamais assez.
Le traiter de bête, c’était trop peu. Depuis près de deux mois, il gardait chez lui et nourrissait comme un poulet de grain ce marin qui lui était tombé du ciel. À Agrigente, naturellement, impossible d’obtenir une place à l’hôpital. Comment jeter à la rue un moribond ? Il avait alors écrit au consul de Norvège à Palerme, parfaitement, au consul ! Et le consul lui avait répondu de garder chez lui et de soigner le matelot de l’Hammerfest jusqu’à sa guérison et, en cas de mort, de le faire enterrer décemment : tous ses frais lui seraient remboursés.
Quel homme de génie, ce consul ! Comme si lui, Pietro Milio, avait de quoi avancer de l’argent et héberger des malades ! Comment ? Où ? Il avait logé le marin, mais en lui cédant son lit, et il se rompait les os sur le divan démoli qui lui entrait dans les côtes ses ressorts en montagnes russes, si bien que, chaque nuit, il rêvait qu’il était étendu de tout son long sur les pics inégaux d’une chaîne de montagnes. Mais pour ce qui est des soins, pouvait-il aller chez le pharmacien, chez l’épicier, chez le boucher prendre la marchandise à crédit, en disant que la Norvège paierait ? Alors, quoi ? nourrir le typhique de bogues et de poulpes, le matin, de congres, le soir, quand il en péchait, et, si la pêche n’avait pas été bonne, le jeûne complet !
Et cependant, ce pauvre diable de Norvégien avait réussi à s’en tirer ! Il fallait qu’il fût bâti à chaux et à sable, pour résister au médecin du pays qui avait un si bon cœur et un tel amour du prochain qu’il tuait au moins un de ses concitoyens par jour. Si don Pietro gémissait de la sorte, ce n’était pas qu’au fond il détestât le malheureux étranger, non, mais, « porco diavolo ! » s’écriait-il, où trouver un homme plus déshérité et plus guignard que moi ? »
Enfin, quelques jours encore et il allait être délivré. Le Norvégien, qu’il appelait L’Arso[6] (il se nommait Lars Cleen), était entré en convalescence, et dans une semaine, deux au plus, il serait en état de se mettre en voyage.
Il était grand temps : donna Rosolina refusait de monter plus longtemps la garde auprès de sa nièce. Elle faisait remarquer qu’elle était, elle aussi, à marier et qu’il ne lui paraissait pas convenable que deux filles à marier restassent à tenir compagnie à un homme qu’elle croyait Turc et, par conséquent, hors de la grâce de Dieu. Il se levait déjà, il pouvait bouger et…, et… sait-on jamais !
Donna Rosolina n’ajoutait pas, quand elle faisait ses doléances à don Pietro, que l’attitude de Venerina envers le convalescent la choquait depuis longtemps.
Le convalescent semblait, au sortir de sa terrible maladie, retrouver une nouvelle enfance. Son sourire, le regard de ses yeux limpides, avaient une expression puérile. Il était encore d’une grande maigreur ; mais son visage s’était rasséréné, sa peau se colorait légèrement et ses cheveux, qui étaient tombés pendant sa maladie, repoussaient plus blonds et plus légers.
Venerina, à le voir si timide, comme éperdu dans la béatitude de cette résurrection en pays inconnu, au milieu d’étrangers, éprouvait pour lui une tendresse presque maternelle. Mais toute la conversation se réduisait, pour Venerina, – qui ne comprenait pas le français, et moins encore le norvégien, – à une série de variations, sur le nom du jeune homme, Cleen. S’il refusait, en plissant le nez et en détournant la tête, de prendre quelque drogue ou quelque aliment, elle prononçait ce « Cleen » d’une voix sombre, impérieuse, en fronçant les sourcils au-dessus de ses yeux sévères, comme pour dire :
– Obéis, je n’admets pas de caprices !
Si, par contre, dans un élan d’affectueuse gentillesse, la voyant passer près de lui, il la tirait par sa jupe, le visage éclairé d’un sourire de gratitude et de sympathie, Venerina prolongeait ce « Cleen » en une exclamation de stupeur et de reproche comme pour dire :
– Tu deviens fou ?
Mais cette stupeur était feinte et le reproche plein de douceur : l’un et l’autre étaient destinés à calmer les scrupules de donna Rosolina, présente à ces scènes et qui serait passée par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, si elle n’avait eu sur ses joues maigres un empan de rouge.
Venerina éprouvait, elle aussi, le sentiment d’une résurrection. Habituée à demeurer toujours seule dans cette maison pauvre et nue, sans la moindre intimité avec quiconque, sans aucun sentiment un peu vif, elle était, depuis longtemps, la proie d’un invincible ennui, d’un spleen sans issue : son cœur s’était desséché, et cette stérilité sentimentale provoquait chez elle une paresse absolue. Elle aurait été en peine de dire pourquoi, à présent, elle s’occupait si volontiers du ménage, comment elle faisait pour se lever de si bonne heure et passer son temps à se parer.
– C’est un miracle ! un vrai miracle ! s’écriait don Paranza, quand il rentrait le soir, avec ses engins de pêche, tout parfumé de mer.
Il trouvait tout en ordre, la table mise, le souper prêt.
– Un vrai miracle !
Il pénétrait dans la chambre du convalescent, en se frottant les mains :
– Bonsouarre, mossiur Cleen, bonsouarre !
– Buona sera, répondait en italien le convalescent en souriant, et en détachant, en sculptant presque, la prononciation de ces deux mots.
– Comment ! comment ! s’écriait don Pietro, étonné, en regardant alternativement Venerina, qui riait, et donna Rosolina, plus sérieuse que jamais, assise, les lèvres pincées et les paupières basses.
Peu à peu, Venerina avait réussi à enseigner à l’étranger quelques phrases en italien et un peu de nomenclature élémentaire. Son procédé était des plus simples : elle lui indiquait un objet dans la chambre et l’obligeait à en répéter le nom jusqu’à ce que la prononciation fût correcte : bicchiere, letto, seggiola, finestra.
Quels éclats de rire quand il se trompait ; et le rire redoublait, si elle s’apercevait que sa tante, raidie dans sa sévérité pudibonde, serrait les lèvres pour ne pas céder à la contagion de ce rire, surtout quand le malade accompagnait de gestes comiques les mots détachés, télégraphiant en signaux à bras les parties essentielles de la phrase qui lui faisaient défaut. Mais bientôt, il fut capable de dire : « Ouvrir, fermer fenêtre, prendre verre » et même : « Je veux aller au lit. » Mais ce « je veux » une fois appris, il ne tarda pas à en faire un usage extrêmement fréquent, et l’application qu’il apportait à le prononcer donnait au mot quelque chose de plus impératif. Venerina en riait, mais elle pensa atténuer ce ton catégorique en apprenant au malade à faire suivre, chaque fois, « je veux », de « je vous prie ». Mais il ne parvenait pas à prononcer correctement ce « je vous prie », et, quand il voulait quelque chose, il attendait que Venerina se tournât vers lui, et, joignant alors ses mains dans un joli geste de prière, il lançait son « je veux » avec une force et une brièveté plus impérieuses que jamais. Le geste de prière était absolument nécessaire chaque fois qu’il voulait obtenir la petite boîte que son camarade avait apportée du bateau, le jour où il en avait été débarqué moribond. Venerina la lui tendait chaque fois de mauvais gré et sans rien de sa gentillesse habituelle. Cette boîte représentait pour lui la patrie lointaine : elle contenait tous ses souvenirs, des lettres, quelques portraits. Venerina l’épiait d’un regard oblique, tandis qu’il relisait quelques-unes de ses lettres ou qu’il demeurait distrait, les yeux pleins de rêve ; et il lui apparaissait soudain sous un autre aspect, comme absorbé par une autre atmosphère qui l’éloignait d’elle. Elle remarquait alors mille particularités de la race du marin, qu’elle n’avait pas, jusque-là, observées. Cette boîte, dans laquelle il fouillait avec tant d’insistance, lui évoquait l’image de l’autre marin, du géant qui l’avait soulevé de la civière comme une plume, l’avait déposé sur le lit et s’en était allé en pleurant. Elle qui avait si bien soigné le malheureux abandonné ! Qui était-il, après tout ? D’où venait-il ? Quels souvenirs conservait-il avec tant d’amour dans cette boîte ? Venerina haussait les épaules avec rage, elle se disait :
– Qu’est-ce que ça peut bien me faire ?
Et elle le laissait seul dans sa chambre à se repaître de ses souvenirs secrets, entraînant sa tante, qui la suivait, tout étourdie de cette résolution soudaine :
– Qu’est-ce qu’il y a donc ?
– Il n’y a rien. Allons-nous en !
Venerina retombait alors, du coup, dans son ennui et sa paresse. Une rage sourde l’emplissait d’amertume, ou bien c’était un flot de désirs vagues qui l’accablait ; de nouveau, la maison lui paraissait vide et la vie aussi, elle se révoltait :
– Je ne veux rien faire, plus rien !
IV
Lars Cleen, dès qu’il était seul, avait la sensation d’être tombé dans un autre monde, plus lumineux, dont il ne connaissait que trois habitants et une maison, non, pas même toute une maison, rien qu’une chambre à coucher. Il ne comprenait goutte à la mauvaise humeur de Venerina. Il ne se rendait, d’ailleurs, compte de rien. Il tendait l’oreille aux bruits de la rue, il écoutait ; mais aucune sensation du dehors ne parvenait à éveiller en lui une image précise. La cloche… oui ; mais c’était une église de son pays qu’elle évoquait. Un meuglement de sirène, et il voyait Hammerfest, perdu dans des mers boréales. Et quelle impression, un soir, dans le silence, lui avait faite la lune apparue dans le cadre de la fenêtre ! Et, pourtant, c’était bien la même lune que, si souvent, dans son pays ou sur mer, il avait contemplée ; mais ici, dans ce pays inconnu, elle lui semblait s’adresser aux toits des maisons, au clocher de l’église, dans un langage de lumière tout différent, et plus il la considérait, plus son angoisse augmentait, plus il se sentait seul et abandonné.
Il vivait dans le vague, dans l’indéterminé, comme dans une sphère vaporeuse de rêves. Un jour, enfin, il s’aperçut que, sur le couvercle de la boîte, trois mots à la craie étaient inscrits : Bet ! Bet ! Bet. Il demanda, d’un geste, à Venerina, ce que cela signifiait, et Venerina, alors :
– Toi, bête !
Lars Cleen fixa sur elle ses yeux clairs, rieurs et stupéfaits. Il ne comprenait pas, ou, plutôt, il n’osait pas croire que… Non non ; et, de ses deux mains jointes, il lui demandait d’avoir pitié de lui qui devait partir d’ici peu. Venerina haussa les épaules et fit de la main un geste d’adieu :
– Bon voyage !
– Non, non, fit de la tête Cleen.
Et il lui fit signe d’approcher : il ouvrit la boîte et en retira une photographie de Trondhjem. Elle représentait, au milieu des arbres, la majestueuse cathédrale de marbre qui domine le reste de la ville, et à côté de l’église, le cimetière où les fidèles vont, chaque samedi, orner de fleurs les tombes de leurs morts.
Elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi il lui montrait cette photographie.
– Ma mère, ici, s’épuisait à répéter Cleen en lui montrant du doigt le cimetière à l’ombre du temple magnifique.
Il était comme don Pietro : il ne savait pas très bien le français, dont, au surplus, Venerina ne comprenait pas un traître mot. Il tira de la boîte une autre photographie : c’était le portrait d’une jeune femme. Venerina pâlit en la regardant. Mais Cleen approcha le portrait de son visage pour faire voir que la jeune femme lui ressemblait.
– Ma sœur, ajouta-t-il.
Cette fois, Venerina comprit, et sa figure s’éclaira. Mais cette jeune femme n’était-elle pas la fiancée ou la femme du jeune matelot qui avait apporté la boîte ? Venerina ne se posa pas longtemps la question. Il lui suffisait de savoir que L’Arso n’était pas marié. Mais n’allait-il pas repartir d’ici quelques jours ? Il était déjà capable de sortir de la maison et d’aller à pied, au coucher du soleil, jusqu’au Vieux Môle.
Une troupe de gamins, sans souliers, haillonneux, certains nus comme des vers, rôtis par le soleil, suivaient, chaque fois, Lars Cleen dans ses promenades : ils l’épiaient, échangeant à haute voix des remarques et des commentaires qui ne tardaient pas à se changer en moqueries et en huées.
Lars Cleen, tout étourdi, ébloui par cet air, grillé par la lumière, se tournait tantôt vers un des gamins, tantôt vers un autre, en souriant ; parfois il était obligé de menacer de sa canne les plus insolents ; puis, il s’asseyait sur le parapet du quai et contemplait les bâtiments à l’ancre, ou bien la vaste mer, doucement agitée, enflammée par le reflet des nuées du couchant. Les gens s’arrêtaient pour le dévisager, mais lui ne bougeait pas, comme égaré, perdu dans une extase : on le regardait comme on regarde une grue ou une cigogne, fatiguée et perdue, tombée du ciel. Sa toque de fourrure, son visage pâle, la blondeur extrême de sa barbe et de ses cheveux, attiraient surtout la curiosité. À la fin, cette curiosité l’excédait et il rentrait tout triste chez don Pietro.
La lettre que son camarade lui avait laissée, en même temps que la petite bourse, l’informait que l’Hammerfest, après un voyage en Amérique ferait escale de nouveau à Port-Empédocle dans les six mois. Trois mois avaient déjà passé. Il aurait certainement beaucoup aimé rembarquer sur le même bateau, retrouver ses camarades ; mais comment rester trois mois de plus, sans aucune raison, dans la demeure de ses hôtes ? Milio avait déjà écrit au consul de Palerme pour obtenir son rapatriement gratuit. Que faire ? Partir ou attendre ? Il résolut de demander conseil à Milio lui-même, un de ces soirs, quand il rentrerait de la pêche aux congres.
Venerina assista, après souper, à ce dialogue, qui faisait semblant d’être en français, entre son oncle et l’étranger. Plutôt qu’un dialogue, on eût dit une altercation, tant les gestes des deux hommes répétés avec une sorte d’exaspération, prenaient de violence. Venerina, intriguée d’abord, consternée ensuite, devint rouge comme braise quand elle vit son oncle la montrer du doigt avec rage. Qu’arrivait-il ? On parlait d’elle ? Qu’en disait-on ? La honte, l’anxiété, le dépit, l’agitaient à tel point qu’à peine Cleen sorti, elle se jeta sur son oncle :
– Qu’est-ce que vous disiez de moi ?
– De toi ? Mais rien, répondit don Pietro, rouge et suant, après cette terrible fatigue.
– Ce n’est pas vrai. Vous avez parlé de moi. J’ai très bien compris. Et tu t’es mis en colère !
Don Pietro ne comprenait pas encore.
– Que t’a-t-il dit ? Qu’a-t-il inventé ? reprit Venerina, de plus en plus enflammée. Il veut s’en aller ? Eh bien ! laisse-le partir ! Ça m’est bien égal, tu sais, tout à fait égal !
Don Paranza regarda un long moment encore sa nièce, abasourdi, la bouche entr’ouverte.
– Tu es folle ? Ou c’est moi ?…
Mais, brusquement, il commença à tourner dans la pièce comme s’il cherchait une issue et, levant les bras au ciel :
– Quel âne bâté ! criait-il. Quel imbécile ! Ah ! l’âne que je suis ! À soixante-huit ans ! Ah ! ma mère ! ma mère !
Il se tourna soudain vers Venerina, les mains dans les cheveux :
– Écoute un peu, c’était pour lui dire en français que j’étais une bête, que tu m’as demandé comment ça se disait.
– Mais pas du tout… Que vas-tu imaginer ? Don Pietro, la tête dans les mains, parcourait la pièce de long en large.
– Je suis une vieille bête, un âne bâté ! Mais ta guenon de tante, que faisait-elle ici ? Elle dormait ? Porco diavolo ! Et toi ?… Et cette espèce de… ? Attends un peu, je vais te le vider en cinq sec…
Et il s’élança vers la porte de la chambre où Cleen s’était enfermé. Venerina lui barra la route :
– Non, mon oncle, que veux-tu faire ? Je te jure qu’il ne sait rien ! Je te jure qu’entre lui et moi, il n’y a jamais rien eu ! Tu n’as pas compris qu’il veut s’en aller ?
Don Pietro restait de plus en plus interdit. Il comprenait de moins en moins.
– Qui donc ? Lui ? Il veut s’en aller ? Qui t’a dit ça ? C’est tout le contraire. Il ne veut pas s’en aller. Il me prend sérieusement pour une bête. Mais je vais m’en débarrasser, et sans tarder…
Venerina le retint encore et, cette fois, elle cacha sa tête contre son épaule et éclata en sanglots. Don Paranza sentait ses jambes se dérober sous lui. De sa main libre, il esquissa le signe de la croix.
– Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soupira-t-il. Viens par ici, ma fille, viens par ici. Allons dans ta chambre et raisonnons avec calme. J’y perds mon latin, moi.
Il l’entraîna dans la pièce voisine, la fit asseoir, lui tendit son propre mouchoir pour qu’elle essuyât ses yeux et commença à l’interroger paternellement.
Pendant ce temps, Lars Cleen, qui avait entendu de sa chambre la discussion entre l’oncle et la nièce sans y rien comprendre, ouvrait tout doucement la porte et glissait sa tête pour regarder, sa lampe à la main, dans la salle déserte. Que s’était-il passé ? Il entendait les sanglots de Venerina, de l’autre côté de la cloison, et il en était profondément troublé. Pourquoi cette dispute ? Pourquoi pleurait-elle de la sorte ? Milio lui avait dit qu’il ne pouvait plus continuer à l’héberger : la place faisait défaut ; la tante, cette vieille folle, en avait assez de rester là, et la nièce ne pouvait rester seule à la maison en compagnie d’un étranger. Il ne parvenait pas bien à comprendre en quoi consistaient au juste ces difficultés. Mais, chaque fois qu’il sortait en ville, tant de choses lui semblaient étranges dans ce pays… Ce qui était sûr, c’est qu’il allait être obligé de partir sans attendre son bateau. Et il y perdrait sa place de timonier. Partir ! Était-ce son départ qui faisait pleurer sa jeune infirmière ?
Tard dans la nuit, Lars Cleen, assis sur son lit, continuait à réfléchir, à rêver. Il lui semblait voir sa sœur : il la voyait. Elle seule au monde l’aimait. Et cette jeune fille, elle aussi, à présent… Était-ce possible ?
– Cette jeune fille ? Et tu voudrais ?
Pourquoi pas ! Chaque fois qu’il rentrait en Norvège, sa sœur lui répétait qu’elle consentirait à ne plus le revoir de sa vie pourvu qu’elle sût que, dans un de ses lointains voyages, il avait rencontré une brave fille et l’avait épousée. Elle souffrait de le voir sans désir, résigné à tout, s’abandonnant au destin, exposé à toutes les aventures, prêt aux plus dangereuses, sans aucune espèce d’affection pour lui-même, au point qu’une fois, sur l’Océan, pendant une tempête, il s’était jeté du haut de l’Hammerfest pour sauver un de ses camarades. Il n’y avait eu, en vérité, aucun mérite : il n’attachait aucun prix à la vie.
Et maintenant… Était-ce possible ? Ce village au bord de la mer, en Sicile, si loin de son pays natal, était-il donc le but assigné par le sort à sa vie ? Était-il arrivé, sans le soupçonner, au lieu de sa destinée ? Était-ce pour cela qu’il était tombé malade et avait cheminé jusqu’au seuil de la mort ? Pour reprendre le cours d’une existence nouvelle ? Qui sait ?
– Et toi, l’aimes-tu ? avait fini par demander don Pietro à Venerina, après lui avoir arraché les quelques renseignements qu’elle possédait sur l’étranger et l’aveu de ces naïfs passe-temps d’où était né un amour resté jusque-là inconscient.
Venerina cachait son visage dans ses mains.
– L’aimes-tu ? répétait don Pietro. C’est donc si difficile de dire : oui ?
– Je ne sais pas, répondait Venerina entre deux sanglots.
– Et moi, je sais, grommela don Paranza en se levant. Va au lit tout de suite et tâche de dormir. Demain, nous aviserons… Mais tu me fais faire un drôle de métier !
Et, secouant sa tête crépue, il s’étendit sur le divan défoncé.
Demeurée seule, Venerina, le visage en feu, les yeux étincelants, se prit à sourire ; puis, cachant de nouveau son visage dans ses mains, elle se jeta sur son lit tout habillée.
Venerina avait dit vrai : elle ignorait si elle aimait ou non. Mais elle étreignait et embrassait son oreiller. Étourdie par cette scène imprévue que son amour-propre avait provoquée par simple malentendu, elle ne réussissait ni à voir clair en elle-même, ni à bien définir ce qui s’était passé. Un brûlant sentiment de honte l’empêchait de se réjouir de l’explication qu’elle venait d’avoir avec son oncle, explication désirée peut-être inconsciemment par son cœur, après ces mois où elle était restée comme suspendue à une idée, à un sentiment, qui ne parvenaient pas à coïncider avec la réalité, à s’affirmer de façon ou d’autre. Certes, si Cleen partait, elle souffrirait beaucoup ; elle éprouvait de l’horreur pour l’ennui mortel où elle s’enliserait à nouveau, seule dans la maison vide et silencieuse ; aussi se réjouissait-elle que son oncle fût, à présent, avec elle, occupé à chercher les moyens de vaincre, si c’était possible, toutes les difficultés qui avaient, jusque-là, tenu en suspens son sentiment.
Mais ces difficultés pouvaient-elles être vaincues ? Cleen, tout proche qu’il fût, lui semblait si loin, si loin d’elle ! Il parlait une langue qu’elle ne comprenait pas ; il avait dans le cœur, dans les yeux, un monde qu’elle ne pouvait même pas soupçonner. Comment le retenir en Sicile ? Était-ce possible ? Et pouvait-il vraiment avoir l’intention de passer toute sa vie, pour l’amour d’elle, hors de son milieu naturel ? Il avait voulu rester, mais c’était seulement jusqu’au retour de son bateau. Aucune affection un peu vive ne l’attirait, c’était certain, dans son pays ; sinon, à peine guéri, il n’aurait pensé qu’à se faire rapatrier au plus vite. S’il désirait attendre, c’est qu’il éprouvait peut-être le même sentiment pour elle qu’elle pour lui, un sentiment imprécis et comme perdu dans l’incertitude de la destinée.
Des pensées d’un autre genre assiégeaient don Pietro sur son divan. Les ressorts gémissaient et don Paranza grognait :
– Quels fous ! Comment ont-ils fait pour s’entendre ? Elle ne sait pas un mot de sa langue, et lui pas un mot d’italien. Et, pourtant, ils se sont compris. Miracles de la folie ! Ils s’aiment, ils s’aiment, sans penser que les poulpes, les bogues et les congres de cet imbécile d’oncle ne peuvent prendre la responsabilité et les frais d’une noce et d’un nouveau ménage… Enfin… Si Di Nica voulait accepter… On verra demain… Dormons !
Agostino di Nica faisait des affaires d’or avec son petit vapeur. Et il avait eu l’idée d’agrandir son commerce jusqu’à Tunis et l’île de Malte. Il avait donc commandé à l’arsenal de Palerme un autre vapeur, un peu plus grand, et qui pouvait prendre quelques passagers.
– Peut-être, réfléchissait don Pietro, un homme comme L’Arso pourra-t-il lui être utile. Il sait le français mieux que moi et il parle très bien l’anglais. C’est, par-dessus le marché, un vrai loup de mer. Qu’il l’embarque, comme interprète ou comme matelot, qu’il lui donne de quoi vivre et nourrir décemment sa famille, et tout ira bien. Venerina, lui apprendra à parler chrétien. Son enseignement fait des miracles… Mais, en attendant, je ne peux plus les laisser seuls ensemble. Demain, je l’amène avec moi chez di Nica, et, si ma proposition est acceptée, il restera, s’il le veut, mais en me suivant chaque jour à la pêche ; s’il n’est pas embauché, il faudra qu’il parte tout de suite, sans rémission. Pour l’instant, dormons.
Mais impossible de fermer l’œil. Les pointes des ressorts semblaient plus pointues, cette nuit-là, comme hérissées de toutes les difficultés au milieu desquelles don Paranza se débattait.
V
Depuis quinze jours environ, Lars Cleen accompagnait Milio à la pêche, matin et soir : ils quittaient la maison et y rentraient ensemble.
Di Nica, non sans beaucoup de si et de mais, avait accepté la proposition que Milio lui présentait comme une véritable fortune pour lui. (Oui, mais les conséquences ?) Le vapeur neuf devait être prêt dans un mois au plus et Cleen s’y embarquer comme interprète, à l’essai pour un mois.
Venerina avait bien répété à son oncle que Cleen ne s’était pas encore clairement expliqué, et elle lui avait recommandé d’agir avec la plus grande délicatesse, en le poussant avec toute la prudence possible à parler, à se déclarer. Le pauvre don Paranza, plus embarrassé que jamais, s’était d’abord rendu seul chez di Nica et, la place obtenue, il était rentré à la maison l’offrir à Cleen, ajoutant, dans son français barbare, que, s’il voulait attendre comme il lui en avait exprimé le désir, le retour de l’Hammerfest, il fallait travailler. Il lui avait trouvé une situation ; quand le bateau norvégien reviendrait d’Amérique, il se trouverait à la tête de deux places et il pourrait choisir l’une ou l’autre, à sa convenance. En attendant de travailler, il fallait le suivre chaque jour à la pêche.
Cette proposition avait plongé Cleen dans la confusion et la perplexité. Il était clair que la scène entre l’oncle et la nièce avait éclaté au sujet de son départ prochain et qu’il était la cause des pleurs de sa chère infirmière. Accepter, c’était donc se compromettre définitivement. Mais, comment refuser cette offre, après tous les soins, toutes les gentillesses dont elle l’avait comblé ? Et, d’ailleurs, cette offre était telle qu’elle ne le liait en rien, qu’elle le laissait libre de choisir, libre de montrer ou non sa reconnaissance pour ce qu’elle avait fait pour lui.
Chaque matin, à présent, en quittant son divan, les reins brisés, don Pietro s’exhortait de la sorte :
– Courage, don Paranza, pour ta double pêche ! Et il préparait le nécessaire : les deux gaules avec les lignes, une pour lui, l’autre pour L’Arso, la boîte d’appâts, les hameçons de rechange : rien ne manquait pour la pêche aux poissons. Mais pour la pêche au mari, où trouver ce qu’il fallait ? Où trouver l’hameçon qui ouvrirait la bouche au fiancé et l’obligerait à se déclarer ?
Il s’arrêtait un instant au milieu de sa chambre, les dents serrées, les yeux écarquillés ; puis, levant les bras au ciel, il s’écriait :
– Des hameçons français ?
Le comble, c’est qu’il devait s’adresser à Cleen en français, alors que même en sicilien il ne s’en serait pas sorti :
– Monsiurre, ma nièsse…
Que dire après ? Comment lui servir tout cru que cette sotte s’était amourachée de lui ?
La Norvège ou le consul de Palerme le défraieraient très probablement de ses dépenses ; mais qui le dédommagerait de ce nouveau malheur ?
– C’est à lui de me dédommager, porco diavolo. Il a mis le feu chez moi. Qu’il s’y brûle, qu’il y rôtisse !
Cet air de sainte nitouche, d’innocent tombé du ciel, il allait le lui faire passer ! Et tout en appâtant ses hameçons sur la jetée, don Paranza se tournait vers L’Arso, assis sur un rocher voisin, la taille bien droite, ses yeux clairs fixés sur le bouchon qui flottait sur l’azur profond de l’eau miroitante.
– Ohé, Mossiur Cleen ! Ohé !
Le Norvégien ne quittait pas son bouchon des yeux ; mais le voyait-il, seulement ? Il semblait pétrifié.
Cleen, à ce cri, sursautait, tiré de son rêve ; il souriait, retirait doucement sa ligne de l’eau, croyant que Milio lui reprochait sa négligence, et il rechargeait à son tour les hameçons depuis longtemps désarmés.
Comment pêcher sérieusement dans ces conditions ? Don Paranza, lui-même, perdu dans ses pensées, ruminant la meilleure façon d’entrer en matière, laissait les poissons dévorer l’appât ; il en oubliait son bouchon, il en oubliait la mer, et pour le rappeler à lui, il fallait le bruyant ressac d’une vague plus forte sur les écueils voisins. Furieux, il remontait sa ligne, et l’envie le prenait d’en fustiger la face de l’ingrat. Mais ce qui le mettait le plus en colère, c’était d’entendre Cleen répéter en souriant le juron qu’il avait appris de lui, en redressant sa canne à pêche :
– Porco diavolo !
Don Paranza oubliait, à ces moments-là, de parler français, et il s’exclamait :
– Mais moi, porco diavolo, je le dis sérieusement ! Toi, tu plaisantes, imbécile ! Tu t’en moques bien.
Cela ne pouvait durer. Il n’arrivait à rien et il se faisait une bile d’encre :
– Qu’ils se débrouillent ensemble, s’ils veulent. Il le déclara tout net, un soir, à sa nièce, en rentrant de la pêche.
Il ne s’attendait pas à l’éclat de rire dont Venerina accueillit l’aveu rageur de son impuissance. Son visage rayonnait :
– Pauvre oncle !
– Tu ris ?
– Mais oui !
– Tu es arrivée à tes fins ?
Venerina cacha son visage dans ses mains, en faisant signe que oui. Don Paranza, très content au fond, allégé de son fardeau au moment où il s’y attendait le moins, fit semblant de se mettre en colère :
– Comment ! Et tu ne m’en disais rien ! Tu me laisses à la torture ! Et lui aussi, il reste muet comme un poisson !
Venerina baissa les mains ; son visage réapparut :
– Il n’a rien su te dire ?… Même aujourd’hui ?
– Muet comme une carpe, je te dis, comme une morue sèche ! J’ai le foie gonflé de bile, tant je me suis fait de souci tous ces jours.
– Il a dû avoir honte…, fit Venerina, cherchant à l’excuser.
– Avoir honte, un homme ! cria don Pietro. Il a fait rire à mes dépens tous les poissons de la mer ! Où est-il ? Appelle-le ; qu’il me parle ce soir-même : il ne suffit pas qu’il t’ait dit à toi ce qu’il devait.
– Alors, ne fais pas les gros yeux, lui recommanda Venerina en souriant.
Don Paranza s’apaisa et, secouant sa tête crépue, grommela dans sa barbe :
– Je suis une grosse… Tu le sais mieux que moi. Dis-moi un peu comment tu as fait, sans savoir le français…
Venerina rougit, haussa à peine les épaules, et ses yeux noirs étincelèrent.
– J’ai fait comme j’ai su, fit-elle avec une malice naïve.
– Et quand cela ?
– Aujourd’hui même, quand vous êtes rentrés, a midi, après le déjeuner. Il m’a pris la main… Moi, je…
– Ça va ! Ça va ! grogna don Paranza, qui n’avait jamais été amoureux de sa vie. Le dîner est prêt ? Je vais lui parler.
Venerina le supplia des yeux de ne pas s’emporter et se sauva. Don Pietro pénétra dans la chambre de Cleen.
Cleen, le front appuyé aux vitres du balcon, regardait dehors, mais sans rien voir. La petite place devant la maison était déserte et sombre. Les réverbères à pétrole n’avaient pas été allumés ; la lune, seule, était chargée, ce soir-là, de l’éclairage du bourg. En entendant la porte s’ouvrir, Cleen sursauta. Qui sait à quoi il rêvait !
Don Paranza se campa au milieu de la chambre, en hochant la tête : il aurait voulu lui faire un sermon de vieil oncle grognon, mais il sentit la difficulté d’un sermon en français assorti à l’air bourru qu’il venait de prendre, et, réfrénant, non sans effort, son impatience, il commença ainsi :
– Mossiur Cleen, ma nièsse m’a dit…
Cleen sourit timidement, l’air égaré, et fit plusieurs fois : oui, de la tête.
– Oui ? reprit don Paranza. Ça va bien.
Il allongea ses deux index et, les joignant à plusieurs reprises par le bout pour exprimer l’union de deux époux :
– Vous et ma nièsse…, mariage…, oui ?
– Si vous voulez !… répondit Cleen en ouvrant les mains, comme s’il n’était pas bien sûr de l’acceptation de Milio.
– Oh ! pour moi ! fit don Pietro en italien.
Il se reprit aussitôt :
– Très heureux, mossiur Cleen, très heureux. C’est fait. Donnez-moi la main…
Ils se serrèrent la main. Ainsi fut conclu le mariage. Mais Cleen en restait étourdi. Il souriait d’un sourire timide, tout embarrassé par l’étrange situation où il s’était mis sans le vouloir bien nettement. Certes, cette Sicilienne brune lui plaisait ; il aimait sa vivacité, ses yeux de soleil ; il lui était très reconnaissant de ses soins affectueux ; il lui devait la vie, oui, mais… la prendre pour femme, vraiment, si vite !
– Maintenant, reprit don Paranza dans son français, je vous prie, mossiur Cleen : cherchez, cherchez d’apprendre notre langue… Je vous prie…
Venerina frappait à la porte :
– À table !
Ce premier soir, à table, ils éprouvèrent tous les trois un grand embarras. Cleen semblait tomber des nues ; Venerina, le visage en feu, honteuse de son audace, n’osait regarder ni son fiancé ni son oncle. Ses yeux se brouillaient quand ils rencontraient ceux de Cleen, et s’abaissaient aussitôt. Elle souriait pour répondre au sourire de son fiancé, aussi embarrassé qu’elle ; mais il lui venait une envie folle de quitter la table, de s’enfermer dans sa chambre et de se jeter sur son lit pour pleurer à l’aise. Pleurer tout son soûl, sans savoir pourquoi.
– Si ces deux-là ne sont pas fous, c’est que la folie a disparu de cette terre, pensait de son côte don Paranza, les sourcils froncés, sur des charbons ardents, lui aussi.
Et il avalait avec effort le maigre souper.
Mais, le repas fini, Cleen, non sans quelque hésitation, le pria de transmettre à Venerina un gentil compliment qu’il ne pouvait lui faire lui-même ; puis, ce fut Venerina qui le chargea de traduire son remerciement et d’ajouter…
– Quoi ? demanda don Paranza, écarquillant les yeux.
Et comme, après ce premier échange de phrases, la conversation entre les deux fiancés cherchait à continuer par son intermédiaire, il donna soudain du poing sur la table :
– Qu’est-ce que c’est que ce métier-là !… Débrouillez-vous tout seuls !
Il se leva au milieu des rires des deux jeunes gens, et s’installa, pour fumer sa pipe, sur le divan, non sans grogner, dans sa barbe laineuse, son éternel : « Porco diavolo ! »
VI
C’était la dernière nuit de mai. Le petit vapeur de Di Nica rentrait de son troisième voyage à Tunis. Encore une heure, ce serait l’aube, et le bateau aborderait au Vieux-Môle. À bord, tout le monde dormait, sauf le timonier, à la poupe, et le second, de quart sur la passerelle de commandement.
Cleen avait quitté sa couchette et, depuis un gros moment, sur la dunette, il contemplait la lune déclinante entre les cordages, que les secousses rythmées de la machine faisaient vibrer. Il éprouvait une sensation d’étouffement sur cette coquille de noix, sur cette mer close, et même…, oui, même la lune, dans l’éloignement de son exil, lui semblait rapetissée… Comme elle était plus grande, sur l’océan, quand elle apparaissait entre les cordages de l’Hammerfest ! Un de ses camarades était peut-être, à cette heure, en train de la contempler. De tout son cœur, il était près de ses anciens compagnons. Qui était de garde, en ce moment, sur l’Hammerfest ? Il fermait les yeux et revoyait, l’un après l’autre, tous ses camarades ; il les voyait surgir des écoutilles ; il revoyait son cher cargo, comme s’il y était encore, blanc d’écume, majestueux et bondissant. Il entendait la cloche du bord ; il respirait l’odeur particulière de sa couchette ; il s’y étendait pour réfléchir, pour rêver. Il rouvrait les yeux, et ce n’était pas ce qu’il venait de voir à travers sa mémoire et son imagination qui lui semblait un songe, c’était cette mer-là, ce ciel, ce petit vapeur, sa vie présente. Et une tristesse profonde s’abattait sur lui jusqu’à l’accablement. Ses nouveaux camarades ne l’aimaient pas, ne le comprenaient pas, ne voulaient pas le comprendre ; ils se moquaient de sa prononciation, quand il usait des quatre mots d’italien qu’il avait déjà réussi à apprendre, et, pour ne pas envenimer les choses, il se contraignait à dominer sa colère, à sourire de ces railleries stupides et vulgaires. Il fallait espérer qu’avec le temps, cela passerait. Peu à peu, avec l’aide de Venerina, et grâce à une pratique quotidienne, il finirait par parler correctement. Il n’y avait plus rien à faire : ce bourg, en Sicile, ce rafiot et cette mer, pour toute la vie, c’était son lot.
Égaré comme il l’était encore dans sa nouvelle existence, il ne parvenait à rien imaginer de précis pour l’avenir. L’arbre peut-il s’étendre dans l’air si ses racines ne sont pas déjà nombreuses et bien fixées dans la terre ? Mais ce qui était certain, c’est que le destin l’avait transplanté là pour toujours.
L’Hammerfest, qui devait revenir d’Amérique au bout de six mois, n’était pas revenu. Sa sœur, à qui il avait écrit pour lui donner des détails sur sa maladie et lui annoncer ses fiançailles, lui avait répondu de Trondhjem une longue lettre, pleine à la fois, d’inquiétude et de joyeuse stupeur ; elle l’informait que l’Hammerfest avait reçu un contre-ordre à New-York et avait été frété pour un voyage aux Indes, à ce que lui avait écrit son mari… Qui sait, donc, s’il reverrait jamais l’Hammerfest ? Et sa sœur ?
Il se secoua pour se soustraire à la tristesse de ces réflexions. Le jour s’était levé. Les étoiles s’effaçaient dans le ciel gris, la lune pâlissait de minute en minute. Et là-bas, encore allumé, il y avait le feu vert du Vieux-Môle.
Don Paranza et Venerina attendaient sur le quai l’arrivée du vapeur. Pendant les deux jours que passait Cleen à Port-Empédocle, don Pietro n’allait pas à la pêche ; il restait à surveiller les fiancés… Cette mijaurée de donna Rosolina avait refusé cette mission pour deux motifs : primo, parce qu’elle était, elle aussi, à marier, et que sa pudeur aurait pu être offusquée du spectacle ; secundo, parce que le Norvégien lui faisait peur.
– Vous avez peur qu’il vous mange ? lui criait don Paranza. Il n’aime pas les os, tranquillisez-vous.
Donna Rosolina ne se tranquillisait pas. Et elle n’avait rien voulu donner, à l’occasion des fiançailles, pas même une petite bague, elle qui en possédait des douzaines, pour témoigner son affection à sa nièce.
– Plus tard ! Plus tard ! disait-elle.
Un jour ou l’autre, par force, Venerina hériterait de tout ce qu’elle possédait : sa maison, la propriété au pied du Mont Cioccafa, les bijoux, le mobilier, et aussi les huit couvertures de laine qu’elle avait tricotées de ses mains, dans l’espoir, encore tenace, d’y étouffer de chaleur un infortuné mari.
Don Paranza s’indignait de cette avarice ; mais il ne voulait pas que Venerina manquât de respect à sa tante.
– C’est la sœur de ta mère ! Je m’en irai avant elle, c’est dans l’ordre de la nature, et tu n’as rien à attendre de moi. Elle seule te restera, il ne faut pas te fâcher avec elle. Tu lui feras faire un brin de cour par ton mari, ça ne nuira pas. D’ailleurs, dans la mesure où le Bon Dieu peut s’intéresser à un imbécile comme moi, tu verras qu’il viendra à notre aide.
En fait, les quatre sous promis par le consulat de Norvège pour l’entretien de Cleen finirent par arriver, et il fut possible de louer une maisonnette, d’acheter quelques meubles modestes, le mobilier indispensable au jeune ménage. Les papiers de Cleen arrivèrent aussi de Trondhjem.
Venerina, ce matin-là, bouillait d’impatience et de joie ; elle voulait montrer à son fiancé leur maisonnette complètement aménagée. Mais quand le vapeur fut amarré au môle et que Cleen put débarquer, sa joie se changea en une brusque colère, en entendant le salut que les autres matelots adressaient, en miaulant ou presque, à son fiancé :
– Bon tchon, bon tchon[7].
– Imbéciles ! marmonnait-elle entre ses dents. Et elle les foudroyait du regard.
Cleen souriait ; ce sourire accrut l’irritation de Venerina.
– Tu n’es donc pas capable de casser la figure à un de ces idiots ? Ils se moquent de toi et tu souris ?
– Allons ! Allons ! fit don Paranza, tu ne vois pas qu’ils plaisantent, entre camarades ?
– Je ne veux pas, répondit Venerina. Qu’ils plaisantent entre eux, mais pas avec un étranger qui ne peut leur répondre sur le même ton.
Elle avait l’impression qu’on se moquait d’elle. Cleen la contemplait ; les regards furieux de Venerina lui semblaient une marque de son amour pour lui ; cette colère lui faisait plaisir. Mais, chaque fois qu’il voulait lui exprimer ce qu’il sentait, ou lui confier quelque chose, il avait la sensation de se heurter à un mur ; il se taisait, alors, et souriait, sans comprendre que cette bonté souriante, dans certains cas, ne pouvait plaire à Venerina.
Était-ce sa faute si ces gens étaient grossiers ? S’il ne pouvait sortir dans les rues sans avoir une troupe de polissons à ses trousses ? S’il les menaçait, c’était bien pis : les gamins se débandaient en criant les pires injures.
Venerina entrait en fureur :
– Estropies-en un ! Ils ont besoin d’une bonne leçon ! Tu ne vas pas devenir le souffre-douleur du pays, n’est-ce pas ?
– Bon conseil ! faisait don Pietro. Tu ferais mieux de lui recommander la prudence !
– Avec cette canaille ? Des coups de bâton…
– Ils ne continueront pas, sois tranquille, dès que L’Arso aura appris…
– Lars ! criait Venerina, furieuse, à présent, d’entendre son oncle appeler ainsi son fiancé, comme tout le village.
– L’Arso, Lars, c’est la même chose, soupirait don Pietro, en haussant les épaules.
– Change de nom ! reprenait Venerina, exaspérée, en se tournant vers Cleen. Ah ! c’est un plaisir de s’entendre appeler la femme de L’Arso !
– Est-ce que tu n’es pas déjà la nièce de don Paranza ? Quel mal y a-t-il ? Son sobriquet est L’Arso ; le mien, Paranza. Il n’y a qu’à en rire !
Venerina ne plaisantait plus, à présent, en enseignant sa langue à son fiancé : elle prenait des colères noires.
– Naturellement. Si tu estropies les mots comme ça, il est forcé qu’on se moque de toi. Mais, Sainte Vierge, est-ce donc si difficile ?
Le pauvre Cleen – que pouvait-il de plus ? – souriait avec douceur et essayait de mieux prononcer. Mais, au bout de deux jours, il fallait embarquer et Cleen ne parvenait pas à profiter des leçons autant que Venerina l’eût souhaité.
– Tu es bouché à l’émeri ! mon pauvre ami.
Les querelles des fiancés semblaient puériles à don Pietro, condamné à leur servir de chaperon et que ce rôle ennuyait. Sa présence ajoutait à l’embarras de Cleen, qui n’arrivait pas à comprendre pourquoi l’oncle restait là. N’était-il pas le fiancé de Venerina ? N’aurait-il pas pu sortir avec elle pour faire un tour de promenade sur le plateau, en pleine campagne ? Il l’avait proposé, un jour, mais Venerina elle-même s’était récriée :
– Es-tu fou ?
– Pourquoi ?
– Chez nous, on ne laisse jamais seuls deux fiancés, pas une minute.
– Un teneur de chandelle est obligatoire, ajoutait don Paranza.
Cleen était humilié par ce protocole, qui le troublait, et lui ôtait tous ses moyens. Une sourde irritation le gagnait, un tourment secret à se voir traité et considéré dans ce pays comme un imbécile, et il redoutait de finir par en devenir un.
VII
Mais quelqu’un savait fort bien qu’il n’était pas un imbécile. C’était son patron, Di Nica, dont il réglait au mieux les commissions et les affaires avec ces voleurs d’agents maritimes de Tunis et de Malte. S’il n’en disait rien, ce n’était ni pour nier les mérites de Cleen, ni pour lui refuser un juste éloge, c’était « à cause des conséquences » que cet éloge aurait pu provoquer.
Pourtant. Di Nica crut lui témoigner généreusement l’estime où il tenait ses bons et loyaux services en lui accordant dix jours de congé, à l’occasion de son mariage.
– Tu trouves que c’est peu, disait-il à don Pietro, qui ne paraissait pas satisfait. C’est assez, c’est plus qu’il n’en faut. Tu vas voir, en dix jours, le bel enfant qu’ils vont confectionner. Tout au plus pourrais-je lui permettre, quand il rembarquera, d’emmener sa femme à Tunis et à Malte, en voyage de noces. C’est un garçon sérieux, j’ai confiance en lui. Mais je ne peux pas faire plus.
Il bondit quand don Pietro lui proposa d’être témoin au mariage :
– Je n’ai rien contre ce brave garçon, au contraire. Mais si j’acceptais une fois, je ne ferais plus que ça toute ma vie. Non, non, mon cher Pietro. J’enverrai à la mariée un petit cadeau, en hommage à notre vieille amitié ; mais, surtout, ne le dis à personne…
De son côté, donna Rosolina, à force de presser sur le bon cœur que Dieu lui avait donné, en fit sortir un cadeau pour Venerina : une paire de boucles d’oreilles à pendentifs. Elle avait la gentillesse, par-dessus le marché, d’offrir aux jeunes mariés, pour leurs dix jours de lune de miel, sa maison de campagne au pied du mont Cioccafa.
– Mais prenez garde de ne pas abîmer le mobilier…
Il y avait là quatre chaises boiteuses et si mangées des vers que, pour un peu, elles auraient marché seules. L’odeur de moisi qui régnait dans la cahute décrépite, perdue dans les arbres, était insupportable.
Le premier soin de Venerina, en arrivant en voiture avec son mari, son oncle et sa tante, fut d’ouvrir toutes grandes les fenêtres.
– Les tentures ! Les rideaux ! criait désespérément donna Rosolina, courant après sa nièce.
– Ils vont prendre un peu l’air ! Ça leur fera du bien !
– Oui, mais avec toute cette lumière, ils vont perdre leur couleur.
– Ce n’est pas du brocart !
L’heure qu’elle passa dans sa maison de campagne avec les nouveaux mariés fut pour donna Rosolina un véritable supplice. Elle souffrait de voir tripoter le moindre objet, comme si on lui avait arraché ses accroche-cœur trempés dans l’huile. Quand, avec leurs gros souliers ferrés, le gardien et sa famille entrèrent pour saluer les jeunes époux, elle pensa défaillir.
Le gardien surveillait la propriété ; il habitait avec sa famille dans la cour caillouteuse de la villa, près de la citerne, une pièce sombre, à la fois maison et étable. Perplexe, ne sachant s’il faisait bien ou mal, il apportait, en cadeau de noces, un panier de fruits séchés.
Lars Cleen contemplait avec stupeur ces êtres humains, vêtus de haillons, brûlés par le soleil, qui lui faisaient l’effet d’appartenir à un autre monde.
La femme du gardien annonçait en souriant qu’un de ses cinq enfants, le second, avait les fièvres depuis deux mois et restait étendu sur la paille, comme un mort.
– On ne le reconnaît plus !
Elle souriait, non pas qu’elle n’eût un gros chagrin, mais pour ne pas montrer sa peine, alors que les maîtres étaient en fête.
– Je viendrai le voir, promit Venerina.
– Mais non ! Que dit Votre Excellence ? Ne vous occupez pas de nous, pauvres que nous sommes ! Votre Excellence est là pour se divertir… Quel beau mari ! Je n’ose pas le regarder.
– Et moi ? demanda don Paranza. Je ne suis pas beau ? Et je viens aussi de me marier… avec donna Rosolina. Nous faisons deux beaux couples !
– Voulez-vous bien vous taire ! glapit Rosolina, scandalisée. Je n’aime pas qu’on plaisante avec ces choses-là.
Venerina riait comme une folle.
– Mais je suis sérieux !… Je suis sérieux ! protestait don Pietro.
Et, pour faire rire sa nièce, il insista tellement sur sa mauvaise plaisanterie que la vieille fille ne voulut pas rentrer seule avec lui. Elle ordonna au gardien de monter sur le siège, à côté du cocher.
– Les mauvaises langues ! Sait-on jamais, avec un vieux fou comme vous !
– Ah ! chère donna Rosolina ! que voulez-vous que je fasse, à présent ? gémit don Pietro, une fois dans la voiture, en branlant la tête et en se mouchant avec un grand soupir, comme s’il se dégonflait d’un coup de toute la gaieté prodiguée devant sa nièce. Je voudrais seulement avoir rendu heureuse cette pauvre enfant !
Il avait l’impression d’avoir atteint le but de sa longue existence cahotée. Que lui restait-il d’autre à faire, désormais, que de se mettre à la disposition de la mort, la conscience tranquille, mais angoissée ? Quatre jours encore à s’ennuyer ; et puis, la fosse commune…
La voiture longeait justement le cimetière et les feux du couchant éclairaient le plateau.
– Trois pelletées de terre… Et qu’aurai-je fait, en ce bas monde ?
Donna Rosolina, près de lui, les lèvres serrées, les yeux fixes, s’efforçait d’imaginer ce que faisaient les époux dans sa maison et réfrénait ses regrets, pleine de colère contre le petit vieux assis à côté d’elle. Elle se tourna de son côté ; il avait fermé les yeux, elle crut qu’il dormait :
– Réveillez-vous… Nous arrivons.
Don Pietro rouvrit ses yeux rougis en grommelant :
– Je le sais bien, qu’on arrive… Je pense à mes congres de ce soir. Qui me les fera cuire ?
VIII
Après qu’elle eut dominé le premier embarras de sa brusque intimité avec un homme qui lui faisait encore l’effet d’être tombé du ciel, Venerina se mit à protéger et à conduire par la main, comme un enfant, son mari enchanté des spectacles que lui offrait la campagne, cette nature violente et pour lui si étrange.
Il s’arrêtait pour contempler longuement les troncs difformes des oliviers, tout en bosses, en éperons, en jointures tordues et noueuses, et il n’en finissait plus de répéter : « Le soleil ! Le soleil ! » comme si ces troncs portaient l’empreinte vivante de cette brûlante rage solaire dont il se sentait étourdi, presque soûlé.
Le soleil, il le retrouvait partout, et en particulier dans les yeux et sur les lèvres charnues de sa femme. Ses émerveillements mettaient Venerina en joie, et elle l’entraînait pour lui montrer d’autres choses plus dignes d’être vues : la grotte du Ciocaffa, par exemple. Mais il s’arrêtait, quand elle s’y attendait le moins, devant les choses les plus ordinaires :
– Qu’est-ce que tu regardes ? Les figuiers de Barbarie ?
Il était pareil à un enfant, et elle lui éclatait de rire au nez, à le voir émerveillé par des riens. Elle le secouait aussi, lui soufflait sur les yeux pour le tirer de sa stupeur :
– Éveille-toi ! Éveille-toi !
Il souriait, l’embrassait et se laissait guider par elle comme un aveugle.
Il ne pouvait s’empêcher de lui parler sans cesse de la famille du gardien, qu’ils étaient allés voir, comme ils l’avaient promis. Il ne se résignait pas à l’idée que ces gens habitaient entassés dans cette pièce, dans cette tanière fumeuse et puante. Venerina lui répétait vainement :
– Si tu leur enlevais l’âne, le cochon et les poules, ils ne pourraient plus y dormir en paix. Il faut qu’ils habitent tous ensemble ; ils ne font qu’une famille.
– C’est horrible ! C’est horrible ! criait-il en levant les bras au ciel.
Et ce pauvre enfant par terre, sur son grabat, couleur d’argile, et réduit à l’état de squelette par les fièvres ? Cet enfant, eh bien ! on le soignait avec les infusions traditionnelles, qui le guériraient, comme elles guérissaient tout le monde.
– N’y pense pas, lui disait Venerina, affligée, elle aussi, mais beaucoup moins, car elle savait ce qu’est la vie du pauvre monde.
Elle s’imaginait que son mari le savait aussi bien qu’elle et, le voyant bouleversé, elle se disait qu’il était d’une bonté anormale, presque maladive, et cela lui déplaisait.
Ces dix jours de campagne passèrent vite. De retour au village, Venerina accompagna son mari jusqu’au bateau, mais ne voulut pas s’embarquer avec lui pour le voyage de noces offert par Di Nica.
Don Pietro l’y engageait :
– Tu verras Tunis, que nos chers frères latins, les Français, nous ont si gracieusement volée… Tu verras Malte, où ton imbécile d’oncle s’est ruiné… Ah ! si je pouvais vous accompagner ! Tu verrais comme je me giflerais de bon cœur, s’il m’arrivait de me rencontrer dans les rues de La Vallette tel que j’étais alors, jeune, stupide et patriote.
Mais Venerina n’y consentit pas : elle craignait la mer ; et puis, elle aurait eu honte au milieu de tous ces hommes. Don Pietro insistait :
– Tu seras avec ton mari… Les femmes d’ici sont toutes les mêmes. Elles aimeraient mieux mourir que faire plaisir à leur homme.
Et se tournant vers Cleen :
– Et toi, qu’en dis-tu ?
Lui n’en disait rien. Il regardait Venerina avec le désir de l’avoir près de lui ; mais il ne voulait pas qu’elle fît un sacrifice, ni qu’elle risquât de souffrir en voyage.
– J’ai compris, conclut don Paranza. Tu es un grand babbalacchio[8].
Lars ne comprit pas l’expression sicilienne qu’employait l’oncle, mais il sourit en voyant s’esclaffer Venerina. Et il partit seul.
À peine le bateau eut-il pris le large, après les derniers saluts du mouchoir à sa femme qui, sur le quai du Vieux-Môle, agitait le sien, il éprouva instinctivement un grand soulagement, mais qui le rendit plus triste, à y mieux réfléchir. Il se rendit compte, seul à nouveau devant la mer, qu’il avait souffert pendant ces dix jours d’une terrible contrainte, en dépit du plaisir qu’il éprouvait auprès de sa femme. Il retrouvait la possibilité de penser librement, de s’abandonner à lui-même, sans plus avoir à torturer son cerveau pour deviner et comprendre les sentiments de cette créature si différente de lui et qui, pourtant, lui appartenait si intimement.
Il trouva quelque réconfort à se dire qu’avec le temps, il s’adapterait à sa nouvelle existence, qu’il arriverait à penser, à sentir comme Venerina, et aussi que sa femme réussirait, à force d’affection et d’intimité, à pénétrer jusqu’à lui, à ne plus le laisser seul dans son angoissant exil du cœur et du cerveau.
Venerina, de son côté, pensait à son mari. Elle désirait avec ardeur son retour, mais elle ne parvenait pas à imaginer autre chose qu’une brève escale : deux jours à la maison et le reste de la semaine, en mer ; deux jours avec son mari et le reste de la semaine, seule, à attendre chaque soir que l’oncle revînt de la pêche ; alors, souper et puis se coucher, seule… Et cela ne la contentait pas. Elle aussi trouvait que c’était trop peu. Et elle passait des heures et des heures dans l’attente, une attente secrète, qui lui faisait un peu peur.
– Quand ?
IX
C’est du joli ! s’écria don Paranza, dès les premières nausées, dès les premiers vertiges. Cette canaille d’Agostino avait deviné juste ! Tu as eu peur que ton oncle mourût trop vite et sans entendre les miaulements de ton chaton !
– Mon oncle, protestait Venerina, offensée et souriante à la fois.
Elle était heureuse : elle avait de quoi occuper, maintenant, ses longues veillées solitaires : petits bonnets, bavoirs, chemises, langes… Ses veillées et ses journées aussi. Elle n’avait plus le loisir de penser à elle, elle ne songeait qu’au petit ange qui allait « descendre du ciel, tante Rosolina, du ciel ! » criait-elle à la vieille fille pudibonde, qu’elle décoiffait en l’embrassant.
– Vous serez marraine et l’oncle Pietro parrain.
Donna Rosolina battait des paupières, ravalait sa salive sous les embrassades de cette folle, qui ne respectait ni son rouge ni ses accroche-cœur.
– Doucement, doucement… J’accepte. Mais à condition que vous le baptisiez d’un nom chrétien. Je ne sais même pas le nom de ton mari.
– Appelez-le L’Arso, comme tout le monde, répondait Venerina en riant. Qu’est-ce que ça peut bien me faire, maintenant !
Tout lui était égal, à présent ; elle ne faisait même plus un brin de toilette quand son mari devait débarquer.
– Repeigne-toi un tout petit peu, lui conseillait donna Rosolina. Tu n’es pas à ton avantage, tu sais…
Venerina haussait les épaules :
– S’il me veut comme ça, très bien… S’il ne veut pas de moi et me laisse la paix, encore mieux…
La joie de son attente était si exclusive que Cleen ne se sentait pas autorisé à en prendre sa part. Il était laissé de côté et il ne songeait à se réjouir que du bonheur de sa femme, comme si l’enfant qui allait naître n’était pas aussi le sien. Il est vrai qu’il allait naître dans un pays où Cleen était étranger, et d’une mère qui ne se souciait pas de savoir quelles pensées, quels sentiments l’agitaient.
Venerina avait sa vie toute tracée ; il n’y avait plus de place pour l’imprévu : elle avait une maisonnette, un mari ; elle allait avoir un enfant et elle ne se disait pas que son mari, l’étranger, était au début d’une existence nouvelle et qu’il attendait qu’elle lui tendît la main pour le guider. Insoucieuse ou incompréhensive, elle le laissait sur le seuil, exclu de tout, perdu dans sa solitude.
Il repartait, et, sur mer, sa solitude et son angoisse augmentaient encore. Ses camarades, le voyant toujours triste, ne se moquaient plus de lui, mais ne prenaient pas garde à sa présence.
Nul ne songeait à lui demander :
– Qu’est-ce que tu as ?
Il était l’étranger… Il devait donc avoir des raisons incompréhensibles d’être tel qu’il était.
Il s’en serait aisément consolé, si du moins, chez lui, il ne s’était pas senti aussi étranger que sur le bateau. Chez Lui ? Dans ce bourg de Sicile ?
Non ! Non ! Son cœur volait au loin, vers son pays natal, vers la vieille maison où sa mère était morte, où demeurait sa sœur, qui, peut-être, à cette minute précise, pensait à lui et le croyait heureux…
X
Un espoir tenace vivait en lui. C’était la dernière digue contre la mélancolie qui l’envahissait et l’étouffait : c’était l’espoir de se retrouver en son enfant et de se sentir avec lui, à travers lui, moins seul sur la terre d’exil.
Mais cette espérance s’envola dès qu’il vit son fils, venu au monde deux jours plus tôt en son absence. C’était tout le portrait de sa mère.
– Il est tout noir, pauvre petit. Sang de Sicile ! dit Venerina de son lit, tandis qu’il le contemplait dans son berceau, profondément déçu. Ferme les rideaux, tu vas l’éveiller… Il ne m’a pas laissé fermer l’œil de la nuit, pauvre mignon ! il a des coliques. Il dort, laisse-m’en profiter…
Cleen, ému, baisa sa femme au front, referma les volets et sortit de la chambre sur la pointe des pieds. Dès qu’il fut seul, il cacha son visage dans ses mains et se mit à pleurer.
Qu’avait-il espéré ? Un signe, un seul, chez ce petit être, la couleur des yeux, celle des cheveux, qui le proclamât sien, étranger comme lui et qui rappelât son pays. Qu’avait-il espéré ? Même alors, n’aurait-il pas grandi ici, avec les autres enfants du village, sous ce soleil brûlant, soumis à des habitudes de vie étrangères à son père, élevé presque exclusivement par sa mère, par conséquent avec les mêmes idées, les mêmes sentiments qu’elle. Qu’avait-il espéré ? Il serait un étranger pour son fils comme pour tous les autres…
Dans les deux jours qu’il passait chez lui chaque semaine, il cherchait à dissimuler son état d’âme, et cela ne lui était pas difficile : personne ne faisait attention à lui. Don Pietro s’en allait, comme d’habitude, à la pêche, et Venerina ne s’occupait que du poupon, qu’elle ne le laissait même pas toucher :
– Tu le fais pleurer… Tu ne sais pas le tenir… Allons, sors un peu, va faire un tour. Pourquoi me regardes-tu comme ça ?… Va faire une visite à tante Rosolina. Il y a trois jours que je ne l’ai vue… Don Pietro a peut-être raison. Elle veut sans doute que tu lui fasses la cour.
Pour faire plaisir à sa femme, Cleen alla une fois rendre visite à donna Rosolina ; mais il fut reçu de telle façon qu’il jura de n’y jamais retourner seul ou en compagnie.
– Non, monsieur, je ne vous laisserai pas franchir mon seuil, lui déclara donna Rosolina, les yeux pudiquement baissés. Je regrette, mais je ne puis vous le cacher. Vous êtes mon neveu, c’est entendu, mais on vous sait étranger, avec des mœurs curieuses ; et qui sait ce qu’on pourrait croire ! Je ne puis vous recevoir seul. Je passerai tout à l’heure chez vous, si vous ne voulez pas venir ici avec Venerina.
Il se trouva ainsi mis à la porte et n’eut pas le cœur d’en rire, comme fit Venerina, quand il lui raconta la chose. Puisqu’elle connaissait si bien la folie de cette vieille, pourquoi lui avoir fait faire cette figure d’imbécile ? Est-ce qu’elle aussi voulait se moquer de lui ?
– Tu n’as pas encore trouvé d’ami ? lui demandait Venerina.
– Non…
– C’est difficile, je le sais : les Siciliens sont un peu ours. Mais tu es, toi, comme une mouche sans tête. Éveille-toi un peu ! Va retrouver l’oncle, il est sur la jetée. Entre hommes, vous avez de quoi causer. Moi, je n’ai pas le temps de te faire la conversation : j’ai trop de travail !
Il la regardait avec l’envie de lui demander :
– Tu ne m’aimes plus ?
Venerina, voyant qu’il ne bougeait pas, levait les yeux de sa couture et, devant son air égaré, éclatait de rire :
– Que veux-tu de moi ? Un homme qui reste à la maison comme un enfant, ça ne s’est jamais vu ! Apprends un peu à vivre comme les hommes d’ici, dehors plus que dedans. Je n’aime pas te voir ainsi. Tu me fais de la peine.
Quand il était sorti, elle ne le voyait plus. Mais à l’air triste qu’il prenait en s’apprêtant à sortir, chassé de chez lui, tout pareil à un chien sans maître, elle aurait pu deviner de quel cœur il allait se traîner par les rues de ce village où le sort l’avait jeté et qu’il détestait déjà.
Ne sachant où aller, il se rendait à l’agence de son patron. Il trouvait régulièrement le vieux Di Nica derrière ses commis, le cou dressé, les lunettes sur la pointe du nez, surveillant ce qu’ils inscrivaient sur les registres. Il ne se défiait pas d’eux, – oh ! pas le moins du monde ! – mais c’est si vite fait, par distraction, d’écrire un chiffre pour un autre, de faire une erreur d’addition !… Et puis, il surveillait leur calligraphie… La calligraphie était son faible ; il voulait que ses livres de comptes fussent propres et nets. La petite pièce où il se tenait était humide et sombre, au rez-de-chaussée ; certains jours, dès quatre heures, on n’y voyait plus : il fallait allumer les lampes.
– C’est une honte, patron Di Nica. Quand on a autant de sous que vous en avez !
– J’ai des sous, moi ? demandait le vieux. J’ai ceux que vous voudrez bien me donner ! Et puis, que voulez-vous ! j’ai débuté ici, c’est ici que je veux finir !
En voyant entrer Cleen, il se tourmentait : celui-là, à présent, que veut-il ?
Il allait vers lui, la tête rejetée en arrière pour pouvoir regarder à travers ses besicles posées au bout de son nez et disait :
– Que voulez-vous, mon garçon ? Rien ? Eh bien ! prenez une chaise et asseyez-vous là, devant la porte.
Il redoutait les distractions de ses commis ; et puis, il ne voulait pas que Cleen fût au courant des affaires de l’agence avant le voyage.
Cleen restait assis un instant sur le seuil. Personne ne voulait donc de lui ? Et pourtant, il ne portait plus sa toque de fourrure ; il était habillé comme tout le monde ; pourquoi les passants se retournaient-ils pour le dévisager comme un objet rare exposé devant l’agence ? Soudain, il voyait cabrioler devant lui un gamin qui lui réclamait aussitôt après un petit sou, et tous de rire.
– Qu’est-ce que c’est ? criait le vieux Di Nica, en s’avançant sur le seuil. Le guignol ? Les marionnettes ?
Les gamins se sauvaient avec des cris et des sifflets.
– Mon garçon, disait alors Di Nica à Cleen, les gens d’ici sont des sauvages. Allez-vous-en ! Faites-moi ce plaisir.
Et Cleen s’en allait. Ce vieil avare, avec sa défiance continuelle, lui donnait la nausée. Il descendait à la plage, couverte de tas de soufre, et il assistait, avec une amertume et un dégoût profonds, au labeur bestial de tous ces gens, sous le grand soleil. Pourquoi, avec les trésors que produisait ce commerce, ne pensait-on pas à faire travailler de façon plus humaine ces malheureux, moins bien traités que des bêtes de somme ? Des chariots, des wagonnets et un aménagement des quais, n’aurait-on pu embarquer plus rapidement tout ce soufre ?
– Pas un mot là-dessus, lui recommandait don Paranza, le soir, après souper, si tu ne veux pas finir sur la croix, comme Jésus-Christ ! Tous les richards du pays ont intérêt à ce que les quais ne soient pas aménagés, parce qu’ils sont propriétaires des spigonare qui portent le soufre de la plage aux cargos… Prends garde, c’est la croix qui t’attend !
Et sur la plage nue, entre les dépôts de soufre, couraient les égouts découverts qui empestaient le pays, et chacun se lamentait, et personne ne faisait rien pour fournir le village de l’eau nécessaire. À quoi servait tout cet argent pourchassé avec tant d’acharnement ? Qui en profitait ? Tous ces richards étaient plus pauvres que les pauvres ! Pas un théâtre, pas un endroit où se divertir honnêtement après ce terrible labeur. Dès le soir venu, le village paraissait mort, veillé par quatre réverbères à pétrole. Et on eût dit que les hommes, au milieu des difficultés continuelles et des ruses de cette lutte pour le gain, n’avaient même pas le temps de penser à l’amour. Quant aux femmes, elles se montraient indolentes, négligées, dépourvues de toute coquetterie.
Le mari était fait pour travailler, la femme pour s’occuper de la maison et des enfants.
– C’est donc ça, pensait Cleen ? C’est donc ça toute la vie ?
Et un sanglot lui montait à la gorge.
XI
L’Hammerfest ! L’Hammerfest qui arrive ! Don Paranza, tout haletant d’avoir couru, annonçait la grande nouvelle à Venerina :
– J’ai l’avis, tiens, regarde : il arrive aujourd’hui ! Et L’Arso qui est en mer… Porco diavolo ! Qui sait s’il rentrera à temps pour revoir son beau-frère et ses amis !
Il se précipita chez Di Nica, sa feuille à la main :
– Agostino, l’Hammerfest !
Di Nica le regarda, comme s’il avait été frappé de folie subite :
– Qui est-ce ? Connais pas !
– Le bateau de mon neveu.
– Et que veux-tu que ça me fasse ?
Il se mit à rire, les yeux clos, d’un rire du nez dont il avait la spécialité, en écoutant les sottises que lâchait don Pietro, navré du contretemps :
– Si on pouvait…
– Mais oui, raillait Di Nica, tout de suite. Je vais télégraphier à Tunis et je le fais revenir au grand galop. N’en doute pas.
– Tu as toujours été le plus généreux des hommes ! lui cracha don Paranza à la face.
Et il le planta là, plein de dégoût.
Il rentra chez lui s’habiller pour la visite à bord. Sur l’Hammerfest, qui achevait à peine de s’amarrer dans le port, les camarades de Cleen lui firent mille fêtes. Lui qui, pour les affaires de son vice-consulat, s’en tirait, d’habitude, avec quatre phrases, toujours les mêmes, il dut, cette fois, se torturer terriblement les méninges pour trouver, dans son imaginaire connaissance de la langue française, de quoi répondre à toutes les questions qui lui grêlaient dessus et il mit dans un état pitoyable sa pauvre chemise empesée, tant il sua pour faire comprendre à ces diables de matelots qu’il n’était pas exactement le beau-père de L’Arso et que Venerina n’était pas sa fille, bien qu’il l’eût élevée comme une fille depuis sa petite enfance.
Ils ne comprenaient pas, ou faisaient semblant de ne pas comprendre :
– Beau-père ! Beau-père !
– Comme vous voudrez ! s’écriait don Paranza. Me voilà devenu beau-père !
Cela n’aurait rien été, si, en qualité de « beau-père », on n’avait voulu le faire trop boire, malgré ses vives protestations :
– Je ne bois pas de vin.
Ce n’était pas du vin. Qui sait quelle boisson diabolique on lui avait fait avaler ! Il avait un enfer dans l’estomac… Et quel travail effrayant pour faire comprendre à tout l’équipage, qui voulait absolument connaître la mariée, qu’il était impossible de les emmener tous !
– Seulement le beau-frère ! Où est-il ? Vous, seulement !… Venez, venez…
Et il le conduisit chez Cleen. Le beau-frère ignorait encore la naissance du petit ; mais il apportait quelques menus cadeaux à Venerina de la part de sa femme. Il était désolé de ne pouvoir embrasser Lars. L’Hammerfest repartait trois jours plus tard pour Marseille.
Venerina ne put échanger un seul mot avec le jeune colosse dont la présence lui rappelait le jour où Lars, moribond, avait été porté sur sa civière dans la maison de son oncle. Elle se revoyait lui donnant de quoi écrire, recevant de lui la petite bourse. C’était en le regardant pleurer qu’elle s’était attendrie sur le sort du malade. Et maintenant, Lars était son mari, et ce géant blond et souriant, penché sur le berceau du petit, était son parent, son beau-frère. Elle voulut que son oncle lui répétât en sicilien ce qu’il disait de l’enfant.
– Il dit qu’il te ressemble, répondit don Paranza. Mais ce n’est pas vrai. C’est à moi qu’il ressemble !
Ce fut l’alcool qu’on lui avait fait ingurgiter à bord et qui lui restait sur l’estomac qui le poussa à dévoiler ainsi son orgueil et sa tendresse de grand-oncle gâteau. D’habitude, il dissimulait son sentiment et affectait d’appeler l’enfant : « Le chat qui miaule. » Venerina se mit à rire.
– Et maintenant, mon oncle, que dit-il ? demanda-t-elle en entendant parler l’étranger, son beau-frère.
– Un peu de patience, grogna don Paranza. Je ne peux pas vous écouter tous les deux à la fois… Ah ! oui… L’Arso, évidemment… Dommage, il dit… Il ne sera pas possible de le voir, si votre capitaine, eh oui ! a des engagements. Le bateau ne peut pas attendre…
Mais le déchirement suprême ne fut pas épargné à Cleen. Par suite d’un retard dans l’arrivée des feuilles de connaissement, l’Hammerfest dut renvoyer son départ d’un jour. Il s’apprêtait à quitter Port-Empédocle quand le vapeur de Di Nica se rangea le long du môle.
Lars Cleen se jeta dans un canot et vola jusqu’à son cher cargo, le cœur en tumulte. Il ne raisonnait plus ! Ah ! partir, fuir avec les copains, s’exprimer de nouveau dans sa langue, retrouver sur ce bateau la patrie, en finir avec l’exil, avec cette agonie ! Il se jeta dans les bras de son beau-frère et le serra à l’étouffer, dans un déluge de larmes.
Mais quand ses camarades, groupés autour de lui, lui demandèrent, consternés, la raison de ses pleurs, il se ressaisit, mentit, répondit qu’il pleurait uniquement de joie en les revoyant.
Seul, son beau-frère ne l’interrogea pas : il lut dans ses yeux le désespoir, le projet qui l’avait poussé à bord, et il lui fit comprendre d’un regard qu’il l’avait deviné. Il n’y avait plus une minute à perdre : déjà, la cloche du départ avait sonné.
Un moment après, debout sur son canot, Lars Cleen vit l’Hammerfest sortir du port. Il agitait son mouchoir trempé de larmes, et ses yeux n’arrêtaient pas de pleurer. Il ordonna au patron du canot de ramer jusqu’à la sortie du port : il voulait voir sans témoin son bateau s’éloigner peu à peu sur la mer sans limites, et avec lui son pays, son âme, sa vie… Le voilà qui s’éloigne… Encore… Encore… Il a disparu.
– On rentre ? interrogea de la tête le marinier.
De la tête, il fit signe que oui. Il était seul pour toujours. Abandonné de tous. Loin de tous. Étranger.
UNE INVITATION À
DÎNER[9]
– Est-ce qu’il y aura suffisamment ?
Les trois sœurs Santa, Lisa et Angelica Borgianni échangeaient des regards de perplexité en s’interrogeant de la sorte. Elles travaillaient depuis deux jours à préparer ce dîner, un festin de « grands seigneurs ».
Santa, la cadette, était plus grande qu’Angelica ; Angelica plus grande que Lisa, l’aînée. Toutes trois, du reste, poitrinantes et fessues, ne le cédaient pas à leurs frères pour la stature colossale et la force herculéenne.
– La famille Borgianni, huit piliers de cathédrale ! disait Mauro, le plus jeune frère et le dernier-né de la famille.
Trois sœurs et cinq frères : Rosario, Nicola, Titta, Luca et Mauro par rang d’âge.
Rosario et Nicola s’occupaient des terres ; Titta de la solfare près du bourg d’Aragona ; Luca était entrepreneur de travaux publics et avait presque tous ceux de l’arrondissement ; Mauro avait la passion de la chasse, il était chasseur.
Rosario Borgianni était célèbre pour ses accès de fureur. Une vraie bête fauve. On racontait sur lui les plus terribles histoires ; des aventures qu’il avait eues au temps du brigandage, naturellement accrues et embellies par l’imagination populaire. On prétendait qu’il avait tenu tête un jour à une douzaine de brigands, particulièrement sanguinaires, et qu’il les avait tous tués. On exagérait ! Il n’en avait tué que quatre : deux sur ses propriétés, deux autres sur la route de Comitini à Aragona.
On en racontait de belles également sur Mauro. Un jour par exemple, à la chasse, il était tombé du haut du Mont des Forche ; il avait rebondi trois fois et chacune des trois fois, brandissant son fusil de la main droite, il avait crié :
– Heureusement que je suis bon valseur !
On l’avait relevé pourtant avec une fracture à la jambe droite et une légère commotion cérébrale, lui qui déjà n’avait pas le cerveau bien en place.
Une autre fois, à la chasse, il aperçoit trois ou quatre étourneaux posés sur la croupe de bœufs en train de paître sur une pente. Il se baisse, approche tout doucement et à peine à bonne portée, boum, un coup de fusil. Le bouvier bondit furieux.
– Halte, lui crie Mauro en le mettant en joue. Un pas de plus et je te déquille.
– Mais voyons, monsieur Mauro, mon bétail…
– Tu ne sais donc pas, imbécile, que là où je vois du gibier, je tire.
– Même sur la croupe de mes bœufs ?
– Même sur la tête de l’enfant Jésus, si je prenais l’esprit saint pour un pigeon.
*
* *
Le repas semblait préparé pour trente invités au bas mot. En réalité il n’y en avait qu’un seul, et qu’on ne connaissait même pas. On savait simplement qu’il arriverait le lendemain de Comitini et que ce repas lui était dû à titre de remerciement. Il avait donné asile à Luca, l’entrepreneur qui, pendant quinze jours, avait tenu le maquis.
Pas précisément pour un meurtre, mais presque. Voici : Luca Borgianni avait pris en adjudication la construction du chemin entre Favara et Naro. Un soir, la journée finie, il revenait à cheval. À un moment donné, il aperçoit une ombre qui s’allongeait menaçante sur le gravier baigné de lune. Pas de doute, quelqu’un était posté là, la tête couverte d’une cagoule. Par bonheur, Luca l’avait aperçu, ou plutôt il avait aperçu la cagoule. Il avait eu l’impression que le coquin s’accroupissait pour se garer de la lune qui émergeait lentement de la colline à gauche.
– Qui va là ? Pas de réponse.
Tra-ta, tra-ta ; par précaution, il arme son fusil. Un grillon se met à chanter.
Luca de nouveau arrête sa monture.
– Qui va là. ?
Silence. Le chant du grillon.
– Je compte jusqu’à trois, cria Luca tout pâle. Si tu ne réponds pas, tu peux faire le signe de la croix. Un !
L’ombre ne bougeait toujours pas.
– Deux !
L’ombre restait immobile, impassible. Et toujours le chant du grillon.
– Trois !
Un coup de fusil. Quelque chose qui saute en l’air et Luca qui repart au triple galop. Quand il arriva à la maison, il haletait.
Frères et sœurs l’entourèrent :
– Cachez-moi ! Cachez-moi !
– Pourquoi ? Une blessure ?
– Non, tué…
– Toi ? Qui ?…
– Quelqu’un… Je ne sais pas… J’ai tiré dessus… Cachez-moi…
Ses frères l’avaient empoigné et enfermé dans la cave. Puis Mauro avait fait un tour dans le village pour savoir si on parlait déjà de l’homicide. Rosario et Titta avaient attendu avec impatience que Luca se fût remis un peu de son émotion, puis l’avaient conduit en lieu sûr. Ils avaient déjà pensé à une cachette, chez un de leurs amis et compères de Comitini. Luca allait s’y rendre cette nuit même à cheval. Nicola, armé jusqu’aux dents, était allé rôder autour de l’endroit où son frère avait fait le coup pour découvrir de quoi et de qui il s’agissait. Luca s’était enfin mis en route. Le lendemain à l’aube revoilà Nicola.
– Eh bien ?
– Rien. J’ai trouvé seulement un manteau à capuchon par terre. Certainement le blessé s’est traîné jusqu’au village et il a abandonné son manteau, percé en plusieurs endroits… Luca tire comme un ange ! Il doit l’avoir blessé à mort, à en juger sur le manteau… Je n’y comprends rien… Deux trous gros comme ça dans le capuchon. Il a donc été touché à la tête… Et il a disparu !
Trois jours s’étaient écoulés dans l’angoisse. Au village on ne parlait toujours de rien. Dans les villages voisins, pas la moindre blessure, pas le moindre cas de mort violente. Au bout de quinze jours, on avait fini par apprendre qu’un paysan, travaillant dans ces parages, s’était servi d’une borne comme de porte-vêtement ; il avait encapuchonné la borne de son manteau et le soir, il était rentré au village en l’oubliant. Luca l’avait pris pour un individu embusqué et avait tiré dessus.
Le repas était prêt depuis la veille, étalé sur la longue table au milieu de la pièce : un cochon de lait, garni de laurier, farci de macaronis, dans un plat allant au four ; sept lièvres écorchés avec une garniture d’alouettes, le tout tué par Mauro ; deux dindes énormes ; un agneau ; un plat de tripes ; des pieds de bœuf à la gelée ; un gros poisson bouilli ; un pâté gigantesque ; plus un régiment de fiasques et des fruits en quantité.
– Est-ce qu’il y aura suffisamment ?
Titta disait : oui, Mauro disait : non et il faisait le compte :
– Nous, huit ; l’invité, neuf ; le domestique et la servante, onze. Dieu soit loué, chacun de nous mange comme quatre, et… et…
– N’aie pas peur, l’invité ne manquera de rien… certifiait Titta.
Cette conversation avait lieu sur le coup de minuit, devant la table déjà servie. Les sept frères et sœurs avaient quitté leur lit, l’un après l’autre, tout doucement, poussés par un même désir de voir l’effet que produisait la table garnie. Comme des ombres noctambules, ils s’étaient trouvés réunis en chemise, le bougeoir à la main. Quelque dispute était à prévoir ; elle ne tarda pas à éclater entre Titta et Mauro. Mauro saisit un lièvre et en menaça son frère. Ils s’empoignèrent. Mais Angelica devait sauver la situation :
– Mazurka ! mazurka ! cria-t-elle en entendant les mandolines et la guitare d’une sérénade qui par chance passait en ce moment.
– Bravo ! c’est la Nocturne, s’écria Santa au même moment en battant des mains.
Et elle commença à danser avec sa sœur, en chemise de nuit. Tous les autres suivirent l’exemple. Lisa se jeta dans les bras de Titta, Rosario forma couple avec Nicola et Mauro, demeuré seul, se mit à danser avec le lièvre aux oreilles pendantes, en riant joyeusement.
*
* *
Tout d’abord, au milieu des poignées de mains, des questions et des embrassades prodiguées à Luca (le pilier le plus solide de la famille), personne ne fit attention à un petit homme d’âge incertain, écrasé par un énorme couvre-chef qui lui descendait jusqu’à la nuque, soutenu des deux côtés par les oreilles qui pliaient sous la charge. Le pauvre malheureux semblait ému par les témoignages d’affection de ces huit colosses qui n’avaient pas un seul regard pour lui, tout intimidé déjà et si petit qu’il n’arrivait pas, chapeau compris, à l’épaule de Lise, la moins grande des trois sœurs.
– Attendez que je vous présente Don Diego Filinia, autrement dit Schiribillo, finit par dire Luca. Et il lui posa la main sur l’épaule en souriant, d’un air protecteur.
– Dieu, quel petit homme ! s’écrièrent en chœur, en s’avisant de sa présence, les trois sœurs. Et il s’appelle Schiribillo ?
– Je suis petit de naissance, Mesdames… Et Schiribillo est mon surnom… balbutia Don Diego, en retirant par politesse son grand chapeau et en souriant avec une humilité pleine de gaucherie.
Les sept géants considéraient avec une commisération profonde ce nabot, tête nue, sans un cheveu sur le crâne luisant, ovale et protubérant. Ils ne trouvaient pas un mot à lui dire. Quelle désillusion ! Et quel drôle d’invité ! Si on l’avait su plus tôt…
– Pourquoi pleure-t-il ? demanda soudain Angelica, envahie de dégoût et de pitié, après l’avoir longuement dévisagé.
– Il pleure ? fit Luca, et ce disant, il se tourna, puis se baissa jusqu’au niveau du minuscule invité en le regardant dans les yeux.
– Je ne pleure pas, non, protesta Don Diego qui portait à son œil droit un vaste mouchoir de cotonnade à fleurs. En route, il m’est entré une poussière dans l’œil. Mais, je ne pleure pas…
– Ah ! s’écrièrent les géants rassurés.
Don Diego abaissa doucement son mouchoir de son œil à son nez, comme pour y recueillir une goutte furtive.
– Débarrassez-vous de votre manteau…, lui suggéra Santa.
Mais Don Diego refusa.
– Non, non, grand merci. Je préfère le garder… Sinon, Dieu soit loué, je me mets à éternuer, et quand je commence, je ne sais jamais quand je m’arrêterai… Alors je préfère garder mon manteau.
Le silence qui suivit ses paroles l’emplit de confusion. Il soupira : – Eh oui !
Puis par deux fois, encore : – Eh oui !… eh oui !
Et il se frottait sans arrêt les mains, en tenant les yeux baissés. Personne ne se décidait à parler et ce silence devenait plus lourd de minute en minute.
– Nous avons le devoir, reprit enfin Luca, d’être reconnaissants envers Don Schiribillo pour toutes les gentillesses qu’il a eues pour moi pendant mon séjour à Comitini.
– Soyez-en remercié de tout cœur, dit alors Rosario, en tendant la main à l’hôte. Et vous vous appelez comment ? Schiribillo ?
– Mais pas du tout… Je m’appelle Filinia… Filinia, fit Don Diego, avec un humble sourire.
– Notre maison est la vôtre, ajouta Nicola, en serrant à son tour la main de l’invité et en regardant ses frères et sœurs d’un air de dire : « À votre tour, moi, j’ai déjà dit ma phrase. »
Titta et Mauro, l’un après l’autre, suivirent l’exemple et dirent la leur, en avançant d’un pas, militairement, et en serrant aussitôt après la main de Don Diego, qui ne sut rien trouver d’autre à répondre que : « Mais voyons… Mais voyons… »
Il fut impossible de tirer un mot aux trois sœurs, tant leur déception était grande.
On en vint à parler de l’incident pour lequel Luca avait dû se cacher. Luca n’admettait pas l’hypothèse de la borne.
– Une borne, s’écriait-il en proie à l’indignation, une borne ! C’était un homme en chair et en os qui était posté là ! Quand j’ai tiré, j’ai entendu un cri, moi qui vous parle… Je voudrais connaître la crapule qui a inventé l’histoire de la borne. Je lui apprendrais à se moquer de Luca Borgianni.
– Ça va, ça va, répétait Rosario. N’en parlons plus. Ne pensons qu’à nous amuser.
Don Diego approuva de la tête ; ce n’était pas qu’il espérât s’amuser, lui chétif, entre ces huit colosses, mais il valait mieux par prudence écarter tout sujet de dispute. On ne sait jamais où s’égarent les coups !
En attendant de se mettre à table, Rosario et Nicola se mirent à causer avec l’invité des choses de la campagne, des bonnes années et des mauvaises. Don Diego, toujours humble, se remettait pour tout entre les mains de Dieu, mais cette docilité finit par mettre Nicola en colère :
– Les mains de Dieu, les mains de Dieu ! Ce sont des bras d’hommes qu’il faut à la terre. Des bras comme ceux-ci, regardez Schiribillo !
Et il tendait vers Don Diego, en serrant les poings, ses bras herculéens, comme s’il avait l’habitude de bourrer la terre de coups pour l’obliger à donner chaque année plus que son dû.
– Et regardez ceux-là, tout vieux et fatigués qu’ils soient, s’écria Rosario en montrant les siens.
Titta et Mauro voulurent eux aussi montrer leurs biceps et relevèrent les manches de leur veste et de leur chemise. Le pauvre Don Diego considérait avec affolement à hauteur de son nez ces huit bras musculeux, de force à tuer huit bœufs.
– Je vois, je vois, répétait-il avec un sourire de stupeur et de consternation. Je vois, je vois…
– Touchez, ordonnèrent les frères Borgianni.
D’un doigt tremblant, Don Diego effleura les bras et de l’autre main il portait le mouchoir à son nez de peur qu’une goutte ne tombât dessus.
– À table, annonça mollement Santa.
– Schiribillo, à table ! cria Mauro. Et laissez-vous faire. Nous allons vous faire grandir… Vous allez tellement manger que vous ne pourrez plus passer par la porte. Nous vous descendrons par la fenêtre quand vous serez gavé.
– Je mange très peu, très peu, avertit Don Diego.
– Quelle est la place de l’invité, demanda Titta à voix basse à ses sœurs.
– Entre Rosario et Lisa, proposa Mauro. Mais Lisa se révolta : – Nous autres femmes, nous nous assiérons à part.
Don Diego s’assit entre Rosario et Nicola. Les huit Borgianni à peine en place, remplirent de vin les gros verres à eau.
– Le signe de la croix ! dit Rosario solennellement.
Et de boire !
– Don Diego, vous ne buvez pas, demanda Titta.
– Merci, jamais avant le repas, s’excusa l’hôte timidement.
– Allons donc, pour ouvrir l’appétit, suggéra Nicola en lui mettant le verre en main.
Don Diego l’approcha de ses lèvres par politesse et le découronna à peine d’une petite gorgée prudente.
– Cul sec, cul sec, criaient les huit Borgianni.
– Je ne pourrais pas, merci, je ne pourrais pas… Mauro se leva de sa chaise :
– Attendez, je vais le mettre à la raison…
Et saisissant le verre d’une main, de l’autre la tête de Don Diego, il dit : – Laissez-vous faire…
Et il lui fit avaler son verre de force.
– Oh ! mon Dieu ! hoquetait Don Diego, à demi asphyxié, les yeux pleins de larmes. – Oh ! mon Dieu !
Il s’était levé et essuyait son front trempé de sueur, au milieu des rires de toute la tablée.
– Regardez ! Le vin lui ressort par les yeux ! raillait Angelica.
On servit le cochon de lait farci… Rosario se leva, découpa ; la plus grosse portion fut pour Don Diego.
– C’est trop, beaucoup trop, répétait l’invité, l’assiette à la main.
– Ne commencez pas, cria Nicola. Ce n’est pas trop.
– La moitié seulement, je vous en prie, insistait Don Diego. Je ne pourrais pas. Je mange très peu.
– Mangez, cria Mauro et il se leva de nouveau. Don Diego, épouvanté, baissa le front vers son assiette et commença à manger en silence.
Tous d’ailleurs mangeaient en silence. Mais chaque fois que l’invité faisait le geste de poser sa fourchette, les huit géants reprenaient d’une seule voix :
– Mangez, jusqu’à la dernière bouchée !
– Maintenant je ne pourrais vraiment plus rien manger, protesta Don Diego, avec quelque énergie et un grand soupir de soulagement, quand il eut vidé son assiette. J’ai dîné comme un prince.
Mauro s’insurgea :
– Vous dites ?… Nous ne faisons que commencer…
– Vous autres, évidemment, repartit en souriant Don Diego. Vous avez, Dieu merci, la capacité qu’il faut… Je parle pour moi…
– Pour qui nous prenez-vous, fit Titta, en fronçant les sourcils. Vous vous figurez qu’on vous a invité pour manger un seul plat et c’est tout ? Occupez-vous de manger et faites ce que vous devez, comme nous avons fait ce que nous devions. Nous vous avons des obligations, laissez-nous les remplir.
– Ne vous fâchez pas, je disais simplement que je…
– Vous mangerez, coupa court Rosario. Voilà la chasse de Mauro.
– Un lièvre et cinq alouettes pour moi seul, s’écria Don Diego atterré. Mais c’est impossible. Mais voyons, comment pouvez-vous croire que je…
– Pas d’histoire, n’est-ce pas ! fit Nicola.
– Mais regardez-moi un peu, implorait Don Diego. Où voulez-vous que je les mette ? Vous ne voulez pas que j’y laisse la peau…
Rosario ne comprit pas :
– Quelle peau ? Vous n’avez rien à laisser. Le lièvre est écorché !
– Je parle de la mienne, de ma peau ! Où voulez-vous que je mette un lièvre ?
– Je vous ai mis aussi cinq alouettes.
– Mais je n’ai pas le ver solitaire… Permettez-moi de manger seulement les alouettes.
– Écoutez, hurla Mauro, en brandissant une cuisse de lièvre qu’il déchiquetait à belles dents. C’est moi qui ai tué tout ce gibier. Je me suis cassé les jambes pour vous, trois jours de suite. Si vous ne mangez pas tout, je prendrai la chose comme une injure personnelle.
– Ne vous fâchez pas, je vous en supplie. Je vais essayer.
Et le pauvre Don Diego recommandait son âme au Dieu de miséricorde. Il mangeait et la sueur commençait à lui couler du front. Il levait les yeux et il voyait ces huit démons de l’enfer qui entonnaient du vin, du vin et encore du vin.
– Jésus, viens à mon aide, gémissait-il tout bas. Le repas n’en finissait pas. Don Diego aurait voulu pleurer, se rouler à terre de désespoir, se griffer la figure, se décrocher la mâchoire de rage. On n’avait jamais vu pareille cruauté. Même pas du temps de Néron. Il n’avait même plus la force de soulever son assiette. Les couverts, les verres, les bouteilles tourbillonnaient devant lui sur la table ; ses oreilles bourdonnaient. Ses paupières se fermaient seules, tandis que les huit Borgianni, déjà saouls, hurlaient, gesticulaient comme des énergumènes, tantôt debout, tantôt assis et sans cesser de s’injurier.
À présent, si Don Diego écartait un peu son assiette en disant comme en rêve : « Je n’en peux plus… je n’en peux plus… » les huit géants se jetaient sur lui et le couteau sur la gorge :
– Mangez, grand imbécile. C’est pour vous que nous avons fait tous ces frais.
Don Diego n’était déjà plus de ce monde, lorsqu’à travers ses paupières mi-closes il lui sembla apercevoir sur la table une énorme meule de remouleur. Il fit alors une suprême et vaine tentative pour se lever et s’enfuir :
– Oh ! mon Dieu ! ils m’ont attaché à ma chaise, gémit-il, et il fondit en larmes.
C’était faux, mais le pauvre Don Diego se croyait attaché. Rosario se leva de toute sa hauteur, le tranchoir à la main. Don Diego eut l’impression qu’il touchait le plafond de sa tête et qu’il tenait en main un sabre pour l’exécuter.
– La moitié pour Don Diego, cria Rosario, en partageant l’énorme pâté que le pauvre homme avait pris pour une meule.
– L’autre moitié à ses deux voisins, proposa Angelica.
– Et nous alors, fit Mauro. Nous rien ? Je veux ma part.
Mais Luca prenait parti pour Angelica.
– Non, non, aux deux voisins.
Don Diego, épouvanté, voyait grossir la dispute.
– Et moi, alors, par droit du plus fort, je prends ma part, cria Mauro. Il se leva et étendit la main vers le pâté.
Mais Luca fut plus prompt : il saisit le pâté et, poursuivi par toute la famille, parmi les cris et les bourrades, il le jeta par la fenêtre. Une rixe furieuse suivit : frères et sœurs s’étaient pris aux cheveux : hurlements, gifles, coups de poings et coups d’ongles, chaises renversées, bouteilles, verres et plats en miettes, le vin répandu sur la nappe, la fin de tout. Rosario monta debout sur une chaise et de sa voix de stentor il cria :
– Vous n’avez pas honte de donner pareil spectacle… Avec un invité à votre table !
À cet énergique rappel à l’ordre, les furieux se figèrent comme pétrifiés. Ils cherchèrent leur invité : où était-il passé ? Où diable s’était-il fourré ?
Sur la chaise, le manteau ; sous la table, une paire de souliers. Le malheureux s’était sauvé pieds nus pour courir plus vite.
– En somme, tout a bien marché, constataient entre eux un moment plus tard les huit Borgianni, enfin calmés. – Tout a bien marché, sauf le dessert.
CARNET DE L’AUTEUR
BIOGRAPHIE
Vous désirez quelques notes biographiques sur moi et je me trouve extrêmement embarrassé pour vous les fournir et cela, mon cher ami, pour la simple raison que j’ai oublié de vivre, oublié au point de ne pouvoir rien dire, mais exactement rien sur ma vie, si ce n’est peut-être que je ne la vis pas, mais que je l’écris. De sorte que si vous voulez savoir quelque chose de moi, je pourrais vous répondre : « Attendez un peu, mon cher Crémieux, que je pose la question à mes personnages. Peut-être seront-ils en mesure de me donner à moi-même quelques informations à mon sujet. Mais il n’y a pas grand’chose à attendre d’eux ; ce sont presque tous des gens insociables qui n’ont eu que peu ou point à se louer de la vie. »
Je suis né – cela, je le sais – en Sicile, à Agrigente, le 28 juin 1867. J’ai quitté très tôt la Sicile, à dix-huit ans, pour venir à Rome, Mais un an après, je suis parti pour l’Allemagne où je suis resté deux ans et demi. J’ai pris mon doctorat de lettres et philosophie à l’Université de Bonn avec une thèse de dialectologie romane écrite en allemand. De Bonn je suis revenu à Rome, mais je n’en ai pas rapporté Heine, comme on se plaît à le dire, j’en ai rapporté Gœthe dont j’ai traduit les Élégies romaines.
Mais de tout cela il ne m’est rien resté. Je crois vraiment, dans la petite mesure où je puis valoir quelque chose, ne rien devoir à personne ; j’ai tout fait modestement tout seul. Et je n’ai pas eu de patron littéraire et j’ai beaucoup lutté – plus de six ans – pour me faire éditer, avec mes tiroirs déjà pleins de manuscrits.
Je n’ai pas connu Carducci, je ne connais pas d’Annunzio ; avec Verga, je n’ai eu de rapports que très tard, à l’occasion des fêtes organisées par Catane, sa ville natale, lors de ses quatre-vingts ans. Le Conseil municipal de Catane m’avait invité à prononcer le discours commémoratif, ce que je fis. J’exposai les raisons pour lesquelles la renommée de Verga avait été et devait nécessairement être étouffée par d’autres. En Italie, on aime mieux un style de mots qu’un style de choses. Et voilà pourquoi Dante est mort en exil, pourquoi Pétrarque a été couronné au Capitole.
Quant à moi, mon cher Crémieux, – si licet parva componere magnis – je ne sais pas bien pourquoi je n’ai pas encore été lapidé, mais je vous jure qu’il n’y a pas eu de ma faute.
J’ai enseigné vingt-quatre ans la stylistique à l’École de Magistère des jeunes filles de Rome, de ma trentième à ma cinquante-quatrième année. Depuis six ans, je n’enseigne plus et j’en bénis Dieu.
LUIGI PIRANDELLO.